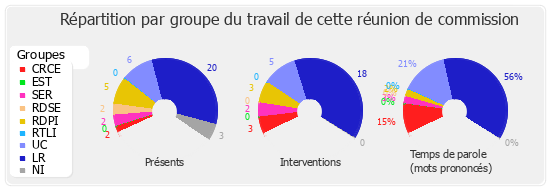Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation
Réunion du 23 novembre 2016 à 9h00
Sommaire
La réunion
La réunion est ouverte à 9 heures.
La commission examine tout d'abord le rapport de M. Philippe Dallier, rapporteur spécial, sur la mission « Égalité des territoires et logement ».
Le compte rendu de cette réunion sera publié ultérieurement.
La commission examine ensuite le rapport de MM. Gérard Longuet et Thierry Foucaud, rapporteurs spéciaux, sur la mission « Enseignement scolaire » (et articles 55 octies et 55 nonies).

La mission « Enseignement scolaire » sera dotée en 2017 de 70 milliards d'euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement, soit une augmentation de plus de 4 % de ses crédits, correspondant à 3 milliards d'euros, par rapport à 2016. Formidable !, direz-vous. Mon jugement est plus nuancé.
Parmi les points positifs, l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) versée aux enseignants du premier degré est revalorisée. Actuellement, les instituteurs ne perçoivent que 400 euros, les enseignants du secondaire, 1 200 euros. Le budget propose un alignement, qui bénéficiera à 300 000 enseignants. Cette mesure a un effet symbolique et matériel considérable ; j'y suis favorable.
Les moyens en faveur de l'enseignement technique agricole continuent de croître. Le programme 143 verra ses crédits augmenter de 2,5 % par rapport à 2016. Le coût unitaire de formation par élève devrait être contenu ; on optimise les heures d'enseignement, notamment en réduisant le nombre d'enseignements en très petits groupes qui coûtent cher.
Je salue l'effort entrepris en matière de scolarisation des élèves handicapés. En 2015-2016, ils étaient près de 280 000 à être scolarisés.
Enfin, le niveau de crédits alloués au fonds de soutien aux activités périscolaires, fixé à 373 millions d'euros, apparaît plus sincère que l'an dernier - il était alors de 319 millions d'euros.
Mais ce budget ne s'attaque pas au vrai problème, à savoir la diminution constante de la performance de l'enseignement français, selon les enquêtes nationales et internationales. Ainsi, seuls 82 % des élèves entrant en sixième maîtrisent la compétence 1 du socle commun (la maîtrise de la langue française) et 72 % la compétence 3 (principaux éléments de mathématiques et culture scientifique et technologique).
L'enquête PISA de 2012 montre que le fossé se creuse entre une élite scolaire dont le niveau continue de progresser et une part croissante d'élèves rencontrant des difficultés. Ces écarts s'expliquent notamment par le poids des déterminismes sociaux en France, pays de l'OCDE où le milieu d'origine a le plus d'influence sur les résultats scolaires.
Face à ce diagnostic, et conformément à ses engagements électoraux, le Gouvernement n'offre d'autre réponse que le dogme des effectifs.

En 2017, 11 802 postes seront créés. Si les schémas d'emplois pour 2016 et pour 2017 étaient respectés, l'objectif de 55 000 créations de postes sur le quinquennat serait atteint. Mais la statistique est la forme suprême du mensonge ! En réalité, ces créations de postes mélangent différentes catégories de personnels : les assistants d'éducation pour 2 150 postes, les accompagnants aux élèves en situation de handicap pour 4 251 postes, les assistants de vie scolaire individuels pour 195 postes. En outre, près de la moitié de ces créations de postes concerne des stagiaires, qui n'enseignent qu'à mi-temps. Par ailleurs, les postes ouverts ne sont pas nécessairement pourvus. Entre 2012 et 2015, 4 075 postes sont ainsi restés vacants, qui plus est dans les matières les plus fondamentales - français, mathématiques et langues vivantes étrangères. C'est inquiétant et souligne le déficit d'attractivité de la profession.
Le Gouvernement a choisi une politique du chiffre dangereuse.
D'une part, les niveaux attendus aux concours de recrutement risquent de diminuer. Certains jurys de CAPES indiquent avoir pris en compte le nombre de postes ouverts dans la fixation des seuils d'admission et d'admissibilité plutôt que les capacités des impétrants. D'autre part, pour combler les vacances, le ministère a recours, dans l'urgence, à un nombre important de contractuels, recrutés parfois par simple appel téléphonique.
Le rééquilibrage en faveur du premier degré demeure insuffisant. L'augmentation de 3 milliards d'euros des dépenses de personnel résulte dans une large mesure de la mise en oeuvre du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), général à la fonction publique. L'effort n'est donc pas ciblé sur le primaire.
Il n'y a pas non plus d'effort de maîtrise des dépenses non salariales. Ainsi, le coût du système d'information de gestion des ressources humaines Sirhen a explosé, passant d'une prévision de 80 millions d'euros à 323 millions d'euros. À l'heure actuelle, seuls 18 000 agents sont gérés par ce système d'information.
Le plan numérique à l'école se traduira par une dépense de 190 millions d'euros alors que les professionnels doutent de l'efficacité pédagogique de cette mesure. Les opérateurs de l'éducation nationale ne participent en rien à l'effort d'économie globale de fonctionnement. La subvention pour charges de service public des opérateurs augmentera de plus de 3 millions d'euros en 2017.
L'article 55 octies, introduit à l'Assemblée nationale, tire les conséquences de la pérennisation de la dérogation pour les communes qui organisent la semaine scolaire sur huit demi-journées, et concentrent toutes les activités périscolaires sur la neuvième demi-journée : elles pourront continuer à percevoir les aides du fonds de soutien aux activités périscolaires.
L'article 55 nonies prend en compte la suppression de l'échelonnement indiciaire spécifique dont bénéficiaient les enseignants bi-admissibles à l'agrégation, et qui leur rappelait le souvenir de leur double échec. Cette mesure adoptée par l'Assemblée nationale est bienvenue.
Parce que les 3 milliards d'euros mobilisés pour l'enseignement scolaire ne servent pas à opérer un rééquilibrage en faveur du primaire et, plus généralement, ne permettront pas de répondre aux vrais défis de l'éducation nationale, je vous propose de rejeter les crédits de la mission « Enseignement scolaire », même si je reconnais que sur certains points, il y a eu des gestes responsables.

Avec 70 milliards d'euros en autorisations d'engagement comme en crédits de paiement en 2017, la mission « Enseignement scolaire » constitue, de loin, le principal poste du budget de l'État. Cet effort, qui traduit le choix de notre pays de consacrer une part importante de ses dépenses publiques à la formation de sa jeunesse, constitue globalement un motif de satisfaction.
Le budget 2017 de la mission, en augmentation de près de 3 milliards d'euros en autorisations d'engagement comme en crédits de paiement, apporte certaines réponses. À la différence de Gérard Longuet, j'estime qu'il poursuit le chantier de reconstruction d'un vivier de personnels plus nombreux et mieux formés, après les coupes drastiques opérées sous le précédent Gouvernement : 80 000 postes avaient été supprimés en raison du non remplacement d'un départ sur deux à la retraite. Les effets de cette politique se font encore sentir, alors que les créations de postes annoncées concernent pour la moitié des enseignants stagiaires qui ne passent que la moitié de leur temps à enseigner, le reste étant consacré à la formation.
Il fallait augmenter les effectifs pour répondre à la hausse de la démographie scolaire - entre 2011 et 2015, le nombre d'élèves a augmenté de 7,7 % - mais aussi pour renforcer certains dispositifs en faveur des élèves rencontrant des difficultés particulières. Je pense aux réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté.
Les 11 802 créations de postes prévues étaient nécessaires mais seront insuffisantes pour répondre aux besoins de notre système éducatif.
Nous constatons tous, sur le terrain, la faiblesse du taux de remplacement des courtes absences, les difficultés des chefs d'établissement à mettre un enseignant devant chaque classe.
Le nombre élevé de postes vacants ou pourvus par des enseignants stagiaires contraint de nombreux établissements, souvent situés dans les académies les moins favorisées, à recourir à des enseignants contractuels qui ne sont généralement pas formés. Ce n'est pas acceptable, sachant que notre système scolaire figure parmi les plus inégalitaires de l'OCDE.
Cette situation doit s'analyser au regard de la faible attractivité du métier d'enseignant, liée à la dégradation des conditions de travail et de la condition matérielle des enseignants.
Un effort significatif en matière de rémunération a certes été entrepris ces dernières années avec la création de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves versée aux enseignants du premier degré depuis 2013 ou encore la revalorisation des indemnités pour les enseignants de l'éducation prioritaire. Cet effort sera amplifié en 2017.
Le premier degré demeure cependant le parent pauvre de notre système, alors que les difficultés scolaires se cristallisent à cette période. Les études nationales et internationales montrent que la proportion d'élèves ne maîtrisant pas les compétences fondamentales en fin de CE1, de l'ordre de 20 %, est à peu près la même en fin de troisième. L'effort de rééquilibrage en faveur du primaire mérite d'être poursuivi.
Plus généralement, la mise en oeuvre du protocole « Parcours professionnel, carrières et rémunérations » (PPCR), dont le coût pour 2017 est estimé, contribution au compte d'affectation spéciale (CAS) « Pensions » comprise, à plus de 780 millions d'euros, se traduira par des hausses de revenu significatives pour les enseignants. Ce geste, bien que trop tardif, était attendu.
Néanmoins, comme Gérard Longuet, je pense qu'un effort plus soutenu aurait pu être fait en faveur des enseignants les plus jeunes, alors que le protocole « Parcours professionnel, carrières et rémunérations » se concentre sur la fin de carrière.
Le plan en faveur de la jeunesse annoncé en avril 2016 par le Premier ministre, dont le coût est estimé à 72 millions d'euros en 2017, comporte différentes mesures qui vont dans le bon sens.
L'aide à la recherche du premier emploi (ARPE) destinée aux jeunes de moins de vingt-huit ans permettra d'assurer la transition entre l'école et la vie professionnelle. Je regrette cependant que l'Assemblée nationale ait voté un amendement du Gouvernement visant à diminuer de 47,5 millions d'euros les crédits consacrés à ces dispositifs.
L'an dernier, je m'étais inquiété de la réforme annoncée des bourses de lycée. Le dispositif qui nous est proposé devrait se traduire par une simplification des conditions d'attribution et par une augmentation de l'ordre de 10 % des montants, soit 25 millions d'euros supplémentaires. Attention toutefois à ce que les nouvelles modalités d'attribution ne se traduisent pas par une diminution du nombre de bénéficiaires.
Si le budget 2017 de la mission « Enseignement scolaire » présente certains points de satisfaction, il me semble manquer d'ambition face, par exemple, au déficit d'attractivité du métier d'enseignant, lié notamment à la faiblesse des salaires en début de carrière.
Par ailleurs, l'effort de 100 millions d'euros consacré à la formation continue en 2017 est un minimum compte tenu de la mise en oeuvre de la réforme du collège et de la volonté de développer l'usage du numérique dans les établissements. Aussi je vous proposerai de vous abstenir sur ce budget.
Je considère que les dérogations prévues par le décret « Hamon », puis le décret du 1er août 2016, tendent purement et simplement à revenir sur la réforme des rythmes scolaires. Néanmoins, la suppression de l'article 55 octies aurait pour conséquence de pénaliser financièrement les communes ayant mis en oeuvre ces dérogations. Aussi, je m'abstiendrai sur cet article.
S'agissant de l'article 55 nonies, il me semble relever du domaine règlementaire. Le ministère m'a cependant indiqué que l'inscription au niveau législatif permettrait d'en asseoir le fondement juridique. Je m'abstiendrai donc également sur cet article.

Merci à nos rapporteurs, dont le constat ressemble étrangement à celui de l'année dernière. Les choses n'ont pas beaucoup changé. Malheureusement, dans le classement PISA, la France recule. Plus inquiétant, la France est, en matière d'éducation, de plus en plus inégalitaire, avec d'un côté un enseignement élitiste et, de l'autre, une frange de la population scolaire écartée des savoirs fondamentaux. Je regrette que le Gouvernement ait mis fin à des expériences utiles, comme les internats d'excellence devenus « internats de la réussite » ou d'autres solutions à destination des élèves en très grande difficulté, en décrochage ou exclus du système scolaire.
Nous consacrons beaucoup de moyens à l'enseignement, mais notre système scolaire laisse de côté beaucoup d'élèves. La France consacre plutôt moins de moyens au primaire que les autres pays, au profit du secondaire, qui se disperse, propose beaucoup trop d'options. Pour ma part, dans mon lycée du centre de Paris, j'avais choisi l'option menuiserie...
Concentrons les moyens sur les savoirs fondamentaux, sur le primaire, où la France est en retrait, et essayons d'offrir des solutions adaptées aux élèves les plus en difficulté. L'augmentation des effectifs n'est pas la réponse et ne se traduit pas par une réduction des inégalités ; le classement PISA est à cet égard très inquiétant.

Ce budget connaît il est vrai une hausse importante : 3 milliards d'euros, c'est trois fois le budget de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Mais les deux tiers de cette augmentation sont dus aux augmentations de salaires et de pensions : seulement 1,2 milliard d'euros sont consacrés aux politiques éducatives, ce qui n'est pas négligeable, je l'admets.
Comme l'a dit Gérard Longuet, ce budget ne s'attaque pas à la vraie cause de l'échec scolaire, à savoir l'échec dans le premier segment du primaire - dernière année de maternelle, CP et CE1, ce « premier cycle » prévu par la loi « Jospin » mais jamais appliqué. L'avenir scolaire d'un jeune est quasiment scellé le jour de son septième anniversaire. Sur les 140 000 jeunes qui sortent sans diplôme ni qualification du système scolaire, un sur deux avait soit redoublé le CP, soit connu des difficultés au cours de ce premier cycle, dans un pays où le déterminisme social est total. Il faut donc faire porter les efforts sur ce cycle. Des crédits ont été redéployés mais ils demeurent largement insuffisants et l'on accorde trop peu de moyens aux pédagogies qui permettraient aux enseignants, pour peu qu'ils y soient formés, de tenter d'améliorer les choses.
En outre, le métier de professeur des écoles n'est pas assez attractif ; leur rémunération est inférieure de 20 % à celle des professeurs du secondaire ; sur une carrière, elle est inférieure de 30 % à celle de leurs homologues allemands. L'inflation budgétaire n'est manifestement pas la réponse, puisque le budget de l'enseignement scolaire a doublé ces vingt dernières années.
À son arrivée au ministère de l'éducation nationale, Jack Lang lancé un plan de création de 185 000 postes d'enseignant sur cinq ans. Or selon l'enquête PISA de 2010, qui portait sur les enfants qui avaient bénéficié de ces moyens supplémentaires, les résultats ne se sont pas améliorés. Il faut donc redéployer les moyens vers le primaire, former les enseignants à des pédagogies adaptées pour rattraper les jeunes décrocheurs.
C'est pourquoi je proposerai à la commission de la culture de proposer au Sénat de rejeter les crédits de la mission, sans nier les efforts qui ont été faits dans certains domaines, mais qui restent insuffisants.

La majorité sénatoriale a décidé qu'il n'était pas souhaitable de débattre du budget. Je le regrette d'autant plus que nos rapporteurs spéciaux ont bien travaillé - en particulier pour parler d'autre chose que du budget ! Le Gouvernement a encore mieux travaillé en présentant un budget que nous aurions eu plaisir à défendre. Peut-être est-ce pour cela, d'ailleurs, que vous avez décidé de ne pas en discuter. Nous ne sommes pas d'accord avec la proposition de notre rapporteur Gérard Longuet de rejeter les crédits. C'est un budget à mettre sous verre, quand on entend ce qui, peut-être, nous arrivera l'année prochaine.

Année après année, les moyens par élève sont plus élevés que la moyenne tandis que les résultats et le niveau sont inférieurs à la moyenne, de même que la rémunération des enseignants, et l'on ne consacre pas suffisamment de moyens au premier degré.
Le diagnostic est clair, mais rien ne change. Ce projet de budget ne marque aucune inflexion, et ne propose que de poursuivre les créations de postes.
J'aimerais disposer d'un tableau synthétique retraçant l'évolution du nombre d'élèves, du nombre de classes et du nombre d'enseignants.
La réforme des rythmes scolaires reste contestée et contestable. J'aimerais qu'on en dresse le bilan. L'État y consacre 373 millions d'euros, somme jugée plus sincère par nos rapporteurs. Mais si l'on ajoute le coût pour les collectivités locales, quel est son coût global en année pleine ? Il faudra qu'un prochain gouvernement revienne sur cette réforme.
Le groupe de l'UDI-UC s'associera à la proposition de Gérard Longuet de rejeter ce projet de budget.

Je suis toujours réservé sur l'emploi du terme de « performance » à propos du système éducatif.
Le déterminisme social est malheureusement une réalité ; la catégorie sociale de l'élève détermine son bagage culturel et lexical à l'entrée en CP, et même en maternelle. Un élève qui réussit en CP dispose de deux fois plus de mots qu'un élève en difficulté. La situation se dégrade. Si notre pays est encore capable de former l'élite dont il a besoin, il laisse malheureusement de côté beaucoup trop d'élèves.
Les inégalités sociales croissent dans notre pays. Comment vit un enfant dont la famille fréquente les Restaurants du coeur ? Quelle est son appétence pour l'éducation, pour l'école, quel est son projet, sa motivation, son avenir ? Sans tomber dans le misérabilisme, il faut avoir cela en tête.
Les écarts s'accroissent au fil de la scolarité, jusqu'à doubler. Les moyens humains ne régleront certes pas tout et l'école ne pourra pas résorber seule ces inégalités - il faut en parallèle poser la question du chômage, des inégalités de revenus, etc. -, mais ils sont quand même essentiels : une classe de vingt-quatre élèves autonomes ou une classe de quinze élèves en difficulté, ce n'est pas la même chose et la réussite n'est pas la même au bout.

On note une progression importante des effectifs d'élèves en situation de handicap : plus 53 415 élèves, soit 23 %. Faut-il y voir un meilleur accueil et une meilleure intégration des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire ou bien une augmentation du nombre de personnes en situation de handicap ? Dans ce cas, quelle est la nature du handicap ?

Il s'agit là du premier budget de la nation - plus de 70 milliards d'euros. Les moyens humains sont indispensables, mais, en dépit du dévouement des enseignants, les difficultés rencontrées sont nombreuses et cruelles.
Entre 1980 et 2015, les dépenses engagées par l'État, les collectivités territoriales et les ménages sont passées de 66 milliards d'euros à 130 milliards d'euros. Comment se répartissent les personnels entre l'administration centrale et les classes d'enseignement ? Les programmes sont de plus en plus denses alors que les fondamentaux - l'écriture, la lecture, le calcul - sont trop souvent laissés de côté. C'est réellement sur le premier degré que devraient porter les efforts.

N'en déplaise à Gérard Longuet, l'éducation prioritaire a démontré que le travail en petits groupes, particulièrement dans le primaire, avait bien souvent permis à des enfants d'entrer au collège mieux armés. C'est un point sur lequel il ne faut pas céder.
L'enseignement agricole a également su, avec des petits groupes, aider des élèves à rattraper leurs difficultés et obtenir de très bons résultats. Malheureusement, ces classes spécifiques n'ont pas été maintenues.
Par ailleurs, je sais que le ministère de l'éducation a engagé un travail d'audit et d'analyse des nouveaux rythmes scolaires. Ma ville a été partie prenante à ce travail d'appréciation. A-t-on eu quelques échos ?

Je partage l'analyse du rapporteur général : le qualitatif et l'orientation vers des procédures de succès sont absentes de ce projet de budget. C'est pourquoi nous considérons que les moyens ne sont pas mobilisés en faveur de ce qui est le plus important : l'enseignement primaire et le soutien aux pédagogies qui marchent.
Pour répondre à Marie-France Beaufils, le travail en petits groupes permet incontestablement de remettre dans le « droit chemin » des élèves qui s'en éloigneraient. Ce que nous reprochons au système, c'est l'absence de détection en amont : on ne prête pas assez d'attention aux difficultés constatées ab initio chez les très jeunes enfants dont le vocabulaire est trop limité - on en revient au déterminisme social - parce qu'ils sont issus d'un milieu où le vocabulaire est insuffisamment étendu, différencié, adapté. Si nous portions un regard plus attentif sur le tout début du primaire, nous éviterions les sessions de rattrapage.
Le coût budgétaire des petits groupes pose essentiellement problème dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement professionnel. En tant qu'élus locaux, nous sommes comptables : nous voulons toujours maintenir les établissements et récusons des regroupements qui seraient pertinents. Je parle d'expérience, élu d'une région de tradition industrielle où les lycées professionnels ont repris les formations d'organismes créés grâce à des initiatives privées patronales, consulaires ou paternalistes. Chaque établissement cultive sa singularité ; il s'ensuit une grande dispersion des moyens avec un ratio enseignant par élève très faibles. Cela coûte très cher et n'a guère d'utilité.
Quand il s'agit de rattraper un retard en lecture, le travail en petits groupes peut être pertinent, mais on évitera d'en arriver là si l'on décèle les difficultés en amont.
La commission a demandé à votre rapporteur spécial de travailler sur les heures supplémentaires dans le second degré. Ce travail, qui sera restitué début décembre, sera l'occasion d'aborder la question de la durée du travail de l'enseignant, problème à peu près sans solution statistique car nous ne sommes pas dans une logique comptable comparable aux minutes de production dans la confection ou dans l'emboutissage.
Je ne réponds pas à Jean-Claude Carle, dont je partage entièrement le point de vue.
À Maurice Vincent, je répondrai que nous aurons un débat non pas sur le budget, mais sur les heures supplémentaires, lors de la restitution du travail que j'ai mené le 7 décembre. Quand un budget est consacré essentiellement aux salaires, on peut demander si le temps de travail est utilisé pertinemment. Vous avez raison de souligner la nécessité d'un effort quantitatif et nous avons raison de dire que cet effort, s'il n'est pas doublé une réflexion qualitative sur l'utilisation de cette masse d'heures considérable, risque de nous faire perdre un peu d'argent.
Pour répondre à la remarque de Vincent Delahaye, une synthèse des statistiques sur les élèves, les classes et les enseignants manque en effet, il s'agit de l'une des recommandations que je formule dans mon rapport sur les heures supplémentaires.
L'association des maires de France évalue le coût global du périscolaire à un montant compris entre un milliard d'euros et 1,2 milliard d'euros ; la contribution de l'État représente donc un petit tiers du coût total. Le problème, c'est le secondaire, notamment son deuxième cycle : les moyens sont trop importants par rapport aux performances.
Éric Bocquet a malheureusement raison d'évoquer le déterminisme social et la reproduction des inégalités sociales. L'action des collectivités locales pour essayer d'impliquer les élus, les associations et les parents devrait constituer une réponse. Si l'on considère l'éducation nationale comme un producteur et les parents comme de simples consommateurs, on va l'échec. Je constate, y compris dans des quartiers difficiles, le développement de l'enseignement privé sous contrat. Cela résulte de l'engagement des parents. Toute action d'enseignement qui ne mobilise pas les parents, qui ne les oblige pas à s'intéresser à l'éducation de leurs enfants est condamnée à perpétuer le déterminisme social. C'est aussi l'occasion de mettre les parents à niveau.
Les chiffres évoqués par Dominique de Legge traduisent une meilleure compréhension des élèves en situation de handicap. Le handicap est-il, comme l'horizon, une ligne qui recule à mesure qu'on avance ? Je pense en effet que le handicap « traditionnel » s'efface au profit d'un handicap psychologique plus subtil mais réel. Où situer la frontière entre le handicap structurel et le handicap déterminé par l'environnement ? On s'aperçoit que les inadaptations traditionnelles diminuent en nombre grâce aux progrès de la médecine, mais qu'en revanche les inadaptations à la vie collective s'accroissent, pour des raisons plus sociales que somatiques.
Pour répondre à Marc Laménie, l'enseignement est supporté par l'État mais aussi par les collectivités locales et par les familles. Les défaillances de l'un sont-elles compensées par les autres ? Non. Il faudrait un partage des responsabilités et des engagements. Je constate que les ménages dépensent plus et n'hésitent pas, quitte à « se saigner », à s'adresser à l'enseignement hors contrat, dans le secondaire comme dans le supérieur : c'est une réponse, pas toujours pertinente, à une inquiétude. Pour nous tous qui avons la passion du service public et de la réussite publique, c'est un peu décevant. Bien que libéral, je n'ai pas envie pour autant de « marchandiser » complètement l'enseignement. Il suffit d'ailleurs d'observer les publicités dans les transports en commun pour les services de soutien scolaire.

Il me semble que les difficultés rencontrées par notre système scolaire résultent de choix politiques.
Nous avons rencontré à la fois les organisations enseignantes, les parents d'élèves, qui ont évoqué ces problèmes et proposé des solutions. Peut-être faudrait-il faire une synthèse de toutes ces propositions pour introduire de l'efficacité dans notre système scolaire.
On croit détenir la vérité ; or je crois plutôt que c'est la vérité qui nous tient.
S'agissant des rythmes scolaires, peut-être faut-il aborder les choses autrement pour satisfaire les aspirations des Françaises et des Français. Parents d'élèves, organisations d'enseignants ou personnels de l'éducation nationale, le premier reproche qu'ils peuvent nous faire, c'est de ne pas les écouter.
À l'issue de ce débat, la commission décide de proposer au Sénat de ne pas adopter les crédits de la mission « Enseignement scolaire ».
La commission décide de proposer au Sénat l'adoption, sans modification, des articles 55 octies et 55 nonies.
Puis la commission examine le rapport de MM. Alain Houpert et Yannick Botrel, rapporteurs spéciaux, sur la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » et sur le compte d'affectation spéciale « Développement agricole et rural ».

Nous examinons le dernier budget agricole de la législature, ou plutôt le budget agricole de la dernière année de la législature. Le collectif de fin d'année représente à lui seul un petit budget agricole puisqu'il demande l'ouverture de 889 millions d'euros d'autorisations d'engagement nouvelles, soit 32 % des autorisations d'engagement ouvertes en loi de finances initiale pour 2016. C'est dire si celle-ci était sincère !
Le projet que nous examinons ne paraît pas l'être davantage puisqu'il est marqué par une série de sous-dotations. Je veux parler des risques de refus d'apurement, qui, quant aux refus passés, ne sont toujours pas complètement réglés quand d'autres risques, estimés à plus de 600 millions d'euros, ne sont nullement provisionnés. On pourrait aussi évoquer les suites des contentieux avec les vétérinaires en mission, qui ne sont budgétées que partiellement, l'impasse totale sur les conséquences budgétaires de certaines situations, comme celles que connaissent certains laboratoires d'analyses, ou des hypothèses de budgétisation favorables, par exemple sur le cours du bois, qui permet de minorer les besoins de financement de l'Office national des forêts.
La programmation budgétaire assure-t-elle une traduction suffisante des annonces que le Gouvernement a multipliées ces deux dernières années ? Force est de regretter que les plans successifs ne font l'objet d'aucun suivi circonstancié dans les documents budgétaires, si bien qu'il est impossible d'en mesurer la portée, tant pour les finances publiques que pour les exploitants. Cela appelle des progrès de transparence, d'autant que ces plans recourent à des mesures, souvent indirectes, susceptibles d'applications très diverses selon la mobilisation des services.
Bref, on voit clair sur les sous-budgétisations, mais pas sur la budgétisation des mesures d'urgence qui ont rythmé la vie agricole de ces deux dernières années. Plus généralement, les mécanismes d'amortissement des crises doivent être moins discrétionnaires et d'application plus simple. Des propositions utiles ont été formulées sur ce point, en particulier la proposition de loi de Jean-Claude Lenoir, qui aurait mérité un autre sort à l'Assemblée nationale. Nous devrons revenir sur ce dossier. Le collectif chiffre à 193,3 millions d'euros les autorisations d'engagement rattachables au plan annoncé le 4 octobre dernier. En réalité, cette imputation est invérifiable. Surtout, se pose la question de l'adéquation entre les transferts prévus et les pertes de revenu prévisibles.
L'agriculture française subit des crises très graves : les végétaux, la viticulture sont touchés à leur tour, alors que la crise laitière persiste. La production agricole, déjà en baisse en 2015, devrait chuter en 2016 avec la combinaison de la baisse des prix et de l'effondrement des rendements. Une baisse de 1 % des revenus, c'est 140 millions d'euros en moins. Or la variation risque d'être bien supérieure. Une baisse de 5 % de la valeur de la production, c'est 700 millions de pertes de revenu. La baisse pourrait être de 30 % dans certains cas. Cela mérite une plus grande clarté budgétaire mais aussi opérationnelle et davantage de moyens que ceux retracés ici.
Certains choix de budgétisation défient l'entendement. Alors qu'on ouvre près de 200 millions d'euros en collectif au titre de la gestion des crises et des aléas de production, les crédits figurant sous ce chapitre s'élèvent à 5,5 millions d'euros. Autant dire que la programmation budgétaire pour 2017 fait le pari, pour le moins audacieux, de l'absence de crises.
Depuis 2010, nous avons perdu 10 % de nos exploitations. L'emploi agricole baisse, l'excédent commercial fond. Les crises conjoncturelles frappent une agriculture structurellement fragilisée et qui n'investit plus. En volume, l'investissement agricole est en 2015 au même niveau qu'en 1980 ! Au cours de cette période, les prix de l'investissement ont presque triplé : les exploitants n'ont pas les moyens de suivre. Cette crise de l'investissement fait à l'évidence partie du défi plus large de redresser l'agriculture française.
Certains ne manqueront pas de voir dans la progression des crédits du budget 2017 une contribution en ce sens. De fait, les masses budgétaires de la mission s'accroissent de 24,9 % en crédits de paiement, et même de 40,3 % pour le programme 149 qui finance les actions structurelles. Évolution largement optique, qui découle de la budgétisation, pour 480 millions d'euros, d'une compensation au titre de la réduction du taux de cotisation sociale d'assurance maladie - une mesure certes utile, mais qui s'applique depuis 2016. Bref, cela ne change pas la situation des exploitants.
Au demeurant, si l'on intègre les dotations demandées dans le collectif, ce n'est plus la hausse affichée qu'il faut retenir, mais, au contraire, une baisse des dotations, illustration de la relativité des communications budgétaires.
Pour redresser l'agriculture, il faut assurer un revenu rémunérateur aux agriculteurs. La nouvelle politique agricole commune (PAC) présente des failles de ce point de vue. Compte tenu de notre contribution au budget européen, le compromis agricole aurait pu mieux tenir compte de l'exposition aux crises d'une agriculture très diversifiée, mais aussi, plus largement, de la nécessité de défendre l'Europe agricole dans un contexte de concurrence internationale croissante. Au demeurant, la PAC n'est pas à l'abri des pratiques peu loyales de certains de nos partenaires en matière de coût du travail et de fiscalité.
La France, toujours présentée comme la première bénéficiaire de la PAC, n'arrive en réalité qu'au onzième rang des pays de l'Union quand on rapporte les versements au nombre d'habitants. Preuve que notre agriculture est remarquablement productive, mais aussi que nous pourrions négocier des enveloppes plus élevées.
Encore faudrait-il que nous en profitions réellement. J'ai parlé des refus d'apurement qui amputent nos retours en provenance du budget européen. Le refus de l'Union européenne de nous déléguer nos enveloppes dans le cadre de la nouvelle PAC nous oblige par surcroît à recourir à un système d'apports de trésorerie remboursables qui ne recueille pas les suffrages de nos agriculteurs. Le nombre de demandes déposées entre la précédente et l'actuelle campagne a chuté d'un tiers, de près de 100 000 dossiers, ce qui témoigne de l'insatisfaction des bénéficiaires. Surtout, il est temps que les enveloppes européennes soient réellement accessibles !
Quelques observations pour conclure.
Les moyens de notre politique agricole sont de plus en plus sollicités par la récurrence des crises et par la perte de compétitivité. La mission devient une sorte de second volet du premier pilier de la PAC, au risque de délaisser le développement rural qui est pourtant son objet même. Le report de la montée en charge du paiement distributif, que le Gouvernement avait présenté comme un choix fort de gestion de l'enveloppe européenne de la France agricole au service d'une agriculture diversifiée, est de ce point de vue emblématique.
L'inclusion de l'indemnité compensatrice de handicap naturel (ICHN) dans la base du régime du micro-bénéfice agricole se traduit par une surcharge fiscale, problème qu'il faudra surmonter car il n'entrait pas dans nos intentions qu'il en aille ainsi quand nous avons accepté, à la va-vite, le « micro-BA » dans le collectif de fin d'année 2015. De même, il nous faudra tirer les conséquences des difficultés que suscitent une série de petites taxes, dont la taxe sur les farines. Nous allons peut-être revenir à 1775, quand Turgot a provoqué le premier mouvement social contre le libéralisme ! L'Assemblée nationale a supprimé cette taxe l'an dernier sans proposer de solution pour financer les 67 millions d'euros qui devaient aller à la Mutualité sociale agricole.
Enfin, nous devrons consolider les instruments de la politique de sécurité sanitaire et développer le volet international de notre action.
Le budget agricole se caractérise par un empilement indigeste de mesures d'urgence, sans solutions structurelles. Les propositions, pourtant, ne manquaient pas : je vous renvoie à la proposition de loi de Jean-Claude Lenoir. Plutôt que des micromesures, il aurait fallu une réponse globale transpartisane, à la hauteur de la situation. L'éleveur et l'agriculteur sont les derniers remparts à la friche !
Je vous propose de rejeter les crédits de cette mission.
Quant à elle, la programmation financière du compte d'affectation spéciale (CAS) « Développement agricole et rural » laisse perplexe, avec des prévisions de recettes très surévaluées et des mesures d'annulation de crédits en gestion récurrentes pour des montants élevés. Des programmes sont en cours et une évaluation de la contribution des dépenses du CAS aux innovations dans l'agriculture sera présentée dans les mois à venir. Dès lors, je vous propose d'adopter ses crédits.
Je conclurai en évoquant l'interdiction du diméthoate, dont on pulvérise les cerises notamment. Nous avons tous voulu donner à notre agriculture une orientation bio. Les résultats sont paradoxaux avec, d'un côté, l'augmentation des surfaces agricoles en bio mais, de l'autre, le plan Écophyto qui n'obtient pas suffisamment de résultats.

Je partage nombre des analyses de mon corapporteur, mais je n'en tire pas toujours les mêmes conclusions. Pour ma part, j'invite nos collègues à adopter les crédits de cette mission.
Il est exact que la budgétisation de la réduction de la cotisation d'assurance maladie des exploitants agricoles explique pour une bonne part l'évolution des crédits. Elle équivaut en moyenne à près de 1 000 euros transférés aux exploitants, pour une dépense totale de 480 millions d'euros. Il est également exact qu'elle ne constitue pas une mesure réellement nouvelle puisqu'elle s'applique depuis le début de 2016. Il s'agit d'une mesure pérenne de baisse des charges qui améliore le revenu net agricole et la compétitivité de nos exploitations. Elle répond à une revendication ancienne de la profession agricole.
Malgré l'adoption successive de plusieurs plans d'urgence, qui démontrent la grande attention du Gouvernement pour un monde agricole fortement éprouvé par les dérèglements de marché et par les aléas climatiques, les interventions plus classiques du budget ont été préservées et même amplifiées.
Les aides au titre de l'ICHN, des mesures agroenvironnementales et climatiques et des filières d'outre-mer sont revalorisées.
Quant aux difficultés d'exécution du budget européen, elles ont des prolongements potentiellement défavorables pour la France. Les refus d'apurement réduisent considérablement les « retours » dont notre pays aurait dû bénéficier.
Je remarque d'abord que cette situation est largement un héritage du passé, puisque la période considérée va de 2008 à 2012. J'observe aussi que le Gouvernement a pris des mesures vigoureuses : un plan complet a été mis en oeuvre, avec une indispensable refonte du registre parcellaire. Par ailleurs, nous devons être attentifs aux opérations de cartographie des zones simples défavorisées qui conditionnent l'éligibilité à certaines aides. Interrogé au Sénat, le ministre a fait part de toute sa vigilance et de celle de ses services.
Enfin, il semble que la France soit un des pays les moins pénalisés en proportion au titre des apurements. Comme son enveloppe est large, de l'ordre de 9 milliards d'euros, le total apparaît plus élevé que pour d'autres. Cependant, les entreprises agricoles concurrentes des nôtres bénéficient beaucoup plus que les nôtres de paiements indus, ce qui constitue pour elles un avantage concurrentiel peu loyal. Il faudra être vigilant, d'autant que le secteur agricole peut être pénalisé par des pratiques concurrentielles déloyales comme le recours aux travailleurs détachés dans certaines industries agroalimentaires.
Le retard pris dans le versement des aides directes au titre de la PAC a plusieurs causes. Le système d'identification des parcelles agricoles a dû être refondu à la suite de l'apurement de la période 2008-2012. Autre cause, le passage à la nouvelle PAC et le passage des droits à paiement unique aux droits à paiement de base, qui a suscité un certain nombre de difficultés dans les directions départementales.
L'Agence de services et de paiement (ASP) a nettement sous-estimé le développement informatique à mettre en oeuvre afin de traiter les dossiers PAC : clairement, les retards constatés dans le versement des droits sont largement imputables à cette erreur. Je sais que cette question fait l'objet de toute la vigilance du ministère et qu'un effort budgétaire est prévu dans le collectif de fin d'année.
Dans ces conditions, la mise en place des aides de trésorerie remboursable s'est avérée le moyen le plus efficace de soutenir les exploitations, même si le système a pu présenter des insuffisances, en particulier en ce qui concerne les mesures agroenvironnementales et climatiques ou les aides versées aux producteurs bio.
Par ailleurs, il ne me parait pas utile d'inscrire au budget des crédits représentant des risques sanitaires dont le montant n'est par définition pas connu. Cela n'a du reste jamais été fait. Comment alors intenter au Gouvernement un procès en insincérité ?
Sur la forêt, les crédits proposés sont plus stables. Cela témoigne plutôt d'un certain redressement et doit être apprécié en fonction des économies liées à l'achèvement des travaux consécutifs à la tempête Klaus. Les économies rendues possibles par les travaux déjà réalisés sont recyclées pour soutenir l'investissement forestier et réhabiliter les terrains montagneux.
L'Office national des forêts se porte mieux. Son nouveau contrat d'objectifs et de performances, négocié avec l'État et les communes forestières, préserve ses moyens tout en lui fixant des objectifs de mobilisation de la ressource plus élevés qu'on n'aurait pu le craindre.
Reste que l'économie forestière est vulnérable au cours du bois, variable clef du budget. Nous devrons reboiser si nous voulons concilier l'ensemble des usages, dans le contexte de l'application de la loi sur la transition énergétique et de nos engagements internationaux. Le fonds stratégique devra sans doute trouver des moyens supplémentaires. Nous devons aussi encourager l'ONF à mener à terme ses réformes internes, qui sont en bonne voie.
Nous vous rendrons bientôt compte de notre mission de contrôle sur la sécurité sanitaire des aliments, composante capitale dans ses aspects sanitaire, économique et budgétaire. Le collectif demande ainsi 158 millions d'euros au titre de la compensation des pertes de revenu liées à la crise de l'influenza aviaire. Le suivi de terrain peut être défaillant dans certaines zones compte tenu du manque de vétérinaires libéraux, qui font le lien avec les administrations de l'État.
Les sujets d'inquiétudes ne manquent pas, liées à la fièvre catarrhale ovine ou à la résurgence de certaines maladies comme la tuberculose bovine. Si nous devons solder l'affaire des vétérinaires en mission et de leurs droits à retraite, le Gouvernement n'est pas revenu sur son engagement de créer 180 postes d'inspection dans les abattoirs. Inutile de vous dire combien ces moyens sont nécessaires. L'engagement est tenu et en trois ans, les 180 postes auront été créés.
Je conclus en vous recommandant l'adoption des crédits de la mission et du compte d'affectation spéciale pour 2017. Dans un contexte éprouvant pour les filières et pour les exploitations, alors qu'il a fallu faire face à des dépenses exceptionnelles pour répondre à des exigences qui avaient été peut-être négligées dans le passé, le budget 2017 témoigne du sérieux avec lequel le Gouvernement a réagi aux graves difficultés des producteurs et de la continuité de son action au service d'un développement rural durable.

Je suis sensible à la mention des problèmes que rencontre Osiris, source de difficultés sur le terrain pour les agriculteurs qui ne reçoivent pas les fonds attendus.
La Cour des comptes a regretté, dans sa dernière note d'exécution budgétaire, que beaucoup de dépenses fiscales relatives à la politique forestière n'aient pas été renseignées. J'ai consulté le bleu : six dépenses fiscales relatives aux politiques forestières ne le sont toujours pas. Ce n'est pas admissible : ces dispositifs ont été votés par le Parlement pour soutenir la filière forêt or nous ne savons rien de leur efficacité et des progrès qu'ils sont censés favoriser. On se moque du Parlement !
Nous examinerons dans quelques jours l'acte II de la loi Montagne. Encore faut-il que cela se traduise en actes. Je veux alerter sur la grande misère du service de restauration des terrains en montagne, la RTM. Le réchauffement climatique accroît les risques d'érosion, les problèmes hydrauliques, or dans le même temps, on réduit les effectifs du service de la RTM, qui a l'expertise sur les dangers et les risques. Comment entretient-on 20 000 ouvrages avec 9,686 millions d'euros en crédits de paiement ? Cela fait 484 euros par ouvrage. Rapporté à la superficie, cela fait 22 euros par hectare. Ces sites sont sensibles et dangereux : c'est pourquoi, sous le Second Empire, des acquisitions foncières ont été réalisées dans les Alpes et les Pyrénées et le service de la RTM créé. Notre incapacité à entretenir ces ouvrages pose un problème de sécurité et d'environnement.

Il faudra faire la lumière sur ce logiciel Osiris, qui a suscité semble-t-il des retards de paiement des apports de trésorerie remboursables : on compte 100 000 dossiers de moins. Preuve que le système des ATR ne fonctionne pas.

Vous connaissez bien, monsieur Bouvard, les aspects fiscaux de la forêt en montagne. Il est vrai que la forêt est obscure ; je souhaite que, prochainement, elle soit traversée de rais de soleil...

S'agissant de l'ASP, des crédits sont prévus au budget de l'année 2017. Plus qu'un problème informatique, il y a eu une erreur d'appréciation quant à l'importance des moyens qu'il aurait fallu déployer.
J'ai également consulté le bleu budgétaire, et ne peux que souscrire à votre constat. Toujours est-il que les dépenses fiscales les plus significatives sont renseignées ; les autres n'ont sans doute pas la même importance qu'un certain nombre d'exonérations sur les droits de mutation ou sur les investissements en forêt, qui pèsent davantage dans la gestion forestière.
Il y a un véritable conflit d'intérêts entre les propriétaires forestiers et les scieries. Depuis des années, il est demandé de restreindre les exportations de bois, en particulier à destination de la Chine. Un certain nombre de mesures environnementales ont été prises, avec l'exigence de traitement des grumes.
Pour un certain nombre d'essences, les cours sont bas, même s'ils fluctuent. On peut espérer que les résineux verront leur cours remonter, entraînés par le redémarrage de l'activité dans le bâtiment. Le chêne, essentiellement destiné à la tonnellerie et à l'exportation, se vend bien. Les autres essences, moins bien. Les propriétaires forestiers s'insurgent donc contre la limitation des exportations, qui étaient pour eux un moyen de soutenir les cours.
Quant au service de la RTM, je prends acte de vos propos. Cette question sera davantage prise en considération. En tout cas, je partage les préoccupations d'un parlementaire élu d'une région de montagne qui sait parfaitement de quoi il parle.

Je remercie les deux rapporteurs spéciaux pour leur rapport qui permet de disposer d'une vision très complète des interventions publiques au service de l'agriculture que nous devons soutenir.
À l'issue de ce débat, la commission décide de proposer au Sénat de ne pas adopter les crédits de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ».
Elle décide de proposer au Sénat d'adopter, sans modification, les crédits du compte d'affectation spéciale « Développement agricole et rural ».
La commission examine le rapport de M. Hervé Marseille, rapporteur spécial, sur la mission « Administration générale et territoriale de l'État » (et articles 52 bis et 52 ter).

Le budget de l'administration générale et territoriale de l'État pour 2017 est un budget de circonstances, d'abord parce que la programmation budgétaire pour 2017 porte la trace de modifications importantes du périmètre budgétaire, avec le rattachement pour plus de 80 millions d'euros du fonds interministériel de prévention de la délinquance, mais aussi en raison du cycle électoral à venir.
Le projet de budget, qui voit ses dotations croître de plus de 15 % pour un supplément de crédits de 386 millions d'euros, ne s'alourdit plus que de l'ordre de 3,3 % à 4,3 %, selon la conception qu'on choisit du périmètre constant, lorsqu'on neutralise ces éléments ponctuels.
Cette progression reste élevée et conduit à dépasser les plafonds de la loi de programmation des finances publiques. La hausse des charges résulte essentiellement des mesures de revalorisation des rémunérations. C'est l'effet indice de la grille de la fonction publique, avec la revalorisation du point et la mise en oeuvre du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR). Par ailleurs, des mesures spéciales sont prévues pour accompagner l'application du « Plan préfectures nouvelle génération », le PPNG.
Le budget de la mission « Administration générale et territoriale de l'État » pour 2017 nous laisse de ce point de vue au milieu du gué. Il enregistre le moins difficile du PPNG et laisse entiers les problèmes les plus délicats. Le PPNG est, en réalité, un plan de restructuration du réseau préfectoral. Il s'agit de délester les préfectures des missions d'accueil au guichet pour renforcer le contrôle de légalité et la mission de conseil aux collectivités territoriales, la coordination stratégique des administrations locales de l'État et les prestations d'ingénierie au service des collectivités.
Le budget programme les suppressions d'emplois de guichet, mais ne finance pas clairement le renforcement des ambitions annoncées.
La rationalisation de la fonction de délivrance des titres sécurisés, au coeur du PPNG, pose question. Les seuls guichets qui demeureront dans le réseau préfectoral seront ceux qui concernent les accueils des étrangers, dans le cadre de la délivrance des titres de séjour ou des demandes d'asile. Cela peut susciter des crispations d'autant que le ministère compte amplifier la dématérialisation du circuit des titres.
Pour la carte nationale d'identité comme pour les permis de conduire ou les certificats d'immatriculation, quelques dizaines de centres d'expertise et de ressources (CERT) traiteront les dossiers adressés par quelque deux mille mairies sélectionnées, comme pour le passeport biométrique, pour procéder au recueil des données.
Dans cette affaire, l'État donne le sentiment de s'éloigner du local. Il faudra mettre à niveau les compensations qu'appellent les suppléments de charges devant peser sur les communes d'accueil des stations de recueil de données.
Enfin, les problèmes de sécurité informatique sont cruciaux et des besoins de renforcement déjà identifiés.
Des financements croisés marquent l'équilibre financier de l'Agence nationale des titres sécurisés, le passeport biométrique finançant d'autres productions. Ce n'est pas satisfaisant. Les dépenses paraissent mieux maîtrisées, mais le monopole de l'Imprimerie nationale doit être pris en considération.
L'autre dimension du PPNG doit être le retour de l'État dans les territoires par un recentrage du réseau préfectoral sur les missions stratégiques. Le budget n'en porte pas la trace, sinon par les emplois créés pour répondre à la crise des migrants et aux demandes d'asile ce qui n'est pas négligeable. Pour le reste, ni le contrôle de légalité, ni le conseil aux collectivités territoriales, ni l'ingénierie territoriale ne sortent renforcés du budget. Les modifications apportées à l'administration décentralisée de l'État appelleront d'autres prolongements. Quant à la restructuration de la présence infradépartementale de l'État, elle demeure marquée par l'ouverture de maisons de l'État et de maisons d'accès du public aux services publics, sans que l'impact sur le réseau des sous-préfectures soit clairement exposé. Il est intéressant de mieux cartographier les sous-préfectures en tenant compte des intercommunalités nouvelles, mais n'oublions pas les territoires ruraux.
Élément majeur de ce budget, les élections prévues en 2017. La programmation tient compte du projet de dématérialiser la propagande électorale pour les élections présidentielles et législatives - objet d'un article rattaché qui a été supprimé par l'Assemblée nationale. La décision relève traditionnellement de l'assemblée concernée. Il est d'autant plus sage de stabiliser les conditions de la propagande électorale que la réception des documents de propagande sous forme papier provoque un effet-signal qui joue pour la participation électorale. Je vous proposerai donc de confirmer le vote de l'Assemblée nationale.
Les circonstances historiques ont laissé au règlement le soin de préciser les règles d'organisation de la propagande électorale pour l'élection présidentielle, curiosité regrettable. Les dotations aux formations politiques sont maintenues, comme l'an dernier. On constate une lente érosion de leur valeur réelle.
Enfin, je souhaite que les frais élevés que supporte le budget au titre de l'administration centrale du ministère fassent l'objet d'audits à la mesure de leur volume, que les actifs immobiliers estimés à plus de 2,5 milliards d'euros soient gérés plus activement de même que les locations du ministère.
Pour finir, les dépenses de contentieux, qui résultent de choix d'action discutables, doivent être plus sincèrement évaluées en loi de finances initiale.
Le rapport que je vous présente ne manque pas de relever quelques points de perplexité mais il faut aussi tenir compte d'autres considérations. Un certain nombre de conditions sont réunies pour améliorer les services rendus aux collectivités territoriales par le réseau préfectoral. À la prochaine législature d'aller plus loin. Nous pouvons aboutir à une solution satisfaisante pour ménager les mairies qui désirent continuer à jouer un rôle de proximité dans la délivrance des titres sécurisés.
Par ailleurs, il faut tenir compte des circonstances. Les services sont fortement sollicités du fait de la crise migratoire et de l'état d'urgence.
Enfin, le Gouvernement a entendu le Parlement en renonçant à des projets quelque peu précipités de réorganisation de la propagande électorale. Il va, c'est à noter, au-delà des conséquences budgétaires du vote de l'Assemblée nationale, qui ne concernait que les élections législatives, en l'étendant à l'élection présidentielle.
Dans ces conditions, je vous recommande l'adoption des crédits de la mission pour 2017.

Merci d'avoir évoqué un sujet qui préoccupe les élus locaux, à savoir le déploiement de l'administration préfectorale, entre changement et continuité.
Je connais relativement bien le territoire, étant d'ailleurs moi-même issu du corps préfectoral, et je peux vous dire que la réduction de nombre des préfectures de région n'est pas sans inconvénient. Je pense au Grand Est : le préfet de région réside à Strasbourg, ville qui a beaucoup de charme et de rayonnement, mais qui est inaccessible pour huit des dix départements de la région. Difficile, pour les responsables territoriaux, d'établir des relations avec l'État quand la préfecture de région est distante de plus de 200 kilomètres. Cela s'apparente à une véritable démission de l'État. Les élus peuvent devoir gérer une crise industrielle ponctuelle ou un conflit autour d'un équipement majeur ; à cet égard, la diminution du nombre des préfectures de région, l'incompréhension que suscite l'organisation territoriale des services extérieurs de l'État, mettent à mal le fonctionnement du système. Ajoutez l'instabilité chronique du corps préfectoral, et l'on peut considérer que la présence de l'État sur le territoire au niveau stratégique n'est pas satisfaisante, quelle que soit la bonne volonté des préfets de région.
Au niveau infradépartemental, il faut distinguer l'accueil du public et la présence de l'État. On peut comprendre que la numérisation rende moins indispensable la présence physique de fonctionnaires. Le numérique, s'il se double d'un déploiement de la fibre optique, apporte une réponse satisfaisante en qualité de service.
Les sous-préfets sont en général de hauts fonctionnaires compétents, qui assurent une fonction de conseil ou d'intermédiation entre les responsables territoriaux élus et l'administration de l'État. La suppression des sous-préfectures serait absurde, sauf si l'État renonce à s'occuper du territoire. Auquel cas on pourrait envisager des regroupements plus importants encore. Mais si l'État, qui gère plus de 55 % de la richesse nationale, prétend apporter à ceux qui exercent des responsabilités un service d'écoute, d'information et de conseil, comment supprimer la présence physique du sous-préfet ? Certes, il est souvent seul, mais il a l'expérience, le niveau et les relations au sein de l'administration pour apporter une véritable réponse, surtout si le préfet de département lui confie des missions au niveau départemental qui lui permettent d'échapper à l'isolement.
Vous citez dans votre rapport l'expérimentation menée en Alsace-Lorraine. En Alsace et en Moselle, nous avons hérité du système allemand de quadrillage intense, et sans doute excessif, du territoire. C'est pourquoi l'Alsace et la Moselle comptaient beaucoup de sous-préfectures. Mais on ne peut transposer cette expérimentation dans la France de l'intérieur.
L'État veut-il exister sur le territoire ? Si oui, qu'il conserve des moyens humains de qualité : il ne peut pas à la fois prétendre s'occuper de tout et être absent de nos territoires.

Il n'est pas simple pour les élus locaux d'obtenir des conseils. Les petites sous-préfectures ont vu leurs heures d'ouverture sensiblement réduites ; vont-elles être remplacées par des maisons de services au public ? La dématérialisation des actes a été une source d'économie pour les communes - mais nous restons attachés à la propagande électorale sur papier, essentielle pour la participation électorale.

La dématérialisation de la propagande électorale mérite d'être expérimentée avant d'être généralisée : la fracture numérique est une réalité, attention à ne pas exclure les plus défavorisés de l'exercice de la démocratie.
Le déploiement des titres sécurisés a été très rapide. Les communes concernées par l'expérimentation ont été avisées très récemment ; la mienne doit être prête au 1er décembre. Or avec une compensation de 3 500 euros, on est loin de la réalité des coûts qu'entraînent les stations de recueil de données.
Je sais que les comptes de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS), dont le fonds de roulement baisse, ne permettent pas d'abonder les dotations au profit des collectivités. Quelles propositions pour que ces dernières, confrontées à ces charges nouvelles, ne soient pas pénalisées ?

Nous avions déjà abordé l'an dernier la question de la dématérialisation de la propagande électorale, sujet d'actualité avec les échéances électorales qui se profilent. Où en est-on de la concertation annoncée avec les associations d'élus locaux et la commission des lois ?
Il faut réorganiser rapidement les sous-préfectures, dont certaines ne comptent guère plus que le chauffeur, la cuisinière et la secrétaire. C'est peu pour venir en appui aux élus locaux. Dans ma ville de Laon, la préfecture de l'Aisne est désormais fermée tous les après-midi. Cela fait mauvais effet, croyez-moi !

Je travaille avec Marie-Françoise Perol-Dumont à un rapport, au nom de la délégation aux collectivités territoriales, sur l'adaptation des missions de l'État à la réorganisation du territoire. À entendre le ministère et les préfectures, tout va bien. Ce que démentent les collectivités : à Limoges, on n'a jamais vu le préfet de région depuis qu'il est parti pour Bordeaux. Quant au préfet de département, il n'a pas de délégation. Il y a un vrai manque de proximité. Les collectivités estiment donc que, compte tenu de ses moyens restreints, l'État devrait se recentrer sur ses missions régaliennes, plutôt que sur la culture ou le sport.

Les directions départementales ne dépendent pas des préfectures, elles n'entrent pas dans le périmètre de la mission.

Drac, Dreal et autres sont tout de même autour du préfet, qui est le chef de l'administration.

Justement, il est contourné par l'administration, qui s'adresse directement au ministère. Or les collectivités se sentent perdues sans une vraie autorité locale. Les citoyens, les élus s'interrogent. Cette analyse est partagée, par-delà les clivages politiques !

S'il est une mission qui répond à l'exigence de sobriété de l'État, c'est bien celle-ci. Encore faut-il que l'action générale et territoriale de l'État soit conduite avec efficacité. La question n'est pas tant celle du montant des crédits que de la bonne adaptation des dispositifs. Après les phases actives de décentralisation des compétences, une réforme plus poussée de la présence, y compris symbolique, de l'État dans les territoires doit être envisagée. Le regroupement des collectivités permettra une représentation adaptée, à condition que le préfet de région prenne en compte la diversité des territoires sous son autorité. On peut mener une action efficace sans forcément découper le territoire : le temps n'est plus aux sous-préfets des champs et aux sous-préfets des villes, au train de vie grandiose, mais à la présence, partout, d'un État moderne, à moindre coût. Les frais de maison, les hôtels particuliers historiques sont devenus difficile à justifier.
Si je prône la mobilisation autour du développement des usages numériques, notamment pour la transmission d'informations, encore faut-il distinguer entre une élection emblématique comme la présidentielle et une élection de proximité, où la propagande papier est nécessaire, ne serait-ce que pour savoir qui est candidat.

Cela dit, on peut faire des économies. On pourrait imaginer, par exemple, que seuls les citoyens qui le souhaitent aient accès à la propagande papier.
Efforçons-nous d'être modestes dans les dépenses d'administration générale et dans la structuration des administrations territoriales. Si l'on ne parvient pas à faire des économies ici, où en fera-t-on ?

On a déshabillé les préfectures de tous les moyens d'ingénierie qui leur permettaient de porter une vision positive de l'aménagement. Désormais, elles ne se préoccupent plus que de contrôle et de sécurité. La réforme Perben est une catastrophe pour les départements de la région parisienne, qui a fait exploser les délais. Or les petites et moyennes communes ont besoin de soutien logistique. Chez moi, le carrefour les autoroutes A15 et A115 est particulièrement accidentogène, du fait de problèmes d'aquaplaning - mais la gestion du problème relève d'une administration située à Créteil ! Un vrai bazar !
Après le gros investissement sur les passeports, le réseau sera-t-il le même pour les cartes nationales d'identité ? Et serons-nous enfin indemnisés à la hauteur des dépenses ?
Enfin, la délivrance des cartes d'immatriculations et des permis dans un même garage fait courir un risque de distorsion de concurrence entre les gros concessionnaires et les autres - sans parler du risque de traficotage... Avec cette privatisation croissante, l'État abandonne toute velléité de contrôle !

Le financement des partis politiques est maintenu à son niveau antérieur - mais cette stabilisation vient après des années de baisse. C'est une érosion en valeur réelle. Cela signifie des moyens en moins pour la démocratie. Le rattachement financier des parlementaires mériterait d'être modernisé : il pourrait intervenir une fois pour toutes, au moment de l'élection, plutôt que de devoir être renouvelé chaque année.
La question des emprises immobilières appelle aussi une rationalisation, car la contribution des cessions au budget opérationnel n'est pas mince : 14,4 % du produit ! Comment l'expliquer ?

Dans certains départements, dont le mien, le préfet de département reçoit délégation du préfet de région pour instruire les dossiers. En outre, il applique l'instruction émise il y a quelques mois par le Premier ministre ordonnant de faire une interprétation facilitatrice des normes. Car pour les normes comme pour la Bible ou le Coran, on peut en avoir une lecture intégriste ou une lecture ouverte... ce qui change tout !

C'est une proposition que nous avons formulée avec Alain Lambert. Tous les maires devraient avoir cette instruction dans leur poche ! Un exemple : un immeuble situé dans le périmètre des 500 mètres autour d'un édifice classé ou inscrit ne peut faire l'objet d'aucuns travaux « de nature à en affecter l'aspect ». Une lecture facilitatrice de ces termes débloque bien des dossiers ! Preuve qu'il sort beaucoup de choses intéressantes de la Sarthe...

La commission consultative d'évaluation des charges (CCEC) du Comité des finances locales peut être saisie pour évaluer les transferts de compétences et de charges.

Pas de sanction, mais certaines collectivités sont parvenues à obtenir une indemnisation.

Je me dois de rappeler que le non-respect par les partis politiques de la loi sur la parité leur coûte 5,6 millions d'euros en pénalités.

Je partage pour l'essentiel les observations et témoignages de nos collègues. C'est pourquoi je dis que nous sommes au milieu du gué : il faut un accompagnement des collectivités locales dans les secteurs plus ruraux. Or l'instabilité préfectorale va de pair avec l'instabilité territoriale. Avec la modification des périmètres, l'administration de l'État doit se conformer à de nouvelles cartes qui se superposent. Sur les 238 sous-préfectures, soixante comptent moins de dix employés. Une rationalisation s'impose. Certes, outre la perte de standing, la fermeture d'une sous-préfecture peut entrainer des anomalies fiscales : cela a été le cas à Guebwiller, qui a perdu du coup un supplément de dotation...
La compensation prévue pour les cartes nationales d'identité est clairement insuffisante. Le ministre de l'intérieur a proposé une rallonge de sorte que finalement les compensations aux communes pourraient atteindre entre 40 et 50 millions d'euros. Il faut continuer la négociation. Les grandes associations d'élus sont consultées par le Gouvernement sur l'ensemble de ces sujets.
Oui, le coût des élections est important. C'est pourquoi le Gouvernement propose la dématérialisation de la propagande. Un tirage au sort serait encore moins coûteux, mais répondrait-il à nos exigences démocratiques ? Il est heureux qu'on soit revenu à plus de raison.
En effet, Éric Doligé, la réorganisation territoriale complique le redéploiement des services de l'État.
Vincent Eblé souhaite un État sobre et numérique, j'en prends acte.
Pour les cartes nationales d'identité, le réseau sera le même, avec peut-être un peu plus de points d'entrée. L'indemnisation est clairement insuffisante, je l'ai dit. La présidente Michèle André a alerté par le passé sur le risque de destruction du tissu rural. Il faut une discussion avec les associations d'élus et les petites communes pour parer aux difficultés financières et en termes de proximité.
Les cessions font l'objet d'un versement au budget général, qui reverse - après avoir prélevé une fraction. D'où le différentiel.
La commission décide de proposer au Sénat l'adoption des crédits de la mission « Administration générale et territoriale de l'État ». Elle décide en outre de proposer de confirmer la suppression de l'article 52 et d'adopter les articles 52 bis et 52 ter.
La réunion est close à 12 h 40.