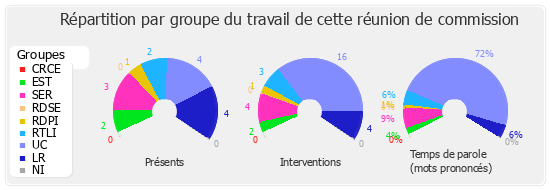Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
Réunion du 7 mars 2018 à 10h30
Sommaire
- Article 13 de la constitution
- Audition de mme chantal jouanno candidate proposée aux fonctions de présidente de la commission nationale du débat public cndp (voir le dossier)
- Vote sur la proposition de nomination aux fonctions de présidente de la commission nationale du débat public cndp
- Désignation d'un rapporteur (voir le dossier)
- Questions diverses (voir le dossier)
La réunion

Nous entendons ce matin Chantal Jouanno, candidate proposée aux fonctions de présidente de la Commission nationale du débat public (CNDP).
Je vous rappelle qu'en application du 5ème alinéa de l'article 13 de la Constitution, cette nomination ne peut intervenir qu'après l'audition de la personne pressentie devant les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, ces auditions étant suivies d'un vote.
Conformément aux dispositions de la loi organique et de la loi ordinaire du 23 juillet 2010, cette audition est publique et ouverte à la presse.
À l'issue de cette audition, je demanderai aux personnes extérieures de bien vouloir quitter la salle afin que nous puissions procéder au vote qui se déroulera à bulletin secret.
Le dépouillement doit être effectué simultanément à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'Assemblée nationale procédera à l'audition de Mme Jouanno cet après-midi à 16 h 30 ; nous pourrons donc dépouiller le scrutin aux alentours de 18 heures.
Enfin, je vous rappelle qu'il ne pourrait être procédé à cette nomination, si l'addition des votes négatifs de chaque commission représentait au moins 3/5ème des suffrages exprimés dans les deux commissions.
Madame Jouanno, le Sénat vous connaît bien puisque vous y avez siégé entre 2011 et 2017 et que vous étiez, avant votre départ, membre de notre commission et présidente de la délégation aux droits des femmes.
Je rappellerai brièvement quelques éléments de votre parcours. Après avez été sous-préfète et directrice du cabinet du préfet de la Vienne et de la région Poitou-Charentes à votre sortie de l'Ecole nationale d'administration, vous occupez divers postes au ministère de l'intérieur avant de rejoindre le cabinet de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'intérieur, comme conseillère technique en 2003.
En 2006, vous devenez directrice de cabinet et de la communication à la présidence du conseil général des Hauts-de-Seine.
À la suite de l'élection de Nicolas Sarkozy comme président de la République en 2007, vous devenez sa conseillère pour le développement durable, avant d'être nommée présidente de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en février 2008.
Vous restez moins d'un an à ce poste, puisqu'en janvier 2009, vous êtes nommée secrétaire d'Etat à l'écologie, puis ministre des sports en novembre 2010
En 2011, vous êtes élue sénatrice de Paris, et vous exercez en parallèle un mandat de conseillère régionale puis de vice-présidente de la région Ile-de-France, à partir de la fin de l'année 2015. Lors du renouvellement sénatorial de 2017, vous choisissez de ne pas vous représenter et vous annoncez votre intention de quitter la vie politique pour rejoindre le privé.
Votre retraite de la sphère publique aura été brève, ce qui nous donne le plaisir de vous retrouver ce matin.
Créée en 1995, la CNDP est une autorité administrative indépendante dont la mission est d'organiser la consultation du public en amont de l'élaboration de certains projets, plans ou programmes, à travers la tenue de débats publics ou de concertations préalables sous l'égide de garants.
Il s'agit d'une mission importante, puisque l'association des citoyens au moment de l'élaboration de grands projets d'infrastructures est très utile pour assurer leur acceptabilité.
Cette participation du public en amont est complémentaire à celle qui existe en aval, au moment de l'autorisation des projets, par le biais de l'enquête publique ou de la consultation publique.
Le rôle de la CNDP a été récemment renforcé par une ordonnance du 3 août 2016, récemment ratifiée, qui a réformé les modalités de participation du public, en reprenant en grande partie les préconisations faites par la commission présidée par Alain Richard.
Cette réforme a notamment conduit à élargir les cas de saisine obligatoire de la CNDP et à créer un droit d'initiative au profit des citoyens, des parlementaires, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement, qui peuvent saisir la commission afin de lui demander d'organiser une consultation sur un projet donné.
Avant de vous laisser la parole pour que vous puissiez nous présenter votre projet, j'aimerais vous poser quelques questions liminaires.
Nous aimerions, bien sûr, savoir quelles sont vos motivations pour exercer la fonction de présidente de la CNDP ? Quelle est votre vision du rôle de la CNDP et de la participation du public préalablement à l'élaboration de certains projets ? On sait que des interrogations se font jour sur une éventuelle fusion avec le CESE, le Conseil économique, social et environnemental : vous nous donnerez sans doute votre avis.
Vous nous donnerez aussi, je n'en doute pas, tous les éléments nous permettant d'être certains de l'impartialité qui sera la vôtre dans vos fonctions, où vous pourrez être amenée à animer des débats sur des sujets dont vous avez eu à connaître dans vos responsabilités passées. Je pense par exemple aux consultations à venir sur la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), ou sur des projets d'aménagements dans la région Ile-de-France, par exemple les projets d'infrastructures olympiques.

J'ai grand plaisir à vous retrouver. Je reviendrai tout à l'heure sur les raisons de la brièveté de mon passage vers le privé, mais veux vous dire d'emblée les raisons de mon intérêt pour la CNDP. Dès lors que l'on s'engage sur les questions environnementales, de développement durable et d'aménagement du territoire, on se trouve aussitôt confronté à la question du débat public : quelle est l'acceptabilité mais plus encore la faisabilité d'un projet, quel sera son impact sur les populations, pour qui sera-t-il soutenable et pour qui le sera-t-il moins ? Telles sont les questions qui se posent d'emblée sur des sujets qui touchent à notre modèle de société, nos modes de production, nos comportements, et qui exigent un débat très large. Autant dire que ces questions sont inhérentes à tout ce qui touche à l'aménagement du territoire et à l'environnement.
Dans mon parcours professionnel, j'ai eu l'occasion d'expérimenter différentes techniques de concertation, de participation ou de consultation du public pour élaborer des projets ou des politiques - non pas tant dans la préfectorale, où les décisions du préfet sont motivées par l'exigence, régalienne, de garantir la sécurité, que dans mes fonctions au sein de collectivités locales. Je pense, par exemple, à la consultation qui avait été menée par le Conseil général des Hauts-de-Seine pour inviter la population à hiérarchiser les priorités dans les politiques qu'il entendait mener. C'est ainsi qu'ont été organisés des consultations par internet, des débats avec les élus, des conférences de consensus avec des citoyens représentatifs. Toutes ces expériences ont été enrichissantes.
Lors du Grenelle de l'environnement, nous avons répondu au souhait exprimé, durant la campagne, par le futur Président de la République, de construire les politiques avec les associations environnementales. Il nous revenait de mettre en oeuvre cette volonté, et d'engager le débat avec l'ensemble des parties prenantes en veillant à ce qu'il soit le plus ouvert possible et ne sombre pas dans un affrontement manichéen. D'où l'initiative du « dialogue à cinq partenaires », une technique de construction des politiques réutilisée dans le cadre du plan de prévention des risques technologiques et dont le Conseil d'Etat, dans son rapport de 2011, a souligné tout l'intérêt.
Comme vice-présidente de région sur les projets d'aménagement, j'ai eu à mettre en place une politique de soutien aux quartiers innovants et écologiques, avec toutes les difficultés que cela emportait. Il s'agissait de rencontrer les porteurs de projet en associant la population très en amont, afin qu'elle en retire le maximum de bénéfice.
Si l'on veut aller plus loin sur l'aménagement du territoire, l'environnement, le développement durable, il faut rechercher les meilleurs moyens d'organiser le débat public, pour qu'il soit utile. Là est le sens de ma candidature : il s'agit pour moi d'être utile aux porteurs de projets, aux collectivités locales, aux citoyens.
Vous m'interrogez sur ma vision de la CNDP. Je n'ai pas la prétention de vous livrer, à ce stade, un plan stratégique, car il me faut d'abord en passer par la pratique, et mesurer les conséquences des dispositions de l'ordonnance d'août 2016 qui, avec l'élargissement des motifs de saisine obligatoire et du droit d'initiative, accroît considérablement la mission de la CNDP. La priorité, pour les années à venir, sera de mettre en oeuvre ces dispositions nouvelles, et de voir en quoi elles contribuent au débat public et à la mise en oeuvre de projets ou de politiques : en somme, de les évaluer. Il sera intéressant, de ce point de vue, de débattre avec les porteurs de projets, les maîtres d'ouvrage et l'ensemble des parties prenantes des modalités de cette évaluation. Comment savoir si le débat public a été efficace ? On ne l'évalue pas au nombre de projets arrêtés mais bien plutôt à la mesure dans laquelle le débat a contribué à enrichir un projet ou un programme. Il s'agit, dans le débat public, de dresser une cartographie des données et des intérêts, pour que la décision soit prise à la lumière de cet éclairage.
On comprend, du même coup, combien impartialité et neutralité sont essentielles à la CNDP. Vous avez donc raison de me demander comment, eu égard à mon parcours politique, je saurai les garantir. Car de fait, la CNDP, garante de l'objectivité du débat public, doit permettre à toutes les opinions de s'exprimer et s'assurer qu'elles seront prises en compte jusqu'en aval, c'est-à-dire jusqu'à la phase de l'enquête publique.
L'impartialité de l'institution est garantie, tout d'abord, par son mode de fonctionnement. Ses 25 membres sont nommés par les institutions qu'ils représentent, et qui rassemblent l'ensemble des parties prenantes de la société - acteurs économiques, sociaux, associatifs, élus, membres du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation. Ce pluralisme est une première garantie. Ces membres s'engagent tous sur une charte de déontologie, qui garantit l'absence de conflit d'intérêt. Son président ne saurait présider de commission particulière : si ma candidature était retenue, je n'aurais donc pas à interférer dans des débats qui peuvent concerner des projets dont j'ai eu à connaître.
Si je suis candidate, enfin, c'est bien pour garantir la neutralité de l'institution. Il est hors de question que j'exprime une opinion politique sur un projet. Ce serait sortir du rôle du président, qui est de garantir que les conditions du débat public soient réunies. J'ai déclaré, naguère, que vous n'entendrez plus parler de moi, et je ne m'en dédis pas : je ne ferai aucune déclaration politique.

Vous aviez en effet déclaré que vous quittiez la sphère publique. N'étant guère familier des arcanes du pouvoir, je me demande comment vous en êtes venue à vous porter candidate. Vous a-t-on sollicitée ? Y avez-vous vu une opportunité qui vous a décidée à quitter la sphère du privé ?
Je m'interroge, également, sur le statut du président de la CNDP. Est-il un fonctionnaire ou est-il régi par un autre statut ? Qu'en est-il, enfin, de sa rémunération, et du budget de l'institution ?

Je rebondis sur cette question, car lors de précédentes nominations, il nous avait été indiqué que de nouveaux processus de recrutement avaient été mis en place, par le biais de cabinets de recrutement - je pense à la présidence de la RATP, notamment... Je rappelle également, s'agissant de la question des rémunérations, qu'un récent rapport de la Cour des comptes porte sur les autorités administratives indépendantes et notamment les conditions de rémunération de leur personnel et de leurs dirigeants.

Dans le secteur privé, où j'ai travaillé pour un cabinet de chasseurs de têtes - une expression que je n'aime guère -, j'ai conservé une petite frustration : celle de ne pas capitaliser l'expérience acquise dans mes fonctions publiques. Quand on s'est occupé par le passé de l'intérêt général, le coeur balance toujours de ce côté.
Je connais encore beaucoup d'acteurs de la sphère publique, qui m'ont fait savoir que la présidence de la CNDP venait à échéance le 22 mars et qui m'ont demandé si j'étais intéressée. C'est un poste qui ne se refuse pas tant sont vastes les enjeux politiques, au sens large, qui y sont attachés. Puis je n'ai plus entendu parler de rien, jusqu'à la publication du communiqué de presse de l'Elysée.
Vous m'interrogez sur les conditions statutaires. Le président de la CNDP n'a pas le statut de fonctionnaire - même si je le suis par ailleurs, comme administrateur civil. Il est nommé, comme les autres membres, pour cinq ans. Sur les conditions de rémunération du président et des vice-présidents, il y a eu un projet de décret sur cette question, dont je ne sais s'il a été publié. En général, ces conditions font l'objet d'un dialogue avec le secrétaire général du gouvernement mais elles sont, en tout état de cause, très éloignées de ce qu'étaient les miennes dans le privé. Ce n'est pas l'argent mais l'intérêt de la fonction qui a motivé ma candidature.
Vous avez tous à connaître du budget de la CNDP à l'occasion des lois de finances. Pour les années à venir, il n'est pas facile de le calibrer, compte tenu de l'ampleur des réformes introduites par l'ordonnance, mais aucune difficulté budgétaire n'est aujourd'hui signalée.

Je me félicite que le précédent gouvernement ait élargi le champ des compétences de la CNDP, pour une meilleure contribution du débat public à l'élaboration des grands projets d'aménagement. Vous mesurez combien son rôle et ses prérogatives sont devenues importantes ; vous mesurez aussi l'indispensable neutralité qui doit être la sienne. Dans l'organisation de la concertation préalable sur les quatre façades maritimes, pour prendre un exemple au coeur de l'actualité, comment la CNDP sera-t-elle garante de cette impartialité ? Notre commission a mené une importante réflexion sur les problématiques du littoral. La CNDP doit assurer une vraie concertation entre collectivités, maîtres d'ouvrage et porteurs de projets. Comment entendez-vous travailler à concilier les usages de la mer pour le développement économique et les enjeux humains et environnementaux ?

La principale garantie de neutralité réside dans les personnes en charge de l'organisation de la concertation. Comme je l'ai dit, il serait bon que les règles de déontologie s'appliquent à l'ensemble des représentants de la CNDP. La Commission, cependant, ne doit pas se tromper de rôle : elle n'est pas décisionnaire, mais intervient en amont pour dresser une cartographie de l'ensemble des parties prenantes, des intérêts en présence, des arguments. Elle doit prendre en compte ceux des élus, des maitres d'ouvrage, des représentants des associations locales. Son rôle n'est pas d'émettre un avis mais de permettre aux décideurs de se déterminer. Déontologie des personnes en charge, cartographie aussi large que possible, rôle circonscrit : tels sont les trois moyens de garantir l'impartialité dans des débats sensibles.

La CNDP a participé à l'organisation des débats sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Quel bilan tirez-vous de la manière dont elle est intervenue dans ce débat ? Car le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas apaisé le débat public, qui s'est, au contraire, durci. Vous nous dites que ses 25 membres, issus de tous horizons, garantissent la pluralité. Mais dans ce débat, on a retrouvé chez eux le clivage entre les « pro » et les « anti ».
La question des garants est centrale. Comment faire pour que les présidents de débat soient toujours dégagés de tout conflit d'intérêt ?
Vous dites, enfin, que vous vous interdirez d'intervenir sur le fond, mais quid de la forme du débat ? Si, dans le cadre d'un débat sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, manquent les éléments formant le socle du débat, considérerez-vous que l'Etat oppose une difficulté ou estimez-vous devoir vous en tenir à la réserve ?

Sur Notre-Dame-des-Landes, le travail de la CNDP n'a pas été évalué. Je ne saurais dire, ainsi, quels ont été les sujets des 240 saisines intervenues. Le rapport du Conseil d'Etat a tiré un bilan en 2011, mais pas depuis. Il manque une évaluation plus régulière, qui doit servir à nous améliorer. Le seul fait que les acteurs locaux, notamment politiques, aient pu avoir le sentiment que la CNDP est partisane pose problème. Le retour d'expérience est donc très important. Reste à savoir qui doit conduire l'évaluation, pour garantir son impartialité.
La CNDP a adopté une charte déontologique pour remédier à des soupçons de prise de position. Il est important, à mon sens, que ces dispositions soient élargies à l'ensemble des représentants, des garants et des présidents de commissions particulières. Ces présidents, jusqu'à présent, sont nommés par un vote des membres de la CNDP, sur proposition de son président. Il serait bon de mettre en place un jury préalable, avec plusieurs candidats, pour que l'ensemble des membres de la Commission puissent juger en impartialité.
Dans l'organisation des débats, le rôle de la CNDP et de son président est d'être vigilants sur la forme. Si elle considère que l'ensemble des informations ne sont pas fournies, elle doit le dire. Sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, les modalités d'organisation des débats ont été publiées hier soir : il semblerait que le président de la commission particulière estime que le gouvernement a fourni l'ensemble des informations nécessaires.

Songez-vous à un « audit » de fonctionnement de la CNDP pour modifier certaines pratiques ?

Le terme d'audit est un peu dur. Il serait logique, en revanche, alors que l'ordonnance a modifié ses compétences, d'évaluer l'organisation des débats. Il ne s'agit pas de mettre en question ce qui a été fait, mais de rendre des comptes sur le fonctionnement de la Commission et de démêler le bon du moins bon.

La mission de la CNDP s'inscrit dans le cadre des grands projets d'aménagement du territoire, qui se déploient dans le temps long. Vous mettez en avant l'exigence d'impartialité, d'objectivité, de neutralité, mais comment y répondre quand on voit, dans un débat public tel que celui de Flamanville, qui s'est tenu en 2005-2006, que la mise en service était initialement prévue pour 2018-2019 et que le coût du projet, initialement de 2,8 milliards, est aujourd'hui de 10,5 milliards ? Autant dire que les conditions initiales ont été largement modifiées par l'évolution même du projet. Ne pensez-vous pas que le débat public ex ante devrait se prolonger ex post pour voir où en sont les objectifs initiaux, s'ils ont été modifiés, et pourquoi ?

La question s'est posée dans le cadre de l'ordonnance : le fait que le temps des grands projets soit très long et que ses conditions, au moment du débat initial, ne soient pas les mêmes que lors de la décision finale, est un constat partagé. On part, de fait, d'un projet à l'état zéro, assorti des alternatives possibles. Il faut s'assurer que les évolutions soient prises en considération pour apporter des réponses à l'opinion. C'est pourquoi il a été décidé de nommer des garants post-débat, chargés de veiller à la bonne transmission de l'information au public et aux parties prenantes. Mais ce processus ne doit pas, cependant, interférer avec l'enquête publique, en aval. Autrement dit, le garant poursuit le processus d'information mais sans être partie prenante à l'enquête publique.

J'ai vécu la mauvaise expérience de deux débats publics, qui se sont étalés sur une dizaine d'années et ont abouti à un échec, faute de parvenir à concilier deux exigences politiques majeures : développer les énergies marines renouvelables d'une part et protéger les milieux marins et la vie des pêcheurs, d'autre part. Malgré deux débats publics, le consensus n'a pas été possible si bien que le gouvernement a été amené à modifier la procédure d'adoption, en transférant l'avis conforme du conseil de gestion du parc marin, où l'Etat n'est pas majoritaire, au conseil d'administration de l'Agence pour la biodiversité, où il l'est. D'où, sur le terrain, un sentiment de frustration.
En 2015, l'autorité administrative a préconisé de confier à la CNDP une mission de conciliation, importante sur des sujets conflictuels, et d'encourager la production de contre-expertises indépendantes de celles des maîtres d'ouvrage et porteurs de projets, pour plus de crédibilité. Ces mesures ont été reprises dans l'ordonnance et le décret, et je m'en réjouis. Quel est votre point de vue sur cet élargissement ?

La possibilité a été ouverte, en effet, de demander des expertises alternatives et complémentaires, nécessaires pour garantir l'objectivité de l'information. Le dispositif de conciliation, en revanche, est chose plus radicalement nouvelle au regard de la mission initiale de la CNDP. Il faudra du temps pour le mettre en oeuvre. Autant il est possible d'identifier, dans les arguments, les points sur lesquels les parties peuvent se retrouver, autant il est plus délicat de produire un document sur les points d'accord. Il faudra creuser tout cela, car c'est très nouveau.

J'indique à notre président que Mme Jouanno n'a pas été directrice de cabinet du préfet de la Vienne, mais du préfet de la région Poitou-Charentes, ce qui est plus important.
Je m'interroge sur le budget de la CNDP. Les textes votés visent à augmenter la transparence, ouvrir les possibilités de saisine et en faciliter l'accès. De quelle équipe disposerez-vous pour y faire face ? Avez-vous idée des moyens complémentaires dont vous aurez besoin ?

Le budget pour 2017 a été de quelque 2 millions d'euros en exécution. L'équipe de la CNDP, composée de 7 personnes, est petite, mais elle s'appuie sur des ressources importantes : 250 garants, et des présidents de commissions particulières. J'ajoute qu'au-delà de ce budget, les porteurs de projet financent la concertation via un fonds de concours, estimé à près de 3 millions d'euros pour l'an prochain. Quant au budget voté pour 2018, il est en forte augmentation, à 3,4 millions d'euros, pour prendre en compte les nouvelles missions de la CNDP.

Ma question porte sur l'acceptabilité des projets et la transmission de l'information sur les sujets de nature scientifique. Comment intensifier l'effort sur cette information pour tenir compte de l'insuffisante culture scientifique de la société française ? Un projet comme celui du centre industriel de stockage géologique de Bure devrait être accompagné d'un effort d'information.
Comment associer le plus de citoyens possible, notamment ceux qui vivent sur le territoire concerné ? Comment mieux les mobiliser, car force est de constater que peu d'entre eux se déplacent ?

Je préfère parler de faisabilité que d'acceptabilité, car la CNDP intervient très en amont. Il s'agit de voir ce qui est faisable et qui en recevra l'impact, car pour certaines personnes, le fait est qu'il n'y a pas d'alternative possible. Souvenez-vous que dans le Grenelle I, le principe d'un droit à l'alternative avait été reconnu, même si l'on n'a pu le mettre en oeuvre.
La CNDP se doit de diffuser une information aussi impartiale, complète et compréhensible que possible. Sur des sujets très complexes, l'une des solutions passe par un système consistant à tirer au sort des citoyens et à les former à la compréhension de l'ensemble des enjeux. Ce système a fait ses preuves. A Bure, le débat public n'a pas été possible, du fait des opposants au projet. Ce système, en même temps que l'information diffusée par la presse locale ont néanmoins permis d'ouvrir le débat le débat.
Pour élargir le champ de la participation, il est possible de recourir au numérique. Mais c'est une solution qui, du fait de la fracture numérique, ne saurait se substituer au débat public. Avec l'expérience, on parvient à trouver des voies adaptées à la technicité ou à la conflictualité des projets.

Quelle articulation envisagez-vous entre la CNDP et le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, que le Président de la République souhaite voir devenir un outil de la consultation publique pour tout projet de réforme ? Comment voyez-vous la place de la CNDP ? Partenaire, coopérateur, impulseur ? Car je n'ose dire concurrent.

La CNDP a certes la possibilité d'organiser des débats nationaux, mais dans le champ circonscrit de l'environnement ou de l'aménagement du territoire. L'ordonnance a utilement précisé qu'elle intervient très en amont et non une fois que la réforme a déjà été pensée. Voyez le cas des nanotechnologies, où la CNDP avait été chargée d'organiser un débat qui s'annonçait conflictuel. Le gouvernement avait déjà des orientations, mais dans le débat public, il s'agissait de fournir une information en cartographiant l'opinion avant d'élaborer un projet de réforme. Le CESE interviendrait plus en aval : nous ne sommes pas en concurrence. En revanche, la CNDP dispose d'une réelle expertise en matière d'organisation du débat public, qui peut être très utile. Elle intervient en accompagnement de la politique de modernisation de l'action publique, afin de d'apporter son conseil pour l'organisation de débats.

Quel est exactement le rôle du président de la CNDP ? Est-il à la fois président et directeur, est-il assisté d'un secrétaire général ayant la fonction de directeur ? Quel est sa mission, au-delà d'être une caution morale importante de respect et d'impartialité, pour des dossiers où l'environnement et l'aménagement du territoire sont parfois difficilement conciliables ?

La commission nationale de la CNDP compte 25 membres permanents. Sur les débats particuliers sont nommés des présidents de commissions particulières, avec des équipes dédiées, et des garants. Cette assemblée de 25 membres se réunit chaque mois et prend les décisions : elle arbitre sur la nomination des présidents de commissions particulières, les équipes qui l'entourent, l'état d'avancement des dossiers, le lancement des débats et la validation de leurs modalités. Le président présente les candidats à la présidence des commissions particulières, fait en sorte que les dossiers soumis soient le plus complet possible. Il veille donc au respect de l'ensemble des règles de la CNDP.
Il a également un rôle dans le fonctionnement interne de la CNDP : il nomme les membres permanents, et assure le budget. Le secrétaire général, en lien avec le président, assure le fonctionnement interne, notamment la rédaction des marchés publics.
Pour des raisons déontologiques, le président ne peut présider des commissions particulières, mais lorsque la CNDP organise le débat avant de décider de projets, il vérifie que tous les éléments d'information sont réunis.

Vous aspirez à présider une autorité administrative indépendante (AAI), alors que celles-ci ont été mises sur la sellette par la Cour des comptes et le Sénat. Une commission d'enquête du Sénat, présidée par Marie-Hélène des Esgaulx, et dont le rapporteur était Jacques Mézard, a examiné la quarantaine d'AAI existantes. Nous avons été désagréablement surpris de découvrir une certaine opacité de fonctionnement de ces autorités. Tous les gouvernements ont créé des AAI, parfois pour se désengager de leurs responsabilités, parfois pour des raisons pertinentes...
Le rapport proposait la suppression de 20 AAI sur 40 - la moitié ! Vous engagez-vous, devant cette commission, à être transparente sur le fonctionnement de votre autorité ?

La CNDP était sur la sellette, cela ne m'a pas échappé. Une AAI demandant la transparence sur les informations transmises dans le cadre des débats doit être particulièrement transparente sur son budget et son fonctionnement. La CNDP est indépendante car la décision d'organiser un débat est indépendante, mais cela ne l'exonère pas des règles de fonctionnement des institutions publiques... Les deux questions sont distinctes : être indépendant ne signifie pas être opaque...

J'ai été membre de la CNDP durant huit ans. En 2011, on ne donnait pas cher de l'avenir de cette institution lors de son évaluation. J'ai vu les efforts de Christian Leyrit et Jacques Archimbaud pour remettre la CNDP au goût du jour. Je m'étonne de vous entendre parler de la nécessité d'un audit éventuel car les discussions actuelles sur les ordonnances sur l'environnement ont plébiscité et renforcé l'institution. Après avoir connu une CNDP un peu poussiéreuse avec des débats se tenant uniquement en salle, j'ai vu apparaitre une expertise du débat public et des techniques diversifiées de consultation - consultations numériques, conférences du consensus, débat en salle suivi d'un débat mobile à la sortie d'une gare ferroviaire... Le croisement de ces différentes techniques est utile. Citoyen, j'ai aussi constaté que le recours au débat public et aux contre-expertises peut être une réussite, comme ce fut le cas pour la consultation relative à l'A 31. Cela rassure le public et peut ébranler les certitudes du maître d'ouvrage.
Je remarque que l'assiduité des parlementaires des deux chambres était assez faible, même si je sais désormais quelles sont leurs contraintes d'agenda...
Quelle sera l'ampleur donnée à la CNDP par les ordonnances ? Qu'en sera-t-il de la multiplication des débats, avec le droit d'initiative citoyen ? Nous aurons besoin de plus de moyens et de garants. Comment mettrez-vous en oeuvre ces réformes ?

Je n'ai pas parlé d'audit, c'est le président Maurey qui a utilisé ce terme...

J'ai utilisé les termes d'évaluation et de retour d'expérience sur les débats menés. Nous devons tirer les enseignements des très gros débats publics.
Il y a un trio à la tête de la CDNP, avec les vice-présidents Ilaria Casillo et Jacques Archimbaud, ce dernier devant également bientôt être remplacé. Il pourrait être intéressant que le Parlement ait à connaître de la nomination des vice-présidents. Les membres de ce trio doivent avoir des expertises complémentaires.
Les garants ont déjà été sélectionnés par un jury représentant les différentes parties prenantes. Ils ont dû suivre une formation, et bénéficient d'un tutorat entre garants, les plus expérimentés aidant les nouveaux garants. Le vivier existe, avec 250 garants, qu'il faudra faire vivre pendant plusieurs années. Il a été envisagé de recourir à des délégués régionaux pour animer et suivre ces garants.

Le rapport Duron préconise d'organiser un nouveau débat public pour la métropole lyonnaise en matière d'organisation des transports. Maire depuis 20 ans au sein de cette métropole, j'ai été entendue par plusieurs commissions sur les réseaux ferrés et routiers. À chaque fois, elles ont botté en touche en raison de la complexité du sujet entre les noeuds ferroviaires, les contournements... N'utilise-t-on pas la CNDP et le débat public pour éviter de trancher, alors qu'il s'agit parfois d'un problème de gouvernance ? Une fois le débat public réalisé, n'est-il pas vain d'en refaire continuellement ? Pourquoi le rapport Duron préconise-t-il encore la tenue d'un tel débat ?

M. Duron serait plus à même que moi de répondre. Ne confondons pas les rôles de la CNDP et du décideur public. N'oublions pas que les débats publics coûtent cher : ils doivent être organisés en cas de nécessité, avant une décision. Après un débat public, des garants assurent la continuité jusqu'à la réalisation du projet. Ils évitent de recourir une nouvelle fois à un débat public, qui peut coûter un à deux millions d'euros. Les ordonnances, qui prévoient un garant systématique, évitent le type d'écueil que vous évoquez.

Je vous remercie. Nous allons procéder au vote mais attendrons celui de l'Assemblée nationale pour dépouiller le scrutin. Ce vote se déroule à bulletins secrets et il ne peut y avoir de délégation de vote.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
La commission procède au vote sur la candidature de Mme Chantal Jouanno, candidate proposée aux fonctions de présidente de la Commission nationale du débat public, en application de l'article 13 de la Constitution.
La commission désigne Mme Françoise Cartron en qualité de rapporteure de la proposition de loi visant à proroger l'expérimentation de la tarification sociale de l'eau.
OUVERTURE À LA CONCURRENCE DU TRANSPORT FERROVIAIRE

Nous avons appris, par voie de presse et avec consternation, le recours à des ordonnances pour l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire... Le président du Sénat a annoncé être totalement opposé au recours à des ordonnances sur ce sujet crucial pour les territoires. J'ai moi-même dénoncé cette démarche. Selon le Gouvernement, cela permettrait d'aller plus vite. Cet argument n'est pas recevable car Louis Nègre et moi-même avions déposé en septembre une proposition de loi sur le sujet. À la demande de la ministre des transports, nous avions accepté de ne pas l'examiner en janvier, en attendant le rapport de la mission Spinetta. Chose extrêmement rare, le président du Sénat a saisi le Conseil d'État sur cette proposition de loi. Ce dernier a rendu son avis le 22 février. Nous étions convenu, avec la ministre, que cette proposition de loi serait le véhicule législatif soutenu par le Gouvernement pour mettre en place la réforme.
Recourir aux ordonnances n'est pas correct vis-à-vis du Sénat, même si ce n'est ni la première, ni probablement la dernière fois. Cette proposition de loi est prête. Les ordonnances ne sont pas une baguette magique : il faut demander l'avis du Conseil d'État, présenter le projet de loi d'habilitation en Conseil des ministres, le déposer devant les assemblées avant le débat. Ensuite, les ordonnances sont signées et doivent être ratifiées...
Le projet de loi d'habilitation pourrait être examiné la semaine du 9 avril à l'Assemblée. La procédure envisagée est particulièrement surprenante. Nous examinerons le projet de loi d'habilitation, mais au fur et à mesure du débat, des dispositions législatives seraient incluses dans la loi d'habilitation : ces dispositions n'auront donc pas été examinées par le Conseil d'État, nous les découvrirons au fil de l'eau, et elles pourront parfois être déposées directement en séance !
Cela s'inscrit dans une série de manques d'attention et de respect à l'encontre du Sénat, comme lors de l'examen des propositions de loi relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et relative au développement durable des territoires littoraux. Hier, le secrétaire d'État Julien Denormandie estimait que la proposition de loi de Patrick Chaize tendant à sécuriser et à encourager les investissements dans les réseaux de communications électroniques à très haut débit était un texte remarquable, mais qu'il n'était pas débattu au bon moment. Elle a tout de même été adoptée à l'unanimité, et j'en félicite son auteur et son rapporteur...
Mardi prochain, le président du Sénat proposera à la Conférence des présidents d'inscrire la proposition de loi relative à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs à l'ordre du jour de la séance à partir du 28 mars, pour qu'elle soit votée avant l'examen du projet de loi d'habilitation à l'Assemblée nationale. Cela prouvera qu'on peut aller plus vite tout en respectant les droits du Parlement.
Quel que soit votre avis sur le fond du texte, je vous invite à soutenir cette démarche : s'il y a trop d'obstruction et que le texte n'est pas adopté, nous donnerons raison au Gouvernement. Une durée suffisante a été prévue pour un débat démocratique.
Nous avons quelques divergences avec le Gouvernement, d'abord sur l'annonce gouvernementale de report de l'ouverture à la concurrence de 2019 à 2023. Nous prenons aussi davantage en compte les territoires. Le Gouvernement se fonde sur un open access pur, avec une concurrence totalement libre. Les opérateurs risquent alors de se positionner uniquement sur les TGV ou les lignes les plus rentables. Ils se battront sur le Paris-Lyon, et les autres sortiront leur mouchoir pour pleurer...
Notre proposition de loi met en place un système très important de lots : vous pouvez vous positionner sur le Paris-Lyon, mais en même temps vous devez vous positionner sur des lignes moins rentables, afin que l'ouverture à la concurrence ne se traduise pas par un moindre service rendu aux usagers.

La prise en compte de cet enjeu par notre proposition a été saluée lors d'un colloque de la CGT. Nous devons apporter un plus à l'usager, et non un moins. En décembre, Jean-François Longeot a été nommé rapporteur de ce texte. Il devra travailler très vite et très bien. Nous examinerons son rapport en commission le 21 mars.

Le Gouvernement tape sur la SNCF, et la rend responsable de tout. Ayant été quatre ans membre du conseil d'administration de RFF, Réseau ferré de France, j'ai vu que le Gouvernement donnait des instructions pour ne travailler que sur les lignes à grande vitesse. Tous les dignitaires, du président de la République à Brice Hortefeux, faisaient réaliser des études mirifiques sur certaines lignes. Celles concernant la ligne Poitiers-Limoges ont coûté 140 millions d'euros. RFF n'a pas pu investir sur l'entretien des voies existantes. Et ensuite, on nous parle du statut des cheminots, certes important...
PLAN NATIONAL 2018-2023 SUR LE LOUP ET LES ACTIVITÉS D'ÉLEVAGE

Le plan national 2018-2023 sur le loup et les activités d'élevage a été publié le 19 février, déclenchant de vives réactions. Plusieurs sénateurs, de divers groupes et commissions, ont souhaité que nous nous saisissions du sujet.
Le groupe d'études « Développement économique de la montagne », qui se reconstituera prochainement sous la présidence de notre collègue Cyril Pellevat, me paraît être l'instance la mieux appropriée pour mener ce travail, dans la mesure où tous les sénateurs peuvent y adhérer. Je vous propose de charger notre collègue Cyril Pellevat d'une mission « flash » sur le plan Loup, en associant l'ensemble des membres du groupe d'études, pour entendre au mois de mars différentes personnalités et établir des recommandations.

Le plan Loup a été adopté par le Premier ministre avec un nombre de tirs limité. N'est-il pas trop tard ? Avec des élus de l'arc alpin, nous avons rencontré les cabinets ministériels en décembre.

J'ai cru comprendre que les propositions du Gouvernement ne satisfont personne...

Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques, a également été saisie. Nous avons décidé ensemble de confier ce travail au groupe « Montagne », transcommissions et transpartisan.

Il était indispensable de se saisir du sujet. Certes, le plan Loup a été adopté, mais il n'est qu'un cadre général. Il ne satisfait personne. Travaillons aussi sur sa mise en oeuvre dans les territoires avec les parcs régionaux...

Il importe de réagir. Le loup a quitté la montagne et se déplace désormais en plaine. Je ne vais pas multiplier les adhésions à des groupes d'études, mais souhaiterais parfois participer à ces réunions.