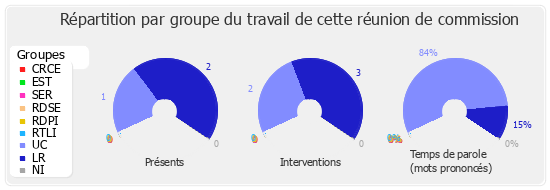Commission des affaires culturelles, familiales et sociales
Réunion du 3 octobre 2007 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
La commission a procédé, tout d'abord, à l'examen du rapport pour avis de M. Jean-Léonce Dupont sur le projet de loi n° 474 (2006-2007) adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de l'accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens.

a tenu à remercier la commission de la confiance que celle-ci lui a témoignée en lui confiant ce rapport, tâche qui s'est avérée délicate, compte tenu à la fois des passions que déclenchait ce texte et, parallèlement, de la diversité - voire du caractère contradictoire - des données et des chiffres livrés par les différentes parties concernées. Il a indiqué s'être efforcé de procéder à une analyse équilibrée du sujet afin d'évaluer l'impact du Protocole de Londres sur l'usage de la langue française ainsi que sur la recherche publique de notre pays.
Evoquant le contexte historique et juridique dans lequel intervenait ce projet de loi de ratification, le rapporteur pour avis a rappelé que le brevet européen était né de la volonté des Etats d'édifier un système de brevets unifié à l'échelle de l'Europe pour protéger leurs inventions dans l'Espace économique européen, dans un souci de réduction des coûts et de simplification des procédures que la diversité des langues nationales rendait particulièrement complexes pour les déposants. Suite à l'échec des tentatives pour instituer un brevet communautaire, une Convention sur la délivrance des brevets européens a été signée à Munich le 5 octobre 1973. Entrée en vigueur fin 1977, elle a instauré le brevet européen et créé l'Office européen des brevets (OEB).
Le rapporteur pour avis a précisé que les 32 Etats signataires sont convenus de choisir trois langues de procédure : l'anglais, l'allemand et le français, dans des conditions fixées par l'article 65 de la Convention de Munich. Une mesure de simplification supplémentaire a été envisagée avec le Protocole de Londres, conclu le 17 octobre 2000, une dizaine de pays acceptant que les Etats ayant une langue officielle en commun avec les trois langues officielles de l'OEB renoncent aux exigences de traduction intégrale prévues par la convention de Munich. Ce protocole, qui concerne exclusivement l'article 65 précité, a un caractère facultatif, ce qui signifie qu'il ne lie pour l'instant que les 13 Etats qui en sont parties, 9 d'entre eux ayant achevé leur procédure d'adhésion ou de ratification. Or l'article 6 du protocole de Londres soumet son entrée en vigueur à la ratification par au moins 8 Etats membres, dont l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France.
a estimé qu'il était temps de procéder à cette ratification et de lever ainsi l'épée de Damoclès qui pesait sur le Protocole de Londres ; il a proposé un certain nombre de mesures d'accompagnement afin à la fois d'en maximiser les effets positifs et d'en atténuer les inconvénients.
Après avoir précisé le contenu du brevet et la valeur juridique de ses éléments (les revendications déterminant les conditions de la brevetabilité et l'étendue du droit du titulaire du brevet, la description et les dessins facilitant la compréhension de l'invention), il a indiqué que, selon l'étendue territoriale de la protection que le déposant souhaite apporter à son invention, il peut choisir une procédure nationale, européenne ou internationale.
Il a rappelé que, même si la proportion d'inventions d'origine française dont le premier dépôt est effectué auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) baisse régulièrement, les déposants français choisissaient très majoritairement (dans 90 % des cas) la procédure nationale de dépôt de brevet français pour des raisons économiques, (d'autant plus que l'INPI facture à un coût réduit le rapport de recherches des antériorités) et qu'environ 60 % de ces demandes nationales faisaient ensuite l'objet d'une extension européenne.
Puis il a évoqué le régime linguistique actuel et son évolution en application du Protocole de Londres. Il a indiqué que les demandes de brevet européen devaient nécessairement être introduites dans l'une des trois langues officielles de l'Office européen des brevets (OEB) : l'allemand, l'anglais ou le français, qu'elles étaient alors publiées dans cette langue dans un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt, la délivrance du brevet intervenant 3 à 4 ans après la publication de la demande. Il a précisé que la langue qui faisait foi était la langue de procédure et de délivrance. A ce stade, la traduction des revendications doit être effectuée dans les deux autres langues officielles de l'Office. Puis, à compter de la délivrance du brevet, la traduction intégrale - tant des revendications que de la description - doit être effectuée dans les langues nationales des Etats désignés qui l'exigent, pour que l'invention soit protégée sur le territoire de ces Etats.
a précisé que, dans la pratique, ces traductions étaient effectives dans un délai moyen de 5 ans et que l'ensemble des Etats parties à la Convention avaient usé de la faculté de traduction offerte par l'article 65 de la Convention, qui permet aux Etats de prescrire la traduction intégrale (revendications et description) du brevet dans leur langue nationale pour rendre celui-ci valide sur leur territoire.
Il a observé que le Protocole de Londres ne s'appliquait qu'à la période postérieure à la délivrance du brevet européen, les règles applicables au stade du dépôt de la demande de brevet continuant à prévaloir. Il a distingué trois situations :
- premièrement, celle des Etats parties au Protocole de Londres ayant pour langue officielle l'une des trois langues officielles de l'OEB (soit la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, le Lichtenstein et Monaco) : ces pays renoncent aux exigences de traduction prévues à l'article 65 susmentionné. Toutefois, les revendications devront toujours être disponibles dans les trois langues officielles de l'OEB ;
- deuxièmement, la situation des Etats parties au Protocole de Londres n'ayant pas pour langue officielle l'une des trois langues officielles de l'OEB : ces pays renoncent également aux exigences de traduction prévues à l'article 65, ce qui signifie qu'ils doivent désigner l'une des trois langues officielles de l'OEB comme langue valable sur leur territoire. Néanmoins, ils conservent le droit d'exiger une traduction des seules revendications dans une de leurs propres langues officielles, si le brevet européen n'a pas été délivré ou traduit dans la langue officielle de l'OEB qu'ils ont prescrite ;
- troisièmement, la situation des Etats parties à la Convention de Munich, mais non à l'accord de Londres : ils peuvent continuer à bénéficier des stipulations de l'article 65, et donc à exiger une traduction intégrale dans leur langue officielle.
Le rapporteur pour avis a conclu que :
- tout Etat partie au Protocole de Londres conserve le droit d'exiger la traduction des revendications dans sa langue officielle, mais non des descriptions qui ne seront donc disponibles que dans la langue de procédure qui a conduit à la délivrance du brevet européen, à savoir l'allemand, l'anglais ou le français, ou dans deux ou trois de ces langues si la traduction dans les autres langues officielles est demandée par les Etats ayant choisi une autre langue officielle de l'OEB que celle de la procédure ;
- chaque Etat partie conserve le droit d'exiger qu'en cas de litige fondé sur un brevet, une traduction intégrale du fascicule soit fournie par son titulaire dans la langue nationale du pays.
s'est interrogé ensuite sur les enjeux du Protocole en termes de recherche publique et de diversité linguistique.
Il a observé qu'une partie des professionnels concernés, qu'il avait souhaité entendre, continuaient à s'inquiéter des conséquences de la ratification par la France du Protocole de Londres, faisant notamment valoir que :
- pour la première fois en France, des textes rédigés dans une langue autre que le français, « langue de la République », auraient une valeur juridique ;
- le Protocole conduirait de facto à réduire l'usage de notre langue, l'absence d'obligation de traduction en français des brevets augmentant considérablement le volume de brevets diffusés en langue anglaise en France ;
- le risque existerait d'une perte de fonctionnalité de la langue française dans un domaine stratégique, l'innovation scientifique et technique ;
- cet accord pourrait être préjudiciable aux déposants, qui n'ont pas tous les moyens d'effectuer une veille technologique en anglais ;
- la diminution du coût d'accès au brevet serait d'une ampleur incertaine et elle dépendrait notamment du nombre d'Etats ayant ratifié l'accord de Londres ;
- les déposants français resteraient contraints d'effectuer les traductions intégrales de leur brevet en anglais et en allemand, s'ils souhaitent que leur invention soit protégée dans des Etats n'ayant pas pour langue officielle une des trois langues de l'OEB et ayant opté pour l'une de ces langues, ainsi que dans les autres langues des Etats parties à la Convention de Munich mais non au Protocole de Londres, afin que leur invention soit protégée dans ces Etats.
Le rapporteur pour avis a rappelé que l'hypothèque de la constitutionnalité de l'accord avait été levée. En effet, dans son avis du 21 septembre 2000, le Conseil d'Etat a estimé que la France pouvait signer l'accord sans révision préalable de la Constitution et, dans sa décision du 28 septembre 2006, le Conseil constitutionnel a estimé que l'accord ne méconnaissait pas la disposition selon laquelle « la langue de la République est le français ».
a déclaré qu'il fallait relativiser la réalité de l'usage de la langue française dans le cadre juridique actuel, et qu'en pratique, la convention de Munich s'était traduite par une augmentation continue des dépôts en anglais. Il a ajouté que la veille économique et technologique s'effectuait le plus souvent en anglais, dans la mesure où les traductions intervenaient très tardivement (dans un délai moyen de 5 ans).
Le rapporteur pour avis a souligné que le Protocole viendrait confirmer le statut de la langue française, en consacrant cette dernière comme l'une des trois langues officielles de l'OEB. En outre, le brevet européen pourrait toujours être intégralement délivré par l'OEB en langue française et les revendications devraient toujours être disponibles dans les trois langues officielles. Il a indiqué qu'au demeurant, son impact sur l'usage de la langue française devait être nuancé, le Protocole ne conduisant pas à l'abandon du français comme langue de premier dépôt par les déposants français.
En outre, il a relevé que les activités de veille, qui portaient plutôt sur les revendications, ne seraient pas remises en cause ; par ailleurs, l'INPI continuerait d'assurer une traduction en français du résumé de toutes les demandes de brevets européens publiées désignant la France. Il a jugé essentiel également que le lexique des termes scientifiques géré par l'OEB reste dans les trois langues officielles.
Il a estimé que, s'agissant des organismes publics de recherche, le Protocole de Londres devrait leur permettre de réaliser des économies non négligeables en matière de traduction. Le coût des traductions est cependant difficile à évaluer, car il dépend de nombreux paramètres, tels que le taux de change du dollar, la longueur du texte de brevet à traduire, la complexité technique du texte, le nombre de traducteurs assermentés pour une langue particulière, ou le degré d'urgence. S'agissant des économies susceptibles d'être réalisées, la diversité des chiffres avancés s'explique par le mode de calcul : l'économie est de 20 % si l'on prend en compte le coût intégral du brevet pendant toute sa durée de vie ; elle est de 40 % si l'on impute les coûts de traduction à l'investissement initial lié au dépôt du brevet. Or, c'est bien le montant de cet investissement qui sera ou non rédhibitoire pour un déposant potentiel.
C'est pourquoi le rapporteur pour avis a jugé pertinent de retenir les évaluations du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, à savoir une diminution du coût des traductions située dans une fourchette de 35 % à 45 %. L'économie potentielle moyenne par brevet déposé serait ainsi de 1 566 euros. L'économie potentielle annuelle réalisée par les organismes de recherche sous la tutelle du ministère serait donc au moins d'1,1 million d'euros et de 0,5 million d'euros s'agissant des universités.
Le rapporteur pour avis a également fait état d'autres estimations : inférieures pour ce qui concerne l'Association pour le Droit à l'Information en Français (ADIF), globalement supérieures s'agissant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
Puis M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur pour avis, a recommandé l'adoption des mesures d'accompagnement.
Il a défendu, tout d'abord, la nécessité de plaider pour un renforcement de la sécurité juridique qu'offraient les traductions, surtout dans le nouveau contexte de non-traduction de la description du brevet. Après avoir évoqué les dispositions de l'article L. 614-10 du code de la propriété intellectuelle en la matière, il a souhaité que ce point essentiel soit abordé, au moins dans le cadre des négociations en cours sur le brevet communautaire.
Il a ajouté que le véritable défi à relever était la localisation des centres de recherche sur le territoire national et que, dans ce but, il fallait faire de la recherche une réelle priorité et poursuivre le chemin de la modernisation de notre système de recherche engagé depuis quelques années.
Il a souhaité aussi que soit inscrite dans les statuts de l'INPI, au titre de ses missions pérennes, l'obligation de réaliser les traductions abrégées des brevets dans les meilleurs délais.
Il a observé, par ailleurs, que notre pays souffrant d'un manque de culture du brevet, il convenait d'inciter les écoles d'ingénieurs et les universités à mieux former les jeunes dans les domaines de la veille technologique, des dépôts et de la valorisation des brevets.
Il a indiqué qu'il fallait poursuivre le combat pour la diversité linguistique, mené de longue date par la commission, notamment au travers des travaux de M. Jacques Legendre. Les pouvoirs publics doivent veiller à la pleine application de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, dite loi Toubon. A cet égard, il a insisté tout particulièrement sur la nécessité pour notre pays de défendre sa position sur l'information en français du consommateur, des évènements dramatiques récents ayant montré l'utilité vitale d'une information en français, et donc d'une traduction de qualité des notices d'instruction et d'utilisation. Il a rappelé qu'en 2004, le Sénat avait adopté à l'unanimité une proposition de loi, dont M. Philippe Marini était l'auteur, qui tendait à apporter quelques compléments utiles et pratiques à la loi de 1994. Il a suggéré que la commission demande au Gouvernement l'inscription rapide de cette proposition de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, il a souhaité que notre pays continue sa lutte incessante en faveur du plurilinguisme dans les enceintes internationales et de la place du français dans les institutions européennes.
Enfin, le rapporteur pour avis a préconisé des mesures d'accompagnement en faveur des professions menacées. Il a évoqué notamment la situation les traducteurs, dont un certain nombre seront nécessairement touchés par l'application du Protocole. Pour ceux-là, des actions de formation devraient être encouragées et le problème de leur financement étudié par les ministères concernés. Il a indiqué que la position du principal syndicat de traducteurs avait considérablement évolué, celui-ci étant aujourd'hui convaincu à la fois de la nécessité pour la profession de s'adapter et de l'existence de nouvelles opportunités pour ceux qui sauraient développer leur spécialisation.
En conclusion, et sous réserve de ces recommandations, M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur pour avis, a demandé à la commission de donner un avis favorable à l'adoption du projet de loi.
Un échange de vues a suivi l'exposé du rapporteur.

a félicité ce dernier pour la grande clarté et pour la qualité de son rapport, qui permet de se faire une idée très précise de ce sujet à la fois technique et conflictuel, au-delà des passions et de l'action des différents groupes d'intérêt qu'il suscite.
Il a déclaré soutenir la position du rapporteur, tant pour ce qui concerne son avis sur la ratification que ses recommandations.

Après avoir salué le grand intérêt de l'exposé du rapporteur, M. Jack Ralite en a relevé le caractère très technique. Soulignant les difficultés qui en résultent pour les dirigeants de petites et moyennes entreprises, il a indiqué que nombre d'entre eux étaient d'ailleurs peu favorables à la ratification du Protocole, de même que l'Assemblée parlementaire de la francophonie ainsi qu'un certain nombre de syndicats et d'organismes. En outre, certains pays ne souhaitent pas ratifier le Protocole.
Il a fait valoir que moins de 7 % des brevets étaient déposés en français et que les problèmes tenaient surtout à l'insuffisance de l'investissement dans la recherche et le développement (R&D), à la méconnaissance de l'atout stratégique que représente la propriété industrielle pour la conquête des marchés internationaux, ainsi qu'à l'absence de culture de l'action commerciale dans notre pays.
Evoquant ensuite les chercheurs, dont certains sont favorables au Protocole, M. Jack Ralite a regretté qu'ils s'expriment le plus souvent en anglais dans les colloques et dans les revues scientifiques.
Il s'est déclaré très préoccupé par cette forme d'abandon de la propriété intellectuelle, alors même que cette dernière a été inventée en France.
Relevant que les traductions ne représentaient que 10 % du coût d'un brevet, contre 75 % de frais de maintien et 15 % de frais de procédure, il a jugé que les économies devraient plutôt être réalisées sur les gros postes de dépenses.
Il a également exprimé le souhait que la France refuse la fatalité du « tout anglais » dans toutes les activités, qu'elle accroisse ses investissements en R&D et qu'elle oeuvre au renforcement de la coopération européenne dans les domaines scientifiques et technologiques.
Il a conclu son propos en se déclarant défavorable à la ratification du Protocole de Londres.

Après avoir félicité le rapporteur pour la qualité de sa présentation, M. Jacques Legendre a fait part de l'évolution de sa position sur le sujet au cours du temps : plutôt favorable à la ratification dans un premier temps, compte tenu de ses avantages en termes de simplification et de réduction de coût, il avait également exprimé le souhait que la langue française ne soit pas instrumentalisée au profit de telle ou telle profession. Dans un second temps, ses préoccupations se sont accrues.
Il a évoqué la difficulté de se faire une opinion sur les avantages et désavantages de l'accord de Londres au plan économique : ceux-ci lui sont apparus « balancés », compte tenu des difficultés qu'éprouveront les petites et moyennes entreprises en matière de veille technologique et du risque d'être « inondé » de brevets anglo-saxons.
a abordé, ensuite, l'impact du Protocole sur la langue française, l'enjeu étant de savoir si l'on veut ou non que celle-ci reste une langue internationale, au rayonnement mondial. Il a estimé que le Protocole rendrait encore plus difficile ce dernier compte tenu :
- des freins mis par certains Etats, notamment de langue latine ;
- des réticences croissantes des étrangers à faire l'effort de l'apprentissage du français, compte tenu de l'usage de plus en plus réduit de notre langue dans un nombre croissant de domaines (sciences, transport, informatique, domaine militaire...). Il a affirmé que, de recul en recul, les étrangers ayant choisi le français comme langue d'accès à la modernité estimaient avoir de moins en moins de raisons d'apprendre notre langue.
Par conséquent, M. Jacques Legendre s'est déclaré préoccupé pour l'avenir du français sur la scène mondiale, une langue internationale unique risquant de s'imposer au détriment de la diversité culturelle.
Evoquant par ailleurs les décisions du Conseil d'Etat et du Conseil constitutionnel, il s'est inquiété du fait que, pour la première fois, des documents en langue étrangère puissent avoir valeur juridique et il a rappelé l'opposition au Protocole exprimée tant par le Conseil national des Barreaux que par M. Pascal Clément, ancien Garde des Sceaux et ancien représentant de la France dans les négociations sur le brevet communautaire.
Après avoir souligné que les frais de traduction permettaient de maintenir la diversité des cultures et la vitalité des langues, il a évoqué le caractère peu libéral des Américains en matière d'usage de leur langue.
En conclusion, M. Jacques Legendre a souhaité que la commission émette un avis défavorable à la ratification du Protocole de Londres, afin d'inciter le Gouvernement à conduire une politique cohérente en matière de francophonie.

a fait état des avis partagés de son groupe politique. Compte tenu des compétences propres de la commission des affaires culturelles, notamment en matière de francophonie et de défense de la langue et de la culture françaises, il a déclaré partager l'opinion de l'orateur précédent. Il a rappelé également que les délais pris par la France pour inscrire le texte à l'ordre du jour du Parlement avaient leur justification.

s'est déclaré préoccupé par le développement d'une sorte « d'esperanto », fort éloigné de l'anglais comme langue de culture. Evoquant ensuite le rapport de MM. Lévy et Jouyet sur « L'économie de l'immatériel », il a estimé que l'on avait là un cas concret de « déshumanisation » dont la facture serait lourde. Il a fait part de sa crainte du pragmatisme lorsque sont en cause des valeurs fondamentales.

a estimé que la défense de la langue et de la culture françaises ne passaient pas uniquement par notre langue. Relevant que l'anglais constituait aujourd'hui un idiome international, il a souligné qu'à l'instar de ce que l'on constate en matière télévisuelle, le développement du français passait surtout par la création, l'innovation et la défense de l'expression française, domaines que le Protocole de Londres ne remet pas en cause.

a exposé son expérience de chercheur, dont la réputation ne s'est pas faite au travers de ses travaux en français, mais en anglais dans des publications anglo-saxonnes. De la même façon, la participation à des congrès scientifiques internationaux suppose de s'exprimer dans cette langue véhiculaire qu'est l'anglais. Il a relevé que l'usage de cette langue s'avérait également nécessaire si l'on souhaitait attirer en France des chercheurs étrangers. Il a souligné que ceci ne signifiait pas de « mettre le drapeau dans sa poche ». Pour autant, sanctionner le texte par un avis négatif lui a semblé avoir une portée excessive, l'aménagement technique qu'il propose ne devant pas être confondu avec le combat pour la francophonie.

a répondu ensuite aux différentes interventions, qui portent sur trois domaines principaux :
- s'agissant de l'impact du Protocole sur les entreprises, il a estimé qu'il convenait d'être mesuré, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) et le Cercle des Entreprises Offensives (CEO) s'étant prononcées en faveur de la ratification ;
- pour ce qui concerne plus généralement la recherche française, le rapporteur pour avis a partagé certains des propos des intervenants et il a insisté sur l'absolue nécessité d'encourager la localisation des centres de recherche en France, ceci d'autant plus que l'innovation est aussi à la source de l'enrichissement du français scientifique ; à cet égard, il a cité l'exemple du secteur nucléaire ;
- évoquant enfin le niveau linguistique, il s'est déclaré très sensible aux propos tenus, mais il a insisté qu'il soit bien tenu compte, d'une part, du rapport des forces en présence et, d'autre part, des risques encourus en cas de non ratification.
a fait valoir ainsi que la place prise par la langue anglaise dans le domaine de la recherche scientifique était un état de fait, qui s'impose à tous, même si on peut le regretter.
Quant à l'hypothèse d'une non ratification par la France du Protocole de Londres, il a estimé que les risques, à terme, du « tout anglais » n'étaient pas négligeables, compte tenu notamment des positions défendues par les Italiens et les Espagnols.

a estimé que, si un avis négatif de la commission des affaires culturelles ne suffirait sans doute pas à aboutir à la non ratification du Protocole, à l'inverse un avis favorable ne serait pas conforme à sa vocation.

a considéré, quant à lui, que si la commission se préoccupait, de façon permanente, de défendre la langue et la culture françaises, il convenait cependant de ne pas se tromper de combat. Il a jugé qu'un avis défavorable ne serait donc pas compris, dans la mesure où il n'est pas question de « marchandisation » de notre langue, mais bien du rayonnement de la science française.
La commission a donné ensuite un avis favorable à l'adoption du projet de loi autorisant la ratification de l'accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens.

Puis la commission a entendu M. Louis de Broissia, rapporteur du groupe de travail sur la crise de la presse.
A titre liminaire, le rapporteur a rappelé que la création de ce groupe de travail n'avait pas procédé d'un événement particulier ou d'un incident ponctuel qui aurait fait la « une » de l'actualité, mais qu'il avait été créé pour étudier un phénomène s'inscrivant désormais dans la durée : les difficultés rencontrées par la presse quotidienne d'information générale et politique.
A l'issue de la vingtaine d'auditions effectuées par le groupe de travail, le rapporteur a dressé le constat suivant : à l'image de « Libération », qui a obtenu une nouvelle prorogation de la procédure de sauvegarde sous laquelle son éditeur est placé depuis le 4 octobre 2006, tous les titres de la presse quotidienne d'information doivent résoudre une équation économique délicate, caractérisée par une baisse continue des recettes et le maintien de coûts de production élevés.
Il a évoqué, en premier lieu, la diminution des recettes de vente, phénomène regrettable, imputable au fait que les Français ne lisent plus de quotidiens ou presque. Il a énuméré quelques données permettant de prendre conscience de la gravité de la situation.
Il a ainsi constaté que la France se situait seulement au 12e rang européen et au 31e rang mondial pour la diffusion des quotidiens et qu'avec moins de 160 exemplaires diffusés pour 1.000 habitants, elle se classait très loin derrière les pays scandinaves, le Royaume-Uni ou l'Allemagne.
Il a regretté que notre pays ne compte, par ailleurs, plus aucun quotidien payant atteignant le million d'exemplaires diffusés, alors que le Royaume-Uni en compte cinq et qu'à l'échelle mondiale, Ouest France, premier quotidien hexagonal, ne se classe qu'à la 76e place du classement avec 800.000 exemplaires, à des « années-lumière » des principaux quotidiens japonais.
Il a souligné que les chiffres de la diffusion de la presse en France étaient encore moins flatteurs, puisqu'une analyse des dix dernières années permet de constater une diminution régulière, mais prononcée, de la diffusion des 12 quotidiens nationaux : la diffusion payée France de cette catégorie de presse est revenue, selon l'Office de la justification de la diffusion (OJD), de l'indice 103 à l'indice 92 entre 2000 et 2006.
Il a noté, ensuite, que la presse quotidienne française connaissait également une diminution régulière de ses ressources publicitaires.
La presse quotidienne reste ainsi à l'écart de la reprise des investissements publicitaires constatée en 2006 et doit faire face à la quasi-disparition des petites annonces de ses colonnes. Si ces dernières comptaient pour 320 millions d'euros dans les recettes de la presse nationale d'information en 1990, elles ne représentent plus aujourd'hui que 70 millions d'euros, soit à peine 5 % de son chiffre d'affaires total.
Le rapporteur a observé que si l'ensemble des recettes de la presse quotidienne diminuaient, les coûts de production restaient, quant à eux élevés, à l'image du prix du papier qui connait une hausse constante depuis 2002.
Il a relevé que les coûts d'impression demeuraient plus importants que la moyenne européenne, cette situation résultant moins du niveau des salaires individuels que des sureffectifs négociés par le syndicat du Livre au cours des différents conflits sociaux ayant accompagné la modernisation du secteur.
Il a constaté que le seul point positif tenait à la réduction du coût de distribution : le coût d'intervention des messageries a en effet considérablement diminué sous l'effet des plans de restructuration successifs des Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP).
Il a résumé cette situation en expliquant que la baisse des ventes et la diminution des recettes publicitaires, conjuguées au niveau relativement élevé des coûts fixes, constituaient un véritable effet de ciseaux pour les quotidiens français qui enregistrent des pertes comprises entre 56 et 175 millions d'euros par an.
Le secteur de la presse quotidienne française est ainsi caractérisé par l'une des plus faibles rentabilités constatées dans l'Union européenne, entraînant deux conséquences notables :
- la réduction de la capacité des quotidiens français à réaliser les investissements nécessaires à la modernisation de leur outil de production ;
- l'hésitation des investisseurs à apporter les capitaux propres supplémentaires, pourtant indispensables au financement des projets de développement des sociétés de presse, notamment dans le numérique.
s'est interrogé sur les raisons qui ont conduit la presse quotidienne, qui fut longtemps la première du monde, à se couper progressivement de ses lecteurs et ce secteur à se retrouver quasi dépendant des subsides publics.
Les auditions réalisées par le groupe de travail ont validé l'idée d'une responsabilité collective des différents acteurs du secteur.
Il a jugé difficile d'analyser la situation actuelle de la presse quotidienne payante sans prendre en compte son environnement immédiat, marqué par l'arrivée de redoutables concurrents.
Il a évoqué, d'abord, le cas des quotidiens gratuits d'information qui ont démontré qu'un concept audacieux et innovant pouvait rencontrer l'adhésion d'un public dénigrant majoritairement la presse payante. Le succès fulgurant de ce produit, à l'image de « 20 minutes » lancé en mars 2002 qui est devenu depuis septembre dernier le quotidien le plus lu de France avec plus de 2,4 millions de fidèles, repose sur deux principes simples tirés d'une observation attentive des comportements des lecteurs : une neutralité éditoriale totale et un mode de distribution parfaitement adapté au « public cible ».
Il a évoqué, ensuite, le cas d'internet, véritable révélateur des faiblesses de la presse quotidienne payante. Ce média permet de fournir une information quasiment instantanée, actualisée en continu, à la fois large et diversifiée, là où le quotidien ne peut développer qu'un nombre restreint de sujets et se doit de respecter une heure de bouclage et des contraintes de pagination.
Internet permet aussi, et surtout, le développement d'un rapport original à l'information. Facilitant les possibilités d'échanges et d'expression personnelle, il enlève à la presse et aux rédactions une de leur spécificité : la capacité à organiser et à hiérarchiser l'information transmise aux lecteurs. De fait, internet tranche par rapport aux médias traditionnels qui fonctionnent principalement dans une logique verticale et descendante et ne permettent que marginalement la réaction et la participation de leurs consommateurs.
Puis le rapporteur a abordé le phénomène des « blogs », si caractéristiques de la culture du web, qui mélangent sans complexe, information et opinion, faits vérifiés et rumeurs, analyses documentées et impressions fantaisistes.
Il a également évoqué le journalisme participatif, à l'image d'Ohmynews en Corée du Sud, qui permet aux citoyens de produire une information certifiée.
S'agissant des responsabilités syndicales, M. Louis de Broissia, rapporteur, a rappelé au préalable que le syndicat du Livre faisait en effet partie intégrante de l'économie du secteur et que ses succès, ses excès aussi, avaient profondément marqué l'organisation de la presse quotidienne française et entraîné des surcoûts considérables tant pour les éditeurs que pour la communauté nationale.
Concernant les surcoûts directs, il a dénoncé les salaires confortables et les effectifs pléthoriques dans les imprimeries du « Livre », qui rendent en effet la fabrication des quotidiens français 1,5 fois plus chère que celle d'un quotidien anglais.
Il a jugé cette situation d'autant plus choquante que la presse parisienne s'enfonce dans la crise et que l'écart avec les autres métiers de la presse, comme les journalistes, n'a jamais été aussi important et d'autant plus visible que les imprimeries de labeur ont considérablement réduit leurs coûts.
S'agissant des surcoûts indirects, il a indiqué que les plans sociaux destinés à accompagner la réorganisation du processus d'impression et à réduire l'emprise du « Livre » dans le secteur pesaient tant sur les éditeurs que sur la collectivité nationale.
Il a ajouté que ces surcoûts avaient des conséquences extrêmement pénalisantes pour la presse qui, pour y faire face, avait dû :
- augmenter ses prix de vente et se couper ainsi de la partie de son lectorat la plus sensible au prix (jeunes, classes populaires) ;
- réaliser des économies sur les autres postes, en particulier celui des journalistes, affaiblissant ainsi le contenu des titres.
Bien qu'ils soient victimes de coûts de production élevés et d'un manque évident de moyens, il a estimé que les éditeurs portaient eux aussi une part de responsabilité non négligeable dans le déclin qui les frappe.
Ceux-ci ont en effet manqué de discernement en matière de distribution et de diffusion. En privilégiant une interprétation laxiste de la loi Bichet, ils ont provoqué une véritable déliquescence du réseau se traduisant par l'encombrement des linéaires, la multiplication des invendus et la disparition des points de vente.
Il a souligné que les éditeurs avaient également manqué d'ambition et d'audace en matière éditoriale, leur attitude trop longtemps conservatrice ayant contribué à la désaffection du lectorat.
Il a reconnu que des efforts avaient depuis lors été entrepris, la création de suppléments thématiques ou l'ajout de produits dérivés ayant permis d'accroître la valeur ajoutée du journal et le lancement de nouvelles formules -à grand renfort de publicité au Monde ou au Figaro- de rénover des maquettes vieillissantes.
Il a toutefois jugé que le bilan de ces opérations restait mitigé : si elles ont enrayé la chute des ventes, elles n'ont pas réussi à faire repartir les courbes de diffusion à la hausse.
Il a ensuite observé que, tout comme les éditeurs, les pouvoirs publics avaient aussi leur part de responsabilité dans cette crise et que le régime économique de la presse illustrait les difficultés rencontrées par l'Etat pour définir une stratégie cohérente et efficace destinée à préserver un média indispensable à l'information des citoyens et à la diffusion des courants de pensées et d'opinion.
Il a expliqué qu'au cours des cinq dernières années, la direction du développement des médias avait certes rationalisé le dispositif des aides directes en modifiant les modalités d'attribution de sept d'entre elles, mais que le système restait néanmoins perfectible sur de nombreux points.
D'une part, son impact sur la situation des quotidiens reste limité : la modicité des sommes engagées et la multiplicité des objectifs affichés contribuant simplement à maintenir à flot les titres les plus mal en point (L'Humanité, France Soir et Libération) et à alléger les charges courantes des autres bénéficiaires.
D'autre part, trop de crédits publics demeurent attribués sans la moindre contrepartie. Il a illustré son propos par l'aide à la distribution allouée aux Nouvelles messageries de la presse parisienne : alors que l'Etat devrait s'engager à financer un troisième plan de modernisation de l'entreprise, aucun bilan précis du degré de réalisation des deux précédents n'a été établi. Dans ces conditions, il a estimé qu'il serait temps de contractualiser ce type d'engagement afin de pouvoir contrôler l'utilisation des crédits.
Il s'est enfin demandé si la crise de la presse ne correspondait pas, dans une certaine mesure, à une véritable crise du journalisme et des journalistes.
Il a affirmé que les journalistes étaient certes les principales victimes de la crise de la presse hexagonale : variables d'ajustement de titres en difficulté, ils officient dans des conditions de plus en plus précaires et subissent des pressions de plus en plus intenses.
Mais en provoquant de véritables désastres médiatiques tels que le traitement des affaires « Alègre » ou « Outreau », les journalistes ont également porté un coup à la crédibilité de la presse censée éviter les errements des médias tels que la télévision et la radio.
a alors proposé les pistes de réflexion et les voies de réforme envisagées par le groupe de travail.
Il a jugé essentiel, en premier lieu, de redonner au système de diffusion de la presse une certaine efficacité par l'intermédiaire de solutions négociées dans le cadre du système coopératif.
Il lui est notamment apparu nécessaire d'ajouter à la définition actuelle du produit presse une référence à un « apport éditorial substantiel », afin de réserver le régime issu de la loi du 2 avril 1947 à des produits en harmonie avec l'objet visé par le législateur.
Afin de lutter contre les comportements opportunistes qui perturbent le fonctionnement du réseau, il lui a également semblé utile de mettre en place une période probatoire destinée à réguler le flux croissant de nouvelles publications à la durée de vie limitée.
Il a déclaré que la recomposition et la modernisation du réseau des diffuseurs devaient constituer la priorité d'une « filière presse » toujours dépendante des résultats de la vente au numéro. De ce fait, il a proposé d'améliorer le maillage du territoire national par la mise en place d'un réseau de vente différencié se caractérisant par :
- le renforcement du réseau existant ;
- l'ouverture de points de vente en centre-ville proposant aux lecteurs l'ensemble de l'offre de presse ;
- le développement de points de vente spécialisés ;
- la mise en place de points de vente complémentaires ne proposant que les quotidiens et les titres à grande diffusion.
Il a également préconisé de moduler la rémunération des diffuseurs en fonction des contraintes impliquées par leur degré de spécialisation, afin qu'un point de vente recevant toute l'offre de presse soit mieux rémunéré que celui qui n'en propose qu'une partie.
Enfin, il a recommandé d'associer les diffuseurs à la gestion de l'offre de titres. Simple manutentionnaire, le diffuseur doit redevenir commerçant et décider lui-même du nombre de titres exposés, en fonction de sa clientèle et de son espace de vente.
Au cas où ces solutions négociées ne pourraient voir le jour en raison de l'opposition de quelques éditeurs, le rapporteur a estimé que ces réformes pourraient être menées par la voie législative en envisageant :
- de faciliter la prise de décision au sein des coopératives de presse en aménageant le principe « une entreprise, une voix », édicté dans un contexte politique et une composition de marché historiquement datés.
- de restaurer l'esprit de la loi du 2 avril 1947 et sa volonté de garantir principalement la distribution des titres de presse d'opinion sur l'ensemble du territoire : elle consiste à restreindre : en restreignant le champ du texte de loi aux seuls titres d'information politique et générale.
a en outre fait des propositions concernant l'aide au portage. Si la vente au numéro et l'abonnement postal sont les deux formes de diffusion les plus couramment utilisées sur notre territoire, le portage constitue indéniablement un aspect important de la modernisation du secteur de la presse écrite, notamment pour les quotidiens.
Dans ces conditions, il a estimé nécessaire de réformer l'aide publique au portage afin de donner un second souffle à un dispositif qui semble péricliter. Il a appelé de ses voeux l'évaluation de l'efficacité et de la pertinence actuelle de cette aide afin d'envisager d'éventuelles voies de réformes.
Un certain nombre des personnalités auditionnées par le groupe de travail ayant laissé entendre que la crise de la presse quotidienne serait avant tout une crise du contenu, M. Louis de Broissia, rapporteur, a souhaité susciter chez les éditeurs de presse quotidienne une véritable réflexion en matière éditoriale afin que leurs titres éveillent à nouveau chez le lecteur potentiel l'envie d'acheter.
Pour ce faire, il a suggéré de créer un « Médiamétrie » de la presse quotidienne consacré à l'étude des comportements d'information et de loisirs des lecteurs, tout en incitant les éditeurs à renouveler l'offre éditoriale en rompant avec l'élitisme, le catastrophisme, la partialité et l'impersonnalité des titres.
D'autre part, le groupe de travail a appelé de ses voeux une politique volontariste de la part des éditeurs et des pouvoirs publics destinée à sensibiliser les jeunes générations à la lecture de la presse. Pour ce faire, il a proposé trois actions destinées à favoriser « la prise en main » de la presse quotidienne par les jeunes de 11 à 18 ans, visant à :
- garantir le libre accès des quotidiens aux classes de collège ;
- financer un abonnement individuel à chaque élève rentrant en seconde ;
- et installer des points de vente dans les lycées.
Abordant le défi majeur de la définition d'un nouveau modèle économique permettant de garantir la pérennité de la presse dans l'univers numérique, le rapporteur a fait part de deux certitudes : ce modèle reposera sur l'existence de groupes plurimédias et sur l'exploitation des informations sur plusieurs supports de diffusion.
Dans ces conditions, il a proposé de :
- favoriser la constitution de groupes plurimédias en ajustant les règles anticoncentration plurimédia et en autorisant les groupes français et européens à détenir un quotidien, quels que soient leurs actifs ;
- trouver une solution au droit d'auteur en laissant à l'éditeur, pendant un laps de temps limité, toute liberté pour organiser l'exploitation multisupport d'un même article.
Le renouveau de la presse nécessitant également des mesures précises à l'égard des journalistes, le rapporteur a souhaité proposer trois réformes permettant de conforter leur position.
La première repose sur l'intégration des chartes d'éthique et de déontologie des journalistes au sein des textes régissant la profession, et notamment de la convention collective nationale de travail des journalistes. Il est apparu urgent au rapporteur de rendre opposables ces chartes afin de garantir le libre exercice de la profession de journaliste et la qualité de l'information.
Les deux autres mesures sont relatives à l'inscription de la protection des sources dans le droit positif français.
Il convient ainsi de préciser qu'il ne pourra être porté atteinte au droit des journalistes et à la protection de leurs sources d'information qu'à titre exceptionnel et lorsque la nature de l'infraction, sa particulière gravité, le justifient.
Il paraît également nécessaire d'étendre au domicile des journalistes les règles spécifiques applicables aux perquisitions effectuées dans une entreprise de presse, protégeant ainsi le travail des nombreux journalistes indépendants et « free-lance ».
Le rapporteur a regretté que ces deux mesures, annoncées par le précédent Garde des sceaux, n'aient toujours pas été inscrites à l'ordre du jour parlementaire. Elles constitueraient pourtant un signe fort à l'endroit d'une profession en plein doute ainsi qu'une occasion de conformer notre législation aux exigences de l'article 10 de Convention européenne des droits de l'homme.
Un débat s'est ensuite engagé.

a souhaité insister sur la formation des journalistes et sur l'inféodation des écoles de journalisme à une pensée unique pénalisante pour la presse quotidienne française. Il a rappelé que cette inféodation avait amené l'Institut d'études politiques de Paris à créer sa propre école.

a toutefois indiqué que les modalités de recrutement des écoles de journalisme avaient considérablement évolué, contribuant ainsi à la diversité des points de vue des professionnels qui y sont formés. Il a également regretté que les patrons de presse aient perdu contact avec le terrain et soient devenus de simples managers.
A l'issue de cet échange de vues, la commission a approuvé les conclusions du groupe de travail et en a autorisé la publication sous la forme d'un rapport d'information.
Enfin, la commission a décidé de proposer à la nomination du Sénat MM. Louis de Broissia et David Assouline pour siéger au sein de la commission du dividende numérique.