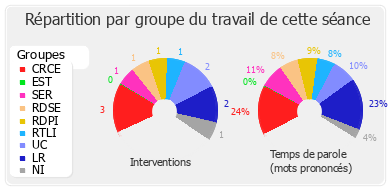Séance en hémicycle du 24 juin 2020 à 21h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à dix-neuf heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Marc Gabouty.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle le débat, organisé à la demande du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, sur le thème : « Quelle réponse de la France au projet d’annexion de la vallée du Jourdain par l’État d’Israël ? »
Dans le débat, la parole est à Mme Christine Prunaud, pour le groupe auteur de la demande.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens à remercier la conférence des présidents et, en particulier, M. le président du Sénat et M. le président de la commission des affaires étrangères pour l’inscription à l’ordre du jour de ce débat.
Permettez-moi de commencer mon propos en citant des propos tenus en 2017 par M. Jean-Paul Chagnollaud, président de l’Institut de recherche et d’études Méditerranée Moyen-Orient : « Les gouvernements israéliens de ces dernières années ont tout fait pour tourner le dos à Oslo, accentuer leur contrôle sur la population palestinienne des territoires et accélérer, dans des proportions jusque-là jamais atteintes, la colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est avec l’obsession d’y établir, encore et encore, des faits accomplis qu’ils veulent irréversibles. La prochaine étape est l’annexion de tout ou partie de la zone C, ce qui est déjà une réalité de facto dans la vallée du Jourdain entièrement absorbée par le système de domination israélien. »
Je partage totalement cette analyse d’un statu quo qui dure depuis des années. Le niveau de la violence que subissent les Palestiniens s’amplifie. Une grande partie de la communauté internationale a considéré et juge malheureusement toujours acceptable ce niveau de violence, malgré des droits internationaux constamment bafoués.
Avant de poursuivre mon intervention, je tiens à vous préciser, mes chers collègues, que la défense de la Palestine et du droit international n’est pas la remise en cause de l’État d’Israël. Cette mise au point était nécessaire.
Le 28 janvier 2020, Donald Trump, aux côtés de Benyamin Netanyahou, dévoilait son plan de paix. En fait, il s’agit davantage d’un plan de guerre contre les Palestiniens. Les plus grandes puissances mondiales se sont seulement indignées de ce plan. Il était donc impensable pour les Palestiniens de coconstruire cette feuille de route qui ne leur laissait aucune place.
Très bientôt, le 1er juillet prochain, la Knesset pourrait se prononcer sur le plan Netanyahou, qui comprend l’annexion par Israël de la vallée du Jourdain. Celle-ci est déjà en grande partie sous le contrôle de l’État d’Israël et des colonies juives en Cisjordanie, devenues légales avec la bénédiction de M. Trump.
Sachant qu’Israël occupe au moins 85 % de la Palestine historique, il faut surtout avoir conscience que ce vote marquerait, à coup sûr, la mort d’une solution à deux États.
En ce sens, les propositions de Donald Trump sur la Palestine sont une provocation. Ainsi, la Maison-Blanche imposerait aux Palestiniens un État démilitarisé et non souverain, puisqu’il n’aurait de contrôle ni sur ses frontières ni sur son espace aérien.
Pire que tout, son territoire serait totalement morcelé. Ce qui est prévu, c’est bien un archipel d’une demi-douzaine de cantons, voire d’îlots – le vocabulaire employé pour décrire ces territoires est abondant –, séparés par des zones de territoire israélien et reliés entre eux par des routes, des tunnels, des ponts et des check-points ; il aurait une seule frontière directe avec un autre État, l’Égypte, mais il s’agirait, là encore, d’une frontière virtuelle, puisque sous contrôle israélien, et aux limites encore inconnues.
Poursuivons l’énumération du contenu dévastateur de ce plan : il ne sera plus question du retour des réfugiés et de leurs descendants, il sera possible de transférer administrativement entre 300 000 et 400 000 Palestiniens du « Triangle » et la résolution 194 de l’Assemblée générale des Nations unies ne sera pas appliquée, non plus que les autres, d’ailleurs : aucune résolution n’a été appliquée !
En monnaie d’échange, M. Trump propose aux Palestiniens une aide de 50 milliards de dollars pour l’économie et le logement, voire l’éducation – on ne sait exactement –, secteurs en partie sous contrôle israélien.
Quel sera l’avenir des Palestiniens des territoires occupés et bientôt annexés ? Vers où seront-ils expulsés de la terre où ils sont nés, où ils vivent et qu’ils font fructifier ? Sous quel statut de citoyen vivront-ils ?
Ne nous méprenons pas : c’est un peuple encore plus soumis à Israël qui se prépare. C’est la fin du mince espoir d’une solution où les Palestiniens seraient maîtres de leur territoire, en toute souveraineté, et de leur destinée.
Des voix s’élèvent néanmoins à travers la population israélienne, mais aussi au sein de l’armée et du renseignement, sur la provocation que constitue cette annexion. Cette prise de conscience se diffuse assez largement.
En témoigne la tribune parue dans L e Monde le 18 juin dernier : l’ont signée une cinquantaine de personnalités et d’organisations juives qui voient dans ce projet d’annexion un dévoiement du projet sioniste porté par David Ben Gourion. Ce qui devait être un pays d’accueil et de refuge, démocratique et en paix avec ses voisins, s’est transformé depuis des années en un État agressif et discriminatoire.
En réponse au plan Trump, l’Autorité palestinienne a déjà annoncé la fin – du moins la remise en question – de la coopération sécuritaire qui est en place actuellement en Cisjordanie et permet de contenir autant que possible les violences entre chaque camp.
Politiquement – ce n’est pas à négliger dans la société israélienne –, cette annexion aurait pour conséquence que les Arabes palestiniens représenteraient environ 40 % de la population israélienne. Pour un gouvernement qui, il y a deux ans, a fait voter une loi sur « l’État-nation, État juif », cette décision constitue une source d’instabilité à l’intérieur même de ses frontières. Il faut rappeler le contenu de cette loi très grave : le droit à l’autodétermination des peuples est réservé à la population juive, la langue arabe est retirée de la liste des langues officielles, le caractère juif de l’État – État qui devient donc théocratique – est reconnu.
Nous essayons tous ici de persévérer dans la défense de la solution à deux États, du droit au retour des réfugiés palestiniens, du statut de Jérusalem comme ville internationale et capitale partagée des deux États : c’est le strict respect du droit international et des résolutions de 1947 créant l’État d’Israël et de 1967 en fixant les frontières.
Face à la présente situation, nous assistons pourtant aujourd’hui à une paralysie des Nations unies et de l’Union européenne, du fait des désaccords entre certains pays et de la frilosité des plus grandes puissances.
Les États occidentaux ne condamnent pas ce plan, mais affirment seulement qu’il est contraire au droit international et aux résolutions des Nations unies.
Je regrette que notre gouvernement se cache derrière la nécessité d’une action unanime des États européens, que l’on sait impossible en l’état, pour ne rien faire de concret pour la reconnaissance des droits du peuple palestinien et d’un État palestinien.
Accompagnons avec conviction et détermination nos amis palestiniens, mais également israéliens, dans l’espoir d’un avenir de paix, d’un avenir qui ne soit pas fondé sur la suprématie de certains et l’oppression des autres, mais sur la pleine égalité, la liberté, la dignité et les mêmes droits pour tous.
Monsieur le ministre, nous avons récemment évoqué ce dossier avec vous en commission des affaires étrangères : nous savions que nous nous retrouverions aujourd’hui pour ce débat ; je vous remercie de votre présence ce soir. Il reste quinze jours pour que notre pays riposte : c’est le mot que vous aviez alors employé et qui m’avait plutôt convenu. Mais quelle riposte ? Pourriez-vous au moins nous indiquer quelles mesures le Gouvernement compte mettre en œuvre ou, à défaut, quelles pistes il entend suivre ? Je vous remercie de votre attention et des réponses que vous saurez nous donner.
Applaudissements sur les travées des groupes CRCE et SOCR. – M. Olivier Cigolotti et Mme Agnès Constant applaudissent également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme le disait à l’instant ma collègue Christine Prunaud, face au crime contre le droit international et le droit des Palestiniens qui se profile à partir du 1er juillet si Benyamin Netanyahou met à exécution son projet d’annexion, le temps des communiqués de presse et des déclarations de principes est passé : le temps est venu d’accompagner ces déclarations d’une riposte forte, déterminée et tenace dans la durée, de la France, de l’Union européenne et des Nations unies contre un processus de colonisation et de sabotage des accords d’Oslo qui dure depuis trop longtemps sans réaction à sa mesure. Je ne parle pas ici de l’action des ambassadeurs de France qui se sont succédé à notre consulat de Jérusalem, qui ont toujours agi avec courage, mais de la nécessaire riposte du gouvernement de la France et de son Président de la République.
C’est pour entendre les voies choisies pour cette riposte que nous avons demandé ce débat, car seule une pression internationale d’ampleur peut arrêter le projet.
Adversaire farouche du processus de paix et de la solution à deux États, le Premier ministre israélien a tout fait pour les miner, pas à pas ; aujourd’hui, il veut porter le coup fatal.
Ne pas réagir, sinon par des mots, une fois de plus, ce serait nier le danger majeur encouru de toutes parts.
Danger encouru par les Palestiniens, dont le droit reconnu à vivre en paix dans leur État, avec Jérusalem comme capitale partagée, serait bafoué corne jamais.
Danger encouru par le droit international et la solution multilatérale agréée selon des paramètres reconnus par l’ONU, au moment même où le multilatéralisme fondé sur le droit est attaqué de toutes parts et laisse place à la loi du plus fort, à la politique du fait accompli par la force.
Danger encouru par la région, déjà à feu et à sang, par les pays arabes voisins, au premier rang desquels la Jordanie et sa population.
Danger encouru, enfin, par les Israéliens eux-mêmes, qui ne seraient plus, alors, les citoyens de l’État qu’ils espéraient, mais seraient enfermés par leurs dirigeants dans ce qui deviendrait un État d’apartheid, reléguant des millions de Palestiniens dans des bantoustans sans droit réel à la citoyenneté, un État dès lors durablement instable et connaissant plus d’insécurité que jamais.
Oui, nous avons le devoir de réagir avec force, au nom de la justice, de la paix et du droit !
Nous n’en pouvons plus, monsieur le ministre, de nos accommodements avec l’inacceptable au nom d’un prétendu réalisme. Où cela nous a-t-il menés ?
Quand les deux chambres du Parlement français ont voté la demande d’une reconnaissance de la Palestine par le Président de la République, on nous a dit que c’était trop tôt, puis qu’il fallait attendre le plan américain. Deux présidents ont passé et le scandaleux plan Trump est arrivé, qui donne son imprimatur à l’annexion après avoir coupé les vivres à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNWRA), de manière à nier les droits des réfugiés, et validé le déménagement de l’ambassade américaine à Jérusalem.
Quand le plan Trump a été rendu public, vous l’avez condamné dans les mots, mais encore bien timidement au départ, …

… comme s’il y avait encore matière à discuter, alors que ce plan visait clairement à fermer le ban d’une solution viable à deux États.
Quand des militants parlaient boycott des produits issus des colonies, désinvestissement, sanctions, ils ont été traînés devant la justice et leurs actes assimilés à de l’antisémitisme. Or la Cour européenne des droits de l’homme vient de condamner la France, par une décision du 11 juin dernier rétablissant ces militants dans leurs droits.
Oui, aujourd’hui, il faut clairement et fermement dire : « Stop ! » Il faut agir avant le 1er juillet. Il est déjà bien tard, diront certains ; en vérité, il ne sera jamais trop tard, car le combat pour le droit des Palestiniens ne cessera pas.
Si nous laissons Benyamin Netanyahou avancer, il le fera, car il est prêt à tout. Il est de la trempe de ces dirigeants extrémistes avec lesquels il s’entend si bien, de Trump à Bolsonaro ; qui sait s’il ne pactisera pas, demain, avec Erdogan pour se partager la région sur le dos des autres puissances et des Palestiniens, après avoir attisé le feu dans la région.
C’est en raison, aussi, de ces rapprochements troubles que nous refusons d’écouter l’argument qui voudrait que l’on s’abrite derrière la décision de refuser de s’engager dans des sanctions européennes prise par quelques pays emmenés par la Pologne et la Hongrie. Ne trouveriez-vous pas honteux, monsieur le ministre, que ces pays dont nous combattons les dérives antidémocratiques deviennent l’alibi de notre inaction, de l’inaction européenne ?
Oui, monsieur le ministre, nous attendons du Gouvernement et du Président de la République des actes forts. Des possibilités existent.
Nous devons agir à l’ONU et avec l’ONU, aux côtés de son secrétaire général et de la majorité des nations, et saisir le Conseil de sécurité pour exiger la condamnation qui s’impose.
Nous devons reconnaître l’État de Palestine. En ces circonstances, un tel geste dirait mieux que tout autre discours notre refus de l’impasse dramatique envisagée et déclencherait sans nul doute un mouvement international d’ampleur. En effet, il ne faut pas seulement s’opposer au plan d’annexion ; il faut du même coup contre-attaquer et relancer le processus inverse, vers la solution de paix à deux États.
Nous devons travailler avec Josep Borrell, pour proposer à l’Union européenne d’adopter des sanctions, notamment la suspension de l’accord d’association, mais aussi envisager la suspension des accords de coopération militaire et la réévaluation d’investissements impliqués dans le processus de colonisation.
Oui, monsieur le ministre, il est possible, il est urgent, il est conforme à nos valeurs d’agir. Tout nous commande de le faire, de la gravité de la situation sur place aux dangers de la situation internationale. Ne comptons pas sur une quelconque lassitude : les Palestiniens sont à bout et la région est une poudrière depuis longtemps, l’annexion n’annonce donc que le pire pour demain.
N’oublions pas les paroles de Yitzhak Rabin, quelques minutes avant d’être assassiné : « Nous avons fondé un peuple, mais nous ne sommes pas revenus dans un pays vide. » Sans cette promesse de reconnaissance et de respect mutuel, la paix n’adviendra pas.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE, ainsi que sur des travées du groupe SOCR.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà plus de soixante-dix ans que la Palestine et Israël sont en conflit, un conflit dont les conséquences dépassent les frontières de ces deux pays et se font sentir dans toute la région. La Jordanie, le Liban et la Syrie, notamment, accueillent de très nombreux réfugiés palestiniens et sont directement déstabilisés par cet affrontement. L’Europe a elle aussi été directement atteinte, puisqu’elle a été le théâtre de plusieurs attentats. Parce qu’il met en cause le principe d’intangibilité des frontières et celui de l’autodétermination des peuples, ce conflit possède une dimension universelle.
Les décennies passant, certains ont pu déplorer une forme de lassitude de la communauté internationale. Le projet d’annexion par Israël du tiers de la Cisjordanie occupée, qui sera précisé dès le 1er juillet, attire de nouveau l’attention sur ce conflit dont la résolution semble s’éloigner toujours plus du droit.
Figurant dans le plan de paix américain, cette annexion bénéficie du soutien actif des États-Unis de M. Trump, véritable intermittent de la déstabilisation à la politique étrangère isolationniste.
Si cette annexion avait lieu, elle n’en constituerait pas moins une violation du droit international. Les Nations unies, par la voix de leur secrétaire général António Guterres, ont rappelé la solution prévue par le droit : « Deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité à l’intérieur de frontières reconnues, sur la base des lignes antérieures à 1967. »
Quelle serait l’autre solution ? Ne pas appliquer le droit international, c’est entériner la loi du plus fort, où la force est le droit. Cela implique encore plus de violences ; or cette région en a déjà beaucoup trop connu. L’annexion aggraverait fortement les tensions qui traversent la région.
Un autre chemin est possible. Ces dernières années, nous avons observé un rapprochement inédit entre les pays arabes et Israël. Il existe à présent une coopération entre les pays de la région en matière de renseignement, en matière économique, mais aussi en matière culturelle. Ces relations nouvelles sont une chance, mais elles restent à l’évidence fragiles.
Les Émirats arabes unis, qui comptent parmi les pays arabes ayant des liens forts avec Israël, ont mis en garde contre ce projet d’annexion. Il mettrait un coup d’arrêt certain et immédiat au processus de normalisation des relations. Ce rapprochement est pourtant une occasion historique pour la région et pour tous ceux qui y vivent. Il rend la coexistence pacifique envisageable. Les Palestiniens ont répondu au plan de paix de M. Trump par une contreproposition qui prévoit la création d’un « État palestinien souverain, indépendant et démilitarisé ». Le principe d’un État palestinien démilitarisé aux côtés d’Israël avait été accepté par Benyamin Netanyahou lors de son discours de juin 2009 à l’université israélienne Bar-Ilan.
La Palestine et Israël sont à un tournant de leur histoire : la solution à deux États, souverains et coexistant pacifiquement, est possible. Il ne faut pas renoncer à la négociation, mais saisir les mains tendues.
Ne laissons pas l’histoire se répéter. Le respect des instances internationales est une exigence indispensable pour assurer les conditions de la paix et du progrès. Le projet d’annexion détruira tout espoir d’un État palestinien indépendant. Il ne faut pas donner plus d’arguments aux extrémistes qui ne cherchent que le chaos.
Ce qui vaut pour l’annexion vaut également pour le processus de colonisation des territoires palestiniens par Israël. Les violations du droit international doivent cesser pour qu’une paix durable puisse exister. « Le plus fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître », nous rappelle Rousseau. Personne n’a intérêt à la loi du plus fort !
Alors, quelle doit être la réponse de la France à ce projet d’annexion ? Elle ne peut pas, bien sûr, soutenir la violation du droit international. La réponse de la France doit être européenne. L’Union a déjà fait savoir qu’elle s’opposerait à une telle annexion.
Si Israël ne renonce pas à ce projet, nous voulons que l’Europe fasse entendre sa voix. La diplomatie européenne doit dépasser les incantations et défendre ses valeurs et ses principes, en particulier la protection des minorités.
L’Europe a en outre les moyens de peser contre cette décision d’annexion en tant que premier partenaire commercial de l’État hébreu. L’Union européenne a su faire naître la paix sur un vieux continent, divisé et belliqueux, autrement que par la guerre. Elle doit s’engager en faveur de la paix au Moyen-Orient, car elle ne manquerait pas de souffrir d’une reprise des hostilités.
Dans un village mondial où la violence est monopole d’État, seul le respect du droit saura structurer une société planétaire pacifiée.
Applaudissements sur les travées des groupes CRCE, SOCR et UC.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans l’histoire déjà trop longue du conflit israélo-palestinien, le 1er juillet 2020 fera date comme point de départ d’une nouvelle étape. C’est en effet à partir de ce jour que le gouvernement israélien devra se prononcer sur la mise en œuvre du plan de paix de l’administration Trump relatif au Proche-Orient.
Ce plan, présenté en janvier dernier comme le « deal du siècle », ne propose rien de moins que l’annexion par Israël de la vallée du Jourdain et des colonies juives de Cisjordanie, soit environ le tiers de la superficie de cette dernière, en échange de la reconnaissance d’un État palestinien à la souveraineté diminuée, sans armée ni contrôle sur ses frontières, et sans Jérusalem.
Ce plan, bien évidemment fait sien par le Premier ministre israélien et rejeté par les Palestiniens, marque tout d’abord une rupture.
Une rupture avec le consensus international, car il jette aux orties les accords d’Oslo de 1993, qui devaient aboutir à la création mutuellement acceptée de deux États souverains, avec des frontières stables et Jérusalem pour capitale partagée.
Une rupture, aussi, car c’est la première fois qu’un plan de résolution prend pour point de départ une situation de fait, celle de la colonisation, et non la situation depuis longtemps artificielle que reconnaît le droit international.
Une initiative unilatérale d’Israël vers l’annexion serait considérée comme une violation du droit international ; elle créerait, de surcroît, un risque de chaos dans la région, ce qui aurait des conséquences terribles pour la population, le risque de flambée de la violence au Proche-Orient étant au plus haut.
Telle est la position de la France et de la plupart de ses partenaires occidentaux. Cependant, cette seule position ne nous permet pas d’influer sur la situation, car nous en sommes réduits aux protestations de principe qui sont, avouons-le, sans grande portée.
Conscients des enjeux, les États européens tentent en effet de faire valoir la prévalence du droit international.
Alors que l’Union européenne, premier partenaire économique d’Israël, pourrait être en position de force, notre désunion nous rend inaudibles. La politique étrangère de l’Union se décidant à l’unanimité des États membres, il lui faut trouver des compromis, d’autant plus délicats que l’héritage de la Shoah s’ajoute aux enjeux stratégiques et économiques.
Cet attentisme forcé est d’autant plus dommageable que ce qui serait vécu comme une humiliation par les Arabes pourrait très bien avoir des répercussions jusque dans notre pays, notamment dans nos quartiers les plus sensibles. Au-delà même de l’Union européenne, la pression internationale s’était déjà révélée inefficace pour lutter contre le processus de colonisation. Le soutien indéfectible de Washington au gouvernement Netanyahou, depuis quatre ans, surpasse le reste. Pour comble, il vient même accélérer le processus, l’État hébreu souhaitant agir vite dès lors que les élections américaines de novembre prochain pourraient conduire à un changement d’administration.
La perspective de l’annexion pose également de graves questions au sein même du peuple israélien. Ce serait en effet une erreur de considérer celui-ci comme un bloc monolithique, uni derrière son Premier ministre.

Certains Israéliens voient ainsi dans cette perspective une aubaine à saisir, quand d’autres la considèrent comme un cadeau empoisonné. D’autres encore jugent que le plan Trump ne va pas assez loin et que la Cisjordanie et Gaza appartiennent à Israël.
Cependant, la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19 incite d’autant plus les Israéliens à la prudence qu’ils sont conscients des troubles sécuritaires qu’occasionnerait l’annexion. Autant dire que l’idée est loin de faire consensus.
Il est donc permis de croire que la population israélienne est moins naïve que certains aimeraient le penser, car bien consciente que ce plan de paix permettra tout sauf, justement, la paix.
Comment imaginer un seul instant qu’un État palestinien non viable, à la souveraineté limitée, puisse jamais être accepté par son peuple et, si tant est qu’il le soit, puisse vivre normalement ?
Le découpage de la Cisjordanie proposé par le plan Trump ne répond à aucune logique, mais s’apparente à une succession d’enclaves sans aucune cohérence, à une conurbation désordonnée.
À l’extérieur des frontières d’Israël et de la Palestine, l’annexion entraînerait nécessairement une réaction des pays arabes voisins. Malgré leur lassitude à l’égard de ce conflit, ils ne peuvent rester sans réagir, au risque de se décrédibiliser aux yeux de leur opinion publique.
Les Émirats ont d’ailleurs récemment mis en balance la perspective de leur normalisation des relations avec l’État hébreu dans l’espoir de faire pencher la balance vers la retenue.
La Jordanie serait, pour sa part, sans doute contrainte de remettre en cause sa coopération avec Tel-Aviv, notamment concernant les lieux saints de Jérusalem. Ce pays devrait en outre se préparer à voir arriver de nouveaux flux de réfugiés en provenance de la vallée du Jourdain, ce qui mettrait gravement en danger son économie et sa cohésion déjà si fragiles. Le risque de déstabilisation de la région est donc immense.
La question de l’eau me semble également être une donnée cruciale du conflit. L’ancien Premier ministre israélien Yitzhak Rabin l’expliquait déjà en 1992 : « Si nous réglons tous les problèmes du Proche-Orient, mais pas celui du partage de l’eau, la région explosera. La paix ne sera pas possible. »
La question centrale et inquiétante de l’accès à l’eau des territoires palestiniens est pourtant posée par l’annexion de la vallée du Jourdain. Faut-il y voir la fin de l’agriculture palestinienne et donc l’apparition d’une certaine insécurité alimentaire pour ces territoires ?
La mise en œuvre de l’annexion des colonies et de la vallée du Jourdain constitue donc une manœuvre infiniment dangereuse, qui déstabilisera encore plus une région déjà soumise à de multiples tensions.
Pour satisfaire la frange la plus extrême de l’opinion israélienne, elle crée plus de problèmes qu’elle n’en résout, au premier rang desquels le statut des Palestiniens eux-mêmes.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous devons garder en mémoire cette citation d’Albert Einstein : « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. »
Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées des groupes SOCR et Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la gravité des propos des collègues qui m’ont précédé le démontre : nous sommes peut-être à un tournant historique dans cette région du monde. Si le gouvernement israélien persiste dans le projet d’annexion de la vallée du Jourdain et de relance de la colonisation, nous assisterons sans doute à la fin de la séquence ouverte en 1993 avec les accords d’Oslo. En effet, ce processus reposait sur l’idée d’une solution juste et durable au conflit israélo-palestinien, reposant sur deux États ayant chacun Jérusalem comme capitale.
Certes, la perspective de l’annexion inscrite dans le contrat de coalition de l’actuel gouvernement israélien découle évidemment du plan Trump, qui prévoit un « État » palestinien fait d’une étonnante constellation de parcelles plus ou moins reliées entre elles. Disons les choses franchement : personne ne peut en vérité croire à la viabilité d’une pareille entité. Par conséquent, l’annexion de la vallée du Jourdain, si elle devait se produire, marquerait l’ouverture d’une nouvelle séquence dans ce long et douloureux conflit. J’emploie le conditionnel, car il peut y avoir encore un espoir que le gouvernement israélien entende la voix de ses amis et, surtout, les voix de plus en plus nombreuses qui s’élèvent contre ce projet en Israël même, où deux tiers des Israéliens y seraient opposés, et dans la diaspora, notamment américaine.
La France est l’amie d’Israël, elle l’a toujours été. Les liens entre nos deux pays sont forts, profonds, sincères. C’est pourquoi, fidèle à sa tradition politique et à sa culture, notre pays ne peut pas laisser sans rien dire un pays ami plonger dans l’inconnu. Ce qui paraît acquis, et cela inquiète vivement les responsables militaires et sécuritaires israéliens, c’est que ce tournant débouchera sur une relance du cycle de la violence, amplifiée par l’arrêt inévitable de la coopération sécuritaire entre Israël et l’Autorité palestinienne. Ni les Israéliens ni les Palestiniens n’avaient besoin de cela !
Au-delà de la réaction des Palestiniens, dont nul ne peut aujourd’hui estimer l’ampleur et la forme, il y a bien d’autres conséquences négatives prévisibles pour Israël. On pense d’abord aux pays qui ont conclu des traités de paix avec Israël : l’Égypte et la Jordanie. La Jordanie, en particulier, a prévenu que l’annexion de la vallée du Jourdain et l’éventuelle remise en cause du statut de l’esplanade des mosquées étaient inacceptables et auraient de lourdes conséquences. C’est aussi le rapprochement d’Israël des pays du Golfe, favorisé par une crainte commune de l’activisme iranien sur tous les fronts de la région, qui serait bien évidemment compromis, sans doute irrémédiablement. C’est enfin le lien entre Israël et la diaspora qui serait mis en tension.
Reste la question de fond, la question centrale à laquelle on est toujours ramené lorsque l’on se soucie, comme nous tous, de l’avenir de ce pays qui nous est proche : si Israël ferme la possibilité de deux États, quel avenir entend-il dessiner pour tous ceux qui auraient pu être un jour les citoyens d’un État palestinien ? C’est notamment pour tâcher d’éclairer cette question que j’avais décidé, avec le bureau de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, d’organiser une mission d’information en Israël et dans les Territoires palestiniens. Celle-ci a été temporairement différée par la crise du Covid-19, mais la question reste posée, brûlante et inquiétante, tant elle semble mener à une impasse.
En effet, de deux choses l’une : soit les Palestiniens seront des citoyens à part entière de cet État unique, et cela posera la question de l’identité de l’État d’Israël, car l’ensemble des Arabes israéliens et des Palestiniens représenteraient déjà la moitié de la population de ce large ensemble ; soit les Palestiniens ne seraient pas des citoyens à part entière, ce qui serait en contradiction avec la nature démocratique de l’État d’Israël affirmée lors de sa création et sans cesse démontrée depuis.
Il y a là une équation politique insoluble. C’est pourtant dans cette voie périlleuse que le gouvernement israélien pourrait s’engager dans quelques jours.
Nous devons alerter nos amis israéliens sur le danger que ce projet d’annexion ferait peser sur l’État d’Israël, sur sa sécurité, sur son image et même sur son identité. Il est utile de rappeler les mots de Theodor Herzl : « S’il se trouve parmi nous des fidèles appartenant à d’autres religions ou à d’autres nationalités, nous leur garantirons une protection honorable et l’égalité des droits. » Et Herzl de jeter le pont intellectuel et culturel entre le sionisme et la culture européenne en ajoutant : « L’Europe nous a enseigné la tolérance. »
Voilà qui me conduit, monsieur le ministre, à vous demander ce que l’Europe est aujourd’hui en situation d’apporter dans ce conflit. Le haut représentant de l’Union européenne, Josep Borrell, a déclaré le mois dernier : « Nous sommes prêts à utiliser toutes nos capacités diplomatiques afin de prévenir toute forme d’action unilatérale. » Vous-même avez déclaré devant notre commission qu’une annexion par Israël de la vallée du Jourdain ne pourrait rester sans réponse. Mais quelle réponse ? C’est ce que nous attendons, ce soir. De quoi parlons-nous concrètement ?
Nous comprenons bien que certains canaux diplomatiques fonctionnent mieux dans une certaine discrétion, mais, si nous ne pesons plus sur le cours des choses, notre discrétion ne confine-t-elle pas à l’effacement ? Nous voyons – ce n’est malheureusement un secret pour personne – que les Européens peinent à parler d’une seule voix dans ce dossier, ce qui, évidemment, affaiblit leurs positions.
Alors, à défaut d’avoir une voix claire et forte à l’échelon européen, du moins pourrions-nous espérer faire entendre haut la voix de la France, ce qui serait déjà un début pour structurer une réponse européenne. Malheureusement – nous le ressentons ainsi –, nos positions semblent figées, alors que la situation, elle, évolue et pourrait même dégénérer rapidement.
Monsieur le ministre, personne ne remet ici en cause votre implication personnelle – en ce qui me concerne, je la connais – dans ce dossier extrêmement complexe et sensible, et vous n’avez pas ménagé votre peine. Pour autant, quelle est la vision de la France, au-delà de la répétition de la nécessité de respecter le droit international ? N’est-il pas temps d’aller au fond du débat, puisque celui-ci a déjà commencé en Israël ? La solution à deux États a-t-elle encore une consistance sur le terrain ? Voilà les vraies questions qu’il convient de se poser. Nous savons même que certains Palestiniens se posent désormais la question, se disant peut-être que la dernière carte qu’il leur reste est la lutte pour un État binational et l’égalité des droits.
Comment la France se positionnera-t-elle dans ce contexte ? Si Israël annexe 30 % de la Cisjordanie, si les États-Unis reconnaissent cet état de fait, quel langage tiendra la France ? Continuerons-nous à nous accrocher à l’idée de deux États, lorsque plus personne dans l’ancienne Palestine mandataire n’y croira ?
Ce sont ces questions difficiles et douloureuses que nous devons aborder avec lucidité. Ce genre de débat sert à cela. Si les choses n’évoluent pas comme nous l’aurions souhaité, il ne suffira pas de se lamenter : il faudra aussi en tirer les leçons pour la suite.
Il ne reste que quelques jours pour dissuader le gouvernement israélien de poursuivre dans cette voie porteuse de tant d’incertitudes et de dangers. Si le gouvernement israélien persiste, n’écoutant ni les Européens, ni les démocrates américains, ni les pays arabes qui lui sont le moins hostiles, ni même son propre appareil sécuritaire, la France et l’Europe ne devront-elles pas revoir entièrement les principes qu’avec constance et courage elles ont toujours défendus pour la paix dans cette région du monde ?
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC, ainsi que sur des travées des groupes LaREM et CRCE. – Mme Claudine Kauffmann applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le gouvernement israélien doit se prononcer à partir du 1er juillet sur la mise en œuvre du plan Tramp pour le Proche-Orient, qui prévoit l’annexion formelle et unilatérale par Israël de la vallée du Jourdain, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Si cette décision d’imposer ses lois en Cisjordanie occupée était mise à exécution, au mépris du droit international, elle serait non seulement dévastatrice pour une potentielle relance des négociations et pour la paix régionale, mais elle remettrait également en cause le projet même d’un État palestinien, qui est jusqu’ici au cœur du processus de paix.
En réaction, le mois dernier, le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a annoncé qu’il romprait les accords sécuritaires et économiques conclus avec Israël dans le cadre du processus de paix engagé à Oslo si le projet d’annexion était mené à bien. La Jordanie, seul pays arabe avec l’Égypte à avoir conclu un accord de paix avec Israël, a fait savoir qu’elle reconsidérerait également ses relations avec l’État hébreu en cas d’annexion.
Ce projet est contesté au sein même de la société israélienne. Plusieurs experts israéliens ont en effet publié une tribune pour faire part de leur inquiétude quant à la menace que ferait peser cette annexion sur la sécurité nationale d’Israël.
Pour les signataires de ce texte, elle remettrait en cause le traité de paix avec l’Égypte, mais également celui avec la Jordanie. Avec une communauté palestinienne très nombreuse, le Royaume de Jordanie pourrait connaître des troubles en cas d’annexion israélienne de l’autre côté du fleuve Jourdain. Or la Jordanie offre à Israël une profondeur stratégique en direction de la Syrie, l’Irak et, surtout, l’Iran. Ces troubles pourraient donc lui être fortement dommageables.
Toujours selon les signataires de ce texte, les pays arabes du Golfe favorables à Israël, notamment l’Arabie saoudite, pourraient eux aussi faire entendre leur voix face à une colère populaire attisée par la baisse des prix du pétrole.
Enfin, les signataires n’excluent pas un effondrement de l’Autorité palestinienne en cas d’annexion. Or Israël a besoin de la collaboration avec l’Autorité palestinienne dans la lutte qu’elle mène contre le terrorisme.
Le chef de file centriste de l’opposition israélienne, Yaïr Lapid, a déclaré avec le parti démocrate et une majorité des juifs américains que cette annexion unilatérale provoquerait des dommages irréparables. Quant à Amit Gilutz, porte-parole de l’ONG israélienne B’Tselem, que nous connaissons bien ici, qui lutte pour la défense des droits humains dans les Territoires palestiniens occupés et qui milite pour une solution à deux États équilibrée, il a rappelé à juste titre que cette annexion existait déjà de fait et qu’elle ne constituait qu’une volonté de légitimer une situation déjà existante et dramatique pour le peuple palestinien. Il a appelé la communauté internationale « à ne plus se taire ».
La France, qui est depuis le Brexit le seul pays de l’Union européenne membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, ne peut rester silencieuse à cet appel et doit agir pour préserver la solution à deux États, en n’abandonnant ni l’exigence de sécurité pour Israël ni celle de la justice pour les Palestiniens.
Depuis l’adoption par les deux chambres du parlement français au mois de décembre 2014 de deux propositions de résolution invitant le gouvernement français à reconnaître l’État de Palestine, force est de constater que le processus de paix est au point mort. La France a certes accueilli, en 2017, soixante-dix pays et organisations internationales pour une conférence internationale pour la paix au Proche-Orient, mais, soyons réalistes, rien n’en est ressorti.
Depuis la tenue de cette conférence, qu’il faut tout de même saluer, s’est ouverte une période d’incertitudes au Proche-Orient. Le 6 février 2017, la Knesset adoptait une loi légalisant les colonies sauvages de Cisjordanie, au mépris de la résolution 2334 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies au mois de décembre 2016. Cette loi était déjà un pas vers l’annexion formelle de la Cisjordanie. Le 19 juillet 2018, le Parlement israélien adoptait une loi fondamentale disposant qu’Israël est « l’État-nation du peuple juif » avec Jérusalem pour capitale et l’hébreu comme seule langue officielle. Le texte va à l’encontre des principes démocratiques et institutionnalise des discriminations raciales envers les Arabes israéliens.
Si le projet d’annexion de la vallée du Jourdain était formellement mis en œuvre, sans susciter de lourdes sanctions de la part de l’Europe et de la France, ce serait la fin de tout espoir de voir naître un État de Palestine.
Dans ce contexte, la France ne peut pas faire l’économie d’une réflexion en profondeur sur la méthode d’accompagnement international du processus de paix. Elle ne doit pas se résoudre à abandonner l’objectif d’un État de Palestine, vivant dans la paix et la sécurité aux côtés de l’État d’Israël, au sein de frontières internationalement reconnues et avec Jérusalem pour capitale des deux États.
Aussi, en ma qualité de président du groupe d’amitié France-Palestine de la Haute Assemblée, j’appelle une nouvelle fois, solennellement, le gouvernement français à reconnaître l’État de Palestine. Reconnaître la Palestine comme un État, ce serait se conformer au droit international et, lorsque l’on est législateur, on se doit d’être du côté du droit.
La France doit également enclencher une dynamique à l’échelon européen sur la question des sanctions. L’Union européenne doit absolument s’accorder rapidement sur des sanctions économiques à l’encontre d’Israël, si ce projet d’annexion de la vallée du Jourdain allait à son terme, comme elle a réussi à le faire à l’encontre de la Russie après l’annexion de la Crimée. Compte tenu de l’importance de leurs échanges commerciaux avec l’État hébreu, les Européens, s’ils en ont la volonté politique, ont tous les outils nécessaires pour condamner Israël.
La France devrait également manifester son soutien à l’Autorité palestinienne dans les poursuites qu’elle a entamées à l’encontre d’Israël auprès de la Cour pénale internationale en saisissant à son tour la CPI, alors que cette dernière, après un examen préliminaire de cinq ans, vient d’autoriser la Palestine à attaquer Israël pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, la France ne peut plus attendre, les enjeux sont trop importants pour se contenter de grandes déclarations et de très petites sanctions. Le gouvernement français a l’obligation d’agir, et il doit le faire maintenant.
Applaudissements sur les travées des groupes SOCR et CRCE, ainsi que sur des travées du groupe LaRE M. – M. Olivier Cigolotti applaudit également.

« Pourquoi ce besoin de nous mettre le monde entier à dos ? […] Ils pensent que c’est une chance unique qui ne se représentera jamais. C’est sûrement vrai. Mais toutes les chances ne sont pas bonnes à saisir. » Cette déclaration de Chuck Freilich, ancien conseiller israélien à la sécurité, résume l’ampleur du défi posé par le projet d’annexion de la vallée du Jourdain.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme vous le savez, le 1er juillet prochain, selon les termes d’un accord relatif à la formation d’un gouvernement d’union avec son ex-rival Benny Gantz, le Premier ministre Benjamin Netanyahou pourrait traduire dans les faits le plan de l’administration Trump qui prévoit l’annexion de près de 30 % de la Cisjordanie.
Alors que les accords de 1993 devaient ouvrir la voie à un État palestinien, le plan de paix de Trump – une proposition unilatérale – fonde Israël à agir. Certes, depuis plusieurs années, une forme d’annexion est de facto déjà visible dans cette région. La colonisation s’y accélère : 200 000 colons au moment des accords d’Oslo, 430 000 aujourd’hui. En outre, que dire de l’incorporation progressive du droit israélien en territoires occupés ?
Allant de toute évidence à l’encontre du droit international, l’annexion de la Cisjordanie par l’État israélien représenterait une grave violation de la Charte des Nations unies et des conventions de Genève. Elle serait contraire à la règle fondamentale affirmée à maintes reprises par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale des Nations unies, selon laquelle l’acquisition de territoires par la guerre ou la force est inadmissible.
Clairement, au sein de la communauté internationale, la condamnation est unanime, si je mets bien entendu de côté les États-Unis.
Dans ces conditions, que va devenir la recherche d’un axe d’entente israélo-palestinien ? Cette annexion enterrerait en effet le droit palestinien à l’autodétermination des peuples par des moyens non violents.
De l’autre côté, la diaspora, attachée au respect des droits de l’homme, pourrait ne pas reconnaître le projet sioniste visant à l’établissement d’un État juif et démocratique.
Alors que la situation humanitaire et sécuritaire est déjà difficile dans les territoires palestiniens, l’annexion pourrait provoquer une troisième intifada.
Quoi qu’il en soit, l’État israélien devra assumer le sort de centaines de milliers de Palestiniens vivant en Cisjordanie ; sort que l’on peut présumer difficile, le Premier ministre Netanyahou n’envisageant pas, selon ses propos, d’accorder aux Palestiniens résidant dans les territoires cisjordaniens annexés les mêmes droits civiques et politiques que ceux qui sont dévolus aux Israéliens. Comment accepter l’institution de citoyens de seconde zone, de deux peuples vivant dans le même espace, dirigés par le même État, mais avec des droits profondément inégaux ? Pourtant, sans sourciller, le Premier ministre a déclaré que cette annexion les « rapprocherait de la paix ».
La question israélo-palestinienne, c’est aussi un enjeu régional déterminant. Naturellement, on sait que les pays du monde arabe sont attentifs à cette phase critique.
Que vont devenir les accords de paix notamment conclus avec l’Égypte et la Jordanie ? Le chef de la diplomatie jordanienne a annoncé que l’annexion de la Cisjordanie par l’Israël serait une « menace sans précédent pour le processus de paix » et pourrait plonger le Proche-Orient dans un « long et douloureux » conflit. Je crains aussi que toutes les dernières manœuvres de rapprochement avec les pays arabes sunnites tels que l’Arabie saoudite soient définitivement enterrées…
Face à tout cela, quelle peut-être la réaction de la communauté internationale ?
La solution à deux États, que la France et l’Union européenne appellent de leurs vœux, serait réduite en poussière en cas d’annexion. Pourtant, c’est cette voie que nous devons défendre, car elle constitue le meilleur équilibre entre les aspirations des deux parties. Sur le plan géopolitique, Israël aurait plus à perdre qu’à gagner en annexant la vallée du Jourdain. Par conséquent, tout doit être mis en œuvre pour éviter cela et faire perdurer les promesses d’Oslo. C’est d’ailleurs votre position, monsieur le ministre, et mon groupe est également sur cette ligne.
Oui, il faut préserver la référence au droit international et condamner ce qui s’apparente à un passage en force ! C’est une décision unilatérale échappant complètement aux codes de la diplomatie, qui exigent au moins des négociations avec tous les acteurs concernés.
Comme vous avez déjà eu l’occasion de le rappeler, il est important de distinguer dans nos accords bilatéraux avec Israël la distinction juridique entre le territoire d’Israël et les Territoires palestiniens occupés depuis 1967. Certains y voient une sanction déguisée, mais avons-nous d’autres leviers ? En outre, cette distinction est conforme aux décisions internationales, en particulier la résolution 2334.
Mes chers collègues, aujourd’hui, de nombreuses manifestations ont lieu contre l’annexion et le plan de l’administration Trump, comme lundi dernier à Jéricho. Des milliers de Palestiniens manifestent pour leurs droits. Légitimement, ils attendent une réponse diplomatique à la hauteur des enjeux.
Dans cette perspective, monsieur le ministre, la France a toujours un rôle important à jouer. Aussi, nous comptons sur votre action bienveillante et, surtout, énergique.
Applaudissements sur des travées des groupes UC, LaREM, SOCR et CRCE.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la tenue de ce débat arrive à point nommé, à l’aube d’une date qui pourrait porter le coup de grâce à deux promesses que nous avons d’ailleurs de la peine à tenir depuis soixante-dix ans de négociations internationales. Ces promesses, ce sont celles d’une paix durable au Proche-Orient et d’une issue positive au conflit israélo-palestinien, qui permettrait à Israéliens et Palestiniens de vivre côte à côte, en paix et sécurité. Cette date, c’est celle du 1er juillet, qui a été actionnée par un compte à rebours en deux temps.
Le 28 janvier a marqué le premier temps de ce compte à rebours, lorsque le Président américain Donald Trump a présenté son plan de paix pour le Proche-Orient. Ce plan américain a été préparé sans les Palestiniens. Il met en cause le droit international en s’inscrivant en contradiction avec les accords d’Oslo de 1993 et les résolutions du Conseil de sécurité.
Ce plan peut difficilement être une base pour une solution de paix viable au moins sur deux points : d’une part, il ouvre la voie à une annexion en reconnaissant sans délai la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur les colonies dans les territoires palestiniens occupés de Cisjordanie, ce qui sortirait Israël du régime de l’occupation en vigueur depuis 1967 ; d’autre part, il nie le statut de Jérusalem comme capitale des deux États, en admettant qu’il devienne la capitale indivisible d’Israël.
Le 13 mai a marqué le second temps de ce compte à rebours, avec la prestation de serment devant la Knesset du gouvernement d’union et d’urgence de Benjamin Netanyahou et de son rival électoral Benny Gantz.
Sur la base de l’accord de coalition, Benjamin Netanyahou a solennellement affirmé le projet d’annexion d’une partie de la Cisjordanie occupée à partir du 1er juillet prochain, conformément au plan de paix américain et en coordination avec Washington. Présenté comme un « exercice de souveraineté », son caractère illégal au regard du droit international ne fait pourtant aucun doute. Peu importe que cette annexion forcée soit majeure ou ne concerne que quelques bribes de la Cisjordanie, elle serait une acquisition de territoires par la force, contraire au droit international.
Dans la société israélienne, une telle annonce ne fait pas l’unanimité, car elle fait prendre un risque aux intérêts israéliens. Un sondage du 9 juin a fait ressortir que près des deux tiers des Israéliens ne la soutiennent pas, car ils ne veulent ni trouble supplémentaire ni se retrouver au ban de la scène internationale, alors qu’ils auront assez de soucis avec les conséquences économiques de la pandémie. Le chômage s’est d’ailleurs envolé pour atteindre le taux très élevé de 29 %.
Dans une tribune publiée au début du mois d’avril, des experts et anciens hauts gradés des milieux militaires israéliens ont considéré que l’annexion de la vallée du Jourdain constituerait une menace pour la sécurité nationale d’Israël. Elle remettrait en cause le traité de paix avec l’Égypte, intermédiaire incontournable dans le dialogue avec le Hamas à Gaza et, de plus, partenaire dans la lutte contre le terrorisme dans le nord du Sinaï. Le traité de paix avec la Jordanie pourrait aussi en sortir fragilisé, la stabilité du pays se trouvant clairement remise en cause en raison de sa proximité géographique et de son rôle de garant de l’accès à l’esplanade des mosquées. Enfin, selon eux, une telle annexion anéantirait tout espoir d’une coopération renforcée entre Israël et les monarchies du Golfe. La réaction récente de l’ambassadeur des Émirats arabes unis à Washington est un premier avertissement.
Loin de nous l’idée de nier le droit souverain d’Israël à assurer sa sécurité nationale. Au contraire, c’est plutôt par souci de sa sécurité et de la stabilité de la région : cette décision risquerait de l’enfermer dans une dangereuse impasse et dans une fuite en avant qui pourraient être regrettables pour tous.
Monsieur le ministre, notre groupe soutient l’action que vous menez, sous la conduite du Président de la République, laquelle consiste à ramener toutes les parties à la table des négociations afin de préserver la solution juste à deux États viables, vivant en paix et en sécurité, au sein de frontières sûres et reconnues et ayant Jérusalem pour capitale. Nous vous soutenons dans la tâche ardue d’empêcher que le 1er juillet ne soit le point de départ d’un bouleversement historique, regrettable, pour le Proche-Orient. Nous le faisons en accord avec plus d’un millier de parlementaires européens, qui viennent de signer une pétition contre ce projet d’annexion. Il faut que nous portions un message ferme, cohérent et uni.
Ce même 1er juillet, l’Allemagne prendra la présidence du Conseil de l’Union européenne, tandis que le 19 juin, vous aviez tenu une conférence de presse conjointe avec votre homologue allemand, Heiko Maas, au cours de laquelle ce sujet a été évoqué. Nous savons la force de votre travail à deux. Peut-on espérer un format nouveau, avec un moteur franco-allemand, de relance du processus de paix au Proche-Orient ?
Jean-Paul Sartre disait : « Chaque parole a une conséquence. Chaque silence aussi. » Oublions les paroles et les silences ! Adoptons les actes concrets qui s’imposent, au nom des intérêts des Israéliens et des Palestiniens, au nom de la paix et de la sécurité au Proche-Orient !
Applaudissements sur les travées du groupe LaREM, ainsi que sur des travées des groupes SOCR et CRCE. – M. Yvon Collin applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’ai tenu à intervenir à la suite d’un courrier adressé aux parlementaires par Avraham Burg, ancien président de la Knesset.
La question qui nous est soumise aujourd’hui – quelle réponse de la France au projet d’annexion de la vallée du Jourdain par l’État d’Israël ? – appelle une seule réponse, toute de bon sens, de discernement et de retenue, afin de renforcer la paix dans une région trop souvent déchirée : la France doit s’opposer à cette annexion inique ! Je rappelle à dessein que le territoire qui fait l’objet des convoitises d’Israël constitue une partie essentielle d’un futur État palestinien viable.
Que l’on ne se méprenne pas, mon propos n’est pas de donner dans l’antisionisme, bien au contraire ! Israël a pris depuis longtemps sa juste place dans le concert des nations. Cependant, la France, qui porte haut depuis des siècles le flambeau de la liberté, ne saurait s’accommoder de cette annexion. Car ne nous y trompons pas : tous les Israéliens ne sont pas favorables à ce vol territorial, beaucoup souhaitent préserver la paix et œuvrent à sa pérennité.
Trop de larmes et trop de sang ont été répandus en cette région du monde. Il est temps que les armes se taisent enfin.
Notre devoir est de faire respecter le droit international qu’Israël s’apprête à fouler aux pieds. Notre responsabilité est de soutenir les valeurs démocratiques, sans lesquelles ne peut exister une quelconque stabilité régionale au Proche-Orient.
Si Israël en venait à annexer la vallée du Jourdain, la perspective de résoudre pacifiquement ce conflit, dans le cadre d’une solution à deux États, basée sur les frontières d’avant 1967, s’évanouirait aussitôt.
Mères juives et arabes ne mettent pas leurs enfants au monde pour les voir tomber sous les balles. Toutes aspirent à une paix qu’elles n’ont jamais connue.
La France se doit donc d’adopter une position extrêmement ferme afin de dissuader les bellicistes israéliens de passer à l’acte. À défaut, le pire est envisageable : un embrasement total du Proche-Orient, avec les conséquences dramatiques à tous égards que chacun peut imaginer.
« La paix est un rêve suspendu », avait déclaré Kofi Annan. Il nous appartient de faire que ce rêve devienne enfin réalité pour les Israéliens et les Palestiniens. Nous, parlementaires français, pouvons y prendre toute notre part. Soyons les indéfectibles soutiens des pacifistes israéliens. Soyons les boucliers protégeant le peuple palestinien. Souvenons-nous, enfin, qu’une guerre n’engendre pas de vainqueurs, seulement des orphelins et des veuves !
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en propos liminaire, je rappellerai le mouvement mondial de durcissement des relations internationales, de retour de la politique du fait accompli et d’émergence de dirigeants imprévisibles, ce contexte n’étant pas sans conséquence sur le climat dans la région dont nous débattons aujourd’hui.
J’en viens à quelques constats.
Vu d’Europe, la longue séquence de guerre au Proche et au Moyen-Orient contre Al-Qaïda, puis l’État islamique, a fait passer au second plan la situation israélo-palestinienne. Pour autant, les tensions ne se sont pas arrêtées. Elles connaissent des hauts et des bas, mais le conflit s’installe dans une exceptionnelle longévité, après l’échec de nombreux sommets et plans de paix placés sous l’égide de puissants parrains.
Israël se sent toujours en insécurité sur son territoire et au pourtour, dans un contexte géopolitique régional dégradé. Quant aux Palestiniens, ils ont le sentiment, à juste titre, que leur cause n’est plus aussi mobilisatrice qu’auparavant, y compris dans l’opinion publique arabe. Désorganisés, ils voient s’éloigner l’espoir d’une solution favorable, en particulier du point de vue territorial.
Dans ce dossier, l’Europe paie, comme sur d’autres sujets internationaux, son manque d’ambition, d’unité et de poids. Elle est présente comme acteur économique ou culturel, voire humanitaire pour les Palestiniens. Elle est appréhendée comme un bailleur de fonds et porteur de projets, mais malheureusement pas comme un décideur politique majeur. Pourtant, dès le début des années 1980, les Neuf estimaient que « les liens traditionnels et les intérêts communs qui unissent l’Europe au Moyen-Orient leur imposent de jouer un rôle particulier et leur commandent d’œuvrer de manière plus concrète en faveur de la paix ». Vous constaterez avec moi que, malgré la bonne volonté, les résultats sont mitigés.
Quant à la France, elle possède une connaissance fine, inscrite dans la durée, de la région et des parties. Nous auditionnions en commission des affaires étrangères, il y a quelques jours, l’ambassadeur de France en Israël, puis le consul général à Jérusalem, qui nous ont livré leur appréciation de la situation.
Forte de son réseau diplomatique et culturel actif, notre pays entretient des relations suivies, tant du côté israélien que du côté palestinien, mais sa voix et sa « voilure » restreinte portent moins qu’à l’époque du général de Gaulle. Si la France conserve sa capacité à parler à tout le monde, ce qui est éminemment souhaitable, c’est surtout sa capacité à être entendue, à peser, qui s’est dégradée, et pas seulement au Proche-Orient. Sans doute aussi notre action internationale manque-t-elle d’une grande vision, d’un nouveau souffle.
De leurs côtés, les États-Unis, et particulièrement le Président Trump, qualifié par le gouvernement israélien de « plus grand ami qu’Israël ait jamais eu à la Maison-Blanche », avancent sans nuance. Le lien indéfectible avec Israël et les intérêts immédiats priment sur tout le reste, sans égard pour l’avis des alliés européens et les conséquences locales. Comment pourrait-il en être autrement ? Au moment où l’avenir des relations transatlantiques n’a jamais été aussi incertain, les désaccords politiques nombreux et le contentieux commercial à vif, l’Amérique suit son propre agenda.
Le « plan Trump » a suscité de fortes inquiétudes, en raison notamment du projet de faire de Jérusalem la capitale d’Israël et du sort qu’il prévoit pour la vallée du Jourdain, propositions contestées par les Palestiniens et une partie de la communauté internationale.
Au cœur de l’« Orient compliqué », les avis divergent sur l’annexion de la vallée du Jourdain. Au-delà des seuls Palestiniens, des milliers d’Israéliens, cela a été rappelé à juste titre, ont manifesté samedi à Tel-Aviv contre le projet du gouvernement d’annexer des pans de Cisjordanie occupée. À l’inverse, pour certains de ceux qui sont installés dans la zone, « la vallée du Jourdain est une merveilleuse région… qui fait partie d’Israël ! », mais ils regrettent que le plan implique des concessions.
Alors que l’échéance du 1er juillet approche, Paris appelle toujours les autorités israéliennes « à s’abstenir de toute mesure unilatérale qui conduirait à l’annexion de tout ou partie des Territoires » occupés… pardon, « palestiniens », voulais-je dire. Lapsus révélateur…
De même, le chef de la diplomatie de l’Union européenne souligne que « la solution des deux États, avec Jérusalem comme future capitale pour les deux États, est la seule façon de garantir une paix et une stabilité durables dans la région ». Reste à savoir si les Européens pourront s’entendre – c’est souhaitable – et s’ils sont prêts à prendre des mesures concrètes pour dissuader Israël de poursuivre son plan d’annexion et, dans l’affirmative, lesquelles ? Chacun a pu constater l’effet nul de la menace de sanctions contre la Russie dans la crise ukrainienne, ainsi que les effets souvent contre-productifs des sanctions a posteriori.
Si la France et l’Union européenne échouaient à dissuader les autorités israéliennes, cela jetterait le discrédit sur notre capacité à changer le cours des événements mondiaux, et le risque d’embrasement de la région serait important, au détriment de l’intérêt sécuritaire d’Israël. À moins que la Jordanie, qui a menacé le mois dernier de reconsidérer ses relations avec l’État hébreu si ce dernier menait à bien ses plans d’annexion, ne fasse bouger les lignes, ou la Russie, redevenue une puissance majeure du Proche-Orient à la faveur des atermoiements européens en Syrie. Et quelle sera l’attitude de la Chine ? Dans les prochaines années, un succès diplomatique sur ce dossier brûlant lui conférerait ce statut d’acteur politique global, et plus seulement économique, qu’elle recherche.
Monsieur le ministre, je ferai prochainement, avec plusieurs collègues sénateurs, un déplacement en Israël, lequel avait dû être reporté en raison du Covid-19. Nous souhaitons faire entendre la voix de la France, notamment celle du Sénat. La diplomatie parlementaire est faite pour tisser des liens, bâtir des ponts, favoriser le dialogue, et nous nous y efforcerons. Nous ne pouvons pas laisser faire.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe CRCE. – M. Olivier Cigolotti et Mme Agnès Constant applaudissent également.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureux de conclure ces échanges, que j’ai trouvés utiles et denses, sur la question majeure du conflit israélo-palestinien, lequel en est peut-être à un tournant historique, comme l’a rappelé le président Cambon.
Début mars, à la suite de la publication de la « vision » américaine, j’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer à ce sujet devant certains d’entre vous. Vous savez, vous l’avez rappelé, que j’y attache beaucoup d’importance.
Comme vous le savez, Benyamin Netanyahou et Benny Gantz, respectivement candidats du Likoud et de Bleu Blanc aux dernières élections législatives israéliennes, ont conclu un accord de coalition fin avril, qui a conduit à l’investiture du nouveau gouvernement israélien le 17 mai dernier. Cet accord prévoit la possibilité d’engager un processus d’annexion partielle de la Cisjordanie à partir du 1er juillet 2020, à travers l’adoption d’une loi par la Knesset.
Si le champ géographique de l’annexion n’a pas été précisé, ni dans l’accord de coalition ni par la suite, en tout cas à ce jour, deux conditions ont été posées : la première, c’est qu’Israël devra obtenir l’assentiment des États-Unis ; la seconde, c’est que, d’une part, les intérêts stratégiques d’Israël devront être pris en compte et que, d’autre part, les accords de paix existants – notamment avec l’Égypte et la Jordanie – devront être préservés.
Les États-Unis devraient se prononcer en cherchant à s’assurer d’un consensus entre le Likoud et Bleu Blanc sur le périmètre de l’annexion et en prenant en compte les résultats du comité conjoint israélo-américain qui a été mis en place pour cartographier les frontières, après la publication de la « vision » américaine. La position des États-Unis fait toutefois peu de doutes, mon homologue Mike Pompeo ayant déclaré à plusieurs reprises, et encore pas plus tard que cet après-midi, heure française, que, du point de vue américain, la décision d’annexion appartenait en dernier ressort à Israël, ce qui revient à un nihil obstat.
Avant d’évoquer les conséquences préoccupantes qu’aurait l’annexion, je rappellerai la position de la France sur les conditions d’un règlement du conflit. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire devant la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, cette position repose sur trois éléments : un cadre, celui du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité ; un objectif, à savoir l’établissement de deux États, vivant dans la paix et la sécurité au sein de frontières sûres et reconnues, fondées sur les lignes du 4 juin 1967, avec Jérusalem pour capitale de ces deux États, étant entendu qu’une solution concertée, réaliste et juste doit être trouvée sur le statut des réfugiés ; enfin, une méthode, celle de la négociation entre les parties et non des décisions unilatérales.
Voilà le prisme à travers lequel nous avons lu le plan proposé le 28 janvier dernier par le Président américain. Ce que nous avons constaté, et je le redis ici avec beaucoup de force, c’est que ce plan s’écarte du droit international, qu’il ne permettra pas la création d’un État palestinien viable et qu’il n’est accepté que par l’une des parties comme une base possible de négociation.
La « vision » américaine, vous l’avez dit, propose qu’Israël exerce sa souveraineté sur la vallée du Jourdain et sur toutes les colonies de Cisjordanie et conserve l’ensemble de la ville de Jérusalem. Le projet d’annexion, que le Premier ministre Netanyahou a endossé dans son discours d’investiture, prévoit de mettre en œuvre cette vision, de manière unilatérale et accélérée. Si cette annonce se concrétisait, ce serait – je pèse mes mots – la décision la plus grave dans le conflit israélo-palestinien depuis 1980 et la loi constitutionnelle israélienne sur Jérusalem.
L’annexion de territoires palestiniens, quel qu’en soit le périmètre – la position de la France est : quel qu’en soit le périmètre –, remettrait donc en cause de façon grave et irrémédiable les paramètres essentiels au règlement du conflit.
Tout d’abord, l’annexion remettrait en cause le cadre du droit international. Elle constituerait une violation en particulier du principe fondamental de non-acquisition de territoire par la force, principe qui est au cœur de l’ordre international que nous avons bâti collectivement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, principe que nous invoquons, par exemple, s’agissant de la Crimée.
L’annexion ne serait pas non plus conforme aux résolutions prises par le Conseil de sécurité de 1967 à nos jours, qu’il s’agisse de la résolution 242 de 1967 ou de la résolution 2334, adoptée en 2016, qui appelle les États à ne pas reconnaître de changement par rapport aux frontières de 1967 sauf s’ils ont été agréés par les parties, c’est-à-dire aux termes d’une négociation.
Ensuite, l’annexion rendrait quasiment impossible d’atteindre l’objectif de la solution des deux États. L’annexion nous éloignerait irréversiblement de l’établissement d’un État palestinien viable, tant sur le plan politique que sur le plan économique.
Du point de vue économique, les Palestiniens souffriraient de restrictions accrues d’accès aux ressources, comme l’eau, cela a été rappelé par l’un d’entre vous. Ils perdraient l’accès à certaines terres agricoles et même à une grande partie d’entre elles si l’annexion de la vallée du Jourdain était comprise totalement dans le processus.
Du point de vue politique et géographique, l’annexion contribuerait à réduire et à morceler encore davantage le territoire palestinien, ce qui remettrait en cause de manière irréversible sa contiguïté et, par là même, la viabilité d’un État palestinien souverain.
Les Palestiniens verraient parallèlement leur liberté de mouvement, déjà limitée, encore davantage entravée, au sein même du territoire palestinien, mais également vers l’étranger, en cas d’annexion de la vallée du Jourdain.
Non seulement l’annexion rendrait irréversible la présence des colonies existantes, mais elle accélérerait la construction de nouveaux logements dans les emprises, où le droit israélien deviendrait pleinement applicable. Je rappelle ici les chiffres, même s’ils ont déjà été cités dans le débat : le nombre de colons a été multiplié par trois depuis les accords d’Oslo. Ils sont aujourd’hui 650 000, dont 220 000 à Jérusalem et 430 000 en Cisjordanie.
L’annexion, décision par définition unilatérale, remettrait également en cause la méthode qui a été privilégiée jusqu’à présent par les deux parties et l’ensemble de la communauté internationale, celle des négociations directes entre Israéliens et Palestiniens.
Les mesures unilatérales et les faits accomplis ne sont pas compatibles avec une logique de négociation. Or seule une logique de négociation permettrait d’aboutir à une solution viable parce qu’acceptée par les deux parties.
L’annexion remettrait bien sûr en cause les aspirations nationales des Palestiniens, qui ont vocation à disposer d’un État viable, mais elle remettrait tout autant en cause le projet national des Israéliens, qui est de vivre dans un État qui soit à la fois juif et démocratique. Je suis très heureux que vous en ayez fait la remarque, madame Prunaud, monsieur Cambon, monsieur Cazeau, car on ne le dit pas suffisamment.
En ancrant dans le droit israélien la réalité de l’État unique, l’annexion forcerait à terme les Israéliens à faire un choix impossible entre le caractère juif de leur pays et le caractère démocratique de leur État. Ils seraient face à cette contradiction permanente et de longue durée.
Enfin, l’annexion aurait des conséquences négatives pour la stabilité régionale et pour la sécurité même d’Israël, à laquelle la France est extrêmement attachée et sur laquelle elle ne transigera jamais. Nos amis Israéliens le savent.
Les relations qu’Israël entretient avec ses voisins égyptien et jordanien font partie des rares progrès enregistrés au cours de plusieurs décennies de conflit israélo-arabe. Cet acquis est fragile. Le sujet est d’une grande sensibilité en Jordanie comme en Égypte. Une décision d’annexion viendrait fragiliser la relation d’Israël avec ses voisins.
Les autorités jordaniennes ont formulé, au plus haut niveau, des mises en garde contre les risques qu’emporterait l’annexion sur la relation des deux pays. Le Roi de Jordanie a évoqué la possibilité d’un « conflit massif ».
L’accord de paix de Wadi Araba, signé en 1994, avec Israël comme le traité de paix israélo-égyptien de 1979 reposent sur la perspective de la création d’un État palestinien souverain et indépendant. Même si cette perspective est restée théorique jusqu’à présent, y mettre un terme par l’annexion fragiliserait l’équilibre de ces accords et leur perception par les populations concernées.
Une décision d’annexion pourrait également provoquer des réactions déstabilisatrices dans les camps de réfugiés palestiniens, en particulier en Jordanie et au Liban.
J’ajoute qu’une telle décision ne manquerait pas d’être instrumentalisée par les groupes terroristes, dans les territoires palestiniens et, au-delà, dans la région. Elle aura aussi un effet d’aubaine politique pour les États les plus hostiles à Israël, en nourrissant, par exemple, la rhétorique anti-israélienne de l’Iran, au détriment des voix modérées dans la région.
Mesdames, messieurs les sénateurs, l’annexion ne serait, en somme, dans l’intérêt de personne : ni dans celui des Palestiniens, qui en subiraient les conséquences immédiates ; ni dans celui des Israéliens, dont la sécurité passera, à terme, par un accord avec les Palestiniens et par une pleine intégration régionale ; ni dans celui d’une région dont la stabilité est déjà menacée par les tensions et les conflits ; ni dans celui des Européens et de la communauté internationale, qui ont investi des efforts diplomatiques et financiers massifs dans la perspective des deux États.
Pour toutes ces raisons, et à quelques jours de l’échéance du 1er juillet, la France est pleinement mobilisée. À défaut de pouvoir relancer immédiatement des discussions de paix, notre objectif est de préserver les conditions d’une négociation future et la possibilité d’une solution négociée. Nous nous coordonnons avec nos partenaires européens et arabes pour envoyer des messages préventifs et des messages dissuasifs pour que l’annexion, quel qu’en soit le périmètre – je le répète –, ne se produise pas.
Dans l’hypothèse où nos efforts n’aboutiraient pas, nous nous préparons à réagir. Comme je l’ai indiqué à plusieurs reprises, une décision d’une telle gravité ne peut pas rester sans réponse. Je ne déclinerai pas la totalité des réponses : elles interviennent lorsque les actes sont posés ; chacun l’a bien compris. Mais il importe tout de même d’essayer de clarifier.
Le premier axe de notre action est préventif. Pour dissuader les Israéliens de procéder à tout acte unilatéral qui conduirait à l’annexion de territoires palestiniens, nous leur faisons passer des messages clairs, aussi bien publiquement qu’en privé, aussi bien à titre national qu’en coordination avec nos partenaires, notamment européens.
Nous faisons d’abord valoir les avantages que les Israéliens pourraient retirer d’une coopération accrue avec l’Union européenne s’ils renonçaient à l’annexion et s’ils s’engageaient dans un véritable processus politique négocié sur la base du droit international et des paramètres agréés. Dans cette configuration, on pourrait envisager, si c’était le cas, le rehaussement de nos relations bilatérales. Ce serait dans l’intérêt de tous.
Mais, à l’inverse, nous indiquons aux Israéliens que nous ne reconnaîtrons aucun changement aux lignes de juin 1967 qui ne serait pas agréé entre les parties et que nous ne reconnaîtrons donc pas la souveraineté israélienne sur les territoires annexés. Tout cela, j’ai moi-même eu l’occasion de l’exprimer à plusieurs reprises depuis l’investiture du nouveau gouvernement israélien. Je l’ai dit à la fois publiquement et lors d’entretiens récents que j’ai eus avec mon homologue M. Ashkenazi.
Mme Prunaud affirmait que la France n’était pas reconnue comme un acteur du processus de paix. Mon homologue palestinien, M. al-Malki, ne dit pas du tout cela lorsque je le rencontre. Au contraire ! À chaque entretien, y compris entre Mahmoud Abbas et le Président Macron, il est répété régulièrement que les Palestiniens savent pouvoir compter sur nous pour être à leurs côtés et pour agir en faveur d’une solution négociée.
Parallèlement à cela, nous continuons à assurer les Palestiniens de notre engagement en faveur de l’établissement d’un État palestinien souverain, viable, contigu et démocratique. Nous avons mobilisé des aides spécifiques. Par exemple, dans le contexte de la Covid, nous avons débloqué de manière anticipée notre aide budgétaire annuelle de 16 millions d’euros pour permettre à l’Autorité palestinienne de fonctionner. Nous avons doublé l’année dernière et maintenu cette année notre aide à l’UNRWA, après le départ financier des États-Unis d’Amérique. Tout cela vise à donner aux Palestiniens des raisons de ne pas se détourner du cadre d’Oslo au moment même où celui-ci est remis en cause par Israël.
Nous incitons aussi les Palestiniens à inscrire leur action dans le cadre d’un processus politique négocié. Il nous revient de les alerter sur le risque d’effritement progressif de l’Autorité palestinienne si elle venait à renoncer à ses propres prérogatives.
Le second axe de notre action est dissuasif. Il s’agit de dire dès à présent que, si les Israéliens décidaient d’aller de l’avant dans le processus d’annexion, nous serions contraints d’y opposer des mesures affectant les relations de l’Union européenne et de ses États membres avec Israël. Les relations entre l’Union européenne et Israël sont régies par de nombreux accords, à commencer par l’accord d’association UE-Israël, mais aussi par beaucoup d’accords de coopération. La participation d’Israël à différents programmes de coopération, en particulier pour la partie qui est en préparation dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027, devrait être réexaminée à la lumière du contexte nouveau que créerait une annexion partielle de la Cisjordanie. Cela devrait être aussi le cas en matière commerciale pour veiller à renforcer le contrôle de l’origine des produits importés au sein de l’Union européenne.
Il est vrai – je l’ai entendu – qu’il est difficile de réunir un consensus au sein de l’Union européenne sur la question israélo-palestinienne. J’ai moi-même plusieurs fois appelé à l’unité sur ce sujet essentiel, notamment lors du Conseil des ministres des affaires étrangères récent, le 15 mai dernier. Mais nous ne pouvons décider seuls de suspendre tel ou tel accord entre l’Union européenne et Israël. Pour autant, cela n’empêche pas une coordination étroite avec nos plus grands partenaires européens : l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le haut représentant Josep Borrell, ainsi que plusieurs États membres proches de nos vues.
Je relève que, même si quelques États européens se distinguent sur le sujet, la règle de l’unanimité ne s’applique pas à tous les programmes européens auxquels participe Israël. Une série de mesures peuvent être prises à titre national et de manière coordonnée avec nos principaux partenaires européens. Il s’agit d’introduire dans tous les accords bilatéraux avec Israël des clauses territoriales, afin de matérialiser la distinction juridique – M. Collin rappelait ce problème – entre le territoire d’Israël et les territoires occupés. Cela ne signifie pas du tout que nous mettons fin à tous les accords qui nous lient avec Israël. Nous avons évidemment des intérêts communs avec ce pays, y compris en matière de sécurité dans la région. Il s’agit non pas de suspendre toute coopération, mais de marquer clairement et systématiquement une distinction juridique qui traduise nos positions politiques.
Il nous appartiendra aussi d’instituer de manière systématique des mesures de contrôle de la mise en œuvre de l’étiquetage différencié des produits des colonies. C’est désormais une obligation au titre du droit à l’information du consommateur européen. Elle a été confirmée cette année par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne.
Dans le même mouvement, nous nous coordonnons avec nos partenaires arabes, à commencer par l’Égypte et la Jordanie. Je l’ai souligné, ces pays sont directement concernés par les conséquences d’une décision d’annexion. Cela induit des enjeux de sécurité ; M. Cazeau les a bien évoqués. D’ailleurs, le vice-Premier ministre Benny Gantz et mon homologue M. Ashkenazi sont tous deux d’anciens chefs d’état-major des armées qui connaissent l’importance du maintien des accords de paix d’Israël avec l’Égypte et la Jordanie. Nous essayons de coordonner vis-à-vis d’eux nos messages avec les partenaires arabes.
À cet égard, nous avons établi – l’un d’entre vous a évoqué la relation avec l’Allemagne – un format de concertation avec nos homologues jordaniens, égyptiens et allemands. Nous nous réunissons pour coordonner nos actions et nos ripostes en cas d’annexion.
Dans le même esprit, nous incitons l’Arabie saoudite, qui est à l’origine – il faut le rappeler – de l’initiative de paix arabe de 2002 à se mobiliser. Nous avons relevé, comme vous, que les Émirats arabes unis ont récemment mis en garde contre une décision d’annexion.
Une éventuelle décision d’annexion ne modifierait en rien – au contraire ! – notre détermination ancienne à reconnaître, le moment venu, l’État palestinien dans le cadre et le format appropriés et lorsque cette décision sera utile à la paix.
Mesdames, messieurs les sénateurs, faute de pouvoir relancer dans l’immédiat un processus politique crédible de négociations, nous avons la responsabilité de tout faire pour en préserver la possibilité dans le futur. La situation est préoccupante ; nous en avons parfaitement conscience. C’est pourquoi nous agissons de manière déterminée et résolue, et non uniquement déclaratoire, afin de préserver la solution des deux États dans le cadre du droit international, seul moyen d’aboutir à la paix après des années et des années de conflictualité.
Applaudissements sur les travées du groupe LaREM, ainsi que sur des travées des groupes SOCR, RDSE, UC et Les Républicains.

Nous en avons terminé avec le débat sur le thème : « Quelle réponse de la France au projet d’annexion de la vallée du Jourdain par l’État d’Israël ? »

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, jeudi 25 juin 2020 :
De neuf heures à treize heures :
Ordre du jour réservé au groupe socialiste et républicain

Proposition de résolution présentée en application de l’article 34-1 de la Constitution, pour une nouvelle ère de la décentralisation, présentée par M. Éric Kerrouche et les membres du groupe socialiste et républicain (texte n° 515, 2019-2020)
Proposition de loi portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes du covid-19, présentée par Mme Victoire Jasmin et plusieurs de ses collègues (texte de la commission n° 531, 2019-2020).
De quatorze heures trente à dix-huit heures trente :
Ordre du jour réservé au groupe La République En Marche

Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne (texte de la commission n° 533, 2019-2020) ;
Deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent (texte de la commission n° 522, 2019-2020).
À dix-huit heures trente :
Débat sur les conclusions du rapport : « Comment faire face aux difficultés de recrutement des entreprises dans le contexte de forte évolution des métiers ? »
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures cinq.
La liste des candidats désignés par la commission des lois pour faire partie de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales a été publiée conformément à l ’ article 8 quater du règlement.
Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire sont :
Titulaires : M. Philippe Bas, Mmes Marie Mercier, Jacky Deromedi, Annick Billon, Marie-Pierre de la Gontrie, Laurence Rossignol et M. Thani Mohamed Soilihi ;
Suppléants : M. François Bonhomme, Mmes Catherine Di Folco, Jacqueline Eustache-Brinio, Dominique Vérien, Laurence Harribey, Maryse Carrère, Esther Benbassa.
La liste des candidats désignés par la commission des lois pour faire partie de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux a été publiée conformément à l ’ article 8 quater du règlement.
Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire sont :
Titulaires : MM. Philippe Bas, André Reichardt, Mme Muriel Jourda, M. Yves Détraigne, Mme Gisèle Jourda, MM. Jean-Pierre Sueur et Martin Lévrier ;
Suppléants : Mmes Jacky Deromedi, Catherine Di Folco, Catherine Troendlé, MM. Jean-François Longeot, Yannick Vaugrenard, Ronan Dantec et Pierre-Yves Collombat.
La liste des candidats désignés par la commission des affaires sociales pour faire partie de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi permettant le don de congés payés sous forme de chèques-vacances aux membres du secteur médico-social en reconnaissance de leur action durant l ’ épidémie de Covid-19 a été publiée conformément à l ’ article 8 quater du règlement.
Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire sont :
Titulaires : M. Alain Milon, Mmes Frédérique Puissat, Pascale Gruny, Jocelyne Guidez, MM. Yves Daudigny, Bernard Jomier et Martin Lévrier ;
Suppléants : Mmes Catherine Deroche, Corinne Imbert, M. Philippe Mouiller, Mmes Michelle Meunier, Élisabeth Doineau, Véronique Guillotin et Cathy Apourceau-Poly.
La liste des candidats désignés par la commission des lois pour faire partie de l ’ éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique portant report de l ’ élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France a été publiée conformément à l ’ article 8 quater du règlement.
Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire sont :
Titulaires : MM. Philippe Bas, Christophe-André Frassa, Mme Muriel Jourda, MM. Yves Détraigne, Jean-Yves Leconte, Jean-Pierre Sueur et Richard Yung ;
Suppléants : Mmes Jacky Deromedi, Catherine Di Folco, Jacqueline Eustache-Brinio, MM. Hervé Marseille, Éric Kerrouche, Mme Nathalie Delattre et M. Pierre-Yves Collombat.