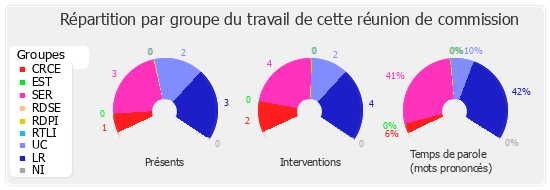Commission d'enquête Évaluation politiques publiques face aux pandémies
Réunion du 16 septembre 2020 à 9h00
La réunion

Mes chers collègues, nous poursuivons nos travaux avec une audition consacrée à la santé publique.
Je vous prie d'excuser l'absence du président Milon, retenu dans son département.
Nous entendons ce matin en visioconférence depuis Genève le Professeur Antoine Flahault, médecin de santé publique et épidémiologiste, directeur du Global Health Institute et, ici à Paris, le Professeur Franck Chauvin, président du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), accompagné des Professeurs Christian Chidiac et Didier Lepelletier, respectivement président et co-président du groupe de travail du HCSP « Grippe, coronavirus, infections respiratoires émergentes », et le Professeur Emmanuel Rusch, président de la Société française de santé publique (SFSP), président de la Conférence nationale de santé (CNS) et du comité de contrôle et de liaison covid-19.
Parmi les personnes auditionnées, nombreuses ont été celles qui ont appelé à un changement du modèle de santé publique dans notre pays. Cette audition a pour objet de revenir sur la stratégie conduite dans la lutte contre l'épidémie au regard des meilleures pratiques dans le domaine, mais aussi d'examiner les évolutions possibles.
Que penser, par exemple, de la mise en place d'un comité scientifique, alors que notre pays dispose d'un Haut Conseil de la santé publique, mais aussi de sociétés savantes compétentes dans ce domaine ?
Je demanderai à nos intervenants de présenter brièvement leur principal message, afin de laisser le maximum de temps aux échanges, ainsi qu'aux questions des rapporteurs et des commissaires.
Je vais maintenant, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, vous demander de prêter serment. Je rappelle que tout témoignage mensonger devant une commission d'enquête parlementaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, MM. Antoine Flahault, Franck Chauvin, Christian Chidiac, Didier Lepelletier et Emmanuel Rusch prêtent serment.
Pr Antoine Flahault, médecin de santé publique et épidémiologiste, directeur du Global Health Institute. - L'Europe a particulièrement bien géré la crise. Elle n'est d'ailleurs pas la seule, puisqu'un certain nombre de pays d'Asie, comme la Corée du Sud ou le Japon, ont également très bien géré cette première vague épidémique. L'Australie a quant à elle très bien géré la deuxième vague épidémique, puisque ce pays a fait face à une vague très dure durant les mois de juillet et d'août.
Les pays européens ont passé un été extrêmement calme : le taux de mortalité y est très bas et on y observe une très faible sévérité des cas, et donc une très faible saturation des hôpitaux. Aujourd'hui, on constate cependant une croissance très importante de la circulation du virus dans certains pays, en particulier en France, mais aussi en Espagne, en Grande-Bretagne, en Hollande, en Belgique, en Suisse, au Portugal, au Danemark ou en Autriche.
Cette vague est un peu paradoxale : il ne s'agit pas véritablement d'une deuxième vague, car elle se caractérise pour l'essentiel par une augmentation de la positivité des tests de diagnostic biologique, dits « PCR ». Les personnes contaminées sont très souvent asymptomatiques ou pauci-symptomatiques, le plus souvent des jeunes. Pour le moment, les personnes plus âgées sont encore peu touchées : les cas sont peu sévères et les décès peu nombreux.
Ce n'est pas le cas partout. Ainsi, Israël a connu une véritable nouvelle vague cet été avec une augmentation de la morbidité et de la mortalité. Les États-Unis qui, comme l'Europe, se situent dans l'hémisphère nord et en zone tempérée, n'ont connu aucun répit estival et continuent de souffrir d'une gestion désastreuse de la pandémie.
Face à cette épidémie, on remarque une grande différence dans la gestion de la crise et de résultats selon les pays. Je voudrais citer deux ou trois exemples notables : aujourd'hui, l'Allemagne, l'Italie et la Suède ont très peu de cas rapportés et une très faible mortalité. Dans ces pays, le nombre de tests positifs n'augmente pas, alors que le nombre total de tests est au moins aussi important qu'en France ou en Espagne, par exemple.
Pr Franck Chauvin, président du Haut Conseil de la santé publique (HCSP). - J'aimerais insister sur trois points.
Tout d'abord, le Haut Conseil de la santé publique est une instance peu connue, qui a été créée en 2004, installée en 2007 et renouvelée en 2017. J'en ai été élu président par mes pairs il y a trois ans.
Le Haut Conseil exerce trois missions : premièrement, il doit fournir l'expertise sanitaire nécessaire à la prise de décision ; deuxièmement, il doit fournir l'expertise pour le concept et l'évaluation des stratégies de prévention ; troisièmement, il est chargé de mener une réflexion prospective et de donner des conseils sur la santé publique. J'insiste sur ces trois points pour anticiper d'éventuelles questions concernant l'installation du conseil scientifique : ce dernier s'est en fait chargé du troisième volet. Vous le savez probablement, j'ai intégré le conseil scientifique le 15 mars dernier à la demande de Jean-François Delfraissy, afin d'assurer la meilleure coordination possible entre les deux instances.
Ensuite, je veux évoquer l'expertise produite par le Haut Conseil.
Durant cette période, nous sommes volontairement très peu intervenus dans les médias - stratégie qu'il conviendra évidemment d'analyser -, alors que le HCSP a reçu 90 saisines venant de la direction générale de la santé, de la cellule de crise, du groupe de travail conduit par Jean Castex et d'autres ministères. Nous avons fourni 108 avis, fruit d'un travail qui a impliqué et permis d'auditionner près de 300 experts. Ces avis ont pour partie été publiés dans les 48 heures, de sorte que les pouvoirs publics puissent prendre les décisions qui s'imposaient.
Il me semble important de revenir sur la nature de l'expertise et le travail que nous fournissons. Durant cette crise, nous avons entendu beaucoup de personnes qui considéraient qu'elles étaient légitimes pour donner leur opinion. Le Haut Conseil de la santé publique fournit pour sa part des avis élaborés collégialement, fruit d'une réflexion multidisciplinaire. Hélas, on a donné le même poids aux opinions exprimées ici et là et à des avis qui nécessitent des dizaines d'heures de travail, puisque nous avons tenu plus de deux cents réunions durant cette crise, ce qui représente plusieurs milliers d'heures de travail et d'expertise cumulées.
Je l'ai dit, l'un des rôles du Haut Conseil est de fournir des recommandations, c'est-à-dire de contextualiser les avis de façon à ce qu'ils soient utilisables par les pouvoirs publics pour prendre des décisions. Le HCSP ne prend lui-même aucune décision. Jean-François Delfraissy l'a dit hier, je le redis : il est impératif qu'on garantisse l'étanchéité entre la prise de décision et l'élaboration des recommandations ou des avis, afin d'éviter les drames.
Enfin, je souhaiterais livrer une analyse globale des événements et du contexte.
Le contexte est celui d'une crise exceptionnelle, non pas tant par l'épidémie elle-même, certes exceptionnelle, mais qui a été précédée par d'autres crises tout aussi graves, qui n'ont pas pour autant laissé les mêmes traces, comme la grippe de Hong Kong en 1969, mais parce que les experts que nous sommes avons été confrontés au phénomène de la polémique-spectacle : on a préféré mettre en scène des polémiques plutôt que d'essayer de faire progresser l'information et de se fonder sur des avis.
Il convient de s'interroger : pourquoi le pays de Pasteur est-il devenu le pays de l'OCDE le plus réticent vis-à-vis de la vaccination ? Pourquoi le pays de Descartes et de Claude Bernard a-t-il oublié qu'il existait une démarche expérimentale pour démontrer des intuitions ou des hypothèses ? On a vu que le nombre de followers sur Twitter et que le raisonnement syllogique étaient devenus la règle.
Pr Emmanuel Rusch, président de la Société française de santé publique (SFSP), président de la Conférence nationale de santé (CNS) et du comité de contrôle et de liaison Covid-19. - La Société française de santé publique regroupe un certain nombre d'associations et d'organisations qui se penchent sur la santé publique, et un certain nombre de personnes physiques adhérentes. Il s'agit à la fois d'une société savante et professionnelle. Quant à la Conférence nationale de santé, c'est une sorte de Parlement de la santé qui associe des représentants des territoires, des associations d'usagers, des partenaires sociaux, des acteurs de la prévention, des offreurs de services de santé.
Dans ces deux instances, nous sommes attentifs à garder du temps pour la concertation et la délibération, afin que notre parole résulte d'une forme de consensus.
Je reprendrai les principaux points que nous avions évoqués dans l'avis de la Conférence nationale de santé du 2 avril dernier.
Premier point, une telle crise sanitaire nécessite une approche large : il est important d'assurer la cohérence de l'ensemble des mesures prises pour lutter contre l'épidémie, car c'est bien une combinaison de mesures qui est mise en oeuvre. On a trop tendance à se polariser sur l'une ou l'autre - le port du masque, la distanciation sociale, les traitements -, alors qu'il faudrait tenir compte de l'ensemble de la chaîne. Souvent, c'est un simple maillon faible qui explique le manque d'efficacité de tout le dispositif. Par conséquent, l'enjeu est d'assurer un pilotage cohérent et de trouver la bonne organisation collective de cette chaîne de mesures.
Deuxième point, nous avons besoin d'une communication honnête, transparente, fondée scientifiquement, organisée et adaptée aux publics cibles, accessible et compréhensible. C'est indispensable pour créer un climat de confiance.
Troisième point, qui nous semble toujours d'actualité, il est nécessaire de prendre en compte les situations de vulnérabilité ou de précarité. Nous devrions nous interroger sur le cadrage des mesures : doit-on cibler une population générale virtuelle, ou bien les catégories les plus fragiles en espérant que cette démarche profite à l'ensemble de la population ?
Quatrième point, il est nécessaire d'assurer la continuité des soins, y compris ceux qui ne sont pas liés à la covid-19. Dès le début de cette épidémie, nous avons constaté que des patients non atteints par le virus rencontraient des difficultés pour accéder aux soins dont ils avaient besoin.
Cinquième et dernier point, nous avions souligné la nécessité de débattre des enjeux éthiques que posent à la fois les mesures prises et leurs conséquences sur une partie de la population, notamment les catégories les plus vulnérables. Avec Jean-François Delfraissy, nous avions proposé à l'époque la création d'un comité de liaison avec la société civile, qui n'a finalement pas vu le jour. Nous avons malgré tout eu le plaisir de voir se constituer un comité de contrôle et de liaison covid-19, mais celui-ci reste un comité de contrôle circonscrit à la question - importante - des systèmes d'information, du numérique, de leur place et de leur utilité dans cette crise.
Le discours que je viens d'entendre est différent de celui du Professeur Delfraissy, qui affirmait hier que le conseil scientifique a été créé parce qu'il n'existait rien d'équivalent. On s'aperçoit aujourd'hui qu'un certain nombre d'organismes étaient déjà en place.

Professeur Chauvin, quels ont été vos avis ou recommandations sur la nature du pilotage de la crise ? Certes, on s'attendait à ce que la vague soit nationale et traverse le pays d'est en ouest, mais n'aurait-il pas fallu un pilotage plus territorialisé ?
Quelles ont été vos recommandations concernant la priorisation des soins, qui a provoqué une discontinuité dans la prise en charge de certaines pathologies ? Nous avons reçu des associations de patients : il semblerait que les reports de prise en charge des malades du cancer et des insuffisants rénaux aient provoqué des pertes de chance pour l'ensemble de ces malades, variables selon la territorialisation de l'organisation des soins. Avez-vous également des préconisations particulières à ce sujet ? Pourquoi les malades de la covid-19 paraissaient-ils prioritaires par rapport aux autres ?
Enfin, quelles ont été vos recommandations concernant les personnes accueillies dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ?
Pr Franck Chauvin. - Comme je l'ai indiqué, Jean-François Delfraissy m'a demandé d'intégrer le conseil scientifique le 15 mars dernier. Considérant la masse considérable de travail qu'avait le Haut Conseil de la santé publique, notamment les nombreuses saisines relatives aux problèmes de thérapeutique ou d'hygiène à l'école, Jean-François Delfraissy et moi-même avons réparti les rôles de façon - me semble-t-il - assez harmonieuse, en laissant au conseil scientifique les recommandations sur la stratégie et le pilotage, et au Haut Conseil les réponses aux saisines qui lui parvenaient dans le cadre de la crise sur des recommandations plus opérationnelles.
Toutes les recommandations sur le pilotage ont donc été émises par le conseil scientifique et non par le HCSP. En tout cas, je partage votre souci d'un pilotage territorial de la crise. Le conseil scientifique l'a d'ailleurs dit à plusieurs reprises.
Concernant la continuité des soins, le Haut Conseil a dès le mois de février été saisi de la question de la prise en charge des patients. Très tôt, la question de la priorisation a été posée. Avec les données dont nous disposions à l'époque, sachant que nous avions une très faible connaissance du virus, les seules données sur les facteurs de risques provenant de Chine, le Haut Conseil de la santé publique a identifié les personnes à hauts risques afin qu'elles soient prises en charge prioritairement.
Il a semblé aux experts du HCSP que les personnes que vous évoquiez - malades du cancer notamment - étaient particulièrement vulnérables. Je pense notamment à une recommandation du Haut Conseil, élaborée avec les sociétés savantes et les cancérologues, qui estimait qu'il pourrait être dangereux pour certains patients de fréquenter des zones de forte circulation du virus. Ces patients, souvent immunodéprimés, sont particulièrement vulnérables. Durant une certaine période, ces personnes ont effectivement été prises en charge soit à domicile, soit en téléconsultation. En très peu de temps, on a ainsi assisté à une véritable mutation des pratiques, avec beaucoup de téléconsultations qui ont permis d'assurer la continuité des soins de ces malades.
Ensuite, dès que la charge de travail s'est quelque peu apaisée dans les hôpitaux, les patients chroniques - vulnérables au vu des données épidémiologiques que nous avions - ont repris le chemin des hôpitaux, notamment en cancérologie. Des zones « covid free » ont été identifiées, afin que ces patients puissent être pris en charge.

Ce que vous décrivez ne s'est pas concrétisé dans tous les territoires !
Pr Franck Chauvin. - J'ai entendu Jean-François Delfraissy hier évoquer les Ehpad. Je partage son sentiment sur le sujet : il faut que nous réfléchissions plus globalement à ce modèle, car ces établissements se sont révélés particulièrement fragiles et sensibles à ce type d'épidémie. Il existe d'autres modèles ailleurs qui permettraient d'en limiter la diffusion. Nous devrons conduire une réflexion collective sur les Ehpad.
Pr Emmanuel Rusch. - Le constat établi par la Société française de santé publique et la Conférence nationale de santé est celui d'une forme de cacophonie ou, en tout cas, d'interférences dans le pilotage de la crise.
Sans vouloir généraliser, car il faut étudier les faits territoire par territoire, ces interférences existent au niveau territorial entre la dynamique portée par le préfet, celle qui est enclenchée par les agences régionales de santé et celle qui est insufflée par les collectivités territoriales. Pour éviter ces interférences, il faut à la fois que des directives nationales claires et précises soient prises et que l'on soit capable de s'adapter à des considérations ou des contextes locaux. S'agissant de la coordination des acteurs au plan local, il faut donc que le curseur soit positionné au bon niveau. Est-ce aux préfets d'assurer cette coordination ou aux agences régionales de santé ? Nous n'avons pas d'avis à ce sujet.
Nous, si !
Pr Emmanuel Rusch. - En tout cas, la coordination des acteurs doit être clairement définie.
La question de la priorisation des soins est complexe en tant que telle, mais aussi parce que l'on ignorait en février-mars quels serait l'ampleur de l'épidémie et son impact sur le système de santé. Dans cette crise, on a appris en marchant. On a effectivement constaté qu'il existait des difficultés d'accès aux soins pour un certain nombre de malades et que certains soins pouvaient être reportés. C'est l'une des difficultés du moment : certaines prises en charge ont pu être décalées, mais elles ne peuvent l'être à l'infini. On se retrouve aujourd'hui à devoir à la fois gérer une épidémie qui reprend hélas un peu de souffle et à devoir et absolument prendre en charge les autres problématiques de santé.
Je n'ai pas forcément de réponse précise à apporter à la question de la priorisation des soins, mais, globalement, je fais confiance aux professionnels de santé qui, en fonction de l'urgence, ont certes dû faire des choix, mais ont essayé, me semble-t-il, de le faire au mieux.
Franck Chauvin le soulignait à l'instant, on a transformé nos organisations, notre façon de travailler en très peu de temps. J'en ai fait l'expérience personnellement en contribuant au développement de l'éducation thérapeutique à domicile. Les usagers comme les professionnels de santé ont été assez facilement convaincus que d'autres modalités pratiques permettant de maintenir la nécessaire distanciation sociale existaient. Comme dans toute crise, cette période a aussi été l'occasion de changer un peu nos pratiques professionnelles.
Je ne peux pas dire que j'ai immédiatement perçu l'ampleur de la crise qui allait survenir dans les Ehpad. Comme d'autres, j'ai découvert progressivement l'étendue du problème. Seulement, quand il s'agit de personnes âgées, comme de soignants ou d'autres populations vulnérables, il est important de se concerter. Il n'y a jamais eu autant de réunions, mais aussi jamais autant de plaintes d'un manque de dialogue : il y a là un paradoxe et, finalement, le sentiment que les échanges n'aboutissent pas à une véritable concertation. En réalité, quand on veut agir pour une personne, mais qu'on le fait sans elle, on le fait toujours contre elle. Il faut garder ce point à l'esprit.
Y a-t-il des gériatres au sein de la Conférence nationale de santé ?
Pr Emmanuel Rusch. - Elle comporte des associations représentant les personnes âgées, des enseignants-chercheurs en santé publique qui s'intéressent à la gériatrie, des sociologues, mais pas de gériatres à proprement parler.
Professeur Chauvin, pourriez-vous très rapidement préciser vos propositions pour faire évoluer les Ehpad ?
Pr Franck Chauvin. - Durant cette crise, on a constaté que les Ehpad n'étaient pas aussi médicalisés qu'on le pensait.
On ne l'a tout de même pas découvert !
Pr Franck Chauvin. - On le savait, mais on s'est aperçu durant cette crise, précisément parce qu'elle nécessitait une forte mobilisation médicale, que cette lacune devait être comblée. Les acteurs sur le terrain ont très rapidement créé des réseaux informels d'entraide. Je voudrais insister sur le rôle qu'ont joué les hôpitaux dans les régions, au-delà de la prise en charge thérapeutique : dans certains territoires, le centre hospitalo-universitaire ou les centres hospitaliers généraux importants ont mis en place des équipes de liaison pour cette prise en charge.
Je ne peux vous livrer qu'une réflexion personnelle sur les Ehpad. Elle n'a pas fait l'objet d'une concertation au sein du Haut Conseil ou d'une autre instance. Je pense que le fait qu'une population vulnérable soit regroupée dans un même espace la rend extrêmement sensible à la diffusion d'une épidémie. De fait, les mesures consistant à fermer ces établissements, qui peuvent se concevoir en période de crise aiguë - mais n'ont hélas pas permis d'empêcher la propagation du virus -, sont inconcevables à long terme. Comme l'a dit le conseil scientifique à plusieurs reprises, il n'est pas possible de fermer les Ehpad, notamment aux familles. Le Haut Conseil de la santé publique, quant à lui, a auditionné la société française de gériatrie et d'autres sociétés françaises de façon à disposer d'une expertise multidisciplinaire.
Je crois qu'il est encore trop tôt pour faire l'analyse complète de ce qui s'est passé. Le Haut Conseil de la santé publique fera un retour d'expérience interne le 21 octobre prochain et un retour d'expérience externe au mois de décembre, qui seront l'occasion de conduire une réflexion avec un peu de recul, car l'analyse à chaud est toujours compliquée.
L'analyse est sans doute compliquée, mais ces retours d'expérience interviennent bien tardivement ! Alors que l'épidémie est en train de prospérer, un retour d'expérience, même incomplet, reste intéressant et permet de prendre des mesures différentes. À travers vos propos, on voit bien que les mesures prises n'ont pas forcément aussi bien fonctionné que nous l'aurions souhaité.
Disposez-vous de comparaisons internationales, Professeur Flahault ?
Pr Antoine Flahault. - Oui, en ce qui concerne les maisons de retraite et, en particulier, les personnes âgées, le bilan de la France est plutôt mauvais. Le taux de mortalité dans notre pays est de 462 décès par million d'habitants contre 113 décès en Allemagne, soit quatre fois plus, et 204 en Suisse.
En Suède ou au Royaume-Uni, le taux de mortalité chez les personnes âgées est un peu plus élevé qu'en France, mais la Suède, par exemple, a déjà fait un premier retour d'expérience. Les Suédois ont constaté que le personnel des Ehpad avait été sous-équipé en matériel de protection. En Suisse, beaucoup moins de clusters sont apparus : l'ensemble du personnel a été très prudent et disposait de matériel de protection individuel. En outre, on empêchait au maximum l'entrée de personnes étrangères aux résidences, famille, proches ou fournisseurs.
En Suède, les personnes travaillant dans les Ehpad étaient souvent des précaires, en contrat de travail à durée déterminée. En juillet et en août, l'Australie a également connu une forte mortalité dans ses Ehpad. Les pouvoirs publics se sont rendu compte que les salariés des maisons de retraite étaient, là encore, souvent précaires et travaillaient régulièrement dans plusieurs maisons de retraite à la fois. Aussi, ils ont contribué à diffuser le virus d'un établissement à un autre. Les autorités australiennes ont finalement mis gratuitement à disposition des tests de dépistage : bien que positifs, certains travailleurs précaires ont continué à travailler, tout simplement parce qu'ils avaient besoin de vivre.
Je ne sais pas si la situation en Suède ou en Australie est comparable à celle de la France. En revanche, il est certain que la priorité doit être de protéger les Ehpad en cas de deuxième vague, voire d'agir sans attendre. Cette mesure n'est pas populaire et il existe bien entendu parmi les personnes âgées, des individus qui sont prêts à prendre des risques, mais il s'agit de risques colossaux. Personnellement, je compare le risque couru aujourd'hui par une personne âgée de plus de 80 ou 85 ans à celui d'une personne contaminée par le virus Ebola dans le Nord-Kivu en République démocratique du Congo en pleine période épidémique. La covid-19 est une maladie d'une très grande dangerosité et d'une très grande transmissibilité : on ne peut pas faire prendre aux résidents et au personnel d'un Ehpad des risques de ce genre, même si l'on doit évidemment tenir compte de la volonté de chacun.
Des solutions existent : les Suisses, par exemple, ont développé des logiciels de visioconférence pour que les personnes âgées échangent avec leur famille, des parloirs pour maintenir le contact avec leurs proches. C'est humainement très compliqué, mais il faut rester vigilant sur ce point, car il y va de la santé de tous les résidents et pas simplement de celui ou de celle qui, par des directives anticipées ou d'autres moyens, aurait exprimé sa volonté de prendre ce risque à titre personnel.

Professeur Flahault, vous avez entamé votre propos en affirmant que l'Europe avait globalement bien géré la crise. Mais quand on compare pays par pays, il existe quand même des différences notables.
Je pense à l'Allemagne ou à ces pays qui ont le mieux géré l'épidémie en mettant par exemple en place des stratégies de tests de dépistage, ce que la France n'a pas pu faire faute de moyens. On s'aperçoit que la communication du Gouvernement a consisté à gérer la pénurie de tests et de protections. Le Professeur Delfraissy l'a plus ou moins reconnu hier en disant que les avis du conseil scientifique tenaient compte de la situation : s'il n'a pas conseillé le dépistage de masse, c'est qu'il savait qu'il n'y avait pas de tests disponibles.
Même si la comparaison est plus difficile, je pense aussi à la Corée du Sud et à Taïwan qui ont des taux de mortalité extrêmement faibles grâce à une stratégie très claire, mais aussi un pilotage unifié. En vous entendant, et malgré la qualité des uns et des autres, on se dit qu'un pilotage aussi éparpillé, du fait de la multiplicité des instances mises en place, n'a pas aidé à gérer la crise de manière efficace. Comme l'a dit le Président de la République, nous étions en guerre. Or, dans une guerre, on ne demande pas son avis à tout le monde, des sous-lieutenants aux généraux : cela ne peut pas marcher...
Que devrait-on faire qui n'a pas été fait dans la période de crise que nous traversons ? Pourquoi a-t-on créé un conseil scientifique, alors qu'il existait un Haut Conseil de la santé publique ?
Par ailleurs, quel était votre degré de connaissance de l'épidémie et du virus quand les premiers cas ont été diagnostiqués en Chine en février dernier ? Fin janvier, la ministre de la Santé déclarait que le virus n'arriverait pas chez nous. Elle se fondait sûrement sur des modélisations et des données : pourquoi un tel manque de connaissances ? Le 6 mars encore, le Président de la République incitait les Français à se rendre au théâtre, au restaurant et au cinéma. Se pourrait-il que ses propos s'inscrivent dans une stratégie de recherche d'une immunité collective - ce qui pourrait s'entendre - qui n'aurait pas été assumée officiellement ? On perçoit beaucoup d'ambiguïté dans les discours. De ce fait, il est très difficile pour nous d'appréhender ce qui s'est réellement passé au mois de février.
Professeur Chauvin, vous avez parlé de retours d'expérience en octobre et en décembre. Mais c'est maintenant qu'ils seraient utiles ! Les personnels des hôpitaux franciliens ont témoigné qu'ils avaient beaucoup appris de la vague épidémique survenue dans les établissements du Grand Est peu avant, que ce soit sur les méthodes de réanimation, le rôle des anticoagulants ou des anti-inflammatoires.
Même chose pour les médecins généralistes : initialement, on avait annoncé qu'ils devaient rester à l'écart du dispositif et que tous les patients devaient s'adresser au Samu ; par la suite, la stratégie a évolué et, désormais, le virus est partout. Quelles sont aujourd'hui les recommandations données aux médecins généralistes et aux personnels hospitaliers ? Qui doit les leur fournir ? Est-ce la Haute Autorité de santé ? Existe-t-il un guide des bonnes pratiques expliquant la conduite à tenir devant un potentiel malade de la Covid-19 ?
Pr Antoine Flahault. - Si j'ai dit que l'Europe avait bien géré cette crise, c'est parce que, aujourd'hui, je préfère être européen que nord-américain ou israélien. Par ailleurs, il existe en effet des différences notables entre les pays.
La comparaison entre l'Allemagne et la France est très utile, car il s'agit de pays de taille voisine, proches dans un grand nombre de domaines sociaux et économiques et disposant de systèmes de santé comparables. La différence entre leurs taux de mortalité ne s'explique pas par une différence de qualité des soins, alors que les différences observées entre Singapour, la Corée du Sud ou Taïwan et l'Europe sont davantage culturelles, notamment au sens politique du terme. Ainsi, le règlement général de protection des données est européen et n'existe pas en Asie : les systèmes de traçage électronique, les dispositifs utilisant les caméras de surveillance dans les lieux publics ou de surveillance des cartes de crédit sont inenvisageables dans nos pays.
Pour en revenir à la comparaison entre la France et l'Allemagne, je pense pour ma part que ceux qui affirment que l'on manquait de masques et de tests à cette époque font preuve d'une certaine complaisance.
Je vais citer l'exemple un peu sensible de Didier Raoult : très tôt, il était assez clair pour ce médecin qu'il fallait tester davantage. Il l'a dit à l'époque, reconnaissons-le. Simplement, il n'a pas essayé de trouver un consensus avec ses pairs. C'est un personnage très clivant, qui n'a finalement pas réussi à appliquer ses méthodes en dehors de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur où les taux de létalité par habitant se sont révélés inférieurs à ce que l'on observe dans le reste du pays.
Ce qui marque dans le discours de Didier Raoult, c'est qu'il disait : « quand on veut, on peut ». Je pense que s'il y avait eu un consensus général, la France aurait probablement voulu et donc pu. La situation en Allemagne a évolué très différemment grâce à une personnalité comme Christian Drosten, médecin charismatique et très consensuel, qui a cherché et obtenu l'aval de ses confrères, ce qui a permis d'engager une stratégie inclusive et efficace de tests. Ce virologue a tout fait pour que les tests soient disponibles et bien diffusés. Grâce à lui, l'Allemagne a très tôt mis en place une politique de testing, tracing, isolating, c'est-à-dire un dispositif de recherche des contacts.
Le test a un rôle vertueux, car les personnes qui se savent positives peuvent plus facilement s'isoler et rechercher leurs contacts pour qu'ils s'isolent et se mettent en quarantaine. Les premiers cas en Italie ou en Grande-Bretagne ont été découverts dans les services de réanimation à l'hôpital ; en Allemagne, ils l'ont été par les laboratoires : la circulation du virus a ainsi pu être précocement identifiée.
Ceux qui disent que l'on manquait de masques manifestent la même complaisance. Vous nous demandiez quel était notre degré de connaissance de la pandémie en février. J'ai publié un tweet le 26 janvier dans lequel je diffusais une vidéo transmise par un collègue de Wuhan, qui disait manquer de masques en plein coeur de l'épidémie. Wuhan est pourtant la capitale de la fabrication des masques ! Les Chinois se sont alors révélés très inventifs : ils ont pris un mètre de papier toilette, un bout d'élastique, et fabriqué un masque de protection couvrant très bien le nez et la bouche. Cela montre que tous les Ehpad, de même que toutes les écoles auraient pu fabriquer des masques, et ce pour presque rien et sans aucun risque de pénurie...
Hélas, il n'y a pas eu la même volonté ici, mais une forme de complaisance dans les discours, y compris les discours scientifiques expliquant que les masques n'avaient pas d'intérêt pour se protéger du virus - ce qui, pour une maladie respiratoire, est quand même étonnant ! Ces discours servaient simplement à accompagner la pénurie de masques, ou peut-être à protéger un stock de masques destiné aux seuls personnels de santé qui, eux, ont été très correctement équipés et qui n'ont, de ce fait, pas été trop affectés.
Vous évoquez le professeur Raoult, mais il n'était pas seul. Pourquoi personne n'a-t-il été capable d'obtenir un consensus comme en Allemagne ? On a l'impression que notre pays a réagi trop lentement et que nos structures n'étaient pas prêtes : c'est un point qu'il nous faudra élucider.
Pr Antoine Flahault. - On a parfois tendance à vouloir réécrire l'histoire après coup en disant, par exemple, que l'on était au courant avant les autres - ce que je fais avec mon plaidoyer pro domo sur mon tweet du 26 janvier.
En revanche, je le dis très clairement, au début, peut-être parce que je suis épidémiologiste de formation, je n'étais pas convaincu par le discours d'un Christian Drosten ou d'un Didier Raoult sur la nécessité des tests. Les virologues ont été pionniers. À l'époque, je considérais que les tests ne guérissaient pas les gens et que l'on avait surtout besoin de traitements et de mesures de prévention. Pour moi, les tests ne faisaient pas partie des mesures prioritaires à prendre.
Certains de nos confrères ont été plus visionnaires que nous épidémiologistes. Plusieurs de mes collègues - j'en ai notamment parlé avec Anders Tegnell en Suède - n'étaient pas convaincus de l'utilité des tests. D'une certaine façon, nous avons aussi accompagné le discours un peu complaisant dont je parlais.
De fait, on ne réalise pas de tests pour la grippe saisonnière : on se contente de surveiller ce que les généralistes constatent dans leur pratique. Les seuls tests que l'on réalise servent à déterminer la souche du virus qui circule ; les syndromes grippaux définissent l'épidémie de grippe. À tort, je n'ai pas perçu l'utilité et l'importance du cercle vertueux qu'enclenchent les tests, de leur capacité à enrayer les chaînes de transmission. Cet été, en France, nombre de jeunes de moins de 40 ans se sont soumis à un test qui s'est révélé positif et ont fait en sorte, se sachant porteurs, de ne pas contaminer leurs proches plus âgés.

Nous sommes dans le vif du sujet !
Pr Franck Chauvin. - Il faut en effet se garder de la tentation de réécrire l'histoire à la lumière des connaissances que nous avons aujourd'hui. Notre première saisine concernant cette épidémie date du 25 janvier ; on ne peut pas dire que le temps de réaction ait été faible. La deuxième est venue le 3 février, puis huit autres saisines courant février. J'ai recréé le groupe coronavirus en février avec une trentaine d'experts pour y répondre.
Vous parliez du pilotage. Pour moi, il est très clair : il y avait une cellule de crise, avec un directeur, Jérôme Salomon, qui a la possibilité de saisir des instances d'expertise. Mais les experts ne font pas du pilotage - pas plus la Conférence nationale de santé que le Haut Conseil de la santé publique, la Haute Autorité de Santé ou le conseil scientifique. J'insiste : les instances de conseil ne sont pas des instances de pilotage ! Je crois à l'expertise scientifique, multidisciplinaire, par recherche de consensus d'experts qui échangent sur les bases des données scientifiques, comme ce qui se pratique dans la plupart des pays. Il peut y avoir des figures emblématiques qui incarnent quelque chose à un moment donné, mais cela ne fait pas l'expertise scientifique, et certainement pas le pilotage.
Mon expérience, c'est celle d'un directeur de crise qui nous saisit en urgence, pour un avis en 24 ou 48 heures. Mon expérience, c'est celle des deux pilotes qui réunissent leur groupe de travail jour et nuit pour fournir les expertises qui aboutiront à un décret, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique. Notre rôle est d'édicter la doctrine sanitaire. Didier Lepelletier est ainsi à l'origine de toute la doctrine de sortie de confinement élaborée avec le groupe de Jean Castex.
Mon expérience, c'est celle d'une communication extrêmement fluide entre les instances de conseil et les instances de décision. Je n'ai nullement eu l'impression d'une multiplication d'instances de décision.
Y a-t-il eu un changement de doctrine ? Reprenez les avis des instances de conseil, vous constaterez une persistance dans la doctrine. Certes, on insiste tantôt sur le lavage des mains, tantôt sur la distanciation ou le masque, mais ce sont toujours les sept mêmes mesures qui sont prônées. Le contrôle de l'épidémie passe par la mobilisation de ces mesures simultanément. Je n'ai pas du tout cette impression de fluctuations.
Les connaissances ont évolué. Le Haut Conseil a rendu en 2011 un avis sur le masque en cas de pandémie ; à la lumière de ce que nous savons maintenant, je ne vois pas ce que l'on pouvait rajouter à l'époque. La stratégie globale, en termes de doctrine sanitaire, a été relativement stable. En revanche, il y a eu des incertitudes, des questionnements, notamment sur la question de l'aérosolisation. Personne n'avait la réponse. Le Haut Conseil compte des spécialistes de l'environnement, de la climatisation, de la ventilation ; le débat a été intense et constructif avant d'aboutir à un avis, mais la question de la part de transmission par aérosols n'est toujours pas tranchée.
Je n'ai pas du tout une impression de flottement dans le pilotage national ; en revanche, je n'ai pas de visibilité sur le pilotage territorial.
Une crise sanitaire n'est pas qu'une crise sanitaire. C'est une crise de la logistique, de la production, de la mise à disposition de médicaments, une crise sociale ; il faut repérer les travailleurs indispensables. Cela exige une coordination, et nécessite la mise en place d'un centre de crise traitant de l'ensemble des politiques.
Donc il ne faut surtout rien changer ?

On a eu l'impression, un temps, que rien ne se faisait sans le Conseil scientifique. La communication du Conseil scientifique a pu brouiller le message, reconnaissez-le. Était-ce utile que le Premier ministre donne ses conférences de presse aux côtés du Professeur Delfraissy ? La décision devait être politique.
Pr Franck Chauvin. - Je ne saurais le dire. Le défaut des professionnels de santé publique est sans doute de ne pas être des spécialistes de la communication. Les expériences à l'étranger montrent à quel point il est compliqué d'adapter la communication aux différents temps de la crise.
Je ne dis pas qu'il ne faut rien changer, monsieur le président, mais qu'il convient de partir de l'analyse contradictoire, de l'intérieur et de l'extérieur, pour établir un état des lieux de la situation. J'ai conscience, et le Professeur Delfraissy l'a rappelé, qu'il convient de changer des choses, et nous avons d'ailleurs fait des propositions en ce sens.

Mon propos était volontairement provocateur.
Pr Emmanuel Rusch. - J'endosse d'abord ma casquette de président de la Société française de santé publique. Courant janvier, dans la communauté de santé publique, des lanceurs d'alerte ont fait passer des messages auprès de leurs collègues ; ces alertes étaient discutées dans nos instances, sans qu'il y ait de consensus sur l'évolution prévisible de la situation.
Les choses se sont progressivement décantées en février. Il y a ce que dit la communauté de santé publique, dans sa diversité - épidémiologistes, sociologues, etc. - et les alertes de l'OMS, qui incite à « tester, tester, tester ». Je ne peux pas dire que le consensus ait été immédiat dans la communauté scientifique santé publique.
La question du masque mériterait une analyse fine. Le sujet est rapidement venu au sein de la communauté de santé publique, mais le message a été brouillé par la prééminence du modèle biomédical : il fallait le masque parfait, chirurgical, FFP2, correctement mis... Cela laisse peu de marges de manoeuvre, et rend les choses impossibles.
Nous avons relayé, sur le site de la Société française de santé publique et dans notre flash mail, le message selon lequel, même en l'absence de données scientifiques bien établies, le principe était bien le port du masque. Cela n'a pas été sans mal.
Vous nous préciserez par écrit la date exacte.
Pr Emmanuel Rusch. - Je coiffe maintenant ma deuxième casquette, celle de président de la Conférence nationale de santé. La Conférence nationale n'a pas fonctionné pendant un an ; elle a été reconstituée le 12 février, avec une nouvelle équipe. Nous nous sommes réunis fin février-début mars, mais nous avons perdu quinze jours... Nous sommes restés un an sans Conférence nationale de santé, ce qui est bien dommage. Je peux témoigner du dynamisme de ses membres, qui n'ont pas hésité à se réunir à toute heure, jours fériés compris. Ce n'est pas une instance d'expertise scientifique, mais un regroupement d'expertise de la société civile : elle dégage des consensus collectivement acceptés ; nous gagnerions à la mobiliser davantage.
Nous nous sommes autosaisis, mais à ce jour, la Conférence nationale de santé n'a jamais été saisie.

Des recommandations ont-elles été faites aux médecins généralistes, au regard de la situation actuelle ?
Pr Franck Chauvin. - Des recommandations thérapeutiques ?
Oui, concernant la prise en charge de patients suspects d'infection à la covid ? Les médecins de terrain demandent à bénéficier des retours d'expérience, comme le font les sociétés savantes entre elles. Cela rassurerait la population et les soignants.
Pr Christian Chidiac. - Le Haut Conseil de la santé publique compte en son sein deux généralistes qui participent à la rédaction des avis dont certains, assez fournis, concernent la prise en charge des patients. Le problème tient à la diffusion de ceux-ci et à la communication autour de la production scientifique du Haut Conseil. Notre rapport publié fin juillet comportait des éléments sur la prise en charge ambulatoire, mais nous n'avons pas rédigé de fiches pratiques à l'attention des médecins, faute de temps. Ce n'est d'ailleurs pas notre rôle, mais plutôt celui des sociétés savantes ou du site du Gouvernement.

C'est pourquoi nous souhaitons un retour d'expérience le plus rapide possible.

Merci pour cet échange passionnant. Ce sont de tels échanges, et non des monologues assénés à une assemblée, qui font progresser.
Nous avons découvert, au fil des auditions, que des alertes avaient été lancées dès le mois de janvier, y compris par la ministre de la Santé elle-même. En reconstituant la chronologie des évènements, on a l'impression que le mois de février n'a pas été très actif. Le Professeur Flahault a proposé une grille d'explication intéressante, en parlant de défaut de volonté. Il est sûr que si on ne veut pas, on ne peut pas... Le Professeur Chauvin, lui, nous dit que notre dispositif est fonctionnel. Il faut aller plus loin. Pourquoi n'a-t-on pas voulu ? Il nous manque une clé d'explication.
Si le dispositif était fonctionnel, pourquoi le chef de l'État a-t-il voulu un conseil scientifique ? Le Professeur Delfraissy a estimé hier que nous n'étions pas prêts, en termes logistiques et dans l'appréhension même de la crise sanitaire. Nous sommes bien obligés de poursuivre cette réflexion. Tous les pays n'ont pas vécu la même situation ; certains ont bien réagi, ayant appris du retour d'expérience. La France, elle, n'avait pas rencontré d'épidémie - depuis 1995, le VIH, traité, n'est plus perçu comme tel -, c'était donc un phénomène nouveau. Il n'y a pas de honte à constater que nous n'avions pas le dispositif adéquat.
Le pilotage fonctionne, nous dit le Professeur Chauvin : c'est la cellule de crise. Pour nous, le pilotage relève du conseil de défense... Il faut une articulation entre le politique, qui doit prendre et assumer les décisions, et l'analyse scientifique qui élabore la politique de lutte contre l'épidémie. Or manifestement, notre fonctionnement n'a pas donné les meilleurs résultats...
Comment expliquez-vous les difficultés persistantes dans les Ehpad ? L'épidémie se caractérise par sa violence pour les personnes âgées et le risque que représentent les formes d'habitat regroupé. Or l'Ehpad conjugue ces deux facteurs de risque ! Pourquoi tant de retard à se pencher sur la situation des Ehpad ? Est-ce dû à la lenteur de l'avancée des connaissances, ou, plus structurellement, à une mauvaise prise en compte des personnes âgées dans un pays qui, à entendre des voix autorisées, pratique l'âgisme ? Quel est votre avis ?
J'apprends avec étonnement que la Conférence nationale de santé, sommet de la démocratie sanitaire, n'a pas fonctionné pendant un an ; c'est un dysfonctionnement majeur ! Vous nous apprenez en outre qu'elle n'a toujours pas été saisie pour donner un avis sur la lutte contre l'épidémie...
Professeur Flahault, vous publiez beaucoup de données internationales passionnantes. Certains considèrent que les régimes autoritaires répondraient mieux à l'épidémie que les démocraties. Qu'en pensez-vous ?
Pr Antoine Flahault. - Merci de ces questions et de ces échanges. Il ne faut pas faire d'anachronismes, mais poser la question du pourquoi. Les démocraties d'Asie - Singapour, Taïwan, Hong Kong, Japon, Corée du Sud -, mais aussi l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ont été extrêmement vigilantes et s'étaient préparées à l'émergence d'un virus venu de Chine continentale ou d'Asie du Sud-Est. Ces pays avaient des informations via le renseignement et ont pris très au sérieux l'alerte de Wuhan. Pour eux, point de débat picrocholin sur une « petite grippe » ; ils ont déroulé un plan qu'ils avaient dans les cartons - testing, tracing - avant même les premiers cas sur leur territoire. Au 1er février, quand Pékin annonçait 12 000 cas, Hong Kong, qui n'était pas dupe, estimait la réalité à 75 000, au vu des modélisations mathématiques. Imperial College est parvenu à des estimations proches.
L'Europe, l'Occident n'imaginaient plus qu'une pandémie pouvait émerger. Les pays voisins de la Chine, eux, se rappelaient le SRAS, les grippes aviaires ; la grippe H1N1 leur a servi de terrain d'exercice. Singapour a freiné le virus sans jamais confiner, du moins jusqu'en avril, quand des clusters se sont développés dans des cités-dortoirs - preuve que la vulnérabilité sociale est toujours un maillon faible de la chaîne. Le niveau de vigilance, d'alerte et de préparation n'était pas le même en Asie et en Europe.
J'en viens au sujet du pilotage. Vous avez été étonnés que la cellule de crise ait piloté. C'est une vision très française ! En Suède, ce n'est pas le politique qui gère la pandémie, mais l'Agence de santé publique ; Anders Tegnell n'est pas ministre de la Santé. Il faut une étanchéité entre le rôle du politique et celui du scientifique, ai-je entendu. En Suède, il y a plutôt consanguinité - pour autant, sa culture de santé publique est l'une des meilleures au monde, ses indicateurs de santé sont excellents, son école de santé publique, avec l'Institut Karolinska, est une voix que l'on écoute.
En Suède, point de décret ni de loi pour gérer la pandémie, mais un auto-confinement et une responsabilisation des Suédois, avec une pédagogie pour obtenir le consensus autour des mesures à mettre en oeuvre à titre personnel. Certes, la ministre de la Santé est intervenue quand il s'est agi de fermer les collèges, lycées et universités, ou de limiter les rassemblements à 50 personnes, mais pas pour promouvoir le télétravail ou inciter les gens à rester chez eux ; si les commerces non-essentiels ont fermé, c'était faute de clients. C'est bien le scientifique, via les agences, qui gère la situation.
Mais si l'on veut une vision autoritaire, pilotée par le Gouvernement, qui empiète sur nos libertés, c'est au politique de reprendre les rênes.
Les régimes autoritaires sont-ils plus efficaces ? Le fondement scientifique du confinement est de faire baisser le taux de reproduction, qui découle de trois paramètres : la probabilité de transmission, le nombre de contacts et la durée de contagion. Faute de médicament, on ne peut faire bouger ce dernier paramètre ; il faut donc jouer sur les deux premiers. Réduire la probabilité de transmission, c'est pratiquer les gestes barrières : cela ne relève pas du politique, sinon pour rendre le masque obligatoire dans les transports publics ou les lieux clos. Pour réduire le nombre de contacts, on peut opter pour un confinement strict et autoritaire, qui nécessite alors une décision du pouvoir politique.
C'est le pouvoir autoritaire de Chine qui a inventé le confinement strict - option que n'envisage, à ma connaissance, aucun manuel d'épidémiologie ! Les confinements aux États-Unis en 1918 n'étaient pas décidés au niveau fédéral, mais par les États ; les confinements plus stricts se sont révélés plus efficaces que les confinements plus souples.
Pour réduire le nombre de contacts et faire baisser le R0, les Chinois ont été extrêmement stricts, violents, isolant les gens chez eux en scellant les portes ! Je ne dis pas que la France, l'Italie ou l'Espagne ont fait pareil, mais elles ont adopté, sur la recommandation de l'OMS, dans l'urgence, un confinement strict qui nécessitait un pilotage au plus haut niveau de l'État. La Suisse, l'Allemagne, l'Autriche ont opté pour un semi-confinement bien moins strict : les gens pouvaient se déplacer sans autorisation administrative, mais ne l'ont pas fait, ils suivaient les recommandations des scientifiques. En Suède, on a observé un retrait du pouvoir politique au profit de l'auto-confinement et de la responsabilisation individuelle ; on a laissé les agences et les experts scientifiques expliquer à la population pourquoi il fallait rester chez soi. Cela fonctionne très bien dans un pays façonné par la responsabilité individuelle dans le champ de la santé publique. Le grand tort de la Suède, à mon avis, a été de ne pas avoir protégé ses Ehpad, et de ne pas promouvoir le port du masque - cela dit, nous ne sommes pas là pour évaluer les différents modèles, mais pour en tirer les leçons.
Un régime très autoritaire peut certes fait baisser le R0 grâce à un confinement très strict, mais faut-il pour autant perdre notre âme ? Il n'y a pas que la covid dans la vie ! Une récente étude de Zürich montre qu'un confinement moins strict est aussi efficace contre la pandémie ; il n'est pas forcément nécessaire de confiner l'économie.
Pr Franck Chauvin. - J'adhère à l'analyse du Professeur Flahault pratiquement en tout point. La santé publique s'inscrit dans la culture et le système politique d'un pays. Le modèle suédois est très intéressant - mais la part des dépenses hospitalières dans les dépenses de santé y est très loin de ce qu'elle est en France. La Suède a développé un modèle de santé, pas un modèle hospitalier.
Je prendrai pour ma part l'exemple britannique, avec l'agence Public Health England : c'est l'irruption du politique dans la décision en santé publique qui a singulièrement compliqué les choses, et pesé sur les résultats.
De mon point de vue, le modèle français, tel qu'il est organisé, a fonctionné comme il était dit qu'il fonctionnait. Est-ce le meilleur modèle de santé publique ? La discussion, complexe, mériterait d'avoir lieu. En France, la Direction générale de la santé est une direction du ministère de la Santé ; d'autres pays ont une autre organisation. Les relations, telles que je les ai vécues, entre l'instance d'expertise que je préside et le ministère de la Santé qui gérait la cellule de crise, ont été fluides. Le ministre a pu disposer d'expertises répondant à la charte de l'expertise sanitaire, fixée par décret.
La relation entre l'expertise et le politique est complexe. En France, c'est le politique qui décide, non l'expert, qui se borne à faire des recommandations. En France, il faut un décret au Journal officiel pour fixer le fonctionnement d'un certain nombre d'institutions. Ai-je répondu à votre question ?
Merci. Il n'y a pas de hiatus dans les constats. Il ne s'agit pas de dire que nous aurions tout fait mal, et notre édifice de santé publique s'est beaucoup perfectionné ces dernières années. Sans doute faut-il faire la part des raisons d'ordre mémoriel, ou de proximité avec la source du virus, et celles, structurelles, d'organisation de la santé publique. Vos contributions nous permettent d'avancer dans notre réflexion sur l'amélioration de la gouvernance de la santé publique.
Pr Franck Chauvin. - Il faut mener une réflexion sur la faiblesse de la culture de santé publique dans notre pays. La population française a dû apprendre un certain nombre de notions qui, dans d'autres pays, sont acquises très tôt. Nos collégiens et lycéens reçoivent un enseignement en génétique, mais pas en santé publique...

Ou en instruction civique...
Pr Franck Chauvin. - En France, on considère que la santé, c'est le soin. Or le système de soins ne contribue que pour 25% à la santé de la population ! Tout le reste se passe ailleurs. En Suède, au Danemark, aux Pays-Bas, les gens comprennent les consignes et les appliquent. Notre pays associe très peu la population aux mesures préconisées. Si les Français avaient une culture de santé publique plus développée, s'ils étaient plus impliqués, ils comprendraient, sans que cela fasse débat, la nécessité de la distanciation physique et sociale, du port du masque, etc.
Pr Emmanuel Rusch. - Plus largement, la question est celle de la culture scientifique et de l'éducation aux sciences.
Le sujet des Ehpad est symptomatique d'un système de santé structuré en tuyaux d'orgue. Il suffit de voir la difficulté que le comité de contrôle et de liaison a eu à agréger dans les systèmes d'information les données de mortalité dans le médico-social avec les données hospitalières, et celle que nous avons encore à décompter la mortalité à domicile. Notre modèle est d'abord hospitalier ; l'ambulatoire s'est peu à peu développé, mais le médico-social reste encore à la marge. Est-ce une question de culture, de perception des personnes âgées ou handicapées ? Il faut se préoccuper du parcours de santé de la personne dans son ensemble, pas uniquement des épisodes à l'hôpital ou en établissement.
Avant de présider la Conférence nationale de santé, j'ai présidé pendant six ans sa commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers. La mise en place des conseils de vie sociale dans les Ehpad a été une évolution très positive ; il faut désormais les faire vivre. Les associer aux prises de décisions faciliterait les relations entre les familles, les personnes âgées, les soignants et les gestionnaires d'établissements, qui ont souvent dû agir du jour au lendemain, sans concertation avec les pensionnaires ou leur entourage.
La crise a entrainé une réorganisation en milieu hospitalier, mais pas dans le médico-social. Il faut qu'on se bouge ! Nous ne cherchons pas à réécrire l'histoire, mais à analyser pour pouvoir faire des préconisations.

Comment se fait-il qu'alors qu'on décrétait l'isolement des Ehpad, il n'y ait pas eu de consignes concernant le personnel - tout le personnel, jusqu'aux cuisiniers ? Le virus est rentré dans les Ehpad via le personnel, les résidents n'ont pas été mis à l'abri. Le Lot a été globalement très peu touché, mais la moitié des résidents des quatre établissements autour de ma commune ont été contaminés ! J'ai interpellé le préfet et interrogé le Gouvernement dès début avril sur la pénurie de matériel de protection pour le personnel des Ehpad. S'il avait été incité à fabriquer ses propres protections, comme l'a évoqué le Professeur Flahault, on aurait sans doute évité bien des contaminations.
Professeur de physique-chimie, je plaide moi aussi pour un renforcement de l'éducation scientifique et je porte souvent des amendements sur le sujet.
Vous avez évoqué l'émotion créée par le déballage d'opinions dans les médias. Pourquoi n'a-t-on pas vu monter dans la société ce phénomène qui se manifestait déjà dans d'autres domaines ? Comment s'étonner que la parole scientifique ne soit pas davantage écoutée et reconnue, quand des générations ont été biberonnées à la télé-réalité ?
Les décès chez les personnes âgées ont été quatre fois moins nombreux en Allemagne qu'en France, a dit le Professeur Flahault. Où se situe la différence entre les établissements allemands et les nôtres ? L'Allemagne n'a pas employé le même vocabulaire guerrier, n'a pas infantilisé sa population, elle a fait le pari de l'intelligence. Que faudrait-il changer dans notre société ?

Les enfants de plus de 11 ans ont l'obligation de porter le masque en permanence, en classe et hors de la classe. Des généralistes font le lien avec une recrudescence de cas de bronchites, d'herpès, de fatigue. Qu'en pensez-vous ?
Je considère qu'il faut prioriser les tests PCR et réduire les délais d'attente. Est-il vraiment utile de tester des enfants de 2 ou 3 ans qui ont un rhume et un peu de température ? Ne peut-on les laisser tranquille ?

J'ajoute une question : pourquoi le masque à partir de 11 ans seulement, et non dès 6 ans comme en Espagne ?

Le Professeur Chauvin dit être satisfait du fonctionnement de l'expertise. Hier, les Professeurs Delfraissy et Costagliola nous parlaient pourtant de difficultés et même de carences dans la gestion de la santé publique. Le Professeur Rusch nous dit que la Conférence nationale de santé n'a pas été saisie, or le Professeur Delfraissy, que j'interrogeais sur ses relations avec les instances de démocratie sanitaire, m'a répondu être constamment en relation au niveau national. J'avais pourtant évoqué spécifiquement les commissions régionales de santé et les commissions spécialisées dans le domaine des droits des usagers. La représentante d'ADT Quart Monde ne m'a pas apporté la réponse que j'attendais. Quelles sont les relations avec les différentes instances territoriales, ARS, préfets ? La Conférence nationale de santé a-t-elle eu des remontées du terrain ? Les conférences régionales de santé et de l'autonomie sont à même d'apporter, me semble-t-il, un éclairage précieux.

Il ressort de nos auditions que nous avons quantité d'organismes scientifiques, d'instances de conseil et d'expertise, qui fournissent des avis. Cela ne contribue-t-il pas à brouiller le message ? Un nombre trop élevé d'instances nuit à la force du propos. Une meilleure centralisation éviterait sans doute une déperdition d'énergie.
Vous dites avoir été alertés très tôt, dès janvier-février. Les parlementaires, comme la population, l'ont été bien plus tard. Quand nous relayions des échos, nos interrogations étaient balayées : il ne s'agissait que d'une grippette... Comment se fait-il qu'avec une telle multitude d'instances de conseil, le politique ait mis tant de temps à agir ?
Je m'étonne que vous sembliez surpris que les Ehpad soient si peu médicalisés. C'est pourtant le propre de ces établissements, conçus pour sortir de l'hôpital les personnes très âgées en perte d'autonomie. Se pose la question de leur accompagnement, dans une société qui considère que résidents en Ehpad perdent leurs droits, ne sont plus citoyens, qu'il faudrait les protéger malgré eux ! La première des protections, me semble-t-il, est la protection du personnel des Ehpad. Or les masques ont manqué, et continuent à manquer : je suis régulièrement alertée sur un provisionnement insuffisant en cas de deuxième vague.
Enfin, les enseignants sont très démunis face à des enfants qui présentent des symptômes de rhume classiques - nez qui coule, toux... Faut-il fermer la classe ? Les mesures sont parfois draconiennes et source de stress dans les écoles.
En France, la santé se résume trop au soin ; nous sommes trop peu impliqués dans la prévention et l'éducation. Or on en revient à des mesures aussi élémentaires que le lavage des mains...

Vous avez évoqué la « polémique spectacle », qui a nourri et majoré les inquiétudes et troublé les messages. Comment l'expliquez-vous ? À qui profite-t-elle ? Certainement pas à nos concitoyens... Que proposez-vous pour y remédier ?
Pr Antoine Flahault. - Merci de ces questions. On savait, par l'expérience de Wuhan, que les personnes âgées étaient particulièrement à risque. L'Allemagne en a tenu compte et a donné la priorité absolue à leur protection. Nous n'avons pas eu en France la même attitude s'agissant de la protection individuelle des résidents et du personnel des Ehpad - il aurait fallu en effet équiper jusqu'aux cuisines, jusqu'aux fournisseurs mêmes. Tous les maillons de la chaîne doivent être forts.
L'idée qu'il puisse y avoir aujourd'hui pénurie dans les Ehpad français est tout bonnement inaudible. Peut-être ne faut-il pas tout attendre de l'État et des collectivités locales ; les masques de protection peuvent s'acheter, se fabriquer. La France a les moyens de protéger ses Ehpad.
L'expérience de l'été montre que les personnes âgées ont compris le risque de la covid19 - plus important que celui d'une infection grippale dès 40 ans, très féroce après.
Quelle place pour la parole scientifique dans les médias ? Le monde a changé, les réseaux sociaux sont libres, ouverts, une source inépuisable d'informations peu validées, contradictoires, voire fake. C'est le propre de la démocratie... on peut s'en plaindre ou s'en réjouir, c'est un fait.
Les gouvernements européens, pour la plupart - le Royaume-Uni tardivement, après avoir payé un lourd tribut - ont adossé leurs politiques sur la science. Il faut s'en réjouir. Plutôt que de déplorer un manque d'étanchéité entre le scientifique et le politique, privilégions une politique fondée sur des connaissances scientifiques. En France comme dans tous les pays européens, la gestion de l'épidémie était fondée sur des preuves scientifiques, qui évoluent, changent, sont débattues par la communauté scientifique. Les données scientifiques ne se résument pas aux données sanitaires ; on tient aussi compte de l'apport des sciences humaines, sociales, politiques.
Non, le masque ne présente pas de risque particulier pour les enfants. On entend qu'il pourrait gêner ceux qui souffrent de maladies de peau. L'expérience montre plutôt le contraire : le masque, en ce qu'il dissimule, les soulage en évitant la stigmatisation que peuvent entraîner les problèmes dermatologiques.
Il faut promouvoir le port du masque dans les écoles. Je regrette qu'il ne soit pas préconisé dès 6 ans - cela aurait sans doute évité nombre de clusters dans les établissements scolaires en France et en Suisse. Les instituteurs peuvent accompagner les élèves sans dogmatisme, ôter le masque quand certains apprentissages l'exigent. Les pays asiatiques sont pionniers. Ne disait-on pas, hier encore, que nous ne porterions jamais de masques comme en Asie, que ce n'était pas la culture occidentale ?
Ne soyons pas complaisants, faisons la promotion du masque dans les lieux clos - uniquement les lieux clos, mais tous les lieux clos, surtout ces salles de classe souvent mal ventilées.
Pratiquer un test PCR sur un enfant de 2 ou 3 ans est impossible, sauf à faire un prélèvement salivaire ; le frottis naso-pharyngé donne souvent un faux négatif, car l'enfant se débat. C'est ce qui a sans doute conduit à négliger le portage du virus chez les enfants, dont on sait aujourd'hui qu'il est probablement de même niveau que celui des adultes.
Sur la question du port du masque en milieu scolaire, les établissements recevant du public (ERP) ont effectivement été destinataires de plusieurs circulaires et, parmi eux, l'école a reçu des consignes différentes en fonction des classes d'âge. Très tôt, pour préparer au mieux la sortie du confinement du 11 mai, le Haut Conseil de la santé publique a remis au ministre de la santé un rapport conséquent sur le sujet. Il paraît indispensable que l'enfant ait la capacité de porter le masque ; en laisser la discrétion au professeur nous exposait excessivement aux ruptures d'égalité et aux éventuelles contestations, ce qui nous a menés à proposer dans un premier temps une barrière d'âge à 12 ans. Face à l'appréhension suscitée par la réapparition des clusters, nous avons ensuite été interrogés sur la possibilité d'abaisser cette barrière. Bien qu'on ne sache pas encore exactement l'impact du port du masque sur le développement d'un enfant, les pédiatres s'accordent pour constater une assez bonne adaptation de l'enfant. Le port du masque par de très jeunes enfants, au-dessus de 6 ans, ne semble donc pas poser de problème, à condition qu'on prévoie les dérogations nécessaires pour ceux présentant des problèmes particuliers de comportement.
Se pose également la question de la détection. Il me paraît important d'axer la surveillance et d'éventuellement tester les seuls cas symptomatiques, et de privilégier les réponses ciblées aux mesures générales de fermeture d'établissement. Ces mesures ne sont bien entendu applicables qu'à la condition d'être très attentif au moment des diagnostics différenciés et de ne négliger aucun cas symptomatique.
Pr Franck Chauvin. - Vous me demandez de préciser le terme employé de « polémique spectacle ». Il nous a en effet fallu réagir à des propos scientifiques d'individus isolés, alors que ce n'est pas du tout la mission d'un organisme sanitaire indépendant. Dans ce contexte-là, la communication nous semblait plus délétère que bénéfique et nous nous sommes donc astreints à la discrétion.
Je nous pense d'ailleurs confrontés à un phénomène d'une ampleur nouvelle : le populisme scientifique. Les opinions doivent désormais être démontrées par les faits, alors que la démarche scientifique commanderait précisément l'inverse. Nous rencontrons ainsi le même problème qu'a connu le monde politique il y a quelque temps. Nous l'avions déjà expérimenté en 2009, sans toutefois y prêter une attention suffisante.
Encore aujourd'hui, des personnes ayant prédit qu'il n'y aurait pas de seconde vague continuent d'être invitées sur les plateaux de télévision. On confond volontiers les tribunes et professions de foi avec les avis donnés par des instances de conseil scientifique, délivrés par des membres respectant les règles déontologiques proscrivant tout lien d'intérêt. Le public s'est ainsi laissé prendre au jeu fallacieux des syllogismes en tout genre.
À mon sens, la faible culture de la France en santé publique est en partie la cause de ces récupérations. Nous souffrons en la matière d'une véritable carence. Une politique de santé entièrement fondée sur le soin curatif - qui mobilise 93 % des dépenses de santé pour seulement 25 % des besoins de santé de la population - nous fait passer à côté d'un pan fondamental de l'accompagnement thérapeutique. L'exemple déjà évoqué de la Suède nous montre tout l'intérêt et l'urgence d'une inflexion plus prononcée vers la santé publique.
Sur les liens entre agences et décideurs politiques, je vous répondrai en deux temps. Je ne crois pas déceler de problème particulier au niveau central. Durant cette crise, le HCSP a beaucoup contribué et les liens entretenus avec la DGS, à qui seule revenait la décision politique, ont été fréquents. Il convient d'ailleurs de bien séparer les instances d'expertise indépendante - HAS et HCSP - des agences qui sont directement placées auprès du ministère et qui ont un rôle surtout opérationnel - Santé publique France. Les premiers sont chargés de fournir un conseil, la seconde a une mission d'exécution.
Plus que d'une pluralité d'acteurs au niveau central, le problème me semble venir d'une absence d'acteurs au niveau territorial. Les services de santé publique locaux, lorsqu'ils existent, sont loin des centres décisionnaires. J'observe une véritable carence d'effecteurs de santé publique sur le terrain. Les communes ont été très peu associées dans la première vague. Outre les difficultés très pratiques que ce manque engendre, notamment en matière de dépistage, il occulte un élément plus grave et moins connu des crises sanitaires : l'importance des inégalités sociales en santé. Sans santé publique de territoire, nous découvrons trop tardivement, et presque par hasard, l'extrême vulnérabilité des personnes défavorisées face aux crises sanitaires. Les seules données collectées au niveau central, concentrées sur les chiffres de la mortalité, ont sans peine mis en lumière la vulnérabilité particulière des personnes âgées, mais pas celle des personnes pauvres. Nous n'avons été sensibilisés au phénomène que parce que les Britanniques, puis les Américains, s'y sont penchés.

Il existe pourtant des contrats locaux de santé (CLS) au niveau territorial, mais qui n'ont pas tous été activés.
Pr Franck Chauvin. - Ce qui achève de prouver qu'une santé publique de territoire ne peut être performante que si elle est connectée aux autres instances sanitaires, notamment les ARS et les professionnels de santé.
Pr Emmanuel Rusch. - La Conférence nationale de santé avait souligné le problème des moyens disponibles en Ehpad dès avril. En effet, par sa composition même, qui réunit des directeurs d'établissement et des représentants d'usagers, elle rassemblait les principaux acteurs concernés et, si nous avions été consultés, nous aurions parfaitement pu donner l'alerte.
L'éducation pour la santé évoquée tout à l'heure est à mon sens fondamentale ; la « polémique spectacle » en est sans conteste une conséquence de notre retard en la matière.
Vous avez évoqué les contrats locaux de santé, abondamment activés par l'ARS de la région Centre-Val de Loire. Leur problème principal réside dans le statut des professionnels mobilisés, souvent très précaire et de rémunération très faible. Leur turn-over inquiétant ne peut qu'interroger la pérennité de ces outils pourtant très utiles.
Sur les relations entre acteurs, nous avions proposé de monter, avec le Conseil économique, sociale et environnemental (CESE) ainsi que la commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), un comité citoyen. Cette solution n'a pas été retenue et le comité de contrôle et de liaison lui a été préféré.
Contrairement aux organes d'expertise scientifique, la CNS se situe plutôt dans une dynamique de société civile. Elle entretient des liens avec toutes les conférences régionales de la santé et de l'autonomie (CRSA) et a très tôt organisé la réunion de leurs présidents, qui n'étaient absolument pas mobilisées par les ARS au cours de la crise. Il en est allé de même pour les conseils territoriaux de santé (CTS), qui sont des organes de démocratie sanitaire très importants, mais tout aussi négligés par les ARS. Il y a là un important problème « culturel », par lequel l'acteur décisionnaire ne songe même pas à solliciter les instances représentatives des usagers !
Les outils statistiques mis à notre disposition, qui permettent aux opérateurs de l'État et aux ARS de suivre au niveau national le niveau de l'épidémie, devraient à notre sens être davantage territorialisés. Nous disposons d'informations pertinentes et exhaustives sur la mortalité, la prévalence et la positivité du virus à grande échelle. Mais certains éléments nous inciteraient désormais à examiner des chiffres plus localisés : on perçoit sur le terrain une forme d'épuisement de la part des laboratoires de biologie médicale dans le dépistage, ainsi que des menaces sur l'approvisionnement en réactifs et des problèmes de réception de machines commandées. Par ailleurs, le prélèvement et le dépistage d'un échantillon doivent s'effectuer dans des délais compatibles avec la rupture de la chaîne de transmission. En conséquence, il me paraît difficile de ne pas prioriser les capacités de tests à l'avenir, ce qui nécessite de disposer d'une information très territorialisée, pour savoir quelles équipes particulières renforcer et quelles zones cibler davantage.
Vous ne m'ôterez tout de même pas l'impression qu'on a inutilement multiplié les comités.
Pr Franck Chauvin. - Sur la recherche clinique, nous avons rendu des avis pour lesquels nous avons reçu diverses pressions médiatiques.
Il est vrai que la relative harmonie des agences sanitaires précédemment décrite ne s'est absolument pas retrouvée dans le champ des essais cliniques. Le bilan des travaux lancés pour les traitements montre que près de 62 projets, en avril et mai, bénéficiaient d'un agrément de l'ANSM. Ces essais, bien trop nombreux, n'ont pas été productifs, et se sont même mutuellement nui. Il a manqué une structure de coordination similaire à celle mise en place pour le traitement du VIH, l'agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virale (ANRS).
À ce jour, ces essais n'ont rendu qu'un seul résultat : une molécule semble avoir des effets sur la mortalité à 28 jours, la dexaméthazone, et uniquement pour un certain type de patients.

J'aurais souhaité des précisions sur la contradiction entre la nécessaire protection apportée par les Ehpad à leurs résidents et la remise en cause des libertés individuelles des personnes âgées. Par ailleurs, même si vous affirmez que les liens entre les décideurs politiques et vous-mêmes ont été fluides, ce sentiment n'est absolument pas partagé par la population et je ne sais pas si l'ajout d'un échelon territorial de santé publique sera suffisant pour y remédier.

Je suis parfaitement d'accord avec la proposition de M. Rusch de davantage territorialiser les données de suivi, ce qui est à mon sens indispensable à une meilleure gestion de la capacité des laboratoires.
Pr Emmanuel Rusch. - Dès le 2 avril, nous alertions sur la nécessité d'une politique de communication organisée et dédiée de la part des pouvoirs publics. Comme pour de nombreux sujets de santé publique - notamment la vaccination - ces derniers ont tardé à identifier les médias pertinents pour asseoir leur message. Trop de temps a été perdu à se mobiliser dans les médias classiques, alors que les polémiques se déchaînaient déjà sur les réseaux sociaux.
Sur les personnes âgées en Ehpad, je ne peux que vous rejoindre. Je pense que, lorsque l'État intervient pour limiter certaines libertés, cela doit toujours être justifié et proportionné. Or la CNS a constaté que cela n'avait pas toujours été le cas.
Pr Antoine Flahaut. - Cette question des Ehpad est importante. La mortalité étant concentrée chez les personnes âgées, il convient de les protéger. Les résidents d'Ehpad sont des adultes, qui signent le règlement intérieur de l'Ehpad au moment de leur admission et qui consentent d'emblée à certaines restrictions de leurs libertés individuelles.
Je tiens à rappeler que toutes les générations devront s'acquitter d'un tribut lourd à la suite de cette crise : pour les jeunes, il sera surtout de nature économique et sociale. Nous allons avoir un grand besoin de sérénité intergénérationnelle, condition nécessaire à la victoire contre cette pandémie.

Je vous remercie.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
La réunion est close à 11 h 50.