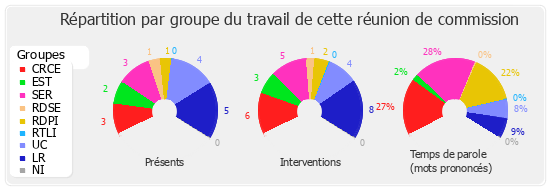Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
Réunion du 9 novembre 2022 à 9h00
La réunion

Mes chers collègues, je vous propose de débuter cette réunion par la désignation de rapporteurs. Je vous propose ainsi de confier :
- à Marie-Pierre Monier le rapport sur la proposition de loi n° 49 (2021-2022) relative à la titularisation des accompagnants d'élèves en situation de handicap et des assistants d'éducation ;
- à Jean-Raymond Hugonet le rapport sur les projets d'avenants aux contrats d'objectifs et de moyens (COM) 2020-2022 de France Télévisions, Radio France, ARTE France, France Médias Monde et de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) ;
- à Else Joseph, Catherine Morin-Desailly et Thomas Dossus une mission d'information sur l'expertise patrimoniale internationale française,
- à Céline Boulay-Espéronnier, Sonia de La Provôté et Jérémy Bacchi le soin d'animer une mission d'information sur la situation de la filière cinématographique en France ;
- à Jacques Grosperrin le rapport d'une mission d'information visant à évaluer les dispositifs Parcoursup' ;
- à Max Brisson, Annick Billon et Marie-Pierre Monier le rapport d'une mission d'information sur l'autonomie des établissements scolaires ;
- à Cédric Vial le rapporteur d'une mission d'information sur les modalités de financement et de mise à disposition des AESH sur le temps de restauration et d'accueil périscolaire ;
- et à Toine Bourrat et Jean-Jacques Lozach le rapport d'une mission d'information visant à évaluer le dispositif « 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école ».
Il en est ainsi décidé.

Nous examinons ce matin le rapport pour avis de notre collègue Jérémy Bacchi sur le projet de loi de finances pour 2023.

Dans les quinze premiers jours d'octobre, la presse a recouru à des titres alarmistes qui ne vous ont pas échappé. Quelques exemples : « Crise de la fréquentation des salles : à qui la faute ? », « Panique à bord du cinéma français », « Le cri d'alarme d'un cinéma en crise »... En un mot, on pourrait à juste titre s'exclamer : « Mais qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ??? »
Je voudrais, dans le cadre de cette présentation, nuancer par un peu d'optimisme cette atmosphère bien sombre : non, le cinéma n'est pas mort, non, il n'est pas prêt de mourir, oui, les défis sont nombreux, oui, nous sommes armés pour les affronter !
Je vais commencer par le principal opérateur qu'est le CNC.
Le Centre sort de deux années « hors normes » où, un peu à l'image de son petit frère le CNM, il a été en tête de la bataille pour préserver puis redresser le secteur.
Comme je vous l'indiquais l'année dernière, le cinéma a bénéficié d'un soutien de 430 millions d'euros. Ils auront été intégralement dépensés à la fin de l'année.
Le Centre va donc revenir à un étiage plus normal en 2023, avec un budget en léger déficit et des dépenses de soutien autour de 700 millions d'euros.
Si l'on s'inscrit dans le temps long, il est remarquable de constater que tant au niveau des ressources que des dépenses, le CNC affiche une grande stabilité sur trois points :
- le niveau des ressources, qui ont su évoluer et s'adapter à la montée en puissance des plateformes ;
- le niveau des soutiens, qui demeurent également constants sur 10 ans, jouant en quelque sorte le rôle « d'amortisseurs » ;
- enfin, et contrairement aux craintes exprimées, sur la répartition de ces soutiens entre cinéma et audiovisuel.
Le maintien de cette répartition sur longue période est d'autant plus remarquable que l'audiovisuel vit ce qu'il est convenu d'appeler un « âge d'or », avec l'explosion de la demande pour les séries, genre désormais dominant. Le cinéma n'en a pas pâti en termes de soutien. A vrai dire, le principal sujet de la filière aujourd'hui est lié aux capacités de notre appareil créatif à répondre à l'ensemble des demandes, ce qui n'est pas évident tant les besoins sont criants pour les personnels techniques, les scénaristes, les comédiens... Le plan France 2030, doté de 350 millions d'euros pour l'image, cherche précisément à réduire ces goulets d'étranglement.
La combinaison de ce haut niveau de soutien sur longue période et des aides exceptionnelles durant la crise pandémique a permis au cinéma français de rattraper en 2021 toutes les productions de l'année 2020. 340 films, soit 6 par semaine, ont été produits en 2021, en hausse de 30 % par rapport à 2109, pourtant déjà une excellente année, ce qui constitue un record, voire une surchauffe.
Les perspectives pour les prochaines années sont bien entendu complexes, mais le CNC parie sur un tassement de la production, moins en termes de nombre de films produits que de montants investis.
C'est là un signe qui pourrait s'avérer à terme préoccupant s'il marquait autre chose qu'une pause conjoncturelle.
Le cinéma sort donc d'une période de forte crise transformé, en premier lieu par l'évolution de son environnement.
Je vais vous dire un mot de ce contexte, avec le dossier « éternel » de la chronologie des médias. Catherine Morin-Desailly l'avait d'ailleurs traité de manière très approfondie dans un rapport paru en 2017, qui demeure toujours d'actualité.
Pour résumer de manière simple un sujet qui ne l'est pas, le principe de la chronologie est celui de l'ouverture successive de « fenêtres » d'exclusivité : d'abord la salle, puis la vente en vidéo « physique » ou à la demande à l'acte, puis les chaînes de cinéma payantes comme Canal Plus, puis les plateformes, puis les chaînes gratuites.
Elle poursuit deux objectifs :
- d'une part, protéger la salle de cinéma, en lui réservant pendant une certaine durée l'exclusivité de l'oeuvre ;
- d'autre part, assurer le préfinancement des oeuvres cinématographiques en France. Ainsi, la position de chaque diffuseur est garantie, et est d'autant plus favorable qu'il aura contribué au financement du film.
Ce système, unique au monde, a été progressivement introduit en droit français à partir des années 70. Depuis 2009, la chronologie est négociée directement entre les parties prenantes et étendue par arrêté du ministre de la culture.
Pour la dernière négociation, on a assisté à une singularité : les pouvoirs publics ont fait le choix d'y mêler l'entrée en vigueur de la directive européenne « SMA » du 14 novembre 2018, qui permet d'imposer aux plateformes américaines telles que Netflix ou Disney + des obligations de financement d'oeuvres françaises et européennes.
La chronologie qui porte la marque de ces deux dossiers a été signée le 24 janvier 2022, étendue le 4 février et est prévue pour durer trois ans.
Dans l'ensemble, les débats ont été longs, passionnés, chacun veillant à maintenir sa position mais gardant un oeil sur celle des autres. La nouvelle chronologie a considérablement raccourci le délai pour que les oeuvres financées par les plateformes puissent être disponibles après leur exploitation en salles à 15 mois contre 36 auparavant. La place du groupe Canal Plus, premier financeur du cinéma français, a été confortée.
Pourtant, dès le 4 octobre, le CNC a convoqué une réunion pour effectuer un premier bilan, alors qu'il n'était prévu qu'en janvier.
Le principal problème posé est celui de Disney et de ses relations avec les chaînes gratuites.
Pour résumer là encore, Disney n'est pas un opérateur comme les autres. La société américaine réalise un quart des entrées en France, et a toujours placé la salle au coeur de sa stratégie. Ce n'est bien entendu pas le cas de Netflix ou Amazon Prime qui entretiennent des liens plus distendus avec le cinéma.
Disney estime que l'accord lui est défavorable sur un point. En effet, une fois le film Disney, qui par hypothèse n'aura pas reçu de financement en France, exploité en salle, il lui faut attendre 17 mois pour le rendre disponible sur sa plateforme Disney Plus. Au bout de 22 mois, Disney doit cependant retirer le film de Disney Plus afin de préserver l'exploitation des chaînes gratuites comme TF1, sauf en cas d'accord spécifique.
Ce sujet est bloquant pour Disney, qui a pour cette raison renoncé à sortir en salle son film de Noël, mais également pour les chaînes gratuites, dont les présidents se sont exprimés publiquement dans la presse.
Fondamentalement, comme vous le voyez, il s'agit d'un sujet en apparence technique, mais qui en dit long sur la complexité d'adapter notre propre système aux nouvelles conditions de production et d'exploitation. Je compte bien suivre ce sujet de près pour la commission en 2023.
2023, justement, sera-t-elle une année funeste pour le cinéma ?
Comme je vous l'indiquais en introduction, la presse et plusieurs professionnels ont soufflé un vent de pessimisme en octobre, à tel point que je m'attendais en recevant les exploitants de salles à assister à un remake de « Titanic » plus que de « La Gloire de mon père » ! La réalité est cependant bien plus nuancée, et probablement plus optimiste, comme l'ont remarqué Monique de Marco et Sylvie Robert qui ont assisté à cette audition avec moi.
Tout d'abord, quelques faits. Le cinéma a attiré en 2020 et 2021 50 millions de spectateurs de moins que sur la seule année 2019. Selon les chiffres les plus récents, l'année 2022, avec 155 millions de spectateurs, serait 30 % en dessous de 2019. C'est donc un signal que nous ne pouvons ignorer : les spectateurs ne sont pas complètement revenus en salles.
Pourtant, là encore en prenant un peu de distance, on se rend compte que le cinéma a dans le passé enregistré des résultats bien pires, sans pour autant en mourir. Ainsi, la moyenne de fréquentation dans les années 80 était de 135 millions de spectateurs par an, elle est montée à 185 dans les années 2000, et à près de 210 millions dans les années 2010.
Tout en étant incontestablement médiocre, 2022 est cependant bien meilleure que la décennie 80. Les prévisions pour les prochaines années font état d'un retour autour de 195 millions, qui traduirait donc un effritement relatif, mais un haut niveau tout de même. Sans les endosser, je veux ici citer les propos de l'ancien président de Disney, Bob Isner en septembre 2022 lors d'une intervention à la Conférence Code 2022 de Vox Media : « Je ne pense pas que les films reviennent un jour, en termes de fréquentation, au niveau qu'ils avaient avant la pandémie. [...] Cela ne signifie pas que la fréquentation des salles de cinéma va disparaître, mais elle ne reviendra pas au niveau d'avant. »
Ensuite, force est de constater que les fondamentaux du cinéma demeurent solides. Le CNC a réalisé une étude sur les raisons pour lesquelles le public ne retrouvait pas complètement le chemin des salles.
En dehors des sujets liés à la pandémie, deux éléments ont attiré mon attention :
- d'une part, le prix des places, qui est souvent cité. S'il est très élevé, parfois au-delà de 20 euros, dans certaines salles parisiennes, il s'établit en réalité en moyenne à 7 euros, parmi les plus faibles d'Europe. En réalité, il y a une fausse perception du prix, qui vient de l'écart entre ce qui est affiché et ce qui est acquitté après usage des places des comités d'entreprise, des réductions diverses et des cartes d'abonnement. Ainsi, seules 15 % des places sont vendues plus de 10 euros ;
- d'autre part, le manque d'attractivité des films est également mentionné, instruisant le procès facile d'un cinéma français qui n'intéresserait pas le public. Si l'on oublie le côté caricatural de la remarque, elle met cependant l'accent sur un point essentiel : le cinéma français, qui représente en moyenne 35 % des entrées - un cas presque unique au monde -, a besoin du cinéma américain, qui attire le public dans les salles, créant un cercle vertueux. Or, l'année 2022 a été très peu fournie en films américains : alors que la proportion est traditionnellement d'un film américain pour 2,5 films français, le rapport est 1 à 6 en 2022. En un mot, il y a eu moins de films d'outre-Atlantique, où les tournages ont été totalement interrompus en 2020 et 2021 et où de nombreux studios ont choisi de décaler les sorties. Pour autant, le très grand succès de Top Gun « Maverick » (près de 7 millions d'entrée) côtoie les 500 000 entrées « surprise » de « La Nuit du douze » de Dominik Moll ou les 1,5 million de « Novembre » de Cédric Jimenez. Dès lors, et quelle que soit la catégorie, le public revient dans les salles quand l'offre lui convient. On peut donc penser - tel est en tout cas l'avis des exploitants - que les sorties prévues en 2023, apparemment de très haute qualité pour les films français comme américains, pourraient bien permettre au cinéma de retrouver des couleurs.
Je livre d'ailleurs à votre appréciation ce petit fait : le dernier baromètre SVod Mediametrie/Harris interactive montre que les 15-24 ans se détournent déjà massivement des plateformes, au profit des vidéos courtes en ligne popularisées par TikTok, ou bien de YouTube. Cette tendance s'observe dans tous les pays européens comme aux Etats-Unis. Cette catégorie de population est également celle qui comparativement est la plus revenue vers le cinéma après la pandémie. Je crois donc profondément, et ce sera mon mot de conclusion, au caractère unique de l'expérience de la salle, qui a résisté aussi bien à la télévision dans les années 80 qu'aux plateformes. Je crois donc qu'avec notre soutien, le 7ème art pourra traverser cette période et même en sortir renforcé !
Sous le bénéfice de ces observations, je propose de donner un avis favorable à l'adoption de crédits du cinéma pour 2023.

Je relaie les inquiétudes exprimées par beaucoup sur les chiffres de fréquentation alarmants dans les salles de cinéma. Les nouveaux acteurs que sont les plateformes menacent très directement notre exception culturelle. Je me félicite des bons résultats du CNC mais souligne qu'il ne faut pas orienter tous les investissements en faveur de la transition écologique car tous nos efforts doivent être concentrés pour permettre au cinéma de lutter contre les grosses productions américaines.

Le CNC a été secoué par les propos tenus par certains professionnels, qui appellent à des états généraux du cinéma. Il est ici question du type de soutien qu'il apporte aux films via les avances au cinéma d'auteur. Je m'interroge par ailleurs sur les moyens de contraindre les plateformes à respecter leurs obligations de financement et d'exposition vis-à-vis du cinéma.

La crise que nous traversons est complexe à analyser et je remercie le rapporteur d'avoir pris de la hauteur par rapport aux propos inquiétants tenus dans la presse. Je crois profondément au caractère unique de l'expérience cinématographique mais ne peux que m'interroger sur les conséquences des changements de pratique suite à la crise pandémique. Il nous faut bien avoir conscience que les plateformes véhiculent un modèle et une culture anglo-saxonne à laquelle nous ne devons pas nous soumettre.

Le cinéma est confronté aux mêmes défis que les autres secteurs culturels. On est encore incapable d'estimer les changements de pratique liés à la crise du covid. Elle a en effet profondément modifié notre rapport à la salle. Ces dernières essaient actuellement de faire évoluer leur offre et leur cadre, avec des travaux conséquents pour inciter notamment les jeunes à revenir. Les exploitants que nous avons reçus ont également mis en avant cette nécessité de reconquérir les publics. Comme Laure Darcos, je m'interroge sur la contestation par certains du CNC. Les films restent de moins en moins longtemps à l'affiche et il y a des incertitudes autour de la répartition des aides en particulier pour les films dits du « milieu ». Il va donc falloir se poser des questions pour ne pas se laisser enfermer dans un logique trop libérale.

J'étais en effet inquiète avant d'entendre les représentants des exploitants et j'ai été agréablement surprise par leur optimisme. On ne peut qu'être inquiet de la relative désaffection des 24-34 ans et j'espère que la campagne de publicité lancée par le ministère de la culture permettra de les faire revenir en salle. Je m'interroge sur les conséquences de la baisse de la redevance pour la production. A l'opposé, je salue l'inscription d'une enveloppe de 800 000 euros pour la transition écologique des salles même si elle pourrait rapidement s'avérer insuffisante.

Je voudrais interroger le rapporteur sur deux points. D'une part, la place des régions dans le financement est trop souvent négligée. Elles doivent renouveler leurs conventions avec le CNC en 2023 et sont pour beaucoup plongées dans l'incertitude. D'autre part, je ne sais pas où en est le projet de transfert de la gestion des taxes à Bercy. Un dernier point : il est essentiel de faire émerger une plateforme européenne en mesure de porter nos valeurs.

Je m'interroge également sur le sort des petites salles ainsi que des salles d'art et d'essai qui me paraissent menacées.

En ce qui concerne la fréquentation dans les salles, je rappelle que la France a évité la catastrophe qu'ont connue les autres pays avec des baisses de 60 à 65 %. La tranche d'âge des plus de 65 ans a cependant du mal à revenir en salles. Les plus petits cinémas s'en sortent paradoxalement plutôt bien même s'il faut naturellement surveiller l'évolution.
En ce qui concerne le CNC, je rappelle que toute la profession ne sollicite pas l'organisation d'états généraux même si cette demande recouvre des questions essentielles. Je note la stabilité sur le long terme de la répartition entre les crédits dédiés à l'audiovisuel et les crédits dédiés au cinéma, ce qui constitue une bonne nouvelle compte tenu de la place prise par les séries. Je rappelle d'ailleurs que les plateformes ont une obligation de financement minimale de 15 % pour le cinéma. Il y a donc un vrai débat à mener sur le CNC mais le sujet le plus préoccupant est à ce stade la pénurie de scénaristes, de techniciens, d'acteurs pour le cinéma car ils sont aspirés par la production de séries. Le CNC a, en la matière, un rôle éminent à jouer. J'approuve également les initiatives en faveur de la transition écologique des salles et je note les efforts faits par ces dernières pour, par exemple, concentrer les séances. En ce qui concerne les taxes affectées, je rassure Catherine Morin-Desailly : la loi de finances pour 2022 est revenue sur leur transfert à la DGFIP, ce qui est une excellente nouvelle. Enfin, en ce qui concerne les régions, je tiens les chiffres à disposition et je suivrai ce dossier avec beaucoup d'attention.
La commission émet un avis favorable à l'adoption des crédits consacrés au cinéma au sein de la mission « Médias, livre et industries culturelles » du projet de loi de finances pour 2023.

Nous examinons à présent le rapport pour avis de notre collègue Jean-Jacques Lozach sur les crédits consacrés au sport dans le projet de loi de finances pour 2023.

Depuis 2017, j'ai eu à maintes reprises l'occasion de regretter à la fois l'affaiblissement du ministère des sports qui a atteint son paroxysme il y a deux ans avec sa disparition en tant que ministère de plein exercice et l'absence de stratégie cohérente permettant d'associer les différents acteurs du monde du sport de manière harmonieuse et efficace.
Le rétablissement d'un ministère des sports de plein exercice chargé de coordonner la préparation des Jeux olympiques et paralympiques en mai dernier n'a, certes, pas permis d'éviter les désordres du mois de juin au Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions mais il ouvre, je l'espère, l'ère des clarifications nécessaires et de la recherche de plus d'efficacité.
On doit, en effet, reconnaître à la nouvelle ministre des sports sa forte implication pour à la fois définir de manière plus claire le rôle des différents acteurs, préserver les moyens budgétaires dans un contexte économique dégradé (le budget augmente de 20 M€ par rapport à 2022) et mieux coordonner les efforts pour réussir les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.
Car il ne faut pas se méprendre sur l'objectif réel de cette réorganisation. C'est bien l'impératif de réussir l'organisation des Jeux qui a précipité cette prise de conscience que la désorganisation de la politique publique du sport n'était plus tenable.
Depuis plusieurs mois, les interrogations n'ont cessé de grandir sur la capacité du COJOP à boucler son budget et la perspective d'un déficit qui devra être pris en charge par le contribuable est devenue aujourd'hui une possibilité - pour ne pas dire une probabilité - qui vient contredire les déclarations très souvent rassurantes du Gouvernement.
Le coût de la sécurité tant publique que privée de l'événement explose, de même que les prix des biens et services nécessaires aux Jeux. Pour compenser l'inflation, les collectivités territoriales sont dès aujourd'hui sommées d'accroître de 50 M€ le montant de leur contribution pour financer les infrastructures olympiques, j'y reviendrai.
Vous nous avez, monsieur le président, proposé de nous rendre sur le chantier du village des athlètes mercredi 30 novembre. Ce sera l'occasion de faire le point avec le directeur général de la Solidéo.
Comme l'a indiqué la ministre des sports lors de son audition, nous aurons bien une clause de rendez-vous en 2024. Si le Gouvernement s'engage pour réussir le mieux possible l'échéance des Jeux olympiques et paralympiques, les plus grandes incertitudes demeurent sur l'après 2024 et le projet de budget porte la marque de ces hésitations.
Je rappelle que le projet de loi de programmation des finances publiques acte la baisse des moyens consacrés au sport pour 2024 et 2025.
Pour en revenir au budget qui nous est soumis aujourd'hui, je vous propose d'examiner brièvement ses forces et ses faiblesses.
Quelles sont tout d'abord les avancées que nous pouvons saluer dans ce budget ?
Outre une augmentation de 2,6 % des crédits, je citerai d'abord la reconduction de plusieurs dispositifs qui ont permis d'amortir le choc qu'a représenté la crise sanitaire pour le secteur du sport.
Le Pass' Sport bénéficiera à nouveau de 100 M€ de crédits. L'élargissement de la liste de ses bénéficiaires aux étudiants boursiers doit être salué comme l'expérimentation engagée pour inclure les salles de sport privées dans l'offre, même si nous aurions pu sans doute nous passer de cette étape pour inclure, dès 2023, toutes les structures sportives dans le dispositif. Le prétexte de l'expérimentation ne doit pas servir d'excuse au rationnement budgétaire.
La poursuite du plan d'équipements sportifs de proximité doté de 200 M€ constitue également une caractéristique importante de ce budget. La première enveloppe de 100 M€ a déjà permis de financer plus de 2 000 équipements en 2022 sur les 5 000 équipements prévus. 50 M€ supplémentaires viendront compléter cet effort en 2023 et autant en 2024.
La hausse des moyens de l'AFLD doit être saluée même si le surcroît de +0,8 M€ est moindre que les 1,8 M€ demandés. Je regrette que la ministre ne nous ait pas répondu sur le plan d'équipement du nouveau laboratoire antidopage de l'université de Saclay. Nous resterons vigilants à ce sujet. Peut-être qu'un déplacement à Saclay dans le cadre de la mission sur les Jeux olympiques et paralympiques pourrait nous permettre d'y voir plus clair ?
Concernant la préparation des Jeux olympiques et paralympiques toujours, comme je le disais en introduction, le financement des infrastructures olympiques nécessitera un effort supplémentaire de 100 M€ de la part de l'État et de 50 M€ de la part des collectivités territoriales. J'ai insisté auprès de la ministre pour que cet effort ne pénalise pas les collectivités les plus fragiles, notamment en Seine-Saint-Denis.
Concernant toujours les Jeux olympiques et paralympiques il y a toutes les raisons de saluer la mise en place d'une « billetterie populaire » dotée de 11 M€ en 2023 et 2024 afin de démocratiser l'accès aux stades et de valoriser les bénévoles.
L'Agence nationale du sport verra quant à elle ses moyens budgétaires augmenter de 19 M€ afin, en particulier, de poursuivre la préparation des athlètes olympiques et paralympiques.
Je salue, à cette occasion, la signature prochaine d'une convention entre l'ANS et l'INSEP qui devrait permettre de clarifier le rôle de ces deux institutions dans un esprit de coopération affirmé. Les rôles respectifs des maisons régionales de la performance (MRP) opérées par l'ANS et du « réseau grand Insep » ont également été clarifiés, ce qui était nécessaire.
L'INSEP bénéficiera pour sa part de 5 ETP supplémentaires, ce qui permettra de rétablir ses moyens humains après la baisse de l'année dernière tandis que sa dotation augmente légèrement à 23,43 M€.
Le maintien des 1 442 effectifs de CTS en 2023 constitue une autre satisfaction, de même que l'abandon de la réforme de leur statut. La redéfinition de leurs missions permet de pérenniser ces personnels indispensables aux fédérations. La mise en place de l'École des cadres dotée de 0,5 M€ permettra de mieux les former et de les accompagner tout au long de leur carrière.
Je terminerai cette liste des aspects positifs en évoquant l'augmentation des moyens, notamment humains, consacrés à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et contre la radicalisation qui constitue une priorité. 20 postes sont créés dans les Drajes.
Après avoir regardé le verre à moitié plein, il est maintenant temps de le regarder à moitié vide. Et les déceptions sont au moins aussi nombreuses que les satisfactions.
Sans revenir sur le fait que la trajectoire financière des moyens consacrés au sport devrait baisser dès 2024, il y a tout lieu de s'inquiéter de l'insuffisante prise en compte de l'inflation dans ce budget. La ministre se félicite d'une hausse de 2,6 % des crédits mais, avec une inflation qui devrait dépasser les 4,3 %, la baisse en termes réels est bien là.
Lorsque j'ai interrogé le cabinet sur une nouvelle dégradation du contexte économique, la seule réponse a été de dire que des crédits pourraient au besoin être prélevés en gestion sur des dispositifs comme le Pass' Sport ce qui réduit, bien évidemment, considérablement la portée de ce budget. Par ailleurs, je ne partage pas l'analyse selon laquelle les dotations faites aux différents acteurs (INSEP, AFLD...) compenseraient la hausse attendue de l'inflation... sauf à les obliger à arrêter leurs investissements ou à contraindre leur développement.
Concernant les équipements sportifs de proximité, l'ANDES a indiqué que le plan mis en oeuvre en 2022 n'avait pas été exempt d'effets d'aubaine s'agissant d'équipements répondant aux nouvelles pratiques qui étaient déjà souvent prévus dans nombre de collectivités. Or, l'accent mis sur ces nouveaux équipements a aussi eu pour effet de délaisser les équipements locaux structurants qui sont très souvent dans un état souvent vétuste.
On peut également regretter, je l'ai déjà dit, le fait que l'extension du Pass' Sport aux salles de sport privées soit aussi laborieux.
Je note également qu'aucun progrès n'est fait concernant le sport sur ordonnance en dépit de la poursuite du développement des maisons sport santé.
Deux autres regrets plus substantiels m'obligent à porter un regard partagé sur ce budget :
- Tout d'abord, les crédits du plan de relance qui bénéficiaient au sport ne sont pas reconduits, à l'exception d'une enveloppe pour l'ANS concernant l'emploi.
On ne peut que s'étonner, par exemple, que les crédits consacrés à la rénovation thermique des équipements sportifs ne soient pas pérennisés vu le contexte de crise que nous connaissons. La ministre nous a indiqué que le « fonds vert » pourrait être mobilisé mais nous ne savons pas à quel niveau et selon quelles modalités et quels délais. Les crédits du plan de relance relatifs à la modernisation numérique des fédérations ne sont pas non plus prolongés sans qu'un véritable bilan ait été présenté au Parlement.
- Le second regret majeur concerne, une fois de plus, le mauvais usage qui est fait du produit des trois taxes portant sur le sport (les droits audiovisuels, les paris sportifs et les jeux de la FDJ). En 2023, le produit de ces 3 taxes devrait atteindre 487 M€ mais seuls 166 M€ devraient bénéficier au sport et plus particulièrement à l'ANS.
Plus étrange encore, le plafond de la « taxe Buffet » a été abaissé de 14,4 M€ pour tenir compte de la baisse du rendement induite par la faillite de Mediapro mais, au lieu de compenser cette baisse du plafond de la « taxe Buffet » par la hausse du plafond de la taxe sur les paris en ligne par exemple, le Gouvernement a préféré recourir à une dotation budgétaire de 14,4 M€ pour compenser à l'euro près.
Ce choix m'apparaît contraire au principe selon lequel « le sport doit financer le sport ». Si nous voulons vraiment clarifier le financement du sport, il me semble indispensable que la ministre des sports ouvre la réflexion sur l'attribution de la totalité du produit de ces taxes au sport.
Je terminerai cette liste des regrets en évoquant le manque d'originalité de ce budget qui ne comprend guère de mesures innovantes pour permettre au sport de jouer un rôle plus important dans l'accompagnement des jeunes en difficulté par exemple. Le sport demeure un outil précieux pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes comme le montrent les bons résultats obtenus par les coachs d'insertion professionnelle dans les QPV. Un coup de pouce à ces professionnels aurait été le bienvenu, notamment pour prévenir les conséquences de la récession qui pourrait faire des dégâts parmi les publics les plus fragiles de la politique de la ville.
En conclusion, vous aurez compris, mes chers collègues, qu'il y a tout lieu d'être partagé sur ce projet de budget.
Je ne doute pas de l'implication de la ministre qui reconstruit une politique publique du sport qui avait été mise à mal au cours du précédent quinquennat. Les principaux programmes sont financés à court terme. Mais il existe trop d'incertitudes concernant les conséquences de la dégradation de la situation économique avec une crise énergétique qui touche durement les installations sportives.
Par ailleurs, l'horizon est d'ores et déjà frappé par la perspective d'une baisse des crédits qui ne correspond pas à l'ambition de faire de la France une nation sportive.
Compte tenu de l'ensemble de ces observations, je propose à la commission d'émettre un avis de sagesse sur l'adoption des crédits des programmes 219 et 350 de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » du projet de loi de finances pour 2023 en espérant que le débat en séance publique sera l'occasion pour le Gouvernement de revenir sur la baisse du plafond des taxes affectées.

Nous partageons la vision du rapporteur et notamment les points positifs qu'il a relevés concernant la stabilisation du nombre de CTS, les 5 ETP en plus à l'INSEP et les 20 emplois supplémentaires consacrés à la lutte contre les violences et la radicalisation. Nous saluons également l'élargissement des territoires éligibles aux plans d'équipements sportifs.
Par contre, le budget ne nous semble pas à la hauteur des ambitions d'un pays qui accueillera prochainement la coupe du monde de rugby et les jeux olympiques et paralympiques.
Le sport vit des moments difficiles comme l'ont montré les événements au Stade France. Les tensions importantes qui traversent le CNOSF ne sont pas rassurantes. Il existe des inquiétudes concernant la situation de plusieurs fédérations. Dans ces conditions le rétablissement d'un ministère de plein exercice ne suffit pas à constituer une politique du sport. On parle beaucoup d'héritage mais où sont les équipements structurants et pourquoi les crédits relatifs à la rénovation thermique n'ont pas été prolongés ? Le ministre de l'éducation nationale a reconnu les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du plan « savoir nager » compte tenu de la vétusté de nombreuses piscines. Il y a besoin d'un plan d'investissement pluri-annuel. Dans ces conditions, la perspective d'une baisse des moyens pour 2024-2025 nous inquiète. La volonté du Président de la République de faire du sport une grande cause nationale en 2024 ne s'appuie pas sur un budget à la hauteur. Dans ces conditions nous nous abstiendrons sur le vote de ces crédits.

Nous saluons le retour d'un ministère de plein exercice mais nous attendons la poursuite de l'effort financier après 2024 alors que la programmation budgétaire prévoit une baisse des crédits de 20 %. Il faut une situation budgétaire stable pour développer une politique du sport dans la durée.
L'ANS voit ses moyens augmenter de 19 millions d'euros mais le volet territorial reste inachevé. On constate la baisse du rendement de la taxe Buffet et l'absence d'un véritable engagement de l'Etat pour développer les équipements locaux structurants même si une nouvelle enveloppe de 100 millions d'euros est prévue pour les équipements répondant aux nouvelles pratiques. De nombreux clubs continuent à souffrir et le sport pour tous n'apparait pas prioritaire.
Le groupe de l'Union centriste soutiendra l'avis de sagesse proposé par le rapporteur.

Nous saluons l'analyse du rapporteur concernant en particulier les inquiétudes après 2024 compte tenu de la baisse annoncée des crédits. Le produit des trois taxes affectées reste insuffisamment attribué au sport. Alors que ce montant a augmenté depuis 2017, la part relative qui profite au sport a baissé de moitié. Nous pensons que l'élargissement de l'éligibilité au Pass'Sport aurait pu être plus important ou que son montant aurait pu être augmenté. Nous regrettons que l'enveloppe réservée à la transition numérique des fédérations n'existe plus. Nous sommes en phase avec l'avis de sagesse proposé par le rapporteur.

Le budget nous semble sous-dimensionné pour répondre à la situation préoccupante des jeunes dans le contexte marqué par la crise sanitaire des deux dernières années. Les moyens consacrés au sport pour tous augmentent très peu et la baisse du plafond de la taxe Buffet constitue un mauvais signal. Le groupe CRCE votera contre l'adoption de ces crédits.

La ministre des sports a pris ses fonctions dans un contexte compliqué marqué par les événements du Stade de France. On peut saluer une forme de reprise en main mais regretter la place trop importante accordée aux jeux olympiques et paralympiques (JOP) dans ce budget. Le budget des JOP ne sera pas tenu et l'organisation de cet événement risque de sacrifier la saison culturelle de 2024. On constate certes une montée en puissance du Pass'Sport mais il n'y a aucune priorité donnée à l'adaptation des infrastructures sportives au dérèglement climatique. Nous soutiendrons donc l'avis de sagesse proposé par le rapporteur.

Je partage certaines remarques du rapporteur concernant en particulier les modalités d'affectation des trois taxes à l'ANS mais je constate aussi que ce budget comprend des avancées et que les moyens sont bien là. On ne peut refuser le budget de 2023 au motif que les crédits pourraient baisser en 2024. Les problèmes que rencontre le sport ne sont pas principalement d'ordre budgétaire mais relèvent plutôt de l'organisation des fédérations et du CNOSF.

Je salue le rapport même si j'ai l'impression que le constat penche plutôt du côté négatif. On se félicite du retour d'un ministère des sports de plein exercice mais il s'agit d'abord d'un ministère des jeux olympiques. Je souhaiterais que le rapporteur explicite son avis de sagesse.

Le budget est en hausse mais il y a des interrogations sur les jeux olympiques et sur les moyens qui seront consacrés au sport après 2024. J'ai trois questions qui portent sur la situation difficile des bénévoles employeurs, sur la continuité des activités sportives entre l'école et l'extra-scolaire et sur les raisons qui conduisent le rapporteur à proposer un avis de sagesse.

Je suis perplexe car si le budget est bien en hausse, on ne perçoit pas la mobilisation du pays dans le cadre de la préparation des jeux olympiques et paralympiques. La ministre des sports a démontré une connaissance technique irréprochable mais on ne perçoit pas de souffle politique dans ses propos. Son collègue le ministre de l'intérieur est mobilisé puisqu'il annonce l'absence d'évènements culturels pendant les JOP et on aurait aimé que la ministre des sports soit également mobilisée pour faire des jeux un événement fédérateur du pays.
J'exprime enfin une certaine colère suite à l'organisation des championnats du monde de pelote basque qui ont réuni 37 nations et 600 athlètes à Biarritz et dans sa région sans qu'aucun ministre ne soit présent alors même que de nombreuses personnalités étrangères s'étaient déplacées dont des ministres et des responsables d'exécutifs locaux.

Concernant l'état du mouvement sportif, les données disponibles montrent que le nombre de licenciés après avoir baissé de 7 % en 2020 et 15 % en 2021 a retrouvé en 2022 le niveau de 2019. Le soutien de l'Etat au secteur du sport s'est élevé à 8,8 milliards d'euros lorsque l'on additionne les dispositifs de droit commun et les dispositifs spécifiques.
Ma déception porte plus sur la trajectoire budgétaire à moyen terme que sur les moyens prévus pour 2023. La France va organiser le plus grand événement public qui existe au monde. C'est un événement qu'on accueille une fois par siècle. Or il n'y a pas eu de véritable augmentation des moyens depuis 2016. On est toujours à 0,2 % du budget consacré au sport. C'est une contradiction évidente de vouloir faire du sport la grande cause de 2024 sans s'en donner les moyens.
Concernant les équipements, nous demandons depuis plusieurs années l'élaboration d'un « Plan Marshall » en faveur des stades, des gymnases et des piscines.
Le conseil d'administration du COJOP du 12 décembre devrait clarifier les enjeux budgétaires mais il faut rappeler qu'il y a toujours eu des dépassements par rapport aux budgets prévisionnels. Le budget des jeux de Pékin en 2008 est passé de 2,6 milliards d'euros à 32 milliards d'euros tandis que celui des jeux de Tokyo est passé de 2,3 milliards d'euros à 13 milliards d'euros. Les jeux de Paris ont déjà connu une augmentation de 6,8 milliards à 8 milliards d'euros.
Concernant les trois taxes affectées, la situation se dégrade d'une année sur l'autre. Alors que le CNDS bénéficiait des deux tiers du produit des trois taxes, seul un tiers finance aujourd'hui l'ANS.
A propos du programme « Terres de jeux », même si l'idée était bonne au départ, je crains des désillusions, car il s'agit aujourd'hui d'opérations de communication qui ne bénéficient pas d'investissements. Les 2 800 dossiers acceptés doivent se partager une enveloppe de 20 millions d'euros.
Concernant les polémiques qui frappent les différentes institutions du secteur sportif, les situations sont variables. Il y a des défaillances individuelles, des enjeux de pouvoir forts ainsi que des modes de fonctionnement désuets.
Pour revenir sur la continuité éducative, c'est la grande faiblesse du continuum entre l'école et le sport. A cet égard, le projet de 2 heures de sport supplémentaires au collège repose sur le volontariat et devrait avoir des difficultés à se mettre en place.
Le sport-santé ne pourra pour sa part pas se développer tant que ne sera pas réglé la question du sport sur ordonnance.

Je retiens le message d'alerte envoyé au ministère des sports sur les JOP et sur la trajectoire après 2024. Le rapporteur propose de s'en remettre à la sagesse du Sénat. Je vais mettre au vote la proposition du rapporteur.
La commission émet un avis de sagesse sur l'adoption des crédits consacrés au sport au sein de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » du projet de loi de finances pour 2023.

Nous examinons ce matin le rapport pour avis de notre collègue Julien Bargeton sur le projet de loi de finances pour 2023.

Comme nous le pressentions l'année dernière, les industries culturelles ont fait montre d'une très belle résistance durant la crise, soutenue il est vrai massivement par les pouvoirs publics. Fort logiquement, avec le retour à une vie plus normale, elles ont progressé en 2022 de près de 10 % en chiffre d'affaires, pour s'établir à 18,2 milliards d'euros. La tendance pour le futur demeure très prometteuse.
Je vais vous présenter successivement les quatre grandes familles de ce programme : le livre et la lecture, la Bibliothèque nationale de France, la musique et les jeux vidéo.
Premier point, le secteur du livre et de la lecture.
La crise pandémique a été, vous vous en rappelez, l'occasion de marquer l'attachement des français au livre et aux libraires qui les font vivre. L'année 2021 s'était logiquement avérée spectaculaire, l'année 2022 devrait enregistrer un léger tassement des ventes de l'ordre de 5 %. Ce qu'il faut retenir cependant, c'est que 2022 devrait être bien meilleur que 2019, avec une progression des ventes de l'ordre de 15 %. Il n'est donc pas interdit de dire que la crise a renforcé le secteur. A ce propos, je note avec une grande satisfaction le succès du Pass Culture dans le domaine du livre. Il a permis aux libraires d'augmenter leur chiffre d'affaire de près de 100 millions d'euros, et pas uniquement pour acquérir des mangas, même si ce genre reste dominant avec 51 % des ventes - en baisse cependant de 24 points en 2021, signe peut-être que les lecteurs élargissent leur horizon... Par ailleurs, 60 % des jeunes achetant un manga avec le Pass repartent avec un autre livre.
En dépit de ce constat très positif, tout n'est pourtant pas rose dans le monde des livres.
D'une part, au niveau conjoncturel, j'ai interrogé la ministre sur l'impact de la hausse des prix du papier, dont notre collège collègue Michel Laugier a relevé l'acuité pour la presse la semaine dernière. La ministre a indiqué s'être saisie de la question avec le CNL, j'espère donc que nous pourrons disposer d'éléments prochainement.
L'inflation ne se limite cependant pas au papier, elle implique aussi des hausses de rémunération. Or je rappelle que les libraires ne dégagent que de très faibles marges, de l'ordre de 2 %, qui peuvent être littéralement « dévorées » par la hausse des salaires.
Comme vous le voyez donc, la conjoncture pourrait rapidement dégrader la situation.
D'autre part, un dossier plus structurel pose problème, celui des relations entre les auteurs et les éditeurs.
Nous le savons, il s'agit d'une relation complexe, souvent passionnelle, en tout cas qui porte en elle de fortes oppositions.
C'est également un dossier à rebondissements.
Pour tracer un portrait à grands traits, des négociations se tiennent de manière continue depuis 2013, pour régler des questions en apparence techniques, comme par exemple la périodicité et la nature des informations que doit apporter l'éditeur à l'auteur. Le Sénat a pris ses responsabilités, avec la proposition de loi de Laure Darcos sur l'économie du livre qui a gravé dans le marbre de la loi les dispositions de l'accord signé entre les organisations représentatives du 29 juin 2017.
Pourtant, les relations se sont dernièrement tendues, autour d'un sujet si j'ose dire crucial, celui de la rémunération, à tel point qu'il est devenu « bloquant » dans les relations entre les partis. Les auteurs souhaitent obtenir des conditions plus favorables, dans la lignée des propositions du rapport de Bruno racine en 2020, les éditeurs ne souhaitent pas ouvrir ce chantier qui leur parait mettre en péril l'exercice même de leur métier. Très récemment, un accord pourtant technique n'a pas pu être signé comme prévu le 24 octobre. C'est là le principal défi du secteur dans les années à venir.
Deuxième point, la Bibliothèque nationale de France.
La BnF représente à elle seule 70 % des crédits du programme. Sa dotation évolue de 3,9 % en 2023, conformément aux engagements pris.
Nous nous réjouissons du très grand succès populaire de sa réouverture le 17 septembre, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Je peux vous dire que les équipes de l'établissement, très mobilisées autour de ces travaux, apprécient à sa juste mesure les files d'attente pour accéder à la splendide salle de lecture et la satisfaction des nouveaux usagers.
La BnF est pourtant face à une année 2023 difficile. Les trois quart de son budget sont consacrés au fonctionnement. Le site de Tolbiac possède 500 000 m² de surface vitrée, ce qui nécessite chauffage en hiver et climatisation en été, pour l'accueil des usagers, mais également pour assurer la conservation des documents précieux. Pour vous donner un ordre d'idée, la BnF consomme la même quantité d'électricité qu'une ville de 20 000 habitants.
Selon les premières estimations, le surcoût lié à la hausse des prix de l'énergie serait de 3,6 millions d'euros en 2023, ce qui est beaucoup pour un budget très contraint, et frappera inévitablement les initiatives qui pouvaient être envisagées.
Il reste à espérer que cette crise n'aura pas de conséquence sur le chantier du nouveau centre de stockage. Plus de 70 villes avaient déposé leur candidature, c'est finalement Amiens qui a été retenu. Le projet s'élève à l'heure actuelle à 96 millions d'euros, dont 40 à la charge des collectivités. A terme, il accueillera le Conservatoire national de la presse, auquel je suis très attaché.
Comme vous le voyez donc, entre grands projets, gestion du quotidien et flambée des prix, la BnF va devoir faire face à des défis d'ampleur en 2023, comme hélas de nombreux établissements publics.
Troisième point, la musique enregistrée
Après avoir été à deux doigts de disparaitre au tournant des années 2000, la musique a retrouvé une nouvelle vigueur, que l'on peut résumer en un mot, avec ses promesses, mais également ses failles : le streaming.
Ce mode d'écoute a été popularisé par Spotify à l'origine. Clin d'oeil de la « pop culture », une série suédoise sur Netflix intitulée « The Playlist » retrace avec beaucoup d'intelligence le lancement de cette plateforme. 10 millions de Français sont actuellement abonnés à un service de streaming, et la moitié des 35-64 ans disposent d'un accès payant.
Les perspectives au niveau mondial sont florissantes. Une étude de la banque Goldman Sachs rendue publique le 13 juin dernier estime que les revenus au niveau mondial devraient plus que doubler d'ici 2030, passant de 23 à 56 milliards de dollars, avec une proportion croissante financée par la publicité.
Nous ne pouvons bien entendu que nous en réjouir. Pour autant, de redoutables questions ont émergé : quelle rémunération pour les auteurs, les interprètes, les compositeurs ? Quel modèle économique pour ces plateformes qui, pour l'heure, perdent encore de l'argent ? Quelle exposition des esthétiques les plus fragiles ?
Sur ces sujets cruciaux pour toute la filière, un acteur a émergé en France, je veux bien entendu parler du Centre national de la musique (CNM), à l'origine issu d'une initiative parlementaire, avec une loi adoptée à l'unanimité des deux chambres - je salue au passage le rapporteur Jean-Raymond Hugonet qui s'est beaucoup investi sur le sujet et continue de le suivre.
Nous avons organisé une table ronde passionnante sur le CNM le 19 octobre dernier. Comme vous le savez, la question de ses moyens se pose depuis la fin d'une crise pandémique qui lui a offert une formidable légitimité par la qualité de ses interventions. Cependant, comme je vous le disais l'année dernière, cet accueil enthousiaste repose sur un malentendu : le CNM n'a pas vocation à distribuer des subventions ad vitam, il n'a pas été conçu en ce sens. Il est donc nécessaire de nous interroger, et d'interroger la profession, sur ses attentes, sur ses besoins, et d'en inférer la surface budgétaire que le Centre doit atteindre pour ne pas trahir les espoirs placés en lui à l'origine. Pour mener ce travail, comme vous le savez, j'ai été chargé d'une mission par la ministre de la culture, que j'aborde avec beaucoup d'humilité, mais également d'enthousiasme et de conviction.
Je compte bien entendu m'appuyer sur les travaux de notre commission, et je souhaite pouvoir vous présenter mes conclusions dans quelques mois.
Quatrième point, le jeu vidéo.
Là encore, notre commission a été en pointe, avec une table ronde organisée le 12 octobre dernier.
Je peux vous dire que le secteur a été sensible à cette marque de reconnaissance de notre part.
Le jeu vidéo affiche une santé presque insolente, inoxydable. L'année 2020 avait bien entendu été exceptionnelle avec la pandémie, on pouvait donc légitimement s'attendre à une baisse en 2021. Il n'en a rien été, le secteur a encore connu une progression de 1,6 %, pour s'établir à 5,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le résultat aurait pu être encore meilleur si les consoles de nouvelles génération Xbox Serie et PS5 avaient été plus largement disponibles, mais la production a été freinée par les pénuries de composants.
Nous n'allons pas rouvrir le débat d'une culture « noble » contre une culture moins légitime, incarnée hier par la bande dessiné et la télévision, aujourd'hui par le jeu vidéo.
Notons cependant qu'il existe une très grand diversité de pratiques et donc de jeu : les petites distractions que nous pouvons pianoter sur nos téléphones dans les transports ou bien les énormes productions à plusieurs centaines de millions de dollars sur consoles et ordinateurs. Au passage, le Palais du Luxembourg a lui-même été intégralement numérisé pour les besoins d'un jeu sorti en 2014, Assassin's Creed Unity, dont vous pouvez trouver des extraits assez saisissants en ligne.
Ce qui est important cependant pour nous, comme l'a bien souligné la table ronde, c'est de conforter la place déjà mondialement reconnue de la France dans ce secteur d'avenir, qui embauche massivement des personnels qualifiés et passionnés, présent dans tous les territoires. Notre position enviable repose sur la combinaison réussie d'un système de formation adapté, avec des écoles réputées, et l'existence d'un crédit d'impôt qui nous permet de lutter à armes égales avec les autres pays, notamment anglo-saxon. Nous avons su, pour les jeux, développer et préserver une excellence française dont je souhaite qu'elle perdure.
Je dois enfin dire un mot de l'ambition portée par « France 2030 ».
Lors de la présentation de ce plan le 12 octobre 2021, le Chef de l'Etat a choisi de consacrer un objectif spécifique aux Industries culturelles et créatives, pour un montant estimé à près d'un milliard d'euros. La démarche est très proche de celle des différents PIA.
Pour l'heure, le projet le plus emblématique est celui de « Fabrique de l'Image » pour 350 millions d'euros, qui a pour objectif de mettre un terme aux « goulets d'étranglement » de la production cinématographique et audiovisuelle.
Je crois que nous pouvons nous féliciter de l'ampleur des moyens comme de la reconnaissance des industries culturelles et créatives au plus haut niveau de l'Etat.
Il est cependant essentiel que les parlementaires que nous sommes gardions un oeil sur le déroulé de programmes et sur leur impact réel.
Mes chers collègues, comme vous l'avez compris, nous pouvons porter un regard optimiste sur les industries culturelles, même si la vigilance demeure de mise, je pense notamment à la question des auteurs, à la BnF et aux perspectives du CNM.
Sous le bénéfice de ces observations, je vous propose de donner un avis favorable à l'adoption des crédits du programme « Livre et industries culturelles » pour 2023.

Je déplore l'insuffisante prise en compte de l'inflation et des conséquences de la crise énergétique. Nous avons su faire face durant la crise pandémique mais la réponse ne me parait cette fois-ci pas au niveau. Ainsi, la BnF est dans une situation complexe, plus encore que l'année précédente, qui se traduit déjà par des mouvements sociaux et les plaintes des usagers. Sur la musique, nous devrions avoir un vrai débat sur le financement du CNM qui pourrait passer par une taxe sur les plateformes ou sur la publicité. Suite à la table ronde sur les jeux vidéos, je regrette le manque d'évaluation du crédit d'impôt. Il me semble qu'il pourrait être soumis à des critères comme le respect des conditions de travail ou bien l'éthique des jeux eux-mêmes. A la lumière de ces éléments, le groupe CRCE ne votera pas ces crédits.

La situation entre les auteurs et les éditeurs est effectivement très tendue et me préoccupe beaucoup. Le point de départ de la situation actuelle est le rapport de Bruno Racine remis en 2021 et la volonté de la précédente ministre de la culture de trouver une solution aux statuts des auteurs en nommant un médiateur. Or le dialogue est aujourd'hui dans une impasse, notamment sur la question des rémunérations. Le contrat qui lie auteurs et éditeurs est de nature privé. Il nous est donc difficile d'intervenir. Je sais que le ministère est de son côté très conscient de la difficulté mais manque pour l'instant d'idées pour en sortir. Je tiens par ailleurs à faire état de ma déception sur l'application de la loi relative à l'économie du livre. L'arrêté pris pour la fixation des frais de port par le gouvernement, sur proposition de l'Arcep, constitue à mes yeux un ralliement au modèle d'Amazon et une forme de trahison.
Enfin, sur la taxe streaming, je crois que nous ne sommes pas encore prêts. Il nous faudra par contre surveiller les débats au Sénat pour la préservation des crédits d'impôt. Pour toutes ces raisons, le groupe LR suivra l'avis du rapporteur.

Le livre continue de bien se porter, malgré un léger repli des ventes après une année 2021 exceptionnelle en librairie. L'industrie du livre fait plus que résister : le niveau des ventes reste sensiblement supérieur à celui de 2019. L'actualité du secteur est marquée par la mise en oeuvre de la loi du 30 décembre 2021 visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs.
Du côté de l'industrie phonographique, c'est également une bonne nouvelle, avec une cinquième année d'affilée de croissance en 2021 avec une progression de 14,3 %. À l'inverse, le spectacle vivant ne s'est pas totalement remis du choc qu'a représenté la pandémie.
Dans ce contexte, on peut saluer au moins une mesure nouvelle en crédits budgétaires qu'est le lancement du portail national de l'édition accessible.
Le Centre national du livre semble doté des moyens financiers et juridiques d'accomplir ses missions : il est doté d'un nouveau contrat d'objectifs et de performance pour la période 2022-2026 qui a pour objectif de rééquilibrer les missions du centre, centrées jusqu'à présent sur le soutien économique à la filière, en ajoutant l'objectif de développement du soutien à la lecture. Un point a été soulevé par la Cour des comptes : il pourrait être judicieux que le CNL accompagne la mise en place d'un outil permettant une remontée des ventes réelles de livres.
La situation de la Bibliothèque national de France est à surveiller car l'établissement doit faire face à de nouvelles missions à plafonds d'emploi constant, comme la réouverture du site Richelieu, la création du musée et le développement du dépôt légal numérique. L'impasse budgétaire liée à l'inflation va conduire la BnF à repousser des investissements importants. L'établissement a été conduit à diminuer drastiquement ses dépenses d'investissement et ce freinage se poursuivra en 2023.
Nous espérons que les principaux investissements ne seront pas trop ralentis (création du centre de conservation d'Amiens, sécurisation de l'esplanade du site de Tolbiac et renouvellement du système SSI de Tolbiac).
Pour voir un peu plus loin, le Centre national de la musique continue de soulever de vives interrogations. L'accompagnement de la filière musicale par cette institution impose une réflexion approfondie quant à ses missions et aux financements supplémentaires éventuellement nécessaires pour que le CNM puisse les remplir. Le CNM a soutenu efficacement la filière durant la crise sanitaire. Mais les ressources qui lui seront allouées seront-elles suffisantes en 2023 ? Elles sont inférieures à ce qui avait été envisagé au moment de la création de l'établissement. Nous attendons le résultat de la mission de notre collègue Julien Bargeton pour pérenniser son financement.
Pour ce qui concerne le secteur du jeu vidéo, le fonds d'aide aux jeux vidéo (FAJV) joue un rôle clef pour le soutien à l'écriture, la préproduction et la production des entreprises de création. Politiquement et économiquement, il est nécessaire que le Gouvernement réaffirme son soutien à la filière.
Compte tenu de ces éléments, le groupe de l'Union centriste se ralliera à l'avis favorable proposé par le rapporteur.

J'abonde dans le sens des fortes inquiétudes relayées par mes collègues sur les conséquences pour les établissements culturels de la crise énergétique et de l'inflation, qui pèsent massivement sur les coûts de fonctionnement. Je suis également inquiète sur le CNM dont le président nous a indiqué manquer de 20 M€ pour cette année. Peut-être cela appelle-t-il à une première réponse rapide. Je me félicite cependant des crédits de 1 M€ pour l'acheminement des livres en outre-mer.

Je trouve les propos du rapporteur extrêmement optimistes. Pour ma part, je remarque le léger tassement des ventes de livres ainsi que la baisse de fréquentation des bibliothèques. La situation de la BnF doit également recueillir toute notre attention. En tout état de cause, notre groupe ne votera pas les crédits alloués au Livre et aux industries culturelles.

Sur la musique enregistrée, le rapport que j'avais présenté devant vous prévoyait déjà les difficultés d'aujourd'hui. Il y a un déséquilibre au sein du CNM entre spectacle vivant et musique enregistrée. L'écosystème de la musique est fragile et je souhaite que les auteurs-compositeurs qui sont au centre de la création ne soient pas oubliés. En un mot, il faut moins d'administration et plus de stratégie politique.

Je partage pleinement les propos de Laure Darcos sur la loi du 30 décembre 2021. J'estime que l'arrêté du gouvernement sur les montants de frais de port viole ouvertement l'esprit de la loi et je regrette que nous manquions de moyens pour le contester.

Les préoccupations sur l'inflation ont été entendues au moins partiellement. Elles sont communes à beaucoup de secteurs de l'économie. La BnF, par exemple, voit ses crédits progresser de 8 M€ en 2023, ce qui n'est malgré tout, pas négligeable. Je suis cependant bien conscient que ce sujet doit faire l'objet de toute notre attention. Comme Laure Darcos, je regrette l'absence d'accord entre auteurs et éditeurs. Sur la question des frais de port, nous parlons bien de l'esprit de la loi, le texte étant respecté. Cela dit, nous pourrons peut-être aller plus loin une fois le dispositif établi. Sur le CNM je crois nécessaire de s'intéresser tout d'abord aux besoins de la filière et à la stratégie à mettre en oeuvre avant d'aborder la question des moyens. Sur ce sujet, il est prématuré de se prononcer ou de fermer des portes. Enfin, je regrette également la baisse de fréquentation des bibliothèques ; elle me parait devoir être mise en parallèle avec le cinéma et le théâtre. Il est nécessaire pour l'ensemble des secteurs culturels de redonner le goût de fréquenter ces lieux à nos concitoyens.
La commission émet un avis favorable à l'adoption des crédits consacrés au Livre et aux industries culturelles au sein de la mission « Médias, livre et industries culturelles » du projet de loi de finances pour 2023.
La réunion est close à 11 h 30.