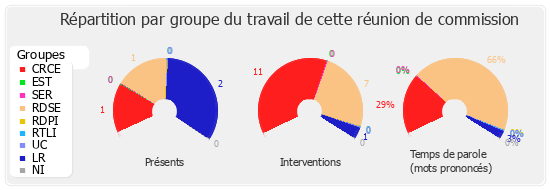Mission commune d'information Inondations dans le Var
Réunion du 10 juillet 2012 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion

Nous auditionnons M. Jean-Pierre Bayle, Président de la 4ème chambre de la Cour des Comptes, accompagné de MM. Cyrille Schott et Jean-Michel Sansoucy, dont le rapport relatif aux enseignements des inondations de 2010 sur le littoral atlantique et dans le Var a récemment été rendu public.
A la suite des crues dramatiques de 2010, où l'action publique a fait l'objet de mises en cause quant à sa capacité à prévenir et à gérer ce type de catastrophes, la Cour des Comptes et les chambres régionales concernées ont mené en 2011 une série de contrôles, en se penchant notamment sur les systèmes d'alerte et de secours, l'application des règles en matière d'urbanisme et l'efficacité des dispositifs d'indemnisation, autant de thèmes qui intéressent en premier chef notre mission commune d'information.
Notre mission a en effet, depuis le mois de février, travaillé sur les enjeux environnementaux, urbanistiques, économiques et sociétaux dans les territoires concernés par le risque inondation, partant des évènements survenus dans le Sud-Est de la France en juin 2010 et en novembre 2011.
Il sera intéressant de comparer nos constats et d'enrichir notre réflexion des propositions et remarques de la Cour des Comptes.

La Cour des comptes rend public un rapport sur les enseignements des inondations de 2010 sur le littoral atlantique (Xynthia) et dans le Var, au terme d'une enquête conduite avec les trois chambres régionales concernées. Ce rapport examine ce qui s'est passé avant, pendant et après les catastrophes ; il en fait un bilan financier pratiquement exhaustif ; il analyse concrètement plusieurs dossiers sensibles, qui illustrent les insuffisances de la prévention ou des décisions d'urbanisme critiquables ; enfin, il examine la réalité des leçons qui ont été tirées.
La chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur a adressé des rapports d'observations détaillés à toutes les collectivités et entités concernées (la région, le département du Var, le Syndicat intercommunal d'aménagement de la Nartuby (SIAN), la communauté d'agglomération dracénoise, le SDIS du Var et les communes de Draguignan, Fréjus et Trans-en-Provence). Ils seront rendus publics dans le courant et à la fin de l'été, au rythme des réunions de leurs instances délibératives.
Les inondations intervenues le 15 juin 2010 dans le Var à la suite de précipitations exceptionnelles ont particulièrement affecté le secteur de Draguignan et les vallées de la Nartuby et de l'Argens. Elles ont causé 23 décès et de nombreux dégâts. Le coût financier pour les collectivités publiques s'est élevé à 201 millions d'euros, dont 39,6 millions d'euros pour les seules collectivités territoriales de la région PACA et près de 25 millions d'euros pour le seul département du Var (coût net, subventions déduites). Les indemnités versées par les assurances ont atteint 615 millions d'euros, dont la moitié environ a été prise en charge par le système de garantie publique « catastrophe naturelle ».
La catastrophe a touché des territoires rendus vulnérables par une urbanisation croissante liée à la pression démographique qui touche la zone littorale. Il existe sur ces territoires aux capacités limitées une « soif de construire » entretenue par les propriétaires et les promoteurs et relayée par les élus locaux.
Des catastrophes avaient précédé celle de 2010, mais ont été oubliées, la plaque posée sur la façade de la pharmacie en face de l'hôtel de ville à Trans-en-Provence rappelle la hauteur d'eau atteinte en 1827.
Les pluies ont dévasté une zone peu étendue, de 40 à 50 km² autour de Draguignan, ce que les outils opérationnels de prévision de Météo-France ne permettaient pas de prévoir de façon suffisamment précise. Par ailleurs, la surveillance des rivières à risque (la Nartuby et l'Argens) par le service de prévision des crues a été très insuffisante. La portée des messages d'alerte a été atténuée par le non passage en alerte rouge et les difficultés de transmission pendant la crise. L'alerte à la population a été insuffisante. En 2011 au contraire, l'envoi de messages aux élus concernés a permis d'activer les plans de sauvegarde en temps opportun. Le nouveau système d'alerte et d'information des populations (SAIP) prévoit la mise en réseau des vecteurs d'alerte existants.
L'état des plans de secours montre d'importantes carences des services de l'Etat et des collectivités locales avant la crise ; elles ont été partiellement corrigées depuis. Le plan ORSEC était en cours de refonte ; le nouveau plan vient d'être signé par le préfet du Var. Le SDACR du Var (schémas d'analyse et de couverture des risques, qui date de 2007) envisageait le risque inondation ; en revanche, la localisation de certains centres avait manifestement été mal évaluée. En effet, plusieurs casernes de pompiers ont été inondées, le centre de secours des Arcs, la direction départementale des SDIS, le centre de secours et le magasin départemental à Draguignan. Le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) a été mis hors service et 87 véhicules ont été perdus sur un total de 160 sinistrés. La catastrophe a coûté 2,82 millions d'euros au SDIS. Les études pour déplacer les centres et les installations n'ont pas encore abouti. Très peu de communes avaient satisfait à l'obligation de réaliser un plan communal de sauvegarde, et ces plans étaient peu opérationnels. Un effort reste donc à accomplir, 27 des 47 communes concernées dans le Var avaient réalisé ce plan fin 2011. La Cour recommande aux communes de mettre au point et actualiser régulièrement leur plan communal de sauvegarde. En revanche, la communauté d'agglomération dracénoise a décidé en 2011 d'élaborer un plan intercommunal de sauvegarde portant sur tous les risques majeurs auxquels est exposé son territoire. L'efficacité et le dévouement des secours doivent être signalés ; dans le Var, la coordination des hélicoptères a été facilitée par la présence d'écoles militaires.
L'Etat a souvent fait preuve de faiblesse face aux projets de construction dans les zones inondables. C'est le cas du projet immobilier de Valescure à Fréjus. De façon générale, les préfets n'ont pas été assez soutenus face aux pressions locales sur les dossiers d'urbanisme en zone dangereuse. Il est nécessaire que la volonté du gouvernement s'exprime clairement et se maintienne dans la durée. Les inondations ont fait apparaître des situations d'extrême danger sans possibilité de réduire la vulnérabilité des documents ; cela a obligé au rachat par l'Etat de ces biens, et révèle le coût élevé des constructions en zone inondable. Dans le Var, le rachat de quatre maisons a coûté 870 000 euros.
Le code de l'environnement affirme le droit à l'information des citoyens sur les risques majeurs. Le préfet établit ainsi le dossier départemental sur les risques majeurs ; dans les trois départements concernés, ces dossiers avaient un contenu trop général et n'ont pas été actualisés dans les délais règlementaires (maximum 5 ans, 13 ans dans le Var). Le préfet du Var a demandé sa mise à jour en 2011. Le maire élabore le document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM). Très peu de communes en étaient dotées avant les catastrophes, et les documents existants n'étaient pas opérationnels (12 communes dans le Var possédaient un document d'information communal ou un plan communal de sauvegarde, mais 9 des 13 communes les plus sinistrées en avaient un). Depuis les crises, les préfectures ont mis en place une aide aux communes pour réaliser ces documents, mais se heurtent au manque de moyens en personnel. Dans le Var, deux ans après les inondations, seuls 32 DICRIM ont été transmis à la préfecture alors que la quasi-totalité des 153 communes est concernée. L'atlas des zones inondables, élaboré par les services de l'État, établit la cartographie des risques et peut permettre d'empêcher des constructions dans des zones dangereuses. Dans le Var, il n'a pas été transmis par le préfet aux maires avant la catastrophe. L'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, applicable depuis 2006, présente de sérieuses insuffisances ; elle a été actualisée en 2011 dans le Var.
Le plan de prévention des risques inondation (PPRI) est adopté par le préfet après enquête publique et avis des conseils municipaux concernés ; il a une valeur contraignante et permet de maîtriser l'urbanisation. Ces plans n'ont pas été prescrits dans toutes les zones à risque ; là où ils l'ont été, la procédure a parfois été interrompue, comme dans le Var. En général, les maires se sont opposés à l'adoption de ces plans ou l'ont retardée, y voyant des obstacles à leur volonté d'urbaniser leur commune. Les préfets n'ont pas toujours su résister aux pressions des élus et ont accepté un allongement excessif des procédures et une minoration des contraintes. Dans le Var, avant la crise, parmi les 13 communes les plus concernées par les inondations, 3 seulement, dont Draguignan, étaient couvertes par un PPRI. Les procédures ont été anormalement longues. Le plan de Draguignan, de manière très surprenante, classe le secteur du Salamandrier dans la zone de Saint-Hermentaire, en zone non inondable mais en amont et en aval de deux zones inondables ; c'est précisément dans ce secteur qu'ont été implantés le centre de secours de Draguignan et l'atelier départemental, qui ont été inondés. La question se pose donc de savoir comment l'aléa et la cartographie ont été établis. Depuis les inondations de 2010 et 2011, le préfet du Var a mis en oeuvre par anticipation 12 des 13 PPRI des communes les plus touchées par les inondations.
Depuis 2010, une reprise en main s'opère donc, avec le souci d'améliorer la couverture des zones à risque ; une directive européenne va par ailleurs introduire de substantielles modifications dans le dispositif français de prévention ; mais les oppositions locales n'ont pas disparu.
Les territoires touchés par les inondations étaient souvent couverts par des documents d'urbanisme obsolètes et peu contraignants, dans le Var, 12 des 13 communes sinistrées disposaient d'un plan d'occupation des sols (POS) antérieur à 1995 et pour 7 d'entre elles, antérieur à 1990. Depuis les catastrophes, les communes n'ont pas pris d'initiative pour les remplacer par des documents de nouvelle génération. L'État n'a pas engagé d'action pour obliger les collectivités territoriales à activer l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et à réaliser des plans locaux d'urbanisme. Le contrôle de légalité sur les actes d'urbanisme était faible ; il a été renforcé depuis la catastrophe, mais son efficacité se heurte au manque de moyens en personnel.
La protection des zones déjà urbanisées et de leurs populations est un enjeu majeur dans les zones à risque élevé. Elle est mise en oeuvre par des digues sur le littoral, et pour les rivières par l'entretien, voire l'aménagement des cours d'eau.
A Draguignan, une clinique, la maison d'arrêt, le centre de secours et les ateliers municipaux ont été fortement endommagés. De nombreux terrains de camping ont été affectés par les inondations, neuf ont dû être fermés dans le Var durant l'été 2010. La nécessité de faire appliquer strictement la réglementation commence à s'imposer, mais lentement.
Dans les zones où le risque est particulièrement élevé, il peut être préférable de renoncer à une protection, et de procéder au rachat. L'État a mis en oeuvre deux méthodes différentes sur le littoral atlantique et dans le Var. Après Xynthia, l'État a délimité des zones de solidarité puis d'expropriation. Le coût élevé des rachats de maisons situées hors zone d'expropriation (84 millions d'euros, sur un coût total de rachat de 316 millions d'euros) illustre le caractère précipité des décisions. Dans le Var, la méthode a été radicalement différente, et à l'inverse trop lente, des zones de rachat amiable n'ont pas été définies immédiatement. Dans une première phase, 20 maisons ont fait l'objet d'arrêtés de péril ; puis une étude est prévue dans les périmètres les plus exposés, l'acquisition devant être limitée à ces seuls périmètres, en concertation avec les élus. Un premier diagnostic identifie 18 nouveaux cas, pour lesquels l'étude est en cours. Cette procédure évite les acquisitions inutiles, mais nécessite un long délai pour statuer sur le cas de constructions dangereuses.
Les quatre cours d'eau à l'origine des inondations dans le Var sont tous non domaniaux, leur lit appartient aux propriétaires des deux rives, qui sont tenus à un entretien régulier. Or les rivières n'ont pas été entretenues et l'intervention des collectivités a été très défaillante. Un contrat de rivière existait pour la Nartuby, mais le SIAN, chargé de sa mise en oeuvre, n'a réalisé que peu des actions envisagées pour la protection contre les crues. Une volonté nouvelle s'exprime autour de la réalisation d'un Programme d'actions de prévention des inondations (PAPI), auquel le président du conseil général s'est engagé.
Le coût moyen du sinistre dans le Var est inférieur à celui de Xynthia (16 788 euros contre 20 909 euros) ; en revanche le coût des indemnisations pour les entreprises et les collectivités est supérieur (266,3 millions d'euros contre 208,9 millions d'euros). 5,65 millions de dons de dons ont été reçus.
Le coût des mesures fiscales de remises gracieuses aux particuliers est 4,5 fois plus élevé dans le Var (4,09 millions d'euros) qu'en Vendée (1,73 million d'euros), alors que le coût des indemnisations au titre du régime des catastrophes naturelles pour les habitations n'y est que légèrement supérieur. Il est surprenant que le nombre de demandes ait été aussi élevé et que toutes aient été satisfaites. Il s'agit principalement de dégrèvement sur les cartes grises ou les impôts locaux.
Le code de l'environnement autorise le rachat à l'amiable par l'État à condition que le prix s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations. Cette comparaison a été faite dans le Var (à l'inverse de Xynthia). Cependant deux biens non assurés ont été rachetés (dont un assuré après la catastrophe), précédent dangereux et source d'iniquité par rapport aux propriétaires de biens dont le rachat a été refusé pour cause de défaut d'assurance. Le contrôle des indemnités versées par les assurances a été insuffisant.
Face aux carences des dispositifs de vigilance, d'alerte et de secours, les progrès enregistrés depuis la crise restent à compléter, en particulier pour créer un réseau performant de la population. Les centres de secours situés en zone inondable doivent être rapidement déplacés.
Le Cour recommande aux communes situées dans des zones à risque de mettre au point et actualiser leur plan communal de sauvegarde et de compléter leur système d'alerte.
Le moyen le plus sage et le moins coûteux pour la protection des vies humaines, est d'empêcher les constructions dans les zones à risque fort non urbanisées. L'État doit faire preuve d'une plus grande fermeté à cet égard, et renforcer son contrôle de légalité sur les actes d'urbanisme des collectivités territoriales. La Cour recommande de faire aboutir dans le délai prévu les plans prioritaires de prévention des risques. Les communes doivent se doter de documents d'urbanisme actualisés et adopter les documents d'information sur les risques majeurs (DICRIM).
Dans le Var, la défaillance de la gouvernance est criante pour l'entretien des rivières non domaniales, les riverains comme la structure intercommunale existante sont dans l'incapacité matérielle et financière de les entretenir. La mise en place d'une stratégie globale à travers un Programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) n'empêche pas de prendre des mesures plus urgentes.

Après nos déplacements, il nous est apparu que si les autres départements faisaient mieux que le Var cela résultait du fait qu'ils avaient vécu des catastrophes d'une intensité particulière. Si j'en crois le rapport de la Cour, l'Etat et les préfets n'ont pas rempli leur mission et les élus locaux ont été des irresponsables ! Tous les rapports, depuis plusieurs décennies, tiennent, à peu de choses près, le même discours. Que faut-il conclure ? Que l'homme est mauvais ? Que les intérêts en jeu sont puissants et contradictoires ? Dans le même temps, que constate-t-on ? Que les habitants, même victimes d'une inondation, ne veulent pas quitter les zones où ils résident et qu'ils savent à leur corps défendant pertinemment inondables ; les élus locaux sont démunis devant l'immensité de la tâche à accomplir. La résistance locale et l'inertie administrative font que la culture du risque s'étiole, quelques années plus tard, avec le souvenir de l'évènement.
Ma question qui vous paraîtra saugrenue est la suivante, face à cette impasse, la question des inondations n'est-elle pas mal posée ? Pour l'instant, c'est l'interdit règlementaire et non le sens de l'aménagement du territoire qui prédomine. Quelle est votre réflexion sur le sujet ?

Effectivement, les leçons doivent être tirées des évènements sans un regard moraliste. A Vaison-la-Romaine, des dispositions ont été ainsi prises à la suite de la catastrophe. La Cour des comptes, dans son rapport, dit - et c'est là le rôle des juridictions financières - qu'il ne faut pas construire en zone inondable et que la catastrophe a coûté très cher aux finances publiques. Or, par exemple, l'entretien des rivières non domaniales coûtent moins cher sur la durée que l'indemnisation des sinistrés après l'inondation. Il faut sans doute se poser la question de la gouvernance des cours d'eau dans le Var.

Certes mais ce ne sont pas les mêmes qui paient et qui bénéficient de l'indemnisation ! Votre position est imparable et même partagée. Cependant, elle n'aboutit, dans la pratique, qu'à des avancées microscopiques à un rythme incompréhensiblement lent.
A Sommières que je suis allé visiter, on construit dans le lit majeur du Vidourle depuis le moyen-âge, période où le pont romain à été incorporé à la ville ! Les habitants se sont adaptés aux inondations. Ils vivent avec.
Dans le Var, comme vous le soulignez, il n'y a pas de gouvernance ou à peine un embryon, de la prévention des inondations. Les questions à se poser sont : que faire ? Qui est concerné ? Et surtout où sont les moyens financiers correspondants ?

Quand une volonté politique convergente existe, il est possible de limiter la soif de construire, notamment des promoteurs peu scrupuleux. L'exemple de Valescure à Fréjus est à cet égard criant.

Prenons un autre exemple, celui de La Palud à Fréjus. S'il est possible de déplorer les constructions en zone inondables dans cette zone, on ne peut ignorer que c'est une zone d'activité qui génère de nombreux emplois sur place vu les entreprises installées. La situation ne se résume pas à l'opposition spéculation contre sécurité !
Au-delà du simple relevé des dysfonctionnements - ce qui est votre rôle -, comment mettre en cohérence les différentes politiques publiques en zone inondables ? La ville de Nîmes s'est donné les moyens pour entreprendre des travaux considérables mais le chemin reste long, sans aucune certitude qu'ils seront suffisants.
Au-delà des représentants de l'État qui se sont sentis isolés et sans soutien du pouvoir central face à la gestion du risque d'inondations, le rapport prend aussi en compte la population et ses craintes qui sont légitimement relayées par les élus locaux.
Une analyse zone par zone est indispensable et correspond à la démarche imposée par la directive européenne sur les inondations qui nécessite la définition de zones à très grand risque et une stratégie pour elles. Contrairement à l'habitude française, cette directive oblige l'État à réaliser une véritable concertation.
Il faut distinguer des zones où l'urbanisation est ancienne comme à Sommières, que je connais bien comme ancien préfet de la région Languedoc-Roussillon, et celle où l'urbanisation n'a pas commencé comme à le quartier de Valescure à Fréjus. Dans ce dernier cas, au regard des dernières inondations, ce n'est pas raisonnable de construire. Pour les zones tellement dangereuses et où la protection serait excessivement coûteuse, il faut racheter les habitations avec toutes les difficultés que les cas sur le littoral atlantique ont prouvées après la tempête Xynthia. Le rapport évite donc les solutions simplistes et généralisées.
Le rapport note les avancées depuis les catastrophes de 2010. Les communes ont été incitées par les préfets à élaborer des plans communaux de sauvegarde. Lors des assises nationales sur les risques naturels en janvier 2012, les compagnies d'assurance s'en sont félicitées et ont souligné leur efficacité.
A la suite de directives fermes du Gouvernement, les préfets ont également favorisé l'élaboration des plans de prévention des risques d'inondation et se sont opposés aux constructions en zone dangereuse. Néanmoins, du temps est nécessaire pour aboutir et les PPRI en sont l'exemple.

La question est en réalité de savoir si la méthode adoptée permettra d'aboutir à des résultats concrets.
Les progrès en matière de gestion de la crise dont vous faîtes état entre les événements de 2010 et ceux de 2011 doivent être relativisés tant la nature des deux crises est différente. En juin 2010, la crue est trop soudaine pour qu'il soit possible de mettre en oeuvre les dispositifs de prévision, d'alerte et de secours prévus ; en novembre 2011, au contraire, le déroulement de l'événement est conforme aux modèles et permet l'application des procédures habituelles.
En 2010, le préfet du Var n'avait aucun moyen d'action face à la crise, quand elle est survenue. Chacun a bricolé, intelligemment je dois dire à son niveau, le préfet en mobilisant les hélicoptères en urgence, la sous-préfète de Draguignan en chaussant ses bottes pour aller immédiatement sur le terrain, les maires en faisant appel aux comités communaux de feux de forêt (CCFF) etc.
Vous critiquez l'absence de PPRI dans de nombreuses communes du Var avant la crue de 2010. Pourtant, c'est à Draguignan, seule commune sinistrée à disposer d'un PPRI, que ne nombre de décès a été le plus élevé. Ce qui prouve bien que l'existence d'un PPRI ne règle pas tout, comme il est commode de le croire.
Il est certain que la bonne approche du risque inondation en matière d'urbanisme est de l'envisager zone par zone, comme vous le proposez. L'important n'est pas tant de posséder un PCS et un PPRI que de réfléchir à leur contenu, qui doit prendre en compte toutes les dimensions du risque, notamment les conséquences du ruissellement urbain trop souvent ignoré
Il est étonnant que vous n'évoquiez pas, dans votre rapport, le rôle de la police de l'eau dans la survenue de la catastrophe de juin 2010, alors qu'il est établi que la violence de la crue de la Nartuby est en partie due au mauvais entretien de la rivière. Notre déplacement à Chateaudouble et à Rebouillon, ainsi que les auditions réalisées sur place, ont confirmé ce constat. Il est curieux que la protection d'un écosystème puisse passer avant la protection des populations. Il faut améliorer l'entretien des rivières, dans un contexte où les riverains n'ont pas les moyens financiers de s'acquitter de cette obligation et où la police de l'eau constitue parfois, par trop de zèle, un obstacle à cet entretien. Quel est votre sentiment sur ce sujet ?
Il est vrai que le contenu de certains PCS et PPRI n'est pas toujours opérationnel, comme c'était le cas du PPRI de Draguignan en 2010.
Il y a des éléments sur la police de l'eau dans notre rapport, notamment dans la partie qui concerne Valescure.

Il faut insister sur ce point. La crue de Nartuby en juin 2010 a été aggravée par la présence d'embâcles, qui ont cédé, embâcles dus au mauvais entretien du cours d'eau.
Les quatre rivières du département du Var à l'origine des crues de 2010 et de 2011 ne sont pas des cours d'eau domaniaux et, à ce titre, doivent être entretenues par les riverains. Il existe certes, dans le cadre de la loi sur l'eau, des mécanismes (déclaration d'intérêt général, contrats de rivière) permettant de confier cette charge aux collectivités territoriales ou aux syndicats de rivière, mais cela n'a pas fonctionné correctement, en raison notamment d'un manque de moyens financiers dédiés à cette mission. A titre d'exemple, le Syndicat intercommunal d'aménagement de la Nartuby (SIAN) dispose d'un budget de quatre millions d'euros alors que les travaux d'urgence sont estimés à quinze millions d'euros. Il faut donc trouver de nouvelles solutions pour l'entretien et la gouvernance des cours d'eau non domaniaux.
Dans ce cadre, les Programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI) semblent constituer un outil intéressant. Après les événements de 2010, le préfet du Var a convaincu les différents acteurs concernés (Conseil général, collectivités territoriales et SIAN) d'initier cette démarche. Mais le processus est extrêmement long. Après avoir obtenu l'adhésion de chacun au projet, il faut ensuite s'accorder sur un PAPI d'intention qu'il convient de faire approuver, avant de créer un syndicat mixte chargé de sa mise en oeuvre. Or, les travaux d'urgence devront être réalisés rapidement sur la Nartuby.
Il est exact que les inondations de novembre 2011 sont différentes de celles de juin 2010. Pour autant, cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas eu une meilleure prise en compte du risque inondations par les communes entre les deux catastrophes. Si le rapport de la Cour des Comptes est critique sur bien des points, il salue aussi les progrès réalisés.
S'agissant de la notion de projet en matière d'urbanisme, le rapport est resté prudent. En effet, il pourrait s'avérer dangereux qu'un projet d'aménagement s'affranchisse par trop des normes de sécurité et conduise à multiplier les constructions. A Valescure par exemple, il est probable que l'application de ce concept aurait conduit à construire plus encore.

La notion de projet ne doit pas être considérée à un niveau individuel mais bien à l'échelle d'un territoire.
Les projets du nouveau Gouvernement sur cette question sont encore incertains.
En tout état de cause, les normes de sécurité en matière d'urbanisme ont un sens. A Rebouillon par exemple, la maison de la famille Milési, dont deux membres ont été emportés par la crue de juin 2010 alors qu'ils se trouvaient dans leur jardin, est bâtie au bord de l'eau. La réponse du maire de la commune à la Cour des Comptes a consisté à dire que sa population connaît et vit avec le risque inondation, ce qui justifierait l'absence de normes urbanistiques plus sévères. Pourtant, il y a eu des morts. La conscience du risque n'a pas progressé dans toutes les communes après la catastrophe.

Le rapport de la Cour des Comptes met cependant moins en cause la responsabilité des élus locaux dans le cas des inondations du Var que dans celui de la tempête Xynthia.

Il ne faut pas exonérer les élus de leurs responsabilités s'il y a eu des défaillances avérées. Mais, le traitement du risque inondation par le renforcement des PCS et des PPRI est-il efficace ? Les résistances locales sont-elles le signe de la faiblesse humaine ou un élément déterminant qu'il convient d'intégrer à la réflexion sur la gestion du risque ?
L'enjeu est de comprendre pourquoi la crue de 2010 a pris une telle ampleur. L'absence d'entretien des cours d'eau a modifié la nature du risque. La priorité doit être redonnée à la hiérarchisation de la protection, celle des populations étant prioritaire par rapport à celle de l'environnement, et à l'allocation de moyens financiers destinés à cette protection.

J'entends la montée au créneau de mon collègue. Nous partageons certaines idées, les textes sont souvent mal appliqués et le facteur humain joue un rôle prépondérant. Le maire de Sommières nous a en effet présentés sa vision des choses : « je n'ai aucun problème, je vis avec les inondations. Ce type d'échanges est important, il faut être avec les élus locaux et le terrain. Peut-être existe-t-il une possibilité de vivre dangereusement, au moins d'apprivoiser le risque. S'adapter au terrain est parfois plus simple. Prenons l'exemple de Vaison-la-Romaine, où l'inondation s'est élevée à deux mètres au-dessus du pont romain, deux réactions étaient envisageables : tout détruire ou trouver une solution pragmatique. La seconde voie a été privilégiée et deux mesures ont été prises. La première a consisté à enlever tout ce qui se situait en zone de risque maximal. La seconde a visé l'aménagement des rez-de-chaussée afin de prévenir les pertes humaines.
Les questions que je me pose sont les suivantes : jusqu'où peut-on adapter la législation et la règlementation française ? Jusqu'où peut-on faire preuve de souplesse sans permettre tout et n'importe quoi ? Si notre système fonctionnait bien, on se contenterait d'avoir la loi d'un côté et des élus locaux qui l'appliquent de l'autre. Mais je me demande si on peut aller jusqu'à la responsabilité individuelle comme dans le cas des Etats-Unis.

La réponse c'est d'abord le principe de précaution. Notre premier contact a été Jacques Oudin, très investi sur le thème de la protection contre les inondations. Il a invoqué les digues néerlandaises comme l'exemple de ce qu'il convient de faire. Ces ouvrages présentent beaucoup d'intérêt. Les digues en France posent de nombreux problèmes de propriété et de responsabilité. Le constat de leur entretien défaillant est patent. Or, ces ouvrages conditionnent des politiques de protection efficaces. Le cas des rivières non domaniales pose également des difficultés. Le cadre législatif n'est pas satisfaisant.
Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur les élus locaux, il convient de les aider et d'agir avec pédagogie. La course au nombre d'habitants dans les communes est connue, mais l'intérêt général doit être garanti par l'Etat et, partant, par les préfets. Certes, des carences sont constatées dans la façon dont les préfets ont travaillé mais les carences les plus importantes sont le fait des maires qui ont eu à gérer les crises. Certains ont même fait l'objet de procédures judiciaires et quelques cas sont cités dans le rapport de la Cour.
Nous recommandons l'adoption de plans. A l'image de l'action publique en matière de personnes âgées ou encore de personnes handicapées, l'Etat doit planifier son action en matière de prévention et de gestion du risque d'inondations. D'où notre insistance sur les plans communaux de sauvegarde. Ces derniers demandent des moyens adéquats, ce qui est parfois difficile, mais vu le coût des inondations ces besoins doivent être relativisés.
La loi doit être la mieux respectée possible et la balle est donc notamment dans le camp des parlementaires. Ainsi, la directive de 2007 continue d'appeler une traduction en droit interne. Ces textes profiteront aux départements et aux régions concernés par le risque d'inondations.

Bien qu'il semble diffus, le risque inondations concerne des milliers de communes et des millions d'habitants. Or, le cadre légal résulte d'un bricolage règlementaire et législatif.
Dans les zones inondables, il faut distinguer les zones rouges où la construction est interdite et celles bleues où la construction est possible sous conditions. Il faut également distinguer les zones non bâties et celles bâties pour lesquelles l'entretien des cours d'eau est indispensable. Il faut enfin distinguer les zones non protégées par des digues de celles protégées pour lesquelles l'entretien de ces ouvrages de protection, encore régi par la loi de 1807 sur l'assèchement des marais, est compliquée par une gestion chaotique. Dans 90 % des cas, les propriétaires de ces digues, tenus à l'obligation d'entretien, sont inconnus de l'administration.
Le législateur doit donc relayer le travail et le constat de la Cour des comptes avec les pouvoirs normatifs qui sont les siens. La Cour se borne, quant à elle, à relever les problèmes et les défaillances en l'état actuel du droit et ne peut se substituer à la représentation nationale.

Il est difficile de demander à des riverains, parfois âgés, d'entretenir les berges des cours d'eau non domaniaux. Cette tâche doit être confiée aux collectivités territoriales ou aux syndicats de rivière, moyennant par exemple une servitude de passage. Le même constat peut être fait pour l'entretien des digues. Le législateur doit faire évoluer les règles dans ce domaine, notamment en modifiant la loi de 1807 sur les digues.
Cette évolution ne doit pas empêcher l'application de règles strictes en matière d'urbanisme, notamment le respect de l'interdiction de construire en zone rouge.

Les experts ne sont pas toujours fiables. Le Titanic était réputé insubmersible !

On peut douter de l'expertise. Plus sérieusement, la définition des zones rouges doit ressortir de la responsabilité de l'Etat.

Le rôle des experts doit effectivement être limité à donner leur avis.
Mais chacun doit prendre ses responsabilités. Or, il semble bien qu'il y ait eu des défaillances constatées.

Sujet très différent, je souhaiterais vous interroger sur les indemnisations par le programme 122. Au lendemain de la crue de 2010, l'Etat a rapidement pris des engagements auprès des collectivités territoriales. Deux ans après la crise, on s'aperçoit pourtant que sur les 23 millions d'euros prévus, seuls 5,7 millions d'euros ont été mandatés. Quelle explication donnez-vous à cette situation ?

Le constat est inverse s'agissant de l'indemnisation des dégâts causés par Xynthia. Il faut trouver un juste milieu entre ces deux exemples.
La faible consommation des crédits du programme 122 dans le cas du Var s'explique par les difficultés de gouvernance. Pour être indemnisé, il faut constituer un dossier puis trouver un maître d'ouvrage pour les travaux, ainsi que les avances de financement. Ainsi, le SIAN a contracté un emprunt de trois millions d'euros pour réaliser des travaux, mais attend toujours les financements complémentaires de l'agence de l'eau, du Conseil général et du Conseil régional.
Les indemnisations ont été plus rapides après Xynthia, notamment parce que le Conseil général de Vendée, même s'il ne souhaite pas s'occuper de la gestion des digues à terme, a pris à son compte la maîtrise d'ouvrage pour leur restauration.
Il faut cependant reconnaître que le préfet du Var s'est fortement mobilisé après la catastrophe de 2010. Il a notamment rapidement engagé des discussions avec le Conseil général pour que celui-ci s'investisse dans la définition des PAPI.

Si les crédits du programme 122 peinent à être dépensés, n'est-ce pas également parce qu'il n'est pas efficace d'appliquer les procédures budgétaires classiques à des situations extraordinaires ? La lourdeur de ces procédures conduit parfois les responsables à utiliser les crédits du programme 128, plus rapidement et facilement mobilisables, pour financer des travaux qui ne relèvent pourtant pas de l'extrême urgence.
Ce point a été particulièrement évoqué dans le rapport consacré au Var. Les juridictions financières ne peuvent pas se permettre d'aller trop dans le détail en matière de préconisations.
Il y a un réel besoin d'aller plus vite. Les associations de riverains estiment que les PAPI témoignent de bonnes intentions mais qu'après la catastrophe la priorité c'est d'abord de nettoyer les rivières. Nous n'avons pas de réponses opérationnelles mais nous posons la question et vous rejoignons quant à cette préoccupation. Même quand il faut aller plus vite, la cohérence doit toujours être recherchée. Je relève que le PAPI prévoit des zones d'expansion des crues, or quand le maire de Sommières déclare vivre avec le risque inondation, il faudrait remarquer qu'il y a eu des travaux d'aménagement réalisés.

En 1958, trois barrages écrêteurs ont été construits sur le Vidourle et ses affluents et lorsqu'arrivent, en 2002, les inondations à Sommières, on voit la limite de l'exercice, on ne peut pas construire un barrage d'Assouan partout, heureusement d'ailleurs, et il faut accepter de vivre avec le risque. Les habitants se sont adaptés.
L'existence de repères de crues sur les bâtiments dans les villes est le contraire d'une logique d'interdiction. Une telle approche n'est peut-être pas généralisable telle quelle, mais il est certain que plus de souplesse appelle également plus de bon sens.

Nous avons connu les inondations de 2002, de 2004 et surtout, celles de 1988, plus graves encore. Le PAPI signé pour la période 2008-2013 représente 125 millions d'euros dont la moitié est prise en charge par la ville de Nîmes. Or je constate que les services de l'Etat nous imposent d'importantes contraintes en dépit des travaux réalisés. Nous devons faire face à d'importants flux de population. Ainsi les préfets nous demandent de construire 500 nouveaux logements par an. Comment répondre à ces attentes ? Nous ne pouvons pas construire au-delà de trois étages, or il serait logique pour prévenir le risque de construire au-dessus de ce seuil. Alors qu'il était convenu d'assouplir les PPRI suite à la mise en oeuvre du PAPI, les rigidités restent identiques. Pourtant les élus locaux ont fait ce qu'il fallait. Je souligne que celui qui est le mieux placé pour parler des risques, c'est le maire et non le préfet, il témoigne en effet d'une meilleure connaissance du terrain, des acteurs et des enjeux.

Des questions vous seront adressées suite à cette audition, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir y répondre.

A quelle date rendrez-vous publics les rapports consacrés aux collectivités territoriales ?
Je précise que 95 % du contenu de ces rapports figure déjà dans le rapport public thématique qui vient d'être diffusé.