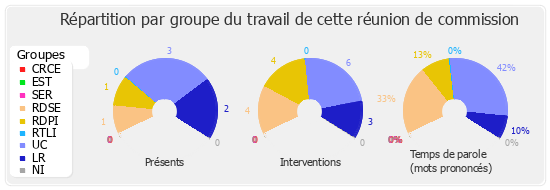Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation
Réunion du 6 mai 2009 : 1ère réunion
Sommaire
- Contrôle budgétaire sur la réforme du conseil économique social et environnemental
- Contrôle budgétaire sur la gestion des stocks de produits de santé par l'etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires
- Contrôle budgétaire
- Point d'étape sur le contrôle de m. michel charasse rapporteur spécial sur les crédits de coopération engagés au maghreb et en afrique de l'est (voir le dossier)
- Point d'étape de m. philippe dallier rapporteur spécial sur la délégation interministérielle à la ville div (voir le dossier)
- Nomination de rapporteurs (voir le dossier)
La réunion

Au cours d'une première réunion tenue dans la matinée, la commission a entendu une communication de M. Jean-Claude Frécon, rapporteur spécial, sur la réforme du Conseil économique, social et environnemental (CESE).
a tout d'abord indiqué que, prévu depuis plusieurs mois, ce contrôle avait du être suspendu en raison, d'une part, de la réforme du Conseil économique, social et environnemental (CESE), issue de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, et, d'autre part, de l'attente des conclusions de la mission confiée par le Président de la République à M. Dominique-Jean Chertier, chargé de mener une réflexion sur la mise en oeuvre des nouvelles missions du CESE et sur sa représentativité. Ces conclusions ont été rendues publiques le 15 janvier 2009.
Il a souligné que la réforme constitutionnelle implique de repenser la place même du CESE au sein de notre paysage institutionnel et incite à adapter son organisation et son fonctionnement. Aussi a-t-il estimé que la période qui s'ouvre représente une chance à saisir pour le CESE.
a rappelé que le Conseil économique, social et environnemental (CESE) relève de la mission « Conseil et contrôle de l'Etat », dont il représente une part très limitée des crédits (moins de 7 %) avec 36,9 millions d'euros de budget annuel. Il a noté que l'évolution de ses crédits est maîtrisée et que son plafond d'emploi demeure stable depuis vingt ans.
Le CESE constitue un lieu de dialogue, de concertation et de proposition privilégié et, par conséquent, la question de sa représentativité au regard de la société civile est cruciale.
Le CESE comprend aujourd'hui 233 conseillers, répartis en dix-huit groupes de représentation et que la durée de leur mandat est de cinq ans. Parmi ces 233 conseillers, 163 sont désignés par les organisations socioprofessionnelles, les 70 autres conseillers étant nommés par le Gouvernement. A ces 233 conseillers, s'ajoutent 72 membres de section, qui tiennent un rôle d'expert, et sont désignés par le Premier ministre pour deux ans.
a précisé que le CESE est organisé en neuf sections : affaires sociales, travail, économies régionales et aménagement du territoire, cadre de vie, finances, relations extérieures, activités productives et de la recherche, agriculture et alimentation et, enfin, questions économiques générales et conjoncture, auxquelles s'ajoutent deux délégations : la délégation pour l'Union européenne (UE) et la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances.
La production du CESE, caractérisée par la grande diversité de ses champs d'études, se mesure d'abord par le nombre d'avis et d'études publiés. Ceux-ci résultent soit d'une saisine gouvernementale (en vertu des articles 69 et 70 de la Constitution avant la révision de juillet 2008) et constituent alors la priorité de l'organisation du travail du CESE en raison du délai de réponse imposé de deux ou trois mois, soit d'autosaisines, celles-ci représentant la majorité des travaux du CESE mais aussi leur principale variable d'ajustement.
Le CESE est une institution engagée sur la voie de la modernisation et, au cours des cinq dernières années, celui-ci a conduit une politique de rationalisation de ses services. Cette politique lui a permis une « mise à niveau » au regard des processus de changement menés au sein des autres administrations d'Etat dans le cadre de la LOLF.
Afin de faire face à son déficit de visibilité, le CESE a entrepris un effort pour diffuser le plus largement possible ses travaux grâce à une politique de communication offensive.
a indiqué que la réforme issue de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 porte sur quatre axes principaux :
- l'extension du champ de compétences du CESE au domaine environnemental et, par conséquent, la modification de la dénomination du CES ;
- l'élargissement des possibilités de consultation du CESE, qui peut désormais être saisi par le Parlement « sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental ». En outre, le Gouvernement peut le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques ;
- la limitation du nombre de membres du CESE à 233 conseillers au maximum ;
- la possibilité de saisine du CESE par voie de pétition.
Il a précisé que seule cette dernière mesure nécessite l'adoption d'une loi organique, les trois autres étant d'application immédiate. Il s'agit, dans ce cadre, de déterminer les modalités de la saisine : les conditions de recevabilité de la pétition, les thèmes sur lesquels le CESE sera habilité à se prononcer, les délais pour rendre l'avis...
Il a ajouté que l'adoption de la nouvelle loi organique devra non seulement répondre aux enjeux organisationnels mais surtout à la question essentielle de la représentativité du CESE, afin qu'il demeure un lieu privilégié de débat et d'échanges entre les différentes composantes de la société française.
Il a rappelé que la question de la composition du CESE, qui n'a que peu évolué depuis 1958, est la plus controversée. A cet égard, le rapport de M. Dominique-Jean Chertier ouvre le débat en proposant trois scénarios possibles.
a souligné que, s'agissant des implications budgétaires de cette réforme, celle-ci doit s'effectuer à moyens constants et qu'il s'agit d'ailleurs d'un engagement ferme pris par le Président du CESE, M. Jacques Dermagne. Il a estimé que la réforme engendrera, toutefois, inévitablement des coûts, certains fixes et d'autres variables selon les options institutionnelles retenues.
Les coûts fixes incontournables sont les dépenses induites par le changement de nom de l'institution : évolution de la charte graphique, dépenses de papeterie. La modification de l'inscription portée au fronton du Palais d'Iéna, qui a été estimée sur devis à plus de 150 000 euros, est plus onéreuse et a été différée.
Les coûts variables sont difficiles à évaluer dans l'immédiat, dès lors qu'ils sont liés à l'impact de la saisine parlementaire ou du droit de pétition citoyenne, dont les modalités pratiques ne sont pas encore connues.
Il a ajouté que les conséquences sur la charge et les méthodes de travail du Conseil, ainsi que sur son budget, seront fortement corrélées au filtre mis en place pour ces saisines. Par exemple, dans le cas de la saisine parlementaire, la saisine directe du CESE par un nombre réduit de parlementaires, par un président de commission ou par un président de groupe pourra alourdir la charge de travail du CESE. En ce qui concerne la pétition citoyenne, si le coût de traitement des avis en résultant et ayant subi un « filtre » efficace est évalué comme nul par le CESE, la gestion en elle-même du droit de pétition (c'est-à-dire le coût de la collecte des signatures et leur vérification) pourrait s'avérer considérable.
a ajouté que, en l'état, le CESE ne dispose ni du savoir-faire, ni des outils, ni des moyens humains nécessaires pour mener à bien ces missions.
Il a estimé que la réforme du CESE peut également fournir l'opportunité de réaliser de nouvelles économies. Il a suggéré d'évaluer la nécessité de maintenir ou de supprimer certains organismes consultatifs dont les missions sont devenues redondantes avec celles du CESE, comme par exemple le Conseil national du développement durable, le Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale, le Conseil d'orientation pour l'emploi, le Conseil d'analyse économique ou le Conseil d'analyse de la société.
Il a observé que, dans le contexte de la réforme, le CESE doit faire face à une difficulté relative au fragile équilibre de sa caisse de retraite. La perspective du prochain renouvellement des membres de l'institution pourrait contribuer à aggraver significativement cette situation déjà critique. En effet, dans le cas où la loi organique imposerait des exigences d'âge ou de parité, le pourcentage de renouvellement (qui est habituellement d'environ 50 %) pourrait passer à 75 % lors de la prochaine mandature et les conséquences sur le financement de la caisse de retraite ne manqueraient pas alors de se faire durement sentir. En outre, à plus long terme, la féminisation accrue du CESE entraînera une charge supplémentaire pour la caisse de retraite, en raison du différentiel d'âge de mortalité entre les hommes et les femmes. Toutefois, dans l'ignorance du contenu de la future loi organique, il est difficile, à ce stade, d'évaluer précisément l'impact du renouvellement futur sur l'équilibre de la caisse de retraite du CESE.
a évoqué plusieurs pistes pour assurer la pérennité de ce régime de retraite.
Tout d'abord, il a estimé qu'un renforcement de l'effort budgétaire peut être envisagé afin d'augmenter la subvention versée par le CESE à la caisse. Dans le cadre de la négociation budgétaire pluriannuelle conduite en 2008, une « rallonge » de 0,3 million d'euros en loi de finances initiale pour 2009 et de 0,5 million d'euros dans le projet de loi de finances pour 2010 a été négociée. Mais cet effort ne sera pas suffisant. Il a observé qu'en période de tensions budgétaires et d'aggravation du déficit public, cette solution ne correspond pas, sur le long terme, à l'orthodoxie budgétaire prônée par la commission.
Il a déclaré qu'une révision des règles gouvernant le régime de retraite du CESE devra vraisemblablement être entreprise, s'agissant tant de l'âge d'ouverture des droits à pension que des conditions de réversion de cette pension.
Il a rappelé que les mesures de régulation budgétaire auxquelles est soumis le CESE depuis deux ans pèsent, elles-aussi, sur le financement de la caisse de retraite du Conseil.
a souligné que le CESE se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins et se voit offrir une opportunité inédite d'affirmer son statut de troisième assemblée constitutionnelle. Dans cette perspective, la mise en oeuvre de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 représente, pour lui, une chance à saisir et que l'adoption de la future loi organique relative à son fonctionnement et au renouvellement de ses membres constituera une étape-clef.

s'est félicité de ce travail de contrôle permettant de mettre en lumière la question de l'avenir du CESE.

a rappelé que le CESE n'est pas une assemblée parlementaire, mais une assemblée consultative. Aussi s'est-il interrogé sur la légitimité du CESE à prétendre s'appuyer sur une caisse de retraite autonome, au même titre que l'Assemblée nationale et le Sénat. Il a indiqué être opposé à l'extension de cette spécificité au CESE.

a ajouté qu'entre les parlementaires et les membres du CESE existe une différence importante, dans la mesure où les membres du CESE conservent une activité professionnelle.

s'est interrogé sur le montant des rémunérations des membres du Conseil, ainsi que des membres de section.

a indiqué que les conseillers du CESE perçoivent une rémunération de base de 1 814,54 euros bruts, complétée par une indemnité de résidence de 54,44 euros bruts et une indemnité représentative de frais de 1 868,97 euros bruts. Il a également précisé que les membres de section reçoivent une indemnité mensuelle représentative de frais d'un montant net de 861,97 euros.

s'est interrogé sur le montant de la dette au titre du versement des droits à pension des membres du CESE.

a expliqué que ce montant correspond à un engagement hors bilan de l'Etat d'un montant de 218,5 millions d'euros.

s'est déclaré favorable à la suppression d'un certain nombre d'organismes redondants avec le CESE, proposée par M. Jean-Claude Frécon.

S'agissant de la suppression éventuelle du Conseil national du développement durable, M. Pierre Jarlier s'est inquiété de la possibilité pour les élus de conserver un lieu de débat pour traiter des enjeux du développement durable.

a observé qu'un tel espace de débat existe au Parlement ou au sein d'associations d'élus telles que l'Association des maires de France (AMF).

a ajouté que les représentants d'associations d'élus pourraient également être nommés, à l'avenir, en tant qu'experts au CESE.

a rappelé que les conclusions du groupe 5 du « Grenelle de l'environnement » comportent la proposition de maintenir une telle instance de dialogue.
La commission a ensuite donné acte, à l'unanimité, à M. Jean-Claude Frécon, rapporteur spécial, de sa communication et en a autorisé la publication sous la forme d'un rapport d'information.
La commission a ensuite entendu une communication de M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur spécial, sur la gestion par l'Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) des stocks de produits de santé constitués en cas d'attaque terroriste ou de pandémie.

a présenté les principales conclusions de sa mission de contrôle sur la gestion des stocks de produits de santé constitués en cas d'attaque terroriste ou de pandémie. Ce stock, géré jusqu'en 2007 par la direction générale de la santé (DGS) du ministère chargé de la santé, l'est désormais par l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS), opérateur créé, à l'initiative de M. Francis Giraud, par la loi du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur.
Le rapporteur spécial a indiqué que si l'actualité l'a, en quelque sorte, rattrapé, trois éléments avaient justifié à l'origine le choix de procéder à ce contrôle :
- les enjeux sanitaires et budgétaires du sujet, puisque la valeur du stock de produits de santé géré par l'EPRUS s'élève à 845 millions d'euros ;
- les interrogations exprimées d'emblée par la commission des finances sur la qualité de gestion de ce stock ;
- enfin, l'arrivée à péremption d'une partie importante des produits stockés.
Il a précisé que, compte tenu de l'actualité, il mènera des auditions complémentaires et se rendra sur des sites de stockage pour apprécier concrètement l'action de l'EPRUS.
Revenant sur l'origine de la mise en place de l'établissement public, M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur spécial, a indiqué que la nécessité de constituer des stocks de produits de santé s'est imposée en France, de façon assez récente, à la suite notamment des attentats du 11 septembre 2001 et de l'apparition du risque de pandémie grippale après la découverte de cas humains de « grippe aviaire».
En peu de temps, des efforts financiers et organisationnels importants ont été menés, plaçant la France parmi les Etats les mieux préparés, même si cette observation doit être relativisée, étant donné notamment l'hétérogénéité de la préparation des Etats-membres de l'Union européenne.
Des difficultés sont cependant apparues, conduisant à la création de l'EPRUS : d'une part, la gestion peu satisfaisante effectuée par le ministère de la santé et, d'autre part, l'obligation constitutionnelle de modifier les modalités de financement des risques sanitaires.
Si la proposition de loi proposant de mettre en place l'EPRUS n'avait pas pour ambition de réformer en profondeur la gestion des crises sanitaires, les attentes relatives à la mise en place de ce nouvel établissement étaient néanmoins fortes, comme, d'ailleurs, les interrogations quant à l'opportunité de créer une nouvelle agence dans le dispositif déjà complexe de gestion des risques sanitaires et quant à la capacité de l'EPRUS à surmonter les difficultés rencontrées dans le passé.
Insistant sur le contexte difficile dans lequel la mission de l'établissement public s'inscrit, M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur spécial, a indiqué que, près de deux ans après sa création, l'EPRUS n'a pas encore répondu aux attentes initiales. Il a identifié trois principaux types de faiblesses : des problèmes de gouvernance qui ont retardé la mise en place opérationnelle de la structure, des difficultés dans la programmation budgétaire des moyens qui lui sont alloués et dans la valorisation comptable du stock, ainsi que des difficultés liées à la mission de gestionnaire logistique des stocks de l'agence.
S'agissant des problèmes de gouvernance, il a précisé que ces derniers tiennent, tout d'abord, au caractère relativement « improvisé » de la mise en place de l'EPRUS. La création de cet opérateur a, en effet, été entérinée dans des délais très brefs en dépit de l'ampleur de la tâche. Plusieurs éléments attestent de cette relative impréparation : l'implantation de l'EPRUS dans ses locaux définitifs n'a été effective qu'au début de l'année 2009, les relations entre la DGS et l'établissement public n'ont été formalisées dans une « convention-cadre » que le 16 février dernier et, en raison de problèmes juridiques, celui-ci vient seulement d'obtenir le statut d'établissement pharmaceutique.
Les difficultés de gouvernance tiennent également au positionnement complexe de l'EPRUS au sein du dispositif de gestion des risques sanitaires et, plus particulièrement, par rapport à sa tutelle. La structure est, en effet, au coeur du dispositif de gestion des urgences sanitaires, sans toutefois que les interfaces avec les différentes agences de sécurité sanitaire, notamment l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), ou les différents ministères en charge de ces questions - le ministère de la défense qui gère ses propres stocks et le ministère de l'intérieur responsable de la réserve civile - ne soient encore complètement stabilisées.
En particulier, le rapporteur spécial a insisté sur le très faible degré d'autonomie de l'établissement public par rapport à la DGS. L'exercice de la tutelle, en ce qui concerne cet opérateur, se distingue, en effet, singulièrement de celle à laquelle sont soumises les autres agences de sécurité sanitaire : l'EPRUS n'exécute la plupart de ses actes qu'à la demande expresse du ministre de la santé.
Par ailleurs, il a rappelé les difficultés de gestion des ressources humaines rencontrées par l'agence : la démission du directeur général à l'été 2008, la nécessité de mettre en place un nouvel organigramme et, enfin, les difficultés de recrutements liées aux compétences assez spécifiques recherchées.
S'agissant des aspects budgétaires, M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur spécial, a rappelé que l'EPRUS bénéficie de deux sources de financement : d'une part, une subvention versée par l'Etat dans le cadre de la mission « Santé » et, d'autre part, une dotation de l'assurance maladie inscrite, chaque année, en loi de financement de la sécurité sociale.
Or, jusqu'à présent, la programmation budgétaire des moyens alloués à l'EPRUS a été peu satisfaisante. Il a, en particulier, insisté sur les taux de consommation très faibles des ressources, moins de 25 % des crédits alloués en 2007 et 2008, qui ont conduit à la constitution d'un fonds de roulement de l'ordre de 246,5 millions d'euros à la fin de l'année 2008. Cette sous-consommation s'explique par la mise en place progressive du dispositif, l'instabilité de la structure administrative, les retards pris dans l'ouverture de l'établissement pharmaceutique et les incertitudes sur les dates de péremption des produits stockés qui ont amené à réviser régulièrement la programmation d'achat et de renouvellement des stocks.
a indiqué qu'il veillera attentivement à la consommation des crédits de l'EPRUS en 2009, ainsi qu'à la réduction du fonds de roulement.
S'agissant de la question de la participation de l'assurance maladie, il s'est interrogé sur la légitimité d'une contribution de l'assurance maladie à ce type de dépenses qui relèvent directement des missions régaliennes de l'Etat, tout en apportant les précisions suivantes :
- d'une part, la loi du 5 mars 2007 constitue un progrès puisque la contribution à la charge des régimes obligatoires de base est désormais plafonnée à 50 % des dépenses effectivement constatées de l'établissement sur trois exercices consécutifs ;
- d'autre part, le décaissement propre à l'assurance maladie s'effectuant sur la base de prévisions de trésorerie, l'assurance maladie n'a pas versé la totalité des crédits inscrits en loi de financement de la sécurité sociale.
a ensuite abordé la question de la valorisation comptable des stocks. Deux questions principales se sont posées s'agissant du stock géré par l'EPRUS : d'une part, celle de la mise en place rapide d'un inventaire comptable, compte tenu des nouvelles exigences posées par la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), et, d'autre part, celle du statut de ces stocks : ces derniers appartiennent-ils à l'Etat ou à l'EPRUS ?
Jusqu'à présent, il a été décidé de comptabiliser l'intégralité du « stock national santé » au bilan de l'Etat, y compris pour la partie gérée par l'EPRUS depuis 2008. Quant aux exigences liées à la confection d'un inventaire comptable, elles ont amené la DGS au recrutement d'un logisticien chargé de développer un outil informatique qualifié de « rudimentaire » par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) auprès du ministère de la santé.
Le rapporteur spécial a indiqué que cet outil est aujourd'hui toujours utilisé dans l'attente d'un nouveau logiciel. Malgré ces faiblesses, la valeur comptable du stock est évaluée à 845 millions d'euros. Il a, en outre, précisé que, en dépit de l'arrivée à péremption d'une partie importante de celui-ci, aucune dépréciation n'est constatée en comptabilité.
Enfin, M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur spécial, a indiqué que l'insertion de l'EPRUS dans une démarche de performance est encore « balbutiante », ce qui peut s'expliquer par la jeunesse de l'établissement et, de façon plus générale, par la difficile application des principes de la LOLF aux opérateurs. En particulier, aucun contrat d'objectifs et de moyens n'est aujourd'hui signé.
Evoquant ensuite les difficultés rencontrées par l'EPRUS dans sa fonction de logisticien des stocks de produits de santé, il a rappelé que la stratégie d'acquisition de ces derniers ne relève pas de la compétence de l'EPRUS, mais est le résultat de procédures interministérielles faisant notamment intervenir le ministère de la défense et le ministère de la santé. Il s'est ensuite successivement interrogé sur l'adéquation aux besoins des stocks constitués en cas de pandémie grippale, l'efficacité des produits stockés et, enfin, la capacité des laboratoires pharmaceutiques à faire face rapidement à la demande mondiale de vaccins.
Sur la question de la validité des produits, il a indiqué qu'une partie du stock est arrivée ou arrive à péremption, ce qui a conduit le ministère de la santé à solliciter l'AFSSAPS pour évaluer la possibilité d'une utilisation plus longue de ces produits sur la base d'études de stabilité, procédé qui soulève des incertitudes juridiques. L'allongement de la durée d'utilisation des produits pose, en outre, des difficultés en matière de suivi des stocks, un ré-étiquetage systématique des produits n'ayant pas été réalisé compte tenu du coût et des délais nécessaires à ces opérations.
Développant la question du suivi des stocks, M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur spécial, a précisé que le stock géré par l'EPRUS est aujourd'hui réparti sur 72 sites dans des établissements dont le statut et les liens contractuels avec l'établissement public varient : il s'agit de prestataires privés comme des laboratoires pharmaceutiques, d'établissements de santé et d'établissements publics relevant du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur. Or la dispersion et l'hétérogénéité de ces sites posent la question de la traçabilité des stocks. Un schéma général de stockage, qui devrait retenir le principe d'une centralisation accrue, est en cours d'élaboration.
Ce constat posé, M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur spécial, a ensuite évoqué quelques pistes de réflexion. En premier lieu, il s'est interrogé sur l'utilité réelle de la mise en place d'un opérateur dédié à la gestion du « stock national santé », notamment au regard de l'étroitesse de la tutelle exercée par la DGS.
Cependant il a indiqué ne pas être favorable à la suppression de l'EPRUS, compte tenu du contexte actuel et de la relative jeunesse de l'établissement, sans oublier que cette structure exerce une seconde mission, à savoir la gestion de la réserve sanitaire.
Toutefois il a insisté sur les améliorations devant être apportées au positionnement de l'EPRUS au sein du dispositif de gestion des risques sanitaires, ce qui suppose :
- une clarification rapide du partage des responsabilités entre l'Etat, l'AFSSAPS et l'établissement public ;
- un renforcement des liens entre le ministère de la santé, le ministère de la défense et le ministère de l'intérieur, qui pourrait prendre la forme d'échanges d'expériences et de regroupements d'achats ;
- le développement de la coopération européenne, voire internationale, en matière de santé humaine. En dépit de certains efforts, notamment dans la période actuelle, celle-ci est encore balbutiante en raison de l'hétérogénéité des niveaux de préparation des différents Etats-membres et du fait que les questions de santé humaine relèvent, pour l'essentiel, de leur compétence.
En ce qui concerne les faiblesses administratives et budgétaires de l'EPRUS, M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur spécial, a précisé qu'il semble y avoir aujourd'hui une prise de conscience réelle des dysfonctionnements et qu'un début de réponse soit apporté : une convention-cadre avec la DGS vient d'être signée, un schéma de stockage est en cours d'élaboration, un recensement et un contrôle de la qualité des stocks doivent être lancés et un nouvel outil informatique devrait être opérationnel au cours de l'année.
Tout en indiquant qu'il veillera à la mise en place effective de ces instruments indispensables à l'efficacité du dispositif, le rapporteur spécial a évoqué d'autres pistes d'amélioration possibles. S'agissant, tout d'abord, de la gouvernance, il lui paraît indispensable de stabiliser et de professionnaliser les effectifs de l'EPRUS, d'élaborer rapidement un contrat d'objectifs et de moyens et de formaliser davantage les procédures de saisine de l'établissement.
En ce qui concerne les aspects budgétaires, M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur spécial, a indiqué qu'il convient d'affiner les prévisions de dépenses de l'agence, ce qui nécessite un renforcement des fonctions financières de l'EPRUS, la mise en place rapide du protocole de contrôle élaboré par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) auprès du ministère de la santé et, enfin, une politique précise et pluriannuelle de renouvellement du stock. Quant à la question de la valorisation comptable de celui-ci, son amélioration repose sur la fiabilisation de l'inventaire.
Enfin, s'agissant, plus particulièrement, du « stock national santé », il a insisté sur la nécessité de renforcer les liens avec les laboratoires pharmaceutiques et de faire rapidement aboutir les réflexions actuellement menées par le ministère de la santé sur l'élaboration d'un statut particulier des médicaments du « stock national santé ». Ce statut devrait permettre de ne pas fixer de date de validité des produits, mais uniquement leur date de fabrication, en contrepartie d'évaluations périodiques de leur qualité. M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur spécial, a insisté sur la nécessité de veiller particulièrement à ce que ce statut prévoie un partage clair des responsabilités entre l'Etat et les fabricants, ainsi qu'un encadrement satisfaisant des tests de stabilité effectués.
Pour le stockage et la distribution, il a indiqué qu'il est nécessaire de mettre en oeuvre le plus rapidement possible le recensement et le contrôle de la qualité des stocks, d'achever l'élaboration du schéma global de stockage et de passer des conventions avec l'ensemble des prestataires de l'EPRUS, en prévoyant un cahier des charges précis fixant les conditions de conservation des stocks.
a conclu son propos en indiquant que la gestion des stocks de produits de santé ne constitue qu'un maillon du dispositif général de gestion des risques sanitaires. Les deux autres questions importantes sont, d'une part, celle de la capacité d'accueil des établissements de santé et, d'autre part, celle de la gestion de la communication.

a indiqué que les conclusions de M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur spécial, rejoignent le constat qu'elle avait elle-même formulé, en tant que rapporteure spéciale de la mission « Sécurité sanitaire », à l'occasion de ses travaux de contrôle sur le dispositif des agences de sécurité sanitaire. Elle a indiqué que, si le dispositif actuel de gestion des urgences sanitaires fonctionne relativement bien, cela tient à la qualité du réseau d'alerte français. Elle a précisé que, dès la constitution du stock stratégique du ministère de la santé, la question de la péremption des produits s'est posée.

a insisté sur la prolifération des agences dépendant du ministère de la santé et les difficultés de gestion de certaines d'entre elles, notamment l'Institut national du cancer (INCA).

a indiqué que la capacité d'accueil des établissements de santé est également un élément important de l'efficacité du dispositif de gestion des urgences sanitaires.

a précisé que les difficultés rencontrées par le ministère de la santé dans la gestion des agences de sécurité sanitaire se retrouvent également à l'échelon européen, insistant sur les difficiles échanges d'informations entre les agences nationales et les agences communautaires. Il a invité M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur spécial, à participer aux travaux de contrôle qu'il mène actuellement sur la gestion des agences européennes, en tant que rapporteur spécial de la mission « Affaires européennes ».

a précisé, d'une part, que, ponctuellement, la coopération entre Etats-membres de l'Union européenne a pu fonctionner, évoquant notamment l'exemple de la gestion de l'épidémie de méningite qui sévit actuellement dans la région de Dieppe, et, d'autre part, que la question de la coordination des agences de sécurité sanitaire nationales et communautaires a été abordée au cours de la présidence française de l'Union européenne, sans que des réelles avancées n'aient été constatées.

En réponse à la question de M. Philippe Dallier, M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur spécial, a indiqué que, en dépit d'une circulaire relative à l'action des maires dans la gestion d'une crise sanitaire de type « pandémie grippale », l'information et l'association des collectivités territoriales sont encore insuffisantes.

a insisté sur le fait que, contrairement à la santé humaine qui relève pour l'essentiel de la compétence des Etats-membres, la santé animale est un des domaines les plus communautarisés du droit européen. Elle a rappelé, par ailleurs, que cette différence est source de difficultés étant donné les liens étroits entre les thématiques relatives à la santé humaine et à la santé animale, comme en témoigne le risque de pandémie de type « grippe aviaire ».
La commission a ensuite donné acte, à l'unanimité, à M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur spécial, de sa communication et en a autorisé la publication sous la forme d'un rapport d'information.

Puis la commission a entendu M. Michel Charasse, rapporteur spécial des crédits de la mission « Aide publique au développement », pour faire le point sur ses missions de contrôle budgétaire des crédits de coopération de la France au Maghreb et en Afrique de l'Est.
a précisé qu'il a réalisé ces deux missions en juillet 2008 et en mars 2009 dans six pays présentant des profils politiques, économiques et culturels distincts, respectivement au Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) et en Afrique de l'est (République de Djibouti, Ethiopie et Kenya). Les crédits de coopération que la France consacre à ces pays sont également d'ampleur très variable. La dotation budgétaire des services de coopération et d'action culturelle (SCAC) peut ainsi varier dans un rapport de 1 à 16.
Au titre de ses principales observations, qui appelleront des développements ultérieurs devant la commission, il a en premier lieu constaté que l'application des principes d'harmonisation, de complémentarité et de division du travail entre bailleurs se heurte encore à d'importantes limites, telles que l'absence de démarche volontariste en Tunisie, l'interprétation variable de la portée de la Déclaration de Paris de mars 2005, la non participation de bailleurs importants qui ne sont pas membres de l'OCDE, notamment les fonds arabes et la Chine, l'inégale appropriation par les autorités locales, ou la difficulté d'utiliser les circuits gouvernementaux sans prendre de risques financiers excessifs, par exemple au Kenya. Cette coordination pourrait être améliorée si elle était au moins acquise au niveau européen, ce qui n'est pas toujours le cas. Il a également porté une appréciation critique sur l'efficacité et la fiabilité des versements du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et sur l'efficacité de la délégation de la Commission européenne à Alger.
Décrivant l'environnement institutionnel et économique, M. Michel Charasse, rapporteur spécial, a indiqué que les opérateurs économiques français sont confrontés en Afrique de l'Est à une forte concurrence de la Chine et de l'Inde, dont les pratiques commerciales ne sont pas toujours considérées comme loyales. La culture du moins-disant dans les marchés publics peut conduire à évincer des prestataires français, comme en Tunisie, en Algérie ou en République de Djibouti.
Les milieux d'affaires soulignent également certaines faiblesses de la maîtrise d'ouvrage, les difficultés d'accès au foncier et l'insécurité juridique au Maroc, le manque de formation des cadres et techniciens, la rigidité de la réglementation en matière d'exportations et d'investissements étrangers en Ethiopie, l'absence de convention bilatérale d'éviction de la double imposition en République de Djibouti, ou le manque de compétence des commissions techniques d'appels d'offres. La corruption des autorités publiques apparaît problématique au Kenya, où de récents scandales de grande ampleur n'ont guère fait l'objet de sanctions malgré la multiplication des autorités de lutte contre la corruption.
Concernant la stratégie de la coopération française, il a constaté que la concentration sectorielle prévue par les documents-cadres de partenariat est globalement respectée, mais que les engagements financiers à mi-parcours n'apparaissent plus guère crédibles, notamment en Ethiopie et en République de Djibouti. L'impact de la forte diminution en 2009 des crédits d'aide bilatérale imputés sur le programme 209 « Solidarité à l'égard des pays en développement » a en effet été immédiat et sévère dans les trois pays de la Corne de l'Afrique. Les taux de décaissement sont satisfaisants, en particulier au Kenya, mais le niveau des crédits délégués est tel qu'ils ont atteint un étiage en deçà duquel le maintien des services de coopération et d'action culturelle (SCAC) et de personnels pour des montants peu significatifs pourrait être sérieusement remis en question. Il a également exposé la situation particulière de l'Algérie, où la stratégie gouvernementale de désendettement et de refus de prêts prive la coopération française d'outils déterminants et peut conduire à s'interroger sur la pérennité de l'Agence française de développement (AFD) et sur les effectifs de la mission économique.
Il a relevé des incohérences dans la gestion de l'assistance technique, particulièrement en Ethiopie où la responsable d'un futur projet de développement urbain a été nommée alors que ledit projet était menacé, et où le conseiller régional santé serait maintenu en dépit de la demande contraire et réitérée de l'ambassade.
Abordant la mise en oeuvre de la LOLF, M. Michel Charasse, rapporteur spécial, a jugé que les nouveaux outils de gestion et indicateurs de performance représentent un progrès indéniable dans l'amélioration du pilotage et de l'efficience des crédits. Relevant que l'accent est opportunément mis sur les partenariats et l'effet de levier, par la mobilisation des financements externes, il a considéré que la France ne peut être présente dans tous les domaines mais doit préserver sa visibilité et sa crédibilité en assumant un rôle de chef de file ou de co-responsable dans des projets multi-bailleurs. L'appropriation de la démarche de performance et de contrôle de gestion par les postes est en revanche inégale : tardive au Maghreb en 2008, correcte en Ethiopie, encore limitée à Djibouti, et très satisfaisante au Kenya.
Le nouveau logiciel unique PRISME est également perçu comme une avancée significative et le recours à la fongibilité entre actions est entré dans les moeurs, mais la fongibilité asymétrique provoque une certaine réticence des gestionnaires. Il a cependant jugé nécessaire d'intéresser davantage ces derniers aux économies réalisées, en leur en rétrocédant une partie.
Concernant la mise en oeuvre des projets et les subventions des SCAC aux associations, M. Michel Charasse, rapporteur spécial, a souligné que le Fonds social de développement (FSD) est un instrument de coopération qui dispose de nombreux atouts mais peut encore être amélioré par de meilleures synergies avec l'AFD, la recherche de cofinancements, l'octroi d'une première tranche de crédits fixée à 50 ou 60 % du montant de la subvention, plutôt que 80 % comme c'est souvent le cas actuellement, et l'émission de titres de reversement en l'absence de service fait.
Il a déploré que certaines collectivités territoriales françaises, dans le cadre de la coopération décentralisée au Maroc, recourent parfois abusivement aux services du SCAC, au point d'en faire une « agence de voyage ». De même, il a relevé le maintien de subventions, selon lui injustifiées, dans certains pays privilégiés de la coopération française. Il a exposé que l'utilité du Haut conseil de coopération universitaire en Algérie n'est pas avérée et que le SCAC d'Alger a rationalisé ses programmes de bourses, notamment après que des boursiers ont été « perdus de vue ».
Les projets du Fonds de solidarité prioritaire (FSP) en Afrique de l'Est pâtissent quant à eux des fortes incertitudes budgétaires, confortant une impression d'extinction progressive de cet instrument. Il a également considéré que le FSP tend à être décrédibilisé par la prolongation structurelle des projets, en particulier dans le domaine éducatif et pédagogique. Selon lui, cette situation tient autant à une incapacité budgétaire à tenir sur le long terme des engagements qui ont une portée politique qu'aux dysfonctionnements traditionnellement constatés : optimisme excessif lors de la conception, difficultés en cours d'exécution, rotation des assistants techniques, « paperasserie » de multiples conventions de financement...
Il a ajouté que l'opérateur Egide est très critiqué en Ethiopie et au Kenya, car perçu comme trop cher et parfois proche de l'amateurisme, et a exposé des difficultés relatives à trois projets financés par la Réserve pays émergents (RPE) en Tunisie.
a ensuite formulé des observations sur le positionnement et les projets de l'AFD. L'activité de l'agence connaît une forte croissance et une importante diversification dans la Corne de l'Afrique, qui peut avoir valeur de test pour sortir progressivement de la logique du « tout subvention » en Afrique subsaharienne. En revanche, les engagements de l'agence ont été plafonnés en 2008 au Maroc et en Tunisie afin de respecter le ratio bancaire de grands risques.
Il a relevé les dysfonctionnements et insuffisances de certains partenaires locaux, selon lui habituels (lenteur et complexité des appels d'offres, respect parfois approximatif des conventions, rotation des effectifs, lourdeurs du processus décisionnel, engorgement et incapacité à tenir les délais, implication insuffisante de la maîtrise d'ouvrage...) et qui provoquent des retards d'exécution des projets. Il a considéré que l'agence ne menace pas toujours suffisamment d'annuler les restes à verser mais est plus réactive que les SCAC de ce point de vue. Quelques dossiers font l'objet de contentieux pour impayés, notamment en République de Djibouti et en Tunisie.
Il a également formulé les remarques suivantes :
- ses interlocuteurs ont regretté l'hétérogénéité des mesures anti-blanchiment mises en oeuvre par les bailleurs de fonds au Maghreb. L'agence applique en effet les dispositions communautaires, en général plus strictes que la réglementation des banques multilatérales de développement ;
- l'Agence devrait appliquer à ses concours aux ONG françaises les mêmes règles que celles de l'ancienne Mission d'appui à l'action internationale des ONG (MAAIONG), concernant la participation minimale requise de l'association subventionnée ;
- dans certains pays, l'AFD recourt trop largement au système de la « caisse d'avance », qui fonctionne par renouvellement au fur et à mesure de la justification de 70 % des dépenses ;
- le maintien « en sommeil » de fonds d'études et de préparation de projets bloque inutilement des subventions budgétaires. Il serait préférable de les annuler après trois ans d'inactivité ou de mettre en place des fonds d'études à dimension régionale ;
- au Maghreb, Proparco, filiale de l'AFD, est trop positionnée sur l'intermédiation bancaire via des banques locales, au détriment des prêts directs aux PME.
a enfin abordé le domaine de la francophonie et de la coopération culturelle. Les alliances françaises et centres culturels visités en Afrique de l'Est sont confrontés en 2009 à une forte diminution de leurs subventions de fonctionnement. La situation financière des instituts de recherche est également tendue et contraint à accélérer la mobilisation des financements européens. Les alliances françaises d'Addis Abeba et de Nairobi ont cependant une valeur d'exemple, avec un taux d'autofinancement élevé (54 % en Ethiopie, près de 75 % au Kenya), des cours de langue attractifs et une réelle crédibilité auprès des autorités locales et des partenaires. Le centre culturel français de Djibouti affiche pour sa part un taux d'autofinancement insuffisant et une fréquentation disparate de ses événements culturels. De même, l'institut de Rabat a eu une programmation trop élitiste.
Il a considéré que la fusion du centre culturel français et de l'alliance française de Djibouti, dont les locaux se jouxtent, au sein d'un seul établissement à autonomie financière, serait logique et permettrait d'améliorer la lisibilité de l'offre française et les synergies de fréquentation. Il a cependant ajouté que la création des « Espaces France », établissements à autonomie financière procédant de la fusion des SCAC et centres culturels, met en question le positionnement des alliances françaises dans les pays, tels que l'Ethiopie ou le Kenya, où elles se substituent aux centres culturels.
Cet exposé a été suivi d'un large débat.

Répondant à la préoccupation exprimée par M. Jean Arthuis, président, sur les nombreux dysfonctionnements apparents de la coopération française et l'opportunité que la commission des finances « durcisse le ton », M. Michel Charasse, rapporteur spécial, a précisé qu'il avait avant tout insisté sur les aspects négatifs, mais que les motifs de satisfaction et atouts de la coopération française ne manquent pas. Une question centrale est cependant de déterminer si la France a réellement les moyens budgétaires d'apporter une aide efficace dans une Zone de solidarité prioritaire (ZSP) aussi étendue.
Puis en réponse à une observation de M. Jean Arthuis, président, sur le désendettement anticipé de l'Algérie et la constitution d'un fonds souverain dans ce pays, il a indiqué que l'Algérie dispose d'un excédent commercial suffisant pour constituer un tel fonds, bien que l'information demeure encore assez opaque sur ce sujet. Se référant à une mission de contrôle qu'il a effectuée en avril 2007, il a déploré que l'AFD, pour accroître rapidement son volume d'activité, octroie des montants élevés de prêts - certes peu concessionnels - à des pays émergents qui disposent de ressources abondantes et parfois d'un fonds souverain, telle la Chine. L'aide française est cependant aussi tributaire de motivations diplomatiques et politiques ayant trait à la politique extérieure de la France qui relève, selon lui, du pouvoir exécutif.

a corroboré l'appréciation de M. Michel Charasse sur le fait que la forte baisse des crédits dans certains pays peut conduire à remettre en question l'utilité de maintenir des services de coopération. Elle y voit le signe d'une perte d'influence de la France et d'un moindre rayonnement de la francophonie.

a considéré que le contexte actuel impose de supprimer les doublons et de développer autant que possible la mutualisation des moyens, en particulier dans le domaine culturel. Si les difficultés budgétaires actuelles se prolongent, il sera nécessaire de concentrer l'aide française sur ce qui est le plus efficace et le plus « rentable » au plan politique et, le cas échéant, de réviser drastiquement le périmètre de la ZSP pour revenir au champ des pays historiquement liés à la France.

Relativisant la « tradition républicaine » selon laquelle la conduite de la politique extérieure ne relèverait que du pouvoir exécutif, M. Jean-Jacques Jégou s'est interrogé sur la portée réelle de l'aide française, l'identification d'une stratégie ou l'existence d'une instance de pilotage, et sur le rôle de la Commission européenne dans la coordination des actions des Etats membres.

a estimé que le pilotage est assuré par le Gouvernement, notamment au travers du Comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID), mais que les ministres successifs en charge des affaires étrangères et de la coopération ne font pas toujours preuve de suffisamment de courage pour en traduire les orientations auprès des autorités des pays partenaires. Il a ajouté que l'aide de la Commission européenne a été conçue à l'origine pour accompagner l'aide bilatérale des Etats membres, avant qu'elle ne finisse par entrer en concurrence avec ces canaux, voire par tenter de s'y substituer. Si la coordination et la complémentarité européennes s'améliorent sur le terrain depuis quelques années, le rythme d'exécution des projets financés par le budget communautaire et le Fonds européen de développement (FED) demeure insuffisant.

a appelé à faire preuve de grande prudence dans l'analyse de la destination de certaines subventions et à replacer l'aide française dans un contexte de contreparties diplomatiques dont le Parlement n'a pas nécessairement connaissance. De même, certains apports de la France sont peu médiatisés ou comptabilisés, tels que la coopération décentralisée, le temps consacré par les professeurs hospitaliers universitaires au soutien des pays d'Afrique, ou les actions du corps enseignant, qui peuvent contribuer à atténuer la perte d'influence de la France. M. Joël Bourdin a partagé ce constat, notamment dans le cas du Maroc.

a rappelé que la commission des finances fait traditionnellement preuve de prudence et n'adopte pas, dans la plupart des cas, le principe de la publication de ses rapports de contrôle. Il a ajouté constater désormais beaucoup moins d'anomalies dans l'emploi des fonds que par le passé. Malgré une diminution de ses crédits de coopération et les imperfections de la comptabilisation par le comité d'aide au développement de l'OCDE, la France reste un des pays les plus généreux en matière d'aide. Il n'en demeure pas moins que, selon lui, notre pays doit resserrer ses priorités géographiques et cesser une politique de « touche à tout ».

a conclu en appelant les services de l'administration, et en particulier ceux compétents en matière d'aide au développement, à ne pas considérer la revue générale des politiques publiques (RGPP) comme un « exercice de style ».

Puis la commission a entendu Mme Nicole Bricq, rapporteure spéciale, qui a souhaité faire le point sur l'avancement des travaux de contrôle budgétaire menés par elle sur « l'Etat locataire ».
a précisé que cette mission fait suite à sa communication de novembre 2008 sur ce même sujet, et qu'elle s'appuie sur les données collectées par France Domaine relatives aux baux locatifs à Paris et en Ile-de-France pour la location de bureaux à l'Etat. Elle a indiqué que le recensement des baux d'un montant individuel supérieur à 500 000 euros l'a conduite à établir la liste des dix baux dont les loyers rapportés à la surface sont les plus onéreux, en particulier quatre baux à la charge du ministère de la justice, notamment le pôle financier du Tribunal de grande instance de Paris, ainsi que le bail de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES), celui de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie (MILDT), le bail de la préfecture de police relevant du ministère de l'intérieur, le bail de la Direction des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel (DPAEP) relevant du ministère du budget, des comptes public et de la fonction publique et, enfin, le bail de l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux sports, à la charge du ministère de la santé et des sports.
Elle a également souligné l'importance des coûts locatifs supportés par des autorités indépendantes telles que les services du Médiateur de la République, dont les locaux sont anciens et mal adaptés, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) et le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).
a indiqué que la méthode utilisée est celle du contrôle sur pièces et sur place ; le contrôle sur pièces consistant à vérifier des données sur lesquelles travaille France Domaine. Elle a jugé nécessaire une gestion active menée de concert entre le ministère ou l'opérateur locataire et France Domaine, précisant que l'Etat devrait être pilote en la matière, ce qu'il n'est pas actuellement. Elle a ajouté que, dans le cas d'une administration exerçant une mission régalienne, l'achat d'immeubles de bureaux est préférable, à ses yeux, à la location, en particulier dans un marché immobilier en baisse.
Elle a ensuite indiqué que le contrôle sur place s'appuie sur la norme du ratio d'occupation de 12 m2 par agent établie par le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Elle a précisé que ce ratio doit cependant être relativisé et qu'il est nécessaire de tenir compte de la mission de l'administration locataire et de ses réels besoins, certaines recevant un public nombreux (ce qui est, par exemple, le cas de l'AERES), alors que d'autres ont de plus grands besoins d'espace d'archivage (le Médiateur de la République en particulier). D'une manière générale, elle a regretté que les locaux soient trop souvent inadaptés à leur destination.
s'est enfin félicitée de l'impact des contrôles menés sur pièces et sur place. Des efforts incontestables ont ainsi été réalisés, comme en témoigne le fait que la liste initiale des baux les plus onéreux a été réduite, le ministère de l'éducation nationale ayant, à titre d'exemple, réorganisé ses services des ressources humaines et résilié le bail de la rue Auber dans le IXème arrondissement de Paris au 31 décembre 2008. Par ailleurs, elle a souligné que des erreurs matérielles ont également pu être relevées dans le cadre des précédents contrôles, et corrigées, ce qui est le cas de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieure, dont le montant du loyer est en réalité de 550 euros par m2, contre 972 euros dans l'évaluation initialement établie par France Domaine.
Elle a enfin indiqué qu'elle poursuivra, au cours des prochaines semaines, ses contrôles sur pièces et sur place, qui ont vocation à faire l'objet d'un rapport à la commission des finances à la fin du premier semestre de cette année.

après avoir remercié Mme Nicole Bricq, rapporteure spéciale, a évoqué pour conclure cette communication le montant élevé du loyer de la Cour de Justice de la République.

Puis la commission a entendu une communication de M. Philippe Dallier, rapporteur spécial, sur la Délégation interministérielle à la ville (DIV).
a évoqué les évolutions récentes qui ont eu des conséquences importantes sur l'activité de la DIV :
- le phénomène « d'agencisation » illustré par la création de l'agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) en 2003 puis de l'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSE) en 2006 ;
- les prises de position adoptées dans le cadre de la revue générale des politiques publiques. Le conseil de la modernisation des politiques publiques du 4 avril 2008 s'est prononcé pour un recentrage de la DIV sur des missions de coordination et le secrétariat général du CIV (comité interministériel des villes).
Le contrôle budgétaire de la DIV mené sur place le 9 avril 2009 avait pour objectif de comprendre les appréciations négatives portées par ce conseil de modernisation à l'occasion d'un premier bilan et de s'assurer que la DIV était en état de se saisir de ses nouvelles missions.
a donné quelques informations concernant les moyens de la DIV :
- l'effectif compte 71 équivalents temps plein, dont la moitié sont des fonctionnaires ;
- il n'existe pas de services déconcentrés mais 200 délégués du préfet ont été nommés dans les quartiers sensibles au 1er avril 2009 (sur 350 postes ouverts par la loi de finances pour 2009) ;
- la DIV loue, depuis 1993, à la Plaine-Saint-Denis 3 848 m2 pour un loyer annuel de 1,318 million d'euros. Elle héberge également le Conseil national des villes, l'Institut des villes et URBACT ;
- le nouvel organigramme est établi autour de trois pôles, un service de l'administration et des finances, une sous-direction de la mise en oeuvre de l'interministérialité et des opérateurs ainsi qu'une sous-direction des études statistiques, de l'évaluation et de la prospective ;
- du fait de son recentrage, la DIV ne gère directement que des crédits d'intervention résiduels qui concernent pour l'essentiel les collectivités d'outre-mer, des mesures expérimentales, les associations dites « têtes de réseau » ou fédérations nationales, l'apurement des restes à payer sur les opérations d'investissement engagées antérieurement et les dépenses d'évaluation de la politique de la ville.
a ensuite présenté les premières constatations résultant de son contrôle :
- la DIV est une administration en pleine restructuration, un projet de décret de réorganisation de la DIV qui deviendra « secrétariat général du comité interministériel des villes » a été transmis au conseil d'Etat ;
- la DIV a mis au point un outil statistique très performant sur les quartiers (SIG Ville) mais sans doute insuffisamment exploité et valorisé car utilisé surtout lors de la présentation du rapport de l'observatoire national des zones urbaines sensibles (ONZUS). Toutefois, cet outil est accessible sur Internet dans une version simplifiée ;
- la capacité actuelle de la DIV à exercer dans de bonnes conditions -et malgré les efforts du délégué- sa mission de tutelle des établissements publics qui lui sont rattachés (ANRU, ACSE, établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, EPARECA, et établissement public d'insertion de la défense, EPIDE), est problématique ; cette difficulté renvoie à une interrogation plus large sur les moyens d'exercice de la tutelle par les ministères ;
- il est déjà certain que la DIV ne pourra pas atteindre tous les objectifs qui lui ont été fixés pour 2009 et qui comprennent la révision de la géographie prioritaire de la politique de la ville, la renégociation des contrats urbains de cohésion sociale ainsi que la conduite et l'évaluation de la « dynamique espoir banlieues », au sein de laquelle la DIV doit jouer un rôle d'impulsion et d'incitation auprès de tous les ministères engagés.

s'étant interrogé sur le pilotage effectif de la politique de la ville au niveau local, M. Philippe Dallier, rapporteur spécial, a insisté sur la place prééminente du maire. Si des améliorations notables ont été obtenues sur le terrain, grâce au meilleur fonctionnement des agences, ANRU et ACSE, et au recentrage de la DIV qui n'agit plus directement dans la gestion des crédits d'intervention, le pilotage au niveau national reste encore flou et n'a pas été favorisé par l'éclatement récent des structures ministérielles.

a regretté les mouvements permanents de la maquette ministérielle qui se répercutent sur les administrations et les outils de l'Etat. L'existence d'une délégation interministérielle rend inutile un ministère ad hoc.

a déploré la multiplication des structures et leur transformation constante souvent pour de simples motifs de communication.

a jugé inappropriée la séparation des administrations chargées du logement et de l'urbanisme.

s'est interrogé sur la cohérence entre les annonces du Président de la République concernant le Grand Paris et la politique de la ville ainsi que sur la compétence de la DIV en la matière.

a souligné que ces déclarations avaient porté sur les infrastructures et moyens de transport en Ile-de-France plus que sur l'urbanisme ou une politique de la ville globale, incluant des objectifs de cohésion sociale.
La commission a ensuite désigné M. Adrien Gouteyron rapporteur du projet de loi n° 247 (2008-2009) autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital et du projet de loi n° 248 (2008-2009) autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu.
Puis la commission a désigné M. Jean Arthuis rapporteur de la proposition de loi n° 363 (2008-2009) de MM. François Rebsamen, Jean-Pierre Bel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, visant à créer une contribution exceptionnelle de solidarité des entreprises ayant réalisé des bénéfices records ;
Enfin, elle a désigné M. François Trucy rapporteur du projet de loi n° 1549 (AN 13ème législature), en cours d'examen par l'Assemblée Nationale, relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.