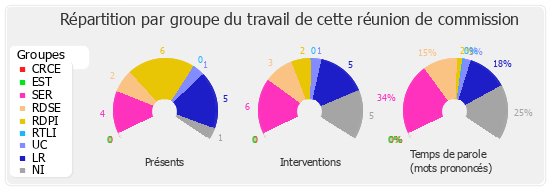Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation
Réunion du 23 octobre 2012 : 1ère réunion
La réunion
La commission entend tout d'abord une communication de M. Yvon Collin et Mme Fabienne Keller, rapporteurs spéciaux, sur le financement des projets d'infrastructure et d'urbanisme (AFD-PROPARCO).

En 2012, vos rapporteurs spéciaux de la mission « Aide publique au développement » ont choisi de faire porter leur contrôle non pas sur un pays, comme c'était l'usage, mais sur une politique transversale : les projets d'infrastructure et d'urbanisme, c'est-à-dire les opérations d'aménagement et de renouvellement urbain, les interventions sur les modes de transport, les réseaux d'eau et d'énergie.
En effet, alors que l'aide au développement est souvent assimilée à une aide d'urgence lors de crises humanitaires, les sommes les plus importantes vont à des projets qui structurent l'espace des pays en développement, notamment dans le domaine des infrastructures et de l'urbanisme. Ces projets n'ont pas toujours bonne presse : n'entend-on pas dire que l'on finance des projets pharaoniques, des « éléphants » éloignés des besoins immédiats des populations ? A l'issue de nos travaux, ces reproches nous paraissent illégitimes : les sommes investies ont un effet multiplicateur, non seulement sur la croissance économique et le progrès social des pays du tiers monde, mais aussi sur l'économie et la société françaises, par leurs retombées directes et indirectes.
Restait à vérifier la qualité des procédures et des évaluations, pour s'assurer du bon emploi des deniers publics. Nous nous sommes plus particulièrement intéressés à l'Agence française de développement (AFD), qui établit des partenariats dans le domaine public, et sa filiale Proparco (Promotion et participation pour la coopération économique), qui soutient des projets d'investissement privés. Dans la mesure où Fabienne Keller et moi-même siégeons au conseil d'administration de l'AFD, nous avons pu décortiquer le processus décisionnel depuis l'identification des projets jusqu'au vote formel des instances délibératives.
Combien de projets sont concernés, et quel est le montant des engagements ? La réponse n'est pas simple, car les cadres d'intervention sectoriels de l'AFD classent différemment les projets. Nous avons examiné trois cadres d'intervention : les collectivités locales et le développement urbain, l'eau et l'assainissement, les transports, soit 2 milliards d'euros par an. Avec les interventions dans le domaine de l'énergie et celles de Proparco, un peu moins de 20 % de celles du groupe AFD, ce sont 3 milliards d'euros qui sont consacrés chaque année aux projets d'infrastructure et d'urbanisme dans le monde - environ soixante-dix projets, infrastructures routières et aéroportuaires, réseaux d'eau et d'énergie...
L'aide française est totalement déliée : le versement d'un prêt ou d'une subvention n'est pas conditionné au choix d'entreprises françaises, ce qu'interdiraient d'ailleurs les règles relatives aux marchés publics dans la plupart des pays du monde. Mais nos partenaires étrangers sollicitent naturellement la France qui compte dans ses domaines de spécialité plusieurs groupes de renommée mondiale. Nos entreprises participent à la réalisation d'équipements qui améliorent la vie des populations locales et jettent les bases du développement. L'AFD évalue aussi les risques sur l'environnement et l'équilibre social des pays, pour réduire autant que possible les externalités négatives.
Les procédures, rigoureuses, associent les équipes locales de l'AFD et les bureaux sectoriels et géographiques de Paris. Les projets font l'objet d'une demande expresse du pays ou de l'entité bénéficiaire. Dès la phase de pré-évaluation, le mode de financement et les impacts sociaux et environnementaux sont pris en compte. Toutefois la procédure d'instruction et de suivi des dossiers peut encore être améliorée et l'AFD revoit ses critères d'appréciation. En outre, si les ambassades sont associées à toutes les étapes de la procédure, les agences de l'AFD sont juridiquement et opérationnellement autonomes, ce qui peut provoquer des conflits. Une fois la décision prise par les instances délibératives de l'AFD ou de Proparco, une convention de financement est conclue. Certains projets sont abandonnés ou ne sont pas menés à terme. C'est plus fréquent dans le cas de Proparco, qui finance des acteurs privés auxquels elle octroie des prêts non bonifiés : une fois sur dix, le client fait défaut - ce fut le cas pour cinq des quelque cinquante opérations que nous avons examinées.
Une partie de l'opinion française juge les interventions de l'AFD et Proparco exorbitantes, étant donnée la situation de notre pays. Cette appréciation ne correspond pas à la réalité. Le taux des prêts non bonifiés de l'AFD est établi en vue d'atteindre l'équilibre économique global et ne comprend pas de marge bénéficiaire. Le différentiel par rapport aux taux de marché est constitué de la bonification versée par l'Etat. Le coût des emprunts de marché de l'AFD est en effet supérieur à celui des principaux bailleurs multilatéraux, la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, la Banque africaine de développement et la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW), qui bénéficie des taux très bas de l'Allemagne. Toutefois, l'AFD possède des avantages comparatifs : elle peut intervenir auprès d'une collectivité sans garantie de l'Etat, en « risque direct » ; elle dispose d'une large gamme d'instruments, subventions, prêts à la concessionalité plus ou moins élevée, financements souverains - prêts directs aux Etats ou avec la garantie de ceux-ci - ou non souverains - pour des entreprises publiques du secteur concurrentiel ou des sociétés privées, sans garantie de l'Etat. L'AFD est capable d'adapter ses schémas financiers à des situations variées, en finançant par exemple la part d'investissement incombant à l'Etat sous forme de concours souverain, et la part incombant au partenaire privé sous forme de prêt classique. Elle peut aussi apporter son appui technique ou institutionnel, notamment en partenariat avec des collectivités territoriales françaises, grâce à son maillage d'agences.
Avec l'AFD et Proparco, notre pays dispose d'instruments opérationnels remarquables. L'augmentation des engagements, qui peut certes exposer la France à une réévaluation de son risque souverain par les agences de notation, n'en est pas moins justifiée par nos ambitions diplomatiques et commerciales.

Après cette analyse générale, nous avons voulu nous rendre sur le terrain, et j'ai mis le cap sur la Tunisie à la fin du moins de juin pour aller observer la conduite opérationnelle de projets. Ce pays, avec lequel nous avons tissé des liens historiques, est depuis longtemps l'un des premiers bénéficiaires de notre aide publique au développement. Il était intéressant de voir comment la France avait adapté ses interventions après le « printemps arabe » : réagissant très rapidement, elle a poursuivi et amplifié son aide, ce que nos amis tunisiens ont apprécié même si des attentes, voire des impatiences, se sont fait jour face à l'urgence des besoins sociaux. Yvon Collin n'a pas pu m'accompagner, mais il avait fait partie d'une délégation du bureau de notre commission qui s'était rendue en Egypte, en Libye et en Tunisie au mois de mars.
Le 17 décembre 2010, l'immolation de Mohamed Bouazizi marquait le début de la révolution tunisienne, qui devait s'achever par le départ du président Ben Ali. Le régime qu'il avait mis en place se caractérisait par la confiscation des ressources nationales au profit de sa famille, par un autoritarisme social et politique au service de la politique dite « du changement ». Le 23 octobre 2011 a été élue une assemblée législative dotée de pouvoirs constituants, qui devait achever ses travaux aujourd'hui même - en fait, ce sera plutôt au printemps. Dans l'attente de l'adoption d'une nouvelle constitution, le pouvoir est exercé par une troïka qui associe les principales formations politiques aux institutions provisoires : le président de la République Moncef Marzouki, le président de l'Assemblée nationale constituante Mustapha Ben Jaafar, et le Premier ministre Hamadi Jebali. La croissance économique s'est arrêtée : le PIB a diminué de 1,8 % en 2011 et n'augmentera au mieux que de 3 % en 2012, ce qui ne suffira pas à faire reculer le chômage et la pauvreté.
Expression du soutien français au processus démocratique, une liste de projets prioritaires a été établie par les experts français et tunisiens. Une aide de 350 millions d'euros a été annoncée en avril 2011 par Alain Juppé à Tunis, puis portée à 425 millions d'euros lors de la réunion des ministres des finances du G8 à Marseille. L'AFD aidera à financer le Plan d'appui à la relance du gouvernement tunisien, auquel contribuent les quatre principaux bailleurs de fonds, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Union européenne et l'AFD. Les fonds français sont destinés aux différents axes du plan de relance : d'une part, 185 millions d'euros ont été décaissés en priorité et affectés à la formation professionnelle ainsi qu'à la préservation et à la modernisation du secteur financier et bancaire, d'autre part, 240 millions d'euros visent à l'amélioration des conditions de vie et au rattrapage économique de certaines régions et populations. La convention de financement portant sur une première contribution de 185 millions d'euros, à décaissement rapide, a été signée à l'occasion du sommet du G8 de Deauville le 27 mai 2011. Le 22 juillet 2011, l'AFD, premier bailleur à débloquer des fonds, a versé la somme considérable de 85 millions d'euros ; le second versement est intervenu en février 2012, après la formation du nouveau Gouvernement.
Les projets d'infrastructure et d'urbanisme occupent une place de premier plan dans ce programme. Une convention de financement de 40 millions d'euros pour le renforcement de la production de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a été signée en mai 2012. Le même mois, une aide de 20 millions d'euros pour le développement des réseaux d'adduction en eau potable rurale a été approuvée par le conseil d'administration de l'AFD. Toujours en mai 2012, l'Union européenne a délégué à l'AFD une subvention de 7,75 millions d'euros pour compléter le Programme national de requalification urbaine (PNRU), déjà financé à hauteur de 40 millions d'euros par l'AFD. A cela s'ajoutent un projet de tramway ou « métro léger » à Tunis, et un autre de RER, le Réseau ferroviaire rapide (RFR).
J'ai pu constater à quel point les réalités tunisiennes étaient proches des nôtres. On assiste là-bas à une course-poursuite entre la route et les transports collectifs, dont la part modale n'est encore que de 25 %. Il faut douze à dix-huit mois seulement pour construire une autoroute, comme celle que l'Arabie saoudite vient de financer entre le centre de Tunis et l'aéroport... J'ai rencontré les responsables de la Société des transports de Tunis (Transtu). Je me suis aussi entretenue avec les dirigeants de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT), ceux de l'Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine (Arru) - bien antérieure à notre Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) ! - et ceux de l'Office national d'assainissement (Onas) et de la Sonede, ainsi qu'avec des urbanistes. Enfin, j'ai eu une entrevue avec Riadh Bettaieb, ministre de l'investissement et de la coopération internationale, l'interlocuteur direct de l'AFD au sein du gouvernement tunisien. J'ai pu apprécier la haute technicité de nos interlocuteurs, dont beaucoup ont été formés en France, mais aussi la force des attentes vis-à-vis de notre pays et l'enthousiasme éprouvé à bâtir un pays nouveau, en relevant les défis du développement.
Le projet structurant RFR se heurtait au choix du chef de file ; le gouvernement a finalement décidé que la société RFR serait chargée de la construction de la ligne et la SNCFT de son exploitation. Cela ressemble fort au partage des tâches entre la RATP et la SNCF...
Il existe en Tunisie un logement social de fait, un habitat populaire issu d'une urbanisation spontanée, sur des terrains cédés au mépris des règles générales de l'urbanisme. La construction des maisons s'échelonne dans le temps, les étages s'ajoutent les uns aux autres à mesure que les familles s'agrandissent. C'est l'Agence de rénovation urbaine qui installe ensuite l'électricité, l'eau et l'assainissement, qui aménage les rues, tandis que le ministère de l'éducation construit des écoles. A Bizerte, j'ai visité le quartier d'Oued Roumine, très à l'écart du centre-ville et du port, où la sécurisation des capacités de production et d'adduction d'eau potable coûtera 40 millions d'euros en cinq ans. Les quartiers de Hached et Bir Massyougha sont situés loin du centre, là où les terrains sont bon marché : leur rattachement aux réseaux de transport et d'approvisionnement coûte donc très cher. Les habitants m'ont accueillie de façon très conviviale, mais ils m'ont fait part de leurs attentes vis-à-vis des institutions tunisiennes et de la France.
En Tunisie, l'AFD intervient aux côtés de la KFW allemande et des bailleurs européens et internationaux, et elle est souvent tête de réseau, même pour des projets où elle ne participe que très faiblement : cela s'explique par les liens noués avec les responsables tunisiens, mais aussi par le fait que notre expertise est reconnue et recherchée. Toutefois, l'action de la France n'est pas toujours suffisamment visible : notre ambassade réclame une communication plus offensive. Le soutien à des micro-projets, en lien avec les ONG tunisiennes, va dans ce sens, alors que le manque de relais dans la société civile avait empêché la France de percevoir les prémices de la révolution tunisienne.
Nos engagements résistent aux changements politiques. En Tunisie, l'AFD a continué à travailler chaque jour lors de la période troublée de la révolution. La pérennité de l'aide est précieuse.
Je souhaite que la France tienne les promesses faites à Deauville il y a plus d'un an, sous le gouvernement précédent : le ministre des affaires étrangères Laurent Fabius m'a donné des assurances en ce sens, mais les contraintes budgétaires sont fortes, qui expliquent certains délais... Je souhaite aussi, bien sûr, que l'on respecte le processus démocratique en cours. Il est important que la transition démocratique se passe bien en Tunisie, car ce pays sert d'exemple au Maghreb et à toute la région. Je crois nécessaire de soutenir des projets structurants dans les pays en développement. Lors d'une conférence sur le Maghreb à Strasbourg, Alexandre Adler appelait la France à renforcer son aide technique et financière aux Tunisiens, dans cette période où des débats de fond traversent la société. J'ajoute que si les touristes sont revenus, la part des Français est en recul.

Considérez-vous que l'argent public ainsi dépensé l'est à bon escient ? Y a-t-il lieu d'adresser à l'administration des remarques ou des questions ? Bref, tout va-t-il aussi bien que vous semblez le dire ?

Je l'ai dit, les aides sont déliées : l'AFD veille au respect des règles applicables aux marchés publics.
Pour répondre au président Marini, l'AFD est un outil très performant, le bras armé de notre aide publique, dans les pays en développement et ailleurs, puisqu'il existe différentes sortes de prestations en fonction de la richesse des pays : aides directes, prêts bonifiés, prêts simples. Les interventions, dont la gamme est particulièrement large, sont très appréciées à l'étranger.
La France a intérêt à rester présente à l'étranger, et pas seulement lors des crises humanitaires. On a longuement débattu des prêts - non bonifiés - accordés par l'AFD en Chine. Lors du tremblement de terre du Sichuan qui a fait 200 000 morts, notre intervention humanitaire a eu des prolongements lors de la reconstruction, et nous avons alors financé, par exemple, des équipements de méthanisation pour les entreprises agricoles. Dans cette région de 80 millions d'habitants, notre présence a été fort appréciée. Les revenus des prêts suffisent à couvrir les frais de fonctionnement de l'AFD en Chine, où travaillent une quinzaine de salariés. Or les interventions de l'agence contribuent à ouvrir des marchés aux entreprises françaises, par exemple dans le domaine du chauffage urbain.

En Tunisie, j'ai eu le sentiment que l'Agence faisait un bon usage des fonds qui lui sont versés : elle accorde surtout des prêts pour des investissements techniques, et quelques subventions d'un montant beaucoup plus faible pour des projets environnementaux ou la formation professionnelle. Le plus souvent, il s'agit de prêts souverains.
Ces interventions profitent-elles à nos entreprises ? La Tunisie réalise 30 % de ses échanges avec la France, dans les deux sens ; de plus en plus d'entreprises françaises sous-traitent là-bas une partie de leurs activités, et les Tunisiens espèrent une nouvelle implantation d'une entreprise automobile européenne. Place de Barcelone, j'ai vu le même tramway Citadis qu'à Strasbourg : Alstom a remporté l'appel d'offres. J'attire votre attention sur les limites de l'aide liée : la gare de Tunis est un conservatoire de vieux trains dépareillés, venus de Hongrie et d'ailleurs, qu'il est très difficile d'entretenir.
La Tunisie est un Etat industrialisé, où le régime Ben Ali, malgré ses graves travers, a fait scolariser tous les enfants et créé des universités dans l'ensemble du pays. Ce n'est donc pas une aide humanitaire que nous apportons, mais un soutien à l'économie du pays et à un Etat en voie de consolidation. Je l'ai dit, la Tunisie sert de modèle, et il est important que la transition s'y déroule correctement. La situation alimentaire n'est pas bonne. La communauté internationale, et la France au premier chef, doivent être aux côtés du peuple tunisien.
Sans doute l'aide publique des pays européens pourrait-elle être mieux coordonnée, grâce à un système formalisé de reconnaissance mutuelle : de même que la France est chef de file en Tunisie, de même la Belgique, l'Allemagne ou le Royaume-Uni pourraient l'être ailleurs, compte tenu de leurs liens historiques avec tel ou tel pays. Cela éviterait les doublons et rendrait l'aide plus efficace : la KFW allemande ne compte que deux représentants pour toute la Tunisie...

J'ai cru comprendre à vos propos que des prêts étaient accordés pour l'implantation d'entreprises automobiles. Finance-t-on des délocalisations ?
La Tunisie est peut-être un exemple de démocratie, mais la fuite des cerveaux ne met-elle pas en péril son économie ?

On peut s'étonner que l'AFD intervienne en Chine et au Brésil : il est cocasse de voir ces pays nous prêter de l'argent pour que nous leur venions en aide. Yvon Collin nous assure cependant que cela a un effet d'entraînement pour les entreprises françaises...
Y a-t-il une vraie synergie entre les aides de l'AFD et celles de l'Europe, auxquelles est consacrée une partie des 20 milliards d'euros de la contribution française au budget de l'Union ?
Des zones d'activité se développent au Maghreb, attirant des industries et des centres d'appels téléphoniques, mais y a-t-il là une vraie stratégie ?

Eric Doligé m'a mal comprise : je disais que la Tunisie réalise 30 % de ses échanges commerciaux avec la France, en partie parce que des industriels français ont localisé une partie de leur production en Tunisie.
Tous les pays en développement souffrent de la fuite des cerveaux, d'autant plus qu'ils sont plus pauvres : paradoxalement, le Nord aspire et pompe les compétences du Sud. La Tunisie est relativement épargnée, même si nos hôpitaux fonctionnent en grande partie grâce à des médecins formés là-bas ; en revanche la situation est dramatique à Haïti, île vidée de ses élites et de sa classe moyenne par la dictature et les chocs climatiques successifs.
Jean Arthuis peut légitimement s'interroger sur la présence de l'AFD en Chine et au Brésil, mais le budget de l'aide au développement pour ces pays inclut les frais d'écolage des étudiants chinois et brésiliens qui étudient en France. Quant aux prêts, ils sont modestes au regard du PIB de ces pays.

Au Brésil, la France et les entreprises françaises sont implantées depuis longtemps. La présence en Chine est plus récente.

Malgré une certaine compétition, la Banque européenne d'investissement, la KFW et l'AFD cherchent bien à coordonner leur action, et ont même décidé de mettre en place un système de reconnaissance mutuelle afin qu'un pilote soit désigné pour chaque opération.

C'est indispensable, car il est terrible pour les gestionnaires de devoir s'adresser à tant d'établissements, pour des projets souvent limités dans le temps et alors que ces pays sont souvent mal organisés. Les Européens n'arriveront pas à s'entendre pour désigner une ambassade chef de file, mais c'est sans doute possible pour l'aide au développement.
A l'issue de ce débat, la commission donne acte de leur communication à M. Yvon Collin et Mme Fabienne Keller, rapporteurs spéciaux, et en autorise la publication sous la forme d'un rapport d'information.
La commission procède ensuite à l'examen du rapport de MM. Yann Gaillard et Aymeri de Montesquiou, rapporteurs spéciaux, sur la mission « Culture » (et article 63).

Nous entamons la longue série des rapports budgétaires. Les crédits de la mission « Culture » vont être présentés par nos deux collègues, qui ont travaillé conjointement.

Avant de détailler les crédits consacrés aux programmes « Création » et « Transmission des savoirs et Démocratisation de la culture », je dirai quelques mots du contexte général dans lequel le budget de la culture a été établi. Pour 2013, la culture recevra 2,6 milliards d'euros, tant en autorisations d'engagement qu'en crédits de paiement - avec une maquette stabilisée par rapport à l'exercice 2012.
En volume, les crédits diminuent de 0,8 % en autorisations d'engagement et de 3,7 % en crédits de paiement : la culture n'a pas échappé à la rigueur et la ministre n'hésite pas à revendiquer ses décisions courageuses. Dès l'été, la presse a dressé la liste des projets abandonnés ou redéfinis : Maison de l'histoire de France, Musée de la photographie à Paris, Centre de restauration, de conservation et de recherche des patrimoines, salle supplémentaire pour la Comédie française, Tour Médicis à Clichy-Montfermeil... La ministre assume ses décisions.

J'ai dit tout le mal que j'en pensais lors de la présentation de mon rapport de contrôle, la semaine dernière, et j'ai vu que beaucoup d'entre vous m'approuvaient. A la suite de cette réunion, vous-même, monsieur le président, avez adressé à Mme Filippetti des questions et observations : je me réjouis que nos réunions aient des effets pratiques sur les relations entre le Parlement et le Gouvernement.

La réunion d'aujourd'hui est consacrée à un autre sujet...
La presse avait évoqué un milliard d'euros d'économies, dont 250 millions dès 2013. La réalité est un peu différente. L'abandon de ces projets est une source d'économies, mais moindres que ce qu'on a pu lire, et en partie virtuelles : comment évaluer précisément ce qu'aurait coûté la réalisation de projets encore à l'étude ? En outre, la mission « Culture » bénéficie de la priorité donnée par le Gouvernement à la jeunesse et à l'éducation : les crédits des écoles d'architecture ou d'art sont majorés et un plan d'éducation artistique et culturelle est engagé. Au total, le bilan financier est moins positif que ne l'a dit la presse.
Un mot des dispositions de la première partie du projet de loi de finances. M. de Montesquiou abordera sans doute la question du Centre national du cinéma (CNC), mais je n'ai pas voulu le suivre, car j'ai beaucoup de sympathie pour cette institution. L'an dernier, la mission d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales avait jugé avec sévérité la multitude de dispositifs relevant du champ culturel. Seule la réduction d'impôts en faveur de la production cinématographique avait été jugée efficiente. Comme le dispositif Malraux, dont l'incidence pour la préservation des centres anciens est reconnue par tous, les Sociétés pour le financement du cinéma et de l'audiovisuel (SOFICA) vont sortir du plafond des niches fiscales. Dans le contexte financier actuel, nous ne pouvons que nous en féliciter.

Nous en féliciter ? Cela accroit le montant de dépenses fiscales, la Commission des finances ne peut guère s'en féliciter !

Sachons faire quelques concessions, il s'agit de la culture...
Je salue aussi les clarifications budgétaires de nature à améliorer la sincérité de la présentation des crédits. J'ai dans le passé dénoncé les modalités de financement de la gratuité de l'entrée dans les musées pour les jeunes, par le déblocage de la réserve de précaution, et selon un calcul qui aboutissait à une surcompensation. Pour la première fois, les crédits correspondants, dont le montant est désormais mieux connu, sont inscrits en loi de finances.
Le versement des bourses aux étudiants, seule dépense de guichet de la mission, donnait lieu chaque année à des opérations internes de gestion en cours d'exercice, car la revalorisation et le dixième mois n'étaient pas financés. C'est désormais chose faite.
Les subventions d'investissement des musées, enfin, ne sont plus considérées comme des subventions pour charge de service public mais bien comme des dotations en fonds propres, ce qui est plus conforme à leur objet.
Les crédits du programme « Création » sont répartis entre 679 millions d'euros d'autorisations d'engagement et 713 millions d'euros de crédits de paiement pour le spectacle vivant, ainsi que 72 millions d'euros d'autorisations d'engagement et 62 millions d'euros de crédits de paiement pour les arts plastiques. L'évolution des dotations consacrées au programme est assez contrastée : les autorisations d'engagement progressent de 2,1 % quand les crédits de paiement diminuent de 1,6 %. Les moyens sont globalement stabilisés, dans l'attente de la loi d'orientation sur la création et le spectacle vivant annoncée par le Premier ministre dans son discours de politique générale. Cette loi viendra-t-elle un jour ?
Les subventions aux multiples opérateurs baissent de 1 % à 2,5 %. En outre, comme les années précédentes, ces opérateurs contribuent à la maîtrise de l'emploi public. Globalement, les dotations diminuent donc de 2,8 %. Les travaux déjà engagés - essentiellement de mise aux normes - se poursuivront.
L'évolution la plus notable concerne les transferts aux collectivités. Il s'agit du coeur du dispositif de soutien au spectacle vivant. Plus de deux mille structures bénéficient d'une subvention, sur des crédits qui sont, pour l'essentiel, déconcentrés, et qui représenteront 283,77 millions d'euros l'année prochaine. La progression apparente de ces crédits est due à la construction de la Philharmonie de Paris - je n'y reviens pas. L'ouverture de 25 millions d'euros en autorisations d'engagement, m'a-t-on expliqué, est destinée à pouvoir faire face à d'éventuels surcoûts...
Les crédits de paiement du programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » diminuent de 2,8 %. Le recul serait encore plus fort s'il n'y avait la priorité donnée à l'éducation et à la jeunesse. Les crédits de l'éducation artistique et culturelle progressent en effet de 7,4 %. Un plan d'accompagnement est mis en place, dont la montée en puissance sera progressive : 2,5 millions d'euros en 2013, 5 millions en 2014, et 7,5 millions en 2015. Nous verrons... Les autres crédits diminuent de manière drastique, qu'il s'agisse du financement des conservatoires, de l'action internationale ou des crédits de fonctionnement du ministère ; mais les opérations en cours seront honorées.
La redevance d'archéologie préventive, sur laquelle porte l'article 63 rattaché, a fait l'objet d'une refonte l'an dernier afin de procurer une recette stable à l'Institut national de recherches et d'archéologie préventive (Inrap). La redevance est désormais adossée à la taxe d'aménagement mais, sous la pression de l'Assemblée nationale, le Gouvernement avait consenti à une exonération en faveur des constructions individuelles - l'Inrap est plutôt impopulaire dans nos campagnes ! Cette disposition est inéquitable : un propriétaire au sein d'un logement collectif, lui, est assujetti à la redevance. Elle entre aussi en contradiction avec la volonté générale d'éviter l'étalement urbain. C'est pourquoi, conformément à la position adoptée par notre commission l'année dernière, je vous propose d'accepter le principe de la suppression de cette exonération, et donc d'adopter cet article sans modification.
- Présidence de M. Jean-Claude Frécon, vice-président -

Le budget de la mission « Culture » n'a pas été sanctuarisé, mais le nombre des emplois sous plafond ne diminue que légèrement, à 15 184 équivalents temps plein travaillé (ETPT) contre 15 204 en loi de finances initiale pour 2012 : suppression de 101 ETP chez les opérateurs, et de 20 autres après la dissolution de la Maison de l'histoire de France ; création de 30 ETP pour renforcer les moyens des écoles nationales supérieures d'architecture et d'art, et de 90 dans le programme « Patrimoines », pour le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) ou le Musée Picasso rénové.
Néanmoins, les crédits du programme « Patrimoines » sont en recul, de 5 % sur les autorisations d'engagement, 10 % sur les crédits de paiement. Plusieurs programmes arrivent à leur terme, comme le centre des archives de Pierrefitte-sur-Seine, qui ouvrira en décembre. Et des projets du précédent gouvernement, en cours de réalisation, sont abandonnés, la Maison de l'histoire de France, ou le Centre de restauration, de conservation et de recherche des patrimoines et le Centre national de la musique qui devait voir le jour sur le modèle du CNC.
Pour le patrimoine monumental, en cette année qui marquera le centenaire de la loi fondatrice de la politique de conservation des monuments historiques, les crédits seront reconduits, et deux initiatives méritent d'être relevées : d'une part, un bilan sanitaire quinquennal des monuments historiques sera établi en début d'année pour rendre compte des investissements menés depuis 2007, et d'autre part, le ministère entend réserver 15 % des crédits alloués à la restauration aux actions de conservation. Le patrimoine étant l'une des richesses de notre pays, et le tourisme une source de ressources financières, cette décision est bienvenue.
Sur l'action « patrimoines des musées de France », des crédits sont ouverts afin d'assurer l'ouverture du MuCEM à Marseille au deuxième semestre 2013 : les crédits de fonctionnement passent de 8 à 17,7 millions d'euros, tandis que les crédits d'investissement diminuent.
L'inscription des crédits de compensation de la gratuité pour les jeunes de 18 à 25 ans dans les musées représente un supplément de dotations de 18 millions d'euros. Le plan d'investissement en faveur des musées territoriaux est consolidé, puisque les crédits de paiement passent de 15,1 millions d'euros en 2012 à 15,6 millions. La politique d'investissement en faveur des centres d'archives départementales et communales est renforcée : les autorisations d'engagement progressent de 2 millions d'euros par rapport à la loi de finances pour 2012. La population porte un intérêt croissant à la généalogie, donc aux archives.
Les crédits prévus pour les acquisitions et l'enrichissement des collections publiques, en revanche, sont divisés par deux, ce qui est considérable, mais sans doute inévitable dans la conjoncture budgétaire actuelle. Les musées sont invités à développer d'autres sources de financement, à l'instar du musée du Louvre dont les salles consacrées au mobilier du XVIIIème siècle seront intégralement financées par le mécénat.
Comment évaluer les sommes consacrées au mécénat culturel ? L'intégralité des charges liées aux déductions des dons faits aux associations est imputée sur la mission « Sport, jeunesse et vie associative ». Comme la Cour des comptes, nous souhaitons que le ministère se donne les moyens de chiffrer précisément la part qui va à la culture. Les sommes en jeu se montent tout de même à plus de deux milliards d'euros. Avant de mobiliser de nouvelles ressources propres et de chercher à mobiliser des partenaires, faisons en sorte de disposer de données précises sur les sommes déjà dépensées en faveur de l'action culturelle.
La mise à jour du répertoire des oeuvres, qui a pris du retard, doit s'achever en 2014. Cela répondra aux préoccupations exprimées par la Cour des Comptes dans son rapport de mars 2011, « Les musées nationaux après une décennie de transformations, 2000-2010 ».
Au sujet du CNC, enfin, notre audition du 3 octobre dernier a suscité des avis divergents, mais montré les limites du modèle économique actuel. Une fiscalité affectée incite l'opérateur à programmer des dépenses aussi dynamiques que le sont ses ressources. Certes, il y a le plan de numérisation des salles et des oeuvres, mais la situation des finances publiques impose de modérer les dépenses du CNC. Il ne me semble pas qu'un prélèvement de 150 millions d'euros, sur une cassette de 800 millions, soit excessif : ce n'est, selon moi, pas suffisant. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de l'examen des articles de première partie. En contrepartie, semble-t-il, le CNC sortirait du dispositif de plafonnement des taxes affectées aux opérateurs. Un autre élément pointé par la Cour des comptes a particulièrement attiré mon attention : il s'agit de l'absence d'évaluation de la pertinence des aides versées par le centre, notamment à l'étranger - il serait souhaitable que les films soient au moins doublés en français, ou sous-titrés. Certains des films ne sont projetés qu'une semaine dans une seule salle - juste le temps de justifier une subvention...

Tout en étant un peu plus sévère que mon collègue sur certaines dotations, je suivrai son avis.

Merci. Les deux rapporteurs pour avis de la commission de la culture souhaitent-ils s'exprimer ?

Le calendrier de travail de notre commission étant un peu décalé par rapport au vôtre, je venais surtout m'informer de votre point de vue sur cette partie du budget. Le budget de la culture concerne des activités économiques essentielles, non délocalisables, indispensables à la cohésion sociale. Il ne s'agit pas d'une cerise sur le gâteau, mais de dépenses stratégiques. Pour reprendre un titre récent du périodique de la Fondation du patrimoine, « l'investissement patrimonial est une dépense pleinement utile à notre économie ». Il faut donc rester vigilant, même si la conjoncture nécessite sans doute de réduire certaines lignes budgétaires. Réduisons, mais avec intelligence et en minimisant les conséquences économiques.
Il n'y a pas de réfaction globale des crédits, il y a des choix. Ainsi le soutien à la création architecturale se développe-t-il, ce qui est extrêmement précieux puisque, depuis le patrimoine historique jusqu'à l'architecture contemporaine, cet art symbolise l'aspiration légitime de nos territoires à une certaine qualité du bâti. Il faut en outre mener à leur terme les opérations engagées qui, après avoir engendré des dépenses d'investissement, exigent à présent des crédits de fonctionnement, musée Picasso, MuCEM, qui ouvrira ses portes en 2013, au moment où Marseille sera capitale européenne de la culture. Nous ferons ce travail d'analyse détaillé au sein de notre commission.

Pour ma part, je me consacrerai uniquement au spectacle vivant. M. Gaillard a indiqué qu'il était préservé et je partage cette appréciation. Vous avez mentionné la Philharmonie de Paris : il aurait fallu l'arrêter lors de l'interruption des travaux qui a duré dix-huit mois ! Dès lors que l'opération a été relancée, la ministre fait à présent un choix assez raisonnable.
Quant au CNC, il aide beaucoup nos collectivités dans la numérisation des salles comme des oeuvres, et participe à la création des films français. Notre cinéma est reconnu dans le monde.

Aujourd'hui, chaque budget doit comporter des sacrifices : on en trouve quelques-uns dans le budget de la culture. Peut-on cerner davantage les sacrifices que représente l'arrêt, l'abandon, le ralentissement de certaines opérations ? Les études engagées sont-elles complètement perdues ?

J'ai plaisir à voir un budget en diminution, et je félicite la ministre pour cela, car ce n'est pas une tâche facile. Je me réjouis que des propositions que j'avais faites l'an dernier - elles n'avaient recueilli d'assentiment ni dans l'hémicycle ni en commission - sur la Maison de l'histoire de France par exemple, soient aujourd'hui formulées par la ministre. A propos de l'audiovisuel aussi, mes propositions budgétaires ont été plus que satisfaites : je demandais 0 % et ce sera cette année une réduction de plus de 2 % ...
Sur le programme « Création », j'ai cru comprendre qu'une seule personne officiait à la fois à la salle Pleyel, à la Cité de la musique et à la Philharmonie, qui représentent des subventions de fonctionnement de respectivement 4,7 millions d'euros, 23,4 millions et 4 millions, sachant que la Philharmonie touche aussi 4 millions de la Ville de Paris. J'aimerais connaître la rémunération de ce directeur de trois structures, dont le budget de fonctionnement me paraît excessif - et je connais les coûts d'un opéra et d'un orchestre, nous en avons un à Massy.
Le montant indiqué pour les dotations en fonds propres, page 132 du projet annuel de performances, ne correspond pas à celui qu'on trouve dans le détail de la page 154. La différence est de cinq millions : où passent-ils ? Ce nouveau concept de dotations en fonds propres correspond-il à une nouvelle politique ? A quoi sert-il ? J'estime enfin qu'on aurait pu ponctionner plus lourdement le CNC, dont l'excédent provient de taxes prélevées sur l'économie française : il est donc juste qu'il contribue aussi aux efforts budgétaires.

A-t-on une idée du montant de dépenses fiscales que représente le mécénat, qui est appelé à prendre toujours plus d'importance ? Nous devons demander au Gouvernement de reclasser cette dépense fiscale sur le budget de la culture pour la part qui lui revient. Avez-vous une idée de l'équilibre relatif du régime de chômage des intermittents du spectacle ? Enfin, j'étais en conflit avec le précédent gouvernement, dont le premier ministre prescrivait la réduction des dépenses publiques, quand son ministre de la culture menaçait les scènes nationales qui n'engageaient pas au moins deux millions de dépenses d'un retrait de l'agrément. Je n'arrivais pas à comprendre cette contradiction. Le nouveau gouvernement y a-t-il mis un terme ?

Le CNC est un partenaire utile pour les communes. Mais il a dans les commissions départementales d'équipement cinématographique une influence hégémonique qui n'est pas normale. Le représentant du CNC est souvent le seul professionnel de la commission et il a en pratique le pouvoir de faire remonter un dossier en commission nationale. Celle-ci est généralement sourde à nos arguments, et ses membres ne connaissent même pas l'économie du cinéma. Elle refuse en deux lignes des projets préparés de longue date par des gens compétents. Les salles parisiennes sont l'unique objet de son intérêt. Or la banlieue parisienne manque cruellement de salles de cinéma, ce qui n'est pas sans contribuer au malaise de la jeunesse. Il serait bon que le ministre revoie le fonctionnement de ces commissions, et mette un terme au rôle occulte qu'exerce le représentant du CNC en leur sein.

Ce budget est courageux et donne l'exemple. J'y relève deux points positifs : l'éducation artistique et culturelle progresse fortement, et les effectifs des écoles supérieures d'art et d'architecture sont étoffés, à une période où l'on a besoin de réfléchir à de nouveaux modes d'habitat et d'urbanisme. Je souhaite appeler l'attention de nos rapporteurs sur le rôle déterminant du CNC dans la modernisation des salles en secteur rural, où les cinémas sont souvent gérés par les collectivités. Sans le CNC, nous n'aurions plus de salles ! S'il y a des économies à faire, ce n'est certainement pas sur l'aménagement du territoire.

Il faut aussi dissocier, à propos du régime des intermittents du spectacle, les artistes en voie de professionnalisation, qui ont besoin de ce statut, et les sociétés qui utilisent ce statut alors qu'elles n'en ont nul besoin.

Parmi les projets abandonnés, on peut citer la Maison de l'histoire de France, le Centre de restauration et de conservation du patrimoine, et le Centre national de la musique, le musée de la photographie, la remise en cause de la subvention pour le projet dit Lascaux 4 ...
A propos de la Philharmonie, il faut avoir à l'esprit que ce projet coûte 386 millions. Certes, on peut dire qu'une grande capitale comme Paris doit avoir une Philharmonie, mais ce projet a été mal conçu, sans étude de marché, sans projet de réseau international, avec un certain amateurisme donc. Les frais de fonctionnement, qui s'élèvent à 80 millions, sont importants. Le rachat de la salle Pleyel a coûté 62 millions d'euros : qu'en faire à présent ? A-t-on vraiment besoin de deux établissements ?

Nous avons eu déjà eu ce débat. Nous n'avons pas connaissance du montant du salaire du directeur que vous évoquiez. Cela n'a pas fait partie des investigations que nous avons faites, ni des questions que le président de la Commission des finances a posées au ministre de la culture. Peut-être pourrait-on l'y ajouter ?

Sur le cinéma : il y a des films qui ne sont même pas projetés ! Un écran pendant une semaine, c'est peu pour justifier une subvention. Et 800 millions de réserve, c'est beaucoup ! Dans la période d'étiage que nous connaissons, il n'est pas nécessaire que le CNC dispose d'une telle cassette. Il est dommage qu'il ait échappé au plafonnement des taxes. Les mesures d'assainissement sont bienvenues.

J'ai dit dans mon intervention que les subventions pour charge de service public sont désormais retraitées en dotations en fonds propres. C'est pourquoi cette ligne apparaît dans les crédits de la mission. Les subventions pour charge de service public diminuent à due concurrence.

les dotations en fonds propres des opérateurs se répartissent entre les deux actions du programme, à hauteur de 12 millions d'euros pour le soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant et 5 millions d'euros pour le soutien à la création, à la production et à la diffusion des arts plastiques.

Ces dotations en fonds propres sont une clarification : il s'agit bien d'une contribution à l'investissement, et non d'un crédit de fonctionnement. La sincérité y gagne.

Sur les dépenses fiscales, la ventilation est très difficile car tout est regroupé sur un seul programme. L'ensemble fait 2,1 milliards. Mais on ne sait quelle part est consacrée à la culture.

Les rapporteurs émettent donc un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission et de l'article 63 rattaché.
A l'issue de ce débat, la commission décide de proposer au Sénat l'adoption, sans modification, des crédits de la mission « Culture » ainsi que de l'article 63 du projet de loi de finances pour 2013.
Puis la commission procède à l'examen du rapport de M. Jean-Marc Todeschini, rapporteur spécial, sur la mission « Sport, jeunesse et vie associative ».

La mission « Sport, jeunesse et vie associative » est de taille modeste : moins de 500 millions d'euros en crédits et aucun emploi depuis le transfert, en 2011, de ses personnels vers la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ». Il s'agit cependant d'une véritable politique, bien identifiée et qui a retrouvé son unité sous l'actuel Gouvernement, sous la direction de Valérie Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
La nature de ses dépenses prédispose la mission à subir la régulation dans un contexte budgétaire difficile : en effet, elle comporte une forte part de crédits d'intervention, sur lesquels il est possible d'exercer un arbitrage.
Les efforts seront sensibles. Néanmoins les crédits de paiement de la mission augmentent de 1 % à périmètre constant en 2013, pour atteindre 0,46 milliard d'euros. Et le projet de loi de programmation des finances publiques prévoit une progression tant en 2014 qu'en 2015. Mais cette évolution recouvre des contrastes : après plusieurs années de baisse, les crédits du programme « Sport » se stabiliseront de 2013 à 2015, quand ceux du programme « Jeunesse et vie associative », sous l'effet de la progression du service civique, augmentent.
Le programme « Sport » regroupe 225,5 millions d'euros d'autorisations d'engagement et 232,2 millions d'euros de crédits de paiement, soit 50,2 % de l'ensemble des crédits de paiement de la mission. A périmètre constant, les crédits de paiement accusent une nouvelle baisse marquée, de 9,1 %. Mais si l'on tient compte des dotations attribuées en loi de finances initiale pour 2012 à la suite d'initiatives parlementaires, la baisse se limite à 5 % par rapport à l'année en cours. Cela reste très significatif et prolonge la tendance engagée depuis deux ans.
A cela s'ajoute un total de fonds de concours de 19,6 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 20 millions d'euros en crédits de paiement. Il s'agit presque exclusivement du fonds de concours de 19,5 millions d'euros du Centre national pour le développement du sport (CNDS) en faveur de l'action « Promotion du sport pour le plus grand nombre ».
Sans vouloir polémiquer, je me dois de souligner qu'au-delà de la crise, la ministre doit aussi gérer les impasses budgétaires laissées par le précédent gouvernement. Ainsi pour les primes des médaillés olympiques, aucune provision n'avait été effectuée en 2012 - ce que j'avais dénoncé. En 2013, il faudra également trouver 6,1 millions d'euros pour les cotisations de retraite des sportifs de haut niveau, non financées par la précédente équipe. Et la situation est encore pire pour ce qui concerne le CNDS.
Pour parvenir à boucler le budget dans ces conditions, le Gouvernement propose, au sein du programme « Sport », des efforts conventionnels, comme la baisse de 5 % des subventions aux fédérations sportives, ou l'étalement des travaux de rénovation de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (Insep). Mais il prend aussi la décision radicale de n'inscrire aucun crédit au titre de la pénalité à verser au consortium gérant le Stade de France pour absence de club résident, alors que 12 millions d'euros étaient inscrits en loi de finances initiale pour 2012 et que la dépense aurait pu atteindre en 2013 jusqu'à 17 millions d'euros.
En première analyse, ce choix m'a surpris. En effet, une telle absence semble poser un problème de sincérité budgétaire, la pénalité résultant d'une obligation contractuelle de l'Etat qui, bien que dénoncée par de nombreux rapports parlementaires, ne s'en impose pas moins à lui. Or, si la somme en question devait être décaissée, l'exécution de ce budget serait mise à mal. Néanmoins, je partage la conviction de la ministre : la situation présente ne peut plus durer, à la fois parce que le montant de la pénalité connaît une évolution dangereuse et parce que cette pénalité résulte d'un contrat fragile - certains éléments pouvant du reste être qualifiés d'abusifs. Le contrat a été signé par le gouvernement Balladur dans une situation tendue, entre les deux tours de l'élection présidentielle de 1995 et à trois ans d'une Coupe du monde de football que la France avait le devoir d'organiser.
La convention est fragile car le Conseil constitutionnel, par une décision du 11 février 2011, a considéré que la loi du 11 décembre 1996 qui l'avait validée était contraire à la Constitution. Cette censure n'a pas entraîné la nullité du contrat de concession liant l'Etat au consortium Stade de France depuis avril 1995. Mais elle a mis en lumière la fragilité juridique de certaines dispositions du contrat, fragilité qui avait justifié la validation législative de 1996.
Au titre de l'indemnité pour absence de club résident, l'Etat, depuis le début du contrat, a dépensé 115 millions d'euros ; or le consortium aurait été à l'équilibre - au moins - sans cette contribution. Une mission vient d'être confiée conjointement à l'Inspection générale des finances et à l'Inspection générale de la jeunesse et des sports pour assister le Gouvernement dans l'examen de la gestion de la concession ainsi que des conséquences financières d'une éventuelle dénonciation du contrat par l'Etat - lesquelles ne seraient pas insurmontables.
Le Gouvernement a su associer aux négociations les fédérations de football et de rugby, qui assurent la rentabilité du stade et qui ont toutes deux des griefs à l'égard du consortium. Tout le monde pourrait s'entendre sur un accord raisonnable.
De fait, si les négociations aboutissent - ce qui semble dans l'intérêt commun et paraît souhaitable - l'Etat n'aurait rien à régler en 2013 au titre de la pénalité. En tout cas, il est clair que ne pas inscrire de crédits en 2013 a contribué à faire réagir tout le monde et dépasser les blocages.
Tout en étant conscient que l'Etat prend un risque dans cette affaire, j'ai fini par approuver l'absence de ligne de crédits proposée pour 2013 et je salue la volonté du Gouvernement de remettre en cause des dispositions contractuelles contestables et très pénalisantes pour les finances publiques.
Par ailleurs, comme l'ont fait ressortir nos travaux menés sur la base d'une enquête de la Cour des comptes, la situation est encore plus grave pour ce qui concerne le CNDS, financé par des crédits non budgétaires. Cet établissement public normalement dévolu au financement du sport amateur et des installations sportives sur le territoire, a été chargé par l'Etat, au fil des ans, de missions sans lien avec cette vocation et incomplètement financées, voire pas financées du tout.
Je pense à la promesse de l'Etat de participer, à hauteur de 160 millions d'euros, à la rénovation des stades de l'Euro de football, à comparer à une recette de 120 millions d'euros. Je pense à la promesse de financer à hauteur de 50 millions d'euros le programme « Arénas » sans la moindre recette correspondante. Et je pense au fonds de concours de 19,5 millions d'euros en faveur du programme « Sport », qui va finir, dans ce contexte, par étrangler la trésorerie du CNDS - et dont la régularité est remise en question par Cour des comptes.
Si rien n'est fait, l'établissement se dirige vers des difficultés financières d'importance. Dès 2012, le déficit s'élèvera à 32 millions d'euros, le fonds de roulement sera quasi nul, et la dette dépassera 480 millions d'euros. En 2013, le déficit sera de près de 40 millions d'euros, et le fonds de roulement sera négatif à hauteur du même montant. Enfin, à l'horizon 2016, le déficit atteindra 50 millions d'euros et le fonds de roulement sera négatif de 175 millions d'euros. Cette impasse, dont le Gouvernement a hérité, appelle des choix. D'une part, un plan d'économies qui ne manquera pas d'avoir des conséquences sur les territoires mais qui semble indispensable. Les dépenses devraient ainsi être réduites de 5 % dès 2013. D'autre part, à titre provisoire, une augmentation des ressources du CNDS - non prévue par le présent projet de loi de finances. Je l'avais souligné l'an dernier, il convient, quand l'Etat charge le CNDS de mettre en oeuvre ses propres engagements, de lui en donner les moyens. Ce n'a été le cas ni pour les travaux des stades de l'Euro 2016, ni pour les Arénas 2015. Ce débat relève néanmoins de la première partie de la loi de finances et ne peut donc être tranché aujourd'hui.
Le programme « Jeunesse et vie associative » regroupe 230,5 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement, soit 49,8 % des crédits de paiement de la mission, en hausse de 7,4 %. Douze dépenses fiscales - essentiellement des niches destinées à encourager les dons - sont en outre rattachées au programme, pour un coût de 2 430 millions d'euros.
Malgré les apparences, de nombreux acteurs consentent des efforts. Ainsi, le Fonds d'expérimentation pour la jeunesse (FEJ), créé par Martin Hirsch, ne recevra pas de crédits. Il sera au contraire sollicité, au travers d'un fonds de concours de 15 millions d'euros, pour soutenir la montée en puissance du service civique. Les partenaires privés du fonds devraient, eux, maintenir leur concours. Le FEJ va désormais achever l'évaluation des quatorze appels à projets qui ont été lancés et, si les résultats le justifient, assurer la transition vers le droit commun. L'objectif sera de capitaliser les résultats probants des expérimentations en vue de leur essaimage dans les collectivités ou auprès des promoteurs volontaires.
Le soutien direct aux associations agréées baisse également, tout comme d'autres crédits, notamment pour l'information des jeunes. Le maintien du financement par l'Etat de postes Fonjep, à hauteur de 24,9 millions, montre toutefois la volonté du ministère de soutenir l'emploi associatif.
En réalité, la poursuite de la croissance du service civique absorbe l'intégralité de la hausse des crédits du programme, et même de la mission : les moyens qui lui sont dévolus passeront de 130 à 160 millions d'euros. Cette hausse, de 23 %, doit permettre de porter le nombre de volontaires de 25 000 à 30 000. Si l'on peut évidemment se féliciter du succès du service civique, né d'une initiative d'Yvon Collin, le dispositif devra toutefois évoluer, pour deux raisons. D'une part, l'objectif ambitieux fixé par le Président de la République d'ouvrir le service civique à 15 % d'une classe d'âge, soit environ cent mille jeunes, pèsera lourdement sur le budget ; d'autre part, la création des emplois d'avenir risque d'entrer en concurrence avec le service civique. Il faudra donc faire évoluer le modèle, proposer par exemple des missions plus courtes ou étalées dans le temps. Martin Hirsch, actuel président de l'Agence du service civique (ASC), n'y est pas fermé. En tout état de cause, il faudra à la fois maîtriser le coût du service civique, et bien distinguer les objectifs et missions du service civique et des emplois d'avenir.
À l'issue de cet examen, et sous réserve des initiatives que pourrait prendre l'Assemblée nationale, je vous recommande d'adopter sans modification les crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative ».

Je voterai contre ce budget. Le désengagement de l'Etat dans le secteur sportif se répercutera implacablement sur les collectivités territoriales. On réduit les crédits des fédérations de 5 % ? Elles réclameront des financements aux conseils régionaux, aux conseils généraux et aux communes ! L'essentiel des équipements et des dotations est financé par des collectivités, mais tout succès sportif se termine par une visite à l'Elysée : jamais un mot de reconnaissance pour ceux qui font vivre le sport dans notre pays. Certaines fédérations disposent certes d'importants moyens, mais d'autres ont de vrais besoins - notamment dans des sports que l'on ne médiatise que tous les quatre ans, quand ils rapportent des médailles ! Ce sont les communes qui en assurent le fonctionnement au quotidien.
Un mot sur le financement des grands investissements. Après la Coupe du monde, la France accueillera bientôt la Coupe d'Europe. Michel Platini à la tête de l'UEFA, quel symbole ! Mais les stades sont loin d'être prêts : à Lyon, les travaux viennent à peine de commencer. Il faut veiller à ce que l'Etat apporte bien sa contribution, même si elle n'est que de 10 %. À l'heure actuelle, il y a partout un problème de financement.
Je félicite le rapporteur pour son analyse sur le Stade de France. La désignation des opérateurs s'est faite dans des conditions scandaleuses. Mais pourquoi n'être pas revenu sur la convention, pendant les cinq ans durant lesquels vous avez été au pouvoir ? Sans pénalité pour absence de club résident, les opérateurs actuels n'auront aucune peine à équilibrer leur budget, quitte à multiplier les évènements non sportifs - mais l'acceptera-t-on ? La fédération de rugby, qui alimente les caisses du Stade de France, veut son propre stade en région parisienne. L'Equipe de France, deuxième client du Stade, rechigne de plus en plus à y jouer car ses joueurs sont sifflés... Le PSG, seul club résident, préfère agrandir le Parc des Princes. Bref, il faut revoir le fonctionnement du stade mythique de 1998 et refuser le chantage du consortium !
Je partage votre analyse sur le CNDS. Quid du grand bassin olympique annoncé d'abord dans le XVIIème arrondissement de Paris, puis en Seine-Saint-Denis ? Le président de la région Île-de-France a même donné une conférence de presse pour l'annoncer, ce qui n'était pas sans m'étonner, étant donné l'état de nos finances...
François Hollande a annoncé cent mille jeunes en service civique. Cela ne se fera pas sans peine ; il faudra aménager le dispositif tout en en préservant le principe.
Autant de raisons de voter contre ce budget.

M. Delattre vient de découvrir quelque chose que nous savons depuis bien longtemps. La baisse du budget du sport a toujours rejailli sur les collectivités territoriales. J'en dirige une depuis huit ans...

Comme parlementaire, vous avez pourtant toujours voté le budget du sport ! On peut regretter que ce budget soit en baisse, mais celui des collectivités le sera également, si bien que les clubs devront faire preuve de responsabilité : pas les petits clubs amateurs, mais les grands équipements.
Le Grand Prix de France de Formule 1 a été organisé en Bourgogne pendant des années. L'Etat ne nous a jamais accompagnés. Il investit des millions dans les Mondiaux de l'hippisme, mais rien dans la Formule 1, alors que notre circuit est grenello-compatible, et que la course rapporte 30 millions d'euros de retombées !
Vous dites que la baisse des crédits du CNDS affectera le moins possible la part territoriale. Cela signifie-t-il moins de crédits pour les équipements territoriaux ?
Enfin, je m'inquiète du regroupement des Centres d'éducation populaire et de sport (Creps). Quel sera leur avenir ? Je ne manquerai pas d'interroger le ministre, sans doute par écrit.

Le CNDS est en grande fragilité financière. Je le déplore.
Le coup de semonce adressé au Stade de France est opportun. Les désaccords pervers entre le consortium, les fédérations et les clubs susceptibles d'y jouer sont insupportables. La suppression des crédits au titre de la pénalité est une excellente mesure. Il faut forcer ces gens à s'entendre, on ne peut gaspiller un tel équipement ! Il est tout aussi déraisonnable que la fédération de rugby réclame son propre stade.
N'oublions pas que la quasi-totalité des ressources du CNDS proviennent du jeu, via la Française des jeux - qui a été taxée pour contribuer à l'aménagement des stades de l'Euro - et, depuis 2010, via les paris sportifs. Une partie importante de la vie sportive en France repose sur un monopole de l'Etat.

Ce budget est un budget de transition, le Gouvernement ayant annoncé une loi cadre de modernisation du sport pour la fin 2013, qui aura sans nul doute des répercussions financières. Certains secteurs sont préservés : le sport pour tous, le sport santé, les aides individuelles aux sportifs de haut niveau. En revanche, l'Etat réduit son apport dans le cadre des conventions passées avec les fédérations sportives. A elles de prendre toutes leurs responsabilités face aux dérives observées en matière de paris ou de dopage. 2013 doit être l'année de la remise à plat des relations entre l'Etat et les fédérations.
La situation du CNDS est très préoccupante, et le moment est venu de prendre des décisions fortes. On a pris l'habitude de demander au CNDS de financer tout et n'importe quoi : son budget dépasse d'ailleurs celui du ministère pour le sport !
Je soutiens la position du Gouvernement vis-à-vis du Stade de France. Le contrat de 1995 a fait la part belle à l'exploitant. Tout le monde a intérêt à trouver un compromis rapidement, car en 2025, l'exploitation du stade revient à l'Etat. Celui-ci n'ayant guère vocation à gérer un équipement sportif, il faudra avoir apuré la situation et que le dossier soit présentable.

Monsieur Delattre, les motifs que vous avez invoqués devraient vous conduire à voter ce budget ! Les collectivités locales ? La réduction de 5 % des subventions aux fédérations que vous avez évoquée ne s'appliquera qu'au soutien au sport de haut niveau, et les fédérations s'attendaient d'ailleurs à une baisse bien plus dramatique. Le Stade de France ? Vous devriez voter pour cette mesure courageuse. Et je ne puis m'empêcher de vous faire remarquer que vous avez été au pouvoir pendant dix ans sans que vous dénonciez la convention ! La France avait besoin de ce stade pour accueillir la Coupe du monde de 1998, d'où la convention. Mais il est évident que l'on ne peut continuer ainsi. Du reste, le consortium et les autres parties prenantes ont eu des réactions très prudentes face à la décision ministérielle.
Mon rapport de l'an dernier évoquait déjà la question d'un stade pour le rugby. L'Etat fait confiance à la négociation, et il a réuni autour de la table les fédérations de rugby et de football. Il est vrai que le PSG réalise des travaux d'urgence au Parc des Princes, mais vu ses ambitions, les recrutements annoncés et les résultats sportifs espérés, on peut penser qu'il y sera bientôt à l'étroit. Bref, il faut avancer sur le dossier du Stade de France.
Le CNDS a été totalement dépouillé. J'ai même volé au secours du ministre UMP l'an dernier en séance publique - en vain - pour demander que l'on puise un peu plus dans les recettes de la Française des jeux pour le financer. On ne donne pas au CNDS les moyens d'investir dans les territoires : cela pénalise les collectivités ! Il faudra trouver des crédits complémentaires pour financer les équipements. Et je ne parle pas des Arenas ni des autorisations de salles décidées à la veille des élections... La « part nationale », qui subventionne notamment le Comité olympique, sera réduite, les investissements dans les territoires aussi, aucun nouveau dossier d'investissement ne sera examiné d'ici la fin de l'année. La ministre avancera des mesures au prochain conseil d'administration du CNDS.
S'agissant du rugby, la fédération a toujours dit qu'elle souhaitait son propre stade.

L'Etat ne peut participer à un équipement autre que le Stade de France en Île-de-France. Il ne faudrait pas que trop de matchs de foot ou de rugby se jouent hors du Stade de France.
Sur le bassin de natation, je n'ai pas d'information particulière.

Je ne doute pas que les stades seront prêts pour la Coupe d'Europe, malgré le retard pris, souvent en raison des nombreux recours. Le CNDS a beaucoup servi à financer les stades, la situation est difficile.

Je remercie notre rapporteur spécial, qui a travaillé dans des délais très courts. Les ministères sont tenus de répondre aux questionnaires des rapporteurs spéciaux avant le 10 octobre, or nous n'avons rien reçu, sur ce budget, avant le 15. Il faut laisser à la commission des finances le temps de travailler correctement.
A l'issue de ce débat, la commission décide de proposer au Sénat l'adoption, sans modification, des crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative ».
Enfin la commission procède à l'examen du rapport de M. Charles Guené, rapporteur spécial, sur la mission « Conseil et contrôle de l'Etat ».

La mission « Conseil et contrôle de l'Etat » se compose de trois programmes indépendants : le Conseil d'Etat et les autres juridictions administratives, la Cour des comptes et les autres juridictions financières, le Conseil économique, social et environnemental (Cese). Sur 625,9 millions d'euros, 59 % sont consacrés à la justice administrative, 35 % aux juridictions financières, 6 % au Cese. Ils sont en principe épargnés par la régulation budgétaire.
Le programme « Conseil d'Etat et autres juridictions administratives » comporte 369,2 millions d'euros de crédits de paiement, en hausse de 5,9 % par rapport à 2012, signe de l'importance accordée aux moyens de la justice administrative. Poursuivant la tendance engagée depuis plusieurs années déjà dans le but de réduire les délais de jugement, les effectifs des juridictions augmentent de 40 ETP en 2013. Afin de rétablir un niveau de performance très dégradé, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a vu ses moyens humains augmenter depuis 2010. Pour 2013, son plafond d'emplois progresse de 23 ETP et passe à 341. L'objectif est de réduire le délai moyen de jugement, qui s'élevait à un an, trois mois et neuf jours en 2009, à sept mois en 2013. Il devrait être de huit mois en 2012, sans dégradation de la qualité de l'instruction. Atteindre l'objectif fixé l'an prochain suppose que l'augmentation des demandes d'asile ne dépasse pas les prévisions et que les avocats soient suffisamment disponibles pour représenter leurs clients. Il faut aussi poursuivre dans la voie de la modernisation et de la professionnalisation.
Le Cese disposera en 2013 de 38,6 millions d'euros, un budget en hausse de 3,15 %. En réalité, cette augmentation est optique : la hausse de 5,57 % des dépenses de titre 2 résulte essentiellement de l'abondement exceptionnel d'1,5 million d'euros au profit de la subvention d'équilibre de la caisse de retraites, consentie par la direction du budget jusqu'en 2015. Hors dépenses de personnel, les crédits du programme diminuent de 8,47 %, grâce à la réduction de 18,6 % des crédits de fonctionnement. Je me félicite que, sous l'impulsion du Président Delevoye, le Cese se soit engagé dans une démarche volontariste d'économies, notamment s'agissant des frais de déplacement et de représentation.
La stratégie de valorisation du patrimoine immobilier du Conseil mérite également d'être saluée. Une augmentation de 47,6 % des dépenses d'investissement permettra la modernisation de l'hémicycle ainsi que les travaux de conservation, d'accessibilité et de mise aux normes du bâtiment. La location du Palais d'Iéna pour diverses manifestations devrait procurer 1,7 million d'euros de recettes, qui alimentent le programme d'investissement à hauteur d'1 million d'euros. Un cercle vertueux est ainsi en train de se mettre en place.
Une partie de ces recettes, 0,5 million d'euros, est affectée au financement de la caisse de retraites, dont l'équilibre, longtemps menacé, est désormais assuré jusqu'en 2017, notamment grâce à la salutaire réforme amorcée en 2011. Le Cese attend en outre le chiffrage de l'abandon de la liquidation automatique à 60 ans de la pension d'ancien membre du Conseil.
Enfin, il met en oeuvre à moyens constants ses nouvelles missions issues de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Jusqu'à présent, une seule saisine parlementaire a été enregistrée, à l'initiative de l'Assemblée nationale.
Le programme « Cour des comptes et autres juridictions financières » est doté de 218 millions d'euros en crédits de paiement, en progression d'1,9 %. Hors dépenses de personnels - 86,8 % du programme - les crédits restent stables en volume, à 28,7 millions d'euros.
La réforme des juridictions financières est désormais une réalité. Le regroupement des chambres régionales des comptes, lancé en avril 2012, devrait être achevé au premier semestre 2013. Les juridictions financières comptent dorénavant vingt chambres régionales des comptes, sept de moins qu'avant la réforme. Difficile toutefois d'en chiffrer l'impact financier. Malgré un surcoût de 4,6 millions d'euros en 2013, principalement dû au dispositif d'accompagnement des départs, le regroupement devrait, à terme, être source d'économies. Je regrette de ne pas disposer d'éléments de chiffrage plus précis. Enfin, la mesure de la performance du programme a été repensée pour englober la totalité des missions des juridictions financières, ce dont je me félicite.
En conclusion, je propose à la commission d'adopter, sans modification, les crédits proposés pour la mission. Je remercie le Conseil d'Etat, le Cese et la Cour des comptes pour la qualité de leurs réponses au questionnaire budgétaire.

Je connais bien cette mission, pour en avoir été longtemps rapporteur spécial. Je salue l'effort fait par le Conseil d'Etat et la CNDA pour réduire la durée d'instruction des affaires. La hausse des effectifs décidée il y a deux ans était destinée à éponger le stock, qui était tel que la durée moyenne augmentait continument. A présent, la durée diminue, je suis heureux de cette évolution positive.

Elle est remarquable : en trois ans, on a gagné trois mois. L'objectif est de parvenir à six mois. En matière d'asile, un mois de gagné représente 15 millions d'euros. Le Conseil d'Etat comme le Gouvernement y gagnent. Le goulot d'étranglement se situe au niveau des avocats, qui ne sont pas assez nombreux pour traiter les dossiers. C'est une piste de réflexion intéressante.
La commission décide de proposer au Sénat l'adoption, sans modification, des crédits de la mission « Conseil et contrôle de l'Etat ».