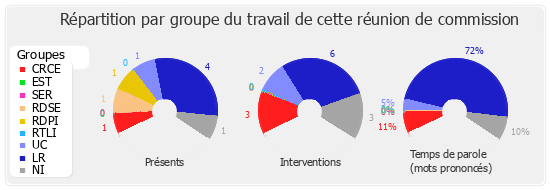Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation
Réunion du 10 octobre 2012 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
La commission procède tout d'abord à l'examen du rapport de Mme Michèle André, rapporteure, sur le projet de loi n° 788 (2011-2012), autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.

Nous sommes aujourd'hui réunis afin d'examiner le projet de loi visant à approuver l'avenant à la convention fiscale de suppression des doubles impositions entre la France et les Philippines, signé le 25 novembre 2011.
Il s'agit du quarante-quatrième projet de loi de ratification présenté devant notre commission depuis 2009. Il intervient dans un contexte difficile de crise, alors que l'évasion fiscale a été dénoncée par la commission d'enquête sénatoriale présidée par Philippe Dominati et dont le rapporteur, Éric Bocquet, a rendu ses conclusions en juillet dernier.
Face au constat dressé par cette commission, j'ai tenu à examiner, non seulement l'environnement juridique philippin, mais aussi son cadre financier.
Cet avenant n'a qu'un seul objectif : permettre la coopération fiscale aujourd'hui bloquée en raison de stipulations conventionnelles obsolètes. En effet, la convention franco-philippine date de 1995. L'article relatif à l'échange de renseignements ne comprend pas la clause relative à la levée du secret bancaire qui a été ajoutée au modèle de convention de l'OCDE en 2005.
Or, cette stipulation est essentielle car ce pays pratique le secret bancaire. Le secrétariat de la commission des finances a interrogé le Bureau du contrôle fiscal de la Direction de la législation fiscale du ministère de l'économie et des finances qui a confirmé qu'en l'état actuel, aucune coopération fiscale n'était possible. Seule la modification de la convention permettra d'imposer aux autorités philippines d'échanger des renseignements, même si les informations sont détenues par une banque ou un établissement financier.
Si la ratification de l'avenant apparaît donc comme nécessaire, elle n'est toutefois pas neutre en termes de conséquences. Certes, la transparence fiscale s'en trouvera renforcée. Cependant, les Philippines seront retirées de la liste française des Etats et territoires non coopératifs.
Cette liste a été établie en 2010 sur la base de celle de l'OCDE. A cette époque, les Philippines avaient quitté la liste noire pour figurer sur la liste grise des Etats qui, bien qu'ayant pris l'engagement de coopérer, n'avaient pas encore conclu les douze accords requis.
Or, vous avez tous en mémoire l'examen du projet de loi tendant à ratifier la convention franco-panaméenne, rapporté par notre collègue Nicole Bricq, qui avait conduit au rejet du texte devant le Sénat. Le contexte est aujourd'hui différent.
Le Forum mondial sur la transparence fiscale avait alors constaté de graves carences dans le cadre juridique panaméen empêchant toute coopération fiscale. Ce n'est pas le cas des Philippines. Elles ont été évaluées positivement en juin 2011. Leur système juridique a été jugé comme globalement satisfaisant par le Forum mondial.
Parmi les progrès constatés, et j'insiste, c'est certainement l'avancée la plus importante, les Philippines ont adopté en 2009 des dispositions législatives dérogeant au secret bancaire dans le domaine de l'assistance internationale.
En conséquence, si celui-ci est maintenu en matière domestique, il sera levé dans le cadre des demandes formulées au titre de la coopération fiscale dès que l'avenant sera ratifié.
Ensuite, la rédaction de l'avenant est plus stricte que celle du modèle OCDE. La France a obtenu l'insertion d'un paragraphe prévoyant que les Philippines doivent « prendre les mesures nécessaires afin de garantir la disponibilité des renseignements et la capacité de son administration fiscale à accéder à ces renseignements et à les transmettre ».
Rappelons aussi qu'aucune contrepartie à la mise à jour de la convention n'a été accordée par la France.
La signature de l'avenant est intervenue sept mois après son paraphe afin de vérifier la mise en oeuvre réglementaire de la dérogation législative au secret bancaire. Les textes d'application ont été étudiés par le secrétariat de la commission des finances et sont annexés au rapport.
Enfin, toujours au titre des éléments en faveur de la ratification, il convient également de souligner la volonté politique exprimée par le nouveau président, Benigno Aquino, de procéder à une « chasse contre l'évasion fiscale ».
Ce n'est pas pour autant un blanc seing que nous accordons ici. En effet, le cadre normatif philippin peut encore être amélioré. Le Forum mondial a recommandé que la législation philippine soit modifiée afin d'imposer aux mandataires, non soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment, de détenir les informations relatives aux bénéficiaires effectifs des titres de propriété pour lesquels ils agissent.
Les Philippines seront, par ailleurs, à nouveau évaluées lors de la seconde phase, mise en oeuvre le premier semestre 2013 par le Forum mondial. Cette nouvelle étape permettra d'apprécier concrètement l'état d'avancement de la coopération et pas uniquement l'environnement juridique.
Nous verrons alors dans quelle mesure ce pays pourra surmonter, non seulement sa culture du secret bancaire, mais également l'éventuelle opposition de certains acteurs économiques liés à l'influence des oligarchies.
Vous l'avez compris, notre vigilance sera suivie d'effet, si besoin est. L'absence de coopération fiscale sera sanctionnée par la réintégration sur la liste française.
En conclusion, sous réserve des observations précédentes et de la vigilance de la commission des finances manifestée dans le cadre de l'examen des accords fiscaux, je vous propose d'adopter le présent projet de loi visant à approuver l'avenant à la convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, conclu avec les Philippines.

J'aimerais tout d'abord connaître la réalité de la présence économique française aux Philippines. Quelle est la nature des activités qui y sont menées ? Le sujet de la fuite des capitaux nous préoccupe. Sur ce point je prends acte des arguments en faveur de la ratification ainsi que de la bonne volonté du Gouvernement philippin dans sa lutte contre l'évasion fiscale. Cependant, de quelles garanties disposons-nous quant à la réalité de ces engagements politiques ? Que se passera-t-il dans une année si aucun progrès n'a été réalisé, notamment en matière de levée du secret bancaire ? J'observe, en effet, que, contrairement par exemple à Malte ou au Japon, la disponibilité des informations telles qu'évaluées par le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales n'est pas totale, même si des progrès ont été constatés. J'émets donc des réserves quant à la capacité pleine et entière de ce pays à échanger les informations demandées.

Sur le premier point, l'étude d'impact jointe au projet de loi précise qu'« aucune banque française n'a de licence bancaire aux Philippines, ni n'est actionnaire de banques philippines. BNP Paribas et Crédit Agricole sont uniquement des « offshore banking units » supervisées par la Banque centrale, qui ne peuvent opérer qu'en devises, pas en pesos ».
Quant à la présence française, la part de marché française aux Philippines a progressé de 1,55 % à 1,65 %. Elle demeure donc modeste, même si elle est l'une des plus élevées dans la zone ASEAN. Parmi la trentaine d'entreprises les plus importantes figurent la société Teleperformance, entreprise de sous-traitance de services aux entreprises à l'étranger ou « call centers », TOTAL, AXA, Essilor, Lafarge, L'Oréal, Schneider, ainsi que les marques de luxe (LVMH et Lacoste...), quelques bureaux de représentation ou commerciaux (International SOS pour les services médicaux, Alstom, etc.).
L'enjeu de cette ratification est qu'en l'état des stipulations conventionnelles en vigueur, nos administrations fiscales ne peuvent obtenir aucun renseignement. En cas d'absence de coopération, ce pays réintégrerait toutefois la liste française des Etats et territoires non coopératifs. La ratification constitue donc une étape préalable nécessaire afin d'imposer aux Philippines l'obligation d'échanger des renseignements en matière fiscale. Vérification en sera faite.
Nous serons bien entendu vigilants quant à l'effectivité des engagements des Philippines en matière de transparence fiscale. L'étude du cadre normatif philippin tel qu'observé par le Forum mondial a recommandé que soit améliorée la disponibilité des informations détenues par les mandataires qui ne sont pas soumis aux obligations imposées dans le cadre de la lutte anti-blanchiment. Nous connaissons également le poids des oligarchies. Nos échanges avec les représentants du Forum mondial conduisent à la même conclusion quant à la nécessité de s'engager dans cette voie conventionnelle. Par ailleurs, le Forum mondial procèdera, en 2013, à l'examen de la phase dite « 2 » qui évaluera la conformité des Philippines à ses engagements en matière de transparence, après avoir constaté la mise en place du cadre normatif lors de la phase « 1 », en juin 2011.
La commission adopte le projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, M. Eric Bocquet s'abstenant.
Elle propose que ce texte fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifié en séance publique, en application des dispositions de l'article 47 decies du Règlement du Sénat.
Puis, la commission procède à l'examen des motions déposées sur le projet de loi n° 23 (2012-2013) autorisant la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire.

Nous avons été saisis de trois motions de procédure sur le projet de loi autorisant la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) au sein de l'Union économique et monétaire. La première, déposée par nos collègues Jean-Pierre Chevènement et Pierre-Yves Collombat, tend à opposer l'exception d'irrecevabilité, la deuxième, déposée par les membres du groupe communiste, républicain et citoyen, tend à opposer la question préalable et la troisième, déposée également par les membres du groupe CRC, est une motion de renvoi en commission. Ces motions ne devraient être examinées en séance publique que jeudi 11 octobre dans la matinée mais, en accord avec le Président et le Rapporteur général, je vous propose de nous prononcer dès maintenant sur leur sort.

Je vous propose d'émettre un avis défavorable à chacune de ces trois motions afin de respecter le vote de notre commission qui a adopté sans modification le projet de loi autorisant la ratification du TSCG, au cours de sa réunion du 9 octobre 2012.

Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer hier, en dépit de la complexité de ce texte, je considère qu'il est nécessaire d'instaurer des contraintes budgétaires, en particulier si nous voulons assurer une certaine solidarité monétaire. C'est pourquoi, je voterai contre ces trois motions.

Le groupe socialiste suivra l'avis du rapporteur général et votera contre ces trois motions.

Sans surprise, je soutiens ces motions, dont deux sont issues de mon groupe politique. Nous aurons l'occasion de nous exprimer de manière plus détaillée sur le fond en séance publique, mais je garde en mémoire le cas du traité établissant une constitution pour l'Europe (TCE), adopté en 2005 par 92% des parlementaires réunis en Congrès alors que 55 % des Français s'étaient prononcés contre. Il est d'ailleurs fort dommage que le Gouvernement n'ait pas choisi la voie du référendum, alors que ce projet de loi engage encore davantage notre nation dans une logique européenne qui exclut toute dimension sociale et dont l'issue est une continuelle dégradation de la situation des peuples.
La commission émet un avis défavorable sur les motions n° 1 tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité, n° 2 tendant à opposer la question préalable et n° 3 tendant au renvoi en commission.
La commission entend ensuite une communication de M. François Marc, rapporteur général, sur les suites à donner à la table ronde sur le crédit immobilier de France.

La semaine dernière, nous avons tenu une table ronde sur la situation du crédit immobilier de France et les conséquences de la cessation programmée de son activité.
Nous avons été nombreux - j'ai notamment le souvenir des interventions de François Rebsamen, Edmond Hervé, Marie-France Beaufils, Francis Delattre, Eric Bocquet ou encore Jean-Pierre Caffet - à considérer que le dossier ne pouvait pas en rester là.
Certains journaux croient même savoir que la Commission européenne aurait rejeté le plan d'aide au CIF.
Il y a deux sujets sur lesquels il me semble que nous pourrions poursuivre la réflexion et prendre une initiative dans le cadre du projet de loi de finances pour 2013 :
- comment préserver le savoir faire et les compétences qui existent aujourd'hui au sein du personnel du CIF ?
- comment faire en sorte que le public de l'accession très sociale à la propriété continue d'avoir accès au crédit immobilier ?
Sur le plan de la méthode, je me propose de coordonner nos travaux puisqu'il faudra à la fois aborder des questions transversales de fiscalité immobilière et de réglementation bancaire.
Je compte adresser des questionnaires à toutes les parties intéressées et organiser des réunions de travail, auxquelles seront conviés tous les commissaires qui souhaiteront y participer.
En ce qui concerne le calendrier, je pense que notre objectif doit être de formuler nos propositions dans le cadre de l'examen de l'article 66 du projet de loi de finances pour 2013, relatif à la garantie de l'Etat au CIF.
Cet article est rattaché à la mission « Engagements financiers de l'Etat ». Nous verrons si le calendrier d'examen de la mission est compatible avec le rythme de nos travaux et le cas échéant, si notre collègue Jean-Claude Frécon, rapporteur spécial de ladite mission, en est d'accord, nous pourrons dissocier le débat sur les crédits et celui sur l'article 66, dont il faut prévoir qu'il dépassera largement la seule question de l'octroi de la garantie.
Mes chers collègues, seriez-vous d'accord pour procéder ainsi ?

Je tiens à insister sur les deux dimensions de ce dossier : la fonction crédit du CIF et l'avenir de son personnel. Car, si nous pouvons apporter des solutions techniques au maintien de la fonction prêteur du CIF, nous ne devons pas, pour autant, négliger d'envisager des solutions concrètes pour son personnel.

Pour ma part, je souhaiterais connaître la date ainsi que les arguments de la décision de rejet de la Commission européenne.

Cette information, que le Gouvernement ne confirme pas, a pour source un article du journal « Le Monde », daté du 9 octobre dernier, dans lequel les journalistes correspondants à Bruxelles font état d'un rejet pour dossier incomplet. Il est indiqué cependant que les négociations se poursuivraient entre Bercy et la Commission européenne.
En réponse à l'inquiétude de notre collègue Yannick Botrel, en tant que membres du pouvoir législatif, nous avons non seulement la possibilité d'apporter des aménagements législatifs mais également la faculté de contribuer à éclairer le pouvoir exécutif sur les perspectives d'avenir de l'ensemble des salariés du CIF.

Nous sommes d'accord pour dissocier l'examen des crédits de la mission « Engagements financiers de l'Etat » de l'article 66, et si besoin de réserver ce dernier jusqu'à l'examen des articles non rattachés de la seconde partie.

Lors de cette table ronde, j'ai fait partie des parlementaires qui ont appelé de leurs voeux la constitution d'un groupe de travail sur le CIF et je vous demanderai de vous souvenir du déroulement de cette réunion.

Je considère que notre action doit rester dans le cadre du projet de loi de finances pour lequel nous sommes réellement en capacité d'agir à court terme.
Puis, la commission procède à l'audition pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes, transmise en application de l'article 58-2° de la LOLF, sur les frais de justice.
- Présidence de M. Philippe Marini, président -

L'enquête d'aujourd'hui concerne « les frais de justice » et s'inscrit dans le prolongement d'une précédente mission que nous avions confiée à la Cour en 2005, sur les frais de justice pénale. Nos rapporteurs spéciaux, Roland du Luart à l'époque et Edmond Hervé désormais, suivent avec une grande attention cette question majeure pour le bon fonctionnement du service public de la justice.
En effet, sans expertise, sans moyens techniques, il n'est ni enquête, ni instruction, ni suivi efficace de quoi que ce soit. Le service public de la justice a besoin de son intendance, mais cette intendance doit être moderne et répondre aux attentes, notamment technologiques, d'aujourd'hui.
La précédente étude de la Cour, conjuguée aux effets de la LOLF, avait permis d'initier une meilleure maîtrise des frais de justice, dans un contexte de fort accroissement des besoins et donc de la dépense. Je forme le voeu que cet effet vertueux puisse à nouveau opérer cette année.
Pour cette audition, nous accueillons pour la Cour des comptes M. Jean-Pierre Bayle, président de la quatrième chambre... et je crois pourvoir dire ancien sénateur ?
M. Jean-Pierre Bayle, président de la 4ème chambre de la Cour des comptes. - J'ai en effet été sénateur pendant neuf ans, M. le Président.
Vous êtes accompagné du président de la 3ème section de la chambre, compétente en ce qui concerne le ministère de la justice, M. Patrice Vermeulen, et de M. Jean Pierre Lafaure, respectivement contre rapporteur et rapporteur.
Nous entendrons également, au titre du ministère de la justice, Mme Véronique Malbec, directrice des services judiciaires, et pour le ministère de l'intérieur, M. Jérôme Bonet, conseiller judiciaire du directeur général de la police nationale, ainsi que le Général Michel Pattin, sous-directeur de la police judiciaire à la direction générale de la gendarmerie nationale.
Enfin, eu égard au caractère budgétaire du sujet, nous entendrons également, pour la direction du budget, M. Julien Dubertret, directeur, et M. François Tanguy, sous-directeur des dépenses de l'Etat et des opérateurs pour la direction générale des finances publiques.
Cette audition a également été ouverte à l'ensemble des commissaires des lois, ainsi qu'à la presse, et est retransmise sur le site du Sénat.
Avant de passer la parole au rapporteur spécial, Edmond Hervé, je tiens à remercier Jean-Pierre Bayle, ainsi que ses collaborateurs, pour la qualité du travail accompli.

M. le Président, mesdames et messieurs, nous abordons un sujet qui touche à la qualité même du service de la justice. C'est en vertu de ce principe de qualité qu'existe la liberté de prescrire du magistrat.
Mais, lorsque l'on constate sur les dix dernières années une forte augmentation des frais de justice, conjuguée à un écart croissant entre les prévisions et les dépenses réelles, qui porte atteinte au principe de sincérité budgétaire, il est normal que la commission des finances s'interroge.
Je vous remercie, M. le président, d'avoir sollicité la Cour afin qu'elle établisse un nouveau diagnostic, après celui de 2005. A titre personnel, je tiens à souligner l'extrême qualité du rapport qu'elle nous a remis.
M. le président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, la Cour était déjà revenue, dans un rapport public annuel récent, sur les frais de justice. Ce sujet fait en effet partie de ses préoccupations anciennes, de par ses implications nombreuses, notamment pour le bon fonctionnement des juridictions, mais aussi en raison de l'évolution des techniques d'investigation judiciaire et des dispositions de la procédure pénale.
La Cour a formulé plusieurs recommandations que je pourrai détailler tout à l'heure, au cours de nos échanges, si vous le souhaitez.
Cette enquête, que vous nous avez demandée fin 2011, a nécessité un travail important auprès du ministère de la justice, du budget, de la police nationale et de la gendarmerie nationale. La Cour a appliqué sa procédure contradictoire habituelle, sur laquelle je ne reviendrai pas.
Les frais de justice sont une dépense dont les conditions de prescription et de mise en oeuvre, ainsi que le coût final, dépendent de facteurs spécifiques qu'il faut rappeler.
Tout d'abord, la liberté de prescription du juge, qui est garantie par la Constitution.
Ensuite, l'évolution des normes, particulièrement riche au cours de la période étudiée par la Cour, que ce soit à l'initiative du Gouvernement ou du Parlement.
Enfin, l'évolution des techniques d'investigation, dans le cadre d'une « culture de la preuve », toujours plus perfectionnées, qui apportent sécurité et efficacité. Celles-ci reposent directement sur le budget des frais de justice, ce qui rend nécessaire leur maîtrise, tant en volume qu'en coût unitaire, au moyen de procédures adéquates.
La Cour a tracé quelques lignes directrices.
La maîtrise des frais de justice, sur la base de dotations initiales réalistes, ne pourra être atteinte par la seule contrainte budgétaire. Le ministère de la justice doit poursuivre la modernisation de ses pratiques, dans le respect de la liberté du juge, et mener des réformes profondes de rationalisation de la dépense.
La non maîtrise des frais de justice crée une insécurité budgétaire qui peut avoir, à terme, une incidence sur le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Leur total est passé de 379 millions d'euros en 2006 à 537 millions en 2011, soit une augmentation supérieure à 40 %. Ils représentaient 23 % des dépenses de fonctionnement du ministère de la justice en 2006 contre 28 % aujourd'hui.
Plusieurs actions doivent être menées.
Tout d'abord, dans l'intérêt du bon fonctionnement du service de la justice, les crédits budgétaires doivent être établis à un niveau adéquat, dès la loi de finances initiale. Il faut mettre fin à ce que nous avons appelé « la sous-budgétisation » et que la direction du budget persiste à qualifier de « surconsommation récurrente ». Notre désaccord avec elle sur le caractère réaliste des prévisions faites a persisté après la contradiction. Dans les faits, tout se passe comme si nous étions revenus au système des crédits évaluatifs.
D'autre part, pour une maîtrise durable de la dépense, il faut porter une attention particulière aux réformes qui sont menées, notamment en matière pénale. Les frais de justice y afférant sont passés de 263 millions d'euros en 2006 à 400 millions en 2011. A cet égard, les études d'impact des projets de loi devraient se soucier davantage des effets sur la dépense des frais de justice et le ministère de la justice ne doit pas hésiter à mener des expérimentations préalables. Il faut également porter une attention particulière aux amendements, qui ne sont pas soumis à la procédure d'étude d'impact.
Enfin, à côté de la maîtrise des techniques nouvelles d'analyse, évoquées précédemment, et d'une meilleure maîtrise des coûts de traduction, comme ont pu le faire d'autres administrations, il faudrait faire diminuer le nombre de mémoires de frais de justice - estimé à environ 3 millions - et rationaliser le circuit de traitement des dossiers, via des outils informatiques performants.
La réduction de la volumétrie conditionne en effet la mise en place d'un circuit de paiement rénové et en particulier le basculement sous « Chorus ». Cette dématérialisation peut également permettre une plus grande efficacité du travail judiciaire proprement dit, ainsi que des économies en personnel administratif.
Pour parvenir à cette rationalisation, la Cour a formulé quatorze recommandations, mais je me limiterai à en présenter les principales.
La Cour préconise la modernisation des services informatiques, qui doit permettre la dématérialisation et l'automatisation de la gestion. Elle encourage la conclusion de marchés multi-attributaires, afin d'optimiser le coût et la qualité des prestations. Elle appelle de ses voeux une amélioration de la tarification. Elle insiste particulièrement sur la sensibilisation des prescripteurs aux coûts de la prescription. Elle recommande l'extension de la procédure de certification pour les prestations tarifées et l'amélioration du recouvrement des frais de justice, notamment en ce qui concerne la justice commerciale.
Nous soulignons véritablement la nécessité pour les fonctionnaires du ministère de la justice d'enrichir leur approche juridique des frais de justice d'une approche économique. Il faut accroître la professionnalisation et la responsabilité des gestionnaires et des prescripteurs, par des actions de formation et par la diffusion de bonnes pratiques, ou la mise en place de référents.
En conclusion, la Cour a montré le caractère dynamique de l'évolution de la dépense, ainsi que les difficultés à la maîtriser. Le ministère de la justice s'est engagé dans la voie de la réforme, et à la faveur de dotations budgétaires plus réalistes, les frais de justice ne devraient plus constituer l'élément de risque que la Cour a relevé dans son audit des finances publiques de juillet dernier. Il reste pour cela à réaliser des progrès en matière de gestion et d'efficacité.

Nous devons garder à l'esprit trois principes fondamentaux : le droit à une bonne justice, l'égalité devant la justice, quelles que soient les ressources des personnes concernées, et la liberté du juge prescripteur.
Cette dernière complique évidemment la prévision des dépenses : il faut donc accepter des écarts entre prévisions et réalisation, ce qui ne signifie pas accepter une sous budgétisation.
Je souligne que le Parlement ne peut excessivement s'offusquer de la croissance des frais de justice, dans la mesure où il en est en partie responsable, par l'effet inflationniste des nouvelles normes.
Je souhaiterais poser deux questions aux représentants de la Cour.
Premièrement, vous mentionnez la nécessite de clarifier rapidement le régime de TVA et des cotisations sociales applicables aux expertises judiciaires. Je souhaiterais en savoir plus sur ces exonérations, leurs conséquences, leur légitimité et leur légalité.
Deuxièmement, à propos des interceptions téléphoniques, j'ai été surpris par la grande différence de coût entre les interceptions de sécurité - demandées par le premier ministre - et les interceptions judiciaires, celles-ci étant beaucoup plus onéreuses. J'ai également été surpris par l'absence de marché pour les interceptions téléphoniques et par le nombre très important de sociétés qui participent à ces écoutes.
Je souhaiterais enfin poser trois questions à Mme Malbec.
Tout d'abord, pensez-vous qu'il existe encore des possibilités de simplifications du « circuit de la dépense » ? En particulier, le processus de déconcentration est-il épuisé ?
Ensuite, comptez-vous revoir le régime de calcul de la rémunération des interprètes ? J'ai été particulièrement choqué par le principe « de la première heure », qui permet à un interprète travaillant vingt minutes d'être payé pour une heure.
Enfin, je considère que les différences de rémunération au sein des administrations centrales ont quelque chose de « non républicain ». Je pense notamment aux ministères de la justice et des affaires sociales. Pensez-vous que le régime des primes de votre administration devrait être revu, afin de la rendre plus attrayante ?
la Cour recommande de clarifier rapidement les conditions d'application de la TVA aux expertises prescrites et des cotisations sociales aux prestations couvertes par les frais de justice, car la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 et le décret d'application de 2000 prévoyaient cet assujettissement aux collaborateurs occasionnels du service public de la justice. Or, dix ans après, ces obligations n'ont toujours pas été mises en oeuvre du fait d'une contrariété d'interprétation entre l'administration fiscale et le juge communautaire, celui-ci réservant l'exonération de TVA aux expertises médicales à but thérapeutique et non au domaine judiciaire.
Ce sujet n'est pas simple. La décision avait été prise de soumettre ces prestations à cotisations sociales, mais n'a jamais été mise en oeuvre, ni par la sécurité sociale, ni même par l'Etat. Les 20 à 30 millions d'euros prévus ont été redéployés dans les conditions de la LOLF vers le paiement des frais de justice. Ensuite, comment appliquer la TVA ? Il a été proposé par la Cour des comptes de faire une double application, à la fois de la TVA et des cotisations sociales, ce qui augmenterait le coût des frais de justice de 40 %.
Le choix concernant la TVA est technique car cela reviendrait à ce que l'Etat se paye à lui-même. En revanche, le paiement des cotisations sociales engendrerait un réel surcoût. Notre orientation serait de dire qu'il est difficile de prélever des cotisations sociales sur des millions d'actes et que, dans ces conditions, le choix de la TVA serait le plus simple. Mais cela demeure un propos spéculatif et ne doit pas préempter le débat. L'administration est coupable et il faut reconnaître un manque de diligence.

Vous êtes favorable à une mesure de périmètre qui ne coûte rien à l'Etat. Nous confirmez-vous le redéploiement vers d'autres usages de 20 à 30 millions prévus initialement pour le paiement des cotisations sociales ?
Je le crains ! De nombreux rapports ont été faits sur le sujet car pendant ce temps, les frais de justice n'ont cessé d'augmenter et ont donc absorbé les crédits destinés aux cotisations sociales. Je veux ajouter que les crédits limitatifs accordés aux frais de justice se heurtent à l'indépendance du magistrat et à sa liberté de prescription. L'activité pénale n'étant pas en baisse, il ne peut être question de fermer le robinet. Il faut néanmoins donner la possibilité au magistrat d'opérer un choix éclairé. C'est toute la difficulté d'un service dans lequel il est très malaisé de prévoir le niveau de dépenses.
Nous avons essayé d'améliorer la maîtrise des prescriptions avec la création, depuis 2010, d'un bureau des frais de justice. Nous avons 3,5 millions de mémoires à traiter et à résorber dans les juridictions. Mais nous sommes tenus par les lois votées qui, par exemple, ont revalorisé la lettre C qui détermine le montant de certaines prestations médicales, ce qui provoque un effet volume sur lequel le ministère a difficilement la main.
Il faut s'interroger sur la diminution légère enregistrée en 2006, mais qui était liée au passage des crédits évaluatifs aux crédits limitatifs. Enfin, il faut préciser que 60 % des prescriptions sont le fait des officiers de police judiciaire (OPJ) et non des magistrats. Ces derniers ne maîtrisent donc pas ce volet de dépenses.
Cela passe par une meilleure connaissance des flux dans chaque juridiction et par une amélioration des outils, ce que n'a pas facilité le passage à Chorus.
Par exemple, nous passons dorénavant des marchés publics, notamment s'agissant de la Cour nationale du droit d'asile, des analyses génétiques, du transport de corps et d'apposition des scellés. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est limiter la prescription du magistrat dans le contexte d'un besoin croissant d'expertises, toujours plus délicates et plus chères en matière scientifique. Là est le dilemme.
Pour sensibiliser les magistrats, comme le recommande la Cour des comptes, nous avons mis en place des référents dans les juridictions. Mais la procédure étant très compliquée...

Existe-il une décomposition des frais prescrits par les magistrats du siège d'une part et du parquet d'autre part ?
Non, pas entre les magistrats du siège et ceux du parquet, car la diversité des magistrats concernés ne le permet pas. Mais nous disposons de ces informations par typologie d'expertise.

Cela m'étonne et je le regrette car on pourrait imaginer que, sur le plan du contrôle de gestion, il serait utile de disposer de cette information et de comparer le niveau des dépenses engendrées, sans remettre en cause le caractère souverain de la décision de chaque juge.
Mais cela risque de ne pas être apprécié.
Ce que je veux dire, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, c'est que le coût ne dépend pas nécessairement du magistrat mais de la complexité d'une affaire.
Nous avons cette ventilation des coûts par juridiction, ce qui nous permet d'entamer un dialogue de gestion de façon à identifier certaines causes de surcoût liées aux prestataires afin de comparer les tarifs entre ressort de Cour d'appel.

Il ne faudrait pas verser dans une comparaison générale et systématique car Paris se trouve dans une situation particulière et présente des coûts plus élevés.
S'agissant de la TVA, nous avions posé la question à Bercy et nous avons aujourd'hui une réponse. Sur les cotisations sociales, c'est beaucoup plus compliqué car cela dépend du statut de chaque prestataire et il risque d'y avoir un effet de levier sur le niveau de dépense du ministère. En tout état de cause, je confirme que le redéploiement des crédits budgétaires a bien été employé en faveur des frais de justice.
Nous nous sommes interrogés sur la réutilisation de ces crédits et avons considéré que leur redéploiement au bénéfice des frais de justice était justifié. Cela étant, s'agissant du paiement de la TVA, le bon sens doit rejoindre l'analyse juridique car les expertises prescrites relèvent davantage du cadre de la prestation de service libérale, donc soumise à TVA, que de celui du salariat, qui relève des charges sociales. L'application des deux types de prélèvement est difficilement compatible. Donc, il ne me semble pas utile de mettre en place une « usine à gaz » pour assurer le prélèvement des cotisations sociales, même si cela devait conduire à modifier la loi.

Sur les interceptions téléphoniques judiciaires et de sécurité, pouvez-vous répondre à notre rapporteur ?
Sur la différence de coût entre ces deux catégories d'interceptions, il manque une réflexion sur la facturation par les opérateurs. En effet, il faut bien avoir à l'esprit que viennent s'intercaler des prestataires privés dans le cas des interceptions judiciaires. En revanche, pour les interceptions de sécurité, il n'est pas fait recours à ces intermédiaires, ce qui explique leur coût plus faible. Nous vous fournirons des chiffres complémentaires.
La Cour des comptes va poursuivre son enquête sur ce sujet car les interceptions représentent 17 % de l'ensemble des frais de justice.

Le code des marchés s'applique-t-il aux prestations couvertes par des frais de justice ?
La plupart des frais de justice ne sont pas considérés comme relevant du code des marchés publics, car sur le plan strictement juridique, il n'est pas laissé de choix dans l'acte d'achat une fois la décision du magistrat prise de prescrire une expertise. Pour autant, cela n'empêche pas de faire jouer la concurrence.
Général Michel Pattin, sous-directeur de la police judiciaire à la DGGN. - Le programme de modernisation des interceptions judiciaires entrera en oeuvre en 2014 avec, à la clé, une économie de 20 millions d'euros dès la première année et de 25 millions fin 2015.
Pour rendre possible ces économies, il faudra, au départ, investir 43 millions pour la modernisation de la plateforme nationale des écoutes judiciaires.
Pour cela, nous avons négocié avec les opérateurs une économie de 40 % en y incluant la géolocalisation qui n'était pas comprise jusqu'à présent dans le marché.
Général Michel Pattin. - Par ailleurs, de nouvelles sources d'économie proviennent du fait que les enquêteurs proposent des durées de plus en plus courtes d'écoute. Celles-ci ne sont plus de plusieurs mois comme autrefois mais d'une durée plus raisonnable et donc moins coûteuses. Sur cette plateforme, nous allons affecter deux civils et deux militaires.
La police nationale souscrit à ces propos. S'agissant de la liberté de prescription et de l'égalité d'accès des citoyens à la justice, il faut avoir pleinement conscience que certaines investigations ne sont pas effectuées du seul fait de leur coût jugé trop élevé. Par exemple, pour un vol de téléphone, la géolocalisation serait d'un coût trop élevé pour l'infraction considérée.

Il s'agit tout simplement de la déclinaison du principe de l'opportunité des poursuites.
La police technique et scientifique appliquée à la délinquance de masse est également limitée en matière de cambriolage.
Sur la plateforme nationale d'interception, une économie de 27 millions d'euros de location de matériel sera également faite.

Il serait utile qu'une fiche récapitulative sur ce sujet nous soit communiquée afin de synthétiser l'ensemble de ces économies.

Le principe d'égalité républicaine en matière de prime n'est pas respecté et cela est regrettable tant pour la reconnaissance du travail effectué que pour la qualité du service attendu. J'attends une réponse à cette question.
La direction du budget est loin d'avoir les meilleures primes. Mais je souhaiterais nuancer le sujet, car un effort de long terme a déjà été engagé vers une convergence des primes, notamment dans les traitements de début de carrière où les écarts sont devenus très faibles. Par ailleurs, je regrette que le ministère de la justice recrute peu en dehors de la magistrature et pas du tout à la sortie de l'ENA. Mon sentiment est qu'une plus grande diversité de recrutement pourrait permettre d'améliorer les pratiques de gestion. Mais ce n'est qu'un avis partial qui ne doit pas être perçu comme agressif par mes collègues.

On se rend compte des limites de la LOLF dans l'administration de la justice car le passage des crédits évaluatifs aux crédits limitatifs n'a pas fondamentalement fait cesser les risques de dérives et les pratiques de reports et de redéploiement qui sont constitutifs d'une insincérité budgétaire. Or, je me souviens que j'ai occupé pendant sept ans les fonctions de rapporteur spécial du budget de la justice et que systématiquement, je demandais qu'à chaque nouvelle loi, une évaluation préalable soit réalisée. Mais cela n'a jamais été mis en oeuvre et nous pouvons aujourd'hui le regretter.
Enfin, je suis choqué qu'un ministère, qui devrait être exemplaire, soit en totale contradiction avec le droit, et je suis en phase sur ce point avec mon collègue Edmond Hervé.

J'ai cru comprendre que l'administration avait conscience de ce problème. Prenez-vous l'engagement de le résoudre ?
La situation a, en effet, assez duré. Sur les effets de la LOLF, il est bon que tous les ministères respectent des crédits limitatifs. Or, nous sommes dans un champ d'une complexité noire avec des millions de factures, ce qui est un cas unique dans la gestion des services de l'Etat, avec des efforts d'apurements très importants. Les restes à payer ne sont pas encore résorbés. Mais je voudrais insister pour bien mettre en évidence le travail accompli par la direction des services judiciaires pour normaliser la situation. Aussi, je souhaite relativiser ce phénomène de sous-budgétisation, qui est apparu en 2009, mais dont l'ampleur, mesurée en terme d'écart entre la prévision et la réalisation, est faible au regard du désordre « innommable » engendré par ces millions de factures.
Depuis 2009, un rebasage budgétaire du montant des frais de justice a été opéré : 409 millions d'euros en 2009, 393 millions en 2010, 460 millions en 2011, 470 millions en 2012 et 532 millions pour 2013.
Ce rebasage pour 2013 semble correct mais nous ne sommes pas à l'abri de surprises. Ainsi, en mars 2011, un décret d'avances de 60 millions a dû être présenté pour apurer des factures datant de cinq à dix ans.

Une dérive de 14 % de ces frais en 2011 et le constat d'insincérité budgétaire doivent nous conduire à regarder plus précisément les chiffres car nous comptons toujours 107 millions d'euros de reste à payer. Combien de temps faudra-t-il pour rattraper ce retard ?
Il me semble normal qu'il y ait un encadrement plus strict de la dépense, non pas au niveau de chaque magistrat, mais au moins au niveau des juridictions. La liberté ne doit pas être sans condition en matière de deniers publics.

Au fil des propos, peut-on faire un parallèle avec le monde de la santé où existe la liberté de prescription du médecin, avec un contrôle très serré de la sécurité sociale ? Cette comparaison est-elle absurde ? Si on contrôle les dépenses de santé, ne peut-on progresser dans l'analyse vis-à-vis des prescriptions opérées par les magistrats ?

La justice traite la santé morale de notre société et cette problématique est intéressante.

J'aimerais connaître l'impact de la rotation des magistrats sur les coûts. Car tous les deux ans, il y a une rupture dans les traitements des dossiers d'environ six mois : trois mois à l'arrivée du nouveau magistrat pour prendre connaissance des dossiers et trois mois au départ, puisqu'il ne lance plus de dossier.
- Présidence de M. Jean-Pierre Caffet, vice-président -
Ces 107 millions d'euros sont bien enregistrés comme une dette de l'Etat, au titre des charges à payer dans la comptabilité nationale. Comme je vous le disais précédemment, le niveau de charge à payer n'est pas satisfaisant, de l'ordre d'un mois et demi, mais il n'est pas choquant techniquement.
Le niveau de dotation inscrit au PLF pour 2013 est suffisant pour ne pas créer de nouvelles dettes.
Les Cours d'appel sont toutes sous plafond de dépense et nous allons entamer un dialogue de gestion avec chaque juridiction qui, naturellement, ne peuvent dépasser le montant de crédits alloués. En cas d'enquêtes coûteuses, par exemple l'affaire Grégory, la Cour d'appel transmet une demande à l'administration centrale. Evidemment, je confirme que tous les crédits sont limitatifs.
La question se pose quant à la désignation des experts et des laboratoires privés qui présentent des coûts plus élevés que les laboratoires publics. Or ces derniers sont à même de répondre aux demandes d'expertise, avec un bon niveau de qualité et à moindre coût.

Il est difficile de résister aux pressions lorsqu'il faut faire le choix de prescrire ou non une expertise. C'est un constat, hélas, naturel.
Pour répondre à M. Adnot, la règle des deux ans est non écrite et ne se vérifie pas dans les faits. Les magistrats n'exercent pas tous, loin s'en faut, cette mobilité. Votre remarque concernant le lancement des enquêtes n'est valable que pour les juges d'instruction qui ne représentent qu'une part limitée. Mais, en tout état de cause, nous travaillons à allonger ce délai.

Pourquoi ne pas instaurer une taxe sur les tabloïdes et la presse, qui tirent leurs revenus de l'actualité judiciaire pour financer les frais de justice ?

M. Tanguy, pourriez-vous nous dire, au nom de la DGFIP, comment améliorer le circuit de la dépense publique ?
Nous souscrivons aux observations de la Cour des comptes. Il s'agit d'un enjeu de gestion (3 millions de mémoires à gérer), de comptabilité (au vu des niveaux de charges à payer) et de performance en matière de délai de paiement.
Les pistes proposées par la DGFIP sont les suivantes :
- professionnaliser la gestion des frais de justice, même si beaucoup a déjà été fait, en rationalisant l'achat public et en unifiant les procédures d'une Cour d'appel à une autre, en centralisant la réception des mémoires et en spécialisant des services pour les gérer ;
- simplifier le circuit de la dépense qui, pour l'essentiel, utilise du papier. La dématérialisation du traitement est un enjeu central pour améliorer la performance et dégager des marges d'économie ;
- enfin, pourquoi ne pas s'interroger sur le périmètre des frais relevant de la tarification ou de la taxation afin de déjuridictionaliser le contrôle de la liquidation et, ainsi, fluidifier la gestion des frais de justice ?

Je ne voudrais pas qu'on laisse croire que des investissements de rationalisation n'ont pas été faits. Un énorme effort à été réalisé. Par exemple, la Cour d'appel de Colmar a été obligée d'arrêter le paiement des frais de justice afin de donner la priorité au remboursement des jurés de Cour d'assises à partir de mars 2012, soit trois mois seulement après le vote du budget ! Ces retards ont un effet inflationniste et il y a de très grandes disparités entre ressorts géographiques, notamment en matière d'interprétariat.

Je renouvelle mes remerciements à la Cour des comptes et à l'administration pour la franchise de ses réponses.
La commission autorise la publication de l'enquête de la Cour des comptes ainsi que du compte-rendu de la présente audition sous la forme d'un rapport d'information.
Enfin, la commission entend la communication de M. Dominique de Legge, rapporteur spécial, sur les investissements de la sécurité civile.

La mission « Sécurité civile » fait partie des missions régaliennes de l'Etat. On peut toutefois s'interroger sur la réalité de son engagement par rapport aux différents acteurs pour mener à bien cet objectif au coeur de la vie de nos concitoyens. Les autorisations de dépenses d'investissement pour la mission sécurité civile s'élèvent, dans la loi de finances pour 2012, à 45,8 millions d'euros. Ce montant doit être mis en perspective des budgets prévisionnels des SDIS pour 2011 qui faisaient apparaitre une dépense totale de 1,216 milliard d'euros en section d'investissement (sur un total de 5,5 milliards d'euros). Comme vous le savez, la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours (les SDIS) a constitué une étape clé dans l'évolution de l'organisation de ces services. Au terme de maintenant un peu plus de dix ans d'application de ce texte, il m'est apparu nécessaire de tirer un bilan. Quel est le processus de pilotage de cet investissement ? Qui décide ? Qui paye ? Et quels sont les grands axes de cette politique ?
A première vue l'on pourrait penser que la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) occupe une position centrale dans le processus d'élaboration des investissements et leur orientation. Pour autant, au regard des moyens dont elle dispose, elle pèse peu et son rôle d'animation, de conseil ou d'orientation se trouve considérablement réduit. A défaut de moyens financiers, la DGSCGC pourrait utilement s'investir dans un travail d'incitation à la mutualisation et s'intéresser de plus près à la norme, qui devient souvent un prétexte pour justifier l'explosion des dépenses.
Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR) est insuffisamment exploité. En théorie largement à la main du préfet, il devrait orienter les choix d'investissement. En pratique, le représentant de l'Etat ne dispose pas de l'ingénierie nécessaire pour orienter utilement la conception de ce document. Par ailleurs les investissements étant assurés par les SDIS, c'est-à-dire par les conseils généraux, le Préfet est mal à l'aise pour peser sur les choix. Après une période de fortes dépenses dans les années 2000, les directeurs des SDIS sont désormais conscients des contraintes pesant sur les conseils généraux. D'une façon générale, il apparaît que la DGSCGC, en liaison avec les préfets de région, pourrait utilement servir de lien et de relais entre les départements d'une même région afin de rationaliser les choix et de s'assurer tout à la fois de la mutualisation d'équipements dont la pertinence au niveau départemental ne se justifie pas et de l'adéquation des moyens aux objectifs. La consolidation des SDACR au niveau régional sous l'autorité du préfet de région permettrait d'atteindre cet objectif.
Le rôle du fonds d'aide à l'investissement (FAI), levier principal de l'Etat dans ce domaine, tend à s'amenuiser depuis sa création. Initialement fixée à 45 millions d'euros en 2003 et ayant connu un pic en 2005, la dotation de ce fonds pour 2012 n'est plus que de 18,36 millions d'euros, soit une division par trois en cinq ans. Par comparaison avec les 1,2 milliard d'investissement des SDIS, cette somme représente à peine 1,5 % de leurs dépenses d'investissement et invite à s'interroger sur son effet levier et par voie de conséquence sur le devenir de ce fonds. Les critères d'attribution méritent aussi d'être précisés. Je propose dans cette perspective de repenser l'emploi de ces crédits avec un objectif de plus grande efficacité. Il s'agirait notamment d'utiliser l'effet de levier pour encourager des redéploiements en faveur d'une plus grande mutualisation des achats réalisés par les SDIS et de projets interdépartementaux. La mise en place d'une consolidation régionale des SDACR, évoquée plus haut, y contribuerait.
Parmi les projets financés par le FAI, Antares demeure un sujet problématique. Ce système d'information et de communication dédié aux forces concourant à la sécurité civile sur le territoire renvoie à une ambition nationale, mais aussi à un projet en réalité non pleinement partagé par les acteurs locaux : police, gendarmerie, SDIS, SAMU. Au final, la charge d'investissement (147,5 millions d'euros), comme celle du fonctionnement (estimée à 54,9 millions d'euros), pèse majoritairement sur les seuls SDIS, et par contrecoup, sur les collectivités (notamment le département) tandis que la police et le SAMU ne sont pas ou peu sollicités. Je souligne en outre le problème posé par l'inadaptation actuelle de ce matériel aux avions de la sécurité civile : Antares ne fonctionne pas dans les airs ! Le ministère doit impérativement prendre les mesures qui s'imposent pour remédier à cette impasse opérationnelle difficilement compréhensible.
En elle-même d'ailleurs, la flotte aérienne de la sécurité civile représente un enjeu budgétaire majeur. Axée sur une stratégie dite de « guet aérien » afin de lutter contre les feux de forêt, cette flotte doit connaître un renouvellement à court terme de l'une de ses composantes : les Trackers. Ces appareils vont arriver en fin de vie à partir de 2016. Les scénarios envisagés font apparaitre un besoin de financement variant de 60 millions d'euros à 160 millions d'euros. La solution apparemment privilégiée aujourd'hui par le ministère s'oriente vers un remplacement des Trackers par une flottille de petits appareils, des Air Tractors, pour un coût de renouvellement de l'ordre de 60 à 80 millions d'euros. A cet égard, je veux insister sur la nécessité de procéder à une évaluation pragmatique du rapport entre le coût de l'investissement, la dangerosité du risque « feu de forêt » et l'intérêt économique. Faut-il nécessairement attaquer tous les feux de forêt naissant, alors que certains d'entre eux ne présentent qu'un faible risque dont l'origine est bien souvent l'absence d'entretien de la garrigue... En tout état de cause l'appréciation sur l'opportunité d'intervenir ne peut se faire indépendamment des acteurs locaux. L'autre question, s'agissant des moyens aériens de la sécurité civile, réside dans le projet de délocalisation de la base de Marignane. Ici, l'enjeu renvoie à une couverture optimale de la zone des feux dans un contexte d'évolution climatique à moyen et long terme. Un déménagement de la base aérienne de la sécurité civile vers Nîmes est aujourd'hui privilégié.
L'investissement en matière de sécurité civile est aussi un investissement dans les personnels. La départementalisation des SDIS s'est accompagnée d'ouvertures d'écoles départementales. Ces écoles répondent à un besoin qui, pour les sapeurs-pompiers volontaires, appelle une réponse de proximité. Pour autant, la politique de formation des personnels doit s'orienter vers un effort accru de rationalisation et de mutualisation des moyens entre les écoles départementales et avec l'école nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers (ENSOSP). Il s'agit là d'un enjeu important en vue de contenir la charge d'investissement et d'éviter d'éventuelles surcapacités de formation.
La sécurité civile ne doit par ailleurs plus faire l'économie d'une réflexion sur un recentrage nécessaire de ses missions, afin de desserrer la contrainte d'investissement. Je pense en particulier à la notion de secours à personne, qui recouvre aujourd'hui des réalités très diversifiées allant du feu aux accidents sur la voie publique en passant par des missions sanitaires et sociales. Une meilleure répartition des tâches doit être imaginée entre les SDIS et les SAMU, notamment dans les cas de carence hospitalière. Revient-il véritablement aux pompiers de jouer le rôle d'un « SAMU social bis » auprès de sans domicile fixe par exemple ? L'augmentation considérable (+ 36,2 % entre 2002 et 2010) du secours à personne impacte significativement l'orientation et les besoins d'investissement des SDIS. Parmi ces dépenses, la mise en place de centres d'appels communs aux SDIS et aux SAMU constitue assurément une source de gains potentiels importants.
Plus généralement, les efforts de mutualisation des achats des SDIS commencent à porter leurs fruits. Progressivement se diffuse un « réflexe mutualisation », notamment sous l'impulsion de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP). La DGSCGC gagnerait à développer son rôle de prescription et de conseil dans ce domaine qui doit être encore approfondi par les SDIS.
En conclusion, la sécurité civile dispose aujourd'hui d'équipements modernes, ou en cours de modernisation, pour faire face à une grande diversité de risques et de situations. L'effort d'adaptation est continu et il a jusqu'à présent porté ses fruits. Pour autant, la contrainte budgétaire se fait sentir de manière croissante, que ce soit pour l'Etat ou les collectivités territoriales. Aussi, dans un souci de préservation de la ressource budgétaire, me parait-il nécessaire de conforter aujourd'hui, au coeur de la logique d'investissement, un principe simple de responsabilisation : « le prescripteur doit aussi être (au moins en partie) le financeur ».

Merci, M. le rapporteur spécial, pour ce contrôle budgétaire qui intéresse, j'en suis certain, tous nos collègues au plus haut point.

Je partage l'avis de Dominique de Legge : toutes les sorties des pompiers ne sont en effet peut-être pas toujours bien calibrées. Par ailleurs, le prescripteur de la dépense doit en être le payeur, sinon la demande tend à un maximum. Pour ce qui est du SDACR, ses objectifs doivent être considérés comme un optimum et non comme un impératif absolu. J'insiste sur le fait que le payeur doit être le décideur. Antares a contribué à augmenter la dépense alors qu'il ne fonctionne ni dans les airs, ni au coeur des feux.
La mutualisation est aussi à l'origine de dépenses supplémentaires car chacun est en demande de particularités propres lors de l'achat d'équipement. Afin d'éviter cette dérive, il convient de définir en amont le matériel et ensuite d'en proposer l'achat aux SDIS concernés.
La maîtrise de la dépense n'existe pas et pour y parvenir il faudrait intégrer d'avantage les services des SDIS dans ceux du département. Je pense en particulier aux services informatiques et immobiliers. Les pompiers expriment en effet toujours un besoin maximal, parfois loin de l'optimum.

A propos des écoles de formation, je veux insister sur le caractère incontournable de la formation, en particulier pour les jeunes sapeurs-pompiers. Mais on n'est pas obligé de construire de nouveaux bâtiments pour y accueillir les modules : on peut utiliser à moindre frais les collèges, le samedi par exemple. Les directeurs de SDIS sont pragmatiques.
Actuellement, la dotation d'Etat transite par les communes pour aller vers les SDIS. Ce circuit responsabilise le maire, mais on pourrait le simplifier.

Je suis d'accord avec Philippe Adnot en ce qui concerne la mutualisation : on est plutôt dans du groupement d'achats. S'agissant de la maîtrise des dépenses, les colonels des SDIS sont conscients de cet impératif et ils ont désormais atteint un niveau d'équipement élevé pour leurs services. Certains exemples doivent être mis en avant. Je pense en particulier au SDIS de l'Aveyron qui, plutôt que d'acheter un équipement neuf, a préféré se tourner vers l'acquisition de la citerne d'une coopérative laitière.
La DGSCGC devrait jouer un rôle de régulateur en matière de normes par rapport aux SDIS, qui font pression sur le conseil général. Dans le domaine de la formation, il me semble important de distinguer la nécessité de former les personnels et l'équipement des plateaux techniques (qui permettent par exemple l'entraînement à la lutte contre le feu). Ces équipements sont nécessaires mais ils ne doivent pas forcément s'accompagner de lieux de restauration et de couchage.
S'agissant du financement des SDIS par les communes et les départements, la charge s'est inversée entre ces collectivités au cours de la décennie passée. Désormais, les départements financent majoritairement les SDIS.

Sur ce point, il faut rappeler que ce financement s'opère à partir d'une enveloppe et qu'à l'intérieur de celle-ci, il est possible de faire varier la participation de la commune, en fonction par exemple de l'évolution de sa richesse.

En tant que rapporteure pour avis de la mission « Sécurité civile » pour la commission des Lois, j'ai fait un point plus particulier l'an dernier sur les dépenses de fonctionnement de la sécurité civile, et notamment celles de l'ENSOSP. On se concentre de plus en plus sur l'investissement au sein de cette mission et le fonctionnement tend à devenir portion congrue. On parvient à sanctuariser les dépenses de fonctionnement actuelles grâce à ce que verse l'Etat, mais on n'arrivera pas à aller au-delà.

Je remercie Dominique de Legge pour ce rapport particulièrement intéressant et éclairant sur les enjeux de l'investissement dans le domaine de la sécurité civile. Peut-être votre prochaine mission de contrôle pourrait-elle porter l'année prochaine sur les dépenses de fonctionnement des SDIS ?
A l'issue de ce débat, la commission, à l'unanimité, donne acte de sa communication à M. Dominique de Legge, rapporteur spécial, et en autorise la publication sous la forme d'un rapport d'information.