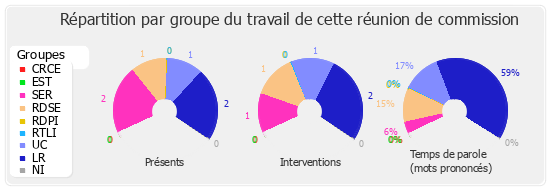Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation
Réunion du 6 juillet 2021 à 16h20
Sommaire
- Assurer les risques exceptionnels : quelle couverture et quel financement ?
- Audition de mm. bertrand labilloy directeur général de la caisse centrale de réassurance ccr joël limouzin membre du bureau de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles fnsea mmes florence lustman présidente de la fédération française de l'assurance ffa et stéphanie pauzat vice-présidente de la confédération des petites et moyennes entreprises cpme (voir le dossier)
La réunion
Assurer les risques exceptionnels : quelle couverture et quel financement
Audition de Mm. Bertrand Labilloy directeur général de la caisse centrale de réassurance ccr joël limouzin membre du bureau de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles fnsea mmes florence lustman présidente de la fédération française de l'assurance ffa et stéphanie pauzat vice-présidente de la confédération des petites et moyennes entreprises cpme

Si les multiples répercussions de la crise sanitaire n'ont pas fini de nous interroger sur nos systèmes économiques et sociaux, il est certain que le secteur assurantiel fait partie de ceux qui traversent une profonde remise en cause. En effet, l'exclusion du risque pandémique de la plupart des garanties « pertes d'exploitation » souscrites par les entreprises a rappelé, parfois douloureusement, que ceux-ci n'agissent que dans le cadre des engagements contractuels souscrits. Plus largement, la crise sanitaire, d'une ampleur inédite, nous a permis de nous interroger sur l'articulation du secteur assurantiel avec la solidarité nationale, et leurs responsabilités respectives.
Dans ce contexte, notre commission avait d'ailleurs examiné l'an dernier la proposition de loi de Jean-François Husson, sur le rapport de Claude Nougein.
De son côté, le Gouvernement a initié une réflexion sur le développement d'une couverture « pandémie », avec la mise en place d'un groupe de travail, piloté par la direction générale du Trésor en avril 2020. Ses travaux ont finalement été étendus à l'ensemble des risques dits « exceptionnels ». Il est vrai que le déploiement d'une couverture assurantielle contre ces risques réputés « inassurables » passe toujours par la résolution d'une même quadrature du cercle, à savoir comment garantir une protection maximale, tout en minimisant son coût pour les assurés.
La question de l'articulation de l'assurance avec la solidarité nationale se pose, au-delà de la crise sanitaire, dans le contexte de dérèglement climatique. L'actualité récente a ainsi rappelé, si besoin en était, les effets des aléas climatiques sur la production et les rendements agricoles, avec l'épisode de gel tardif que nos agriculteurs ont subi en avril dernier. Vous pourrez ainsi revenir sur le régime des calamités agricoles d'une part, et sur l'assurance récolte d'autre part, cette dernière souffrant d'un taux de pénétration modeste, de l'ordre de 30 % des surfaces agricoles. Alors qu'un plan de soutien aux agriculteurs a été annoncé par le Premier ministre, la question du financement du Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA), élargi exceptionnellement à la viticulture et aux grandes cultures, pourra également être abordée.
Afin d'aborder ces sujets, nous avons le plaisir d'accueillir cet après-midi quatre intervenants, que je remercie pour leur participation : Mme Florence Lustman, présidente de la Fédération française de l'assurance (FFA) ; M. Bertrand Labilloy, directeur général de la Caisse centrale de réassurance ; Mme Stéphanie Pauzat, vice-présidente de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ; et M. Joël Limouzin, membre du bureau de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA).
Sans plus tarder, je cède la parole à Florence Lustman, pour un bref propos liminaire sur le rôle des assureurs dans la prise en charge des risques exceptionnels.
Parmi les risques majeurs auxquels notre société est confrontée, la transition écologique figure en premier lieu. Dans le monde, au cours des vingt dernières années, le nombre de catastrophes naturelles a augmenté de 74 % par rapport aux vingt années précédentes, causant 1,2 million de décès et affectant plus généralement 4,2 milliards de personnes. Sur la seule année 2020, un triste record a été franchi avec plus de 126 milliards d'euros de dommages.
En France, entre 2020 et 2050, le coût des sinistres climatiques devrait être multiplié par cinq ou six dans certains départements, majoritairement situés dans l'ouest. Il est donc urgent d'agir, comme nous le rappellent les épisodes récents, tels que la tempête Alex ou les épisodes de gel et les intempéries de juin.
Nous devons également faire face à des risques émergents, et notamment le risque cyber. En 2020, dans le monde, ce risque correspond à 800 000 plaintes et à plus de 4 milliards de dollars de pertes, avec une progression des plaintes de plus de 70 % par rapport à 2019 et, en termes de coût, de plus de 20 % par rapport à 2019. En France, 1 640 plaintes ont été déposées, soit 1,3 fois plus qu'en 2019 et 3,8 fois plus qu'en 2018.
Un autre risque émergent est le risque pandémique. Le Forum économique mondial identifie celui-ci comme le premier risque à court terme. Nous aurons malheureusement de nouvelles pandémies dans le futur. En France, le risque d'augmentation des pandémies est le troisième risque à 5 ans d'après notre étude annuelle des risques.
Quid de l'assurance privée face à la montée de ces risques ?
L'assurance privée ne peut pas seule gérer ces risques exceptionnels. En effet, l'assurance repose sur le principe de la mutualisation : les primes servent à indemniser ceux qui ont des sinistres. Or, quand tout le monde est touché en même temps, ce principe ne fonctionne plus. C'est la raison pour laquelle les risques systémiques sont exclus des contrats d'assurance, tels que les contrats contre les pertes d'exploitation.
On peut trouver des solutions sur des risques non assurables comme les catastrophes naturelles. Notre régime est une chance en France, beaucoup de territoires dans le monde aimeraient avoir une couverture des aléas naturels. Il est rendu possible par la mutualisation sur l'ensemble des contrats d'assurance dommage, c'est-à-dire une mutualisation géographique très importante, permettant une mutualisation à moindre coût pour les assurés. Toutefois, la branche dite « catastrophes naturelles » est déficitaire pour la cinquième année consécutive avec 2,2 milliards d'euros de prestations versées pour 1,7 milliard d'euros de cotisations collectées. Même sur les risques pour lesquels on a trouvé des solutions, l'aggravation de ceux-ci pose des difficultés financières. Le constat est le même pour le risque cyber, pour lequel le ratio qui compare la charge de sinistres par rapport aux primes est passé de 84 % à quasiment 170 %. Sur l'assurance agricole, on paye en moyenne 105 % des primes en sinistres.
Heureusement, l'assurance repose sur la mutualisation entre les assurés d'une même branche, mais aussi entre les différents risques assurés par l'assureur. Sur l'assurance récolte, ce sont les autres branches d'assurance qui compensent l'excédent de sinistres. C'est la clé du fonctionnement de l'assurance. Quand nous devons faire face à une année exceptionnelle, avec une baisse de la sinistralité, ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les tarifs ou rembourser les primes, car ce surplus va financer l'excédent de risques sur d'autres branches.
Nous souhaitons accompagner les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics pour identifier en amont les risques et appréhender la vulnérabilité de leurs installations face aux risques, et en particulier au risque climatique. Nous souhaitons leur permettre de faire face à ces évènements climatiques, et nous agissons dans le sens d'une plus grande prévention. On essaie en somme de repousser les limites de l'assurabilité en faisant plus de prévention, de prévenir plutôt que de guérir.
Sur les deux risques émergents, nous portons deux propositions concrètes.
Premièrement, sur les conséquences économiques des catastrophes de type pandémique, mais pas seulement, nous avons présenté notre proposition dite « CATEX », dès juin dernier, élaborée collégialement. Cette proposition n'a, à ce stade, pas été retenue par le Gouvernement qui a lancé d'autres pistes. En France et en Europe nous n'avons pas encore trouvé d'autres solutions de type assurantiel, à part celle que nous avons mise sur la table.
Deuxièmement, pour ce qui est du risque cyber, il reste des efforts à faire sur la prévention, en particulier sur les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME). Toutes les enquêtes le montrent, ainsi que les audits de risque. Au plan réglementaire, nous attendons également des pouvoirs publics qu'ils précisent et qu'ils lèvent les interrogations sur l'assurabilité des rançons et des amendes administratives qui n'est pas formellement interdite par les textes.
S'agissant des risques qui s'aggravent, l'assurance récolte et les catastrophes naturelles sont des risques déjà pris en charge mais sur lesquels nous avons des propositions. Les principales propositions consistent à lutter contre la non-assurance. Dans les premières réunions récentes organisées sur le sujet par le ministre de l'agriculture, Julien Denormandie, et réunissant l'ensemble de la filière et des assureurs, le problème de la non-assurance fait consensus. 70 % des surfaces ne sont pas couvertes. Nous travaillons dans les groupes de travail mis en place dans le cadre du Varenne de l'eau pour trouver une solution qui ne pénalise pas ceux qui sont déjà assurés.
Sur les catastrophes naturelles, nous plaidons pour une actualisation du régime, sans remettre en question ses fondamentaux. Il faut renforcer les dispositifs de prévention à tous les niveaux.
En conclusion, une interrogation demeure sur la dimension systémique de certains risques, comme la pandémie ou une cyberattaque mondiale, alors qu'ils sont en train d'évoluer et peut-être d'exploser. Pour les risques dits « extrêmes », la seule mutualisation ne suffit pas. Il faut se tourner vers des partenariats public-privé qui ont prouvé leur efficacité. Tous les assureurs sont conscients de ces enjeux car ils sont aux premières loges aux côtés des victimes de ces catastrophes, donc nous sommes particulièrement motivés pour contribuer à ces travaux.
Je traiterai le sujet qui nous occupe sous l'angle des rôles respectifs de l'État et du marché pour la couverture des risques extrêmes. La CCR présente une spécificité en France et dans le monde qui est d'opérer des partenariats public-privé, pour reprendre l'expression de Mme Lustman, en matière d'assurance et de réassurance. Je voudrais vous montrer la valeur ajoutée de tels dispositifs pour couvrir des risques qui, sinon, ne seraient pas ou seraient mal couverts.
Je vais partir d'un constat : dans nos sociétés modernes où l'on croit pouvoir tout prévoir, contrôler ou optimiser, on se fait surprendre par des catastrophes imprévues voire improbables, que l'on n'aurait jamais imaginées, ou qui sont d'un autre âge. À chaque fois, le même scénario se reproduit : on constate que les assurances indemnisent peu ou mal les dommages subis, ce qui est pourtant normal. Compte tenu de la nature et de l'ampleur des dommages, l'État finit par en payer tout ou partie, pour ne pas ajouter la crise à la catastrophe. Puis, dans un second temps, viennent les discussions, les travaux parlementaires, qui engagent des réflexions sur des dispositifs permettant de pallier les insuffisances de marché et d'éviter qu'une pareille mésaventure ne se reproduise dans le futur. C'est peu ou prou ce qui s'est produit l'année dernière avec la crise de la covid-19 : l'État est intervenu massivement pour soutenir les entreprises et les professionnels indépendants, puis des discussions se sont engagées pour la couverture du risque des pertes d'exploitations sans dommages. Des dispositifs ont été mis en place, comme les compléments d'assurance-crédit publics (CAP, CAP+, ou CAP Relais), puis des discussions sont menées pour pérenniser ou reconduire dans le temps ces dispositifs. Ce n'est pas un effet du tropisme de la France en faveur de la socialisation des risques ou de l'intervention étatique : ceci s'observe partout dans le monde, en tout cas dans les pays développés, y compris dans les pays très libéraux. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, des systèmes de couverture de catastrophes naturelles ou des actes de terrorisme ont été mis en place. Cela n'a donc rien à voir avec nos propres spécificités nationales.
Le marché de l'assurance privée n'est pas tout puissant et ne peut pas couvrir tous les risques ; en tout cas, ne peut pas les couvrir tous tout seul. C'est assez surprenant, car nous vivons une époque où les capitaux disponibles sont totalement surabondants et à un coût dérisoire. Les avancées de la science et les outils informatiques permettent d'investiguer n'importe quel type de risque, mais le marché de l'assurance ne peut pas tout couvrir - pas plus que l'État ne le peut. Il arrive que l'offre et la demande ne se rencontrent pas spontanément ou de façon harmonieuse, nécessitant un coup de pouce de la puissance publique. Je voudrais donner trois raisons principales, qui permettent de mieux comprendre dans quel cas de figure on se situe et quelle est la réponse à apporter en termes de spécificités de partenariats public-privé à mettre en place.
D'abord, l'assurance n'a pas la capacité de couvrir les risques systémiques. Elle peut indemniser les sinistres de quelques-uns avec les primes payées par le plus grand nombre. Mais elle ne peut rien lorsque tous les assurés sont sinistrés en même temps, même si les sinistres sont circonscrits à une région ou un pays donnés. La capacité d'absorption et de couverture du marché est limitée. Dans ces cas de figure, l'État est contraint d'apporter sa garantie financière, en complément de la capacité offerte par les acteurs privés. C'est ce que nous avons expérimenté l'année dernière, avec la couverture des pertes d'exploitation sans dommages, où le montant du sinistre effectif était sans commune mesure avec les capacités financières du marché de l'assurance et de la réassurance privées.
En deuxième lieu, le marché de l'assurance privée rencontre des difficultés à mutualiser les risques en présence d'aléa moral ou d'anti-sélection : quel intérêt les assurés ont-ils à choisir une couverture d'assurance s'ils ont la certitude que l'État leur viendra en aide en cas de sinistre ? Quelle possibilité les assureurs ont-ils de couvrir les risques lorsque l'aléa est concentré sur quelques têtes ? Il ne s'agit plus réellement d'un risque mais d'une très forte probabilité. Dans ce cas, l'État doit forcer la mutualisation, en prévoyant une extension obligatoire d'assurance, et introduire une forme de solidarité entre les territoires, comme c'est le cas pour les catastrophes naturelles.
Enfin, se pose le problème de la couverture des « super catastrophes », dont l'occurrence est rare, mais qui peuvent causer des dégâts très élevés. Je prendrai l'exemple de la pandémie : comment fixer un tarif d'assurance qui soit acceptable pour les assurés, lorsqu'ils peuvent avoir le sentiment qu'ils vont devoir payer pendant 30 à 40 ans sans savoir si cela leur sera utile un jour ? Des représentants d'entreprises ont pu se poser cette question. Du côté des assureurs, comment rémunérer le capital énorme à immobiliser pour couvrir les risques ? Pour résoudre ces difficultés, qui existent pour les catastrophes naturelles s'agissant de la crue centennale de la Seine, du tremblement de terre à Nice, du cyclone force 5 sur l'île de La Réunion, qui sont des sinistres qui dépassent la vingtaine de milliards d'euros, la seule façon de fixer le tarif de l'assurance est d'avoir une subvention implicite de l'État, à travers la garantie offerte à un prix raisonnable.
Il existe donc des risques extrêmes, qui ont, pour les raisons évoquées, des difficultés à être couverts uniquement par le marché privé. Mais heureusement, l'État peut mobiliser l'outil législatif, et l'aide budgétaire sous forme de garantie ou de subvention. Il est donc possible de débloquer ces situations avec un grand bénéfice pour la nation, car cela permet de combler les « gaps » de couverture, d'assurer une solidarité entre la population exposée et celle qui l'est moins, tout en protégeant les finances publiques. Le régime « CATNAT » le permet : je vous invite à comparer la situation française par rapport à la situation allemande. Tout ceci permet d'avoir une meilleure connaissance des risques et de travailler sur les questions de prévention.
A l'occasion de la crise de l'année dernière, j'ai eu le plaisir de constater que certains, qui pouvaient être dubitatifs, réticents ou critiques, ont redécouvert l'intérêt d'avoir un État qui joue son rôle de garant de l'assurabilité des risques, et d'avoir un garant en dernier ressort pour soutenir le marché privé de l'assurance. Ayant dit cela, je me dois de vous dire que mettre en place un partenariat public-privé n'est pas chose aisée. Il faut prendre garde à plusieurs écueils : pour le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, à travers le lissage des primes d'assurance qui est opéré de facto par le régime, on atténue le signal prix. Il y a donc moins d'incitations de la part des assurés à prendre les bonnes mesures et décisions. Si on met en place une forme de subventions aux primes d'assurance, on fait supporter une partie du coût du risque par le contribuable plutôt que par l'assuré. Or, le poids de la subvention ne doit pas être disproportionné par rapport au poids de la prime l'assurance, sinon, nous ne sommes plus dans un système assurantiel.
Je pense que l'intervention de l'État et du réassureur public ne peut être que supplétive et doit entraver aussi peu que possible la liberté des acteurs privés. Idéalement, les ménages et les entreprises doivent pouvoir ne pas s'assurer, quitte à les y obliger de facto, ou à les y inciter fortement. C'est important d'avoir la liberté d'adhérer ou pas au dispositif d'assurance et de réassurance publique. Mais lorsque l'on y adhère, il est légitime d'exiger certaines conditions au titre de la solidarité. Ce n'est pas seulement une opinion personnelle, c'est une contrainte que nous avons au niveau du droit européen : tous les six mois, les dispositifs mis en place, comme les dispositifs CAP, ou les dispositifs d'assurance-crédit, sont soumis à la Commission européenne, qui vérifie leur compatibilité avec les règles de concurrence au sein du marché de l'Union européenne.
Le deuxième écueil est une ambition qui doit être considérée avec prudence : il s'agit de la tentation du couteau suisse. En matière de risques extrêmes, le « sur-mesure » s'impose. Il ne faut pas chercher à transposer ce qui existe et qui fonctionne bien, car ce ne sont pas toujours les mêmes problématiques. Pour les catastrophes naturelles, la problématique est d'assurer la solidarité entre les territoires, en particulier entre les territoires ultra-marins et métropolitains, et entre certaines zones du territoire métropolitains et d'autres moins exposées. Le dispositif mis en place permet d'assurer cette solidarité.
Le régime mis en place pour couvrir le risque de terrorisme relève d'une autre logique : en l'absence de capacité privée de réassurance, un pool de coréassurance a été mis en place pour développer cette capacité. L'État offrait initialement la totalité de cette capacité, puis il se retire progressivement à mesure qu'une capacité de réassurance privée émerge sur le marché.
En tout état de cause, les dommages liés à des risques assurables doivent être couverts selon les voies traditionnelles, sans la garantie de l'État. Cela demande une meilleure diffusion de la culture du risque, un effort de promotion des garanties d'assurance et une mobilisation accrue des réassureurs privés. Il ne faut pas aller tout droit vers une solution de facilité, qui est d'utiliser la réassurance publique à la moindre difficulté : il faut d'abord explorer et épuiser les capacités du marché privé.
Pour conclure, nous avons en France, avec le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles et le régime de couverture des attentats, une expérience reconnue de longue date et saluée par des organismes internationaux. Des réflexions sont en cours pour optimiser ou réformer le régime « CATNAT», des réflexions démarrent sur la couverture des risques cyber et des risques agricoles, sur les risques de pandémie, ou encore sur le risque de crédits : la CCR y participe de façon très ouverte, en mettant à disposition ses compétences pour aider à faire émerger des solutions qui présentent un grand intérêt pour nos concitoyens et pour le développement du marché de l'assurance.
Lors de cette pandémie, nous avons constaté, d'une part, un manque d'acculturation des TPE et PME au risque assurantiel et d'autre part, un manque de visibilité sur les contrats d'assurance et les garanties offertes. Ce constat résulte du fait que les assurances ont souvent été vendues aux TPE et PME en contrepartie de quelque chose, c'est le cas par exemple de l'assurance-crédit, ou alors par obligation légale. Il y a donc, dans la majorité des cas, un faible accompagnement de la part des assureurs pour les plus petits contrats.
Nous avons mené une enquête auprès de nos adhérents au mois de mai 2020. Il ressort que 42 % des entreprises sondées disent avoir souscrit une assurance couvrant les pertes d'exploitations. Parmi elles, 34 % ont déclaré un sinistre au titre des pertes d'exploitation, dont 80 % précisent ne pas avoir été indemnisées par leur assureur. Enfin, 7 % des dirigeants qui avaient souscrit à une assurance couvrant les pertes d'exploitation ont constaté que cette garantie avait été résiliée dans le contrat pour 2021. Plus largement, il nous a été remonté que si les chefs d'entreprise souhaitaient maintenir cette garantie, ils devaient faire face à une croissance à deux chiffres du montant de la cotisation.
Si un nouveau mécanisme de couverture des risques exceptionnels doit être mis en place, ce à quoi nous ne sommes pas opposés, il ne faut pas oublier les objectifs fixés au groupe de travail par le Gouvernement. Ils étaient d'offrir une couverture adaptée aux risques d'intensité exceptionnelle, faire face aux baisses de chiffre d'affaires, mais en limitant le coût pour les entreprises, qui pèserait sur nos TPE et PME. Nous sommes bien conscients de la difficulté de créer un tel mécanisme pour les assureurs, notamment parce qu'il s'agit de couvrir des risques exceptionnels.
Nous sommes particulièrement attachés au principe d'une garantie facultative. Charge à l'assureur de motiver et d'expliquer à son client les intérêts d'une telle assurance, mais la décision de souscrire doit revenir au chef d'entreprise.
Au niveau des périls retenus, nous préconisions une couverture face au risque de pandémie, de crise sanitaire grave, mais aussi de l'élargir aux émeutes, menaces, conséquences d'attentats terroristes, éventuellement aux catastrophes naturelles sans dommage. Il nous avait été dit, à l'époque de la mise en place du groupe de travail, qu'un tel périmètre susciterait une hausse du coût des cotisations limitée à 20 %. On nous avait également dit qu'il était impossible de mutualiser des risques différents.
S'agissant des mesures administratives susceptibles de déclencher la couverture, nous souhaitons que cela ne concerne pas uniquement le cas des fermetures administratives, mais également les restrictions de circulation et d'accès. Nous souhaitons également que le déclenchement de la garantie soit automatique. La mutualisation doit être la plus grande possible, et que toutes les entreprises qui souhaitent y souscrire puissent le faire. Un niveau plafond, de cotisation comme de couverture, pourrait être retenu pour les grandes entreprises, afin de limiter les coûts.
Au niveau du système indemnitaire, nous avions opté pour une méthode d'indemnisation forfaitaire, sur la base d'un montant équivalent à 50 % de la marge brute hors bénéfices et masse salariale. S'agissant de la typologie des contrats, nous ne défendons pas une position fermée, tant que le caractère facultatif de la garantie est préservé.
La possibilité d'une auto-assurance a également été évoquée. La députée Valéria Faure-Muntian a d'ailleurs fait des propositions en ce sens. Dans cette perspective, les TPE et PME décideraient d'affecter une partie de leurs résultats d'entreprise, soit dans des fonds propres, soit dans le cadre de contrats dédiés, afin de se créer une enveloppe mobilisable en cas de difficultés. Nous ne sommes pas contre une telle proposition, à condition que le dispositif reste incitatif et facultatif. Il faut néanmoins garder à l'esprit que lorsque l'on parle de renforcement des fonds propres, c'est une notion qui ne parle pas à 99 % des commerçants. Parce que la très large majorité des commerçants sont en entreprise individuelle et n'ont dont pas la même notion de bilan que pour une entreprise au statut de société à responsabilité limitée (SARL).
Concernant la cybersécurité, sujet qui monte en puissance, particulièrement dans un contexte d'essor de la visioconférence et du télétravail, on voit qu'il y a de plus en plus d'alertes. Je rejoins complètement Mme Lustman sur ce point. Seulement 17 % des entreprises de moins de 50 salariés sont assurées contre les attaques informatiques. Un travail important de sensibilisation doit être fait. Là encore, nous ne sommes pas favorables à une couverture obligatoire. Il faut expliquer ce risque, qui peut toucher même les plus petites entreprises, parce que beaucoup de TPE ne se sentent pas concernées. Cela est toutefois en train de changer mais un effort conséquent reste à faire.
En conclusion, nous soutenons la mise en place de dispositifs facultatifs, incitatifs. Le rapport entre le coût et l'indemnisation doit être intéressant, sinon les entreprises ne cotiseront pas. Enfin, il faut inciter les métiers de l'assurance à expliquer, sensibiliser sur l'intérêt de s'assurer et renforcer la clarté des contrats d'assurance comme les garanties offertes.

Merci Madame Pauzat. Avec ce troisième point de vue, le débat gagne en complexité.
Je vais me focaliser sur le secteur agricole. Ces questions économiques nous regardent de très près, mais l'aspect climatique y est encore plus prépondérant. Depuis plusieurs années, les phénomènes climatiques sont d'une intensité exceptionnelle, et s'enchaînent quasiment tous les ans. Presque tous les territoires de notre pays ont été touchés. Certains ont subi quatre années consécutives de sécheresse. Pour d'autres, l'année a vu se succéder épisodes de sécheresse, de grêle et de neige. Cette situation dramatique n'épargne personne. Certaines régions qui se sentaient à l'abri il y a quelques années ne peuvent plus dire qu'elles passeront à côté d'un sinistre, qu'il s'agisse de tempêtes, de sécheresses, d'inondations ou de canicules.
Nous ne pouvons plus nous contenter d'évaluer les dégâts a posteriori. C'est un constat partagé entre le secteur de l'assurance, les agriculteurs, et l'État. Cette situation nous engage tous : agriculteurs, pouvoirs publics, acteurs de l'assurance et de la réassurance. Il nous faut désormais mieux prévenir, mieux préparer, et surtout mieux réparer, afin de permettre aux entreprises agricoles d'être plus résilientes. Cette résilience permet de mieux redémarrer après de tels épisodes. Certains exploitants ont subi cette année l'épisode de gel puis un épisode de grêle. En particulier, 250 hectares d'une même commune ont été ravagés par ces deux sinistres consécutifs. On croirait voir des vignes en plein hiver. Psychologiquement, cette situation est insupportable pour les agriculteurs concernés.
Il est de notre responsabilité collective de réformer en profondeur le modèle de gestion des risques que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons un système assurantiel, qui a évolué avec le temps, et qui s'incarne aujourd'hui dans le système de multirisques climatiques. Vous avez évoqué Mme Lustman un taux de pénétration de 30 % en moyenne, qui concerne surtout le secteur grande culture, ainsi que la viticulture. Sur l'arboriculture, nous ne sommes qu'à 4 ou 5 % de pénétration, et sur la prairie, autour de 1 à 2 %.
Il y a, parallèlement à ce dispositif assurantiel, le fonds des calamités agricoles, qui a fait ses preuves. Il est fondé sur un principe de solidarité, en prévoyant une taxe additionnelle assise sur les cotisations d'assurance acquittées par chaque agriculteur sur ses biens d'exploitation. Son taux, originellement fixé à 11 %, a été réduit il y a quelques années à 5,5 %. Cette taxe représentait, jusqu'à il y a cinq, six ans, un rendement de 120 millions d'euros chaque année, versés au fonds des calamités agricoles, un montant en principe équivalent à l'abondement de l'État. La contribution des agriculteurs représentait, sur les vingt dernières années, 52 % des recettes du fonds, contre 48 % par l'État. Le fonds était donc abondé annuellement de 250 millions d'euros en moyenne.
Aujourd'hui, les agriculteurs qui travaillent à ciel ouvert ne peuvent plus faire face seuls aux changements climatiques. Le Président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Agriculture ont été clairs là-dessus. L'enjeu politique est fondamental. Il y a un objectif de pérennisation de la production sur tous nos territoires, y compris dans les zones plus difficiles. A la FNSEA, nous tenons à ce que l'agriculture soit présente sur tous nos territoires. C'est un maillon clé de notre souveraineté alimentaire ; si l'on ne fait rien pour apporter de la résilience, elle sera atteinte. Certains pensent que l'on pourra toujours trouver à manger. Peut-être, mais notre alimentation risque d'être de plus en plus issue de l'importation.
La solidarité nationale doit jouer son rôle dans le cadre d'un schéma global, qui articule assurance récolte et fonds d'indemnisation des calamités agricoles. Ce débat a été largement engagé dans le cadre du Varenne agricole de l'eau et du changement climatique, que nous avions appelé de nos voeux. Des groupes de travail ont été initiés. Le premier se réunit toutes les semaines, avec les assureurs, les réassureurs et les pouvoirs publics. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de mobiliser des moyens, nous devons obtenir des résultats et des décisions politiques courageuses.
La solidarité nationale doit s'appuyer sur une gouvernance équilibrée. Il y a un vrai débat sur la mise en place d'un « pool » de co-réassurance. Tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet. Mais nous pensons, en tant qu'agriculteurs, qu'il doit y avoir un tel « pool », dont le taux d'indemnisation comme le curseur de détermination des aléas catastrophiques doivent encore être précisés. Cette articulation est fondamentale, car les agriculteurs ne peuvent plus subvenir seuls à leurs risques ou par la seule assurance.
Il est également nécessaire d'appliquer les acquis du règlement européen « Omnibus ». Dans le cadre de la politique agricole commune, il est possible d'aller plus loin en termes d'attractivité du système assurantiel. L'ensemble des filières agricoles le demandent, tout comme d'ailleurs le député Frédéric Descrozaille. Dans son rapport sur la gestion des risques en agriculture, il demandait à baisser le seuil et le niveau de franchise à 20 %, et d'augmenter la part subventionnée à 70 %. Je rappelle que l'Italie a mis en place le règlement omnibus depuis 2018.
Enfin, il y a une question douloureuse, qui ralentit probablement le développement de l'assurance, c'est le système de la référence, que nous appelons communément la « moyenne olympique ». C'est un dispositif où on calcule l'indemnisation à partir des cinq années passées, en enlevant la meilleure et la moins bonne. Mais dans un contexte de sinistres répétés, année après année, le rendement se trouve fortement rabaissé, et l'assurance ne déclenche pas l'indemnisation dans des proportions satisfaisantes. Il faut que nous aboutissions à un nouveau dispositif pour quantifier le vrai potentiel de production d'une entreprise agricole en situation normale. L'objectif est de pouvoir indemniser au plus juste pour permettre aux agriculteurs de repartir dans les meilleures conditions possibles. De nos groupes de travail, il ressort que la combinaison de la contribution via une assurance et de la solidarité nationale va devenir indispensable.
Nous allons un peu plus loin sur la question de l'obligation ou du volontariat. Jusqu'à présent, nous étions sur un principe d'assurance volontaire. Mais on ne peut plus continuer, à l'heure où de nombreux drames se jouent dans les entreprises, avec le système actuel. Or, si l'on veut qu'un système de coassurance et de solidarité nationale fonctionne, il doit être assis sur le principe d'une souscription obligatoire. Nous sommes prêts à aller jusque-là pour donner un vrai coup de « boost » au développement de l'assurance.
Ce que nous constatons aujourd'hui, et je le déplore fortement, c'est que les assureurs sont fortement sollicités dans l'accompagnement du secteur agricole. Le rapport des cotisations sur les sommes décaissées pour sinistres dépasse 100 %, certaines régions frôlant les 200 %, 240 % certaines années. Nous sommes conscients que cela ne peut pas continuer. L'offre assurantielle à destination de l'agriculture est en retrait, certains contrats sont revus à la hausse dès cette année, avec des augmentations de tarifs importantes ou le retrait de certaines options. Si nous comprenons la difficulté de maintenir ces contrats pour les assureurs, nous pensons également que ce n'est pas le meilleur moment pour effectuer de tels changements, alors que nous sommes à la veille d'une réforme. Il y a urgence à mettre en place un nouveau dispositif, avec la transition la plus courte possible.
L'État doit comprendre que sans la solidarité nationale, c'est la souveraineté alimentaire qui est mise en danger.

Ces interventions confirment que nous avons un travail à mener. Le Gouvernement a lancé l'an dernier une réflexion sur l'assurance de la perte d'exploitation liée à la pandémie puis l'a refermée en fin d'année. Je le regrette, compte tenu du travail collectif qui a été mené. Aux risques classiques, s'ajoutent des risques nouveaux et exceptionnels, avec un caractère coûteux et répétitif. L'État ne pourra pas s'occuper de tout et je pense, après la proposition de loi sur laquelle nous avons travaillé, qu'il faut engager une réflexion sur la mise en place d'une sorte de« partenariat public-privé ». Ces risques pourraient être couverts avec des « captives » : quel est votre point de vue ?
Axa vient de relancer deux initiatives. La première prend en compte l'image laissée par le secteur et prévoit un engagement de l'ordre de 300 millions d'euros pour indemniser les restaurateurs dans un délai très court. La seconde est une volonté de travailler à des solutions nouvelles, dans un « partenariat public-privé ». Qu'en pensez-vous ?
S'agissant du monde agricole, des risques nouveaux, répétés ou coûteux créent des drames pour les propriétaires touchés. Un groupe de travail, présidé par le député Frédéric Descrozaille, travaille sur la gestion des risques agricoles. Quelles sont les solutions à imaginer ?
Comment mutualiser de manière très large afin d'éviter les phénomènes d'anti-sélection ? Nous avions proposé dans la proposition de loi une garantie additionnelle à caractère obligatoire, afin d'ajouter une mutualisation par les professionnels à la mutualisation entre les contribuables via l'impôt.
Au total, je comprends vos prises de position, je ne les partage pas toutes mais le dispositif actuel n'est pas satisfaisant et nous devons être imaginatifs de manière collective.

Il y a un problème assurantiel concernant la voirie communale par exemple lorsque survient un « épisode cévenol » : je connais bien la difficulté des maires à remettre en état la voirie après un tel épisode.
S'agissant de l'agriculture, les récoltes devaient être assurées car l'exceptionnel devient fréquent. Sur les cinq dernières années, une seule a été bonne. Par exemple, la plupart de ceux qui sont passés en exploitation biologique n'ont pas résisté à l'attaque de mildiou sur la vigne.
Je rejoins le rapporteur général : il faut mêler la participation du contribuable et celle de l'assuré, même si en fin de compte il s'agit souvent de la même personne.

Je n'ai pas compris si le fonds des calamités agricoles doit continuer à exister ou non. La profession accepte-t-elle d'aller uniquement vers l'assurantiel ? Au contraire, veut-elle garder ce fonds et à chaque épisode climatique, comme celui récent du gel, avoir un ministre qui se déplace pour débloquer des enveloppes budgétaires ? Va-t-on également vers la prévention des risques, par exemple en faisant des réserves d'eau, sachant que la législation sur le climat met des freins en permanence en la matière ?
Mme Pauzat, vous disiez que les TPE et PME étaient assurées pour la perte d'exploitation, mais qu'il y a eu des déclarations de sinistre sans effet, et donc qu'elles n'avaient pas eu suffisamment d'information de la part de leur assureur. En même temps, j'entends que le cyber-risque pouvait devenir la pandémie du futur. Les TPE et PME ont-elles vraiment pris conscience de ce risque et se sont-elles assurées ?

Nous savons que nous allons connaître une recrudescence des catastrophes en tous genres dans les années à venir. Peut-on envisager un fonds européen de garantie qui serait abondé à la fois par le secteur privé exploitant les activités ayant un impact sur le climat et par les États eux-mêmes ?

S'agissant de l'assurance des cultures, il semble qu'il serait proposé une couverture par les assurances pour les pertes de 20 % à 50 % des récoltes, et par le régime des calamités agricoles pour le reste. Le confirmez-vous et avez-vous évalué l'impact sur les dispositifs assurantiels que vous gérez et pour les cotisations à l'hectare ? Le niveau de cotisation est différent en fonction de la valeur des productions agricoles à l'hectare. L'arboriculture est peu couverte, et pour cause, car les cotisations sont rédhibitoires pour les exploitants.
Je pense aussi qu'il faut une réflexion sur un régime de mutualisation à l'échelle européenne. Les phénomènes de gel sont récurrents et liés au réchauffement climatique. L'Europe de l'ouest est plus exposée que l'Europe continentale en raison des différences dans les dates de floraison.

La liberté, pour les entreprises, de s'assurer ou non a-t-elle des conséquences sur le soutien de l'État ? Il serait curieux qu'on puisse choisir de ne pas s'assurer tout en comptant ensuite sur l'État.
Pour nous, le régime des calamités agricoles dans sa forme actuelle est obsolète : il nous faut complètement réinventer ce système. En matière de pertes, nous estimons que c'est supportable pour les agriculteurs et qu'ils peuvent les prendre en charge jusqu'à 20 %, que ce soit par le biais de la fiscalité ou de dispositifs de prévention des risques (stockage d'eau, filet para-grêle, système anti-gel). Il nous faut en effet un vrai plan de bataille et d'accompagnement de l'investissement en faveur de la prévention : tout investissement en faveur de la prévention sera toujours plus rentable que d'intervenir sur du curatif. Pour autant, et même si cela fait des années que nous attirons l'attention sur ce point, le curatif reste le premier réflexe.
Parallèlement à ces dispositifs, et nous le signalons depuis longtemps aux assureurs, il faut mener une vraie expertise des risques et mesurer l'exposition au risque de chaque entreprise agricole afin de définir le montant le plus juste pour la prime d'assurance. Par exemple, dans le système des bâtiments agricoles, lorsqu'on installe des dispositifs anti-incendie, c'est pris en compte par l'assureur et on peut renégocier le contrat d'assurance. Les assureurs ont toute la compétence nécessaire pour mener ce travail.
Dans notre schéma et dans nos propositions, l'acteur majeur, c'est l'assureur. L'assureur peut s'appuyer sur sa proximité : le grand intérêt de ce système, c'est la rapidité d'indemnisation des agriculteurs. Aujourd'hui, le régime des calamités agricoles indemnise jusqu'à un an après les dégâts, ce qui n'est pas tenable en matière de trésorerie. Il faut donc conserver le lien avec l'assurance et vraiment utiliser toutes les compétences de l'assureur, de la gestion de la partie assurance à la partie risque. Sur la partie assurance, il faudrait une prise en charge pour les pertes de rendements allant de 20 % à 50 %, qui s'adapterait en fonction des filières. Toutes ne peuvent en effet pas être abordées de la même façon : lorsqu'il y a un épisode de gel ou de grêle violent, les secteurs de l'arboriculture et de la viticulture peuvent perdre jusqu'à 100 % des récoltes, tandis qu'on n'a quasiment jamais vu un exploitant perdre 50 % de son revenu en prairie. Il faudrait donc mettre en place des curseurs selon les filières, qui détermineraient à partir de quel niveau de pertes la solidarité nationale prendrait le relais.
Il faut ensuite regarder le taux d'indemnisation. Je rappelle que dans le cas du régime des calamités agricoles, il faut justifier d'au moins 30 % de pertes, pour une indemnité à hauteur de 28 %. Cependant, pour quelqu'un qui a perdu 100 %, ne devrait-on pas plutôt considérer que l'assureur en prend une partie en charge, sur le volet de 20 % à 50 %, et qu'ensuite cela revient à l'État ? Cela nous permettrait de renforcer la solidité économique des assureurs, tout en allant vers un vrai partenariat public-privé. Nous passerions ainsi d'un mécanisme collectif et public des calamités à un système plus proche de ce partenariat public-privé. Je considère que nous n'aurons pas le choix que de suivre cette évolution si nous voulons conserver notre souveraineté alimentaire.
Sur le capital assuré, oui, il faut trouver des curseurs qui nous permettent de nous appuyer sur ces éléments. Un hectare de prairie n'a que peu à voir avec un hectare d'arboriculture. Je crois savoir qu'en matière de chiffrage, ces simulations sont en cours. Le groupe de travail sur la réforme de la gestion des risques, piloté par Hervé Lejeune et Frédéric Descrozaille, doit bientôt rendre ces conclusions. Nous attendons quant à nous beaucoup de l'État, et en particulier du ministère de l'économie, des finances et de la relance, parce qu'il apparait très en retrait sur le sujet, en s'interrogeant seulement sur le coût immédiat. Dans l'esprit du ministre Bruno Le Maire, l'idée était plutôt celle, en contrepartie de la solidarité nationale, de l'assurance obligatoire.
Or, nous considérons que l'assurance obligatoire ajoute certaines complexités, par exemple au regard de l'accompagnement financier dans le cadre des aides européennes. On est donc plutôt sur une approche d'assurance « conditionnée ». J'ajoute que si on n'avait pas de responsables agricoles dans certaines compagnies d'assurance, qui connaissent bien ces enjeux, cela ferait au moins un ou deux ans qu'on aurait certainement mis fin à cette offre assurantielle pour l'agriculture.
Ce système ne marchera que s'il y a une offre assurantielle pour tous les secteurs, y compris donc les petits secteurs qui, seuls, ne pourront pas y arriver. Les assureurs doivent donc s'engager filière par filière, tout en conservant un socle minimal de mutualisation. C'est un chantier immense, mais le changement climatique va beaucoup plus vite que nous et nous impose d'avancer sur ces réformes.
Concernant les captives de réassurance, ce n'est pas aujourd'hui un sujet TPE/PME parce que cela semble très complexe. En revanche, ce que l'on avait évoqué lors du groupe de travail, c'était l'éventualité de s'inspirer des contrats « indemnités de fin de carrière » (IFC), c'est-à-dire de donner la possibilité - et ce serait aussi possible pour un commerçant - de cotiser tous les mois ou à la fin d'un bon exercice, et d'avoir ce contrat qui puisse servir en cas de matérialisation de risques exceptionnels. L'idée, c'était également de prévoir quelques cas de déblocages exceptionnels - à l'instar de ce qui est prévu par exemple pour la participation ou l'épargne salariale. Si la société s'approche d'une situation dans laquelle elle serait en cessation de paiement, il faut lui donner la possibilité de récupérer les fonds mis de côté.
Concernant la cybersécurité, les TPE et les PME n'ont pas encore bien pris conscience que le risque cyber pouvait être la pandémie de demain. Il faut vraiment mener un travail de sensibilisation dans ce domaine. Des entités publiques ou privées commencent à travailler sur ce point, que ce soit pour sensibiliser les entreprises ou les collaborateurs, par le biais de mises en situation.
Je crois vraiment qu'il y a là un vrai travail à faire. C'est d'abord, et surtout en matière de sensibilisation, le rôle de tous : les entreprises, les organisations, les experts-comptables, les assureurs et les banquiers. Les TPE se sentent en effet très peu en danger parce qu'elles ont l'impression qu'elles ne sont pas des cibles prioritaires, qu'elles ne disposent pas d'actifs aussi précieux que ceux des grandes entreprises. Or, la cyber-criminalité, ce n'est pas forcément chercher à s'attaquer aux actifs les plus valorisés ou les plus secrets, c'est avant tout une tentative de gripper le système, de nuire à l'entreprise. C'est un sujet dont tout le monde doit s'emparer, et vite. À titre d'exemple, la CPME a créé une commission spécifique avec un président en charge de ce sujet.
Concernant la liberté pour les entreprises de s'assurer ou non, et de maintenir ou non en contrepartie un soutien de l'État, je souhaite rappeler le contexte de 2020. L'assurance n'existait pas ou peu pour répondre à cette situation. Il y avait bien des assurances couvrant les pertes d'exploitation, mais entourées de clauses dans les contrats qu'on a eu du mal à interpréter. Or, durant la crise, les personnes et les entreprises ayant reçu une indemnisation suffisante ont moins fait appel, voire pas du tout fait appel, aux solutions de solidarité mises en place par l'État. Il y a donc un équilibre à trouver, on peut aller vers ce binôme assurance-État.
Les entreprises ne sont pas des chasseurs de subventions et de primes : l'objectif n'est pas de bénéficier d'aides indues, de gagner plus grâce à ces mécanismes de solidarité, mais bien de sauver son entreprise. On pourrait toutefois envisager, après avoir vu ce qui s'est passé durant la crise sanitaire, de rendre obligatoire l'assurance pour certains risques : s'il y a un produit qui existe, alors l'entreprise doit s'assurer sur ce produit, ne serait-ce qu'un minimum. L'État pourrait alors ne pas couvrir ces pertes d'exploitation, assurées, mais c'est un sujet sur lequel il faut que l'on travaille avec nos adhérents.
Concernant le fait que les voiries et les ouvrages d'art et d'infrastructures publiques ne sont pas couverts par l'assurance catastrophes naturelles, il faut rappeler que ces ouvrages ne sont pas exposés aux vols ou aux incendies. L'assurance dommages aux biens devait à l'origine couvrir le vol et l'incendie, c'est simplement une surprime, une extension de garantie qui couvre les dommages consécutifs à une catastrophe naturelle. Il n'est cependant pas du tout interdit d'envisager une assurance obligatoire et spécifique dont la prime serait calculée en fonction des capitaux assurés. Ce sont des choses tout à fait faisables.
Le fonds européen de garantie pour les risques climatiques est très séduisant, même si on ne sait pas trop s'il aurait vocation à couvrir les catastrophes naturelles ou seulement les risques climatiques pesant sur les récoltes. J'ai travaillé sur cette idée avec des collègues italiens, allemands ou espagnols. Toutefois, le fait est que l'exposition aux risques naturels est très diverse d'un pays à l'autre : le risque sismique et volcanique pour les Italiens, le risque inondations pour les Allemands. Si vous ajoutez à cela la diversité culturelle par rapport à la socialisation des risques et à l'intervention de l'État, vous en concluez vite que l'idée même d'un étage européen, sans parler d'un système européen, est très compliquée. Même s'ils reconnaissent le mérite du régime français des catastrophes naturelles, nos homologues allemands n'ont pas du tout la même approche que nous.
Pour illustrer mon propos liminaire, je voudrais revenir sur le régime pour couvrir les pertes d'exploitation et la réforme de l'assurance des risques climatiques sur récoltes. Il est absolument critique et indispensable de clarifier le rôle entre l'assurance agricole et le fonds de gestion des risques en agriculture. Tant que l'on n'aura pas fait cet effort, en limitant très clairement l'intervention du régime des calamités agricoles à des situations très spécifiques, il n'y aura jamais d'assurances agricoles viables et pertinentes.
J'ai indiqué qu'il fallait également éviter la tentation du couteau suisse. Il y a quelque chose qui existe aujourd'hui pour le terrorisme, c'est le GAREAT (Gestion de l'Assurance et de la Réassurance des risques Attentats et actes de Terrorisme). C'est un pool de co-assurance par lequel, lorsqu'il y a un attentat qui cause des dommages à une grande entreprise, les assureurs en couvrent le coût de manière solidaire. C'est en même temps un groupement d'achat de réassurance par lequel ils achètent en commun la réassurance auprès du marché privé. Copier ce dispositif pour les risques agricoles ne semble pas être la bonne option. Nous avons en effet aujourd'hui affaire à des assureurs dont le modèle économique sur les risques agricoles est profitable et d'autres pour lequel il l'est moins. La partie pool de co-assurance aurait donc déjà du mal à fonctionner. Quant au groupement d'achat de réassurance, il n'y a pas de problème de capacité sur le marché privé de la réassurance en matière de risque agricole. C'est un risque qui est couvert massivement, partout dans le monde, qui se mutualise très bien à l'échelon international et ces mêmes capacités existent en France.
Sur le risque agricole, ce que j'ai retenu des difficultés de cette assurance, c'est qu'elle est techniquement déficitaire, quasiment tous les ans. Si on veut qu'elle prospère, et indépendamment de toute idée de régime ou de partenariat public-privé, il faut tout de même, comme pour les catastrophes naturelles, se dire que cela doit concerner des événements rares, les catastrophes au sens strict du terme. Par exemple, pour les catastrophes naturelles, sont visées celles qui surviennent moins d'une fois tous les dix ans. Si cela intervient tous les deux-trois ans, on comprend bien que ce ne peut pas être financièrement équilibré. Le prix de l'assurance ou le surcoût que l'on fait peser sur le contribuable serait trop élevé. En revanche, la réassurance publique des catastrophes naturelles est quasiment équilibrée. En près de quarante ans d'exercice, on a fait appel une fois à la garantie de l'État et pour un montant assez modique. Cela signifie que la prime de réassurance permet l'équilibre et apparaît suffisante. On a donc un dispositif certes public, mais qui s'équilibre. Si l'idée était de faire intervenir la réassurance publique pour couvrir les pertes récurrentes et certaines d'un dispositif de couverture des risques agricoles, alors il ne faudrait pas appeler cela de la réassurance publique mais il faudrait créer un fonds, par exemple en recyclant le fonds de gestion des risques en agriculture, qui deviendrait un fonds de solidarité abondé par le contribuable. C'est important pour la crédibilité de nos dispositifs de réassurance publique.
Sur les pertes d'exploitation sur dommages, je pense qu'il y a deux voies. La difficulté que nous avons rencontrée, outre la frilosité et l'opposition de certaines parties prenantes, était ce sentiment d'être devant un risque binaire : soit le risque ne survient pas, et il peut ne pas survenir pendant 30 ou 40 ans, soit le risque survient et cela peut coûter 50 ou 60 milliards d'euros. Ce n'est pas du tout la même configuration que le risque catastrophes naturelles, où il y a toujours de 300 à 600 millions d'euros de catastrophes naturelles de tailles diverses et variées par an, et de temps en temps plusieurs milliards d'euros. Cette non-granularité du risque de pandémie appliquée aux pertes d'exploitation était une vraie difficulté. Si on veut couvrir ces pertes, il y a deux approches possibles. La première est assez libérale : on n'impose aucune obligation, aucune extension obligatoire de garantie mais on cherche simplement à promouvoir les garanties d'assurance pertes d'exploitation, qui ne sont pas généralisées chez les PME et les ETI. Elles sont encore plus rares pour les pertes sans dommages, du fait aussi de difficultés techniques : ces garanties sont techniquement très difficiles à définir, à tarifer, à mettre en place et à indemniser. Il n'y a guère que les grandes entreprises qui arrivent à obtenir des garanties d'assurance sur mesure, pour leurs besoins. Si on veut développer ce marché, il faut être très modeste, l'appliquer à des domaines spécifiques, par exemple l'annulation de billetteries de spectacles ou encore les cautions que doivent donner les agences de voyage. Si on doit aller vers un régime général, je rejoins l'idée qu'il faut qu'il y ait une forme d'obligation d'assurance, d'extension obligatoire de garantie d'assurance. Dans le cas contraire, il n'y aurait pas de possibilité de mutualiser les risques.
Je vais essayer de conclure de façon constructive. Le point central reste le caractère très important du risque. Le problème est celui du coût du risque.
Monsieur le rapporteur général, je vous remercie de tenter de remettre au centre du jeu une solution assurantielle fondée sur un partenariat public-privé. C'est selon moi la seule façon d'avoir une indemnisation en ligne avec les attentes des assurés et des citoyens. Ce qui permet la mutualisation la plus large, c'est l'inclusion dans tous les contrats dommage. Quand on a une mutualisation extrêmement large, le coût est très restreint pour une TPE. D'après nos évaluations, pour une TPE qui fait moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, pour 4 euros par mois, elle peut s'acheter une indemnisation qui peut aller jusqu'à 3 750 euros. Un restaurant qui fait un million d'euros de chiffre d'affaire par an va payer une prime de 26 euros par mois, et il peut toucher jusqu'à quasiment 22 000 euros en cas de crise. Les montants de primes évalués me paraissent abordables pour toutes les tailles d'entreprises. Votre proposition, Monsieur le rapporteur général, recouvre en partie celle de la FFA. Effectivement, les contrats de pertes d'exploitation en assurance sont des contrats mis en oeuvre après dommage pour couvrir les frais fixes pendant la période de fermeture de l'établissement, comme en cas d'incendie par exemple. Cette garantie est complexe car l'indemnisation nécessite notamment de se plonger dans les comptes de l'entreprise sur plusieurs années. Dans un cas exceptionnel avec des conséquences économiques d'une fermeture administrative de certaines activités économiques, il faut agir vite, d'où l'idée d'une indemnisation forfaitaire. Les exemples que je vous ai donnés partent de marges brutes qui sont différentes selon les activités, évaluées à partir des données de l'INSEE. L'indemnisation forfaitaire permet de verser rapidement les sommes dues, comme dans votre proposition de loi qui prévoit un délai de 30 jours. Une large mutualisation est valable pour le régime « CATNAT », donc je continue de penser que c'est une solution.
Certes, il est complexe d'imposer une garantie alors que certains vont payer toute leur vie, sans toucher de compensations. Mais ce régime pourrait indemniser les conséquences économiques résultant d'une fermeture administrative décidée dans le cadre d'autres évènements, plus locaux, comme une menace terroriste qui peut motiver une fermeture administrative, mais aussi la menace d'une catastrophe sanitaire, ou les manifestations comme celles des gilets jaunes. On a fait le chiffrage de cette garantie principale pour la pandémie, mais ce type de solution n'est pas encore totalement abouti, et il faut continuer à travailler de manière collégiale.
Aujourd'hui, d'autres solutions sont envisagées. La première solution est fondée sur l'épargne, sur le modèle de l'épargne défiscalisée pour les agriculteurs. Les assureurs sont prêts à y répondre, mais je ne suis pas convaincue que l'indemnisation à la clé soit à la hauteur du montant capitalisé. Il faut veiller à ne pas faire miroiter la promesse d'une garantie qui risque de décevoir les assurés, en plein milieu d'une crise.
S'agissant des captives de réassurance, elles consistent à mutualiser le risque dans le temps, et j'y suis très favorable. Cette pratique était courante en France auparavant. Le principe est d'accumuler, tant qu'il n'y a pas de sinistre, en provisions dans ses comptes. Or, aujourd'hui, le régime fiscal ne permet pas de le faire. On pouvait auparavant faire des provisions d'égalisation déductibles, permettant de repousser les limites de l'assurabilité. Juridiquement, une captive est une société d'assurance ou de réassurance qui a des actionnaires particuliers. On peut imaginer une possibilité de lissage des risques, qui pourrait être ouverte à l'ensemble des acteurs de l'assurance, assureur ou réassureur. On pourrait ainsi rapatrier depuis le Luxembourg en permettant de constituer des provisions d'égalisation en franchise d'impôt.
La CCR a fait une proposition de longue date à la direction générale du Trésor pour avoir un traitement fiscal adéquat des provisions d'égalisation, qui évite d'avoir une fuite de l'assiette fiscale de l'assureur et des réassureurs, et de limiter l'objet des provisions d'égalisation aux risques pour lesquels c'est justifié. La solution technique existe.

Je vous félicite de profiter de votre passage devant la commission des finances pour faire passer le message...
Pour conclure, je rappelle que l'assurance est un métier de service, nous expliquons les contrats. Beaucoup de pédagogie reste à faire. Il faut partager la culture du risque. Dans le cadre de l'assurance agricole, la première proposition que nous faisons est d'accroître la prévention et la culture du risque. Nous suggérons d'ajouter un module sur l'assurance dans la formation des candidats à l'installation agricole.
Dans le domaine de la prévention, nous avons en France des programmes d'action de prévention des inondations (PAPI), mis en oeuvre par les communes. Il faudrait y intégrer les surfaces agricoles de façon à alerter les agriculteurs sur les risques qu'ils encourent.
L'autre volet est le développement de l'assurance : comment fait-on pour convaincre les gens de s'assurer ? Notre proposition est de conditionner les aides publiques à la détention de la garantie d'une assurance privée. Par exemple, conditionner la déductibilité de l'épargne de précaution à la souscription d'une assurance sur les récoltes. Il faut également limiter le coût, notamment en allant au maximum de ce que le règlement « omnibus » nous permet de faire.
Enfin, il est évident qu'il faut trouver une solution pour les risques de pointe. Il faut bien distinguer le fonds de gestion des risques en agriculture de la couverture de base, et il faut faire de l'assureur le guichet unique. Ceux qui sont touchés par une catastrophe ne doivent pas être obligés de s'adresser à plusieurs intermédiaires. Les assureurs peuvent déployer de grandes capacités sur un territoire donné pour accompagner les sinistrés.

Je remercie l'ensemble des intervenants pour leur participation.
La réunion est close à 18 h 15.