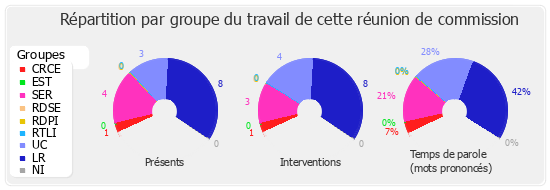Commission des affaires sociales
Réunion du 22 mars 2023 à 8h30
Sommaire
- Audition de mme sandrine duchêne préalable à sa nomination au haut conseil des finances publiques par le président de la commission des finances du sénat (voir le dossier)
- Audition de m. patrick dehaumont candidat à la présidence du conseil d'administration de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail anses (voir le dossier)
La réunion
Audition de Mme Sandrine duChêne préalable à sa nomination au haut conseil des finances publiques par le président de la commission des finances du sénat
Audition de Mme Sandrine duChêne préalable à sa nomination au haut conseil des finances publiques par le président de la commission des finances du sénat

Nous auditionnons Mme Sandrine Duchêne, que j'envisage de nommer au Haut Conseil des finances publiques (HCFP) afin de succéder à M. Éric Heyer dont le mandat de cinq ans non renouvelable vient à expiration ce mois de mars.
M. Heyer avait été nommé par mon prédécesseur, Vincent Éblé. Dans le cadre de cette audition publique, je veux en préambule le remercier de la manière dont il a exercé son mandat dans un contexte particulièrement intense pour le HCFP, marqué par la succession des textes financiers et des avis remis pendant la crise sanitaire, économique et énergétique. Il est également intervenu à plusieurs reprises devant notre commission pour apporter un éclairage précieux à nos travaux.
Je me permets, Madame Sandrine Duchêne, de vous remercier également pour votre présence parmi nous. Aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 6 décembre 2021 portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l'information du Parlement sur les finances publiques, votre nomination ne peut en effet intervenir qu'après une audition publique et conjointe de nos commissions des finances et des affaires sociales. Cette audition ne donne pas lieu à un vote.
Comme vous le savez, le Haut Conseil des finances publiques est un organisme indépendant chargé d'apprécier le réalisme des prévisions macroéconomiques du Gouvernement et de se prononcer sur la cohérence de la trajectoire budgétaire gouvernementale avec les objectifs pluriannuels de finances publiques et les engagements européens de la France.
Composé de onze membres, dont deux sont nommés respectivement par le président du Sénat et le président de la commission des finances du Sénat, en raison de leurs compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et des finances publiques, il est placé auprès de la Cour des comptes et présidé par le Premier président de cette dernière.
Je vous propose donc de commencer cette audition par un exposé liminaire - relativement concis puisque nous disposons au total d'une heure pour cette audition - exposé par lequel vous pourrez nous exposer votre parcours et votre conception du rôle du Haut Conseil des finances publiques. Mais auparavant je cède la parole à ma collègue présidente de la commission des affaires sociales.

Merci pour votre présence. La commission des affaires sociales est toujours très attentive aux avis rendus par le Haut Conseil des finances publiques, au moment de l'examen du PLFSS et plus récemment lors de l'examen du PLFRSS qui a porté la réforme des retraites. Le HCFP a d'ailleurs souligné le peu d'informations dont il disposait pour étayer son avis.
Je souhaite donc simplement, Madame Duchêne, que vous précisiez dans votre propos liminaire, si vous avez une certaine familiarité avec les finances sociales et, le cas échéant, le regard que vous portez sur ce sous-secteur des finances publiques.
J'ai une formation de statisticienne, étant entrée dans le corps des administrateurs de l'INSEE en 1993, j'ai exercé pendant vingt ans des fonctions opérationnelles de prévision économique et financière à Bercy. Je peux dire que je suis tombée dans les finances publiques, au sens large, à l'occasion d'un changement de poste, à l'automne 2002, dans un contexte où il devenait plus probable que le seuil dit de Maastricht, de 3 % de déficit public, serait franchi, et où nous avons également franchi le critère de dette. Je n'ai plus vraiment quitté ce chaudron des finances publiques et sociales, dans mes postes successifs, j'ai aussi travaillé auprès du président François Hollande entre 2012 et 2013, puis j'ai été directrice générale adjointe à la direction du Trésor, où j'ai été auditionnée par le HCFP, qui venait d'être créé.
Je peux donc dire que je suis du métier, ce métier spécifique qui assemble de la technique statistique, des schémas de prévision et de l'analyse économique des finances publiques - l'objectif étant de donner à voir le sous-jacent des politiques économiques, au-delà des chiffres, ceci en articulant les aspects de gouvernance européenne et nationale. J'ai aussi beaucoup oeuvré dans la sphère européenne, depuis la définition, en 2005, du pacte de stabilité et de croissance, jusqu'à ses réformes successives qui ont fait l'empilement de règles que l'on déplore aujourd'hui - cette matière est très riche et je peux dire que ce métier m'a passionnée. Je m'en suis éloignée et je suis actuellement directrice des risques, de la conformité et du contrôle permanent de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, ce qui me donne un autre point de vue qui peut éclairer les débats du HCFP, surtout dans la turbulence financière que nous connaissons. J'ajoute qu'en 2015, j'ai aussi rejoint le comité budgétaire européen, l'instance indépendante chargée de donner son avis à la Commission européenne sur les politiques budgétaires de la zone euro et ce qu'on appelle la politique budgétaire agrégée - pour décider s'il faut relancer, ou bien consolider les finances publiques -, et chargée également de formuler un avis de conformité sur le contrôle des budgets nationaux par la Commission européenne, - ce qui n'est pas la partie la plus facile -, et de faire des propositions de réformes des règles budgétaires européennes. J'ai exercé ce mandat pendant trois ans, jusqu'en 2019, ce qui m'a permis d'examiner de près les mécanismes budgétaires européens.
Pourquoi candidater au HCFP ? Ma première motivation est citoyenne, je cherche d'abord à être utile. Nous connaissons la situation des finances publiques après la crise sanitaire, les incertitudes actuelles : il n'y a rien de simple, il va falloir combiner la soutenabilité des finances publiques, la trajectoire de notre endettement, et la satisfaction des besoins cruciaux de notre société, en matière d'investissement, de transition économique, de santé, de sécurité, ou encore de souveraineté. L'équation n'a jamais été si complexe, et je souhaite, avec mon bagage et mes convictions, me placer au service du HCFP et du Parlement.
Nous avons besoin de clarté et de transparence. J'ai suivi le long chemin vers la transparence, j'espère que l'information transmise au Parlement s'est enrichie au fil des ans, c'est l'une des missions de Bercy. La création du HCFP en 2012 a été un pas important dont nous n'avons pas, au départ, mesuré la portée. Il était innovant de faire intervenir une institution indépendante en amont de la transmission des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale au Parlement - cela a permis un échange, des questions et des réponses, une exigence de cohérence sur les chiffres et sur leur articulation, donc sur la pertinence des mesures pour atteindre les objectifs définis. Je l'ai vécu au cours de mon expérience, je suis particulièrement sensible à l'enjeu démocratique du contrôle sur le budget de la Nation. Le HCFP a trouvé sa place, comme institution indépendante, ses avis sont mieux relayés, il fait entendre sa voix.
Que puis-je lui apporter, au-delà de la technicité ? Je crois que le rôle d'un membre du HCFP, c'est de se poser des questions, de les poser, et d'expliciter ce qui fait sens dans ce qu'il observe. Vous pouvez compter sur moi : j'essaierai de vous donner le maximum d'éclairage pour exercer vos fonctions dans les meilleures conditions.

Ce que vous constatez du HCFP correspond-il à la vision que vous en avez et pensez-vous que ses avis devraient avoir plus de collégialité ? Nous avons déploré le défaut d'adoption de la loi de programmation des finances publiques : quelle est votre position sur le sujet ? N'apporterait-elle pas des éléments de clarté, de transparence et de réalisme ? Même sans loi de programmation, la loi de financement de la sécurité sociale a une portée pluriannuelle puisque son annexe, obligatoire, doit donner une trajectoire pluriannuelle : le HCFP ne pourrait-il pas utiliser cette trajectoire pour évaluer la maitrise des dépenses ? Ne pourrait-il pas émettre un avis sur la trajectoire quadriennale ?
Je retiens votre motivation pour ce poste, je sais que les finances publiques font peur, pour leur aridité, alors qu'elles sont déterminantes, on l'a encore vu avec la réforme des retraites. Comment, à votre avis, mieux expliciter les enjeux des finances publiques et sociales ? Parce qu'il y a des choix à faire, il faut les expliquer : j'aimerais trouver un chemin, non pas de vulgarisation des finances publiques, mais de pédagogie, qui aide chacun à bien se positionner en toute connaissance de cause.

Je vous prie d'excuser le rapporteur général Jean-François Husson, qui est en réunion avec le Président du Sénat. Quel regard portez-vous sur le pacte stabilité et de croissance tel qu'il existe et sur les propositions d'un nouveau cadre, qui, en particulier, prendrait mieux en compte les investissements nécessaires à la transition écologique et les trajectoires budgétaires définies par les États membres ?
Le budget de la Nation exprime des choix et plus on est clair, plus on est audible : il ne faut pas laisser croire que tout est dans le tout, il y a bien une responsabilité financière et les lois de finances et de financement de la sécurité sociale sont un outil majeur des choix politiques. Mon rôle, c'est de remettre les mots auprès des chiffres, et je vous rejoins, Madame la rapporteure générale, il faut expliciter les choses, plutôt que de se cacher derrière la technique.
Je vous rejoins aussi sur la collégialité : il me semble très important que dans une institution indépendante, il y ait une forme de collégialité et une recherche du consensus, qui sera d'autant plus riche qu'il y aura eu débat et que celui-ci aura entrainé un accord, j'y serai attentive.
Le défaut de loi de programmation des finances publiques crée un vide juridique, ce qui n'empêche pas le HCFP de dire ce qu'il a à dire. Il serait souhaitable qu'une nouvelle loi de programmation soit débattue et votée, c'est un échelon essentiel pour s'inscrire dans le cadre européen, ce lien est une avancée. Je ne suis pas assez juriste pour dire si l'avis sur l'annexe de la trajectoire de la loi de financement serait suffisant. La mission du HCFP a été élargie, le mandat inclut la prévision, les dépenses, les recettes, la compatibilité avec la trajectoire pluriannuelle, mais le HCFP ne peut s'autosaisir de questions dépassant son mandat.

Le HCFP nous a régulièrement dit qu'il était saisi dans un délai très court, voire trop court pour fonder un avis véritable : qu'en pensez-vous ? Si ce délai est trop court, estimez-vous que le HCFP pourrait ne pas émettre d'avis, pour contester cette situation ? Ensuite, si l'on n'a pas de loi de programmation, dans quelle mesure le pacte de stabilité et de croissance s'applique-t-il ? Enfin, ne pensez-vous pas qu'avec l'inflation, la dette soit devenue la menace principale sur les finances publiques ?

Le Sénat vient de publier un excellent rapport sur les cabinets de conseil, à l'issue de sa commission d'enquête sur le sujet : est-ce que, selon vous, le HCFP doit recourir à des cabinets de conseil ?

Pensez-vous que les analyses financières soient neutres politiquement ? La logique d'organisation territoriale autour des métropoles, par exemple, a conduit à sous-estimer les territoires ruraux, et quand on a changé la façon de classer la population française, au 1er janvier 2021, la population rurale est passée de 18 % à 30 %, c'est bien le signe qu'on fait dire un peu ce qu'on veut aux chiffres... Le cadre budgétaire européen, ensuite, vous parait-il adapté aux défis qui sont devant nous, en particulier en matière d'investissement ?

Que pensez-vous des monnaies numériques ? Que pensez-vous, également, des différentiels de taux d'intérêt entre pays de la zone euro ?
Le délai pour donner l'avis est toujours un sujet, je n'ai jamais vu un membre du HCFP dire qu'il avait disposé d'un délai satisfaisant pour examiner des textes. Cependant, c'est compliqué, je connais les contraintes d'élaboration des textes financiers, et refuser de rendre l'avis, cela ne me parait pas une solution, ce serait une forme de renoncement. Mieux vaut faire pression sur les ministères pour que le délai soit allongé, et vous avez votre rôle à jouer en la matière ; ensuite il faut compter sur l'intelligence et la célérité du HCFP, qui fait toujours au mieux, avec son équipe. Je ne vois pas l'intérêt de recourir aux cabinets de conseil, le HCFP a des moyens, il peut auditionner en tant que de besoin et il a toute latitude pour conduire ses travaux.
La loi de programmation et le pacte de stabilité sont liés, effectivement. L'idée, c'est de raccorder les lois de finances et de financement au pacte de stabilité, via la loi de programmation et c'est un progrès en cela. Cependant, les textes n'ont pas le même statut, puisque le pacte de stabilité est un engagement de la France à l'égard de ses partenaires européens, tandis que les lois de finances et la loi de programmation relèvent de la procédure budgétaire nationale. Je crois que la connexion est intéressante, et qu'il ne faut pas y renoncer.
La dette engage la soutenabilité des finances publiques, il faut regarder le sujet, notre endettement, public et privé, a effectivement augmenté, la remontée des taux entraine des risques sur les finances publiques - il faut éviter un emballement, nous n'y sommes pas et il faut regarder ce qu'on peut faire à moyen terme, pour prendre les mesures propres à rendre l'environnement financier lisible par les acteurs économiques et sociaux.
Les chiffres ne sont pas neutres, effectivement, la statistique publique doit répondre à la demande sociale d'information, il y a un dialogue avec la société civile : l'enjeu démocratique est important.
En 1997, le cadre budgétaire européen était simple, mais pas adapté à l'économie ; il a été modifié, mais au prix d'un empilement de règles, de négociations, et nous en sommes arrivés à un cadre complexe qui ne répond plus aux objectifs assignés. Les propositions de la Commission européenne pour le changer me semblent aller dans le bon sens, il faut faire plus simple, prendre en compte la situation de chaque État membre, allonger les calendriers, mieux considérer l'endettement à moyen terme - tout ceci pour revenir à l'essentiel : la dépense publique et les prélèvements obligatoires, en prenant en compte les investissements jugés nécessaires. Nous savons depuis le départ que la prise en compte du déficit courant biaisait l'appréciation et qu'il fallait inclure les investissements, le sujet revient dans l'actualité et c'est une bonne chose.
Les données numériques changent-elles la vision des finances publiques ? Elles donnent un accès à de l'information plus précise, améliorent la prévision économique et financière, on l'a vu pendant la crise sanitaire. Sur l'euro, je dirais qu'actuellement, on mesure bien l'apport de la monnaie intégrée, une monnaie de puissance à puissance - et je crois qu'on mesure qu'il vaut mieux être dedans, que dehors.

Merci pour cette audition. Je précise à chacun que Sandrine Duchêne m'a parue avoir au moins deux qualités essentielles pour ce poste : la technicité, c'est très important pour une telle institution, il y a des prérequis pour comprendre ce dont on parle ; et un parcours diversifié, en particulier son poste actuel, plus économique, où elle a pu mesurer les conséquences des décisions publiques. Je pense - et j'espère - qu'avec elle, nos très bonnes relations de travail avec le HCFP pourront se poursuivre.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
Audition de M. Patrick deHaumont candidat à la présidence du conseil d'administration de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail anses
Audition de M. Patrick deHaumont candidat à la présidence du conseil d'administration de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail anses

Mes chers collègues, nous entendons, ce matin, M. Patrick Dehaumont, candidat proposé par le Gouvernement aux fonctions de président du conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). En application de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique, sa nomination doit être précédée de son audition par les commissions compétentes du Parlement.
Je vous précise que cette audition fera l'objet d'une captation vidéo, qui sera retransmise en direct sur le site internet du Sénat et sera consultable en vidéo à la demande.
Comme vous le savez, l'Anses a été créée en 2010, à la suite du Grenelle de l'environnement. L'agence est chargée d'évaluer les risques sanitaires dans les domaines de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Elle a vocation à éclairer le débat public sur des questions de sécurité sanitaire où le besoin d'objectivation scientifique se fait fortement sentir. Régulièrement, l'actualité nous fournit des exemples de ce besoin.
Monsieur Dehaumont, je vous propose de débuter cette audition par un propos liminaire, dans lequel vous pourrez présenter votre parcours. Je rappelle simplement que vous êtes inspecteur général de santé publique vétérinaire et que vous avez notamment été directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV), directeur des Haras nationaux et directeur général de l'alimentation (DGAL).
Vous pourriez également nous préciser les perspectives que vous souhaitez tracer pour l'agence, votre conception de ses relations avec la tutelle, dont je rappelle qu'elle est triple - santé, agriculture, travail -, et le partage des responsabilités entre les ministères et les agences sanitaires.
Les membres de la commission pourront ensuite vous poser leurs questions.
Monsieur Dehaumont, vous avez la parole.
Je suis heureux et honoré de pouvoir présenter ma candidature à la présidence de l'Anses, agence de sécurité sanitaire bien connue dans le paysage sanitaire français et international aujourd'hui. Lorsque j'ai été sollicité pour présenter cette candidature, je dois dire que j'ai accepté sans hésitation, pour trois raisons, sur lesquelles je voudrais revenir : le champ de l'Anses, son contexte et les enjeux auxquels elle doit répondre ; mon parcours, marqué par la santé publique vétérinaire et par de nombreuses interactions avec l'Anses et les structures qui l'ont précédée ; la vision que je peux avoir, à ce stade, des fonctions de président du conseil administration et les axes que j'aimerais porter.
L'Anses couvre un champ extrêmement large : environnement, santé, travail, santé animale, santé humaine, bien-être animal, santé végétale. Ce champ s'est élargi au fil des années. Classiquement, on évoque, pour présenter l'Anses, quatre grandes thématiques.
Sa première mission est l'expertise scientifique, qui se doit d'être indépendante - on a vu des controverses émerger la semaine dernière sur le sujet. Cette expertise scientifique a été construite depuis une vingtaine d'années. Elle s'appuie sur des comités d'experts, sur une organisation rigoureuse, sur la meilleure science possible et disponible, et tend à s'élargir, avec la création récente d'un comité d'experts spécialisé (CES) dédié à l'analyse socio-économique et d'un comité de dialogue sur les biotechnologies.
La deuxième mission, historique, de l'Anses est une mission de veille, de vigilance et de surveillance. L'Anses a à sa disposition des sources d'informations, en matière de nutrivigilance, de vigilance sur les médicaments vétérinaires, sur les produits phytosanitaires, sur l'antibiorésistance, etc.
Une troisième fonction, extrêmement importante, est une fonction de recherche et d'innovation méthodologique. L'Anses a une double fonction de recherche. La recherche opérationnelle appliquée s'appuie notamment sur son réseau de laboratoires, qui s'est développé en interaction avec de nombreux autres organismes, sur des aspects ponctuels très précis, mais aussi sur des aspects systémiques - de grands enjeux tels que l'exposome, qui a été repris dans la loi de santé publique de 2016, ou le projet PARC sur les résidus de substances chimiques, énorme projet européen sur sept ans et à 400 millions d'euros, que l'Anses pilote. Il y a donc à la fois des actions spécifiques sur des thèmes précis, mais aussi une approche de recherche méthodologique, plus intégrative, prenant en compte l'ensemble des aspects de santé, y compris environnementale. Sur le plan de la recherche, l'Anses est aussi un prescripteur important, avec le programme national de recherche Environnement-Santé-Travail (PNREST). C'est un enjeu extrêmement important. La recherche, à l'Anses, doit être à la fois de la recherche opérationnelle, avec les moyens de l'agence et en résonance avec les autres organismes, et de la prescription de recherche, pour alimenter la qualité de l'expertise.
Le quatrième point fait parfois débat. Il s'agit des autorisations de produits réglementés, à savoir : historiquement, le médicament vétérinaire, que j'ai bien connu lorsque je dirigeais l'Agence nationale du médicament vétérinaire ; plus récemment, les produits phytosanitaires ; les biocides, dont l'évaluation et la gestion relèvent de l'Anses.
Cette présentation analytique en quatre points ne doit pas faire oublier que l'on est dans une approche globale, systémique. Vous avez parlé, Madame la Présidente, du concept « Une seule santé », animale et humaine. Effectivement, toutes les actions de l'Anses s'inscrivent aujourd'hui dans cette dynamique, qui est vraiment devenue une dynamique internationale et qui doit intégrer l'ensemble des dimensions de la santé.
Bien sûr, toutes ces actions se déroulent avec un cadre déontologique, qui a connu une montée en puissance et est désormais bien défini, et dans un dialogue permanent avec l'ensemble des parties prenantes, à travers le conseil d'administration, les comités d'orientation thématiques, les plateformes de dialogue, le Comité économique, social et environnemental, la Commission nationale du débat public... Il est essentiel aujourd'hui, compte tenu notamment des sujets de controverse et des incertitudes, de pouvoir s'appuyer sur un débat vraiment ouvert sur la société, assorti de règles de déontologie précises.
En quoi mon parcours peut-il me permettre de penser que je peux être un peu utile à l'Anses et à l'action publique en matière sanitaire en occupant les fonctions de président du conseil d'administration ? Je suis inspecteur de santé publique vétérinaire. Je suis vétérinaire de formation, mais je n'ai jamais eu de clientèle. Très rapidement, lors de mes études, je me suis orienté vers la santé publique, avec notamment des études d'immunologie.
J'ai été chargé de gestion de risques sur le terrain et en administration centrale. Cela m'a permis d'approcher le besoin d'expertise scientifique, car, à cette époque - c'était au siècle dernier -, il n'y avait pas d'expertise scientifique organisée. J'ai travaillé sur les contaminants, sur l'impartialité et l'indépendance de l'inspection et des systèmes de contrôle, autant de sujets qui résonnent beaucoup avec les activités de l'Anses. À l'époque, je travaillais sur ces sujets avec les laboratoires nationaux, qui, aujourd'hui, sont les laboratoires de l'Anses.
J'ai ensuite effectué un passage à l'étranger : j'ai eu l'opportunité de conduire un projet d'appui à la Pologne pour l'accès à l'Union européenne dans les domaines sanitaires.
En revenant de Pologne, j'ai eu une nouvelle opportunité : la direction de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, mission assez exaltante, qui mêlait à la fois expertise scientifique, recherche, décision, gestion de risque - au niveau de la direction, il fallait aussi délivrer les autorisations de mise sur le marché (AMM). Cet exercice se déroulait, à l'instar de ce qui se passait à l'époque à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) - qui aujourd'hui s'appelle l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) -, dans un cadre très européen et international.
J'ai eu l'occasion de m'intéresser tout particulièrement, avec mes équipes, à l'antibiorésistance. Nous avons porté le sujet de la maîtrise de l'antibiorésistance dans le domaine vétérinaire au niveau international, puisque nous étions centre de référence de l'Organisation mondiale de la santé animale, organisation soeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Nous avons aussi pu développer un certain nombre de méthodes que l'on applique aujourd'hui en la matière. Nous avons également eu l'occasion de travailler, au niveau mondial, sur l'harmonisation des méthodes d'évaluation des médicaments.
J'ai ensuite eu la chance d'être nommé directeur général de l'alimentation en 2012. J'ai exercé cette fonction jusqu'en 2019. J'ai toujours abordé cette fonction, exposée politiquement, sous l'angle très strict de respect de l'impact sur la santé publique. Cela me paraissait vraiment essentiel, puisque l'on s'intéressait à des sujets de sécurité alimentaire, de santé animale, de bien-être animal, certains aspects de santé environnementale et de santé végétale.
De ce point de vue, le cas de l'antibiorésistance est exemplaire. En effet, un plan Écoantibio a permis, de 2012 à 2017, de réduire de manière très significative les consommations d'antibiotiques, avec l'aide de l'Anses - à ce moment, la référence scientifique et technique était là. Les résultats ont été très significatifs, avec, sur la période, moins 40 % d'antibiotiques et moins 90 % d'antibiotiques critiques utilisés. Il est intéressant de voir qu'il y avait alors une combinaison de l'action de l'agence sanitaire, de l'autorité ministérielle et du Parlement, puisque la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a permis d'entériner la limitation de l'usage des antibiotiques. En plus des actions incitatives, des actions contraignantes ont été mises en place, comme l'interdiction des marges arrière sur les antibiotiques ou la limitation de l'usage des antibiotiques critiques. La conjonction de la carotte et du bâton, si je puis dire, a permis de diminuer de manière extrêmement importante l'usage des antibiotiques. Cette diminution continue.
J'ai aussi eu l'occasion de piloter les crises d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) des années 2010. On parle aujourd'hui de vaccination. À l'époque, cette possibilité n'existait pas.
Je pense à bien d'autres aspects sur les produits phytosanitaires, notamment à l'affaire Lactalis - je pourrais vous en dresser l'inventaire.
J'ai particulièrement apprécié l'exercice, parce qu'il y avait vraiment, à l'Anses, le répondant scientifique et technique, la compétence, l'indépendance. En outre, nous avons toujours fait ce travail dans le cadre de multitutelles. En réalité, nous avons cinq tutelles, Madame la Présidente : agriculture, environnement, santé, travail et consommation. Je vous proposerais peut-être même tout à l'heure que l'on en envisage une sixième... En fait, ces tutelles ont vraiment toujours été une source de richesse, d'équilibre et de confrontation des opinions pour pouvoir avancer sur certains sujets sanitaires.
On a créé, à cette période, des sujets qui intéressent beaucoup l'Anses aujourd'hui, et dans lesquels elle est très impliquée : les plateformes d'épidémiosurveillance, le centre de référence du bien-être animal, la plateforme de santé animale, qui entrent en résonance avec la plateforme technologique européenne.
Le sujet des données est tout sauf réglé. On a besoin, pour pouvoir travailler sur la santé, de données massives, robustes, élaborées dans de bonnes conditions. Dans quelques situations, on pourrait améliorer le dispositif : sur les phytosanitaires, sur les autocontrôles, sur les entreprises agroalimentaires... Il faudrait que nous puissions disposer des données de manière systématique pour faire du séquençage génomique systématique, ce qui permettrait d'identifier les foyers d'infection. Il y a donc un sujet global de données qui me paraît important.
Pour terminer sur mon parcours, je suis actuellement en appui en matière de ressources humaines pour le suivi des compétences des agents et des déroulements de carrière et pour le suivi d'un certain nombre de structures, pour m'assurer de l'adéquation de la conduite des politiques publiques avec nos attentes.
J'ai bien conscience que la fonction de président n'est pas une fonction exécutive. Je me plais à le souligner, parce que j'ai été habitué à avoir des fonctions de direction. Il ne faut pas confondre ! D'ailleurs, quand j'étais directeur, je disais toujours qu'un directeur dirige et qu'un président préside.
Cela dit, je pense que la présidence du conseil d'administration de l'Anses devrait me permettre de porter cinq ambitions, avec l'ensemble des membres du conseil, dont je rappelle qu'il est vraiment d'essence grenellienne, ce qui est extrêmement intéressant - l'ensemble des parties intéressées y siègent.
Tout d'abord, il faut s'assurer de la pertinence et du portage de la stratégie de l'agence.
Il me semble que le conseil d'administration devra s'intéresser à la force de recherche de l'Anses. Le PNREST, c'est moins de 10 millions d'euros aujourd'hui par an et le taux de réussite de ce programme n'est que de 11 %, alors que celui des programmes proposés par l'Agence nationale de la recherche (ANR), dont les champs sont certes plus larges, est de 25 %. On risque donc de décourager les candidats potentiels, alors que les projets nécessaires sont extrêmement nombreux. À l'heure où l'on parle d'exposome, d'effet-cocktail, etc., c'est vraiment un point à travailler. C'est pour cela que je parlais d'une sixième tutelle : il faut que l'on se pose la question de la relation avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la relation rénovée avec l'ANR et, pourquoi pas, d'une tutelle supplémentaire.
Je veux également travailler à la crédibilité et l'indépendance de l'expertise. Ce sujet a déjà été beaucoup travaillé. Il fait régulièrement l'objet de controverses, ce qui est normal quand on est en zone d'incertitude. Il faudra avancer sur les questions d'analyse socio-économique, sur les notions de débat public, sur les conditions d'organisation de la déontologie, qui progresse en permanence, mais qui nécessite une vigilance constante.
Il faut une transversalité avec les organisations clés, que ce soit Santé publique France, l'ANSM ou les gestionnaires. Cela rejoint la question des données, parce que nous ne pourrons faire un pas significatif en matière de sécurité sanitaire globale que si l'on en fait un en matière de collecte et d'analyse de données. Or cela, nous ne le ferons pas tout seuls. Il faut le faire avec l'ensemble des acteurs ; il faut une volonté politique. Peut-être que les progrès ont été trop lents jusqu'à présent. De fait, lorsque j'étais DGAL, c'était déjà des sujets que l'on évoquait pour les produits phytosanitaires ou pour les autocontrôles, et on n'a pas beaucoup évolué depuis.
J'ai parlé de la déontologie et de l'enrichissement du débat public.
En conclusion, depuis la création des laboratoires nationaux de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa), de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset) et la création de l'Anses au début de l'année 2010, on a un dispositif qui est monté en puissance, qui s'est structuré, qui s'appuie sur la science et qui doit continuer de s'appuyer sur une science extrêmement robuste, dans un cadre déontologique fort, et bien s'inscrire dans les défis de demain.
Le sixième rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) a paru lundi. Il fait plus qu'interpeller... L'Anses a aussi un rôle à jouer sur ces sujets, avec les autres acteurs. Cette ambition doit s'inscrire dans le contexte « Une seule santé », qui est incontournable aujourd'hui.

Nous avons souvent l'occasion de rencontrer l'Anses sur nos chemins parlementaires, dans les auditions et dans les travaux que nous menons.
Avec Chantal Deseyne et Brigitte Devésa, nous avons réalisé, l'année dernière, un rapport intitulé Surpoids et obésité, l'autre pandémie. Nous nous sommes aperçues que l'Anses avait des apports à fournir. Notre première proposition consistait à réaliser des suivis de cohortes réguliers et détaillés, selon l'origine géographique, le sexe, l'âge, ce qui fait écho avec le manque cruel de données que vous venez d'évoquer.
De quelle manière votre agence peut-elle apporter sa contribution à la mission de Santé publique France concernant le surpoids et l'obésité des enfants et des adultes ? Nous nous sommes rendu compte que, trois ans après le lancement du programme, l'Anses n'était toujours pas saisie formellement des enjeux, notamment de l'ultratransformation.
Sur ce sujet, quelle est la nature de vos relations avec le secteur agroalimentaire, si elles existent ?

Merci, Monsieur, pour l'ensemble des éléments qui motivent votre candidature.
Il y a quelques semaines, la Première ministre a annoncé qu'elle mettrait les protections hygiéniques réutilisables à disposition gratuite des femmes. Il y a là un vrai sujet, que relaie notre collègue Patricia Schillinger, qui, à chaque PLFSS, demande à ce que l'on puisse rendre gratuits les produits hygiéniques.
Il y a eu des initiatives dans nos régions, dans nos départements, mais il est grand temps d'aborder le sujet de façon globale. En 2018, un rapport de l'Anses a montré que ces produits de consommation pouvaient, parfois, faire courir des risques d'allergie, voire de syndrome du choc toxique.
Il est temps de regarder comment on peut passer d'un produit de consommation à un dispositif médical, avec des systèmes d'autorisation et des réglementations. En effet, comment établir la traçabilité d'un produit mis à disposition gratuitement quand les conséquences sur les femmes peuvent être terribles ? Je pense que l'Anses devrait se saisir de cette difficulté. Quel est votre avis sur la question ?

Ma question, à laquelle s'associe Pascale Gruny, rapporteur pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles, porte sur le développement de la recherche en santé au travail, mission conduite par l'Anses. Vous avez précisé que le montant du budget alloué à cette mission était de 10 millions d'euros. Que représente ce montant dans les travaux réalisés par l'Anses ?
Comment rendre ces travaux visibles ? On a un peu l'impression que tout ce qui est fait dans ce pays en matière de prévention est immédiatement gommé. On parle très peu de tout ce qui est fait pour réduire la pénibilité au travail par les branches ou par les entreprises - j'ai en tête, par exemple, le film de notre collègue François Ruffin, Debout les femmes ! Comment comptez-vous communiquer sur les travaux de recherche réalisés en la matière, qui ne sont pas forcément simples à comprendre ?

Monsieur, vous avez l'air passionné par ce que vous faites. C'est déjà une bonne chose !
Je veux vous parler de la souveraineté alimentaire. La crise sanitaire nous a montré toute l'importance de la sécurité alimentaire. On a besoin de savoir que l'on pourra s'alimenter en qualité et en quantité suffisante. La crise a mis en avant certains dysfonctionnements de la chaîne alimentaire dans notre pays et a suscité quelques interrogations.
Notre pays est-il doté de véritables indicateurs sur les flux d'approvisionnement alimentaire, permettant une approche précise et préventive de la réalité alimentaire de notre pays ? Comment pourrions-nous réduire notre dépendance sur certains produits ?
Ce n'est pas l'Anses qui pourra, seule, traiter le sujet de l'obésité et du surpoids. Un certain nombre d'autres instances, telles que Santé publique France, doivent forcément être impliquées. Les ministères concernés ont une responsabilité importante en matière de conduite du programme national de l'alimentation, par exemple. Ce plan doit, me semble-t-il, être conduit avec l'ensemble des acteurs, notamment ceux du secteur médical.
Aujourd'hui, nous disposons d'un certain nombre de données, via l'Observatoire de l'alimentation (Oqali) ou le Ciqual, base de données sur la composition d'un grand nombre d'aliments. Effectivement, la question se pose des données relatives aux produits de consommation et des données médicales au regard des critères de population. Cette action devrait, à mon sens, être développée, en globalité, par les ministères de tutelle concernés - ministère de la santé et ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire notamment -, mais la contribution à l'expertise, à la recherche appliquée devrait être développée, sans oublier l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), pour les aspects de recherche. Cette approche globale me semble nécessaire.
Sur les relations avec le secteur agroalimentaire, j'ai toujours eu, dans mes différentes fonctions, des relations cordiales avec les acteurs économiques, mais j'ai toujours posé une ligne claire en termes d'indépendance. Pour ce qui concerne l'Anses, je pense qu'il faut une relation fluide. D'ailleurs, les acteurs du secteur agroalimentaire sont représentés au niveau de l'Anses, parce qu'ils sont une source d'informations extrêmement importante. Cependant, il faut que ces relations s'exercent dans un cadre déontologique bien cadré et qu'il n'y ait pas d'influence sur l'analyse de risques et l'expertise.
Le débat public doit pouvoir s'opérer avec l'ensemble des acteurs. Il faut connaître les attentes de la société lorsque l'on conduit des évaluations de risques ou lorsque l'on prend des décisions de gestion, mais il faut être capable de connaître l'ensemble des positions, et il ne faut pas qu'il y ait de conflit d'intérêts. Je pense très sincèrement que les instances de débat public qui existent au sein de l'Anses, compte tenu de leur nature, de leur positionnement et de leurs règles de fonctionnement, permettent de respecter cet impératif. Qu'il s'agisse des comités d'orientation thématiques auprès du conseil d'administration ou des plateformes de débat public, les règles permettent de collecter de l'information de manière pertinente. Ainsi, lorsque l'Anses a rendu un avis sur les nitrites et sur le risque cancérogène de leurs dérivés, il y a eu des échanges avec l'agro-industrie. Ce n'est pas pour autant que l'Anses doit répondre systématiquement aux attentes de l'agro-industrie ! C'est bien l'évaluation scientifique qui doit prévaloir.
J'avoue que je n'ai pas réfléchi au sujet des protections hygiéniques remises gratuitement aux femmes. Je pense que le risque doit continuer à être évalué - comme vous l'avez dit, l'Anses avait travaillé sur le sujet il y a quelques années. Cela dit, si l'on commence à parler de dispositif médical, on renvoie plus vers l'ANSM, qui est chargée des dispositifs médicaux. Il faut voir dans quelle catégorie cela entrerait. Il y a aussi potentiellement un risque de pollution environnementale. Il faut apprécier ces différentes dimensions et voir quels organismes seront concernés par ces dispositifs - il y en aura sûrement plusieurs. Cela dit, j'entends bien votre remarque sur la nécessité de prendre un certain nombre de précautions avant de s'engager dans la mise en place d'une mesure qui pourrait exposer à des risques supplémentaires les femmes qui en bénéficieraient.
Le budget santé au travail est inférieur à 10 millions d'euros. Je crois que, l'année dernière, le PNREST était de 7,5 millions d'euros. Je n'ai pas en tête le montant exact pour le travail, mais il me semble que, au-delà de la partie prescription, la partie opérationnelle, en matière de recherche, doit n'être que de 2 millions d'euros environ, fournis par la direction générale du travail (DGT). L'enveloppe est donc extrêmement faible. C'est sûrement l'un des sujets les moins visibles de l'Anses, alors que ce n'est pas le plus récent. La nécessité de lui apporter de la visibilité et d'y consacrer plus de moyens est bien identifiée.
Comment rendre visibles les travaux ? Il faut, d'abord, de la masse. Il faut des résultats, et il faut une politique d'information et de communication. Il faut que le grand public y ait accès, mais l'ensemble des parties prenantes doivent être très fortement impliquées sur le sujet. On a aujourd'hui des plateformes de débats. Le débat sur la santé au travail devrait sûrement être renforcé ; nous sommes d'accord.
J'en viens à la souveraineté alimentaire : nous n'avons pas aujourd'hui, à ma connaissance, d'indicateurs de suivi en matière d'approvisionnement - c'est un sujet que je maîtrise mal. Nous sommes dépendants sur certains produits, compte tenu des attentes sociétales et des habitudes alimentaires. Il y a donc aussi un enjeu d'explication, dans un contexte de dérèglement climatique, de coût, etc. En caricaturant un peu, si l'on veut manger des cerises en hiver, on dépend d'un approvisionnement !
Les produits phytosanitaires sont souvent très critiqués, mais leur usage permet, aujourd'hui, de produire en quantité et de participer à une certaine souveraineté alimentaire. On constate, avec l'avancée de la science, qu'il faut retirer certains produits, réduire les doses de certains autres... Les actions ne peuvent pas être isolées : lorsque l'on identifie un risque, un danger, on ne peut conduire que des actions coordonnées. Pour les produits phytosanitaires, la réduction des usages passe, bien entendu, par la réduction de dose et la suppression des produits les plus dangereux, mais, pour cela, il faut accompagner le monde agricole et l'emmener vers ces pratiques, qu'il faut identifier et qui doivent être viables économiquement. Des dispositifs nous permettent, si nous voulons être souverains sur le plan alimentaire, de faire évoluer les modèles si nécessaire, en accompagnant les différentes dimensions de la production.
J'ai souvent été accusé de faire de la surtransposition quand j'étais directeur général de l'alimentation. Mais, lorsque des indices de santé publique le justifient, il est parfaitement pertinent, à mon sens, que les pouvoirs publics soient capables de prendre des dispositions - les textes communautaires le permettent, d'ailleurs. J'ai connaissance de nombreux cas de surtranspositions qui s'expliquent par des raisons de santé publique.

Vous avez évoqué les nitrites. Justement, l'Anses a publié, en juillet dernier, un avis reconnaissant la responsabilité des nitrites présents dans la charcuterie dans le déclenchement de cancers. Or un tel lien de causalité a été établi par le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS dès 2015. Comment expliquez-vous un tel décalage dans le temps ?

Merci, Monsieur, pour l'enthousiasme que vous inspirent vos fonctions à venir.
En mars 2021, Bernard Jomier et moi-même avons remis un rapport sur la santé environnementale. Nous y avons souligné la multiplicité d'intervenants, qui empêche toute visibilité et attente en grande partie à l'efficacité. Nous avons également souligné la multiplicité des autorités de tutelle de l'Anses et la présence, au sein de son conseil d'administration, de représentants d'industriels et d'exploitants agricoles. Nous avons demandé le renforcement des garanties de son indépendance.
Le financement de la recherche s'élève à environ 6 millions d'euros, ce qui paraît dérisoire, compte tenu de l'enjeu, et le taux de réussite n'est que de 11 %. Une amélioration est-elle possible ?
Une mission interministérielle pilotée par l'inspection générale des affaires sociales (Igas) a récemment critiqué, une fois encore, le pilotage trop dispersé en matière de santé environnementale.
Disposez-vous d'un bilan d'étape de la mise en oeuvre des actions du quatrième plan national de santé environnementale, qui couvre la période 2021-2025 ?
Pour quelle raison les antibiotiques relèvent-ils de Santé publique France pour la santé humaine et de l'Anses pour la santé animale ? N'est-il pas possible d'harmoniser un peu les choses ?
On a parlé du rôle des produits ultra-transformés dans l'obésité. Je vous invite à lire, sur le sujet, les travaux très récents de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst).
Enfin, le sujet de l'eau est essentiel. On sait que l'eau du robinet est régulièrement non conforme aux critères de qualité : le taux de non-conformité serait passé de 5,9 % en 2020 à 20 % en 2021. Or, si l'on boit de l'eau en bouteille, on ingurgite du plastique. L'Anses va-t-elle se pencher sur le sujet ? L'Opecst a également conduit des travaux très intéressants sur le plastique.
Je fais une petite parenthèse sur les cerises françaises : on ne peut plus en manger parce que les normes et les surtranspositions imposées aux agriculteurs français conduisent à manger des produits importés de très mauvaise qualité ! La pédiatre que je suis pourrait vous parler du poulet brésilien transformé en Europe, qui est responsable de pubertés précoces.

Il est intéressant que vous proposiez d'introduire un sixième membre autour de la table : on entend, derrière, la volonté de renforcer les liens avec le secteur de la recherche. Nous avions évoqué cet enjeu dans notre rapport. En revanche, cette proposition ne répond pas à la préoccupation de la dispersion, alors que le manque d'impulsion coordonnée a également été relevé par les rapports d'inspection.
Nous avions proposé que le ministère de la santé soit un peu plus en position de leadership, en lieu et place du ministère de l'agriculture. Pouvez-vous aller un peu plus loin sur cette question ?
Comment envisagez-vous la question du décloisonnement ? Au-delà de Santé publique France, on pourrait aussi citer le Haut Conseil de la santé publique (HCSP).
L'Anses a un rôle important dans l'élaboration des valeurs toxicologiques de référence et est souvent dénoncée comme n'étant pas particulièrement performante sur cette question. Quelles pistes d'amélioration entrevoyez-vous ?

Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le 22 février dernier, le ministre de l'agriculture, Marc Fesneau, a déploré un manque de coordination de l'Anses, de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) et des instituts techniques sur l'évaluation des produits phytosanitaires. Il a également dénoncé l'existence de décalages entre les échelons national et européen, évoquant le cas de l'herbicide dont l'Anses a récemment annoncé qu'elle mettrait fin à la plupart des usages, alors que l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) doit finaliser prochainement la réévaluation de la molécule.
Votre candidature à la tête de l'Anses, alors que vous avez été directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de l'alimentation, répond-elle à la préoccupation de Marc Fesneau de mieux coordonner l'Anses, l'Inrae et les instituts techniques ?

Je tiens, Monsieur, à saluer votre dynamisme.
Je rebondis sur la question qu'a posée Frédérique Puissat sur la communication. Le président Georges Pompidou disait qu'il fallait arrêter « d'emmerder les Françaises et les Français ». N'avez-vous pas le sentiment que l'excès de conseils délivrés par les uns et par les autres aboutit, au final, à tuer le conseil ? Avez-vous réfléchi à la possibilité d'une communication par l'Anses qui ne serait pas rejetée par nos concitoyens ?

Pour récolter, il faut pouvoir planter sur des sols de bonne qualité. Or, non seulement l'eau vient à manquer, mais il se pourrait que l'on ait oublié comment traiter et cultiver nos sols selon leurs particularités.
Les méthodes ancestrales, particulièrement le principe de rotation et d'association culturales, apparaissent comme des remèdes. Elles permettent, surtout, d'optimiser les synergies biologiques. Cependant, la question économique et le rendement restent prégnants. À court terme, quelles solutions préconisez-vous pour préserver nos sols ?
J'ignore les raisons du décalage dans le temps sur les nitrites. Le sujet est complexe, et l'on risque de faire un amalgame entre nitrites et charcuterie. Or l'alimentation ne représente que 50 % maximum des apports en nitrites, et la charcuterie n'est qu'une part dans cet apport. Il est clair qu'il faut tendre vers une diminution de leur usage, mais il faut tenir compte de leur effet bactériostatique et prendre, en parallèle, des mesures complémentaires. On parle beaucoup de la réduction de la DLC pour le jambon, par exemple, face au risque de listéria. Les salmonelles viennent de la chaîne de production, depuis l'élevage jusqu'à la transformation, en passant par l'abattage. Il n'est pas question de pointer du doigt un maillon particulier, mais il faut pouvoir s'intéresser aux origines et à la maîtrise du risque de salmonelles. On sait aujourd'hui faire de la viande hachée sans salmonelles ni Escherichia coli parce qu'un système de maîtrise existe - ce n'est pas facile, mais on peut y arriver. Il n'y a donc pas de raison que, sur la filière porcine, on n'arrive pas à produire sans salmonelles, sauf très rares cas.
Les écrits et les recherches laissent penser qu'il y a un vrai risque de santé publique. C'est multifactoriel, là encore : l'eau, l'alimentation, les légumes sont les premiers apporteurs de nitrites dans l'alimentation. Si l'on s'intéresse à la charcuterie, il faut tenir compte de l'ensemble des paramètres qui peuvent permettre de maîtriser le risque microbiologique, en lieu et place des nitrites. C'est certainement une approche progressive qui doit permettre d'adapter la filière.

Le décalage entre 2015, où l'on avait déjà montré qu'il y avait un lien de causalité avec le cancer, et 2022 est tout de même important...
Une dose journalière admissible (DJA) était définie au niveau européen et la France était en dessous de celle-ci. Je pense que c'est un élément d'explication du décalage. Dans les autres pays, les teneurs demeurent bien plus élevées.
Sur la santé environnementale, il y a effectivement beaucoup d'intervenants et une multiplicité des tutelles. Je n'ai pas de réponse magique... Il est probable qu'il faille une implication scientifique et politique plus forte sur ce sujet, et peut-être imaginer une forme de chef de filat. Le sujet est tellement global et complexe que l'on en arrive à un éparpillement et à une multiplicité des acteurs. Cela nous renvoie, sur beaucoup de points, à la question des collectes de données. Il faut probablement une meilleure coordination et davantage de moyens.
Sur l'antibiorésistance, pourquoi Santé publique France s'occupe-t-elle de la médecine humaine et l'Anses de la médecine vétérinaire ? Il y a, d'abord, une raison historique. Les structures de santé humaine se sont occupées de l'antibiorésistance dans le domaine humain, et les structures vétérinaires - à l'époque, l'Afssa et l'ANMV - de celle au niveau animal.
Nous nous intéressons à l'antibiorésistance pour au moins trois raisons : par égard pour l'animal malade à soigner, mais ce n'est pas un problème majeur en médecine vétérinaire ; pour l'alimentation humaine, les denrées que nous ingérons pouvant nous amener à consommer des bactéries résistantes ou des phages de bactéries résistantes - les résidus d'antibiotiques sont très contrôlés au niveau alimentaire : plus de 20 000 analyses sont réalisées chaque année sur les antibiotiques, mais les facteurs de résistance peuvent être présents ; pour l'éventuel passage à l'homme d'une pathologie avec un germe de résistance.
Or, s'il y a, en médecine humaine, une liberté de prescription assez large et une problématique de remboursement, en médecine vétérinaire, on peut maîtriser plus facilement les règles de prescription et il n'y a pas de remboursement. Et le plan Écoantibio a montré que nous étions capables de limiter les quantités de manière extraordinaire et de faire passer la consommation d'antibiotiques critiques quasiment à zéro. L'agriculteur ou le propriétaire d'un animal de compagnie n'a pas accès aux antibiotiques : il faut passer par un prescripteur, le vétérinaire, qui, du reste, doit respecter un certain nombre de règles.
Fusionner l'ensemble dans un seul bloc n'aurait pas d'intérêt, compte tenu des spécificités. En revanche, il est très important que l'articulation soit extrêmement fine. C'est le cas actuellement, puisqu'il y a énormément de relations sur ce sujet entre l'Anses, Santé publique France et l'ANSM, ainsi qu'entre la direction générale de la santé (DGS) et la DGAL. L'articulation entre les différents acteurs a progressé ces dernières années. D'ailleurs, un colloque est organisé chaque année par la DGAL et la DGS sur les avancées en matière de lutte contre l'antibiorésistance. Je suis donc convaincu que le dispositif doit rester au niveau de l'Anses.
L'eau du robinet est très contrôlée. Il y a des seuils limites à respecter. Ils sont parfois dépassés, auquel cas il faut faire soit de la dilution, soit de la fixation sur charbon actif. Il existe des méthodes. Je pense qu'il est préférable - mais c'est aux scientifiques de se prononcer - de boire l'eau du robinet plutôt que l'eau en bouteille, sachant que les dépassements sont rares, sauf peut-être dans quelques zones, compte tenu des moyens de contournement dont on peut disposer.
J'en viens aux cerises : je pense que vous évoquez le diméthoate, que j'ai interdit sans hésitation quand j'étais DGAL, car la teneur des produits traités était supérieure à la dose toxique aiguë pour les enfants. Certains pays continuent de l'utiliser. Je ne sais pas où nous en sommes aujourd'hui. À l'époque, nous avions mis en place des mesures pour obtenir des garanties sur le non-traitement au diméthoate des cerises importées. Les plans de contrôle étaient bien négatifs. Je pense que c'est toujours le cas. On peut peut-être parler de surtransposition, parce que la substance n'était pas retirée au niveau européen, mais il y avait tout de même un risque de toxicité aiguë pour les enfants, ce qui est rare pour un produit phytosanitaire. Je continue donc d'assumer le retrait du diméthoate.
Très sincèrement, je n'ai pas l'impression que le ministère de l'agriculture ait un leadership sur celui de la santé. Cependant, il est vrai qu'il finance beaucoup.
Cela ne lui donne pas plus de droits que les autres tutelles - je l'ai bien vécu en tant que DGAL.
J'ai été sollicité par les directeurs généraux des différents ministères, que je connaissais auparavant, et par le directeur général, Benoît Vallet, avec qui j'ai beaucoup travaillé quand il était DGS. Je pense que c'est plutôt un profil d'expérience qui a été recherché au regard du fonctionnement de l'Anses.
Très sincèrement, je n'ai pas l'impression que la tutelle du ministère de l'agriculture soit plus forte que celle de la santé, du travail ou de la consommation. C'est vraiment un bloc de cinq tutelles, qui travaillent ensemble au quotidien. Cela a peut-être changé depuis que je suis parti, mais je n'ai pas l'impression. Je pense que le système de tutelle est extrêmement riche : quand il faut valider une saisine en commun des tutelles, l'ensemble des dimensions sont prises en compte. Cela permet de maturer la saisine avant de la transmettre à l'Anses et d'éviter qu'une tutelle oriente une saisine en fonction de son attente. Il y a donc là un travail interministériel extrêmement riche, et c'est pour cela, par ailleurs, qu'une tutelle du ministère de la recherche me paraît extrêmement intéressante.
Je n'ai pas le sentiment que l'Anses ait des capacités insuffisantes pour définir les valeurs toxicologiques de référence (VTR), mais je m'y pencherai.
Je connais moins en détail les centres techniques, mais, avec l'Inrae, il y a énormément de collaborations, de projets de recherche, dans des unités mixtes de recherche (UMR), dans des unités mixtes technologiques (UMT), dans des plateformes, sur des projets européens. La recherche au quotidien à l'Anses est rarement faite par des équipes Anses seules, sans collaboration étroite avec l'Inrae. En outre, une convention-cadre a été signée lors du salon de l'agriculture entre l'Inrae et l'Anses, puisqu'il y a à la fois de très nombreux projets communs et un enjeu de vision stratégique commune.
L'autorisation d'un produit phytosanitaire n'est pas une question de coordination avec l'Inrae ou avec les centres techniques, qui sont l'émanation des organismes de production. Elle repose sur l'autorisation d'une substance au niveau communautaire. Une évaluation scientifique du produit est faite à l'Anses, sur la base de lignes directrices préétablies, qui permettent de délivrer une autorisation. Le process me paraît cadré, avec un comité de dialogue sur les produits phytosanitaires qui permet d'entendre l'ensemble des acteurs, notamment les craintes de perte en cas de retrait ou d'efficience en cas de diminution de dose.
Il y a 800 experts à l'Anses, dans les différents CES. De mémoire, peut-être 30 ou 35 % d'entre eux sont issus de l'Inrae. L'articulation est donc extrêmement forte. Je pense qu'il faut faire très attention à la partie recherche. L'autorisation de produits réglementés est un peu autre chose, mais je comprends bien la remarque qui a été faite.
Oui, trop de conseils tue sûrement le conseil. Il faut communiquer de manière fluide, mais communiquer ne suffit pas : par exemple, l'obésité doit s'inscrire dans une question d'éducation pour la santé, pour les jeunes, les adultes, etc. C'est tout un panel d'actions qui permettent d'avancer.
La préoccupation relative à la présence, dans l'eau ou les sols, de résidus éventuels de produits phytosanitaires, par exemple, est aussi une préoccupation quant à la baisse de la biodiversité provoquée par l'utilisation des produits. Ainsi, l'effet rémanent extrêmement long dans les sols des néonicotinoïdes a conduit à leur retrait.
Effectivement, il existe des solutions alternatives : rotation, variétés spécifiques, travail du sol, apport de biomasse... Cela prend du temps. Les moyens techniques différents sont souvent plus coûteux : il est, par exemple, beaucoup plus onéreux de désherber avec un système de herse, par exemple. Il y a un côté assurantiel du produit phytosanitaire.
Il faut, effectivement, adapter les méthodes. Il faut former, convaincre et prévoir un accompagnement financier, tout en faisant attention au quantitatif, parce qu'il faut bien nourrir la population. C'est un travail sur le long terme. On voit bien que les plans Écophyto successifs de ces dernières années ont été beaucoup critiqués, parce que les diminutions ne sont pas au rendez-vous. En revanche, des progrès énormes ont été faits sur le plan des pratiques, en termes de protection des agriculteurs, de conditions d'usage, de limitation de la dérive, etc.
Néanmoins, on a beaucoup de mal à diminuer les doses de manière très significative dans beaucoup de cas de figure, peut-être parce que l'on ne fait parfois pas de rotation, parce que la rémunération n'est pas la même pour les agriculteurs... L'accompagnement des pratiques est déterminant. Au-delà de l'action des pouvoirs publics, le rôle des centres techniques et de l'Inrae est essentiel pour apporter ces solutions.

Merci beaucoup, Monsieur. Nous vous souhaitons un plein succès dans vos nouvelles fonctions.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
La réunion est close à 10 h 45.