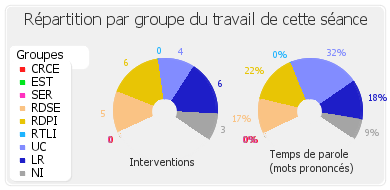Séance en hémicycle du 18 novembre 2013 à 17h00
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à dix-sept heures.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004–1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2012–1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
Il a été transmis à la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois et, pour information, à la commission des finances.
M. le président du Sénat a également reçu de M. le Premier ministre le rapport sur la mise en œuvre du programme national pour l’alimentation établi en application de l’article L. 230–1 du code rural et de la pêche maritime.
Il a été transmis à la commission des affaires sociales ainsi qu’à la commission des affaires économiques.
Enfin, M. le président du Sénat a reçu le rapport d’information de l’Agence de la biomédecine, établi en application de l’article L. 1418–1 du code de la santé publique.
Il a été transmis à la commission des affaires sociales.
Acte est donné du dépôt de ces rapports.

M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 14 novembre 2013, qu’en application de l’article 61–1 de la Constitution la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 5125–31 et L. 5125–32 du code de la santé publique (Pharmacie d’officine) (2013–364 QPC).
Le texte de décision de renvoi est disponible à la direction de la séance.
M. le président du Conseil constitutionnel a également informé le Sénat, le 14 novembre 2013, qu’en application de l’article 61–1 de la Constitution le Conseil d’État a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 80 quinquies du code général des impôts (Déclaration des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale) (2013–365 QPC).
Le texte de cette décision de renvoi est disponible à la direction de la séance.
Acte est donné de ces communications.

M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courrier en date du 15 novembre 2013, une décision du Conseil sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 621–2 et L. 622–1 du code de commerce, « dans leur rédaction applicable en Polynésie française » (n° 2013–352 QPC).
Acte est donné de cette communication.

L’ordre du jour appelle le débat sur la politique d’aménagement du territoire, organisé à la demande du groupe UDI-UC.
La parole est à M. Hervé Maurey, au nom du groupe UDI-UC.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le groupe UDI-UC a souhaité inscrire aujourd’hui à l’ordre du jour du Sénat ce débat sur l’aménagement du territoire, car, vous le savez, c’est un sujet au cœur des préoccupations de notre assemblée, et tout particulièrement de notre groupe politique.
Nous avons également souhaité ce débat car, dix-huit mois après la création d’un ministère de « l’égalité des territoires » et votre arrivée à la tête de ce ministère, le temps nous semble venu de faire un premier bilan de l’action du Gouvernement sur ce sujet.
Je le ferai, vous le savez, avec objectivité car j’ai la chance d’appartenir à un groupe politique où les positions ne sont pas fonction du fait que l’on soit dans la majorité ou dans l’opposition.
J’avoue à cet égard que je suis surpris de l’attitude de certains de mes collègues, dont je ne reconnais pas les prises de position depuis quelques mois tant elles ont évolué.
Pour ce qui me concerne, j’ai critiqué l’absence de politique ambitieuse en matière d’aménagement du territoire du gouvernement Fillon, déclarant même sur ce sujet qu’il n’y avait « plus de pilote dans l’avion ». Et lorsque vous êtes venue pour la première fois devant notre commission en 2012, je vous ai indiqué partager un certain nombre de vos appréciations sur le constat que vous dressiez quant à la situation de notre pays en matière d’aménagement du territoire.
J’avais également exprimé le souhait que la disparition du concept d’« aménagement du territoire » au profit de celui d’« égalité des territoires » ne soit pas une simple évolution sémantique, mais la marque d’un véritable changement, terme qui, à l’époque, avait encore du sens, et donnait encore de l’espoir.
Cela semble bien loin, je vous l’accorde.
Alors, où en sommes-nous aujourd’hui ?
Madame la ministre, j’aurais vraiment aimé, dans l’intérêt du pays, pouvoir observer une évolution positive en matière d’égalité des territoires. Mais, très honnêtement, ce n’est pas possible.
Je tiens d’ailleurs par avance à exprimer ma compassion à l’égard de mes collègues socialistes – je pense notamment à mon ami Pierre Camani – qui vont tenter de démontrer l’inverse en indiquant que l’État est de retour dans nos territoires.
Je leur exprime mes encouragements, car l’exercice sera hélas ! difficile pour eux ; il leur faudra beaucoup de militantisme, d’imagination et un brin de mauvaise foi, voire beaucoup, pour affirmer cela.
En effet, madame la ministre, force est de constater qu’il n’y a pas un domaine dans lequel l’égalité des territoires a progressé en dix-huit mois.
Si je prends l’exemple du département dont je suis élu, et que par définition je connais le mieux, aucun progrès n’est à observer.
Aucun progrès en matière de couverture en téléphonie mobile, malgré mes courriers, mes interpellations, mes questions orales et mes réunions aux cabinets des ministres concernés, Mme Pellerin et vous-même ! Il n’y a pas un endroit dans l’Eure où le téléphone passe mieux que le 6 mai 2012 !
Quand donc l’État s’attaquera-t-il enfin à cette insupportable situation où des citoyens contribuables à part entière entendent à la radio des publicités vantant les avantages de la téléphonie mobile de quatrième génération alors qu’ils n’ont pas la moindre connexion ?

Comment pouvez-vous tolérer cela, madame la ministre ?
Sur le haut débit et le très haut débit, même chose : aucune amélioration n’a été concrètement observée sur le terrain, au-delà des critiques du gouvernement précédent, des déclarations, des feuilles de route et autres missions.
Pire, les socialistes ont montré leur duplicité sur le sujet lorsque, après avoir adopté, ici même, en février 2013, la proposition de loi que j’avais déposée avec Philippe Leroy visant à assurer l’aménagement numérique des territoires, ils ont voté contre à l’Assemblée nationale quelques mois plus tard.
Entre-temps, les socialistes étaient passés de l’opposition à la majorité et, à ce titre, obtempéraient à la nouvelle ministre chargée du numérique, qui reprenait mot à mot les termes de son prédécesseur, Éric Besson, c’est-à-dire ceux des opérateurs.
En matière de démographie médicale, où sont les dispositions de la proposition de loi de Jean-Marc Ayrault sur le bouclier rural, qui visait, en 2011, à soumettre l’installation des médecins à une autorisation préalable ? Elles sont, comme tant d’autres, oubliées !
Sur ce sujet aussi, le parti socialiste recule et Mme Touraine, dont nous connaissons bien, dans cette assemblée, l’arrogance, critique ses prédécesseurs mais ne propose que des mesurettes qui ont prouvé, en vingt ans, leur inefficacité.
En matière d’infrastructures, le Gouvernement a enterré ou reporté aux calendes grecques, à la suite du rapport Duron, nombre de liaisons autoroutières, ferroviaires ou fluviales, invoquant le fait qu’elles ne seraient pas rentables, notion, vous en conviendrez, mes chers collègues, quelque peu antinomique avec celle d’égalité des territoires.
Autre sujet qui montre que l’égalité des territoires non seulement ne progresse pas, mais au contraire régresse : la réforme des rythmes scolaires. Peut-on imaginer réforme plus inégalitaire ?
Car si cette réforme peut, certes avec difficulté, s’appliquer dans les grandes villes disposant de personnels et de locaux, elle est tout simplement inapplicable dans nos petites communes.
Comment organiser des activités périscolaires dans un village où il n’y a pas d’autres salles que la salle de classe ?
Comment trouver du personnel compétent pour uniquement quarante-cinq minutes par jour ?
Je sais que cette réforme n’est pas la vôtre, madame la ministre, mais je ne crois pas vous avoir entendu émettre la moindre réserve sur ce sujet !
Enfin, la politique de matraquage fiscal et social mise en place par le Gouvernement porte atteinte à l’égalité des territoires dans la mesure où ce sont les entreprises les plus fragiles qui sont les premières victimes de cet acharnement du Gouvernement.
Les territoires qui s’en sortent le mieux sont ceux qui étaient les plus dynamiques, et ceux qui souffrent le plus sont ceux qui étaient déjà les plus faibles.
En période de crise, l’aménagement du territoire doit tout particulièrement se concentrer sur la création d’emplois dans les zones les plus fragiles.
Je n’aurai pas la cruauté, madame la ministre, de vous demander votre bilan sur ce point, alors que chacun observe que le Gouvernement en est réduit à saupoudrer les millions, parfois même les milliards, pour éteindre le feu dans les territoires. Voilà quelques jours, nous avons atteint le record de 4 milliards d’euros dispersés en une journée dans les territoires !
Cette situation est aggravée par un mal-être des territoires ruraux, qui observent que le Gouvernement n’aime pas la ruralité.
Pour s’en convaincre, il suffit d’observer le combat permanent du Gouvernement pour réduire le poids du monde rural dans les assemblées départementales et, ici même, au sein de la Haute Assemblée.
Face à cette réalité, vous allez certainement vous féliciter de la création d’un Commissariat général à l’égalité des territoires, dont on nous dit dans le « bleu » budgétaire que « cette nouvelle organisation sera un instrument de justice territoriale et de lutte contre les inégalités spatiales ».
Comme c’est joli ! Mais, en réalité, il n’aura guère plus de pouvoir ni de moyens que l’actuelle DATAR, la délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale.
J’ai assisté à l’audition du futur commissaire général devant notre commission le 14 octobre dernier : M. Delzant a été bien en peine d’expliquer la différence entre ce commissariat à l’égalité des territoires et la DATAR !
Madame la ministre, il ne suffit pas de changer le nom d’un organisme, ou même d’en créer un, comme Mme Pellerin, qui nous annonce une agence du numérique, pour être dans le concret et dans l’action.
De même qu’il ne sert à rien de multiplier les commandes de rapports, d’annoncer des schémas et de confier des missions, si ce n’est pour créer l’illusion et, par là même, la déception.
Vous avez demandé à Éloi Laurent un rapport sur le concept d’égalité des territoires ; j’ai d’ailleurs accepté d’y apporter ma contribution, prouvant ainsi ma bonne volonté... Et après ?
Quid de ce rapport, qui avait d’ailleurs juste oublié de traiter du numérique ? Même mes collègues socialistes s’en sont offusqués, c’est vous dire…
Ce rapport s’interroge sur le fait de savoir si la France en 2040 sera hyperpolisée, postpolisée, régiopolisée ou dépolisée ! Est-ce vraiment la question ?
Oui !

Et puisque l’on parle de prospective, comment ne pas s’étonner ici que les conclusions du séminaire gouvernemental sur la France à l’horizon 2025 n’évoquent pas, même d’un mot, l’égalité des territoires ?
Cette échéance serait-elle trop proche ? Ne s’intéresse-t-on à l’égalité des territoires dans ce gouvernement qu’à l’horizon 2040 ?
Ces changements de façade, ces rapports ne masquent pas, madame la ministre, l’échec du Gouvernement en la matière.
Alors, pourquoi cet échec ? Car c’est bien d’un échec dont on peut parler aujourd’hui ! Je ne suis d’ailleurs pas le seul à le dire puisque, pas plus tard que la semaine dernière, le Conseil économique, social et environnemental a plaidé pour un renouveau de la politique d’aménagement du territoire et vous a demandé de préparer une loi cadre et de programmation sur l’égalité des territoires qui, je cite le rapporteur, « sanctuariserait la politique d’aménagement du territoire, tout en promouvant une meilleure transversalité de l’État en parallèle d’une déconcentration accrue ».
La raison de cet échec est très simple : la politique d’aménagement du territoire n’est pas une priorité de ce gouvernement.
Nous le voyons dans le budget : moins 14 % depuis 2012 en autorisations d’engagement et moins 12 % en crédits de paiement pour la mission « Politique des territoires » alors que dans le même temps les dépenses de l’État diminuent de seulement 1, 7 % en volume.
Nous le voyons plus encore dans les arbitrages sur tous les sujets que j’ai évoqués il y a quelques instants – le numérique, la santé, les infrastructures, l’emploi –, le critère de l’égalité des territoires n’est jamais prépondérant.
Sur le numérique, on privilégie les opérateurs. Sur l’accès aux soins, l’intérêt des médecins. Sur les infrastructures, la rentabilité. Sur l’emploi, le matraquage fiscal. Sur les rythmes scolaires, j’avoue ne pas comprendre le critère qui a prévalu, à part la volonté d’un ministre de faire la une des médias et, de ce point de vue, c’est un succès.
J’ajoute une raison structurelle, que j’avais d’ailleurs déjà soulignée sous le précédent gouvernement : un ministre chargé de l’aménagement du territoire, s’il est en charge d’autres missions qui se gèrent au quotidien ou dans l’urgence, est accaparé par celles-ci au détriment de l’aménagement du territoire qui est une action de moyen et de long terme.
En clair, et je ne vous en fais pas le reproche, vous êtes bien plus ministre du logement que ministre de l’égalité des territoires.
Alors, comment s’en sortir et comment mettre enfin en place une vraie politique d’aménagement du territoire ?
Tout d’abord, arrêtons les rapports et les comités Théodule. Il y a, notamment dans notre assemblée, suffisamment de travaux pour savoir ce qu’il faut faire, ou ne pas faire.
Permettez-moi de vous livrer quelques pistes de réflexion.
Premièrement, il faut un vrai ministère de l’aménagement du territoire qui n’ait pas d’autres missions que l’aménagement du territoire, mais qui ait, en revanche, de vrais pouvoirs en la matière.

Un ministère qui dispose d’une véritable transversalité et qui soit associé à toutes les décisions ayant un impact sur les territoires.
Tous les projets de loi, toutes les décisions doivent intégrer le critère d’aménagement du territoire ; leur impact au regard de l’égalité des territoires doit être évalué comme on le fait aujourd’hui en ce qui concerne la parité. Si nous mettions la même énergie à faire de l’égalité des territoires un devoir politique et moral que nous le faisons – à juste titre – pour la parité entre les hommes et les femmes, la situation s’améliorerait.
Deuxièmement, il faut que l’État se recentre sur ses vraies missions, qu’il s’occupe moins de la sphère économique, qu’il laisse les entreprises se créer, se développer et qu’il allège leurs contraintes. L’État, lui-même ainsi allégé de tâches qui ne sont pas les siennes, pourra se concentrer sur ses missions régaliennes, parmi lesquelles figure, au premier rang, l’aménagement du territoire.
À ce titre, il doit s’investir réellement, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, sur le déploiement des réseaux, c’est-à-dire des infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et numériques.
Je rappelle qu’en matière de très haut débit le Gouvernement a confirmé le choix de son prédécesseur – après l’avoir critiqué – de laisser l’initiative du déploiement aux opérateurs privés et la liberté pour eux de déployer uniquement là où ils ont envie de le faire. Comme ce sont des entreprises privées, elles déploient uniquement dans les secteurs rentables, obligeant les collectivités locales à intervenir dans les zones non rentables.
Ce système est totalement antinomique avec la notion d’égalité des territoires.
Tout d’abord, parce que c’est dans les départements les plus ruraux, c’est-à-dire les plus pauvres, que les opérateurs investissent le moins, voire pas du tout, obligeant par là même les collectivités à investir, à un coût élevé pour le contribuable. Il l’est également puisque, selon la capacité financière des collectivités locales et leur volontarisme en la matière, le déploiement des réseaux sera extrêmement différent d’un département à l’autre.
En matière de numérique, les inégalités vont donc continuer à croître.
Il faut sortir de cette logique. Il faut également que l’État s’attache à assurer une véritable couverture de notre territoire en téléphonie mobile, ce qui, je l’ai dit, n’est toujours pas le cas aujourd’hui.
Troisièmement, l’État doit veiller à ce que nos territoires puissent, pour être vivants, bénéficier non seulement d’infrastructures, mais aussi de services. Des services, ce sont d’abord des services publics, notamment en milieu rural.
J’observe à cet égard que le seul projet concret du Gouvernement qui nous a été présenté dans le cadre de la préparation de la loi de finances pour 2014, c’est la généralisation, à l’horizon 2017, du dispositif « + de services publics », expérimenté par notre collègue Michel Mercier lorsqu’il était ministre.
J’ajoute, sur un autre sujet, que c’est également sur l’initiative de notre groupe politique que l’on a instauré dans la loi postale le principe des 17 000 points postaux présents sur le territoire.
Les services, c’est également l’accès aux soins. Je me permets à cet égard de vous rappeler les conclusions de notre groupe de travail sur la démographie médicale adoptées à l’unanimité et qui prônent des mesures ambitieuses en termes de régulation de l’installation des médecins, mesures indispensables si l’on veut un jour mettre un terme à la désertification médicale.
Quatrièmement, l’État doit tout mettre en œuvre pour favoriser la création d’emplois dans les zones fragiles. Les infrastructures et les services publics y contribuent. Il faut que des politiques incitatives le permettent également, et il faut que l’État employeur, comme cela s’est fait dans le passé, donne l’exemple et n’hésite pas à délocaliser certains de ses services pour dynamiser des territoires.
J’évoquais ainsi, voilà quelques jours, avec mon collègue Henri Tandonnet, l’exemple réussi de l’implantation de l’École nationale d’administration pénitentiaire dans le Lot-et-Garonne. Cette implantation décidée en septembre 1994 a permis de dynamiser un territoire en renforçant la présence étudiante. Il y a 6 000 étudiants par an à Agen grâce à cette école, ce qui a indubitablement des conséquences sur l’économie locale.
Cinquièmement, à une époque où l’argent public est rare, je ne vous dirai pas qu’il faut injecter plus d’argent, je vous dirai, au contraire, qu’il faut optimiser les crédits.
À quoi sert de dépenser des sommes élevées pour créer des maisons de santé subventionnées par le Fonds national d’aménagement et de développement du territoire sans être certain que des médecins viendront s’y installer et sans que le ministère de la santé ou le vôtre ne s’en préoccupe ?
Le moins que l’on puisse exiger lorsque l’on finance une maison de santé, c’est de s’assurer que cet équipement réglera le problème de l’accès aux soins, ce qui n’est malheureusement pas toujours le cas ; je connais un certain nombre d’exemples qui l’attestent.
Sixièmement, sur la méthode, l’État doit veiller à travailler en étroite collaboration avec les élus et non contre eux. Quel que soit le rôle de l’État, qui est primordial, en matière d’égalité des territoires, ce ne doit être à aucun moment l’État contre les collectivités locales.
Je voudrais à cet égard prendre l’exemple du développement de l’éolien.
Comment accepter que des permis de construire soient attribués pour des éoliennes contre l’avis unanime des communes concernées ? Il faut une vision nationale du déploiement de ces infrastructures, qui n’existe pas aujourd’hui, et ensuite une déclinaison locale en concertation avec les élus locaux.
Il n’est pas acceptable que des décisions qui impactent l’avenir d’un territoire soient prises contre la volonté de ceux qui en ont la responsabilité.
L’ambition de l’État ne doit pas aboutir à déposséder les élus locaux des projets de leur territoire.
Voilà, madame la ministre, quelques axes de réflexion qui me semblent prioritaires.
La mission, j’en conviens, n’est pas mince, nous avons cependant la conviction profonde que cette tâche est non seulement nécessaire mais indispensable si nous souhaitons sortir de cette crise et faire de l’égalité des territoires non pas un slogan pompeux mais une réalité concrète.
Il faut simplement, oserais-je dire, une vraie volonté politique, que le Gouvernement ne semble pas avoir.
En conclusion, madame la ministre, mes chers collègues, je voudrais vous citer ces quelques mots prononcés par Georges Pompidou, alors Premier ministre, devant l’Assemblée nationale. Pour présenter l’action de son gouvernement – qui créa la DATAR, il y a tout juste cinquante ans – pour lutter contre l’inégalité entre les territoires, il disait : « Le but de l’action gouvernementale est de remédier à cette inégalité et de tendre vers l’équilibre. Nous en avons tous conscience et nous devons nous pénétrer de l’idée que, de notre action, nous ne tirerons aucune autre satisfaction que celle d’avoir contribué de notre mieux à préparer une France plus harmonieuse ».
Madame la ministre, travailler à préparer une France plus harmonieuse, cet objectif est plus que jamais d’actualité. Nous apprécierions qu’il inspire l’action du Gouvernement dont vous êtes membre et qu’ainsi vous puissiez vraiment agir dans cette direction. §

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, compte tenu du peu de temps qui m’est imparti, je serai bref.
Je ne partage pas tous les propos tenus par notre collègue Hervé Maurey. Je partage ce qu’il a dit sur la téléphonie ou l’implantation de certaines écoles, comme l’École nationale d’administration pénitentiaire, dans les milieux ruraux.
En revanche, je ne le suis pas sur les rythmes scolaires, lorsqu’il affirme que l’indigence qui serait appliquée à la ruralité date de l’élection de M. Hollande. C’est, cher collègue, en somme, ce que vous nous avez dit au début de votre intervention.

Nous ne sommes pas la même ruralité. Il y a longtemps que la ruralité est mal comprise à Paris.

Cela s’explique par de nombreuses raisons, notamment le fait qu’une large part de notre Haute Assemblée soit élue à la proportionnelle. S’il n’y avait pas de proportionnelle, la ruralité serait beaucoup mieux comprise.
Madame la ministre, vous avez dit récemment que l’aménagement du territoire devait viser à réparer les territoires meurtris et à mettre fin aux inégalités. C’est effectivement le cœur du sujet.
Comme le Président Hollande, vous avez vous-même, madame la ministre, des attaches rurales. À l’instar de mon collègue Maurey, je demanderai également, à la fin de mon intervention, qu’une loi de programmation advienne. Pourquoi une telle loi doit-elle intervenir rapidement et est-elle importante ?
Tout d’abord, nous sommes nombreux à souhaiter mettre toute notre intelligence au service de la ruralité ou de l’hyper-ruralité. À cet égard, je rends hommage au groupe centriste d’avoir demandé ce débat.
Toutefois, dans cette loi que nous appelons de nos vœux, il nous faudra distinguer ruralité et hyper-ruralité. En effet, 80 % des territoires français sont ruraux. Or nous n’aurons pas les moyens de nous attaquer à de nouvelles actions, de nouvelles intelligences, de nouveaux crédits sur 80 % du territoire de notre pays ; nous ne serions pas efficaces.
Nous sentons que la fracture se creuse.
Le 13 décembre 2012, les membres du groupe RDSE et moi-même avions présenté une proposition de résolution. Depuis lors, est intervenue l’importance loi sur le logement, sur laquelle vous avez travaillé. Aussi, désormais nous attendons le volet sur l’égalité des territoires.
Il est vrai que, sur le terrain, le service public et le service au public se réduit. La téléphonie est un excellent exemple. Le débat sur la téléphonie est surréaliste. Alors que l’on entend parler de la 4G, de la 5G, voire de la 38G
Sourires.

À cela s’ajoutent la DDE, les fermetures de succursales de la Banque de France, les problèmes de services de santé, les problèmes de l’offre de transport – de nombreux petits trains sont menacés –, la réduction des crédits concernant les infrastructures, et le débat sur l’écotaxe ne va rien arranger puisqu’elle devait apporter une part de crédits à nos infrastructures.
Parfois, les ruraux voient leurs espoirs déçus. Par exemple, dans le Massif central, le projet de ligne reliant Clermont-Ferrand et Paris en TGV, qui desservirait quinze départements ruraux, bien qu’annoncé, a été reporté.
Les choix collectifs ne nous sont pas toujours favorables. Souvent, la route est la seule possibilité pour se déplacer. Nous n’avons pas de liaisons aériennes. Les liaisons ferroviaires peuvent également être insuffisantes. Ainsi, je le dis souvent parce que c’est risible, il faut dix-huit heures pour faire l’aller-retour entre Mende et Paris, et neuf heures pour l’aller-retour entre Mende et Montpellier !
Certes, les ressources financières sont maigres. Pour autant, l’intelligence commanderait que tout ne soit pas concentré dans les capitales régionales. Il faut déconcentrer depuis les capitales régionales vers les départements n’ayant pas d’agglomérations.
Comme diraient les enfants, ça tourne au foutage de gueule. §Voilà trente ans, il nous a été dit : on fait de la décentralisation, ce qui implique de quitter Paris. Or, désormais, tout est entassé dans les capitales régionales ! Les autres, les petits départements ruraux et hyper-ruraux sont complètement délaissés. Il faut remédier à cette situation. Le chantier est immense. Il faut inventer des procédures, revoir les problèmes de dotation, de mise en œuvre des deniers publics, et de zonage. Nous avons besoin de nouvelles stratégies, notamment dans l’hyper-ruralité. Enfin, la stratégie d’accueil des entreprises doit aussi être revue.
L’aménagement du territoire et, surtout, l’égalité des territoires, c’est la solidarité, la République, et cela devrait donc couler de source.
Je vous fais confiance, madame la ministre. Le sujet que nous abordons est essentiel, mais il ne sera jamais prioritaire, car les maires ou les sénateurs des villes de 200 000 habitants, 500 000 habitants ou 1 million d’habitants sont toujours privilégiés. Nous, les petits, les ruraux, les sans-grades, nous passons après les autres. Pourtant, il s’agit d’une grande tâche !
J’ai confiance en M. Hollande, en Jean-Marc Ayrault et en vous-même, madame la ministre. Nous demandons une loi de programmation, qui devra être élaborée avec toute l’intelligence qu’elle mérite.
Une telle loi de programmation ne peut être produite dans la précipitation. Il faut distinguer les zonages, et étudier ce qu’il est possible de faire.
Notre sujet porte notamment sur la question des infrastructures. Il est important de rappeler que, sur cette problématique, certains pays comme le Canada réservent un pourcentage de leur budget à l’hyper-ruralité. En France, nous pouvons faire aussi bien.
Cette loi bien élaborée, bien pensée, prenant en compte les attentes des ruraux, je vous sais capable, madame la ministre, de la mettre en œuvre. §

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, peut-on encore parler d’aménagement du territoire à l’heure de la mondialisation ou, à tout le moins, de l’Union européenne ?
Peut-on encore appliquer des méthodes centralisées, qu’elles soient colbertistes, napoléoniennes ou républicaines, pour organiser le territoire ? D’ailleurs, l’organisation du territoire, est-ce régalien, comme l’a dit un intervenant tout à l’heure ? N’est-ce pas « ringard » ?
Surtout, les objets de l’aménagement sont-ils ceux dont s’occupaient le baron Haussmann, les plans quinquennaux ou le préfet Delouvrier, à l’heure où nous venons de recréer de véritables potentats métropolitains ?
Évidemment non, comme le prouvent la fusion et le changement de dénomination de la Délégation à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale – la DATAR –, du Secrétariat général du comité interministériel des villes et de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances en un Commissariat général à l’égalité des territoires, sous votre tutelle, madame la ministre.
Voilà un thème passionnant dont les quelque treize sénateurs et sénatrices présents pourraient débattre pendant des heures, le sujet ne semblant pas susciter la présence de nos autres collègues en séance.

Heureusement, comme toujours !
En effet, l’aménagement du territoire est forcément une politique complexe, puisqu’il s’agit en réalité de la conjonction de plusieurs politiques – services publics, mobilité, développement économique – qui doivent être menées à tous les échelons territoriaux.
Beaucoup d’efforts ont été menés pour organiser le développement des territoires, entre rural et urbain – peut-être insuffisamment pour le rural – et également au sein même des territoires ruraux et au sein des territoires urbains.
Malgré tout, on constate des échecs, probablement dus, dans certains cas, à une vision à trop court terme. Je ne citerai qu’un exemple : le déséquilibre entre l’est et l’ouest de la région parisienne.
Ainsi, nos collègues Fichet et Mazars ont publié en février 2013 un rapport qui souligne l’influence des politiques d’aménagement du territoire sur le développement économique : « sans infrastructures de transports et de communication adéquates, il est difficile, voire impossible d’attirer nombre d’activités économiques sur le territoire. »
Jusqu’à une période récente, l’aménagement spatial s’est borné au développement des autoroutes ou des lignes à grande vitesse.
Cette conception est révolue, et le Grenelle de l’environnement a souligné la nécessité de mettre un coup d’arrêt au développement routier.
Le transport ferroviaire de proximité est à la peine, face aux lourds investissements de modernisation nécessaires actuellement.
Pourtant, les dessertes ferroviaires locales sont pour les territoires non centraux une nécessité alors que, si l’on observe les choix budgétaires actuels, la priorité est donnée aux lignes à grande vitesse.
L’aménagement du territoire implique un réseau ferroviaire en toile d’araignée, et non ces trains à grande vitesse et grande distance qui visent à relier la France et le reste du monde à Paris.
Il faut aussi penser à reconstruire le fret, disparu depuis une vingtaine d’années : mettre un camion sur un train sera toujours moins polluant et plus sûr pour les usagers de la route qu’un camion qui roule.
Il faut donc retrouver des marges de manœuvre budgétaires grâce à la taxe poids lourds dite « écotaxe », mais qui devrait s’appeler « pollutaxe ». Cette redevance est au service de l’activité locale des territoires, parce qu’elle incite les transporteurs et leurs clients à optimiser leurs transports, autrement dit à ne plus faire circuler de poids lourds à vide.
La crise de l’écotaxe nous oblige d’ailleurs à raisonner à l’échelle européenne en prenant en compte les territoires frontaliers. L’Alsace, à l’inverse de la Bretagne, demande sa mise en œuvre car les camions ont envahi ses routes. L’Allemagne a mis en place la taxe poids lourds il y a déjà presque dix ans...
Un autre enjeu réside dans l’aménagement numérique des territoires, qui est une façon de se déplacer virtuellement ! Le numérique permet de surmonter les problèmes de mobilité, d’isolement, ou encore de handicap grâce aux services en ligne et de gérer au plus près les besoins des citoyens.
C’est pourquoi je salue les départements pionniers, notamment les départements ruraux, ceux qui se sentent tellement abandonnés par le centralisme parisien, et le volontarisme du Gouvernement qui s’est fixé pour objectif que l’ensemble du territoire ait accès au très haut débit sous dix ans. Il s’agit d’un objectif décisif pour nos territoires comme pour la France dans ses rapports avec le monde.
De plus, le maillage numérique permet la délocalisation de nos institutions, par exemple l’École nationale d’administration, l’ENA, à Strasbourg, mais aussi l’INSEE. Toutes ces institutions n’ont finalement pas besoin d’être à Paris.

Il permet également de désengorger Paris et de donner du travail aux jeunes, là où ils ont étudié.
Si le territoire est fixe, tel n’est pas le cas des individus et des familles. Comme le souligne la mission commune d’information concernant l’avenir de l’organisation décentralisée de la République dans le rapport qu’elle a publié récemment, on ne vit plus toujours sa retraite à l’endroit où l’on a travaillé. Ce phénomène ira en s’accélérant avec le vieillissement croissant de la population. De même, hélas ! on ne travaille plus là où on a étudié.
Comment nous, politiques, pouvons-nous avoir une quelconque action sur cette mobilité individuelle ? Devons-nous avoir une action ?
Est-ce le rôle de l’État, des régions, des entreprises ou des individus de penser l’aménagement du territoire ?
L’aménagement du territoire est-il une nécessité ou l’intelligence des territoires ne saura-t-elle pas faire face aux problèmes rencontrés avec un minimum d’intervention ? Tel est l’enjeu de notre débat. §

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous le savons tous, l’aménagement du territoire est un domaine sensible. En effet, qu’il s’agisse de la politique de grands travaux, de la couverture numérique, du développement du ferroviaire, ou encore des pôles de compétitivité, toutes les actions liées à l’aménagement du territoire ont un coût, qu’il soit assuré par l’État, les collectivités ou des sociétés commerciales.
De plus, ces investissements, nous le savons également, sont peu valorisants pour les gouvernements, qui ne récoltent que trop tardivement les fruits de leurs arbitrages.
Pourtant, c’est bien à l’État qu’il convient de définir les grands axes de la politique d’aménagement du territoire.
Or, malgré les efforts des précédents gouvernements qui ont largement investi dans l’aménagement du territoire en mettant en place les pôles de compétitivité, le Grand Paris, la couverture numérique avec les réseaux d’initiative publique, le financement de lignes à haute vitesse, il est nécessaire aujourd’hui, madame la ministre, de prendre conscience du fossé qui se crée entre les hyper-centres connectés à la mondialisation et le reste de nos territoires plus démunis, meurtris, comme vous l’avez souvent dit.
Ce constat va à l’encontre même de l’esprit de la politique d’aménagement du territoire et de l’égalité des territoires. Il n’est donc pas supportable.
Il faut l’admettre, les gouvernements précédents n’ont sans doute pas réussi à répondre pleinement à la progression de l’inégalité des territoires. Mais, malheureusement, madame la ministre, en ce qui concerne le gouvernement actuel, malgré l’avancement du phénomène, il ne semble pas que vous proposiez de réponses plus ambitieuses, au contraire.
Je voudrais ici justifier mes propos. Si l’on établit une rapide comparaison entre les projets annuels de performance des programmes 112 et 162 pour les années 2012 et 2014, celle-ci montre une continuité, entre le gouvernement précédent et le gouvernement auquel vous appartenez, dans la plupart des objectifs assignés à la politique des territoires.
Cette continuité se traduit dans quelques objectifs incontournables, tels que la redynamisation des territoires ruraux, ou encore le soutien au développement des pôles de compétitivité.
Remarquons que l’on trouve en supplément, en 2014, de nombreux vœux pieux sur le développement solidaire des territoires. Cela est louable, madame la ministre, mais quels outils sont proposés par le Gouvernement pour réaliser ce développement ?
Pour étayer mes propos, prenons quelques exemples et quelques dates. Les pôles d’excellence ruraux, dont un rapport d’information sénatorial nous informe de la réussite, ont été créés en 2005. C’est lors du Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire, le CIADT, en 2010 qu’ont été prises l’ensemble des mesures afférentes à la valorisation du potentiel des territoires ruraux, comme les maisons de santé. C’est encore le 28 septembre 2010 que l’accord « + de services au public » a été signé par neuf opérateurs nationaux et l’État.
Force est de constater que vous utilisez les outils mis en place par le gouvernement précédent. Je constate que lorsqu’il s’agit des objectifs, entre 2012 et 2014, les trois quarts des indicateurs sont restés identiques. Je ne peux que vous en féliciter, madame la ministre !
Malheureusement, les politiques des territoires du gouvernement précédent et du gouvernement actuel se distinguent lorsqu’il s’agit d’évoquer les dépenses.
C’est notamment ce qu’indique l’analyse des crédits de la mission « Politique des territoires » du projet de loi de finances pour 2014. L’examen de ce texte dans quelques jours m’oblige à m’attarder un instant sur des considérations budgétaires. Pardonnez-moi d’anticiper sur l’analyse détaillée des objectifs et des crédits afférents à cette mission, mais elle constitue, madame la ministre, le point cardinal de la politique de l’État en faveur de l’aménagement du territoire.
Première constatation : la mission « Politique des territoires » est dotée de 281 millions d’euros ; sa dotation baisse donc pour la deuxième année consécutive, puisque la loi de finances pour 2013 prévoyait 310 millions d’euros et la loi de finances pour 2012, 340 millions d’euros.
Deuxième constatation, plus grave encore : plus de la moitié des 30 millions d’euros d’économies sont réalisés sur l’action 2 du programme 112, intitulée « Développement solidaire et équilibré des territoires ». Les autorisations d’engagement passent ainsi de 133 millions d’euros pour 2013 à 110 millions d’euros pour 2014. Or, madame la ministre, c’est précisément cette action qui finance l’égalité d’accès des usagers aux services publics, notamment – mes collègues l’ont déjà souligné – dans les zones rurales, ainsi que l’amélioration de l’accès à l’offre des soins par l’achèvement du financement des 300 maisons de santé pluridisciplinaires. Où en est-on ?
À l’évidence, ces restrictions budgétaires mettent en danger la continuité des engagements pris dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire. Aussi souhaiterais-je, madame la ministre, que vous nous éclairiez sur la façon dont vous allez pouvoir tenir ces engagements. Cela me paraît capital.
Je me suis également demandé si les baisses de crédits résultaient uniquement d’économies sur les dépenses de fonctionnement. Il n’en est rien. Malgré la création du Commissariat général à l’égalité des territoires, en remplacement – on ne sait pas très bien pourquoi – de la DATAR, du secrétariat général du comité interministériel des villes et de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, les dépenses de fonctionnement augmentent par rapport aux autorisations d’engagement ouvertes en 2013, passant de 10, 3 millions d’euros à 10, 4 millions d’euros. Ce sont donc les dépenses d’intervention qui vont baisser : les autorisations d’engagement passent de 235, 7 millions d’euros pour 2013 à 219, 6 millions d’euros pour 2014.
Afin de ne pas anticiper davantage sur l’examen du projet de loi de finances, je reviendrai maintenant sur un exemple précis, déterminant pour l’égalité des territoires. Cet exemple, qui concerne particulièrement l’aménagement de mon département, les Alpes-Maritimes, mais pas seulement, témoigne à l’évidence du désengagement de l’État. Il s’agit du rapport de la commission « Mobilité 21 » sur la mobilité durable, présenté en juin dernier ; il s’agit surtout – c’est ce point que je veux souligner – de la réaction du Gouvernement, qui a salué un rapport prônant l’arrêt des constructions de lignes à haute vitesse. Madame la ministre, je souhaiterais savoir si le Gouvernement va ainsi bloquer le progrès économique, social et environnemental, au détriment du développement durable.
Les constructions de lignes à haute vitesse sont en effet indispensables pour redynamiser une aire géographique et préserver la qualité environnementale des territoires concernés. Le rapport prône notamment le développement des transports périurbains. Bien sûr, le développement de l’offre de transports périurbains est essentiel au regard des évolutions démographiques, mais elle trouvera à s’appliquer avec une intervention moindre de l’État – c’est cela qu’il importe de souligner –, ce qui n’est pas le cas de la construction des grands axes et du désenclavement de certaines régions, où l’État est et doit être le principal acteur.
Je pose donc la question au Gouvernement : quel sort compte-t-il réserver aux lignes à grande vitesse Montpellier-Perpignan et Paris-Nice ? Madame la ministre, ces deux projets ont en commun d’être essentiels pour l’économie de régions frontalières. Je dirai rapidement quelques mots sur la ligne Montpellier-Perpignan. La construction de cette ligne a été retardée à de nombreuses reprises depuis vingt ans. La situation est telle que le président socialiste du conseil général de l’Aude, André Viola, a annoncé qu’il ne recevrait plus de ministre en visite dans son département tant que le Gouvernement resterait désespérément muet sur le sujet.
J’en viens maintenant à la ligne à grande vitesse Paris-Nice, qui est essentielle pour le développement de mon département des Alpes-Maritimes. Je rappelle pour mémoire – c’est important – les trois objectifs du grand projet ferroviaire Sud Europe Méditerranée : désenclaver l’est de la région, faciliter les déplacements à l’intérieur de la région et constituer le chaînon manquant de l’arc méditerranéen Barcelone-Marseille-Gênes. Au vu de ces trois objectifs, il est évident que la construction de la ligne Paris-Nice permettrait de rationaliser l’offre de transport pour toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et accentuerait l’attractivité des départements de cette région.
Soulignons également que, à l’instar de la ligne Paris-Perpignan, cette liaison est essentielle pour des raisons de souveraineté, je dis bien « pour des raisons de souveraineté ». Madame la ministre, vis-à-vis de nos voisins européens, nous devons nous occuper du désenclavement de nos périphéries.
La situation est d’autant plus gênante pour la France que ces régions frontalières luttent sur le terrain de l’attractivité économique avec des régions européennes mondialement connues ; je pense notamment à la Catalogne, côté espagnol, et à la Lombardie, côté italien.
Je demande donc au Gouvernement, en raison des inquiétudes des élus et des populations, de définir les grands axes de sa politique d’infrastructure ferroviaire dans la perspective de l’examen du projet de loi relatif au ferroviaire et de l’adoption du quatrième paquet ferroviaire européen.
En conclusion – puisqu’il est temps de conclure ce bilan alarmant –, le groupe UMP manifeste de vives inquiétudes à l’endroit de la politique d’aménagement du territoire du Gouvernement. La politique d’aménagement du territoire est en danger, et le mal est profond et insidieux.
Prenons un dernier exemple. Si nous accueillons favorablement le nouveau modèle de convention visant à faciliter le déploiement de la fibre optique en France, nous considérons que la fracture numérique ou technologique n’est en fait – je veux insister sur ce point – que le résultat malheureux d’un décrochage programmé – par le gouvernement actuel – des communes classées en zone de montagne, des communes rurales et des villes moyennes, qui ne semblent pas trouver leur place dans l’égalité des territoires ni dans la mondialisation. Or, madame la ministre, le travail de fond sur l’attractivité des territoires, indépendamment de l’offre technologique, n’a toujours pas été réalisé par le Gouvernement. Nous attendons. §

Madame le ministre, vous avez pleinement raison quand vous affirmez que la politique de l’égalité des territoires a l’obligation de réussir. En effet, la disparité qui subsiste entre les territoires ruraux et les territoires urbains est contraire à l’efficacité économique dans notre pays.
Nos 30 000 communes rurales sont l’avenir de la France. Ce n’est pas un langage convenu, c’est l’affirmation que notre vaste territoire, le plus grand de l’Union européenne, doit exploiter sa taille. C’est un atout considérable. Il faut rééquilibrer notre territoire et faire en sorte que les communes rurales soient elles aussi reliées aux centres économiques mondiaux. C’est à travers la généralisation de l’accès au très haut débit que l’on parviendra à exploiter les talents, attirer les investisseurs et améliorer la qualité de vie de tous, jusque dans les zones les plus isolées.
La France se situe seulement au vingt-troisième rang européen en matière de déploiement du très haut débit, et au trente-huitième rang mondial en matière de vitesse de connexion moyenne. C’est très médiocre. La France doit produire un effort considérable de mise à niveau. La quasi-totalité des petites communes subissent la fracture numérique, du fait de débits insuffisants et même, très souvent, de l’absence totale de service ADSL. Notre taux de pénétration de la fibre optique est de 8 % seulement, contre 17, 7 % en moyenne européenne.
Aujourd’hui, madame le ministre, bien que 98 % des entreprises de plus de dix salariés soient connectées à Internet, la grande majorité d’entre elles n’ont pas accès à des services de très haut débit et doivent se contenter du même niveau d’offre que les particuliers. Je rappelle que le Japon et la Corée du Sud ont fait le choix stratégique d’investir massivement dans les réseaux de fibre optique pour atteindre 1 gigabit et intensifier ainsi leur compétitivité.
Le numérique est essentiel au développement des entreprises. Il est vital pour les petites et moyennes entreprises, les PME, qui représentent 60 % des emplois de notre économie et sont très souvent implantées en zone rurale. De manière plus inquiétante, les tarifs pratiqués sont absurdes, car antiéconomiques : les PME qui disposent d’une connexion à très haut débit paient 200 euros hors taxe par mois pour 2 mégabits et 1 000 euros pour 10 mégabits. C’est contraire à tout bon sens ! C’est une entrave au développement de leur compétitivité et à leur installation en zone rurale.
Les modalités de déploiement proposées inquiètent les collectivités. Par exemple, le Schéma directeur territorial d’aménagement numérique, le SDTAN, du Gers, qui définit les actions et moyens à mettre en œuvre dans le département, prévoit que le déploiement du réseau très haut débit en fibre optique ne concernera qu’une faible partie du territoire : celle où l’habitat est le plus dense.
Certaines communes équipées d’infrastructures téléphoniques, à savoir un nœud de raccordement ou un sous-répartiteur desservant plus de quatre-vingts abonnés, bénéficieront certes d’une montée en débit, mais elles n’auront pas accès au très haut débit. Les communes qui se situent à plus de cinq kilomètres de ces installations ne bénéficieront que d’un renforcement de leur débit via des antennes paraboliques et des antennes Wifi, procédés peu fiables, limités en débit et dont la durée de vie n’excédera pas quinze ans. L’ensemble des communautés de communes devront pourtant contribuer au financement de l’aménagement numérique.
Ce recours au « mix technologique », qui doit être transitoire, creuse les inégalités d’une commune à l’autre et ne répond pas aux besoins réels de la population. Il serait plus efficace d’installer la fibre optique selon un calendrier d’échéance précis, réaliste et ambitieux. Nous devons aussi anticiper l’accroissement considérable des applications du très haut débit et avoir le courage et l’ambition de prévoir un suréquipement au départ ou de mettre en place des infrastructures évolutives.
L’objectif de couvrir la France entière en 2025 représente un investissement global important, estimé à 23, 5 milliards d’euros. Il faut trouver un moyen de financement juste, pérenne, équilibré, entre toutes les collectivités. Notre collègue Hervé Maurey a proposé voilà quelques instants un financement mutualisé, au travers d’une contribution des abonnements d’accès Internet fixe, de la téléphonie mobile et d’une taxe sur les produits électroniques grand public. Il a raison : il faut mettre en place un dispositif spécifique d’alimentation durable du Fonds d’aménagement numérique du territoire. Quel sera-t-il, madame le ministre ?
Pour planifier la montée en débit dans les territoires ruraux, une action coordonnée et une mutualisation des coûts entre les opérateurs privés, les collectivités territoriales et l’État sont indispensables. Les opérateurs investissent dans les territoires les plus denses, car, pour eux, les zones rurales ne sont pas rentables. Les projets réalisés en milieu urbain devront donc, dans un souci d’équité, financer les infrastructures numériques des zones rurales.
La définition d’un programme réaliste de couverture des zones blanches est attendue des élus, qui sont exaspérés d’entendre parler de l’essor de la téléphonie mobile 4G, alors que de nombreuses communes n’ont toujours pas de couverture mobile 2G et 3G ! Il est inadmissible qu’en 2013 on ne puisse pas joindre un médecin d’urgence de n’importe quel point de notre territoire.
Je cite cet exemple du domaine médical, car l’accès au très haut débit est aussi un outil indispensable de gestion de santé publique. En effet, le numérique a le potentiel pour améliorer l’efficacité de notre système de soins et de gestion de la dépendance. L’e-santé constitue l’une des solutions aux problèmes d’organisation de la couverture médicale des communes rurales. La télésanté permettra aux médecins de surveiller leurs patients à distance et d’échanger des données médicalisées avec leurs collègues par l’Internet. Mais la télétransmission des actes de soin, la gestion du dossier médical informatisé et le suivi des patients à distance ne seront possibles que si l’accès au très haut débit est une réalité sur l’ensemble du territoire.
Par ailleurs, le télétravail est une activité en pleine croissance. Inspirons-nous des Pays-Bas, où il existe une centaine de Smart Work Centers, des télécentres comportant des espaces de travail, de réunion et des salles de téléprésence. Ces structures permettent à des territoires de moindre densité urbaine d’implanter dans les zones rurales des unités économiques très variées qui sont pour l’instant implantées dans les métropoles où se concentrent les crèches, les services publics, les banques ou les micro-entreprises. Ces télécentres peuvent devenir des bases essentielles du télétravail, lequel peut être un outil de développement des territoires ruraux. À titre d’exemple, le programme novateur Soho-Solo mis en place par la CCI du Gers s’est concrétisé par la création de huit télécentres et l’inscription de plus de 300 télétravailleurs, ce qui est appréciable à l’échelle de la population active du département.
Pourtant, malgré son potentiel, le télétravail ne concerne que 7 % de la population en France, contre en moyenne 13 % en Europe et 25 % en Amérique du Nord.
Le numérique constitue notre nouvelle frontière, qui est très attendue. Il donne un sens à l’expression « égalité des chances », qui n’est que trop souvent un simple slogan. Il est un moyen de donner une réalité au désir d’entreprendre, qui a déserté notre pays, en privant des territoires de l’économie moderne.
Francis Bacon nous exhorte à « reculer les bornes de l’Empire humain en vue de réaliser toutes les choses possibles ». Dans cet esprit, le numérique révolutionne notre société en générant de nouvelles inventions. La croissance repose aujourd’hui sur les nouvelles technologies et leurs applications. Si nous ne parvenons pas à résoudre le problème de l’accès au très haut débit dans les territoires ruraux, nous pénaliserons toute la France. En créant un écosystème favorable à la créativité et au progrès sur l’ensemble de notre territoire, nous entrerons ainsi tous ensemble dans la modernité. §

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, régulièrement, le Sénat débat sur le thème de l’aménagement du territoire pour dire combien il est important de permettre un aménagement équilibré de notre pays, listant tous les domaines où l’intervention publique est nécessaire pour garantir l’égalité partout sur l’ensemble du territoire.
Je dois bien avouer que plutôt que de débattre entre nous, sans que cela puisse déboucher sur une mesure concrète, nous aurions préféré examiner le projet de loi sur les territoires qui nous a été annoncé voilà maintenant plusieurs mois. Madame la ministre, vous nous direz sans doute dans votre réponse quand celui-ci nous sera enfin soumis.
Nous aurions également aimé que le Sénat adopte, le 10 octobre dernier, comme il en avait la possibilité, la proposition de loi, présentée par mon collègue Le Cam, opérant un rééquilibrage dans la répartition de la dotation globale de fonctionnement aujourd’hui trop défavorable aux petites communes.
Nous partageons, semble-t-il, sur toutes les travées, ou presque, de cet hémicycle, le diagnostic préoccupant de l’abandon progressif des territoires, du creusement des inégalités sociales et spatiales depuis de trop nombreuses années. Les sénateurs Renée Nicoux et Gérard Bailly ont d’ailleurs produit, il y a peu, un rapport dressant un constat sans appel sur le sujet.
La France a longtemps été un pays au fort pouvoir central, mais le mouvement engagé depuis les années quatre-vingt a amorcé une décentralisation donnant plus de pouvoirs aux territoires. Cette démarche a jusqu’à présent toujours été accompagnée d’une forte déconcentration permettant l’accompagnement et le soutien de l’État au plus près des territoires, ce qui a permis des avancées majeures pour la population.
Aujourd’hui, avec l’acte III de la décentralisation, le Gouvernement rompt avec cette tradition : tout en se voyant confier plus de responsabilités et de compétences, les collectivités sont privées du soutien de l’État et sont très contraintes financièrement. L’État lance même des politiques sans prévoir les ressources nécessaires pour les mener en confiant simplement leur réalisation aux collectivités selon le principe : « je décide, tu paies ! »
La réforme des rythmes scolaires constitue à ce titre un bel exemple. Ce sont les collectivités qui assument une politique décidée nationalement, sans les ressources nécessaires, créant de fortes disparités sur le territoire et une insatisfaction justifiée.
Ainsi, dans le cadre des lois de finances, non seulement les dotations des collectivités baissent de 3 milliards d’euros sur deux ans – et nous pensons que cette baisse va continuer –, mais, en plus, l’ingénierie d’État continue d’être démantelée, notamment dans le cadre du ministère de l’égalité des territoires. Comment agir dans ces conditions ? Comment œuvrer pour l’égalité des territoires lorsque la présence humaine au sein des préfectures est toujours rognée, avec des effectifs en baisse de 3 000 emplois entre 2009 et 2013 ? Ce désengagement de l’État bat en brèche, à nos yeux, la notion même d’égalité des territoires.
Alors se dessine une France à deux vitesses distinguant les territoires relevant de la métropole, qui aspirent les pouvoirs et les ressources, et les autres territoires, laissés sinon à l’abandon, du moins dans de grandes difficultés.
Une telle réorganisation de l’architecture institutionnelle porte atteinte à toute idée d’aménagement équilibré des territoires, et comporte deux écueils. Tout d’abord, elle met à mal la démocratie, parce que, nous le savons tous, la proximité des élus avec la population, et le contrôle réel que celle-ci peut opérer, est le gage d’une meilleure adéquation entre les besoins et les projets portés par et pour les territoires.
En outre, la marche forcée organisée vers l’intercommunalité, comme modèle et réponse unique aux enjeux d’aménagement du territoire, ainsi que nous l’avons vu lors du débat sur le transfert automatique de la compétence PLU, semble être une impasse ou, du moins, apparaît déconnectée des réalités locales concrètes.
Alors que l’État, depuis de nombreuses années, a laissé les territoires à l’abandon faute d’y consacrer les moyens nécessaires, ceux-ci ont dû s’organiser eux-mêmes. Aujourd’hui, les lois successives tendent vers la définition d’un cadre normatif et législatif extrêmement contraignant laissant entendre que les élus locaux, principalement les maires, seraient responsables de tous les maux, et notamment de l’étalement urbain, de l’artificialisation de sols, de la gabegie des finances. Quelle caricature !
En donnant le sentiment d’une impuissance, voire d’une incompétence des élus locaux, alors même que ce sont les collectivités qui sont à l’origine de plus de 70 % de l’investissement public, on nourrit désillusion et colère, on renforce, au fond, le sentiment de l’abandon et de la fatalité, ce qui, dans un contexte économique tendu, a des conséquences politiques graves pouvant mener à des comportements antirépublicains.
Aborder efficacement l’enjeu de l’aménagement du territoire devrait ainsi se traduire prioritairement par l’octroi de moyens financiers et humains en appui aux collectivités, car force est de constater qu’elles sont les maillons essentiels de la cohésion nationale.
L’État, par sa politique en termes de service public, a également renoncé à garantir à tous l’accès aux services principaux. Nous regrettons à cet égard que la présente majorité n’ait pas mis un point d’honneur à revenir sur les lois successives de privatisation, que ce soit de la Poste, d’EDF ou de GDF. Le démantèlement de la présence des hôpitaux publics se poursuit, au nom de la rationalisation de l’action publique. Le rail souffre toujours de sous-investissement, comme en témoigne l’accroissement de sa dette. Le fret est progressivement abandonné dans sa mission de proximité, alors que le wagon isolé est l’un des éléments déterminants de la transition écologique. Des villages continuent de dépérir, alors même que, selon des études récentes, de plus en plus de nos concitoyens aspirent à partir des zones urbaines, espérant ainsi gagner en qualité de vie. Mais ils ne le font pas, faute d’infrastructures suffisantes et de garantie d’emploi.
Car, au fond, c’est bien de cela qu’il s’agit : la redynamisation de nos territoires et la nécessaire réindustrialisation ne peuvent être réussies en dehors de la présence et du maillage fin du territoire par les services publics.
Dans ce cadre, nous regrettons que les engagements financiers pour la couverture numérique ne soient pas à la hauteur des enjeux de cette révolution, pourvoyeuse de développement et source d’emplois, notamment pour les territoires les plus enclavés. L’enjeu numérique est du même ordre que la construction du rail hier : c’est fondamental !
À ce propos, j’ai entendu avec plaisir notre collègue Hervé Maurey fustiger l’attitude du privé, qui investit seulement là où c’est rentable. Mon cher collègue, vous me voyez ravie de constater que vous rejoignez nos positions !

Madame la ministre, vous proposez de poursuivre la voie tracée par la précédente majorité, dès 2010, avec le projet de « plus de service au public » en lieu et place de « plus de service public ». Les mots ont un sens !
Vous avez annoncé comme un engagement fort, le 4 novembre dernier, 1 000 nouvelles maisons de services au public à l’horizon 2017. L’État et les opérateurs contribueront à couvrir 50 % des besoins de fonctionnement des initiatives locales. Le reste sera, encore une fois, à la charge des collectivités locales. Une telle démarche relève pourtant, à nos yeux, de la responsabilité nationale.
Sur le fond, et plus généralement, le Gouvernement est lié par Bruxelles et sa politique de l’austérité. En adoptant le traité européen, vous avez autorisé la Commission à se prononcer sur les budgets nationaux et même à exiger des modifications si elle estime que les documents ne sont pas conformes aux objectifs.
Elle a d’ailleurs fait savoir qu’elle attendait beaucoup plus de rigueur de l’État français. Le budget dont nous débattrons bientôt, qui nous semble déjà contestable, est même jugé insuffisamment rigoureux et trop dispendieux.
Nous croyons donc, et je terminerai sur ce point, que les politiques d’aménagement du territoire ne pourront trouver de cadre d’amélioration qu’en rompant avec le carcan libéral imposé, qui conforte les inégalités territoriales et sociales. Au fond, c’est l’idée même d’une politique publique qu’il faut réhabiliter.
À défaut de remise en cause des dogmes libéraux appliqués aux territoires, l’idée même d’aménagement du territoire n’est plus opérationnelle pour assurer le développement de tous nos territoires tant elle est assimilée par certains à une véritable politique d’assistance. §

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, vous me permettrez tout d’abord de regretter le ton outrancièrement polémique de M. Maurey, que j’ai connu, parfois, plus mesuré.
Comme toutes les politiques publiques, la politique de l’aménagement du territoire a oscillé au cours des cinquante dernières années entre une option libérale et une option plus régulatrice.
La création du ministère de l’égalité des territoires symbolise la volonté du Gouvernement de lutter contre la fracture territoriale qui s’est aggravée ces dernières années.
Laurent Davezies nous rappelle que, grâce à la décentralisation, les inégalités régionales se sont considérablement réduites. Le fameux ouvrage de Jean-François Gravier, Paris et le désert français, publié en 1947, décrivait une France déséquilibrée entre une région-capitale écrasante où tout se passait et une province endormie dont l’ennui faisait fuir les talents vers la ville lumière. Nous n’en sommes plus là, fort heureusement.
Mais en même temps que les inégalités régionales se réduisaient considérablement, les inégalités infrarégionales, elles, persistaient, voire se développaient, notamment ces dernières années.
L’égalité des territoires constitue non pas un absolu, mais un cadre pour l’action publique. À cet égard, je me félicite du changement de cap du Gouvernement dans ce domaine, et en dix-huit mois la logique de l’intervention de l’État a été inversée.
Elle a tout d’abord été inversée par l’instauration d’une nouvelle relation entre l’État et les collectivités territoriales et leurs élus. Une relation de confiance…

… affichée par le Président de la République à la Sorbonne, en octobre 2012, lors des états généraux de la démocratie territoriale. Une nouvelle relation proposée par le Premier ministre dans le cadre de l’élaboration du nouveau Pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités territoriales.
« L’État et les collectivités territoriales doivent retrouver le chemin de la confiance. Ils doivent être des partenaires, des acteurs qui se complètent », a déclaré le Premier ministre. Je cite cette phrase car, vous le reconnaîtrez tous aisément, elle nous change des discours stigmatisant les collectivités territoriales et les élus qui avaient contribué à installer un lourd climat de défiance dans les territoires.
Ce changement de paradigme s’établit dans un contexte financier difficile et l’opposition a beau jeu de critiquer les réductions de crédits, mais le cap est le bon !
La logique d’intervention de l’État a été inversée, parce que, madame la ministre, vous avez clairement et fortement affirmé, dans votre discours de Vesoul en particulier, que l’aménagement du territoire doit redevenir une priorité !
La crise que nous traversons est violente pour tous, mais selon la place que l’on occupe désormais dans le réseau de production mondial, on est plus ou moins exposé, on résiste plus ou moins. La crise est violente, mais tous les territoires ne la subissent pas de la même manière.
Le journal Le Monde daté du 31 octobre présente une carte de l’INSEE qui dépeint, de manière impressionnante, les fractures territoriales à partir des évolutions du nombre d’emplois par bassin d’emploi entre 2008 et 2012. Celles-ci varient de moins 14 % à plus 6 %. Certains bassins d’emploi ont un taux de chômage supérieur à 13 %.
Dans mon département de Lot-et-Garonne, les trois bassins d’emploi ont tous subi une baisse du nombre d’emplois : pour deux d’entre eux, la baisse s’établit entre 0 % et 5 % et, pour le troisième, autour de 10 %. Ce département est situé, pour partie, dans la fameuse « diagonale aride » identifiée par le géographe André Brunet et vous comprendrez que je sois particulièrement sensibilisé à la question de l’aménagement du territoire.
Cette géographie du choc de la crise appelle un volontarisme de l’action publique, un partenariat étroit entre les collectivités territoriales et les acteurs économiques et sociaux. La politique d’aménagement du territoire doit viser à soutenir les territoires en difficulté, tout en encourageant la dynamique des territoires les plus compétitifs, car ceux-ci « tirent » la croissance et assurent la péréquation.
Je salue votre volontarisme, madame la ministre, dans ce contexte extrêmement difficile, je le répète.
Je me félicite de la création du Commissariat général à l’égalité des territoires, le CGET, qui regroupera les services de la DATAR, de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances et du secrétariat général du comité interministériel des villes. Le Commissariat général à l’égalité des territoires atteste la volonté d’en finir avec la dichotomie entre l’urbain et le rural, qui a marqué la conduite des politiques en faveur des territoires ces dernières années. Il devrait doter l’État d’une structure lui permettant de concevoir ces politiques de façon plus globale, et donc plus cohérente. Il devrait également lui permettre de conduire ses missions de manière plus « transversale ». Il constitue en tout cas une nouvelle et belle occasion pour revisiter notre conception de l’aménagement du territoire.
Parmi les objectifs majeurs fixés au CGET, vous insistez sur l’accessibilité des services au public. Nous le constatons tous, la disparition des services publics et des services au public en milieu rural engendre un sentiment d’abandon extrêmement fort de la part des élus et des populations locales. Il est urgent de réagir.
La création d’emplois dans l’éducation et dans les forces de sécurité constitue un geste fort à l’égard des territoires. Pour la première fois depuis sept ans, vingt et un postes d’enseignants ont été créés à la rentrée de septembre 2013 dans mon département. De tout cela, M. Maurey ne dit rien, et il ose parler d’objectivité !
Les maisons de services au public peuvent constituer une réponse pour les territoires les plus démunis et je vous demande, madame la ministre, de bien vouloir nous préciser vos ambitions en la matière.
J’attends avec impatience la mise en œuvre des schémas départementaux d’accessibilité des services au public, prévus dans le deuxième projet de loi de décentralisation. Madame la ministre, vous envisagez d’expérimenter cette mesure avant le vote de la loi, avec les départements qui le souhaitent. Je me permets donc de vous proposer la candidature du département de Lot-et-Garonne, que j’ai l’honneur de présider.
Je suis persuadé que les départements peuvent, en partenariat avec les intercommunalités et l’État, jouer un rôle de premier plan dans le maillage des services publics et des services au public ; tel est d’ailleurs le cas dans mon département.
De la même manière, ils peuvent et doivent mener des politiques partenariales avec l’État et les intercommunalités en faveur des aménagements des centres-bourgs ruraux, pour éviter leur dépérissement et accompagner leur revitalisation. Dans le secteur du logement, les partenariats entre l’État, les collectivités et les opérateurs peuvent également s’avérer féconds.
La nouvelle vision de l’aménagement du territoire que vous défendez, madame la ministre, doit trouver sa traduction dans la nouvelle phase de négociation des contrats de plan État-région qui font suite aux contrats de projet.
Ceux-ci devront, me semble-t-il, incarner une autre approche de l’aménagement du territoire pour passer d’une logique de compétition entre les territoires à une logique d’accompagnement d’une stratégie régionale de prise en compte des territoires en déshérence. Il est en effet choquant de constater, mes chers collègues, que ce sont généralement les territoires disposant de moyens importants en ingénierie qui remportent ces appels à projet, même si, je le répète, les territoires dynamiques doivent aussi être encouragés. Cependant, la logique libérale des appels à projet contribue à exclure les territoires les plus fragiles. Ces procédures peuvent donc créer des inégalités là où elles sont censées les réduire. Des mesures spécifiques doivent donc être envisagées pour les territoires les plus fragiles. De ce point de vue, les pôles territoriaux de solidarité et d’aménagement, introduits par le Sénat dans le projet de loi relatif aux métropoles, peuvent constituer des outils intéressants.
Au-delà de la problématique essentielle de la création de valeur et de la création d’emploi dans les espaces ruraux, je voudrais m’attacher à rappeler l’importance stratégique du numérique et de la démographie médicale dans l’aménagement du territoire.
Le numérique est en train de bouleverser l’économie, le rapport entre les individus, le rapport à la distance et au temps. Il constitue un vecteur et un enjeu de développement majeur pour nos sociétés. Il constitue également un vecteur de fracture territoriale, si l’on en reste à une simple logique libérale de déploiement des réseaux, comme le faisait le précédent gouvernement.
La logique engagée par le Gouvernement est tout autre : un État stratège au service de la compétitivité et des territoires.

La feuille de route numérique et le plan « France très haut débit » portent une nouvelle vision de l’aménagement du territoire avec, d’une part, une volonté affichée de couvrir l’ensemble du territoire en très haut débit dans les dix ans et, d’autre part, la prise en compte des spécificités territoriales dans le soutien de l’État : financement des déploiements du très haut débit dans les zones denses par les opérateurs, cofinancement par les opérateurs et les collectivités territoriales et l’État dans les zones moins denses, cofinancement par l’État et les collectivités territoriales dans les zones très peu denses, avec des soutiens financiers de l’État pouvant atteindre 62 %.
Le modèle proposé semble recueillir l’assentiment de la plupart des acteurs du numérique. Un grand pas en avant a été fait dans ce domaine par rapport à la situation antérieure §et il ne tardera pas à produire ses effets, monsieur Maurey, …

… tant les projets sont nombreux sur nos territoires.
De la même manière, la démographie médicale constitue un enjeu majeur pour l’aménagement équilibré du territoire, car la désertification médicale précède la désertification tout court ! Cette réalité inquiète les Français concernés, car les inégalités de territoire sont flagrantes. Le pacte territoire-santé, présenté par Marisol Touraine, vise à mettre en place un plan global de lutte contre les déserts médicaux. Il va dans la bonne voie, mais il faudra aller plus loin pour éviter que ne s’établissent des situations irréversibles sur certains territoires.
Les territoires ruraux attendent une meilleure considération de la place qu’ils tiennent dans notre pays. La France ne peut se réduire à quelques métropoles entourées d’espaces récréatifs. Les espaces ruraux peuvent être des espaces d’innovation pour peu que les volontés locales, soutenues par un État stratège, trouvent là une expression commune.
Dans son ouvrage Du contrat social, Rousseau écrivait : « C’est précisément parce que la force des choses tend toujours à détruire l’égalité, que la force de la législation doit toujours tendre à la maintenir ». À nous, législateur de contribuer à cette entreprise au travers de la future loi pour l’égalité des territoires que vous allez bientôt nous présenter, madame la ministre. §

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le Président de la République a rappelé, dès son élection, la nécessité de lutter contre la « fracture territoriale ». Comme certains d’entre nous l’ont souligné, il a créé à cet effet le bienvenu ministère de l’égalité des territoires, ce qui devrait permettre de prolonger un souci relativement constant de l’action publique, celui de l’aménagement du territoire. En effet, nous avons souvent légiféré en ce domaine, soit directement, par l’adoption de grandes lois, soit indirectement, à travers des textes ambitieux sur la politique rurale, les transports et le logement.
À l’issue de quelques décennies de pratique de la politique d’aménagement du territoire par l’État, mais aussi par les collectivités locales responsabilisées par la décentralisation, la question est de savoir si le déséquilibre entre le milieu rural et le milieu urbain apparu après la guerre s’est aggravé.
Je dirai, pour ma part, que le bilan est mitigé. Nous sommes heureusement loin, madame la ministre, du « désert français » décrit en 1947 par le fameux géographe Jean-François Gravier dénonçant la macrocéphalie parisienne.
L’espace rural a conservé un certain dynamisme, malgré la diminution de l’emploi agricole. Sans occulter les difficultés, je voudrais rappeler, comme le fait régulièrement l’Association des maires ruraux de France, qu’il faut changer de regard sur la ruralité pour lui donner sa véritable dimension, car l’espace rural représente tout de même 70 % de la superficie totale de l’Hexagone. Dans mon département de Tarn-et-Garonne, de trop nombreuses communes enregistrent plus de décès que de naissances. Pourtant, les lois de décentralisation ont donné des compétences aux collectivités locales, qui ont permis de maintenir, pour la plupart des communes, un cadre de vie et des équipements collectifs tous aussi attractifs que ceux des grandes villes.
Il est également vrai – et nous le déplorons tous, mes chers collègues – que l’on observe un retrait très progressif, mais certain, des services publics. Je pense en particulier à la poste, à la santé, à la justice et à la sécurité, avec un affaiblissement de la gendarmerie en milieu rural, qui subit pourtant de nouvelles formes de délinquance. La révision générale des politiques publiques, la RGPP, a ses limites : aujourd’hui, dans certains services de l’État, on a « atteint l’os ».
La couverture numérique, plusieurs orateurs l’ont rappelé, n’est pas non plus à la hauteur des besoins de tous les territoires. Il faut souvent plaider sa cause auprès des opérateurs pour qu’ils assurent une certaine continuité territoriale.
Je n’oublie évidemment pas l’emploi qui est une préoccupation plus aiguë lorsqu’on ne vit pas directement dans l’orbite d’une grande métropole. Quand les salariés du groupe Doux crient « Non à la misère ! », ils rappellent que le malaise de notre industrie touche en premier lieu les territoires ruraux, tandis que le milieu urbain, nous le savons, amortit mieux la crise. Pendant trente ans, grâce à un effet redistributif, la cohésion territoriale a semblé se maintenir, mais elle se fissure dangereusement aujourd’hui.
En réponse à ce constat, que pouvons-nous faire que nous n’ayons pas déjà expérimenté ? Récemment, nous avons déjà eu l’occasion de débattre de la politique d’aménagement du territoire. Je me réjouis de cette nouvelle initiative qui prolonge celle du groupe RDSE, auteur d’une proposition de résolution sur l’égalité territoriale que nous avions examinée l’année dernière. À l’époque, le président de notre groupe, Jacques Mézard, avait rappelé que la République, conformément à ses valeurs fondatrices, était garante de l’égal accès des citoyens aux services publics, mais aussi à l’emploi et au logement.
Cela suppose, mes chers collègues, de se remobiliser pour une nouvelle politique d’aménagement du territoire adaptée aux nouveaux enjeux issus de la mondialisation. Certains outils publics ont besoin d’être toilettés. L’État ne doit pas être plus présent, mais plus efficace. La DATAR doit être réformée. Nous devons mettre en place une démarche planificatrice. Bien sûr, la question des moyens financiers est prégnante. À cet égard, soyons clairs : tant qu’il n’y aura pas de véritable péréquation, les inégalités entre territoires perdureront. Notre Constitution dispose pourtant à son article 72-2 que « la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales ». Cette affirmation est fondamentale, mais disons-le sans détour, mes chers collègues, elle ne crée aucune contrainte.
Les outils existent : qu’il s’agisse de la péréquation verticale ou de la péréquation horizontale, nous disposons d’une palette de dotations et de fonds. Pour autant, la conjugaison de tous ces instruments n’aboutit pas à une véritable solidarité financière qui permettrait aux communes les plus concernées de mieux lutter contre les processus de désertification.
Nous savons comment le sentiment d’abandon alimente tous les populismes. C’est pourquoi, madame la ministre, nous attendons avec beaucoup d’impatience la grande loi de modernisation que vous allez nous proposer : nous participerons très activement au débat auquel elle donnera lieu.
Mme Hélène Lipietz applaudit.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je commencerai par quelques observations liminaires.
Première observation : la fracture territoriale s’est aggravée ces dernières années. Elle a toujours existé, comme en témoigne la situation de la France au lendemain de la guerre – cela a été rappelé –, et l’on pourrait remonter plus loin encore ; mais elle s’est accentuée en raison de la crise, et dans un État ne disposant pas des moyens qui lui seraient nécessaires, certains territoires souffrent plus que d’autres.
Deuxième observation : le clivage entre monde urbain et territoire rural est largement effacé au profit d’autres clivages, qui ont d’ailleurs été mis en exergue dans un rapport récent issu des travaux de la mission commune d’information créée par le Sénat et présidée par Jean-Pierre Raffarin sur l’avenir de l’organisation décentralisée de la République.
Ces constatations reposent sur les appréciations de Laurent Davezies qui décrit très bien la réalité de la France : sans distinguer le monde rural et le monde urbain, il identifie « quatre France » : les territoires marchands et dynamiques, constitués de grandes villes, de zones industrielles ; les territoires marchands en difficulté, rassemblant les anciens bassins industriels, sidérurgiques, miniers ; mais aussi les territoires non marchands dynamiques, notamment toute la partie ouest de la France, du Nord au Sud à partir de la Manche ; enfin, les territoires non marchands en difficulté, à savoir les zones de montagnes et les zones éloignées. Chacun s’y retrouvera !
Troisième observation : oserai-je le dire, car je ne voudrais choquer personne, je ne crois pas au principe de l’égalité en matière de politique d’aménagement du territoire. Nos territoires ne se ressemblent pas ; chacun a sa spécificité, son identité, et je revendique, d’une certaine façon, le droit à la différence et à la diversité. Vouloir appliquer les mêmes recettes, les mêmes normes, les mêmes modes d’intervention à tous nos territoires, quels qu’ils soient, me paraît complètement utopique.
Mme la ministre acquiesce.

Je vous dirai à la fin de mon intervention vers quel concept, en revanche, je pense qu’il faut tendre. Mais ce mot d’« égalité », même s’il est prononcé avec bonheur et délectation par celles et ceux, nombreux, qui affirment que c’est le deuxième terme de la devise de la République française, n’est pas aisé à mettre en œuvre.
Devant ces « différentes France » que Laurent Davezies évoquait, madame la ministre, vous disposez de deux leviers : celui de l’efficacité pour les territoires aux industries de pointe et aux centres de recherche particulièrement performants, mais également celui de la solidarité, au profit des territoires qui connaissent aujourd’hui de grandes difficultés.
Quelles sont les politiques à mener ?
Citons tout d’abord celles que l’État doit mener : ce sont les fonctions régaliennes de l’État s’agissant de l’aménagement du territoire, au premier rang desquelles s’entendent évidemment les missions confiées, d’une part, aux forces de police et de gendarmerie, et, d’autre part, à la justice.
À ce propos, des mesures réorganisant les juridictions en France avaient été prises avant les élections, mais ce n’est pas la réintroduction du tribunal de grande instance à Tulle qui doit nous faire croire que de grands changements sont intervenus ! §D’autres villes sont légitimes à en attendre plus.
Il est bien sûr une autre fonction régalienne : l’école. À cet égard, et contrairement à l’appréciation portée par l’un de nos collègues qui ne comprenait pas que la question des rythmes scolaires fût évoquée par notre collègue Hervé Maurey, je dirai que cette question est extrêmement importante, car les territoires les plus éloignés, les moins peuplés, les territoires ruraux, surtout ceux en difficulté, ont bien du mal à mettre en œuvre ces mesures qui ont été décidées par le ministre.
Qu’il me soit permis d’ouvrir une petite parenthèse sur ce point, puisque c’est la première fois depuis ce week-end que j’ai l’occasion de m’exprimer à la tribune de la Haute Assemblée.
Le Premier ministre a fustigé, samedi dernier, les maires qui « refusaient », disait-il, de mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014. Selon lui, ils ne pouvaient pas « aller contre la loi ».
Mes chers collègues, je me permets de rappeler que ce n’est pas la loi qui a fixé les rythmes scolaires ;…

… c’est un décret du 24 janvier 2013 et une circulaire prise quelques jours auparavant.
Je ne dis pas que le sens du respect des textes ne doit pas conduire les élus, notamment, à les respecter, mais affirmer que ces textes sont du domaine de la loi, c’est responsabiliser les parlementaires. M. le Premier ministre ne peut tenir de tels propos, et je me permets de le corriger sur ce point, avec le plus grand respect pour sa fonction et sa personne !
D’autres fonctions importantes relèvent aussi de l’État : ce sont celles qui consistent à soutenir les territoires les plus dynamiques, mais aussi à apporter à ceux qui le sont moins, les moyens ou les compensations leur permettant d’affronter des difficultés, temporaires pour certains, malheureusement durables pour de nombreux autres.
Madame la ministre, ce territoire que l’on va qualifier de « rural », quelle que soit l’appréciation que j’ai portée tout à l’heure, est animé par des élus extrêmement volontaristes. La créativité y est quotidienne. Autour des élus, des citoyennes et des citoyens, particulièrement bien inspirés, souhaitent participer à l’action publique locale. Encore faut-il leur en donner les moyens.
Dans quels domaines cette intervention est-elle la plus importante ? Il suffit tout simplement, pour le savoir, de demander à un citoyen nouveau venu dans un territoire ce qu’il espère y trouver. Beaucoup parmi nous sont maires – encore que la loi risque de les en empêcher dans quelques années – ; qu’entendons-nous de la part des personnes qui viennent s’installer dans nos territoires ?
Tout d’abord, pour être certain que l’on puisse y demeurer, il faut vérifier la possibilité de s’y rendre. La question des communications, plus particulièrement routières s’agissant de mon territoire, est évidemment essentielle. L’État a réduit son réseau national, encore faut-il qu’il consacre les moyens nécessaires pour que les kilomètres demeurant à sa charge soient non seulement entretenus, mais modernisés.
Je ne peux m’empêcher à ce propos, madame la ministre, d’évoquer un sujet dont je reconnais volontiers qu’il n’est certainement pas présent dans votre esprit ce soir – mais au moins l’aurais-je évoqué – : l’aménagement de la nationale 12 qui conduit les automobilistes parisiens vers la Bretagne et vers Brest. J’insiste notamment, et je l’évoque régulièrement quand on parle d’aménagement du territoire, sur le goulet d’étranglement qui pénalise une bonne partie de l’ouest de la France, situé à Saint-Denis-sur-Sarthon, une commune de l’Orne.
Ensuite, il faut des télécommunications performantes. Beaucoup a été dit par les collègues qui m’ont précédé à cette tribune sur l’importance du très haut débit – je ne m’étendrai pas sur une telle évidence – ; c’est la chance de nos territoires. Aujourd’hui, chacun peut être relié à l’ensemble du monde de par son activité professionnelle ou du fait des liens familiaux et sociaux entretenus grâce à cette technologie.
De ce point de vue, il nous faut être bien plus ambitieux que le Gouvernement. Tout à l’heure, l’un de mes collègues affirmait savoir qui serait servi la dixième année.

On peut penser, en effet, que les premiers servis seront les territoires déjà bien pourvus et plus riches que les autres. Mais on n’attendra pas dix ans pour que des territoires éloignés et dépourvus connaissent l’arrivée du très haut débit. Il faut être imaginatif, et rappeler, madame la ministre, que les collectivités territoriales sont assez désireuses de vous accompagner, au travers de procédés contractuels, afin de renforcer les moyens mis en œuvre par l’État.
Il est un autre domaine important : la culture.
Une politique culturelle ambitieuse dans un territoire est un des piliers du développement économique. Les Français ne supportent plus qu’il puisse exister un décalage, comme on l’a connu autrefois – quand j’étais jeune, je le subissais avec une grande amertume – entre les villes et nos territoires les plus éloignés. Ces territoires – et je pense plus particulièrement à celui que je représente – se sont dotés d’installations et d’équipements et ne demandent qu’à offrir à nos concitoyens des expositions, des représentations et des concerts. Aujourd’hui, le spectacle vivant a toute sa place au sein du territoire rural, d’autant que depuis longtemps, notamment après la guerre, nombre d’animateurs ont excellé pour distraire, divertir et apporter un peu d’animation dans nos campagnes les plus reculées.
Un autre domaine essentiel est la santé.
Mon appréciation diverge de celle de notre collègue Hervé Maurey, car je crois beaucoup aux pôles de santé. C’est pourquoi je demande à l’État de nous aider à en construire. Chacun a son expérience, et je peux comprendre que le département de l’Orne, proche du mien, ait pu éprouver quelques déconvenues.
Pour ce qui nous concerne, la chance nous a sans doute souri, car certaines de nos réalisations connaissent au contraire un très grand succès. Finalement, offrir aux professionnels de la santé un cadre leur permettant de travailler ensemble, de façon coordonnée et cohérence, est certainement un moyen de les attirer, si j’en juge par le nombre de jeunes médecins nouvellement arrivés. Mais ils ne sont pas les seuls : infirmiers et autres professions paramédicales peuvent aussi venir enrichir ces pôles de santé.
Lorsque des personnes s’installent dans nos communes, nous sommes interrogés sur de nombreux autres domaines ; il en est un, madame la ministre, qui vous concerne directement, puisque j’ai lu vos déclarations à cet égard : ce sont les maisons de service public.
Vraiment, je pense que c’est une bonne idée.

Elle n’est pas nouvelle, permettez-moi de vous le dire, mais l’important n’est pas seulement d’avoir l’idée, c’est de la transformer en projet. Pour cela, il faut des moyens. J’ai cru lire, madame la ministre, que vous étiez prête à mobiliser des moyens équivalents à 50 % des frais de fonctionnement de ces maisons de service public.
Bien sûr, il faudra convaincre lesdites administrations de l’État ainsi que d’autres services ou organismes publics de travailler ensemble, mais, honnêtement, je pense qu’ils y sont tout à fait prêts. Le fait de mettre à leur disposition des locaux adaptés avec un parking subséquent me paraît aller dans le bon sens.
Pour m’en tenir au temps qui m’est imparti, madame la ministre, je conclurai en vous disant la chose suivante : si je ne crois pas à l’égalité, je crois à l’équité ! Or l’égalité n’est pas assurée. Je vous demande donc d’être équitables avec les territoires dont les besoins sont importants.
M. Fauconnier s’exclame.

Vous avez raison, il faut préserver la qualité de vie. C’est une bonne ambition : la chasse aux pinsons, etc.

Ainsi, les Français qui, pour beaucoup d’entre eux, ont une origine rurale, peuvent retrouver ce lien très fort avec le territoire où ils sont nés.
En définitive, derrière tout cela, c’est d’une politique visant à renforcer le lien social, ce lien aujourd’hui si distendu, que nous avons tant besoin !
Applaudissements sur les travées de l'UMP, ainsi que sur certaines travées de l’UDI-UC et du RDSE.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, si de nombreux territoires subissent de plein fouet une crise économique qui perdure, ce sont les espaces à dominante rurale qui sont les plus touchés. Ces ensembles, qui comprennent les petites unités urbaines, représentent les deux tiers du territoire métropolitain.
Ce sont les campagnes, les communes rurales et les petites villes qui paient tout particulièrement aujourd’hui le prix de plusieurs années de politiques publiques désastreuses.
La réalité que nous vivons sur le terrain, nous, élus, avec la population, c’est une attente insatisfaite de solidarité nationale et un fort sentiment d’abandon.
La situation du département du Nord est emblématique des difficultés que rencontrent nombre de territoires, dans leurs espaces ruraux en particulier. Le Nord a connu une recomposition sociale importante au cours des dernières années. Ce département, extrêmement jeune dans ses zones urbaines à forte densité de population, voit néanmoins les trois quarts de sa surface désertés de manière croissante par les actifs, laissant place à une population vieillissante, disséminée dans la campagne.
De manière logique, le renforcement du poids des villes entraîne le déclin de l’activité en milieu rural. Les décisions nouvelles relatives à la décentralisation, qui renforcent le poids des entités urbaines, risquent de vider un peu plus les campagnes de leur substance et d’affaiblir les départements, pourtant vecteurs naturels de l’égalité des territoires.
Territoire de tradition ouvrière historique, le Nord est aujourd’hui marqué par une importante artificialisation de ses terres, un habitat individuel très étendu, un vieillissement de la population et, dans le même temps, un renouvellement dû à une arrivée massive de foyers à faibles revenus.
Toutefois, la tendance actuelle des propriétaires en milieu rural est d’aligner les loyers sur les pratiques urbaines et, donc, de réduire la part des loyers accessibles et supportables, notamment pour les familles modestes.
La réponse évidente serait un effort des offices d’HLM en direction des petites communes.
La population rurale est aussi caractérisée, d’une part, par une surreprésentation des sans-emploi et des ouvriers aux modestes revenus, et, d’autre part, par une sous-représentation des cadres, ce qui diminue évidemment l’employabilité des actifs.
Surtout, des pans entiers du territoire constitués de très petits villages sont parmi les moins bien équipés, de sorte que leurs habitants connaissent des difficultés en matière d’accès aux services publics, lesquels ont été progressivement rayés de la carte.
Dans ce contexte, en dépit des politiques d’aménagement conduites par les collectivités locales, pour beaucoup de manière volontariste, on assiste à une fuite des entreprises, accélérée par des infrastructures de transports et de communications insuffisantes ou mal entretenues, au détriment de la création d’emplois, bien sûr.
L’État n’a pas su, au cours des dernières années, répondre aux défis spécifiques auxquels doivent faire face nos territoires. Au contraire, il a fortement nourri à l’égard des politiques nationales, notamment chez les plus fragilisés, un climat de défiance, souvent à l’origine d’attitudes de rejet de la République.
Les milieux ruraux ont été les plus touchés par la réforme générale des politiques publiques, cette RGPP si contestée en son temps, qui a ravagé certains territoires ; Ils ont également subi le désengagement de l’État en matière d’éducation, de santé publique, de mobilité, de sécurité, de logement, de précarité énergétique. On pourrait ainsi multiplier les exemples !
Dans le même temps, avec le retrait des soutiens publics et l’appauvrissement des ménages, les services à la personne se sont effondrés.
Un tel environnement ne peut qu’alimenter l’inquiétude, la peur du lendemain, l’exaspération et la colère dans ces territoires, sentiments renforcés en ce moment par une hausse de la ponction fiscale décidée en 2011. Ces augmentations ont des effets néfastes, notamment pour les plus modestes, qui accusent à tort le gouvernement actuel de ces décisions pourtant antérieures à sa prise de fonctions.
Néanmoins, les attentes restent fortes aujourd’hui et l’impatience continue à gagner du terrain. Nos concitoyens, qui sont confrontés à la disparition de la présence publique de l’État, veulent plus de considération, plus d’égalité et plus de solidarité.
Conscient de la situation dramatique dans laquelle se trouvent la plupart de ces populations, le Président de la République a souhaité, dès son arrivée, repenser l’aménagement des territoires pour lutter contre les inégalités qui se sont aggravées ces dernières années.
Dans ce sens, le choix de placer sous la responsabilité de votre ministère, madame la ministre, l’ensemble des territoires urbains et ruraux constituait une novation pour assurer un développement plus équilibré et plus solidaire entre les villes et les campagnes.
Je salue ce changement d’optique vers plus d’égalité, qui s’oppose à la mise en concurrence des territoires jusqu’ici encouragée.
Vous avez annoncé deux priorités, tout d’abord, la nécessité d’assurer la continuité territoriale permettant, notamment, plus d’accessibilité aux services publics sur tout le territoire, ensuite, votre volonté de donner les moyens à chaque territoire de développer son potentiel.
Je souscris, bien sûr, à ces deux objectifs, dont la réalisation devra contribuer à enrayer les déséquilibres actuels ; toutefois, dans un contexte de crise économique où l’endettement de notre pays augmente, les marges de manœuvre sont considérablement réduites.
Arrivée au deuxième temps de mon propos, je veux vous faire part des attentes ressenties sur le terrain. Je connais vos priorités, madame la ministre. Cependant, face à l’impatience et aux souffrances des populations que je côtoie au quotidien, avec d’autres, je souhaite vous faire partager quelques préoccupations auxquelles il convient que le Gouvernement apporte des réponses appropriées.
Les questions posées par la qualité et l’accessibilité des services au public, absolument vitales pour les habitants des zones rurales, ont des conséquences directes sur l’attractivité des territoires.
Ainsi, face aux carences de l’offre de soins en milieu rural, accentuées dans les petites bourgades par le départ à la retraite de médecins généralistes non remplacés, l’état sanitaire de nos populations, tout comme l’accès aux services d’urgences, tend à se dégrader.
Nos concitoyens attendent toujours la traduction concrète des moyens accordés pour améliorer l’offre de soins disponible dans le Nord, notamment à travers le pacte territoire santé.
Par ailleurs, malgré le vieillissement de la population, de vastes zones restent sans réponse face aux besoins d’hébergement et de prise en charge des personnes âgées.
Les missions de service public de l’éducation sont un autre enjeu important de l’aménagement du territoire. Aujourd’hui, le gouvernement actuel a rendu sa priorité à la politique de l’éducation ; c’est un point qui ne me paraît pas suffisamment souligné.
Ainsi, l’effort en direction des écoles a été bien ressenti à la rentrée scolaire 2013, qui n’a pas été vécue dans l’angoisse des fermetures de classe injustifiées ou des difficultés à ouvrir des classes devenues nécessaires.

Par cet effort, on a pu maintenir des petites écoles qui étaient menacées alors qu’elles constituaient la dernière source de vie dans les villages. C’est le service public qui était en péril, la commune qui se désintégrait, et la République qui aurait été atteinte dans ses fondements !

Après des décennies de reniement de l’idéal républicain, on développe à nouveau dans nos campagnes une politique active en matière d’éducation.
Je vais maintenant évoquer à mon tour la fracture numérique, qu’il n’est pas acceptable de laisser s’accentuer. Le déploiement de réseaux numériques à très haut débit, qui contribue à réduire le handicap de la distance, est essentiel pour favoriser la compétitivité et l’attractivité de ces territoires.
L’un des tout premiers chantiers du Président de la République a été de définir un objectif de couverture de l’ensemble du territoire national d’ici à 2022.
Je vous remercie par avance, madame la ministre, de nous informer de l’état d’avancement de ce projet, car les opérateurs semblent rester particulièrement timides à l’égard des parties défavorisées de notre territoire.
D’une façon globale, la réduction de la fracture territoriale passe aussi par l’amélioration de l’accessibilité des territoires en favorisant le développement de moyens de communication comme le très haut débit, mais aussi celui des infrastructures de transports.
Les difficultés d’accès par la route ou par les transports en commun constituent souvent de lourds handicaps pour de nombreux territoires ruraux.
Le discours tenu par les élus urbains qui bénéficient de services publics denses et bien adaptés ne s’applique absolument pas aux populations des espaces ruraux dont l’habitat est bien trop dispersé et qui sont donc particulièrement concernés par l’inégalité des dessertes de leur territoire.
Vous en conviendrez, les besoins d’un véhicule individuel ne sont pas les mêmes en milieu rural et en milieu urbain ! D’un côté, ils sont impératifs, de l’autre, ils ne sont que facultatifs puisque les déplacements peuvent être effectués en métro, en bus ou en tramway.

Il est donc prioritaire de désenclaver les zones rurales déjà fragiles en modernisant les réseaux de transports qui ont fait l’objet de sous-investissements chroniques ces dernières années.

Je pense, avant tout, aux liaisons ferroviaires dont l’état catastrophique s’accentue malheureusement au lieu de s’améliorer.
Je dois, à ce moment de mon propos, vous exprimer l’inquiétude de la population et des élus du Cambrésis sur deux dossiers particuliers, qui appellent des réponses concrètes en matière d’aménagement du territoire.
La décision prise par le gouvernement précédent de fermer la base aérienne 103 de Cambrai-Épinoy a déséquilibré tout un territoire. Dans cet arrondissement, ce sont 1 500 emplois civils et militaires qui ont été perdus pour une population de 160 000 habitants.

Les conséquences de cette décision sont encore aggravées par des incertitudes quant aux mesures de développement économique attendues et à l’avenir des 350 hectares de terrains libérés.
Autour d’une gouvernance organisée par les collectivités locales, M. le préfet a confirmé, voilà quelques jours, devant l’assemblée départementale, la signature imminente de la création d’un syndicat mixte ouvert avec la région, les deux départements du Nord et du Pas-de-Calais. Cet organisme inclura les communautés de communes et permettra d’échanger avec les porteurs de projets qui jusqu’alors manquaient d’interlocuteur pour répondre à leurs perspectives d’implantation et de développement.
Par ailleurs, dans un secteur géographique où la situation économique s’est encore récemment fortement dégradée, le projet de canal Seine-Nord Europe, qui fédère l’ensemble des élus concernés, constitue, au-delà des perspectives qu’il dégage pour la nation tout entière, une condition de survie pour la population de ce territoire.
Ce canal de grand gabarit et sa plateforme logistique joueront un rôle important dans l’aménagement des territoires touchés en favorisant notamment la création de 4 500 emplois directs et au moins autant d’emplois induits.
Son coût ayant été largement sous-estimé par le gouvernement précédent, il a, bien entendu, fallu remettre à plat le dossier. Dans les territoires concernés, les parlementaires, toutes tendances confondues, attendent l’aboutissement de ce dossier. Le ministre des transports a signé un accord sur la réalisation de grandes infrastructures avec un financement européen qui pourrait atteindre 40 % du coût du projet. Ce sera l’objet du débat de ce soir.
Les quatre départements concernés, dont le Nord, sont également prêts à engager des crédits à hauteur de 500 millions d’euros, qui viendraient s’ajouter aux 500 millions déjà mobilisés par les régions. La part de l ’État se trouvant ainsi allégée, personne ne comprendrait que ce dossier ne se concrétise pas rapidement.
Porteur d’avenir et mobilisateur, ce projet fera jouer la solidarité en faveur des régions situées au nord de Paris et de la Wallonie, marquées par une forte désindustrialisation pendant la dernière décennie.
Pour conclure, les défis auxquels doivent faire face ces territoires sont nombreux, mais ils possèdent souvent des atouts qui peuvent leur permettre d’y répondre.
Le Nord, par sa situation géographique, peut se prévaloir de quelques belles réussites comme l’entreprise Amazon, qui pèse 2 500 emplois dans le Douaisis, le terminal méthanier de Dunkerque, IBM Euratechnologie à Lille, et l’institut Railcom, avec la boucle d’essais ferroviaires dans l’Avesnois, au sud du département.
En tout cas, aujourd’hui, les populations demandent plus de solidarité nationale et, donc, plus d’État. La politique d’aménagement du territoire doit conduire non à détricoter ce qui a fait la France depuis plusieurs siècles, mais à construire une complémentarité entre un État fort et des collectivités décentralisées.
L’intervention de l’État reste fondamentale, notamment dans son rôle de régulateur, pour permettre un rééquilibrage et éviter les disparités et inégalités entre territoires riches et territoires pauvres.
Les territoires défavorisés ne méritent pas le sort d’abandon qui leur semble réservé au regard des contraintes budgétaires et de l’orientation de certaines politiques publiques.
Si les politiques volontaristes développées par les collectivités, notamment par les départements en matière de solidarité, à travers les contrats de territoires par exemple, ont permis de freiner certains effets dévastateurs, ces territoires ont, plus que jamais, besoin d’accompagnement et de soutien de la part de l’ État face aux conséquences désastreuses de la crise et des mutations économiques et sociales.
Les réponses du Gouvernement – et nous savons pouvoir compter sur vous, madame la ministre – doivent traduire une volonté forte de l’État de combattre les inégalités et de rendre un second souffle à ces territoires et de l’espoir à leurs habitants. §
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai été très attentive, comme chaque fois qu’un débat relatif à l’égalité des territoires se déroule au Sénat, à vos interventions sur ce dossier essentiel pour la cohésion nationale, mais aussi complexe, et sur lequel il conviendra de travailler à long terme.
Il est évidemment logique et nécessaire, monsieur Maurey, que le Gouvernement rende compte de l’exercice de ses missions ; c’est d’ailleurs tout l’objet des débats parlementaires de contrôle. Pour autant, les politiques d’aménagement du territoire sont de très long terme : il s’agit de prendre des initiatives et de maintenir ces impulsions afin d’en voir les résultats.
L’année 2013 aura néanmoins été une année charnière, car bien des projets ont été mis en place. Selon vous, monsieur Maurey, le Gouvernement n’a rien fait en matière de zones blanches, de haut débit, de santé, d’infrastructures et, pire, il a réformé les rythmes scolaires… Convenez que de telles affirmations sont quelque peu caricaturales !
M. Jean-Louis Carrère opine.
Vous affirmez m’avoir envoyé des courriers qui seraient restés sans réponse. Or je vous ai répondu personnellement à cinq reprises ; en outre, vos questions écrites ont fait l’objet de sept réponses.
On peut toujours regretter certaines insuffisances. Cependant, en matière tant de haut débit, de santé, d’infrastructures que de rythmes scolaires, le Gouvernement a apporté des réponses concrètes. Vous pouvez ne pas les approuver, mais ne dites pas que rien n’a été fait.
Pour ce qui concerne les infrastructures, je ferai écho aux propos de Mme Bataille.
Le schéma national des infrastructures de transports, le SNIT, a peut-être été largement accepté, mais il n’était absolument pas financé, chacun en est convenu. Nous étions donc face à une situation particulièrement difficile.
Les choix opérés par le Gouvernement procèdent d’une logique que vous contestez, madame Masson-Maret. Ils ont cependant pour objectif de soutenir les territoires qui ont bénéficié, ces dernières années, de trop faibles investissements et qui sont dépendants d’un réseau ferré secondaire largement détérioré, faute d’entretien.
À la suite du rapport Duron, nous avons donc fait le choix important et naturel, même s’il n’était pas simple, de privilégier la desserte, notamment ferroviaire, des zones les plus fragiles qui ont besoin de cette solidarité dans un contexte budgétaire difficile.
M. Jean-Louis Carrère s’exclame.
Vous avez également déclaré, monsieur Maurey, que la création du Commissariat général à l’égalité des territoires, le CGET, issue des travaux de différents rapports que vous avez cités, était inutile.
Or, ce n’est pas un secret, d’aucuns considéraient depuis quelques années que la DATAR avait joué son rôle dans les années soixante, soixante-dix, voire au tout début des années quatre-vingt, mais qu’un pilotage national – presque parisien ! – et peu décentralisé n’était absolument plus adapté à la politique actuelle d’aménagement du territoire. Résultat des courses, et vous l’avez dit vous-même, depuis dix ans, il n’y avait plus de pilote dans l’avion !
L’État refusait désormais toute appropriation de la politique d’aménagement du territoire.
La création du CGET marque le retour à une véritable politique d’aménagement du territoire, mais celle-ci prend acte de trente ans de décentralisation et tisse – nous le verrons lors la négociation du volet territorial des prochains contrats de plan État-région – une nouvelle relation avec les collectivités locales dans laquelle l’État, comme l’a dit Mme Bataille, assume son rôle de solidarité.
Monsieur Lenoir, je reviendrai à la fin de mon intervention sur le débat philosophique relatif à l’équité et à l’égalité. Il s’agit d’organiser sur un plan stratégique les responsabilités des uns et des autres, de mettre en cohérence les politiques menées et d’accorder une attention particulière – c’est bien normal ! – aux territoires les plus meurtris.
Je l’ai dit en prenant mes fonctions, puis à plusieurs reprises devant vous, il est de la responsabilité de l’État de donner davantage de moyens et d’être plus attentif aux territoires meurtris du fait de certaines décisions ou d’une situation économique particulière.
Monsieur Bertrand, vous avez parlé de régions que je connais bien, et évoqué, au-delà de la ruralité, l’hyper-ruralité de territoires qui connaissent une situation particulière en raison des conditions géographiques ou de la faible densité de leur population.
J’y insiste, la politique d’égalité des territoires que mène ce gouvernement vise à prendre en compte l’ensemble des spécificités territoriales.
L’égalité n’est pas l’uniformité. Il existe ainsi, dans les territoires hyper-ruraux, des problématiques très spécifiques.
Pour autant, ces territoires ont également des atouts. Même si ce sujet peut faire débat, il convient de considérer aujourd’hui, à la suite des travaux ayant abouti à la remise du rapport intitulé « Vers l’égalité des territoires », que le dynamisme n’est pas l’apanage des seules métropoles, et que les territoires ruraux ou hyper-ruraux n’ont pas vocation à se transformer en espaces récréatifs ou décoratifs incapables de prendre en main leur avenir. Au contraire !
C’est pourquoi la question du haut débit est essentielle. Du fait des nouvelles technologies et de l’évolution des modes de vie, l’avenir des territoires ruraux et hyper-ruraux peut être positif. Ceux-ci seront aussi utiles à notre pays que le développement des métropoles, y compris celles dont la dimension est internationale. Nous avons besoin que l’ensemble de notre pays soit robuste !
Comme l’ont dit plusieurs d’entre vous à raison, nous ne pouvons pas nous résigner à un arasement des inégalités entre les régions, qui s’accompagnera d’une aggravation des inégalités infrarégionales.
Par conséquent, nous devons travailler à l’échelle infrarégionale pour restaurer l’égalité entre les populations et limiter les risques de décrochage ou un sentiment de relégation susceptibles d’entraîner la dislocation du pacte républicain. Voilà pourquoi la politique d’égalité des territoires est une nécessité.
Cette politique, il faut la porter de manière durable et constante, car ces efforts ne permettront pas de réparer, d’un seul coup, les dégâts provoqués par la mise en concurrence des territoires.
Madame Didier, il ne faut pas opposer les services publics et les services au public, pas plus que de noyer la question des services publics dans celle des services au public.
La présence des services publics en matière d’emploi, de santé et de sécurité est nécessaire et évidente. Mais pour bien vivre sur l’ensemble de notre territoire, nos concitoyens ont aussi besoin d’avoir accès à la culture, à l’essence à la pompe et à des commerces. Autrement dit, nos territoires ont besoin de l’ensemble de ces services pour bien vivre !
Nous pouvons décider pour 2013, 2014 et 2015 le retour des services publics et inventer une histoire différente de celle que nous vivons actuellement, laquelle ne pouvait pas fonctionner.
Cette histoire ne sera pas celle d’un départ, d’une déprise et d’une réflexion « en silo », service public par service public, opérateur par opérateur, lesquels n’ont pas pu anticiper les dégâts occasionnés par des décisions qui, pour rationnelles qu’elles soient du strict point de vue de l’opérateur, pouvaient, du fait de leur addition, entraîner sur certains territoires des conséquences tout à fait néfastes. Les disparitions simultanées d’une maternité, d’un tribunal d’instance et d’une gendarmerie ont ainsi pu provoquer des situations extrêmement tendues. §
J’ai donc souhaité réunir au ministère de l’égalité des territoires et du logement l’ensemble des opérateurs concernés pour les faire travailler de concert. M. Maurey a d’ailleurs souligné que le ministère chargé de l’aménagement du territoire devait être un ministère transversal de plein exercice. Honnêtement, j’ai pu constater que mes prédécesseurs n’avaient aucun pouvoir à ce sujet…
Je suis donc heureuse que le Président de la République ait la volonté, dans le cadre de la politique d’égalité des territoires, de permettre à l’ensemble des opérateurs de franchir une étape supplémentaire dans l’exécution du dispositif expérimental des services au public. Sur ce point, je partage votre point de vue, monsieur Lenoir.
En la matière, je ne prétends pas à l’invention ; je veux développer ce qui fonctionne et remettre en cause, sans fragiliser les territoires, les dispositifs qui n’ont pas permis d’améliorer leur situation de manière globale. C’est le cas des pôles d’excellence rurale.
Sous le gouvernement précédent, quand on ne savait que faire, on créait des pôles. En fonction des appels à projet, on pouvait ainsi investir quelques dizaines ou centaines de milliers d’euros dans certains territoires sans apporter de réponse globale à l’ensemble des territoires.
Nous adoptons la démarche inverse avec les maisons des services publics.
Notre objectif est de mettre en place un dispositif pérenne, alimenté à parts égales par les collectivités territoriales et par le Fonds national d’aménagement et de développement du territoire, le FNADT. Comme certains d’entre vous l’ont indiqué à juste titre, les collectivités financent actuellement à plus de 70 % ce type d’installations.
Ces maisons des services publics auront vocation à accueillir l’ensemble des opérateurs, à apporter une réponse de proximité et une présence humaine, mais aussi à permettre l’accès à un service public de haut niveau, notamment grâce aux visio-guichets, dispositif efficace qui maintient un contact de proximité en évitant les déplacements.
On a souvent opposé le haut débit, les nouvelles technologies et l’isolement des personnes. Ce faisant, on sous-entendait l’accès direct aux services publics par le biais d’Internet.
La présence humaine et la médiation par un interlocuteur, même s’il n’est pas spécialiste du service public concerné, sont à mon sens décisives, comme cela a été indiqué dans un rapport du Conseil économique, social et environnemental voilà deux ou trois ans.
Le maintien d’une présence dans les maisons de services publics permettra d’orienter les usagers vers la délivrance d’un service de bonne qualité. Cet interlocuteur humain, et non pas seulement un répondeur ou un service sur Internet, sera aussi le garant d’une forme de bien-être collectif.
Afin que leur mode de financement soit stable dans la durée, les maisons des services publics seront financées à parité entre l’État et les opérateurs, d’un côté, et les collectivités, de l’autre. Le fonds abondé par les opérateurs garantira leur engagement.
Madame Lipietz, vous avez soulevé la question du haut débit, étroitement liée à la précédente.
Vous le savez, ma collègue Fleur Pellerin est chargée du déploiement d’un plan sur les dix prochaines années. Il est toujours possible de formuler des critiques, mais on ne saurait reprocher au Gouvernement de ne pas favoriser les collectivités les plus rurales, celles dont la situation géographique ou la faible densité nécessitent un investissement public plus important.
Ce plan en trois tiers, dont l’un vise le déploiement dans les zones les plus fragiles, apporte des réponses. Les collectivités locales qui se sont engagées dans cette voie constatent que le dispositif fonctionne. Nous poursuivrons nos efforts à cet égard.
Toutefois, il nous faut, parallèlement, travailler sur la question des usages. C’est le sens du rapport que m’a remis Claudie Lebreton voilà quelques jours.
Il ne s’agit pas seulement de « fibrer » le territoire. La question des usages doit être posée s’agissant des services publics, mais aussi de l’accès à la culture et des nombreuses pratiques que permet la présence du très haut débit, notamment en termes d’évolution des modes de travail.
Travailler en amont sur les usages permettra aux collectivités locales et aux opérateurs de s’approprier immédiatement l’accès au très haut débit, avec toutes les évolutions positives que cela suppose.
Madame Masson-Maret, je crains que vous ne vous soyez trompée en évoquant mon budget. Vous avez en effet fait référence au titre 2 relatif aux salaires et aux traitements des personnels et non au budget de fonctionnement. Or l’évolution des chiffres indiqués dans ce titre résulte de la hausse mécanique du montant des pensions, tandis que le schéma d’emploi est négatif puisqu’il baisse d’un équivalent temps plein.
Quant au budget de fonctionnement, qui fait l’objet du titre 3, il passe de 16, 27 millions d’euros en 2013 à 15, 75 millions en 2014. Contrairement à ce que vous avez indiqué, madame la sénatrice – peut-être était-ce une erreur de lecture ? –, l’effort en termes de finances publiques pèse sur l’ensemble des budgets. Ce principe s’applique aussi à la création du CGET.
Mme Bataille l’a bien relevé, il s’agit à la fois d’associer territoires ruraux et territoires urbains et d’inscrire les quartiers et la politique de la ville dans le cadre général de l’égalité des territoires.
Dans les territoires relégués des grandes agglomérations comme dans les territoires hyper-ruraux, les questions d’accès aux services publics se posent de façon identique non pas sur le plan technique, mais sur le plan politique. Là aussi, cela suppose une vision politique de ce qu’est notre territoire national, à savoir un territoire dans lequel tous nos citoyens ont les mêmes droits et doivent avoir accès aux mêmes services, non de manière uniforme, mais grâce à une réponse adaptée en fonction des situations.
Madame Didier, vous avez parlé de la question des dotations, mais aussi des services publics plutôt que des services au public. J’espère vous avoir répondu et convaincue. Pour avoir multiplié les déplacements dans le cadre d’un « tour de France des territoires », notamment avec certains d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai pu constater que la question de l’accès à l’ensemble de la palette des services publics était essentielle pour le maintien et le développement des territoires.
M. de Montesquiou a parlé des financements du déploiement de la fibre. Je l’ai souligné, nous avons fait non seulement le choix d’assurer la continuité de certains dispositifs existants et d’apporter un appui aux collectivités locales très innovantes, mais aussi celui de porter une attention particulière aux territoires les plus enclavés, dont les spécificités géographiques nécessitent des réponses différenciées, par exemple par le biais de la 4G ou du satellite. Je rappelle que le déploiement dans dix ans du très haut débit sur l’ensemble des territoires, quelles que soient leurs particularités, répond à un engagement du Président de la République.
Monsieur Camani, je vous remercie d’avoir évoqué le climat de confiance, propice à un changement de paradigme. En effet, nous ne réussirons ce chantier de l’égalité des territoires que si nous osons rompre avec la politique d’aménagement des territoires en vigueur depuis les années soixante et soixante-dix. M. Maurey a raison, celle-ci avait un sens à une époque où l’État concentrait beaucoup de responsabilités ; elle a notamment permis l’installation de certains grands établissements publics comme l’École nationale d’administration pénitentiaire, l’ENAP, à Agen.
Nous sommes en 2013. Désormais, et c’est une bonne chose, les collectivités locales ont leur destin en main. Les relations qu’elles entretiennent avec l’État doivent être réinventées et prendre la forme d’un véritable partenariat où chacun assume ses responsabilités. En effet, du fait de la perte d’un certain nombre de compétences, l’État s’est longtemps désengagé de certains territoires – d’une certaine façon, il s’en est lavé les mains –, alors qu’il a une responsabilité à l’égard de chacun d’entre eux : c’est toute la logique de l’articulation des différents niveaux d’intervention.
Là encore, il nous faut réfléchir à d’autres solidarités. Je pense aux appuis en matière d’ingénierie, notamment dans l’aménagement ou sur les questions de droit des sols, que peuvent apporter certaines métropoles ou certains départements ayant développé une véritable compétence. Il n’est donc pas illogique d’envisager le partage de cette compétence, qui est la conséquence de la décentralisation, avec les territoires qui disposent de moins de moyens. Nous travaillons à élargir et à repenser ces modes de relation, notamment avec les agences d’urbanisme qui restent encore aujourd’hui financées par l’État, même si elles sont pleinement dans les mains des collectivités locales.
Monsieur Camani, vous avez également évoqué la question des centres-bourgs. Sans déflorer ce que dira le Premier ministre demain au congrès des maires de France, je souhaiterais rappeler ce que j’avais indiqué à ce sujet dès ma première intervention : l’État avait eu par le passé à assumer ses responsabilités face à la situation des quartiers les plus dégradés – c’est d’ailleurs pour cela que l’ANRU a été créée –, il doit aujourd'hui se pencher de la même manière sur la dévitalisation, voire la nécrose de certains centres-bourgs. C’est le cas de La Réole où je me suis rendue voilà quelques jours, magnifique bourg à l’histoire magistrale situé à quarante kilomètres de Bordeaux. Ici, comme ailleurs, le bâti en centre ancien est d’une extrême fragilité, ce qui pèse sur les élus.
C'est la raison pour laquelle, comme je m’y étais engagée, nous travaillons avec ces communes – bourgs ruraux ou villes moyennes – afin de les aider à faire face à ces situations qui nécessitent une ingénierie complexe pour redéfinir non seulement l’aménagement, mais aussi le bâti lui-même. En effet, dans un certain nombre de cas, les logements des bâtis de ces centres-bourgs ne correspondant plus aux règles et aux modes de vie actuels, il faut repenser leur évolution.
Monsieur Collin, vous avez évoqué la question du service public de la gendarmerie. Le dialogue avec les gendarmeries est très intéressant, à l’instar de celui que nous avons ouvert avec l’ensemble des opérateurs. Dans le cadre de la réflexion que nous menons sur la localisation des maisons de service public afin de maintenir la présence des services publics existants qui pourraient être fragilisés par l’évolution de la carte, l’ouverture à d’autres missions de service public des locaux dont dispose aujourd’hui la gendarmerie sur nombre de territoires est une orientation qui intéresse fortement les instances dirigeantes de la gendarmerie nationale.
Nous souhaitons travailler avec l’ensemble des opérateurs de manière très ouverte pour répondre à certaines difficultés très concrètes. Je pense notamment à la rénovation de certaines implantations ou au logement des gendarmes et de leurs familles, auxquelles, je le sais, nombre d’entre vous sont sensibilisés.
Bien sûr, mais, dans la mesure où les gendarmes doivent vivre à proximité de leur lieu de travail, cette question se pose pour eux avec une acuité particulière.
Monsieur Lenoir, je ne partage pas votre analyse selon laquelle il faudrait refuser l’égalité au profit de l’équité. Si la devise de notre République n’est pas « liberté équité fraternité », ce n’est pas un hasard !
Comme l’a précisé fort opportunément le Conseil constitutionnel, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle différemment des situations différentes ; mais si l’ensemble des citoyens doivent avoir les mêmes droits, comme les mêmes devoirs, ils doivent être considérés comme des égaux.
C’est bien tout le cœur de cette politique d’égalité des territoires. Il ne faut pas croire que l’on puisse opposer les territoires les uns aux autres et qu’il existe des territoires privilégiés et d’autres, comparables à des territoires de relégation, délaissés ; au contraire, chacun a les moyens de son propre développement, même dans des situations différentes.
L’égalité, ce n’est pas l’uniformité, c’est vouloir que l’ensemble du territoire français mérite la même attention. Cet idéal fonde le pacte républicain, à savoir la décision implicite de s’engager à faire partie d’un même pays. C’est donc le cœur de la mission de la ministre de l’égalité des territoires. C’est dans cette optique que je souhaite travailler avec l’ensemble de mes collègues – même si les questions transversales sont complexes –, mais aussi avec tous les élus. C’est dans la réinvention d’une relation entre l’État, garant de l’égalité, et les territoires que nous y parviendrons. Cet objectif noble…
Mme Cécile Duflot, ministre. … mérite non la caricature, mais beaucoup de pragmatisme et, surtout, une détermination dans la durée.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. –

Nous en avons terminé avec le débat sur la politique d’aménagement du territoire.

J’ai reçu avis de la démission de M. Claude Domeizel, comme membre de la commission des affaires sociales, et de Mme Samia Ghali, comme membre de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.
J’informe le Sénat que le groupe socialiste et apparentés a fait connaître à la présidence le nom des candidats qu’il propose pour siéger à la commission des affaires sociales, en remplacement de M. Claude Domeizel, démissionnaire, à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, en remplacement de Mme Samia Ghali, démissionnaire.
Ces candidatures vont être affichées et les nominations auront lieu conformément à l’article 8 du règlement.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de cet après-midi étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt-et-une heures trente-cinq.