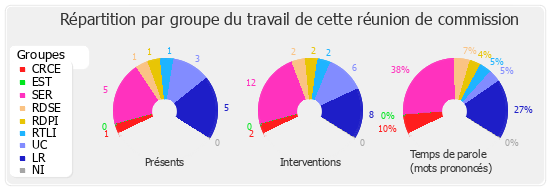Commission d'enquête Évaluation politiques publiques face aux pandémies
Réunion du 15 septembre 2020 à 10h30
Sommaire
La réunion
Audition du professeur Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique

Nous poursuivons nos travaux avec l'audition du professeur Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique.
Je vous prie d'excuser l'absence du président Milon, retenu dans son département.
Le professeur Delfraissy est accompagné de quatre membres du conseil scientifique, MM. Simon Cauchemez et Daniel Benamouzig, Mme Marie-Aleth Grard et M. Denis Malvy, ainsi que de Mme Caroline Jaegy, chargée de mission.
Mis en place le 11 mars 2020, le conseil scientifique a été consacré par la loi du 23 mars 2020 qui en a fait un des éléments de l'état d'urgence sanitaire.
L'article L. 3131-19 du code de la santé publique prévoit ainsi : « En cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire, il est réuni sans délai un comité de scientifiques. Son président est nommé par décret du Président de la République. Ce comité comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat ainsi que des personnalités qualifiées nommées par décret. Le comité rend périodiquement des avis sur l'état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s'y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, y compris celles relevant des articles L. 3131-15 à L. 3131-17, ainsi que sur la durée de leur application. Ces avis sont rendus publics sans délai. Le comité est dissous lorsque prend fin l'état d'urgence sanitaire ».
Le conseil a rendu des avis publics à chacune des étapes de la gestion de la crise, avant ou après les annonces du Gouvernement.
Il est pluridisciplinaire et notre commission d'enquête a déjà entendu plusieurs de ses membres sur différentes thématiques. C'est le cas d'Arnaud Fontanet, dans le cadre de la table ronde consacrée à la gestion de la crise sanitaire dans l'Oise, mais aussi de Bruno Lina, entendu la semaine dernière sur la question des tests et du dépistage. Nous entendrons cet après-midi Yazdan Yazdanpanah sur les questions de la recherche et des traitements.
Sur ces derniers aspects, un second comité, le Comité analyse recherche et expertise (CARE), dirigé par Françoise Barré-Sinoussi, a été mis en place. Il est chargé de faire des recommandations sur la recherche ainsi que sur des essais cliniques et thérapeutiques.
Professeur, vous avez été entendu à deux reprises par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, ce qui me permet de faire écho aux propos que vous avez tenus devant nos collègues députés. Nous sommes en effet aujourd'hui dans une logique de retour d'expérience sur la gestion de la crise.
Vous avez déclaré en conclusion, le 18 juin dernier, que vous aviez deux messages à faire passer : « Premièrement, il faut anticiper pour mieux préparer. Deuxièmement, je pense que nous devons avoir une vraie réflexion sur la construction et sur l'avenir de la santé publique en France. » Pourriez-vous développer et préciser ces deux points ce matin ?
Enfin, vous avez déclaré à l'Assemblée nationale que le conseil scientifique avait fait entendre « sa petite musique ». Pour notre part, comme nombre de nos concitoyens, nous avons plutôt eu le sentiment d'entendre une assourdissante cacophonie de la part du monde scientifique...

Nous poursuivons nos travaux avec l'audition du professeur Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique.
Je vous prie d'excuser l'absence du président Milon, retenu dans son département.
Le professeur Delfraissy est accompagné de quatre membres du conseil scientifique, MM. Simon Cauchemez et Daniel Benamouzig, Mme Marie-Aleth Grard et M. Denis Malvy, ainsi que de Mme Caroline Jaegy, chargée de mission.
Mis en place le 11 mars 2020, le conseil scientifique a été consacré par la loi du 23 mars 2020 qui en a fait un des éléments de l'état d'urgence sanitaire.
L'article L. 3131-19 du code de la santé publique prévoit ainsi : « En cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire, il est réuni sans délai un comité de scientifiques. Son président est nommé par décret du Président de la République. Ce comité comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat ainsi que des personnalités qualifiées nommées par décret. Le comité rend périodiquement des avis sur l'état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s'y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, y compris celles relevant des articles L. 3131-15 à L. 3131-17, ainsi que sur la durée de leur application. Ces avis sont rendus publics sans délai. Le comité est dissous lorsque prend fin l'état d'urgence sanitaire ».
Le conseil a rendu des avis publics à chacune des étapes de la gestion de la crise, avant ou après les annonces du Gouvernement.
Il est pluridisciplinaire et notre commission d'enquête a déjà entendu plusieurs de ses membres sur différentes thématiques. C'est le cas d'Arnaud Fontanet, dans le cadre de la table ronde consacrée à la gestion de la crise sanitaire dans l'Oise, mais aussi de Bruno Lina, entendu la semaine dernière sur la question des tests et du dépistage. Nous entendrons cet après-midi Yazdan Yazdanpanah sur les questions de la recherche et des traitements.
Sur ces derniers aspects, un second comité, le Comité analyse recherche et expertise (CARE), dirigé par Françoise Barré-Sinoussi, a été mis en place. Il est chargé de faire des recommandations sur la recherche ainsi que sur des essais cliniques et thérapeutiques.
Professeur, vous avez été entendu à deux reprises par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, ce qui me permet de faire écho aux propos que vous avez tenus devant nos collègues députés. Nous sommes en effet aujourd'hui dans une logique de retour d'expérience sur la gestion de la crise.
Vous avez déclaré en conclusion, le 18 juin dernier, que vous aviez deux messages à faire passer : « Premièrement, il faut anticiper pour mieux préparer. Deuxièmement, je pense que nous devons avoir une vraie réflexion sur la construction et sur l'avenir de la santé publique en France. » Pourriez-vous développer et préciser ces deux points ce matin ?
Enfin, vous avez déclaré à l'Assemblée nationale que le conseil scientifique avait fait entendre « sa petite musique ». Pour notre part, comme nombre de nos concitoyens, nous avons plutôt eu le sentiment d'entendre une assourdissante cacophonie de la part du monde scientifique...

Comment l'expliquez-vous ?
Je vais vous demander de présenter brièvement vos principaux messages, en dix ou quinze minutes au maximum, afin de laisser le temps aux échanges. Les personnes qui vous accompagnent pourront prendre la parole pour répondre aux questions.
Mesdames, messieurs, je vais maintenant, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, vous demander de prêter serment. Je rappelle que tout témoignage mensonger devant une commission d'enquête parlementaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. J'invite chacun d'entre vous à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire : « Je le jure. »
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, MM. Jean-François Delfraissy, Simon Cauchemez et Daniel Benamouzig, Mmes Marie-Aleth Grard et Caroline Jaegy, ainsi que M. Denis Malvy prêtent serment.
À toutes fins utiles, je rappelle à tous que le port du masque est obligatoire et je vous remercie pour votre vigilance.

Comment l'expliquez-vous ?
Je vais vous demander de présenter brièvement vos principaux messages, en dix ou quinze minutes au maximum, afin de laisser le temps aux échanges. Les personnes qui vous accompagnent pourront prendre la parole pour répondre aux questions.
Mesdames, messieurs, je vais maintenant, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, vous demander de prêter serment. Je rappelle que tout témoignage mensonger devant une commission d'enquête parlementaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. J'invite chacun d'entre vous à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire : « Je le jure. »
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, MM. Jean-François Delfraissy, Simon Cauchemez et Daniel Benamouzig, Mmes Marie-Aleth Grard et Caroline Jaegy, ainsi que M. Denis Malvy prêtent serment.
À toutes fins utiles, je rappelle à tous que le port du masque est obligatoire et je vous remercie pour votre vigilance.
Je souhaite tout d'abord apporter une précision, monsieur le président. Vous avez fait prêter serment à Caroline Jaegy, c'est très bien, puisqu'elle est présente. Toutefois, Caroline est une stagiaire de Sciences Po, qui nous accompagne comme chargée de mission, mais qui n'est pas membre du conseil scientifique. J'en profite pour vous indiquer que les moyens humains mis à disposition du conseil depuis le début de cette crise se sont résumés à deux stagiaires.
Vous avez rappelé qui nous étions. On demande souvent pourquoi ce comité multidisciplinaire ne comprend pas d'économiste. J'avais souhaité la présence de spécialistes en sciences humaines et sociales et d'un représentant de la société civile et nous avons discuté de la présence d'économistes. Au début de la crise, les préoccupations sanitaires étaient largement dominantes, mais nous nous sommes très vite intéressés aux conséquences économiques et nous avons travaillé avec des groupes d'experts en économie. Toutefois, il ne nous est pas paru pertinent d'intégrer un économiste au sein d'un groupe qui avait une vision essentiellement scientifique et médicale, d'autant plus que le Gouvernement avait mis en place un groupe d'experts économistes.
Bien que vous l'ayez également rappelé, j'insiste sur le fait que ce comité a pour but d'éclairer le Gouvernement et les autorités sanitaires : il n'a pas pour fonction de décider. Nous voyons ressurgir des allusions à un « troisième pouvoir » médical : c'est du bullshit, oubliez ça ! On en entend parler uniquement dans les médias. La France est une grande démocratie, le comité scientifique est auditionné par le Sénat, il l'a été par l'Assemblée nationale. Les experts scientifiques et médicaux sont là pour aider à prendre des décisions difficiles parce qu'elles sont compliquées.
Si je suis venu accompagné d'un certain nombre de membres du comité scientifique, c'est parce que nous avons mené un travail de groupe, en faisant un exercice d'intelligence collective. Il ne s'agit pas du tout de la réflexion d'un homme seul, même si le président est mis en avant pour des raisons diverses et variées - tant mieux d'ailleurs, j'ai les épaules assez larges pour recevoir les coups ! Nos avis sont rendus de manière collégiale, après une phase de construction en interne. Nous avons souhaité émettre des avis écrits, destinés à être rendus publics, avec un décalage entre la remise au Gouvernement et la diffusion. Il me paraît essentiel, en termes de vision démocratique, que ce sur quoi les décideurs s'appuient puisse être partagé avec nos concitoyens. C'est d'ailleurs un mode de travail habituel en médecine, où la décision est de moins en moins celle d'une personne, mais de plus en plus celle de groupes. Les réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) ont pour but de permettre les décisions collégiales. On a dit que ce conseil scientifique était un outil très nouveau, mais son mode de travail est en fait très habituel.
Nous avons connu quatre grands moments : le premier a consisté à faire comprendre au politique, entre le 10 et le 17 mars, la nécessité du confinement du pays - cette décision n'est pas seulement française, on la retrouve dans tous les grands pays européens - ; dans une deuxième période, nos avis ont porté sur la manière de gérer le confinement ; la troisième période a porté sur le déconfinement, en sortant du conseil immédiat pour adopter une vision stratégique - nous avons beaucoup travaillé à l'époque avec le groupe constitué autour de Jean Castex, avant que ce dernier ne devienne Premier ministre ; dans la quatrième période, nous avons rendu quelques avis stratégiques autour du déconfinement, des différents scénarios à venir, des plans de préparation de l'ensemble des structures, afin que les différents corps de l'État ne s'endorment pas pendant l'été - notre avis n° 8 de fin juillet tentait d'anticiper la rentrée, en posant le problème des vingt grandes métropoles françaises qui représentent un enjeu majeur pour la rentrée, en termes de densité de population, notamment pour sa partie la plus jeune, d'activité économique et de transports, plutôt que les régions.
Vous nous avez interrogés sur nos relations avec les différentes agences de santé existant déjà en France. J'ai souhaité d'emblée que cet objet nouveau qu'est le conseil scientifique - vous avez rappelé qu'il a été créé par la loi, même s'il a fait ses débuts dans un vide juridique complet - ne constitue pas une nouvelle strate décisionnelle, comme on a l'habitude de le faire en France, mais s'appuie sur ce qui existait déjà. Nous avons eu bien sûr des relations avec Santé publique France, dont la directrice était présente à l'Élysée lors de la réunion du 12 mars, avec le Haut Conseil de santé publique (HCSP), dont le président est membre à part entière du conseil scientifique, avec la Haute Autorité de santé (HAS), avec la recherche, avec REACTing - Yazdan Yazdanpanah vous en parlera cet après-midi. Dans une vie antérieure, j'ai été à l'origine de la construction de REACTing comme modèle de réponse d'urgence aux épidémies. Nous avons également eu beaucoup de relations avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), avec le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) - je précise que je n'ai pas démissionné de la présidence de ce comité, mais que je me suis déporté en faveur de sa vice-présidente, parce que j'ai immédiatement jugé cette fonction incompatible avec une présidence opérationnelle du conseil scientifique - et avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Au mois d'avril, nous avons fait un gros effort pour créer des liens avec les académies de médecine et des sciences, avec le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), pour leur expliquer ce que l'on savait, pourquoi on prenait telle direction, les enjeux qui pouvaient se poser.
Enfin, avec des résultats variables, nous avons créé des liens avec nos collègues étrangers au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, même si ces conseils scientifiques ne correspondent pas forcément à notre modèle. Nous avons eu des échanges d'ordre scientifique, mais l'Europe, à cette occasion, ne s'est pas très bien construite, puisque l'ensemble des décisions prises l'ont été au niveau de chaque pays, chacun ayant tendance à se refermer sur lui-même.
J'en viens à notre relation avec le politique. Cette crise est sans précédent - il y a quatre ans, dans une conférence, j'avais évoqué l'hypothèse de la mutation d'un virus grippal, et non d'un coronavirus, mais j'y croyais sans y croire... Les relations du politique avec le comité scientifique, installé par le politique, posent deux ou trois questions sur lesquelles je veux revenir.
Tout d'abord, ce comité est-il autonome ou dépend-il du politique ? Nous avons tout fait pour garder notre indépendance dans notre mode de fonctionnement : nous pouvons être saisis par le Gouvernement, mais nous pouvons aussi nous autosaisir, nous avons joué la transparence, certaines de nos propositions n'ont pas été retenues.
Ensuite, ce comité comprend des médecins et des scientifiques. Il ne correspond pas au modèle hiérarchique de la haute administration française. Nous ne sommes pas des énarques, nous ne sommes pas des hauts fonctionnaires qui doivent répondre, dans le contexte français, à l'ordre politique. Nous n'avons pas de relation hiérarchique, y compris avec le plus haut niveau de l'État, notre parole est libre.
Certains enjeux restent fondamentaux dans la relation avec le politique. Premièrement, la science se construit sur les incertitudes. S'il n'y a pas d'incertitude en science, on ne construit pas de la bonne science. Donc, nous avons des hésitations. Je comprends que certains d'entre vous puissent ensuite nous interroger sur les différentes prises de parole des scientifiques : distinguons la prise de parole des scientifiques de la prise de parole du conseil scientifique. Cette notion d'incertitude, par définition, ne plaît pas au politique, qui a besoin d'une forme de certitude à court terme pour construire ses décisions. Deuxièmement, il y a le facteur temps : le temps des médias est de quelques heures, le temps du politique est de quelques jours, le temps de la science se compte en semaines et en mois. J'ai dit d'emblée que nous n'aurions pas de résultat d'essais thérapeutiques, de construction solide, avant trois ou quatre mois. On comprend bien qu'il soit difficile pour un politique d'intégrer qu'il n'aura pas de réponse scientifique solide avant plusieurs mois. Ceux qui pensent que l'on peut avoir des résultats extrêmement rapides se trompent : pour avoir des résultats solides, la science prend un peu de temps. Troisièmement, à aucun moment, nous n'avons eu l'idée qu'un « troisième pouvoir » médical pourrait s'installer en France. Nous sommes là pour éclairer le politique sur des questions difficiles, l'actualité le prouve, mais c'est bien le politique qui décide.
De notre point de vue, la relation avec les plus hautes autorités de l'État s'est déroulée dans un climat de confiance, qu'il s'agisse des conseillers de l'Élysée, de Matignon, du ministère de la santé, sous forme de notes ou d'avis. Nous avons eu des positions divergentes : sur l'ouverture des écoles, ou sur la place du citoyen et de la société civile, aucun comité citoyen n'ayant été mis en place au niveau tant national que territorial. Nous avons également pu regretter qu'une certaine forme de gouvernance ne se soit pas installée.
J'en arrive enfin à ce que nous ne sommes pas : nous ne sommes pas une instance de décision, nous ne décidons rien, c'est le politique qui le fait, nous sommes là pour l'éclairer. J'insiste parce que je vois le débat repartir : il peut intéresser les médias, mais pas les gens sérieux ! Nous ne sommes pas une structure pérenne, nous ne sommes pas une nouvelle agence sanitaire. Le conseil scientifique est lié à la crise sanitaire, il faut qu'il ait un début et une fin ; je vous rappelle qu'il avait souhaité disparaître le 9 juillet 2020 et que ce sont les parlementaires qui ont voulu le prolonger jusqu'au 30 octobre. Ce choix nous a mis en difficulté : on aurait pu imaginer que ce conseil passe la main à d'autres scientifiques, mais nous avons jugé en notre âme et conscience qu'il était difficile de ne pas accompagner le Gouvernement en cette période d'été et de rentrée, où nous avions anticipé le retour du virus, et nous avons donc décidé de rester jusqu'au 30 octobre. Mais j'insiste sur la question de fond : à partir du moment où l'on crée un objet nouveau de ce type et qu'on croit lui confier une forme de pouvoir - qu'il n'a pas ! -, la meilleure façon de répondre aux critiques, c'est de mettre fin à cet organisme. Nous en sommes totalement persuadés ; ensuite se pose la question du moment de sa disparition.
Nous n'étions pas non plus un organisme opérationnel. Nous étions là pour guider, construire une doctrine, une réponse s'appuyant sur des bases scientifiques autant que faire se peut. La science a évolué durant cette crise. Comment construire quand on découvre en marchant ? Nous avons été une instance de santé publique. Il a été très peu question d'innovation thérapeutique jusqu'à maintenant, même si cela va arriver. Les décisions que nous avons été amenés à « faire prendre » par le politique au plus haut niveau, quand il l'a souhaité, ont été essentiellement des décisions de santé publique. On en revient donc à ce que j'avais évoqué devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale : ce comité a joué un rôle de construction de la pensée et de la décision en santé publique en France, et l'on peut donc s'interroger sur ce qui manque en termes d'outils et de construction d'une vision de santé publique. C'est l'une des grandes leçons de cette crise.
Je comprends les interrogations de nos concitoyens qui ont le sentiment d'entendre tout et son contraire de la part d'un certain nombre de personnalités scientifiques. Il faut d'abord bien séparer ce que dit le conseil scientifique au moment où il rend des avis écrits et le barnum médiatique qui existe depuis mi-avril - il s'était calmé pendant l'été, mais il reprend depuis trois semaines - où des gens qui croient tout savoir prennent la parole dans les médias, ce que l'on peut regretter. Daniel Benamouzig vous dirait qu'il y a une absence de régulation. Nous avons essayé de cadrer les choses, autant que faire se peut, mais il y a une liberté d'expression naturelle en France et il est donc difficile de réguler les prises de parole.
Enfin, les connaissances ont évolué, y compris les nôtres, concernant notamment les mécanismes de transmission (les lieux de transmission, l'existence de personnes supercontaminatrices, etc.). Il faut prendre des décisions stratégiques fondées sur la science au moment même où cette science se construit.
S'agissant de l'immunité en population, on sait maintenant qu'il y a entre 5 % et 10 % de la population, suivant les régions, qui a été contaminée et a des anticorps : ce n'était pas évident au départ ! Si l'on m'avait demandé de parier, j'aurais plutôt misé sur 20 % ou 25 % en France ; or le taux observé est nettement inférieur, et cela vaut pour l'ensemble des pays.
Sur la signification des anticorps, est-on protégé quand on a été malade une première fois ? Oui, probablement, dans l'immense majorité des cas. Mais on vient de décrire, dans les dernières semaines, quatre cas de deuxième contamination, chez des personnes ayant eu des anticorps. Concernant le supposé rôle contaminant des enfants, on s'est aperçu, en fait, que les enfants étaient contaminés par les adultes. Il y a donc eu une acquisition de connaissances au fur et à mesure, qui a rendu les décisions difficiles à prendre.
Pour conclure, je remercie publiquement l'ensemble du conseil scientifique qui a travaillé énormément - plus de 150 réunions, y compris le week-end ! L'important, c'est le travail d'équipe et l'intelligence collective. Je remercie également les Français qui, à 80 %, sont un peu inquiets, mais restent raisonnables - là aussi, les médias ont un rôle en ne s'intéressant qu'au 20 % de personnes qui, à des degrés divers, refusent les mesures.
Je voudrais enfin vous faire part d'un regret, concernant les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Nous avions d'emblée émis un certain nombre de recommandations et de consignes pour la prise en charge de leurs pensionnaires. La confrontation entre cette vision sanitaire et la volonté de laisser les anciens vivre normalement a mis en évidence le fait que les Ehpad étaient beaucoup moins médicalisés qu'on ne le pensait, que l'organisation de la prise en charge médicale était complexe - cela avait été signalé depuis longtemps dans d'autres structures. S'il devait y avoir une reprise du virus dans quelques semaines, il ne faudrait pas répéter ce qui s'est passé et faire en sorte que tout soit prêt.
S'il nous reste du temps en fin d'audition, nous pourrons vous donner notre vision de ce qui pourrait se passer dans les semaines ou les mois qui viennent, afin de ne pas parler uniquement du passé.
Je souhaite tout d'abord apporter une précision, monsieur le président. Vous avez fait prêter serment à Caroline Jaegy, c'est très bien, puisqu'elle est présente. Toutefois, Caroline est une stagiaire de Sciences Po, qui nous accompagne comme chargée de mission, mais qui n'est pas membre du conseil scientifique. J'en profite pour vous indiquer que les moyens humains mis à disposition du conseil depuis le début de cette crise se sont résumés à deux stagiaires.
Vous avez rappelé qui nous étions. On demande souvent pourquoi ce comité multidisciplinaire ne comprend pas d'économiste. J'avais souhaité la présence de spécialistes en sciences humaines et sociales et d'un représentant de la société civile et nous avons discuté de la présence d'économistes. Au début de la crise, les préoccupations sanitaires étaient largement dominantes, mais nous nous sommes très vite intéressés aux conséquences économiques et nous avons travaillé avec des groupes d'experts en économie. Toutefois, il ne nous est pas paru pertinent d'intégrer un économiste au sein d'un groupe qui avait une vision essentiellement scientifique et médicale, d'autant plus que le Gouvernement avait mis en place un groupe d'experts économistes.
Bien que vous l'ayez également rappelé, j'insiste sur le fait que ce comité a pour but d'éclairer le Gouvernement et les autorités sanitaires : il n'a pas pour fonction de décider. Nous voyons ressurgir des allusions à un « troisième pouvoir » médical : c'est du bullshit, oubliez ça ! On en entend parler uniquement dans les médias. La France est une grande démocratie, le comité scientifique est auditionné par le Sénat, il l'a été par l'Assemblée nationale. Les experts scientifiques et médicaux sont là pour aider à prendre des décisions difficiles parce qu'elles sont compliquées.
Si je suis venu accompagné d'un certain nombre de membres du comité scientifique, c'est parce que nous avons mené un travail de groupe, en faisant un exercice d'intelligence collective. Il ne s'agit pas du tout de la réflexion d'un homme seul, même si le président est mis en avant pour des raisons diverses et variées - tant mieux d'ailleurs, j'ai les épaules assez larges pour recevoir les coups ! Nos avis sont rendus de manière collégiale, après une phase de construction en interne. Nous avons souhaité émettre des avis écrits, destinés à être rendus publics, avec un décalage entre la remise au Gouvernement et la diffusion. Il me paraît essentiel, en termes de vision démocratique, que ce sur quoi les décideurs s'appuient puisse être partagé avec nos concitoyens. C'est d'ailleurs un mode de travail habituel en médecine, où la décision est de moins en moins celle d'une personne, mais de plus en plus celle de groupes. Les réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) ont pour but de permettre les décisions collégiales. On a dit que ce conseil scientifique était un outil très nouveau, mais son mode de travail est en fait très habituel.
Nous avons connu quatre grands moments : le premier a consisté à faire comprendre au politique, entre le 10 et le 17 mars, la nécessité du confinement du pays - cette décision n'est pas seulement française, on la retrouve dans tous les grands pays européens - ; dans une deuxième période, nos avis ont porté sur la manière de gérer le confinement ; la troisième période a porté sur le déconfinement, en sortant du conseil immédiat pour adopter une vision stratégique - nous avons beaucoup travaillé à l'époque avec le groupe constitué autour de Jean Castex, avant que ce dernier ne devienne Premier ministre ; dans la quatrième période, nous avons rendu quelques avis stratégiques autour du déconfinement, des différents scénarios à venir, des plans de préparation de l'ensemble des structures, afin que les différents corps de l'État ne s'endorment pas pendant l'été - notre avis n° 8 de fin juillet tentait d'anticiper la rentrée, en posant le problème des vingt grandes métropoles françaises qui représentent un enjeu majeur pour la rentrée, en termes de densité de population, notamment pour sa partie la plus jeune, d'activité économique et de transports, plutôt que les régions.
Vous nous avez interrogés sur nos relations avec les différentes agences de santé existant déjà en France. J'ai souhaité d'emblée que cet objet nouveau qu'est le conseil scientifique - vous avez rappelé qu'il a été créé par la loi, même s'il a fait ses débuts dans un vide juridique complet - ne constitue pas une nouvelle strate décisionnelle, comme on a l'habitude de le faire en France, mais s'appuie sur ce qui existait déjà. Nous avons eu bien sûr des relations avec Santé publique France, dont la directrice était présente à l'Élysée lors de la réunion du 12 mars, avec le Haut Conseil de santé publique (HCSP), dont le président est membre à part entière du conseil scientifique, avec la Haute Autorité de santé (HAS), avec la recherche, avec REACTing - Yazdan Yazdanpanah vous en parlera cet après-midi. Dans une vie antérieure, j'ai été à l'origine de la construction de REACTing comme modèle de réponse d'urgence aux épidémies. Nous avons également eu beaucoup de relations avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), avec le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) - je précise que je n'ai pas démissionné de la présidence de ce comité, mais que je me suis déporté en faveur de sa vice-présidente, parce que j'ai immédiatement jugé cette fonction incompatible avec une présidence opérationnelle du conseil scientifique - et avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Au mois d'avril, nous avons fait un gros effort pour créer des liens avec les académies de médecine et des sciences, avec le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), pour leur expliquer ce que l'on savait, pourquoi on prenait telle direction, les enjeux qui pouvaient se poser.
Enfin, avec des résultats variables, nous avons créé des liens avec nos collègues étrangers au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, même si ces conseils scientifiques ne correspondent pas forcément à notre modèle. Nous avons eu des échanges d'ordre scientifique, mais l'Europe, à cette occasion, ne s'est pas très bien construite, puisque l'ensemble des décisions prises l'ont été au niveau de chaque pays, chacun ayant tendance à se refermer sur lui-même.
J'en viens à notre relation avec le politique. Cette crise est sans précédent - il y a quatre ans, dans une conférence, j'avais évoqué l'hypothèse de la mutation d'un virus grippal, et non d'un coronavirus, mais j'y croyais sans y croire... Les relations du politique avec le comité scientifique, installé par le politique, posent deux ou trois questions sur lesquelles je veux revenir.
Tout d'abord, ce comité est-il autonome ou dépend-il du politique ? Nous avons tout fait pour garder notre indépendance dans notre mode de fonctionnement : nous pouvons être saisis par le Gouvernement, mais nous pouvons aussi nous autosaisir, nous avons joué la transparence, certaines de nos propositions n'ont pas été retenues.
Ensuite, ce comité comprend des médecins et des scientifiques. Il ne correspond pas au modèle hiérarchique de la haute administration française. Nous ne sommes pas des énarques, nous ne sommes pas des hauts fonctionnaires qui doivent répondre, dans le contexte français, à l'ordre politique. Nous n'avons pas de relation hiérarchique, y compris avec le plus haut niveau de l'État, notre parole est libre.
Certains enjeux restent fondamentaux dans la relation avec le politique. Premièrement, la science se construit sur les incertitudes. S'il n'y a pas d'incertitude en science, on ne construit pas de la bonne science. Donc, nous avons des hésitations. Je comprends que certains d'entre vous puissent ensuite nous interroger sur les différentes prises de parole des scientifiques : distinguons la prise de parole des scientifiques de la prise de parole du conseil scientifique. Cette notion d'incertitude, par définition, ne plaît pas au politique, qui a besoin d'une forme de certitude à court terme pour construire ses décisions. Deuxièmement, il y a le facteur temps : le temps des médias est de quelques heures, le temps du politique est de quelques jours, le temps de la science se compte en semaines et en mois. J'ai dit d'emblée que nous n'aurions pas de résultat d'essais thérapeutiques, de construction solide, avant trois ou quatre mois. On comprend bien qu'il soit difficile pour un politique d'intégrer qu'il n'aura pas de réponse scientifique solide avant plusieurs mois. Ceux qui pensent que l'on peut avoir des résultats extrêmement rapides se trompent : pour avoir des résultats solides, la science prend un peu de temps. Troisièmement, à aucun moment, nous n'avons eu l'idée qu'un « troisième pouvoir » médical pourrait s'installer en France. Nous sommes là pour éclairer le politique sur des questions difficiles, l'actualité le prouve, mais c'est bien le politique qui décide.
De notre point de vue, la relation avec les plus hautes autorités de l'État s'est déroulée dans un climat de confiance, qu'il s'agisse des conseillers de l'Élysée, de Matignon, du ministère de la santé, sous forme de notes ou d'avis. Nous avons eu des positions divergentes : sur l'ouverture des écoles, ou sur la place du citoyen et de la société civile, aucun comité citoyen n'ayant été mis en place au niveau tant national que territorial. Nous avons également pu regretter qu'une certaine forme de gouvernance ne se soit pas installée.
J'en arrive enfin à ce que nous ne sommes pas : nous ne sommes pas une instance de décision, nous ne décidons rien, c'est le politique qui le fait, nous sommes là pour l'éclairer. J'insiste parce que je vois le débat repartir : il peut intéresser les médias, mais pas les gens sérieux ! Nous ne sommes pas une structure pérenne, nous ne sommes pas une nouvelle agence sanitaire. Le conseil scientifique est lié à la crise sanitaire, il faut qu'il ait un début et une fin ; je vous rappelle qu'il avait souhaité disparaître le 9 juillet 2020 et que ce sont les parlementaires qui ont voulu le prolonger jusqu'au 30 octobre. Ce choix nous a mis en difficulté : on aurait pu imaginer que ce conseil passe la main à d'autres scientifiques, mais nous avons jugé en notre âme et conscience qu'il était difficile de ne pas accompagner le Gouvernement en cette période d'été et de rentrée, où nous avions anticipé le retour du virus, et nous avons donc décidé de rester jusqu'au 30 octobre. Mais j'insiste sur la question de fond : à partir du moment où l'on crée un objet nouveau de ce type et qu'on croit lui confier une forme de pouvoir - qu'il n'a pas ! -, la meilleure façon de répondre aux critiques, c'est de mettre fin à cet organisme. Nous en sommes totalement persuadés ; ensuite se pose la question du moment de sa disparition.
Nous n'étions pas non plus un organisme opérationnel. Nous étions là pour guider, construire une doctrine, une réponse s'appuyant sur des bases scientifiques autant que faire se peut. La science a évolué durant cette crise. Comment construire quand on découvre en marchant ? Nous avons été une instance de santé publique. Il a été très peu question d'innovation thérapeutique jusqu'à maintenant, même si cela va arriver. Les décisions que nous avons été amenés à « faire prendre » par le politique au plus haut niveau, quand il l'a souhaité, ont été essentiellement des décisions de santé publique. On en revient donc à ce que j'avais évoqué devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale : ce comité a joué un rôle de construction de la pensée et de la décision en santé publique en France, et l'on peut donc s'interroger sur ce qui manque en termes d'outils et de construction d'une vision de santé publique. C'est l'une des grandes leçons de cette crise.
Je comprends les interrogations de nos concitoyens qui ont le sentiment d'entendre tout et son contraire de la part d'un certain nombre de personnalités scientifiques. Il faut d'abord bien séparer ce que dit le conseil scientifique au moment où il rend des avis écrits et le barnum médiatique qui existe depuis mi-avril - il s'était calmé pendant l'été, mais il reprend depuis trois semaines - où des gens qui croient tout savoir prennent la parole dans les médias, ce que l'on peut regretter. Daniel Benamouzig vous dirait qu'il y a une absence de régulation. Nous avons essayé de cadrer les choses, autant que faire se peut, mais il y a une liberté d'expression naturelle en France et il est donc difficile de réguler les prises de parole.
Enfin, les connaissances ont évolué, y compris les nôtres, concernant notamment les mécanismes de transmission (les lieux de transmission, l'existence de personnes supercontaminatrices, etc.). Il faut prendre des décisions stratégiques fondées sur la science au moment même où cette science se construit.
S'agissant de l'immunité en population, on sait maintenant qu'il y a entre 5 % et 10 % de la population, suivant les régions, qui a été contaminée et a des anticorps : ce n'était pas évident au départ ! Si l'on m'avait demandé de parier, j'aurais plutôt misé sur 20 % ou 25 % en France ; or le taux observé est nettement inférieur, et cela vaut pour l'ensemble des pays.
Sur la signification des anticorps, est-on protégé quand on a été malade une première fois ? Oui, probablement, dans l'immense majorité des cas. Mais on vient de décrire, dans les dernières semaines, quatre cas de deuxième contamination, chez des personnes ayant eu des anticorps. Concernant le supposé rôle contaminant des enfants, on s'est aperçu, en fait, que les enfants étaient contaminés par les adultes. Il y a donc eu une acquisition de connaissances au fur et à mesure, qui a rendu les décisions difficiles à prendre.
Pour conclure, je remercie publiquement l'ensemble du conseil scientifique qui a travaillé énormément - plus de 150 réunions, y compris le week-end ! L'important, c'est le travail d'équipe et l'intelligence collective. Je remercie également les Français qui, à 80 %, sont un peu inquiets, mais restent raisonnables - là aussi, les médias ont un rôle en ne s'intéressant qu'au 20 % de personnes qui, à des degrés divers, refusent les mesures.
Je voudrais enfin vous faire part d'un regret, concernant les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Nous avions d'emblée émis un certain nombre de recommandations et de consignes pour la prise en charge de leurs pensionnaires. La confrontation entre cette vision sanitaire et la volonté de laisser les anciens vivre normalement a mis en évidence le fait que les Ehpad étaient beaucoup moins médicalisés qu'on ne le pensait, que l'organisation de la prise en charge médicale était complexe - cela avait été signalé depuis longtemps dans d'autres structures. S'il devait y avoir une reprise du virus dans quelques semaines, il ne faudrait pas répéter ce qui s'est passé et faire en sorte que tout soit prêt.
S'il nous reste du temps en fin d'audition, nous pourrons vous donner notre vision de ce qui pourrait se passer dans les semaines ou les mois qui viennent, afin de ne pas parler uniquement du passé.

Effectivement, notre commission d'enquête ne se penche pas seulement sur le passé, mais elle tend à préparer l'avenir. Le présent reste important, parce que la situation évolue.
Il est de tradition, après l'exposé de la personne auditionnée, que les rapporteurs posent leurs questions. Nous passerons ensuite aux questions des membres de la commission que je regrouperai.

Effectivement, notre commission d'enquête ne se penche pas seulement sur le passé, mais elle tend à préparer l'avenir. Le présent reste important, parce que la situation évolue.
Il est de tradition, après l'exposé de la personne auditionnée, que les rapporteurs posent leurs questions. Nous passerons ensuite aux questions des membres de la commission que je regrouperai.

Je tiens tout d'abord à remercier les membres du conseil scientifique, parce que leur tâche est difficile et que leur engagement est entier. Pour nous tous, cette audition est l'occasion de chercher les réponses à apporter pour améliorer notre attitude collective face à une épidémie. Les réflexions du conseil sont donc essentielles à cet égard.
Je me limiterai à deux questions sur des sujets que vous avez abordés, monsieur le professeur. La première porte sur l'existence de votre instance, dont les membres et le travail ne sont pas en cause. Quand une épidémie flambe dans un pays, quelle signification peut avoir la création ex nihilo d'une nouvelle instance et sa ratification, quelque temps plus tard, par le Parlement ? Cette création procédait de la seule volonté du chef de l'État. Que dit cette décision de l'état de notre système de santé et de notre préparation à la survenue d'une crise sanitaire de cette ampleur ? Comment voyez-vous la réponse à cette question ? Vous avez rappelé vous-même la durée de vie limitée de cette instance, qui n'a pas vocation à s'inscrire dans le paysage de la gouvernance sanitaire de notre pays. Si l'on partage votre raisonnement sur l'utilité de vos travaux, le jour où cette instance disparaît, quelque chose ne fonctionne plus à nouveau.
Ma deuxième question porte sur la façon dont la controverse scientifique fonctionne dans notre pays. Dans une période où la connaissance se construit pas à pas, dans une situation inquiétante, la controverse a connu des modalités qui dépassaient la légitimité du débat scientifique. Pour parler plus clairement, on a plus assisté à la controverse des ego qu'à autre chose. L'absence de régulation a-t-elle été liée au fait que nous sommes une démocratie ? La parole est libre, et c'est heureux, mais quand les excès prennent le pas sur l'utilité du débat scientifique, c'est l'ensemble de notre population qui en paie les conséquences. Comment remédier à cet état de fait ?

Je tiens tout d'abord à remercier les membres du conseil scientifique, parce que leur tâche est difficile et que leur engagement est entier. Pour nous tous, cette audition est l'occasion de chercher les réponses à apporter pour améliorer notre attitude collective face à une épidémie. Les réflexions du conseil sont donc essentielles à cet égard.
Je me limiterai à deux questions sur des sujets que vous avez abordés, monsieur le professeur. La première porte sur l'existence de votre instance, dont les membres et le travail ne sont pas en cause. Quand une épidémie flambe dans un pays, quelle signification peut avoir la création ex nihilo d'une nouvelle instance et sa ratification, quelque temps plus tard, par le Parlement ? Cette création procédait de la seule volonté du chef de l'État. Que dit cette décision de l'état de notre système de santé et de notre préparation à la survenue d'une crise sanitaire de cette ampleur ? Comment voyez-vous la réponse à cette question ? Vous avez rappelé vous-même la durée de vie limitée de cette instance, qui n'a pas vocation à s'inscrire dans le paysage de la gouvernance sanitaire de notre pays. Si l'on partage votre raisonnement sur l'utilité de vos travaux, le jour où cette instance disparaît, quelque chose ne fonctionne plus à nouveau.
Ma deuxième question porte sur la façon dont la controverse scientifique fonctionne dans notre pays. Dans une période où la connaissance se construit pas à pas, dans une situation inquiétante, la controverse a connu des modalités qui dépassaient la légitimité du débat scientifique. Pour parler plus clairement, on a plus assisté à la controverse des ego qu'à autre chose. L'absence de régulation a-t-elle été liée au fait que nous sommes une démocratie ? La parole est libre, et c'est heureux, mais quand les excès prennent le pas sur l'utilité du débat scientifique, c'est l'ensemble de notre population qui en paie les conséquences. Comment remédier à cet état de fait ?
Je répondrai à votre première question et je laisserai Daniel Benamouzig vous répondre sur le problème de la régulation.
Sur le premier point - pourquoi une nouvelle instance ?-, il manquait probablement quelque chose...
Je répondrai à votre première question et je laisserai Daniel Benamouzig vous répondre sur le problème de la régulation.
Sur le premier point - pourquoi une nouvelle instance ?-, il manquait probablement quelque chose...
Le conseil scientifique a été créé à la suite de signaux d'alerte que j'avais envoyés à l'Élysée au retour d'une réunion de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) où je m'étais rendu au titre du CCNE, parce que j'avais trouvé que les Chinois ne nous disaient pas grand-chose. Après m'être entretenu avec des collègues italiens et avoir pris contact avec Simon Cauchemez sur les modélisations, j'ai contacté l'Élysée. Le 5 mars, une réunion multidisciplinaire de 24 scientifiques s'est tenue à l'Élysée. Le conseil scientifique a été créé de novo pendant le week-end. On aurait pu imaginer que les patrons des différentes agences - Santé publique France, le Haut Conseil de santé publique, la HAS, etc. - se réunissent en comité scientifique des patrons d'agence sanitaire pour éclairer le Gouvernement, mais ce modèle n'a pas été retenu. Je suis mal placé pour parler des raisons qui ont orienté ce choix, puisque nous avons eu tout de suite les mains dans le cambouis.
Nous avons tenté d'être indépendants et autonomes. J'ai été le directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS) et je sais très bien que, dans cette fonction, tout en étant soi-même, on défend l'agence que l'on dirige. Dans un comité de scientifique et d'experts indépendants, où le sens de la hiérarchie n'est pas directement impliqué, une liberté d'expression peut s'établir. En revanche, on peut se dire que, dans un climat d'extrême urgence, il s'agit d'un modèle de réponse. Si l'on observe ce qu'ont fait les autres pays européens, on trouve les deux modèles : des créations de novo et des modèles s'appuyant sur des agences déjà existantes. Au début du mois de juillet, l'ensemble des agences s'étaient organisées pour faire face à la situation et il nous revenait de leur passer la main. Vous avez souhaité que le conseil scientifique poursuive son activité, nous gardons notre indépendance d'esprit, nous sommes capables de donner des signaux d'alerte, ce qui n'est pas toujours facile...
Le conseil scientifique a été créé à la suite de signaux d'alerte que j'avais envoyés à l'Élysée au retour d'une réunion de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) où je m'étais rendu au titre du CCNE, parce que j'avais trouvé que les Chinois ne nous disaient pas grand-chose. Après m'être entretenu avec des collègues italiens et avoir pris contact avec Simon Cauchemez sur les modélisations, j'ai contacté l'Élysée. Le 5 mars, une réunion multidisciplinaire de 24 scientifiques s'est tenue à l'Élysée. Le conseil scientifique a été créé de novo pendant le week-end. On aurait pu imaginer que les patrons des différentes agences - Santé publique France, le Haut Conseil de santé publique, la HAS, etc. - se réunissent en comité scientifique des patrons d'agence sanitaire pour éclairer le Gouvernement, mais ce modèle n'a pas été retenu. Je suis mal placé pour parler des raisons qui ont orienté ce choix, puisque nous avons eu tout de suite les mains dans le cambouis.
Nous avons tenté d'être indépendants et autonomes. J'ai été le directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS) et je sais très bien que, dans cette fonction, tout en étant soi-même, on défend l'agence que l'on dirige. Dans un comité de scientifique et d'experts indépendants, où le sens de la hiérarchie n'est pas directement impliqué, une liberté d'expression peut s'établir. En revanche, on peut se dire que, dans un climat d'extrême urgence, il s'agit d'un modèle de réponse. Si l'on observe ce qu'ont fait les autres pays européens, on trouve les deux modèles : des créations de novo et des modèles s'appuyant sur des agences déjà existantes. Au début du mois de juillet, l'ensemble des agences s'étaient organisées pour faire face à la situation et il nous revenait de leur passer la main. Vous avez souhaité que le conseil scientifique poursuive son activité, nous gardons notre indépendance d'esprit, nous sommes capables de donner des signaux d'alerte, ce qui n'est pas toujours facile...

Pourquoi ? Quelle est la difficulté ? Vous n'êtes pas nécessairement entendus ?

Pourquoi ? Quelle est la difficulté ? Vous n'êtes pas nécessairement entendus ?
Nous sommes là pour émettre des signaux d'alerte, mais il peut y avoir des nuances. Les enjeux de la crise actuelle ne sont plus seulement sanitaires, ils sont aussi sociétaux et économiques. Nous en avons pleinement conscience.
Dans la relation entre un conseil scientifique et les plus hautes autorités de l'État, on passe par différentes phases, même s'il y a un climat de confiance. Je pense que les différentes agences sont parfaitement capables de prendre le relais. Nous sommes prolongés jusqu'au 30 octobre et après, on verra !
Nous sommes là pour émettre des signaux d'alerte, mais il peut y avoir des nuances. Les enjeux de la crise actuelle ne sont plus seulement sanitaires, ils sont aussi sociétaux et économiques. Nous en avons pleinement conscience.
Dans la relation entre un conseil scientifique et les plus hautes autorités de l'État, on passe par différentes phases, même s'il y a un climat de confiance. Je pense que les différentes agences sont parfaitement capables de prendre le relais. Nous sommes prolongés jusqu'au 30 octobre et après, on verra !

Donc, clairement, notre système n'était pas prêt à affronter cette crise ?

Donc, clairement, notre système n'était pas prêt à affronter cette crise ?
Le système de santé publique français et notre vision de santé publique n'étaient pas prêts à affronter un tsunami de ce type.
Le système de santé publique français et notre vision de santé publique n'étaient pas prêts à affronter un tsunami de ce type.
Nous sommes tous conscients de vivre une situation extraordinaire, mais j'insiste sur le caractère ordinaire de notre manière de fonctionner. Jean-François Delfraissy a souligné qu'elle était assez commune dans le monde médical et, plus largement, dans le monde de l'expertise sanitaire en France. Pour ce qui me concerne, je travaillais déjà, l'an dernier, dans le cadre d'un conseil scientifique indépendant sur la question des agénésies transverses des membres supérieurs - les bébés sans bras - selon des modalités de régulation qui, dans leur forme, sont assez fréquentes dans le domaine de la santé, où l'on a besoin d'expertises scientifiques indépendantes, pluralistes, collégiales.
Une autre dimension ordinaire sur laquelle je souhaite témoigner « de l'intérieur » est l'indépendance : on regarde tous le paysage institutionnel dans lequel le conseil scientifique évolue, sa place par rapport à différents pouvoirs. On est assez friands, dans notre pays, de ce type de détails qui caractérisent une grande démocratie. Dans le fonctionnement quotidien, le mot « indépendance » a une dimension très concrète, par exemple dans nos modalités d'échanges. Jean-François Delfraissy faisait référence au nombre de nos réunions, plus de 150, ce qui veut dire que nous nous sommes réunis tous les jours, parfois plusieurs fois par jour jusqu'au mois de juillet. À travers ces délibérations, ces doutes, ces échanges, cette recherche d'angles d'attaque qui n'ont pas été examinés, on finit par construire une pensée collective, qui est un amalgame d'éléments connus de certains d'entre nous - je suis très impressionné, à titre personnel, par la qualité de mes collègues -, fondés sur leurs connaissances scientifiques ou sur leur expérience de clinicien, etc., et d'éléments qui ne sont pas connus, qui sont discutés, débattus, très controversés. Voilà le fruit de la délibération.
De manière très concrète aussi, l'écriture de nos avis, que nous assurons nous-mêmes, représente un travail considérable pour stabiliser une forme de pensée collective, la rendre lisible, précise, s'assurer qu'elle embrasse l'ensemble des problèmes. Elle répond aussi à une exigence de transparence, permettant de rendre compte à nos concitoyens du résultat de notre travail scientifique. C'est un travail auquel il faut s'atteler quotidiennement, jusque très tard dans la nuit. Je passe sur le nombre de versions qui ont été nécessaires pour élaborer chaque document. C'est aussi là que se situe l'indépendance : nous avons la maîtrise de l'écrit, de nos délibérations, de nos questionnements, abstraction faite des questions institutionnelles concernant la saisine, l'autosaisine, la position hiérarchique.
Le deuxième point sur lequel je souhaite revenir est l'écart entre le caractère collégial et assez consensuel de nos avis, la convergence de nos points de vue, et un débat public beaucoup plus controversé sur les mêmes thématiques, parfois même illisible, qui suit des dynamiques très difficiles à anticiper, même si, au fil des mois, on observe la récurrence d'un certain nombre de configurations, comme on dit en sociologie. Ce désordre nous frappe aussi, comme n'importe quel citoyen qui cherche de l'information, mais il faut faire avec. D'une certaine manière, il exprime aussi l'autonomie et la liberté d'un certain nombre d'acteurs.
La difficulté tient au fait que, sur ce type de question, on a une conjonction d'autonomies très grandes et très légitimes. La profession médicale, pour des raisons historiques anciennes, dispose d'une très grande autonomie. La profession scientifique, pour des raisons équivalentes, mais un peu différentes, dispose également d'une très grande autonomie - je suis chercheur au CNRS et je me félicite chaque jour de l'autonomie dont je bénéficie dans mon travail scientifique, dans mes questionnements, dans les recherches que je souhaite entreprendre et ce sentiment est partagé par tous les chercheurs de notre pays. Les acteurs de la sphère médiatique disposent aussi très légitimement d'une très grande autonomie dans leur manière d'apprécier les problèmes, d'organiser les discussions ; c'est aussi un gage de notre démocratie.
Ces grandes autonomies se mélangent, s'entrechoquent et répondent à des logiques très différentes. Les logiques du champ médiatique ne sont pas les mêmes que celles du champ médical ou scientifique. Ce qui me frappe, et qui peut appeler une forme de réflexion collective des différentes professions auxquelles j'ai fait référence, c'est la difficulté de la régulation.
Dans le monde médical, la régulation a été compliquée, les divergences sont difficiles à régler, alors que des instances sont prévues et que ces problèmes se posent depuis toujours. Il y a donc une vraie difficulté à aborder ces questions dans un contexte de forte exposition médiatique. On pourrait dire la même chose des instances scientifiques, où existe une forme de régulation sur laquelle on peut s'interroger. Quel est le rôle des régulateurs de la vie scientifique dans la manière dont un certain nombre de positions sont présentées, défendues, organisées, mises en place ? Je ne suis pas un spécialiste de la recherche clinique, mais on a pu observer un certain polycentrisme, pour rester poli, voire un certain désordre. Il y a là aussi matière à progresser.
Enfin, dans le domaine de l'expression médiatique, les professionnels eux-mêmes doivent engager une réflexion, peut-être dans un cadre civique, sur la régulation des médias, dont l'autonomie est légitime, mais ne doit pas occulter le fait que sont mises en oeuvre des logiques mercantiles, d'audience, de positionnement, qui induisent des effets problématiques sur le débat en santé publique.
Rendre le conseil scientifique responsable de ce désordre, qu'on a pu qualifier de barnum, me semble un raccourci audacieux et injuste.
Nous sommes tous conscients de vivre une situation extraordinaire, mais j'insiste sur le caractère ordinaire de notre manière de fonctionner. Jean-François Delfraissy a souligné qu'elle était assez commune dans le monde médical et, plus largement, dans le monde de l'expertise sanitaire en France. Pour ce qui me concerne, je travaillais déjà, l'an dernier, dans le cadre d'un conseil scientifique indépendant sur la question des agénésies transverses des membres supérieurs - les bébés sans bras - selon des modalités de régulation qui, dans leur forme, sont assez fréquentes dans le domaine de la santé, où l'on a besoin d'expertises scientifiques indépendantes, pluralistes, collégiales.
Une autre dimension ordinaire sur laquelle je souhaite témoigner « de l'intérieur » est l'indépendance : on regarde tous le paysage institutionnel dans lequel le conseil scientifique évolue, sa place par rapport à différents pouvoirs. On est assez friands, dans notre pays, de ce type de détails qui caractérisent une grande démocratie. Dans le fonctionnement quotidien, le mot « indépendance » a une dimension très concrète, par exemple dans nos modalités d'échanges. Jean-François Delfraissy faisait référence au nombre de nos réunions, plus de 150, ce qui veut dire que nous nous sommes réunis tous les jours, parfois plusieurs fois par jour jusqu'au mois de juillet. À travers ces délibérations, ces doutes, ces échanges, cette recherche d'angles d'attaque qui n'ont pas été examinés, on finit par construire une pensée collective, qui est un amalgame d'éléments connus de certains d'entre nous - je suis très impressionné, à titre personnel, par la qualité de mes collègues -, fondés sur leurs connaissances scientifiques ou sur leur expérience de clinicien, etc., et d'éléments qui ne sont pas connus, qui sont discutés, débattus, très controversés. Voilà le fruit de la délibération.
De manière très concrète aussi, l'écriture de nos avis, que nous assurons nous-mêmes, représente un travail considérable pour stabiliser une forme de pensée collective, la rendre lisible, précise, s'assurer qu'elle embrasse l'ensemble des problèmes. Elle répond aussi à une exigence de transparence, permettant de rendre compte à nos concitoyens du résultat de notre travail scientifique. C'est un travail auquel il faut s'atteler quotidiennement, jusque très tard dans la nuit. Je passe sur le nombre de versions qui ont été nécessaires pour élaborer chaque document. C'est aussi là que se situe l'indépendance : nous avons la maîtrise de l'écrit, de nos délibérations, de nos questionnements, abstraction faite des questions institutionnelles concernant la saisine, l'autosaisine, la position hiérarchique.
Le deuxième point sur lequel je souhaite revenir est l'écart entre le caractère collégial et assez consensuel de nos avis, la convergence de nos points de vue, et un débat public beaucoup plus controversé sur les mêmes thématiques, parfois même illisible, qui suit des dynamiques très difficiles à anticiper, même si, au fil des mois, on observe la récurrence d'un certain nombre de configurations, comme on dit en sociologie. Ce désordre nous frappe aussi, comme n'importe quel citoyen qui cherche de l'information, mais il faut faire avec. D'une certaine manière, il exprime aussi l'autonomie et la liberté d'un certain nombre d'acteurs.
La difficulté tient au fait que, sur ce type de question, on a une conjonction d'autonomies très grandes et très légitimes. La profession médicale, pour des raisons historiques anciennes, dispose d'une très grande autonomie. La profession scientifique, pour des raisons équivalentes, mais un peu différentes, dispose également d'une très grande autonomie - je suis chercheur au CNRS et je me félicite chaque jour de l'autonomie dont je bénéficie dans mon travail scientifique, dans mes questionnements, dans les recherches que je souhaite entreprendre et ce sentiment est partagé par tous les chercheurs de notre pays. Les acteurs de la sphère médiatique disposent aussi très légitimement d'une très grande autonomie dans leur manière d'apprécier les problèmes, d'organiser les discussions ; c'est aussi un gage de notre démocratie.
Ces grandes autonomies se mélangent, s'entrechoquent et répondent à des logiques très différentes. Les logiques du champ médiatique ne sont pas les mêmes que celles du champ médical ou scientifique. Ce qui me frappe, et qui peut appeler une forme de réflexion collective des différentes professions auxquelles j'ai fait référence, c'est la difficulté de la régulation.
Dans le monde médical, la régulation a été compliquée, les divergences sont difficiles à régler, alors que des instances sont prévues et que ces problèmes se posent depuis toujours. Il y a donc une vraie difficulté à aborder ces questions dans un contexte de forte exposition médiatique. On pourrait dire la même chose des instances scientifiques, où existe une forme de régulation sur laquelle on peut s'interroger. Quel est le rôle des régulateurs de la vie scientifique dans la manière dont un certain nombre de positions sont présentées, défendues, organisées, mises en place ? Je ne suis pas un spécialiste de la recherche clinique, mais on a pu observer un certain polycentrisme, pour rester poli, voire un certain désordre. Il y a là aussi matière à progresser.
Enfin, dans le domaine de l'expression médiatique, les professionnels eux-mêmes doivent engager une réflexion, peut-être dans un cadre civique, sur la régulation des médias, dont l'autonomie est légitime, mais ne doit pas occulter le fait que sont mises en oeuvre des logiques mercantiles, d'audience, de positionnement, qui induisent des effets problématiques sur le débat en santé publique.
Rendre le conseil scientifique responsable de ce désordre, qu'on a pu qualifier de barnum, me semble un raccourci audacieux et injuste.

Je tiens également à remercier le professeur Delfraissy et les membres du conseil scientifique de nous avoir éclairés durant la gestion de cette crise. Mes questions porteront sur l'état des connaissances.
Professeur, vous avez déclaré, le 24 août : « On peut imaginer des vaccins partiels au premier trimestre 2021. » Le 10 septembre, lors de nos auditions, le professeur Lina m'a semblé plus réservé quant aux dates de sortie des vaccins. Qu'est-ce qu'un vaccin partiel ? Pouvez-vous préciser votre idée ?
J'aimerais également connaître votre avis sur l'origine du covid-19. Vous avez dit que vous aviez participé à une réunion de l'OMS en février et que vous aviez trouvé que les Chinois « ne racontaient pas grand-chose ».

Je tiens également à remercier le professeur Delfraissy et les membres du conseil scientifique de nous avoir éclairés durant la gestion de cette crise. Mes questions porteront sur l'état des connaissances.
Professeur, vous avez déclaré, le 24 août : « On peut imaginer des vaccins partiels au premier trimestre 2021. » Le 10 septembre, lors de nos auditions, le professeur Lina m'a semblé plus réservé quant aux dates de sortie des vaccins. Qu'est-ce qu'un vaccin partiel ? Pouvez-vous préciser votre idée ?
J'aimerais également connaître votre avis sur l'origine du covid-19. Vous avez dit que vous aviez participé à une réunion de l'OMS en février et que vous aviez trouvé que les Chinois « ne racontaient pas grand-chose ».
S'agissant des vaccins, vous avez tous compris que nous sommes dans un modèle de construction vaccinal très différent du modèle habituel : de grands groupes pharmaceutiques, s'appuyant sur les recherches de start-up ou de grandes universités comme Oxford, ont décidé d'expérimenter un certain nombre de candidats vaccins, en suivant les phases 1, 2 et 3 habituelles, et de mettre en place, dans le même temps, les outils industriels permettant une production de vaccin à haut niveau. C'est du jamais vu. D'habitude, les industriels attendent les premiers résultats de leurs produits, vaccins ou médicaments, avant de s'engager dans un processus industriel. Ils prennent donc deux risques, mais demandent aux pays de les « financer » en passant commande de millions de doses, ce qui leur permet d'investir dans l'outil industriel. On a donc un nouveau modèle où l'élaboration d'un vaccin et l'outil industriel se construisent en même temps.
Parmi les différents candidats vaccins, un certain nombre restera sur le carreau. Pour le covid-19, deux types de vaccins sont possibles. Un premier modèle permet de diminuer la gravité des formes sévères chez les patients les plus à risques, ce qui n'est pas très habituel dans la stratégie vaccinale ; le deuxième modèle, plus classique, correspond à des vaccins préventifs qui évitent la transmission d'une personne à une autre. J'ai voulu indiquer que, compte tenu de la dynamique particulière observée et de l'effort considérable entrepris, on peut imaginer que, parmi les sept grands candidats vaccins, deux ou trois donnent de premiers résultats dans le premier trimestre de 2021, pour un vaccin qui aurait une efficacité en termes de transmission de l'ordre de 50 %, par exemple, mais qui permettrait peut-être de réduire la fréquence et la sévérité des formes graves, ce qui serait un élément essentiel, puisque la maladie est bénigne dans 90 % à 92% des cas. Je ne pense pas que Bruno Lina soit en contradiction avec moi sur ce point. Quoi qu'il en soit, le conseil scientifique s'appuie sur les données dont il dispose, mais il ne lit pas dans une boule de cristal ; il y a donc une part de risque à donner une date. Je pense néanmoins que l'évolution sera plus rapide que dans les stratégies vaccinales habituelles.
Sur l'origine du covid-19, je sais qu'il y a eu beaucoup de débats sur l'hypothèse d'un virus qui se serait échappé du laboratoire P4 de Wuhan. Je n'ai aucune opinion sur ce scénario, si ce n'est que ce laboratoire répondait à des critères de sécurité de très haut niveau et que les technologies chinoises ont également atteint un très haut niveau. Je maintiens ma position sur le fait que les Chinois nous disent ce qu'ils veulent et que leur communication scientifique, tout en respectant les conditions habituelles, est quand même sous contrôle. Sur le fond, on peut imaginer qu'il s'agit du schéma habituel d'un virus porté par une chauve-souris, qui passe par un porteur animal avec une rupture de la barrière d'espèce, phénomène qu'on ne comprend pas encore très bien, et atteint l'homme.
S'agissant des vaccins, vous avez tous compris que nous sommes dans un modèle de construction vaccinal très différent du modèle habituel : de grands groupes pharmaceutiques, s'appuyant sur les recherches de start-up ou de grandes universités comme Oxford, ont décidé d'expérimenter un certain nombre de candidats vaccins, en suivant les phases 1, 2 et 3 habituelles, et de mettre en place, dans le même temps, les outils industriels permettant une production de vaccin à haut niveau. C'est du jamais vu. D'habitude, les industriels attendent les premiers résultats de leurs produits, vaccins ou médicaments, avant de s'engager dans un processus industriel. Ils prennent donc deux risques, mais demandent aux pays de les « financer » en passant commande de millions de doses, ce qui leur permet d'investir dans l'outil industriel. On a donc un nouveau modèle où l'élaboration d'un vaccin et l'outil industriel se construisent en même temps.
Parmi les différents candidats vaccins, un certain nombre restera sur le carreau. Pour le covid-19, deux types de vaccins sont possibles. Un premier modèle permet de diminuer la gravité des formes sévères chez les patients les plus à risques, ce qui n'est pas très habituel dans la stratégie vaccinale ; le deuxième modèle, plus classique, correspond à des vaccins préventifs qui évitent la transmission d'une personne à une autre. J'ai voulu indiquer que, compte tenu de la dynamique particulière observée et de l'effort considérable entrepris, on peut imaginer que, parmi les sept grands candidats vaccins, deux ou trois donnent de premiers résultats dans le premier trimestre de 2021, pour un vaccin qui aurait une efficacité en termes de transmission de l'ordre de 50 %, par exemple, mais qui permettrait peut-être de réduire la fréquence et la sévérité des formes graves, ce qui serait un élément essentiel, puisque la maladie est bénigne dans 90 % à 92% des cas. Je ne pense pas que Bruno Lina soit en contradiction avec moi sur ce point. Quoi qu'il en soit, le conseil scientifique s'appuie sur les données dont il dispose, mais il ne lit pas dans une boule de cristal ; il y a donc une part de risque à donner une date. Je pense néanmoins que l'évolution sera plus rapide que dans les stratégies vaccinales habituelles.
Sur l'origine du covid-19, je sais qu'il y a eu beaucoup de débats sur l'hypothèse d'un virus qui se serait échappé du laboratoire P4 de Wuhan. Je n'ai aucune opinion sur ce scénario, si ce n'est que ce laboratoire répondait à des critères de sécurité de très haut niveau et que les technologies chinoises ont également atteint un très haut niveau. Je maintiens ma position sur le fait que les Chinois nous disent ce qu'ils veulent et que leur communication scientifique, tout en respectant les conditions habituelles, est quand même sous contrôle. Sur le fond, on peut imaginer qu'il s'agit du schéma habituel d'un virus porté par une chauve-souris, qui passe par un porteur animal avec une rupture de la barrière d'espèce, phénomène qu'on ne comprend pas encore très bien, et atteint l'homme.

Si la stratégie vaccinale permet d'éviter seulement 50 % de transmissions, pensez-vous qu'elle soit sociétalement acceptable ?

Si la stratégie vaccinale permet d'éviter seulement 50 % de transmissions, pensez-vous qu'elle soit sociétalement acceptable ?
Il s'agit d'une science en mouvement. Dans un premier temps, on peut avoir un vaccin dont l'efficacité soit partielle. Ce premier candidat vaccin pourra être amélioré par la suite, puisque l'on progresse en marchant. J'ai voulu indiquer que l'on n'aurait pas forcément, dans ce premier trimestre de 2021, le vaccin idéal que nous attendons tous, qui permettrait d'éviter la transmission dans toutes les classes d'âge avec une efficacité de 99 %. On aura d'abord quelque chose d'incomplet.
Il s'agit d'une science en mouvement. Dans un premier temps, on peut avoir un vaccin dont l'efficacité soit partielle. Ce premier candidat vaccin pourra être amélioré par la suite, puisque l'on progresse en marchant. J'ai voulu indiquer que l'on n'aurait pas forcément, dans ce premier trimestre de 2021, le vaccin idéal que nous attendons tous, qui permettrait d'éviter la transmission dans toutes les classes d'âge avec une efficacité de 99 %. On aura d'abord quelque chose d'incomplet.

Je remercie également le conseil scientifique pour l'ensemble de son travail. Je poserai trois questions.
Ma première question tient au degré de connaissance. Le conseil scientifique a été installé le 11 mars, après votre travail de sensibilisation du Président de la République. À la fin du mois de janvier, la ministre de la santé, s'appuyant sans doute sur les travaux de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), nous disait que le risque que le virus pénètre en France était très faible. Aviez-vous, dans vos domaines respectifs, le même degré de connaissance ? Dans l'affirmative, cela signifierait que les modélisations de l'Inserm n'étaient pas correctes à l'époque. Dans la négative, quel était votre véritable degré de connaissance ? Pour cette période incertaine, entre janvier et début mars, où l'épidémie était déjà très forte dans la région Grand Est, les associations de patients nous ont dit qu'elles avaient déjà des connaissances. Si le degré de connaissance n'était pas bon en France, que faudrait-il faire pour améliorer, dans le cadre d'une épidémie future, la connaissance de ce qui se passe ailleurs ? Quels étaient les embryons de connaissance et de traitement en Chine ou en Italie ?
Ma deuxième question porte sur la situation actuelle. On a vu, dans la gestion par les soignants de cette épidémie, que la région Île-de-France apprenait de ce qui se faisait dans la région Grand Est, notamment pour l'évolution des traitements de réanimation, l'utilisation des anticoagulants ou des antiinflammatoires. Si l'épidémie repart, comme sa répartition territoriale est plus « lâche » - on trouve des clusters dans l'Aveyron, dans des départements dépourvus de grand centre hospitalier -, qui est chargé de diffuser des guides, des modèles ou des consignes ? La HAS, il faut bien le dire, est absente. Bien sûr, les conseils et les fiches pratiques supposent des connaissances déjà solides, ce qui n'est pas le cas dans le flou actuel. Toutefois, dans le cadre d'une épidémie nouvelle, la prudence a ses limites et entraîne forcément des pertes de chances. A-t-on prévu des échanges de conseils entre les différents réseaux, avec un vrai maillage territorial entre certains hôpitaux et des centres de référence ? Par exemple, les généralistes ont été totalement exclus au départ ; or on sait qu'il existe des biomarqueurs, etc. Qui est chargé de donner les consignes ?
Mon troisième point concerne les essais cliniques : comment peut-on concilier, dans cette épidémie nouvelle marquée par des tâtonnements thérapeutiques, la nécessité d'apporter une réponse rapide aux malades et la conduite de travaux scientifiques robustes pour s'assurer de l'efficacité d'un traitement ? Les essais cliniques n'ont-ils pas pu causer une perte de chances pour ceux qui n'ont pas pu les intégrer ?

Je remercie également le conseil scientifique pour l'ensemble de son travail. Je poserai trois questions.
Ma première question tient au degré de connaissance. Le conseil scientifique a été installé le 11 mars, après votre travail de sensibilisation du Président de la République. À la fin du mois de janvier, la ministre de la santé, s'appuyant sans doute sur les travaux de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), nous disait que le risque que le virus pénètre en France était très faible. Aviez-vous, dans vos domaines respectifs, le même degré de connaissance ? Dans l'affirmative, cela signifierait que les modélisations de l'Inserm n'étaient pas correctes à l'époque. Dans la négative, quel était votre véritable degré de connaissance ? Pour cette période incertaine, entre janvier et début mars, où l'épidémie était déjà très forte dans la région Grand Est, les associations de patients nous ont dit qu'elles avaient déjà des connaissances. Si le degré de connaissance n'était pas bon en France, que faudrait-il faire pour améliorer, dans le cadre d'une épidémie future, la connaissance de ce qui se passe ailleurs ? Quels étaient les embryons de connaissance et de traitement en Chine ou en Italie ?
Ma deuxième question porte sur la situation actuelle. On a vu, dans la gestion par les soignants de cette épidémie, que la région Île-de-France apprenait de ce qui se faisait dans la région Grand Est, notamment pour l'évolution des traitements de réanimation, l'utilisation des anticoagulants ou des antiinflammatoires. Si l'épidémie repart, comme sa répartition territoriale est plus « lâche » - on trouve des clusters dans l'Aveyron, dans des départements dépourvus de grand centre hospitalier -, qui est chargé de diffuser des guides, des modèles ou des consignes ? La HAS, il faut bien le dire, est absente. Bien sûr, les conseils et les fiches pratiques supposent des connaissances déjà solides, ce qui n'est pas le cas dans le flou actuel. Toutefois, dans le cadre d'une épidémie nouvelle, la prudence a ses limites et entraîne forcément des pertes de chances. A-t-on prévu des échanges de conseils entre les différents réseaux, avec un vrai maillage territorial entre certains hôpitaux et des centres de référence ? Par exemple, les généralistes ont été totalement exclus au départ ; or on sait qu'il existe des biomarqueurs, etc. Qui est chargé de donner les consignes ?
Mon troisième point concerne les essais cliniques : comment peut-on concilier, dans cette épidémie nouvelle marquée par des tâtonnements thérapeutiques, la nécessité d'apporter une réponse rapide aux malades et la conduite de travaux scientifiques robustes pour s'assurer de l'efficacité d'un traitement ? Les essais cliniques n'ont-ils pas pu causer une perte de chances pour ceux qui n'ont pas pu les intégrer ?
Le conseil scientifique a débuté ses travaux le 10 mars.
Je vous le dis avec beaucoup de simplicité, j'ai eu 72 ans au mois de mai, et je n'avais pas prévu dans mon agenda de m'engager dans une mission aussi active, après avoir notamment travaillé sur le VIH et Ebola.
J'avais une vision des grandes conséquences éthiques de ces épidémies, et j'ai laissé passer le mois de janvier très tranquillement, comme tout le monde d'ailleurs. C'est vraiment après cette réunion à l'OMS, où je me rendais pour autre chose, que j'ai commencé à me « réveiller ». Nous avions pu poser des questions aux Chinois par vidéo-conférence, et j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas clairs. Ils ne répondaient pas à des questions simples : quels patients développent des formes graves ? Sont-ils ventilés ? Combien de temps ? J'ai « gueulé » à l'époque à l'OMS en disant que c'était pour partie de la langue de bois.
Ensuite, des collègues italiens m'ont interpellé mi-février à propos du phénomène d'orage inflammatoire de cytokines. Les Italiens du Nord sont très brillants, et beaucoup plus liés aux équipes américaines que nous le sommes en France.
Enfin, j'ai eu des discussions avec les modélisateurs.
Malgré ma formation scientifique et mon expérience des crises sanitaires, je ne me suis vraiment réveillé que mi-février. Je suis donc très humble sur cette question.
S'agissant des signaux d'alerte en provenance des modèles épidémiologiques, je laisse la parole à Simon Cauchemez.
Le conseil scientifique a débuté ses travaux le 10 mars.
Je vous le dis avec beaucoup de simplicité, j'ai eu 72 ans au mois de mai, et je n'avais pas prévu dans mon agenda de m'engager dans une mission aussi active, après avoir notamment travaillé sur le VIH et Ebola.
J'avais une vision des grandes conséquences éthiques de ces épidémies, et j'ai laissé passer le mois de janvier très tranquillement, comme tout le monde d'ailleurs. C'est vraiment après cette réunion à l'OMS, où je me rendais pour autre chose, que j'ai commencé à me « réveiller ». Nous avions pu poser des questions aux Chinois par vidéo-conférence, et j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas clairs. Ils ne répondaient pas à des questions simples : quels patients développent des formes graves ? Sont-ils ventilés ? Combien de temps ? J'ai « gueulé » à l'époque à l'OMS en disant que c'était pour partie de la langue de bois.
Ensuite, des collègues italiens m'ont interpellé mi-février à propos du phénomène d'orage inflammatoire de cytokines. Les Italiens du Nord sont très brillants, et beaucoup plus liés aux équipes américaines que nous le sommes en France.
Enfin, j'ai eu des discussions avec les modélisateurs.
Malgré ma formation scientifique et mon expérience des crises sanitaires, je ne me suis vraiment réveillé que mi-février. Je suis donc très humble sur cette question.
S'agissant des signaux d'alerte en provenance des modèles épidémiologiques, je laisse la parole à Simon Cauchemez.
Beaucoup de signaux d'alerte sont venus du monde de la modélisation. Dans une analyse faite mi-janvier, les Chinois rapportaient une quarantaine de cas confirmés, mais nous avions déjà six cas à l'international. En réalité, en analysant les flux de passagers, on pouvait déduire de ces six cas qu'il y avait sans doute déjà quelques milliers d'infections sur le territoire chinois. De fait, très rapidement après la parution de cette étude, les Chinois ont revu à la hausse leur nombre de cas déclarés, ce qui constitua un signal très inquiétant pour l'ensemble de la communauté scientifique.
En réalité, pour qui travaille dans ce domaine, les émergences sont assez fréquentes. En 2009, les premières estimations de mortalité de la grippe pandémique de 2009 étaient comprises entre 0,5 et 1 %, c'est-à-dire le taux estimé actuellement pour le covid-19. On a souvent tendance, au démarrage d'une épidémie, à surestimer la mortalité, car on considère surtout les cas sévères qui vont à l'hôpital. L'ensemble de la communauté scientifique a donc été très inquiète au démarrage de la pandémie de 2009. Puis, progressivement, on a vu que la mortalité s'établissait finalement plutôt à 2 pour 10 000.
Au démarrage de l'épidémie, on attendait donc de voir si les signaux de sévérité allaient se confirmer ou pas. On pouvait en effet être dans un scénario de sévérité très importante, avec une mortalité comprise entre 0,5 et 1 %, mais il n'était pas impossible non plus que, progressivement, on constate une sévérité moindre en même temps qu'une meilleure détection des infections. Il y a donc quand même eu une période de doute, où l'on se demandait aussi si les mesures de confinement sans précédent prises en Chine n'allaient pas réussir à stopper la propagation du virus à l'international.
Beaucoup de signaux d'alerte sont venus du monde de la modélisation. Dans une analyse faite mi-janvier, les Chinois rapportaient une quarantaine de cas confirmés, mais nous avions déjà six cas à l'international. En réalité, en analysant les flux de passagers, on pouvait déduire de ces six cas qu'il y avait sans doute déjà quelques milliers d'infections sur le territoire chinois. De fait, très rapidement après la parution de cette étude, les Chinois ont revu à la hausse leur nombre de cas déclarés, ce qui constitua un signal très inquiétant pour l'ensemble de la communauté scientifique.
En réalité, pour qui travaille dans ce domaine, les émergences sont assez fréquentes. En 2009, les premières estimations de mortalité de la grippe pandémique de 2009 étaient comprises entre 0,5 et 1 %, c'est-à-dire le taux estimé actuellement pour le covid-19. On a souvent tendance, au démarrage d'une épidémie, à surestimer la mortalité, car on considère surtout les cas sévères qui vont à l'hôpital. L'ensemble de la communauté scientifique a donc été très inquiète au démarrage de la pandémie de 2009. Puis, progressivement, on a vu que la mortalité s'établissait finalement plutôt à 2 pour 10 000.
Au démarrage de l'épidémie, on attendait donc de voir si les signaux de sévérité allaient se confirmer ou pas. On pouvait en effet être dans un scénario de sévérité très importante, avec une mortalité comprise entre 0,5 et 1 %, mais il n'était pas impossible non plus que, progressivement, on constate une sévérité moindre en même temps qu'une meilleure détection des infections. Il y a donc quand même eu une période de doute, où l'on se demandait aussi si les mesures de confinement sans précédent prises en Chine n'allaient pas réussir à stopper la propagation du virus à l'international.
Dans notre avis du 12 mars, on estimait que la mortalité, en cas d'infection, se situait entre 0,5 et 1 %. Depuis, on a multiplié les analyses à partir des données de mortalité dans 45 pays et l'on reste dans ce même ordre de grandeur, entre 0,5 et 1 %. Toutefois, pour ce virus en particulier, donner un chiffre moyen n'a pas beaucoup de sens, tant la mortalité se retrouve concentrée dans quelques groupes de population. Contrairement à d'autres virus, il ne faut pas juste penser en termes de moyenne, mais vraiment de distribution de mortalité.
Dans notre avis du 12 mars, on estimait que la mortalité, en cas d'infection, se situait entre 0,5 et 1 %. Depuis, on a multiplié les analyses à partir des données de mortalité dans 45 pays et l'on reste dans ce même ordre de grandeur, entre 0,5 et 1 %. Toutefois, pour ce virus en particulier, donner un chiffre moyen n'a pas beaucoup de sens, tant la mortalité se retrouve concentrée dans quelques groupes de population. Contrairement à d'autres virus, il ne faut pas juste penser en termes de moyenne, mais vraiment de distribution de mortalité.
Durant la première phase, en mars, 85 % des décès ont été recensés chez des sujets âgés de plus de 65 ans ou souffrant d'une pathologie préexistante.
A-t-on tiré des leçons pour la prise en charge des patients ? Vous avez donné tous les éléments : les réanimateurs ont appris à mieux prendre en charge les formes graves, ce qui est un classique. Ils essayent en particulier de retarder la ventilation par intubation. On dispose également à présent de résultats solides d'essais portant sur les anti-inflammatoires de type corticoïdes et aussi, dans une certaine mesure, sur les anti-récepteurs de l'IL-6. On en sait plus aussi sur le problème de la coagulation.
Dans notre avis n° 8 du mois de juillet, on a indiqué que la recherche devait dès début août lister les questions et anticiper sur ce qui se passerait avec les formes graves à la mi-septembre. Yazdan Yazdanpanah vous en parlera certainement cet après-midi. J'ai vérifié il y a quatre jours : les consignes sont données par les sociétés savantes, soit en passant par la Haute Autorité de Santé, soit par le Haut Conseil de la santé publique. Et quand il s'agit d'une consigne très médicale, très technique, ce sont souvent les sociétés savantes elles-mêmes qui la diffusent. En l'occurrence, la société des anesthésistes-réanimateurs s'est regroupée avec la société des infectiologues et celle des gériatres. Ces sociétés savantes viennent de publier des recommandations pour la prise en charge uniforme et relativement homogène des formes sévères dans l'épidémie actuelle.
Pour les médecins généralistes, il y a en effet eu un flottement, vous l'avez souligné. Sur l'organisation des essais thérapeutiques, un médecin généraliste fait désormais partie du conseil scientifique de REACTing. Pour les essais thérapeutiques qui seront menés à partir du mois de septembre, les deux ministères viennent de décider que les médecins généralistes seraient mieux associés qu'au mois d'avril.
Comment peut-on mener des essais cliniques de qualité dans une situation de crise sanitaire ? Je n'ai pas totalement la réponse. Pour Ebola, j'avais même écrit que, dans certaines circonstances, on pouvait être amené à prendre un certain nombre de décisions qui ne relèvent pas de l'essai clinique randomisé. Mais rappelons que la mortalité d'Ebola était initialement de l'ordre de 75 %. Et même dans Ebola, nous avons manqué finalement d'un grand essai randomisé qui nous permette de trancher définitivement sur le type de médicaments qui pouvait être utilisé.
Il me semble donc qu'il faut respecter au maximum les bonnes pratiques cliniques qui existent, y compris en situation de crise sanitaire. Il faut certes les moduler et faire en sorte qu'un maximum de patients puisse être inclus dans les essais, de façon à apporter une réponse la plus rapide possible.
Cela a-t-il été totalement réalisé ? Non, car c'est difficile. Les Anglais l'ont mieux fait que nous, puisque le National Health Service (NHS) a imposé que les essais thérapeutiques fassent partie intégrante de la prise en charge. REACTing l'a fait seulement en partie, Yazdan Yazdanpanah vous expliquera pourquoi.
La réponse à la crise sanitaire ne se situe pas seulement au niveau de l'individu, mais aussi du groupe d'individus. On peut finalement préférer attendre un tout petit peu d'avoir une réponse solide au niveau d'un groupe d'individus pour mieux traiter ensuite un individu donné.
Mais c'est une vraie question relevant de l'éthique de la recherche.
Durant la première phase, en mars, 85 % des décès ont été recensés chez des sujets âgés de plus de 65 ans ou souffrant d'une pathologie préexistante.
A-t-on tiré des leçons pour la prise en charge des patients ? Vous avez donné tous les éléments : les réanimateurs ont appris à mieux prendre en charge les formes graves, ce qui est un classique. Ils essayent en particulier de retarder la ventilation par intubation. On dispose également à présent de résultats solides d'essais portant sur les anti-inflammatoires de type corticoïdes et aussi, dans une certaine mesure, sur les anti-récepteurs de l'IL-6. On en sait plus aussi sur le problème de la coagulation.
Dans notre avis n° 8 du mois de juillet, on a indiqué que la recherche devait dès début août lister les questions et anticiper sur ce qui se passerait avec les formes graves à la mi-septembre. Yazdan Yazdanpanah vous en parlera certainement cet après-midi. J'ai vérifié il y a quatre jours : les consignes sont données par les sociétés savantes, soit en passant par la Haute Autorité de Santé, soit par le Haut Conseil de la santé publique. Et quand il s'agit d'une consigne très médicale, très technique, ce sont souvent les sociétés savantes elles-mêmes qui la diffusent. En l'occurrence, la société des anesthésistes-réanimateurs s'est regroupée avec la société des infectiologues et celle des gériatres. Ces sociétés savantes viennent de publier des recommandations pour la prise en charge uniforme et relativement homogène des formes sévères dans l'épidémie actuelle.
Pour les médecins généralistes, il y a en effet eu un flottement, vous l'avez souligné. Sur l'organisation des essais thérapeutiques, un médecin généraliste fait désormais partie du conseil scientifique de REACTing. Pour les essais thérapeutiques qui seront menés à partir du mois de septembre, les deux ministères viennent de décider que les médecins généralistes seraient mieux associés qu'au mois d'avril.
Comment peut-on mener des essais cliniques de qualité dans une situation de crise sanitaire ? Je n'ai pas totalement la réponse. Pour Ebola, j'avais même écrit que, dans certaines circonstances, on pouvait être amené à prendre un certain nombre de décisions qui ne relèvent pas de l'essai clinique randomisé. Mais rappelons que la mortalité d'Ebola était initialement de l'ordre de 75 %. Et même dans Ebola, nous avons manqué finalement d'un grand essai randomisé qui nous permette de trancher définitivement sur le type de médicaments qui pouvait être utilisé.
Il me semble donc qu'il faut respecter au maximum les bonnes pratiques cliniques qui existent, y compris en situation de crise sanitaire. Il faut certes les moduler et faire en sorte qu'un maximum de patients puisse être inclus dans les essais, de façon à apporter une réponse la plus rapide possible.
Cela a-t-il été totalement réalisé ? Non, car c'est difficile. Les Anglais l'ont mieux fait que nous, puisque le National Health Service (NHS) a imposé que les essais thérapeutiques fassent partie intégrante de la prise en charge. REACTing l'a fait seulement en partie, Yazdan Yazdanpanah vous expliquera pourquoi.
La réponse à la crise sanitaire ne se situe pas seulement au niveau de l'individu, mais aussi du groupe d'individus. On peut finalement préférer attendre un tout petit peu d'avoir une réponse solide au niveau d'un groupe d'individus pour mieux traiter ensuite un individu donné.
Mais c'est une vraie question relevant de l'éthique de la recherche.

La France compte globalement 40 000 morts, si l'on intègre les décès à domicile. Cela fait réfléchir. Ne nous sommes-nous pas trompés dès le départ ? Si l'on regarde les États qui ont mieux réussi que nous, on trouve d'une part les États autoritaires, qui ont pris des mesures d'une telle vigueur qu'ils ont effectivement réussi à limiter la propagation du virus, et d'autre part les États dans lesquels les dirigeants politiques se sont contentés de suivre strictement les recommandations des instances scientifiques. Curieusement, nous n'avons choisi ni l'un ni l'autre. Nous avons souvent louvoyé, donnant un sentiment de confusion à l'opinion publique, cela étant renforcé par des débats télévisés assez chaotiques où chacun venait dire sa part de vérité.
N'aurait-il pas été plus simple de suivre les avis objectifs, travaillés et neutres du conseil scientifique ? Ainsi, la semaine dernière, au vu de la remontée des contaminations, vous avez déclaré, monsieur Delfraissy, que le Gouvernement allait devoir annoncer des mesures fortes pour empêcher la pandémie de repartir. Mais finalement, lors de sa conférence de presse, le Premier ministre n'a fait aucune annonce.
N'y a-t-il pas là un vrai problème ? Pour redonner confiance aux Français, ne faut-il pas donner le sentiment que le politique et le scientifique travaillent réellement ensemble ?

La France compte globalement 40 000 morts, si l'on intègre les décès à domicile. Cela fait réfléchir. Ne nous sommes-nous pas trompés dès le départ ? Si l'on regarde les États qui ont mieux réussi que nous, on trouve d'une part les États autoritaires, qui ont pris des mesures d'une telle vigueur qu'ils ont effectivement réussi à limiter la propagation du virus, et d'autre part les États dans lesquels les dirigeants politiques se sont contentés de suivre strictement les recommandations des instances scientifiques. Curieusement, nous n'avons choisi ni l'un ni l'autre. Nous avons souvent louvoyé, donnant un sentiment de confusion à l'opinion publique, cela étant renforcé par des débats télévisés assez chaotiques où chacun venait dire sa part de vérité.
N'aurait-il pas été plus simple de suivre les avis objectifs, travaillés et neutres du conseil scientifique ? Ainsi, la semaine dernière, au vu de la remontée des contaminations, vous avez déclaré, monsieur Delfraissy, que le Gouvernement allait devoir annoncer des mesures fortes pour empêcher la pandémie de repartir. Mais finalement, lors de sa conférence de presse, le Premier ministre n'a fait aucune annonce.
N'y a-t-il pas là un vrai problème ? Pour redonner confiance aux Français, ne faut-il pas donner le sentiment que le politique et le scientifique travaillent réellement ensemble ?

Ma question, assez voisine, part du constat que le système français n'était pas prêt. Mais l'a-t-il un jour été ? Avons-nous baissé la garde sous la pression économique ou pour d'autres raisons ? Quel pays est aujourd'hui le mieux préparé ?

Ma question, assez voisine, part du constat que le système français n'était pas prêt. Mais l'a-t-il un jour été ? Avons-nous baissé la garde sous la pression économique ou pour d'autres raisons ? Quel pays est aujourd'hui le mieux préparé ?

Monsieur Delfraissy, quelles ont été vos relations avec les instances de démocratie sanitaire ?
Vous dites qu'il y a eu très peu d'innovation thérapeutique. En revanche, il y en a eu dans le domaine du diagnostic et du dépistage. Avez-vous déjà évalué les différents tests ? Quels sont les plus pertinents aujourd'hui ? Aviez-vous connaissance des moyens humains et matériels dont disposaient les laboratoires de biologie quand vous avez conseillé au Gouvernement de multiplier les dépistages ?
Concernant la dimension stratégique et géopolitique, avez-vous pris en compte la situation de l'archipel France, avec ses territoires d'outre-mer, particulièrement la Guyane, terre française en Amérique du Sud. Avez-vous à un moment donné pris en compte les difficultés liées aux différentes frontières, qui n'ont pas été gérées de la même manière dans l'Hexagone et outre-mer ?
On a constaté également que certaines personnes étaient contaminées une seconde fois. Concernant la production des anticorps et la réponse immunitaire, dans la perspective d'un vaccin, allez-vous suggérer que des recherches soient menées sur les personnes qui ont déjà eu le covid, pour voir quelle est leur réponse immunitaire et s'il apparaît opportun de les vacciner ?

Monsieur Delfraissy, quelles ont été vos relations avec les instances de démocratie sanitaire ?
Vous dites qu'il y a eu très peu d'innovation thérapeutique. En revanche, il y en a eu dans le domaine du diagnostic et du dépistage. Avez-vous déjà évalué les différents tests ? Quels sont les plus pertinents aujourd'hui ? Aviez-vous connaissance des moyens humains et matériels dont disposaient les laboratoires de biologie quand vous avez conseillé au Gouvernement de multiplier les dépistages ?
Concernant la dimension stratégique et géopolitique, avez-vous pris en compte la situation de l'archipel France, avec ses territoires d'outre-mer, particulièrement la Guyane, terre française en Amérique du Sud. Avez-vous à un moment donné pris en compte les difficultés liées aux différentes frontières, qui n'ont pas été gérées de la même manière dans l'Hexagone et outre-mer ?
On a constaté également que certaines personnes étaient contaminées une seconde fois. Concernant la production des anticorps et la réponse immunitaire, dans la perspective d'un vaccin, allez-vous suggérer que des recherches soient menées sur les personnes qui ont déjà eu le covid, pour voir quelle est leur réponse immunitaire et s'il apparaît opportun de les vacciner ?

On entend toujours dire que le temps du politique est différent de celui des médias et des scientifiques. Vous avez dit, professeur Delfraissy, que la science se construisait sur les incertitudes. Je ne suis pas sûre que la politique ne se construise pas non plus sur des incertitudes, et ce depuis très longtemps. Il me semble que le rôle du politique est justement de gérer ces incertitudes.
Sur ces incertitudes, justement, nous avons entendu le docteur Crozier, qui nous a parlé d'éthique, et nous avons pris connaissance également de l'avis n° 106 du Comité consultatif national d'éthique (CCNE), qui explique que le questionnement éthique amène souvent à confronter le principe d'autonomie et l'exigence de solidarité. Avec les pandémies, nous sommes au coeur du sujet.
Qu'il s'agisse de la situation politique internationale ou de l'évolution de notre société, notamment de la prise en compte de la précarité dans un contexte de pandémies, ne faut-il pas justement mettre en place des conseils scientifiques faisant également appel aux sciences humaines et sociales, et pas seulement économiques ?
Plus terre à terre, s'agissant de l'organisation, vous avez déclaré : « Il manquait sans doute quelque chose, on a fait le conseil scientifique. » Ne faudrait-il pas réfléchir aujourd'hui à un changement d'organisation ? Nous avons l'ARS, le préfet, Santé publique France... Mme Buzyn, lors de son audition à l'Assemblée nationale, disait que la gestion du stock stratégique de masques de protection ne revenait pas au ministre, mais à l'agence Santé publique France, que les compétences de gestion de crise avaient été diluées, avec pour conséquence un manque de réactivité et qu'il fallait requestionner le rôle des agences sanitaires. Elle préconise une agence dédiée aux crises en général, et pas seulement sanitaires. Quel est votre avis sur ce point ?
Enfin, faut-il continuer à fermer des lits d'hôpitaux ?

On entend toujours dire que le temps du politique est différent de celui des médias et des scientifiques. Vous avez dit, professeur Delfraissy, que la science se construisait sur les incertitudes. Je ne suis pas sûre que la politique ne se construise pas non plus sur des incertitudes, et ce depuis très longtemps. Il me semble que le rôle du politique est justement de gérer ces incertitudes.
Sur ces incertitudes, justement, nous avons entendu le docteur Crozier, qui nous a parlé d'éthique, et nous avons pris connaissance également de l'avis n° 106 du Comité consultatif national d'éthique (CCNE), qui explique que le questionnement éthique amène souvent à confronter le principe d'autonomie et l'exigence de solidarité. Avec les pandémies, nous sommes au coeur du sujet.
Qu'il s'agisse de la situation politique internationale ou de l'évolution de notre société, notamment de la prise en compte de la précarité dans un contexte de pandémies, ne faut-il pas justement mettre en place des conseils scientifiques faisant également appel aux sciences humaines et sociales, et pas seulement économiques ?
Plus terre à terre, s'agissant de l'organisation, vous avez déclaré : « Il manquait sans doute quelque chose, on a fait le conseil scientifique. » Ne faudrait-il pas réfléchir aujourd'hui à un changement d'organisation ? Nous avons l'ARS, le préfet, Santé publique France... Mme Buzyn, lors de son audition à l'Assemblée nationale, disait que la gestion du stock stratégique de masques de protection ne revenait pas au ministre, mais à l'agence Santé publique France, que les compétences de gestion de crise avaient été diluées, avec pour conséquence un manque de réactivité et qu'il fallait requestionner le rôle des agences sanitaires. Elle préconise une agence dédiée aux crises en général, et pas seulement sanitaires. Quel est votre avis sur ce point ?
Enfin, faut-il continuer à fermer des lits d'hôpitaux ?
Le modèle français de relations entre le comité scientifique et le politique était-il le bon ? Il me semble encore trop tôt pour tirer toutes les leçons de la crise. Le nombre de décès pour 100 000 habitants sera un chiffre important. La France se situera probablement en cinquième ou sixième position parmi les grandes puissances mondiales. Je rappelle que c'est la plus grande puissance mondiale, les États-Unis, qui va se trouver en tête.
Un autre élément déterminant sera le retentissement économique et sociétal. Parmi les enjeux sanitaires, il faut distinguer ceux qui sont liés directement au covid, avec une reprise possible de l'épidémie, et ceux que l'on pourrait qualifier de « covid - ». Il est impossible aujourd'hui, comme au mois de mars, de dédier 90 à 95 % des services de réanimation au covid. À Marseille ou Bordeaux, on fera peut-être le choix d'affecter 30 % de lits au covid. Sinon, nous aurions une sur-morbidité liée à des affections autres que le covid.
Nous sommes des citoyens comme vous, et nous sommes persuadés que le sanitaire ne doit pas tout dominer.
Ensuite, s'agissant de notre relation avec le politique, je l'ai dit en toute franchise, les relations se sont construites avec une certaine forme de sérénité, et l'immense majorité des préconisations du conseil scientifique ont été suivies, sauf sur trois points que j'ai rappelés.
Premièrement, on avait une vision quelque peu différente de l'ouverture des écoles au mois de mai.
Deuxièmement, sur la place du comité citoyen et de la société civile pour aider à éclairer une décision, nous n'avons pas du tout été suivis.
Troisièmement, dans l'évaluation actuelle de la reprise ou pas de l'épidémie, on reste quand même dans la nuance. Nous avions indiqué qu'il fallait s'intéresser aux grandes métropoles et construire une réaction des élus de ces métropoles avec les ARS et les préfets. C'est ce qui est en train de se faire à Marseille, Bordeaux, peut-être demain à Rennes. Globalement, il n'y a donc pas eu la dissociation que vous envisagez. Mais c'est toujours difficile. Le comité scientifique a une certaine responsabilité et fait passer certains messages. Mais comment le politique, qui a une vision plus globale, les prend ensuite en compte ? Certains pays européens ont-ils mieux marché que nous ? Oui, notamment l'Allemagne, pour des raisons à la fois culturelles et d'organisation des Länder. Ce pays dispose aussi d'un nombre de lits de réanimation pour 10 000 habitants très largement supérieur au nôtre. Les ratios sont comparables à ceux dont nous disposons en région parisienne, lesquels sont très largement supérieurs à ceux de la province.
N'oublions pas non plus que sur les deux grands enjeux de lutte contre l'épidémie, à savoir la distanciation physique et la capacité à tester, tracer et isoler, les Allemands ont été plus sages que nous. Ils ont aussi testé beaucoup plus rapidement que nous, fin janvier et courant février.
Il y a eu enfin un facteur malchance pour la France, l'épisode de Mulhouse. Arnaud Fontanet vous l'a sans doute déjà dit : sans cet épisode, nous serions vraisemblablement dans une situation intermédiaire.
Sur la démocratie sanitaire, je laisse la parole à Marie-Aleth Grard et Daniel Benamouzig.
Le modèle français de relations entre le comité scientifique et le politique était-il le bon ? Il me semble encore trop tôt pour tirer toutes les leçons de la crise. Le nombre de décès pour 100 000 habitants sera un chiffre important. La France se situera probablement en cinquième ou sixième position parmi les grandes puissances mondiales. Je rappelle que c'est la plus grande puissance mondiale, les États-Unis, qui va se trouver en tête.
Un autre élément déterminant sera le retentissement économique et sociétal. Parmi les enjeux sanitaires, il faut distinguer ceux qui sont liés directement au covid, avec une reprise possible de l'épidémie, et ceux que l'on pourrait qualifier de « covid - ». Il est impossible aujourd'hui, comme au mois de mars, de dédier 90 à 95 % des services de réanimation au covid. À Marseille ou Bordeaux, on fera peut-être le choix d'affecter 30 % de lits au covid. Sinon, nous aurions une sur-morbidité liée à des affections autres que le covid.
Nous sommes des citoyens comme vous, et nous sommes persuadés que le sanitaire ne doit pas tout dominer.
Ensuite, s'agissant de notre relation avec le politique, je l'ai dit en toute franchise, les relations se sont construites avec une certaine forme de sérénité, et l'immense majorité des préconisations du conseil scientifique ont été suivies, sauf sur trois points que j'ai rappelés.
Premièrement, on avait une vision quelque peu différente de l'ouverture des écoles au mois de mai.
Deuxièmement, sur la place du comité citoyen et de la société civile pour aider à éclairer une décision, nous n'avons pas du tout été suivis.
Troisièmement, dans l'évaluation actuelle de la reprise ou pas de l'épidémie, on reste quand même dans la nuance. Nous avions indiqué qu'il fallait s'intéresser aux grandes métropoles et construire une réaction des élus de ces métropoles avec les ARS et les préfets. C'est ce qui est en train de se faire à Marseille, Bordeaux, peut-être demain à Rennes. Globalement, il n'y a donc pas eu la dissociation que vous envisagez. Mais c'est toujours difficile. Le comité scientifique a une certaine responsabilité et fait passer certains messages. Mais comment le politique, qui a une vision plus globale, les prend ensuite en compte ? Certains pays européens ont-ils mieux marché que nous ? Oui, notamment l'Allemagne, pour des raisons à la fois culturelles et d'organisation des Länder. Ce pays dispose aussi d'un nombre de lits de réanimation pour 10 000 habitants très largement supérieur au nôtre. Les ratios sont comparables à ceux dont nous disposons en région parisienne, lesquels sont très largement supérieurs à ceux de la province.
N'oublions pas non plus que sur les deux grands enjeux de lutte contre l'épidémie, à savoir la distanciation physique et la capacité à tester, tracer et isoler, les Allemands ont été plus sages que nous. Ils ont aussi testé beaucoup plus rapidement que nous, fin janvier et courant février.
Il y a eu enfin un facteur malchance pour la France, l'épisode de Mulhouse. Arnaud Fontanet vous l'a sans doute déjà dit : sans cet épisode, nous serions vraisemblablement dans une situation intermédiaire.
Sur la démocratie sanitaire, je laisse la parole à Marie-Aleth Grard et Daniel Benamouzig.
Je ne suis ni scientifique ni médecin, je suis présidente d'ATD Quart Monde et j'ai été nommée dans le conseil scientifique par le président Larcher pour que les plus pauvres ne soient pas les oubliés de cette crise sanitaire.
Dès le premier jour, dans nos réunions journalières par téléphone, j'ai été frappée par l'attention de mes collègues à cette problématique. Dans chacun des avis du Conseil, nous avons fait des préconisations pour porter l'attention du politique sur les plus pauvres dans cette crise sanitaire - logement, bureaux de poste, etc.
Au début de cette crise sanitaire, il y avait dans notre pays 9,3 millions de personnes qui vivaient sous le seuil de pauvreté. À ce jour, nous n'avons pas encore les chiffres, mais les associations envisagent plutôt un chiffre dépassant les 10 millions de personnes. À ce jour, malheureusement, les plus pauvres sont vraiment les grands oubliés du plan de relance. Les quelques miettes qui leur ont été distribuées, avec les 100 euros d'allocation de rentrée scolaire, ne suivent pas du tout les décisions prises par le politique pendant le confinement. C'est pour moi une grande déception, que je me permets de partager avec vous ce matin.
Je ne suis ni scientifique ni médecin, je suis présidente d'ATD Quart Monde et j'ai été nommée dans le conseil scientifique par le président Larcher pour que les plus pauvres ne soient pas les oubliés de cette crise sanitaire.
Dès le premier jour, dans nos réunions journalières par téléphone, j'ai été frappée par l'attention de mes collègues à cette problématique. Dans chacun des avis du Conseil, nous avons fait des préconisations pour porter l'attention du politique sur les plus pauvres dans cette crise sanitaire - logement, bureaux de poste, etc.
Au début de cette crise sanitaire, il y avait dans notre pays 9,3 millions de personnes qui vivaient sous le seuil de pauvreté. À ce jour, nous n'avons pas encore les chiffres, mais les associations envisagent plutôt un chiffre dépassant les 10 millions de personnes. À ce jour, malheureusement, les plus pauvres sont vraiment les grands oubliés du plan de relance. Les quelques miettes qui leur ont été distribuées, avec les 100 euros d'allocation de rentrée scolaire, ne suivent pas du tout les décisions prises par le politique pendant le confinement. C'est pour moi une grande déception, que je me permets de partager avec vous ce matin.

Si vous me permettez, monsieur le président, je n'ai pas obtenu de réponse à ma question portant sur la démocratie sanitaire, en particulier le rôle des conférences de santé et de l'autonomie et des commissions spécialisées des droits des usagers.

Si vous me permettez, monsieur le président, je n'ai pas obtenu de réponse à ma question portant sur la démocratie sanitaire, en particulier le rôle des conférences de santé et de l'autonomie et des commissions spécialisées des droits des usagers.
La question de la démocratie sanitaire, et plus généralement du lien entre les professionnels de santé et le reste des citoyens, est un point extrêmement important. Dans la situation d'urgence qu'on a connue au printemps, force est de constater que ce lien ne s'est pas fait selon les modalités prévues. Cette difficulté doit tous nous interroger, y compris sur la capacité de ces institutions à s'emparer d'un certain nombre de sujets. Elles sont supposées aussi avoir une capacité d'interpellation, de participation active au débat public, et cela peut appeler une réflexion à froid sur leur place et leur rôle dans le système de santé auprès des différentes institutions existantes.
Pour ce qui nous concerne, à l'échelle qui est la nôtre, on a constamment appelé dans nos avis au renforcement de ce dialogue. Il n'est pas trop tard. On entre dans une logique plus territoriale, qui a vocation aussi à impliquer des élus territoriaux dans l'ensemble des décisions qui sont prises. Il serait assez normal que, dans ce cadre-là, une parole citoyenne soit constituée. Nous y serions très favorables et nous nous sommes déjà prononcés en ce sens à plusieurs reprises. Il y a certainement des éléments qui sont améliorables. Il y a aussi des choses qui ont été faites. À titre personnel, je représente le conseil scientifique dans un comité de contrôle et de liaison qui a été créé pour contrôler en particulier les aspects numériques, présidé par un éminent collègue, par ailleurs président de la Conférence nationale de santé. C'est un premier pas, même si le mandat est à mon sens un peu restrictif sur une question importante qui mériterait sans doute une réflexion plus large.
Il a par ailleurs été mentionné très justement que différentes dimensions sociales au sens très large du terme, qui excèdent la dimension sanitaire, gagneraient à être prises en compte. Nous sommes deux spécialistes en sciences sociales, nous ne sommes pas économistes et nous travaillons en étroite liaison avec une collègue anthropologue, qui a également abordé un certain nombre de questions importantes.
Quel est notre rôle ? Par formation, nous regardons tous les phénomènes sociaux comme des phénomènes stratifiés socialement. Les citoyens ne sont pas égaux vis-à-vis de l'information, des services de santé, des risques que l'on subit. Nous examinons systématiquement cette dimension, et c'est pour cette raison aussi que nous pouvons être attentifs à certaines catégories particulièrement vulnérables de notre population, pour des raisons médicales ou sociales.
Ensuite, nous avons alerté très tôt sur des dimensions qui dépassent les aspects médicaux. Je ne pense pas seulement à la dimension économique, mais aussi aux risques psychiques, ou à ce qui se passe malheureusement une fois que la médecine a échoué et que le décès intervient. Sur différents sujets de ce type, nous avons consulté et alerté dans nos avis.
Enfin, la question a été posée de savoir si ce relatif degré d'impréparation qu'on a tous vécu venait de loin. Oui, je crois qu'il vient de loin, et même de très loin. Notre système de santé, pour des raisons historiques, compréhensibles, débattues à différents moments de notre histoire, est un système très curatif. Le président Delfraissy, devant l'Assemblée nationale, a insisté à très juste raison selon moi sur le déficit de capacités et de moyens en matière de santé publique. Il existe certains acteurs de santé publique, qui ont d'ailleurs vu leurs moyens réduits au fil des années par différentes lois de financement de la sécurité sociale, de manière relativement régulière. Mais, surtout, un certain nombre d'acteurs n'ont jamais été créés. La santé communautaire au niveau local est balbutiante. Quand on a réfléchi aux modalités de dépistage et de traçage, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'acteurs opérationnels. Nous avons aussi appelé à une action en ce sens dans nos différents avis.
Plus généralement, de mon point de vue personnel, la santé publique n'est pas à la hauteur des vulnérabilités auxquelles nos sociétés sont désormais exposées. L'épisode que nous traversons aujourd'hui est un épisode dramatique, mais nous pourrions en connaître d'autres au moins aussi dramatiques. Je ne suis pas sûr que le système de soins suffise à y faire face, en dépit de son excellence et du dévouement des professionnels.
La question de la santé publique, en tant que domaine de recherche, de formation et de recrutement d'un certain nombre de professionnels, mais aussi en termes d'organisation, y compris à l'échelle territoriale, excède de très loin la seule question des agences sanitaires et de leur rôle de surveillance, d'animation et d'expertise scientifique.
La question de la démocratie sanitaire, et plus généralement du lien entre les professionnels de santé et le reste des citoyens, est un point extrêmement important. Dans la situation d'urgence qu'on a connue au printemps, force est de constater que ce lien ne s'est pas fait selon les modalités prévues. Cette difficulté doit tous nous interroger, y compris sur la capacité de ces institutions à s'emparer d'un certain nombre de sujets. Elles sont supposées aussi avoir une capacité d'interpellation, de participation active au débat public, et cela peut appeler une réflexion à froid sur leur place et leur rôle dans le système de santé auprès des différentes institutions existantes.
Pour ce qui nous concerne, à l'échelle qui est la nôtre, on a constamment appelé dans nos avis au renforcement de ce dialogue. Il n'est pas trop tard. On entre dans une logique plus territoriale, qui a vocation aussi à impliquer des élus territoriaux dans l'ensemble des décisions qui sont prises. Il serait assez normal que, dans ce cadre-là, une parole citoyenne soit constituée. Nous y serions très favorables et nous nous sommes déjà prononcés en ce sens à plusieurs reprises. Il y a certainement des éléments qui sont améliorables. Il y a aussi des choses qui ont été faites. À titre personnel, je représente le conseil scientifique dans un comité de contrôle et de liaison qui a été créé pour contrôler en particulier les aspects numériques, présidé par un éminent collègue, par ailleurs président de la Conférence nationale de santé. C'est un premier pas, même si le mandat est à mon sens un peu restrictif sur une question importante qui mériterait sans doute une réflexion plus large.
Il a par ailleurs été mentionné très justement que différentes dimensions sociales au sens très large du terme, qui excèdent la dimension sanitaire, gagneraient à être prises en compte. Nous sommes deux spécialistes en sciences sociales, nous ne sommes pas économistes et nous travaillons en étroite liaison avec une collègue anthropologue, qui a également abordé un certain nombre de questions importantes.
Quel est notre rôle ? Par formation, nous regardons tous les phénomènes sociaux comme des phénomènes stratifiés socialement. Les citoyens ne sont pas égaux vis-à-vis de l'information, des services de santé, des risques que l'on subit. Nous examinons systématiquement cette dimension, et c'est pour cette raison aussi que nous pouvons être attentifs à certaines catégories particulièrement vulnérables de notre population, pour des raisons médicales ou sociales.
Ensuite, nous avons alerté très tôt sur des dimensions qui dépassent les aspects médicaux. Je ne pense pas seulement à la dimension économique, mais aussi aux risques psychiques, ou à ce qui se passe malheureusement une fois que la médecine a échoué et que le décès intervient. Sur différents sujets de ce type, nous avons consulté et alerté dans nos avis.
Enfin, la question a été posée de savoir si ce relatif degré d'impréparation qu'on a tous vécu venait de loin. Oui, je crois qu'il vient de loin, et même de très loin. Notre système de santé, pour des raisons historiques, compréhensibles, débattues à différents moments de notre histoire, est un système très curatif. Le président Delfraissy, devant l'Assemblée nationale, a insisté à très juste raison selon moi sur le déficit de capacités et de moyens en matière de santé publique. Il existe certains acteurs de santé publique, qui ont d'ailleurs vu leurs moyens réduits au fil des années par différentes lois de financement de la sécurité sociale, de manière relativement régulière. Mais, surtout, un certain nombre d'acteurs n'ont jamais été créés. La santé communautaire au niveau local est balbutiante. Quand on a réfléchi aux modalités de dépistage et de traçage, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'acteurs opérationnels. Nous avons aussi appelé à une action en ce sens dans nos différents avis.
Plus généralement, de mon point de vue personnel, la santé publique n'est pas à la hauteur des vulnérabilités auxquelles nos sociétés sont désormais exposées. L'épisode que nous traversons aujourd'hui est un épisode dramatique, mais nous pourrions en connaître d'autres au moins aussi dramatiques. Je ne suis pas sûr que le système de soins suffise à y faire face, en dépit de son excellence et du dévouement des professionnels.
La question de la santé publique, en tant que domaine de recherche, de formation et de recrutement d'un certain nombre de professionnels, mais aussi en termes d'organisation, y compris à l'échelle territoriale, excède de très loin la seule question des agences sanitaires et de leur rôle de surveillance, d'animation et d'expertise scientifique.
Ce constat, malheureusement, nous avons dû faire avec. Nous avons tenté d'imaginer des stratégies politiques en fonction des moyens que notre pays a constitués depuis quelques décennies.
L'ampleur de cette crise doit nous appeler à engager une réflexion de fond dans le renforcement de ces différentes dimensions.
Ce constat, malheureusement, nous avons dû faire avec. Nous avons tenté d'imaginer des stratégies politiques en fonction des moyens que notre pays a constitués depuis quelques décennies.
L'ampleur de cette crise doit nous appeler à engager une réflexion de fond dans le renforcement de ces différentes dimensions.
Sur l'outre-mer, nous avons rendu deux avis, dont l'un dès début avril. Je me souviens d'avoir appelé Mme Girardin, et nous avions également organisé une vidéo-conférence avec l'ensemble des préfets et des directeurs des ARS outre-mer. Nous avons rendu un deuxième avis sur le déconfinement outre-mer et le problème des frontières. Ces questions étaient vraiment inscrites à notre agenda. Par ailleurs, Simon Cauchemez a beaucoup travaillé sur les modèles de construction et de réponse qui pouvaient être développés en Guyane fin juillet et début août. Au passage, les expériences de la Guyane et de la Mayenne montrent que, quand on cerne bien les questions, qu'on arrête avec le territoire une série de mesures à prendre, on peut être efficaces. Nous ne devons pas être perdants en permanence. Il faut savoir reprendre la main. On peut parfaitement le faire, même si ce n'est pas facile pour les populations concernées.
S'agissant de la recherche en immunologie, oui, bien sûr, la réponse immunitaire des sujets qui ont déclaré un covid fait l'objet de beaucoup d'études. Elle fait même l'objet d'essais thérapeutiques pour regarder si les anticorps issus des patients convalescents pourraient aider à « guérir » les patients ou à réduire la sévérité des formes graves. Un essai est mené en France ; des données sont également parues en Italie et aux États-Unis. Cela permet d'anticiper ce que pourrait être une réponse vaccinale comme marqueur prédictif au niveau immunologique.
Oui, probablement, madame Guillemot, le politique vit avec l'incertitude, mais ce n'est pas à moi de le dire. Je sais en revanche que la communauté scientifique vit avec l'incertitude. La question pourrait être de savoir comment l'on fait se rejoindre ces deux formes d'incertitude. C'est bien là la complexité du dialogue, mais qui est tout à fait possible à mon avis. Cela pose la question d'une réflexion sur la réponse à apporter aux crises. À mes yeux, si une structure devait voir le jour, une nouvelle « agence » ou un « machin » à la française, elle ne devrait pas être uniquement cantonnée aux crises sanitaires. Il devrait y avoir une réflexion plus globale, à froid, sur la réponse à apporter à la crise.
Ma génération est une génération bénie des dieux, qui a eu 40 ans devant elle avec des aspects extrêmement positifs. Je comprends la jeunesse actuelle qui, dans une certaine mesure, nous dit : « Vous avez vécu une vie extraordinaire, laissez-nous vivre et confinez-vous ! »
Crises économiques, crises sanitaires : nous vivons des crises successives. Nous devons probablement développer une certaine forme de professionnalisation et de capacité à répondre à ces crises sur le plan multidisciplinaire. C'est le politique qui doit décider, bien sûr, toujours, mais il doit pouvoir s'appuyer sur une instance capable de lui fournir de l'information et des modalités de réponse aux crises.
Je ne sais pas s'il faut créer une nouvelle agence, mais, en termes sanitaires, ce qui ressort de cette crise, c'est le problème d'une réorganisation de la santé publique en France. Si l'on regarde les modèles anglo-saxon ou allemand, des pays qui ont un tout petit peu mieux réussi que nous, la santé publique n'est pas intégrée à la santé. Il existe des facultés de santé publique distinctes des facultés de médecine.
Il ne faut pas nécessairement être médecin pour faire de la santé publique. Il existe des formations à Sciences Po ou à l'Essec. Il faudrait sans doute les rassembler et développer une nouvelle vision de la santé publique.
Certains d'entre nous étaient même allés plus loin, souhaitant que se constitue finalement une sorte de secrétariat d'État à la santé publique, qui ne soit pas rattaché au ministère de la Santé, mais à Matignon.
Sur l'outre-mer, nous avons rendu deux avis, dont l'un dès début avril. Je me souviens d'avoir appelé Mme Girardin, et nous avions également organisé une vidéo-conférence avec l'ensemble des préfets et des directeurs des ARS outre-mer. Nous avons rendu un deuxième avis sur le déconfinement outre-mer et le problème des frontières. Ces questions étaient vraiment inscrites à notre agenda. Par ailleurs, Simon Cauchemez a beaucoup travaillé sur les modèles de construction et de réponse qui pouvaient être développés en Guyane fin juillet et début août. Au passage, les expériences de la Guyane et de la Mayenne montrent que, quand on cerne bien les questions, qu'on arrête avec le territoire une série de mesures à prendre, on peut être efficaces. Nous ne devons pas être perdants en permanence. Il faut savoir reprendre la main. On peut parfaitement le faire, même si ce n'est pas facile pour les populations concernées.
S'agissant de la recherche en immunologie, oui, bien sûr, la réponse immunitaire des sujets qui ont déclaré un covid fait l'objet de beaucoup d'études. Elle fait même l'objet d'essais thérapeutiques pour regarder si les anticorps issus des patients convalescents pourraient aider à « guérir » les patients ou à réduire la sévérité des formes graves. Un essai est mené en France ; des données sont également parues en Italie et aux États-Unis. Cela permet d'anticiper ce que pourrait être une réponse vaccinale comme marqueur prédictif au niveau immunologique.
Oui, probablement, madame Guillemot, le politique vit avec l'incertitude, mais ce n'est pas à moi de le dire. Je sais en revanche que la communauté scientifique vit avec l'incertitude. La question pourrait être de savoir comment l'on fait se rejoindre ces deux formes d'incertitude. C'est bien là la complexité du dialogue, mais qui est tout à fait possible à mon avis. Cela pose la question d'une réflexion sur la réponse à apporter aux crises. À mes yeux, si une structure devait voir le jour, une nouvelle « agence » ou un « machin » à la française, elle ne devrait pas être uniquement cantonnée aux crises sanitaires. Il devrait y avoir une réflexion plus globale, à froid, sur la réponse à apporter à la crise.
Ma génération est une génération bénie des dieux, qui a eu 40 ans devant elle avec des aspects extrêmement positifs. Je comprends la jeunesse actuelle qui, dans une certaine mesure, nous dit : « Vous avez vécu une vie extraordinaire, laissez-nous vivre et confinez-vous ! »
Crises économiques, crises sanitaires : nous vivons des crises successives. Nous devons probablement développer une certaine forme de professionnalisation et de capacité à répondre à ces crises sur le plan multidisciplinaire. C'est le politique qui doit décider, bien sûr, toujours, mais il doit pouvoir s'appuyer sur une instance capable de lui fournir de l'information et des modalités de réponse aux crises.
Je ne sais pas s'il faut créer une nouvelle agence, mais, en termes sanitaires, ce qui ressort de cette crise, c'est le problème d'une réorganisation de la santé publique en France. Si l'on regarde les modèles anglo-saxon ou allemand, des pays qui ont un tout petit peu mieux réussi que nous, la santé publique n'est pas intégrée à la santé. Il existe des facultés de santé publique distinctes des facultés de médecine.
Il ne faut pas nécessairement être médecin pour faire de la santé publique. Il existe des formations à Sciences Po ou à l'Essec. Il faudrait sans doute les rassembler et développer une nouvelle vision de la santé publique.
Certains d'entre nous étaient même allés plus loin, souhaitant que se constitue finalement une sorte de secrétariat d'État à la santé publique, qui ne soit pas rattaché au ministère de la Santé, mais à Matignon.

On entend parler de mutation du virus, qui fait dire à certains qu'il serait peut-être moins actif, ou moins dangereux. J'aimerais avoir des précisions sur ce point.
On voit qu'il est difficile aussi d'avoir dans les médias une information suffisamment étayée et qui n'entraîne pas un surcroît de peur dans la population.
En tant que parlementaires, nous avons fait en cette rentrée le tour des écoles et, dans ma ville, j'ai trouvé des directions d'école extrêmement inquiètes, parce qu'elles ne savent pas quoi faire face à des enfants qui présentent des symptômes de rhume ou de nez qui coule. Certaines directrices entendaient tout de suite alerter les médecins et pratiquer des tests, d'autres préféraient attendre un peu. En tant que conseil scientifique, avez-vous des recommandations de nature à aider ces professionnels désemparés ?
Vous avez recommandé une protection des personnes fragiles. Ces préconisations ne sont-elles pas en totale contradiction avec le décret qui exclut de la liste des personnes fragiles certaines pathologies comme l'obésité, dans le but de les contraindre à aller travailler et à ne pas pratiquer le télétravail ?
Vous estimez nécessaire de revisiter, à tout le moins, notre système de santé. Or, durant nos différentes auditions, nous avons été alertés sur le nombre important de déprogrammations d'opérations pendant toute la crise aiguë de la covid. Il y a aussi eu beaucoup de renoncement aux soins, par peur de la contagion. Face à la reprise de la pandémie qui semble se dessiner, n'y a-t-il pas un risque de déprogrammer de nouveau des opérations et de mettre la vie de personnes en danger ?
Enfin, vous avez parlé des vaccins et des traitements. Ne pensez-vous pas que les différents États se trouvent pieds et poings liés par rapport aux politiques des grands laboratoires ? N'est-ce pas le moment de créer un grand pôle public du médicament et de la recherche pour développer un certain nombre de médicaments et éventuellement de vaccins ?

On entend parler de mutation du virus, qui fait dire à certains qu'il serait peut-être moins actif, ou moins dangereux. J'aimerais avoir des précisions sur ce point.
On voit qu'il est difficile aussi d'avoir dans les médias une information suffisamment étayée et qui n'entraîne pas un surcroît de peur dans la population.
En tant que parlementaires, nous avons fait en cette rentrée le tour des écoles et, dans ma ville, j'ai trouvé des directions d'école extrêmement inquiètes, parce qu'elles ne savent pas quoi faire face à des enfants qui présentent des symptômes de rhume ou de nez qui coule. Certaines directrices entendaient tout de suite alerter les médecins et pratiquer des tests, d'autres préféraient attendre un peu. En tant que conseil scientifique, avez-vous des recommandations de nature à aider ces professionnels désemparés ?
Vous avez recommandé une protection des personnes fragiles. Ces préconisations ne sont-elles pas en totale contradiction avec le décret qui exclut de la liste des personnes fragiles certaines pathologies comme l'obésité, dans le but de les contraindre à aller travailler et à ne pas pratiquer le télétravail ?
Vous estimez nécessaire de revisiter, à tout le moins, notre système de santé. Or, durant nos différentes auditions, nous avons été alertés sur le nombre important de déprogrammations d'opérations pendant toute la crise aiguë de la covid. Il y a aussi eu beaucoup de renoncement aux soins, par peur de la contagion. Face à la reprise de la pandémie qui semble se dessiner, n'y a-t-il pas un risque de déprogrammer de nouveau des opérations et de mettre la vie de personnes en danger ?
Enfin, vous avez parlé des vaccins et des traitements. Ne pensez-vous pas que les différents États se trouvent pieds et poings liés par rapport aux politiques des grands laboratoires ? N'est-ce pas le moment de créer un grand pôle public du médicament et de la recherche pour développer un certain nombre de médicaments et éventuellement de vaccins ?

Dans certains pays, notamment les pays anglo-saxons, il existe des instances scientifiques attachées au gouvernement, ce qui permet d'avoir une grande réactivité. Je pense notamment au scientifique en chef au Québec. Je serais favorable à la mise en place d'un système de ce genre, avec également toute une liste de scientifiques qu'on pourrait mettre à contribution. On devra en effet certainement faire face à l'avenir à des crises qui nécessiteront de mobiliser différents types de scientifiques, notamment des géologues, des chimistes, des physiciens, etc. Que pensez-vous de cette idée ? Il faudrait également développer une sorte de culture du risque qui manque sans doute un peu dans notre pays.
Vous avez également fait part d'un regret au sujet des Ehpad. Porte-t-il sur un défaut d'humanité par rapport aux personnes âgées ? J'ai dans mon entourage une personne âgée de 84 ans, qui vit chez elle, et qui veut rester libre de sortir ou pas, de se mettre en danger ou pas.
La santé publique a en effet subi ces dernières années une logique comptable. Je m'interroge sur le nombre de lits en réanimation dont nous disposons actuellement, beaucoup plus faible qu'en Allemagne. Avez-vous conseillé d'augmenter le nombre de lits ? Des changements sont-ils déjà intervenus ?
J'ai en effet récemment entendu un médecin dire que rien n'avait changé et que nous avions toujours le même nombre de lits de réanimation.

Dans certains pays, notamment les pays anglo-saxons, il existe des instances scientifiques attachées au gouvernement, ce qui permet d'avoir une grande réactivité. Je pense notamment au scientifique en chef au Québec. Je serais favorable à la mise en place d'un système de ce genre, avec également toute une liste de scientifiques qu'on pourrait mettre à contribution. On devra en effet certainement faire face à l'avenir à des crises qui nécessiteront de mobiliser différents types de scientifiques, notamment des géologues, des chimistes, des physiciens, etc. Que pensez-vous de cette idée ? Il faudrait également développer une sorte de culture du risque qui manque sans doute un peu dans notre pays.
Vous avez également fait part d'un regret au sujet des Ehpad. Porte-t-il sur un défaut d'humanité par rapport aux personnes âgées ? J'ai dans mon entourage une personne âgée de 84 ans, qui vit chez elle, et qui veut rester libre de sortir ou pas, de se mettre en danger ou pas.
La santé publique a en effet subi ces dernières années une logique comptable. Je m'interroge sur le nombre de lits en réanimation dont nous disposons actuellement, beaucoup plus faible qu'en Allemagne. Avez-vous conseillé d'augmenter le nombre de lits ? Des changements sont-ils déjà intervenus ?
J'ai en effet récemment entendu un médecin dire que rien n'avait changé et que nous avions toujours le même nombre de lits de réanimation.

Le 30 octobre, ce sera aussi le jour de la Sainte Bienvenue. Faut-il redire bienvenue au conseil scientifique tel qu'il existe ? Proposez-vous des pistes pour l'améliorer ?
Vous avez parlé de la presse avec son effet loupe, voire son effet déformant. Avez-vous le sentiment que le Conseil a bien communiqué en direction de la presse ? Y a-t-il des choses à améliorer ?
Il y a eu un grand débat en France entre une méthode empirique proposée par certains et les méthodes récentes fondées notamment sur le principe du double aveugle. Cette controverse, qui s'est transformée en véritable combat, a angoissé beaucoup de Français. Ne faut-il pas que les scientifiques reprennent le chemin de la discussion pour éviter ce genre de combats qui nuisent à une bonne communication ?
Sur les Ehpad, j'ai conscience que la question est un peu caricaturale, mais vaut-il mieux mourir du covid entouré de l'amour de ses proches ou mourir seul de solitude ?

Le 30 octobre, ce sera aussi le jour de la Sainte Bienvenue. Faut-il redire bienvenue au conseil scientifique tel qu'il existe ? Proposez-vous des pistes pour l'améliorer ?
Vous avez parlé de la presse avec son effet loupe, voire son effet déformant. Avez-vous le sentiment que le Conseil a bien communiqué en direction de la presse ? Y a-t-il des choses à améliorer ?
Il y a eu un grand débat en France entre une méthode empirique proposée par certains et les méthodes récentes fondées notamment sur le principe du double aveugle. Cette controverse, qui s'est transformée en véritable combat, a angoissé beaucoup de Français. Ne faut-il pas que les scientifiques reprennent le chemin de la discussion pour éviter ce genre de combats qui nuisent à une bonne communication ?
Sur les Ehpad, j'ai conscience que la question est un peu caricaturale, mais vaut-il mieux mourir du covid entouré de l'amour de ses proches ou mourir seul de solitude ?

Puisque nous sommes dans une commission d'enquête, j'ai une question à charge et une autre à décharge, ou plutôt une question qui vise les dysfonctionnements et l'autre les bons fonctionnements.
Il me semble tout d'abord que la position du comité scientifique a évolué au fil des mois sur l'usage du masque. Les recommandations du comité scientifique ont-elles évolué en fonction de l'état du stock de masques dans le pays ?
René-Paul Savary a dit que le système français n'était pas prêt, qu'il n'avait pas réussi à faire face, et vous avez acquiescé. Quand on se regarde, forcément, on se désole. Mais quand on se compare, on se console... Vous avez parlé de la situation de l'Allemagne, mais il y a aussi dans notre entourage immédiat des pays comme l'Italie, l'Espagne ou le Royaume-Uni, dont le système sanitaire semble avoir été submergé, ce qui n'a pas été notre cas. Bien que nous n'ayons pas été prêts à faire face à cette crise, quels sont les éléments qui nous ont permis de mieux la gérer que l'Espagne, l'Italie ou le Royaume-Uni ?

Puisque nous sommes dans une commission d'enquête, j'ai une question à charge et une autre à décharge, ou plutôt une question qui vise les dysfonctionnements et l'autre les bons fonctionnements.
Il me semble tout d'abord que la position du comité scientifique a évolué au fil des mois sur l'usage du masque. Les recommandations du comité scientifique ont-elles évolué en fonction de l'état du stock de masques dans le pays ?
René-Paul Savary a dit que le système français n'était pas prêt, qu'il n'avait pas réussi à faire face, et vous avez acquiescé. Quand on se regarde, forcément, on se désole. Mais quand on se compare, on se console... Vous avez parlé de la situation de l'Allemagne, mais il y a aussi dans notre entourage immédiat des pays comme l'Italie, l'Espagne ou le Royaume-Uni, dont le système sanitaire semble avoir été submergé, ce qui n'a pas été notre cas. Bien que nous n'ayons pas été prêts à faire face à cette crise, quels sont les éléments qui nous ont permis de mieux la gérer que l'Espagne, l'Italie ou le Royaume-Uni ?

Vous avez déclaré, monsieur le professeur Delfraissy, que vous auriez plutôt parié sur une immunité de 20 à 25 % de la population. À quel moment avez-vous fait ce pari ? Il me semble en effet que le confinement a rendu une telle immunité impossible.
Y a-t-il d'autres conseils scientifiques tels que le nôtre, ratifiés par le Parlement et destinés à aider à la décision politique ? Quelles sont leurs appellations dans les autres pays européens ? Échangez-vous avec eux ? Pour des crises futures, des conseils scientifiques harmonisés au plan européen seraient-ils souhaitables ?
Enfin, vous avez dit que vous n'étiez pas une structure pérenne et que vous étiez amenés à être dissous le 30 octobre. Mais j'ai bien compris aussi que vous entendiez peser dans un débat de fond sur les politiques publiques en matière de santé. En effet, l'expertise que vous aurez acquise pendant cette crise sera pérenne et précieuse. De quelle manière comptez-vous peser sur la réorganisation de la santé publique en France ?

Vous avez déclaré, monsieur le professeur Delfraissy, que vous auriez plutôt parié sur une immunité de 20 à 25 % de la population. À quel moment avez-vous fait ce pari ? Il me semble en effet que le confinement a rendu une telle immunité impossible.
Y a-t-il d'autres conseils scientifiques tels que le nôtre, ratifiés par le Parlement et destinés à aider à la décision politique ? Quelles sont leurs appellations dans les autres pays européens ? Échangez-vous avec eux ? Pour des crises futures, des conseils scientifiques harmonisés au plan européen seraient-ils souhaitables ?
Enfin, vous avez dit que vous n'étiez pas une structure pérenne et que vous étiez amenés à être dissous le 30 octobre. Mais j'ai bien compris aussi que vous entendiez peser dans un débat de fond sur les politiques publiques en matière de santé. En effet, l'expertise que vous aurez acquise pendant cette crise sera pérenne et précieuse. De quelle manière comptez-vous peser sur la réorganisation de la santé publique en France ?
Le virus fait l'objet de très nombreuses études au niveau mondial, qui montrent qu'il a connu de multiples petites mutations, ainsi qu'une mutation un peu plus importante. Mais nous ne disposons d'aucune étude provenant des grands laboratoires internationaux qui décrive de mutation significative.
Il est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu incohérent entre le décret du 29 août et le message actuellement adressé aux personnes les plus fragiles. Nous l'avons signalé aux autorités de santé. Ce décret est très mal tombé, compte tenu de la reprise de l'épidémie.
Début mars, les patients « covid+ » focalisaient toute l'attention. Le conseil scientifique a d'emblée affirmé qu'il fallait être très attentifs à la morbidité induite chez les patients « covid - ». Mais il y a aussi eu des améliorations : moins d'accidents de voiture, moins de traumatismes, moins de fractures du col du fémur chez les personnes âgées, etc. Il y a un équilibre à trouver dans la répartition pour les quatre prochains mois, avec plus de places pour les patients « covid - ». Mais comment va-t-on faire ? Il faut éviter que le système de réanimation ne se trouve de nouveau en tension.
Je suis de ceux qui pensent que l'industrie pharmaceutique occupe une place trop dominante dans notre modèle de santé. Le comité national d'éthique va d'ailleurs publier prochainement une étude sur les coûts faramineux de l'accès à l'innovation. Mais le Président de la République a demandé que le vaccin soit considéré comme un bien public mondial et que son coût soit limité à quelques dollars par unité.
Un comité scientifique doit-il être institué auprès du Président de la République ou du Premier ministre ? C'est une vraie question, elle n'est pas facile. Ce comité ne devrait pas se limiter au sanitaire. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) ne joue pas totalement ce rôle. Il faut un dialogue avec le politique, mais aussi de l'indépendance, un bon niveau et l'envie de donner à la Nation. Les parlementaires devront se poser cette question dans l'après-covid. Un tel comité a existé aux États-Unis, il existe en Grande-Bretagne et au Japon ; mais certains pays n'en sont pas dotés.
Le virus fait l'objet de très nombreuses études au niveau mondial, qui montrent qu'il a connu de multiples petites mutations, ainsi qu'une mutation un peu plus importante. Mais nous ne disposons d'aucune étude provenant des grands laboratoires internationaux qui décrive de mutation significative.
Il est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu incohérent entre le décret du 29 août et le message actuellement adressé aux personnes les plus fragiles. Nous l'avons signalé aux autorités de santé. Ce décret est très mal tombé, compte tenu de la reprise de l'épidémie.
Début mars, les patients « covid+ » focalisaient toute l'attention. Le conseil scientifique a d'emblée affirmé qu'il fallait être très attentifs à la morbidité induite chez les patients « covid - ». Mais il y a aussi eu des améliorations : moins d'accidents de voiture, moins de traumatismes, moins de fractures du col du fémur chez les personnes âgées, etc. Il y a un équilibre à trouver dans la répartition pour les quatre prochains mois, avec plus de places pour les patients « covid - ». Mais comment va-t-on faire ? Il faut éviter que le système de réanimation ne se trouve de nouveau en tension.
Je suis de ceux qui pensent que l'industrie pharmaceutique occupe une place trop dominante dans notre modèle de santé. Le comité national d'éthique va d'ailleurs publier prochainement une étude sur les coûts faramineux de l'accès à l'innovation. Mais le Président de la République a demandé que le vaccin soit considéré comme un bien public mondial et que son coût soit limité à quelques dollars par unité.
Un comité scientifique doit-il être institué auprès du Président de la République ou du Premier ministre ? C'est une vraie question, elle n'est pas facile. Ce comité ne devrait pas se limiter au sanitaire. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) ne joue pas totalement ce rôle. Il faut un dialogue avec le politique, mais aussi de l'indépendance, un bon niveau et l'envie de donner à la Nation. Les parlementaires devront se poser cette question dans l'après-covid. Un tel comité a existé aux États-Unis, il existe en Grande-Bretagne et au Japon ; mais certains pays n'en sont pas dotés.
Nous avons encore des progrès à faire en matière de médecine préventive. Dans certains Ehpad, la situation a été gérée de manière moins défavorable, grâce à l'éducation sanitaire et la formation de leur personnel, à la mobilisation des ressources d'hygiène, à la construction d'équipes mobiles partagées avec la médecine ambulatoire au niveau des territoires, à l'existence de plateformes adossées à des établissements de santé, etc.
Les Ehpad sont de moins en moins des maisons de retraite, et deviennent progressivement des espaces de santé. On vient y chercher du soin, avec des niveaux de ressources humaines qui ne sont pas toujours au rendez-vous. Je rappelle que la durée de vie médiane en Ehpad est de trois ans. Que voulons-nous faire de nos Ehpad, à la lumière de cette expérience cruciale ? Nous devons trouver un équilibre entre l'obligation de la relation - protéger nos aînés ne veut pas dire les isoler ni de leur famille ni du personnel qui les entoure - et le maintien des mesures accompagnant les visiteurs - afin de faire tendre le risque de transmission vers zéro. C'est un équilibre délicat, mais essentiel. Un patient « covid+ » en Ehpad peut-il être maintenu sur site ? C'est une question que nous devons creuser. Nous devons trouver des structures intermédiaires, proposant de la gériatrie de proximité, afin d'éviter de coûteuses hospitalisations.
Nous avons encore des progrès à faire en matière de médecine préventive. Dans certains Ehpad, la situation a été gérée de manière moins défavorable, grâce à l'éducation sanitaire et la formation de leur personnel, à la mobilisation des ressources d'hygiène, à la construction d'équipes mobiles partagées avec la médecine ambulatoire au niveau des territoires, à l'existence de plateformes adossées à des établissements de santé, etc.
Les Ehpad sont de moins en moins des maisons de retraite, et deviennent progressivement des espaces de santé. On vient y chercher du soin, avec des niveaux de ressources humaines qui ne sont pas toujours au rendez-vous. Je rappelle que la durée de vie médiane en Ehpad est de trois ans. Que voulons-nous faire de nos Ehpad, à la lumière de cette expérience cruciale ? Nous devons trouver un équilibre entre l'obligation de la relation - protéger nos aînés ne veut pas dire les isoler ni de leur famille ni du personnel qui les entoure - et le maintien des mesures accompagnant les visiteurs - afin de faire tendre le risque de transmission vers zéro. C'est un équilibre délicat, mais essentiel. Un patient « covid+ » en Ehpad peut-il être maintenu sur site ? C'est une question que nous devons creuser. Nous devons trouver des structures intermédiaires, proposant de la gériatrie de proximité, afin d'éviter de coûteuses hospitalisations.
Dès le début, le conseil scientifique a fait le constat qu'il n'y avait pas de masques et que les masques disponibles devaient être utilisés en priorité par les soignants, qui encourraient le risque le plus important. Nos propositions ont donc tenu compte de la réalité de notre capacité à avoir les masques, et nous l'avons dit. Permettez-moi de rappeler que nous ne jouions aucun rôle opérationnel dans la commande de masques. Personnellement, je pense que nous aurions dû faire plus largement appel à certaines structures privées ou à de grandes ONG dont les capacités opérationnelles auraient pu être mieux utilisées. Par ailleurs, vous avez vu qu'il y avait eu une évolution, y compris scientifique, sur l'intérêt du port du masque. Nous avons réussi, avec d'autres comités internationaux - et notamment l'OMS dont la position a évolué -, à construire une doctrine dans laquelle le masque constitue un outil additionnel pour se protéger et protéger les autres. L'évolution de nos avis a donc tenu compte de la réalité du nombre de masques et de ce que l'on attendait du port de ce masque.
Il faut peut-être attendre encore un tout petit peu avant de faire des comparaisons internationales. Les Italiens ont bien géré la crise : ils ont été en première ligne, mais aujourd'hui le niveau de circulation virale y est beaucoup plus faible que chez nous. La Grande-Bretagne a eu la chance que son Premier ministre ait été atteint, car il était initialement sur la même ligne que le président américain, mais il s'est fait très peur et a ensuite effectué un revirement de position. La situation britannique illustre parfaitement les conséquences d'un retard de 8 ou 10 jours dans la prise de décision concernant une épidémie qui évolue exponentiellement. Il est plus difficile de se prononcer sur l'Espagne, car les éléments de comparaison ne sont pas encore stabilisés.
La France ne va pas s'en sortir si mal, probablement parce que son système de soins hospitaliers est assez extraordinaire lorsqu'il est confronté à l'urgence. Nous étions déjà dans une crise hospitalière lourde en raison des contraintes budgétaires qui pèsent sur l'hôpital depuis longtemps. Mais ce qui a été réalisé de façon extraordinaire en mars et avril ne pourra pas forcément être réédité, car on observe une fatigue générale, une lassitude et des difficultés de recrutement : c'est pour cela que nous devons aujourd'hui prévenir et éviter de nous retrouver dans le même type de situation.
Nous sommes en contact avec les autres pays européens, mais les décisions ne sont pas harmonisées. C'est une forme de faillite de l'Europe. C'était compréhensible au début de la crise, cela l'est moins aujourd'hui face à la reprise de l'épidémie.
L'immunité de population de 25 % que j'avais évoquée était une pure hypothèse de ma part, mais cette hypothèse a été très vite détruite par les chiffres qui font apparaître une immunité de l'ordre de 5 à 10 %.
Notre conseil doit-il être dissous le 30 octobre ? La décision est entre vos mains. Nous avions souhaité disparaître le 12 juillet. Nous discutons de la poursuite de notre mission : elle nous prend beaucoup de temps et nous subissons une très lourde pression. Mais en l'absence de conseil scientifique, qui conseille ? Un conseil scientifique renouvelé ?
Le nombre de lits de réanimation a très fortement augmenté à compter du mois de mars - avec des différences selon les régions - et a diminué ensuite - notamment avec le départ des personnels qui étaient venus en renfort. Le problème ne réside pas tant dans les questions de matériel que dans celles de personnel. Nous avons aujourd'hui plus de lits de réanimation qu'au 1er février : c'est ainsi qu'à Marseille le nombre de lits de réanimation a pu augmenter dès la fin de la semaine dernière. Cette capacité d'augmentation des lits demeure, mais pour quel type de patients ? Nous ne pourrons pas consacrer à nouveau 90 % de ces lits de réanimation aux seuls patients « covid+ ». Nous devons donc limiter au maximum l'arrivée des patients en réanimation, afin d'éviter de nous trouver dans situation éthique extrêmement délicate.
Le conseil scientifique est une structure légère. Dans nos relations avec la presse, nous avons été accompagnés par une chargée de communication. Peut-être à tort - certains membres du conseil scientifique étaient partisans d'une organisation beaucoup plus professionnelle. Nous avons décidé de communiquer essentiellement à l'occasion de nos avis et de ne pas commenter les décisions gouvernementales. Mais, de temps en temps, on se fait piéger et j'en suis un bon exemple récent quand j'ai parlé de mesures difficiles : j'entendais difficiles à élaborer. Nous avons en outre décidé de ne pas être présents sur les réseaux sociaux, car je considérais que cela n'était pas le rôle du conseil scientifique. Je ne le regrette pas.
Dès le début, le conseil scientifique a fait le constat qu'il n'y avait pas de masques et que les masques disponibles devaient être utilisés en priorité par les soignants, qui encourraient le risque le plus important. Nos propositions ont donc tenu compte de la réalité de notre capacité à avoir les masques, et nous l'avons dit. Permettez-moi de rappeler que nous ne jouions aucun rôle opérationnel dans la commande de masques. Personnellement, je pense que nous aurions dû faire plus largement appel à certaines structures privées ou à de grandes ONG dont les capacités opérationnelles auraient pu être mieux utilisées. Par ailleurs, vous avez vu qu'il y avait eu une évolution, y compris scientifique, sur l'intérêt du port du masque. Nous avons réussi, avec d'autres comités internationaux - et notamment l'OMS dont la position a évolué -, à construire une doctrine dans laquelle le masque constitue un outil additionnel pour se protéger et protéger les autres. L'évolution de nos avis a donc tenu compte de la réalité du nombre de masques et de ce que l'on attendait du port de ce masque.
Il faut peut-être attendre encore un tout petit peu avant de faire des comparaisons internationales. Les Italiens ont bien géré la crise : ils ont été en première ligne, mais aujourd'hui le niveau de circulation virale y est beaucoup plus faible que chez nous. La Grande-Bretagne a eu la chance que son Premier ministre ait été atteint, car il était initialement sur la même ligne que le président américain, mais il s'est fait très peur et a ensuite effectué un revirement de position. La situation britannique illustre parfaitement les conséquences d'un retard de 8 ou 10 jours dans la prise de décision concernant une épidémie qui évolue exponentiellement. Il est plus difficile de se prononcer sur l'Espagne, car les éléments de comparaison ne sont pas encore stabilisés.
La France ne va pas s'en sortir si mal, probablement parce que son système de soins hospitaliers est assez extraordinaire lorsqu'il est confronté à l'urgence. Nous étions déjà dans une crise hospitalière lourde en raison des contraintes budgétaires qui pèsent sur l'hôpital depuis longtemps. Mais ce qui a été réalisé de façon extraordinaire en mars et avril ne pourra pas forcément être réédité, car on observe une fatigue générale, une lassitude et des difficultés de recrutement : c'est pour cela que nous devons aujourd'hui prévenir et éviter de nous retrouver dans le même type de situation.
Nous sommes en contact avec les autres pays européens, mais les décisions ne sont pas harmonisées. C'est une forme de faillite de l'Europe. C'était compréhensible au début de la crise, cela l'est moins aujourd'hui face à la reprise de l'épidémie.
L'immunité de population de 25 % que j'avais évoquée était une pure hypothèse de ma part, mais cette hypothèse a été très vite détruite par les chiffres qui font apparaître une immunité de l'ordre de 5 à 10 %.
Notre conseil doit-il être dissous le 30 octobre ? La décision est entre vos mains. Nous avions souhaité disparaître le 12 juillet. Nous discutons de la poursuite de notre mission : elle nous prend beaucoup de temps et nous subissons une très lourde pression. Mais en l'absence de conseil scientifique, qui conseille ? Un conseil scientifique renouvelé ?
Le nombre de lits de réanimation a très fortement augmenté à compter du mois de mars - avec des différences selon les régions - et a diminué ensuite - notamment avec le départ des personnels qui étaient venus en renfort. Le problème ne réside pas tant dans les questions de matériel que dans celles de personnel. Nous avons aujourd'hui plus de lits de réanimation qu'au 1er février : c'est ainsi qu'à Marseille le nombre de lits de réanimation a pu augmenter dès la fin de la semaine dernière. Cette capacité d'augmentation des lits demeure, mais pour quel type de patients ? Nous ne pourrons pas consacrer à nouveau 90 % de ces lits de réanimation aux seuls patients « covid+ ». Nous devons donc limiter au maximum l'arrivée des patients en réanimation, afin d'éviter de nous trouver dans situation éthique extrêmement délicate.
Le conseil scientifique est une structure légère. Dans nos relations avec la presse, nous avons été accompagnés par une chargée de communication. Peut-être à tort - certains membres du conseil scientifique étaient partisans d'une organisation beaucoup plus professionnelle. Nous avons décidé de communiquer essentiellement à l'occasion de nos avis et de ne pas commenter les décisions gouvernementales. Mais, de temps en temps, on se fait piéger et j'en suis un bon exemple récent quand j'ai parlé de mesures difficiles : j'entendais difficiles à élaborer. Nous avons en outre décidé de ne pas être présents sur les réseaux sociaux, car je considérais que cela n'était pas le rôle du conseil scientifique. Je ne le regrette pas.
Nous étions dans une structuration un peu provisoire. Si un comité scientifique devait être institué auprès du Président de la République ou du Premier ministre dans l'après-covid, il faudrait mener une vraie réflexion sur sa communication avec la presse. Par ailleurs, les membres du conseil scientifique peuvent être amenés à communiquer à titre individuel, car certains d'entre eux sont des scientifiques qui peuvent éclairer les populations. Nous avons donc essayé de trouver un équilibre.
Nous ne sommes absolument pas entrés dans la controverse. J'aurais pu y entrer à titre personnel, mais je ne l'ai pas fait et je ne le souhaite toujours pas. Notre premier avis sur les résultats des essais thérapeutiques date de la fin du mois de juillet et s'appuie sur les résultats des essais randomisés.
Nous étions dans une structuration un peu provisoire. Si un comité scientifique devait être institué auprès du Président de la République ou du Premier ministre dans l'après-covid, il faudrait mener une vraie réflexion sur sa communication avec la presse. Par ailleurs, les membres du conseil scientifique peuvent être amenés à communiquer à titre individuel, car certains d'entre eux sont des scientifiques qui peuvent éclairer les populations. Nous avons donc essayé de trouver un équilibre.
Nous ne sommes absolument pas entrés dans la controverse. J'aurais pu y entrer à titre personnel, mais je ne l'ai pas fait et je ne le souhaite toujours pas. Notre premier avis sur les résultats des essais thérapeutiques date de la fin du mois de juillet et s'appuie sur les résultats des essais randomisés.

Ma première question porte également sur la gestion de la communication qui a traumatisé bon nombre de nos concitoyens. Cette communication a connu des allers-retours ; elle a été parfois contradictoire ; elle a été à la fois politique et scientifique. Ne devrait-elle pas être retravaillée afin d'apaiser nos concitoyens en situation de crise ? Ils sont dans l'incompréhension.
Au cours de nos études médicales, nous apprenons que le masque sert à protéger. Mais la communauté scientifique ne semblait plus savoir à quoi servait le masque : fallait-il utiliser un masque ? Si oui, quel masque ? Le masque en tissu était-il efficace ? J'avoue avoir moi-même été un peu perdue. Les réponses à toutes ces questions ont-elles été faites en fonction d'un manque de masques dans notre pays ? Ou s'agissait-il de réponses purement scientifiques ?
Même question s'agissant des tests. L'Allemagne a beaucoup plus testé que nous. N'aurions-nous pas dû avoir une communication claire sur les tests, reconnaissant que nous devrions tester, mais que nous n'étions pas en capacité de le faire pour telle ou telle raison ? Ignorions-nous à ce moment-là que le test était utile ?
Vous nous indiquez que la virulence semble être la même entre mars et aujourd'hui. Si l'on compare le nombre de personnes en réanimation, cela signifie donc que le nombre de personnes contaminées en mars a été beaucoup plus important que ce que l'on pensait alors. Ne pensez-vous pas que l'immunité de groupe pourrait avoir été atteinte, notamment dans certains territoires comme le Grand Est ?

Ma première question porte également sur la gestion de la communication qui a traumatisé bon nombre de nos concitoyens. Cette communication a connu des allers-retours ; elle a été parfois contradictoire ; elle a été à la fois politique et scientifique. Ne devrait-elle pas être retravaillée afin d'apaiser nos concitoyens en situation de crise ? Ils sont dans l'incompréhension.
Au cours de nos études médicales, nous apprenons que le masque sert à protéger. Mais la communauté scientifique ne semblait plus savoir à quoi servait le masque : fallait-il utiliser un masque ? Si oui, quel masque ? Le masque en tissu était-il efficace ? J'avoue avoir moi-même été un peu perdue. Les réponses à toutes ces questions ont-elles été faites en fonction d'un manque de masques dans notre pays ? Ou s'agissait-il de réponses purement scientifiques ?
Même question s'agissant des tests. L'Allemagne a beaucoup plus testé que nous. N'aurions-nous pas dû avoir une communication claire sur les tests, reconnaissant que nous devrions tester, mais que nous n'étions pas en capacité de le faire pour telle ou telle raison ? Ignorions-nous à ce moment-là que le test était utile ?
Vous nous indiquez que la virulence semble être la même entre mars et aujourd'hui. Si l'on compare le nombre de personnes en réanimation, cela signifie donc que le nombre de personnes contaminées en mars a été beaucoup plus important que ce que l'on pensait alors. Ne pensez-vous pas que l'immunité de groupe pourrait avoir été atteinte, notamment dans certains territoires comme le Grand Est ?

Le format de notre commission d'enquête est inédit, car nous sommes encore en pleine crise. Nous sommes donc attendus pour donner des réponses immédiates de vie quotidienne et éclairer les citoyens.
Notre collègue Roger Karoutchi a cité des pays qui réussissent mieux que la France, souvent des pays autoritaires. Bien entendu, il n'est pas question de faire le choix de ce type de régime pour répondre à la pandémie, mais en situation de crise, les citoyens attendent de l'autorité, car nous avons besoin d'une très grande confiance pour tenir ensemble. Or l'autorité politique a semblé adapter ses messages à ses moyens. Faute de masques, les porte-parole gouvernementaux nous ont expliqué à la télévision que le masque était inutile, voire qu'il était dangereux pour le grand public s'il était mal porté ! Pouvez-vous nous confirmer que jamais le conseil scientifique n'a conseillé l'autorité publique en ce sens ? C'était des raisons politiciennes !
Nous avons aujourd'hui une stratégie : « tester-tracer-isoler ». Nous avons légiféré pour permettre à l'État de mettre en oeuvre cette stratégie, y compris avec une application numérique. Mais il n'y a aucun moyen et les citoyens sont totalement désorientés. Le mois dernier, à l'issue d'une fête familiale à laquelle je participais, une personne « covid+ » a prévenu les autres participants dès le lendemain des résultats de son test positif. Ceux-ci sont à leur tour allés se faire tester. Or, tous ceux qui se sont révélés « covid+ » n'ont jamais reçu le moindre appel pour recueillir leurs contacts. Et aucune solution d'isolement, de type hôtel, ne leur a été proposée. Ils ont eux-mêmes prévenu leurs contacts ! S'appuyer sur les citoyens éclairés, c'est utile, mais peut-être vaudrait-il mieux reconnaître que l'on n'a pas les moyens de mettre en place la stratégie annoncée ! Comment expliquez-vous que l'on continue à adresser des messages qui ne correspondent pas aux réalités ? Aujourd'hui, les citoyens ne constatent pas qu'on les teste : il y a des queues de huit à dix heures, les résultats parviennent huit jours après et aucune solution d'isolement n'est proposée.

Le format de notre commission d'enquête est inédit, car nous sommes encore en pleine crise. Nous sommes donc attendus pour donner des réponses immédiates de vie quotidienne et éclairer les citoyens.
Notre collègue Roger Karoutchi a cité des pays qui réussissent mieux que la France, souvent des pays autoritaires. Bien entendu, il n'est pas question de faire le choix de ce type de régime pour répondre à la pandémie, mais en situation de crise, les citoyens attendent de l'autorité, car nous avons besoin d'une très grande confiance pour tenir ensemble. Or l'autorité politique a semblé adapter ses messages à ses moyens. Faute de masques, les porte-parole gouvernementaux nous ont expliqué à la télévision que le masque était inutile, voire qu'il était dangereux pour le grand public s'il était mal porté ! Pouvez-vous nous confirmer que jamais le conseil scientifique n'a conseillé l'autorité publique en ce sens ? C'était des raisons politiciennes !
Nous avons aujourd'hui une stratégie : « tester-tracer-isoler ». Nous avons légiféré pour permettre à l'État de mettre en oeuvre cette stratégie, y compris avec une application numérique. Mais il n'y a aucun moyen et les citoyens sont totalement désorientés. Le mois dernier, à l'issue d'une fête familiale à laquelle je participais, une personne « covid+ » a prévenu les autres participants dès le lendemain des résultats de son test positif. Ceux-ci sont à leur tour allés se faire tester. Or, tous ceux qui se sont révélés « covid+ » n'ont jamais reçu le moindre appel pour recueillir leurs contacts. Et aucune solution d'isolement, de type hôtel, ne leur a été proposée. Ils ont eux-mêmes prévenu leurs contacts ! S'appuyer sur les citoyens éclairés, c'est utile, mais peut-être vaudrait-il mieux reconnaître que l'on n'a pas les moyens de mettre en place la stratégie annoncée ! Comment expliquez-vous que l'on continue à adresser des messages qui ne correspondent pas aux réalités ? Aujourd'hui, les citoyens ne constatent pas qu'on les teste : il y a des queues de huit à dix heures, les résultats parviennent huit jours après et aucune solution d'isolement n'est proposée.

Quels sont vos moyens humains, matériels et financiers ? Avez-vous le sentiment d'avoir été entendus dans vos analyses ? Certaines de vos propositions ont-elles été occultées ? Vous semblez regretter à demi-mot le mode de gouvernance choisi par notre pays : que préconisez-vous pour l'avenir ?

Quels sont vos moyens humains, matériels et financiers ? Avez-vous le sentiment d'avoir été entendus dans vos analyses ? Certaines de vos propositions ont-elles été occultées ? Vous semblez regretter à demi-mot le mode de gouvernance choisi par notre pays : que préconisez-vous pour l'avenir ?

Le conseil scientifique comporte un pédiatre, mais pas de gériatre, alors que le virus atteint essentiellement les personnes âgées. N'est-ce pas dommageable ?

Le conseil scientifique comporte un pédiatre, mais pas de gériatre, alors que le virus atteint essentiellement les personnes âgées. N'est-ce pas dommageable ?
Les tests effectués à partir de prélèvements salivaires devraient permettre de simplifier la mise en oeuvre de notre stratégie. Les données issues des évaluations actuellement conduites en Guyane et en région parisienne font apparaître une très bonne spécificité, ainsi qu'une sensibilité suffisante - de l'ordre de 80 %. Ils devraient donc être mis en place dès la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre.
Une fois le prélèvement effectué, le test peut être réalisé par les techniques actuelles dites de RT-PCR sur de grandes plateformes ou sous la forme d'un test rapide, qui délivre un résultat en 15 minutes ou une heure. Ces tests rapides sont réalisés par des machines fermées comparables à des machines à expresso. Mais ils ne permettent de réaliser que quatre tests simultanés, alors que les grandes plateformes peuvent réaliser plusieurs centaines de tests : c'est un modèle complètement différent. Ces tests rapides ont un intérêt, mais il faudrait commander de nouvelles machines. Cela peut être intéressant pour un Ehpad, mais pas pour réaliser du dépistage de masse tel que nous le réalisons actuellement.
Enfin, les tests antigéniques sont en cours d'évaluation et seront peut-être disponibles à la mi-octobre. Nous devons encore attendre.
Début mars, le conseil scientifique a constaté que la France avait une capacité de 3 000 tests par semaine, alors que les Allemands en effectuaient 60 000. Le conseil scientifique était convaincu que la stratégie des tests était la bonne, mais nous n'avions pas suffisamment de tests pour la mettre en oeuvre. Aujourd'hui, 1 million - voire 1,1 million - de tests peuvent être réalisés chaque semaine, dans deux objectifs : d'une part, le diagnostic pour les personnes qui ont des symptômes ou qui ont été en contact et, d'autre part, le dépistage de santé publique. Reconnaissons que c'est une réussite.
Les tests effectués à partir de prélèvements salivaires devraient permettre de simplifier la mise en oeuvre de notre stratégie. Les données issues des évaluations actuellement conduites en Guyane et en région parisienne font apparaître une très bonne spécificité, ainsi qu'une sensibilité suffisante - de l'ordre de 80 %. Ils devraient donc être mis en place dès la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre.
Une fois le prélèvement effectué, le test peut être réalisé par les techniques actuelles dites de RT-PCR sur de grandes plateformes ou sous la forme d'un test rapide, qui délivre un résultat en 15 minutes ou une heure. Ces tests rapides sont réalisés par des machines fermées comparables à des machines à expresso. Mais ils ne permettent de réaliser que quatre tests simultanés, alors que les grandes plateformes peuvent réaliser plusieurs centaines de tests : c'est un modèle complètement différent. Ces tests rapides ont un intérêt, mais il faudrait commander de nouvelles machines. Cela peut être intéressant pour un Ehpad, mais pas pour réaliser du dépistage de masse tel que nous le réalisons actuellement.
Enfin, les tests antigéniques sont en cours d'évaluation et seront peut-être disponibles à la mi-octobre. Nous devons encore attendre.
Début mars, le conseil scientifique a constaté que la France avait une capacité de 3 000 tests par semaine, alors que les Allemands en effectuaient 60 000. Le conseil scientifique était convaincu que la stratégie des tests était la bonne, mais nous n'avions pas suffisamment de tests pour la mettre en oeuvre. Aujourd'hui, 1 million - voire 1,1 million - de tests peuvent être réalisés chaque semaine, dans deux objectifs : d'une part, le diagnostic pour les personnes qui ont des symptômes ou qui ont été en contact et, d'autre part, le dépistage de santé publique. Reconnaissons que c'est une réussite.
Les délais sont certes encore trop longs, notamment en région parisienne. Mais ailleurs, cela se passe très bien. En région parisienne, la stratégie va désormais être de distinguer le test de diagnostic du test de dépistage. Les tests sont victimes de leur succès. En nombre de tests réalisés par semaine, nous avons dépassé l'Allemagne. Une partie de la jeunesse semble avoir trouvé son mode de fonctionnement en prenant peu de précautions et en ayant recours à des tests au moment du contact avec les plus anciens.
Nous avons reconnu que nous n'avions pas les tests, mais, début mars, il était déjà trop tard pour appliquer la stratégie « tester-tracer-isoler » : il fallait confiner. Cette stratégie peut s'appliquer en sortie de confinement ou lorsque le nombre de personnes infectées est relativement bas. Dès que ce nombre augmente de façon trop importante, la stratégie « tester-tracer-isoler » est dépassée. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau dans cette situation dans certaines régions de France.
Comment une épidémie de ce type se termine-t-elle ? Faut-il attendre d'atteindre 50 ou 60 % d'immunité de population ? Certains le pensent, je suis plus nuancé. La situation extraordinaire sur le porte-avions Charles de Gaulle a montré que ce taux de 50 % était atteignable. Faut-il atteindre ce niveau à l'échelle nationale pour que l'épidémie ralentisse progressivement ? Je n'ai pas la réponse.
La remarque de Mme Guidez concernant l'absence de gériatre au sein de notre conseil est pertinente. Denis Malvy a toutefois de nombreux liens avec les gériatres bordelais. Nous avons beaucoup écouté les sociétés savantes, au cours de nombreuses réunions. La société française de gérontologie nous a fait des propositions dont nous avons tenu compte. D'ici au 30 octobre, nous serons peut-être amenés à faire deux ou trois propositions de nouveaux entrants au sein du conseil, notamment un gériatre qui me semble être une priorité.
Nous avons soulevé la question de la gouvernance, mais nous n'avons pas forcément eu toutes les réponses. Sur ce sujet, je cède la parole à Daniel Benamouzig.
Les délais sont certes encore trop longs, notamment en région parisienne. Mais ailleurs, cela se passe très bien. En région parisienne, la stratégie va désormais être de distinguer le test de diagnostic du test de dépistage. Les tests sont victimes de leur succès. En nombre de tests réalisés par semaine, nous avons dépassé l'Allemagne. Une partie de la jeunesse semble avoir trouvé son mode de fonctionnement en prenant peu de précautions et en ayant recours à des tests au moment du contact avec les plus anciens.
Nous avons reconnu que nous n'avions pas les tests, mais, début mars, il était déjà trop tard pour appliquer la stratégie « tester-tracer-isoler » : il fallait confiner. Cette stratégie peut s'appliquer en sortie de confinement ou lorsque le nombre de personnes infectées est relativement bas. Dès que ce nombre augmente de façon trop importante, la stratégie « tester-tracer-isoler » est dépassée. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau dans cette situation dans certaines régions de France.
Comment une épidémie de ce type se termine-t-elle ? Faut-il attendre d'atteindre 50 ou 60 % d'immunité de population ? Certains le pensent, je suis plus nuancé. La situation extraordinaire sur le porte-avions Charles de Gaulle a montré que ce taux de 50 % était atteignable. Faut-il atteindre ce niveau à l'échelle nationale pour que l'épidémie ralentisse progressivement ? Je n'ai pas la réponse.
La remarque de Mme Guidez concernant l'absence de gériatre au sein de notre conseil est pertinente. Denis Malvy a toutefois de nombreux liens avec les gériatres bordelais. Nous avons beaucoup écouté les sociétés savantes, au cours de nombreuses réunions. La société française de gérontologie nous a fait des propositions dont nous avons tenu compte. D'ici au 30 octobre, nous serons peut-être amenés à faire deux ou trois propositions de nouveaux entrants au sein du conseil, notamment un gériatre qui me semble être une priorité.
Nous avons soulevé la question de la gouvernance, mais nous n'avons pas forcément eu toutes les réponses. Sur ce sujet, je cède la parole à Daniel Benamouzig.
Pour répondre à David Assouline, d'un côté, il y a la construction d'une stratégie, de l'autre, il y a la réalité. La cohérence d'ensemble de notre stratégie « tester-tracer-isoler » est délicate à construire dans la réalité. Dans nos avis, nous avions fait des propositions de moyens spécifiques et importants, avec des brigades - ou équipes mobiles - déployées localement. Les choix faits nationalement ont été différents, ce qui ne facilite pas la cohérence jusqu'à l'isolement. Aujourd'hui, l'ensemble n'est pas consolidé et nécessite des consolidations progressives aux différents étages. À mon sens, cela illustre la difficulté de mettre en oeuvre des logiques de santé publique confiées à d'autres acteurs de santé, dont la santé publique n'est pas la vocation première - je pense notamment aux caisses primaires d'assurance maladie. Cela pose la question des moyens de santé publique que nous pouvons mobiliser dans ce type de situations.
Pour répondre à David Assouline, d'un côté, il y a la construction d'une stratégie, de l'autre, il y a la réalité. La cohérence d'ensemble de notre stratégie « tester-tracer-isoler » est délicate à construire dans la réalité. Dans nos avis, nous avions fait des propositions de moyens spécifiques et importants, avec des brigades - ou équipes mobiles - déployées localement. Les choix faits nationalement ont été différents, ce qui ne facilite pas la cohérence jusqu'à l'isolement. Aujourd'hui, l'ensemble n'est pas consolidé et nécessite des consolidations progressives aux différents étages. À mon sens, cela illustre la difficulté de mettre en oeuvre des logiques de santé publique confiées à d'autres acteurs de santé, dont la santé publique n'est pas la vocation première - je pense notamment aux caisses primaires d'assurance maladie. Cela pose la question des moyens de santé publique que nous pouvons mobiliser dans ce type de situations.
Sur la stratégie « tester-tracer-isoler », le Gouvernement s'est-il donné les moyens de ses ambitions ? Le conseil scientifique avait préconisé un autre schéma, donnant une place plus importante au médecin généraliste et à ce qui existe dans d'autres pays - en Corée, en Allemagne - et que nous avions appelé des brigades. Or le système français de repérage s'est bâti sur l'existant de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM). Mais le tableau que nous brosse M. David Assouline est très négatif : nous avons des chiffres sur le nombre de personnes qui sont contactées. Notre modèle est donc plutôt administratif, avec une très bonne volonté. Le conseil scientifique avait proposé de s'appuyer plus sur le milieu associatif, sur les assistantes sociales, sur les médecins généralistes, etc.
Sur nos préconisations, la durée de l'isolement a été réduite à sept jours, mais dès qu'il y a suspicion ou cas contact, on doit s'isoler sans attendre le résultat du test. Le maillon un peu faible de notre dispositif est le traçage et la capacité à mobiliser des troupes - même si quelque 2 000 recrutements supplémentaires ont été annoncés à la CNAM par le Premier ministre afin d'améliorer les délais de traçage.
Sur la stratégie « tester-tracer-isoler », le Gouvernement s'est-il donné les moyens de ses ambitions ? Le conseil scientifique avait préconisé un autre schéma, donnant une place plus importante au médecin généraliste et à ce qui existe dans d'autres pays - en Corée, en Allemagne - et que nous avions appelé des brigades. Or le système français de repérage s'est bâti sur l'existant de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM). Mais le tableau que nous brosse M. David Assouline est très négatif : nous avons des chiffres sur le nombre de personnes qui sont contactées. Notre modèle est donc plutôt administratif, avec une très bonne volonté. Le conseil scientifique avait proposé de s'appuyer plus sur le milieu associatif, sur les assistantes sociales, sur les médecins généralistes, etc.
Sur nos préconisations, la durée de l'isolement a été réduite à sept jours, mais dès qu'il y a suspicion ou cas contact, on doit s'isoler sans attendre le résultat du test. Le maillon un peu faible de notre dispositif est le traçage et la capacité à mobiliser des troupes - même si quelque 2 000 recrutements supplémentaires ont été annoncés à la CNAM par le Premier ministre afin d'améliorer les délais de traçage.

Sur les sept personnes contaminées dans mon entourage, aucune n'a été appelée après avoir été testée positive. Certains n'avaient pas de solution pour s'isoler et l'un d'entre eux a lui-même dû appeler la CNAM : on ne peut pas dormir à la rue ! Je ne peux que le constater : 100 % des cas que je connais n'ont été ni appelés ni isolés.

Sur les sept personnes contaminées dans mon entourage, aucune n'a été appelée après avoir été testée positive. Certains n'avaient pas de solution pour s'isoler et l'un d'entre eux a lui-même dû appeler la CNAM : on ne peut pas dormir à la rue ! Je ne peux que le constater : 100 % des cas que je connais n'ont été ni appelés ni isolés.
C'est votre expérience sur ce cas.
C'est votre expérience sur ce cas.
À Bordeaux, un travail partagé avec la CNAM, l'ARS et la plateforme de l'hôpital a été mené. Cette plateforme a même été dépassée par son succès. Il faut articuler les moyens disponibles. La priorisation est en train de porter ses fruits. Les acteurs travaillent ensemble pour s'adapter et être réactifs.
À Bordeaux, un travail partagé avec la CNAM, l'ARS et la plateforme de l'hôpital a été mené. Cette plateforme a même été dépassée par son succès. Il faut articuler les moyens disponibles. La priorisation est en train de porter ses fruits. Les acteurs travaillent ensemble pour s'adapter et être réactifs.

Pourriez-vous nous communiquer le nombre de personnes contactées au regard du nombre de personnes testées positives ?

Pourriez-vous nous communiquer le nombre de personnes contactées au regard du nombre de personnes testées positives ?

Cela ne relève pas de la responsabilité du conseil scientifique. Il y a des endroits où cela s'est correctement passé : rassurons nos concitoyens ! Je propose que M. Delfraissy apporte les précisions nécessaires par écrit.
Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Nous vous encourageons dans cet exercice difficile : émettre un avis scientifique solide, qui soit suivi d'une décision politique fonctionnelle et acceptée sur le plan sociétal. Le Sénat aura des préconisations à faire.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
La réunion est close à 13 h 20.

Cela ne relève pas de la responsabilité du conseil scientifique. Il y a des endroits où cela s'est correctement passé : rassurons nos concitoyens ! Je propose que M. Delfraissy apporte les précisions nécessaires par écrit.
Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Nous vous encourageons dans cet exercice difficile : émettre un avis scientifique solide, qui soit suivi d'une décision politique fonctionnelle et acceptée sur le plan sociétal. Le Sénat aura des préconisations à faire.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
La réunion est close à 13 h 20.