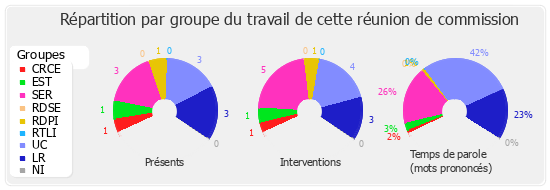Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale
Réunion du 2 décembre 2020 à 9h00
Sommaire
- Communications diverses (voir le dossier)
- Désignation des candidats pour faire partie de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif aux délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales
- Désignation des candidats pour faire partie de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif aux délais d'organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales
- Désignation des candidats pour faire partie de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au parquet européen et à la justice pénale spécialisée
- Proposition de loi constitutionnelle visant face à la crise actuelle à construire le monde d'après fondé sur la préservation des biens communs
- Proposition de loi visant à supprimer la possibilité ouverte au dirigeant d'une entreprise de déposer une offre de rachat de l'entreprise après avoir organisé son dépôt de bilan
La réunion

Mes chers collègues, je souhaiterais proposer que la commission auditionne le ministre de l'intérieur. Il était certes intéressant d'auditionner le directeur général de la police nationale (DGPN) et le directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN) hier, mais ces derniers n'ont pas pu s'écarter des propos tenus préalablement par le ministre, ce qui est tout à fait normal.
Par ailleurs, le Parlement va bientôt examiner le projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée - l'Assemblée nationale en est saisie le 8 décembre prochain. Or, à la suite des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), de la saisine de la Cour de cassation et de l'injonction du Conseil constitutionnel, le garde des sceaux est dans l'obligation d'élaborer un projet de loi, avant le 31 mars 2021, relative à la possibilité, pour les détenus, de saisir la justice lorsqu'ils considèrent que leurs conditions de détention sont indignes.
Nous avons appris que le garde des sceaux, conscient que le temps qui lui est imparti est trop court, a l'intention de greffer au projet de loi précité un amendement visant à donner aux détenus la possibilité de porter plainte - il s'agira en fait d'un projet de loi à l'intérieur d'un autre projet de loi. Si cet amendement est examiné le 8 décembre par l'Assemblée nationale, il ne pourra pas en être de même au Sénat. En outre, si la commission mixte paritaire (CMP) est conclusive, nous ne pourrons pas, là non plus, avoir l'occasion d'en débattre. Il s'agit là d'un vrai problème. C'est pourquoi je propose que nous auditionnions le garde de sceaux sur ce point avant la CMP.
Je souligne une fois encore l'effet délétère de la généralisation de la procédure accélérée. La seule solution pour que nous puissions étudier ce texte est que le Gouvernement décide de supprimer cette procédure accélérée. Ainsi, même après plusieurs lectures, ce texte pourrait être adopté au mois de janvier, à savoir dans les temps impartis.

S'agissant des auditions des DGPN et DGGN, elles étaient prévues de longue date. Il n'était donc pas question de les annuler, d'autant qu'elles sont utiles pour l'examen de la proposition de loi relative à la sécurité globale.
Par ailleurs, je n'ai pas voulu convoquer immédiatement le ministre de l'intérieur, que nous avons d'ailleurs entendu la semaine dernière sur le budget, laissant le soin à nos rapporteurs d'avancer sur le texte. Mais je n'exclus pas de le faire ultérieurement. En ce qui concerne le garde des sceaux, l'objectif est bien de l'auditionner avant l'examen du projet de loi relatif au Parquet européen en CMP.

D'autant qu'il s'agira d'un amendement.
Rappelez-vous les nouvelles dispositions relatives au divorce qui ont été adoptées en CMP, alors même que le Sénat ne les avait pas examinées.

Le garde des sceaux doit en effet répondre à une obligation constitutionnelle énoncée par le Conseil constitutionnel, à savoir la possibilité pour le juge de libérer les détenus qui le saisiront, dès lors que leurs conditions de détention seront considérées comme indignes. C'est bien sur ce point, notamment, que nous l'entendrons.
Désignation des candidats pour faire partie de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif aux délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales
Désignation des candidats pour faire partie de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif aux délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales
La commission soumet au Sénat la nomination de M. François-Noël Buffet, de Mme Catherine Di Folco, de MM. Philippe Bas, Loïc Hervé, Didier Marie, Éric Kerrouche, et Thani Mohamed Soilihi, comme membres titulaires, et de Mmes Muriel Jourda, Jacky Deromedi, Jacqueline Eustache-Brinio, de MM. Hervé Marseille, Jérôme Durain, de Mme Cécile Cukierman et de M. Jean-Yves Roux, comme membres suppléants de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif aux délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales.
Désignation des candidats pour faire partie de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif aux délais d'organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales
Désignation des candidats pour faire partie de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif aux délais d'organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales
La commission soumet au Sénat la nomination de M. François-Noël Buffet, de Mme Catherine Di Folco, de MM. Philippe Bas, Loïc Hervé, Didier Marie, Éric Kerrouche, et Thani Mohamed Soilihi, comme membres titulaires, et de Mmes Muriel Jourda, Jacky Deromedi, Jacqueline Eustache-Brinio, de MM. Hervé Marseille, Jérôme Durain, de Mme Cécile Cukierman et de M. Jean-Yves Roux, comme membres suppléants de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif aux délais d'organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales.
Désignation des candidats pour faire partie de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au parquet européen et à la justice pénale spécialisée
Désignation des candidats pour faire partie de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au parquet européen et à la justice pénale spécialisée
La commission soumet au Sénat la nomination de MM. François-Noël Buffet, Philippe Bonnecarrère, Jean-Christophe Frassa, de Mme Catherine Di Folco, de MM. Jérôme Durain, Jean-Pierre Sueur et Thani Mohamed Soilihi, comme membres titulaires, et de Mme Jacky Deromedi, de M. Stéphane Le Rudulier, de Mmes Catherine Belrhiti, Dominique Vérien, de M. Jean-Yves Leconte, de Mmes Éliane Assassi et Maryse Carrère, comme membres suppléants de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée.

Nous examinons maintenant le rapport d'Arnaud de Belenet sur la proposition de loi constitutionnelle visant, face à la crise actuelle, à construire le monde d'après fondé sur la préservation des biens communs, présentée par Nicole Bonnefoy et plusieurs autres de nos collègues.

Mes chers collègues, je commencerai par la fin, en vous demandant de ne pas adopter cette proposition de loi constitutionnelle, sans toutefois rejeter la notion même de biens communs.
Cette proposition de loi constitutionnelle, inscrite à l'ordre du jour du Sénat à l'initiative du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est riche d'opportunités. Elle nous donne l'occasion de réfléchir à une notion qui rencontre un écho grandissant dans la société et se trouve relayée par un grand nombre d'acteurs. Il s'agit donc de tenter de la définir et de faire avancer ainsi la jurisprudence constitutionnelle, notamment en matière d'environnement.
Les auteurs du texte partent du constat des défaillances de notre modèle de développement, révélées par les crises écologique et sanitaire, la progression des inégalités sociales et la persistance du chômage. Ils relèvent également l'affaiblissement de la coopération internationale au moment même où l'interdépendance des nations et la nécessité d'une réponse globale à des problèmes mondiaux sont plus évidentes que jamais. Face à ces constats, nos collègues nous proposent un ensemble de dispositions visant, d'une part, à autoriser le législateur à porter plus largement atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre, d'autre part, à « questionner » la notion de souveraineté étatique, en contribuant à l'élaboration d'un « État de droit opposable aux États », ainsi qu'à la transformation de la « souveraineté solitaire des États en souveraineté solidaire ». À cet effet, la proposition de loi constitutionnelle prévoit d'inscrire dans la loi fondamentale les notions de « biens communs » et de « biens communs mondiaux », dont la « préservation » ou le « respect » seraient constitutionnellement garantis - sans qu'il faille les opposer de manière systématique au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre. Seraient par ailleurs consacrés de nouveaux objectifs de valeur constitutionnelle tenant à la protection des sols, à la sécurité et à l'autonomie alimentaires, ainsi qu'un principe de conciliation entre le « respect des biens communs », d'une part, et le droit de propriété et la liberté d'entreprendre, d'autre part.
La notion de « biens communs » peut surprendre, car elle est inconnue dans notre droit. Nous imaginons, bien entendu, que l'air, l'eau, les sols et autres ressources vitales sont concernés. Il existe en revanche, en droit international, une notion de « patrimoine commun de l'humanité », concernant notamment le droit de la mer. La décision du Conseil constitutionnel du 31 janvier 2020 consacre également l'objectif de protection de l'environnement en tant que « patrimoine commun des êtres humains ».
Notre droit connaît, en revanche, les « choses communes », les choses « hors commerce », le domaine public dans ses diverses acceptions, des modes collectifs de propriété privée, ou encore les licences libres. Par ailleurs, il reconnaît à la puissance publique diverses prérogatives pour porter atteinte à la propriété privée à des fins d'intérêt général, telles que le droit d'expropriation, le droit de préemption, le droit d'imposer des servitudes d'utilité publique ou encore la soumission de certaines activités à un régime d'autorisation ou de déclaration.
Un grand nombre de catégories et d'institutions juridiques peuvent en principe être mobilisées pour construire des régimes visant à protéger certaines ressources et en garantir l'usage partagé.
Cela n'interdit pas de consacrer, en droit, la notion de « biens communs », à condition de déterminer quels effets juridiques seraient attachés à cette qualification. Le rapport rendu en 2008 par la commission Rodotà, en Italie, fournit, à défaut de définition transposable des « biens communs », des pistes de réflexion. Nous pourrions envisager les « biens communs » comme des « choses matérielles ou immatérielles dont l'usage et la jouissance sont nécessaires au plein exercice de droits et de libertés constitutionnellement garantis ». Néanmoins, une fois que nous aurions dit cela, nous n'aurions pas tout dit...
La notion de « biens communs » est avant tout une notion économique, son appréhension a été profondément renouvelée, à partir des années 1980, par les travaux d'Elinor Ostrom. Celle-ci a montré comment des communautés de taille limitée parviennent à organiser la gestion de certaines ressources communes - pêcheries, systèmes d'irrigation, nappes aquifères, prairies, forêts - de manière que tous les membres de la communauté puissent y accéder, dans une mesure plus ou moins étendue, sans que la ressource s'épuise. Cette gestion repose sur la mise en place, par les utilisateurs eux-mêmes, d'un système de règles socialement sanctionnées. Les analyses d'Elinor Ostrom ont ainsi remis en cause la thèse fameuse de la « tragédie des communs ».
À compter des années 1990, au moment même où le droit de la propriété intellectuelle connaissait un essor sans précédent, une réflexion théorique s'est également développée sur les « communs de la connaissance », qui a donné lieu à des mouvements tels que ceux des « logiciels libres » ou des « semences libres ».
La notion de « communs » ou de « biens communs » a par ailleurs été mobilisée au service de multiples causes militantes, en vue de combattre les méfaits réels ou supposés de politiques d'inspiration néolibérale.
Cette notion peut-elle être consacrée en droit, et à quelles fins ? La réponse à cette question appelle un travail apaisé.
Le Conseil constitutionnel a pris quelques décisions souvent présentées comme excessivement favorables au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre. En réalité, il recherche un équilibre entre les diverses exigences constitutionnelles, au moyen d'un contrôle de proportionnalité.
Dans sa décision du 8 décembre 2016, le Conseil Constitutionnel s'est prononcé sur le « reporting fiscal pays par pays » institué par la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure, il a estimé que « l'obligation faite à certaines sociétés de rendre publics des indicateurs économiques et fiscaux correspondant à leur activité, pays par pays, est de nature à permettre à l'ensemble des opérateurs qui interviennent sur les marchés où s'exercent ces activités, et en particulier à leurs concurrents, d'identifier des éléments essentiels de leur stratégie industrielle et commerciale ». Le Conseil constitutionnel a donc jugé que ces dispositions portaient une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et devaient être déclarées contraires à la Constitution.
En l'espèce, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est assez prudente. Elle n'interdit pas au législateur de prendre des dispositions, même attentatoires aux droits et libertés économiques, pour lutter contre la fraude fiscale. L'apport des nouvelles dispositions par rapport au droit en vigueur était, selon le juge, non indispensable à la réalisation de l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion fiscale, alors même qu'il apportait une atteinte substantielle à la liberté d'entreprendre.
La seconde décision, du 16 mars 2017, n'a pas fermé la porte à ce que le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) soit étendu ou à ce que d'autres dispositions affectant les droits des propriétaires fonciers soient adoptées par le législateur, en vue de satisfaire à des objectifs d'intérêt général. Le Conseil constitutionnel exige simplement que ces objectifs soient clairement énoncés et que les dispositions adoptées permettent effectivement de les atteindre.
En outre, on assiste depuis quelque temps à un « verdissement » de la jurisprudence constitutionnelle.
Depuis l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement, un abondant contentieux a permis de mieux cerner le contenu et la portée juridique de ses dispositions, bien que son potentiel normatif ne soit sans doute pas totalement épuisé.
À cet égard, permettez-moi de mentionner la décision du Conseil constitutionnel du 19 juin 2008, qui a reconnu une pleine valeur constitutionnelle à l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, ainsi que celle du 10 novembre 2011, qui a reconnu la valeur constitutionnelle du préambule de la Charte, de manière indirecte et à l'occasion d'une décision relative au secret de la défense nationale.
L'ensemble des droits, devoirs et principes inclus dans la Charte de l'environnement sont invocables dans le cadre du contrôle a priori de la constitutionnalité des lois. Les articles 1er à 4, relatifs au droit à l'environnement et aux devoirs correspondants, ainsi que l'article 7 sont également invocables dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
Le Constituant serait néanmoins dans son rôle en intervenant, soit pour clarifier certains principes et objectifs constitutionnels, soit pour en fixer de nouveaux, et donner ainsi au Conseil constitutionnel de nouvelles bases pour procéder à son travail de « mise en balance ». Il s'agirait ainsi de conforter ce « verdissement » jurisprudentiel, voire de l'anticiper, afin d'accélérer la prise en compte des enjeux liés à la protection de l'environnement.
S'agissant des droits et obligations substantiels définis par la Charte de l'environnement, la jurisprudence du Conseil constitutionnel s'est élaborée progressivement. Elle a parfois été décevante pour certains, mais les décisions rendues au cours des derniers mois semblent marquer un infléchissement.
Dans sa décision du 20 décembre 2019 relative à la loi d'orientation des mobilités, le Conseil a accepté pour la première fois de contrôler la conformité à la Constitution de dispositions de programmation, dénuées en elles-mêmes de valeur normative, en prenant pour norme de référence le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé, énoncé à l'article 1er de la Charte.
Le 31 janvier 2020, il a érigé en objectif de valeur constitutionnelle la protection de l'environnement en tant que « patrimoine commun des êtres humains ». C'est la première fois que le Conseil prend aussi nettement appui sur le préambule de la Charte, en y reconnaissant une nouvelle exigence constitutionnelle.
Par ailleurs, l'érection de la protection de l'environnement en objectif de valeur constitutionnelle, alors qu'elle n'était jusqu'à présent reconnue que comme un simple objectif d'intérêt général, a pour effet d'élargir la marge d'appréciation du législateur lorsqu'il concilie cet objectif avec d'autres exigences constitutionnelles.
Une portée extraterritoriale est, en outre, conférée par cette décision à cette nouvelle exigence constitutionnelle, au motif que l'environnement est le « patrimoine commun des êtres humains ». En l'espèce, il a été jugé que le législateur n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre en faisant obstacle à l'exportation de produits phytopharmaceutiques non approuvés par l'Union européenne. Cela témoigne du fait que nos actes locaux ont un impact au-delà des frontières, dans ce monde aux enjeux globalisés.
Néanmoins, la jurisprudence reste lacunaire sur certains points, ce qui laisse toute sa place à une nouvelle intervention du Constituant. S'agissant du principe de non-régression, le Conseil constitutionnel sera amené à se prononcer prochainement. Il lui appartiendra de consacrer ce principe - ou pas. Le principe de précaution demande également à être clarifié.
Je voudrais enfin dire un mot des « biens communs mondiaux » et de leur relation avec la souveraineté de l'État.
Les auteurs de la proposition de loi constitutionnelle souhaitent contribuer à l'édification d'un nouveau modèle de gouvernance mondiale fondé sur la souveraineté solidaire, voire sur un état de droit opposable aux États. À l'évidence, le renforcement de la coopération internationale, l'accroissement des obligations des États, la consolidation de leur responsabilité juridique internationale, voire la mise en place de nouveaux mécanismes de décision au niveau mondial n'impliquant pas l'unanimité des États, reposent avant tout sur la négociation et la conclusion de nouvelles conventions internationales.
Toutefois, une révision de la Constitution française ne serait pas nécessairement dénuée de tout effet juridique à cet égard. De nouvelles exigences de fond relatives à l'action de la France dans le monde pourraient servir de base au contrôle de constitutionnalité de nos engagements internationaux. Elles pourraient également être opposables aux actes de droit interne, dans la mesure où ceux-ci ont des conséquences globales, dans la lignée de la décision du Conseil constitutionnel du 31 janvier 2020.
Pour produire de tels effets juridiques, les nouvelles dispositions constitutionnelles devraient avoir un contenu suffisamment clair et précis. C'est une tâche qui appartient au Constituant.
J'espère donc que cette notion de « biens communs » a suscité votre intérêt, grâce à l'initiative de Nicole Bonnefoy. Un travail mérite d'être mené sur sa traduction juridique. J'ai d'ailleurs évoqué quelques pistes de réflexion avec les auteurs de la proposition de loi, au cours des travaux préparatoires.
Peut-être manque-t-il dans notre Constitution une section regroupant les dispositions de fond, notamment les objectifs de valeur constitutionnelle. Pour ne pas encombrer l'article 1er, d'autres articles pourraient être ajoutés à sa suite. Le préambule pourrait également être complété afin de faire référence à la contribution de la France à la préservation des « biens communs mondiaux ». À l'article 34, la compétence du législateur pour « déclarer » les biens communs - c'est-à-dire en fixer la liste - et pour en déterminer le régime pourrait être affirmée.
J'ai conscience de vous proposer une méthodologie collective inhabituelle, puisque j'encourage le travail à se poursuivre sur cette notion, tout en vous invitant à rejeter son véhicule actuel qu'est la proposition de loi constitutionnelle. Mais je ne doute pas que l'intelligence collective prévaudra. Le texte qui nous est soumis est inabouti, mais les objectifs méritent d'être partagés et nous ne saurions exprimer une hostilité brutale.

Monsieur le rapporteur, je vous remercie pour votre travail, dans lequel vous avez mis beaucoup du coeur, d'énergie et de réflexion. Nos échanges ont été très constructifs.
Évidemment, nous restons au milieu du gué, puisque vous demandez à la commission de rejeter ce texte, ce dont nous ne pouvons nous satisfaire. Cependant, inciter la commission à se pencher sur la notion de « biens communs » est, pour nous, une première victoire. Je ne doute pas que vous irez plus loin dans vos propositions.
J'ai noté que certains collègues avaient haussé les épaules lors de l'énoncé de l'intitulé du texte, notamment des termes « le monde d'après ». L'emphase, la grandiloquence du propos peut effrayer, mais le sujet est loin d'être exotique, et Nicole Bonnefoy ne prend pas de substances hallucinogènes... Au contraire, notre collègue est extrêmement opiniâtre, sérieuse et travaille dans le concret. D'ailleurs, un certain nombre de ses propositions de loi ont été adoptées, parce qu'elles sont ancrées dans la réalité.
La thématique des biens communs est tout à fait documentée, elle a donné lieu à un travail intellectuel et juridique solide. Les auditions que nous avons menées attestent qu'il s'agit d'une thématique émergente. Or le Sénat a été, ces dernières années, à la pointe des conquêtes juridiques les plus importantes. À titre d'exemples, je mentionnerai le travail de notre collègue Retailleau sur le préjudice écologique, celui de notre collègue Bonnefoy sur l'indemnisation des victimes de produits phytosanitaires, ou encore le texte relatif à l'écocide, même s'il a été rejeté. Le Sénat joue un rôle prospectif très particulier.
Je vous rappelle également la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. Notre collègue Christophe-André Frassa, rapporteur, avait fracassé ce texte avec toute la rondeur que nous lui connaissons, puisque ses trois articles avaient été supprimés. À l'autre bout de la planète, au Bangladesh, où je suis allé visiter une usine textile, j'ai pourtant pu constater que le petit bout de droit que nous avions modifié produisait des effets au quotidien. Nous ne sommes donc pas dans un débat philosophique, nous agissons concrètement sur la vie des personnes. S'agissant de la notion de « biens communs », c'est bien cet objectif qui est poursuivi.
Nous ne devons toucher à la Constitution qu'avec une main tremblante, mais l'implication de Nicole Bonnefoy est justifiée par l'expérience. Nous constatons qu'ont été censurées, ces dernières années, au nom de la liberté d'entreprendre, des dispositions importantes relatives au reporting fiscal, ou encore à la protection et au partage du sol face à la spéculation foncière. Aucun d'entre nous ne conteste la liberté d'entreprendre, mais elle peut et doit s'articuler avec d'autres principes.
La notion de « biens communs » nous permettrait, sans doute, de contourner ce type d'écueil. Il s'agit d'une réflexion qui n'est pas franco-française, puisqu'en Italie la commission Rodotà, chargée d'introduire dans le code civil italien la notion de « biens communs », a permis d'engager un débat juridique.
Après les travaux pionniers de Stefano Rodotà, une définition des « biens communs », qui seraient ceux qui contribuent aux droits fondamentaux et au libre développement de la personne, qui doivent être soustraits à la logique destructive du court terme, y compris au bénéfice des générations futures, n'est pas quelque chose de fantasque. Le constat de la finitude des ressources, la nécessité d'effectuer un travail collectif supranational nous paraissent déterminants. Ce débat ne concerne pas qu'un pays ni qu'un parti.
Je terminerai mon propos par une citation. « Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner notre cadre de vie au fond à d'autres est une folie. » Ces mots sont ceux du Président de la République. Vous constatez donc que la notion est partout présente, et nous pouvons espérer que, durant le débat en séance, nos arguments finiront par convaincre certains d'entre vous.

Limiter la liberté d'entreprendre pour préserver le bien commun qu'est la santé, c'est ce que l'ensemble de la planète essaie de faire aujourd'hui. La question est donc de savoir si nous devons en rester à la situation actuelle ou, compte tenu de ce que nous constatons, faire évoluer le droit pour encadrer davantage certains principes.
Nous constatons que notre modèle de développement est encore fondé - nous n'avons pas encore fini la transition néolithique - sur une certaine prédation des ressources naturelles, allant au-delà des capacités de régénération de la planète. Par conséquent, nous avons besoin de régulation, car nous ne pouvons pas faire face à cette situation en nous reposant sur l'idée que l'innovation nous permettra de courir plus vite. La question est donc posée et de plus en plus souvent, notamment pour la santé, le climat et la biodiversité.
La gouvernance mondiale actuelle n'est pas en mesure de faire face à la pandémie et aux défis organisationnels et scientifiques qu'elle implique. Par conséquent, nous avons besoin de prévoir des organisations différentes.
Répondre à ces questions au niveau national ne fonctionne pas. Si nous le pensons, au nom d'une souveraineté factice, nous perdons toute capacité d'agir. Sur ces enjeux, la souveraineté ne peut être que partagée. C'est la raison pour laquelle nous devons consacrer cette notion de « biens communs » et mettre notre pays au service de leur protection. La proposition de loi constitutionnelle n'est pas simplement une affirmation de ce principe. Sinon, nous déléguerions au juge constitutionnel le soin de placer le curseur là où il le souhaite. Les articles 2 et 3 donnent bien au législateur compétence pour fixer des bornes à la liberté d'entreprendre au nom de la défense des biens communs.
Ce texte n'a certes guère de chances de prospérer. Lançons toutefois le débat sans le tuer dans l'oeuf. Ce serait une bonne chose compte tenu des enjeux.

Nous pouvons entendre les arguments avancés par le rapporteur, mais nous poursuivrons ce débat en séance, nous devrons déterminer jusqu'où le champ du politique est ouvert.
Je ne m'oppose pas à cette proposition de loi constitutionnelle, même si, sous cette appellation de « biens communs », on désigne finalement, en partie du moins, les services publics qui ont été fortement mis à mal ces dernières années par les gouvernements successifs. Face à cette crise sanitaire et à la crise économique et sociale qui en découle, je ne sais pas si nous devons inventer le monde d'après, mais nous devrions au moins sécuriser ce que le monde d'avant a fragilisé, au nom de la loi du marché.
Les changements devront-ils se faire au sein d'un pays ou à l'échelle mondiale ? Cette question a animé les débats de la gauche pendant un siècle et demi. Je crois simplement qu'il convient de faire ce qui peut être fait à chaque niveau ; c'est parfois par des petits pas que les choses avancent. Monsieur le rapporteur, pouvez-vous me confirmer que cette proposition de loi constitutionnelle sera débattue en séance ?

Je remercie le rapporteur pour son travail de fond, très précis. Il est vrai que, lorsque nous lisons le titre, nous ne pouvons que souscrire à l'idée de protéger des « biens communs » : qui serait contre ? La question est de savoir quels moyens on emploie. Rappelons-nous le texte sur l'écocide, dont j'étais rapporteur. On ne peut qu'être favorable à la préservation de la terre et de notre système environnemental. Il n'en demeure pas moins que le dispositif était inadapté !
La protection des biens communs relève davantage de la théorie économique que du droit constitutionnel.

Nos échanges illustrent bien la difficulté à définir et à cerner la notion de « bien commun ». L'expression est employée au singulier comme au pluriel, nous y mettons des notions liées à l'environnement - climat, eau, biodiversité -, mais nous pouvons aussi être tentés d'y associer les services publics, ou encore la santé. Lors des auditions, certains ont évoqué la relation à la mort, la spiritualité, la pérennité de notre civilisation... C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas inscrire ces termes dans la Constitution sans les avoir préalablement définis avec clarté et précision. La preuve en est qu'au cours de nos échanges, l'auteure de la proposition de loi s'était inquiétée d'une proposition de définition qui, selon elle, aurait pu être interprétée comme laissant libre cours à l'action d'un exécutif peu soucieux de l'État de droit et des libertés publiques...
Ne perdons pas non plus de vue que c'est à une véritable révolution anthropologique qu'en appellent certains promoteurs des « biens communs », qui veulent rompre avec l'anthropocentrisme. Avant de toucher à la loi fondamentale, non seulement nous avons besoin d'une expertise complémentaire, mais une participation plus large du corps social est indispensable.
Quelles peuvent être les modalités de ce travail ? Ce n'est pas au modeste rapporteur que je suis de les définir, mais si nous nous accordons sur l'objectif, nous aurons parcouru une partie du chemin.
De mon point de vue, nous n'avons pas à laisser la main au Conseil constitutionnel. Il appartient au Parlement de dire la volonté du corps social.
En l'état, le texte pose un certain nombre de difficultés de forme et de fond, mais l'amender n'aurait servi à rien, sans définition et travail préalables.

Monsieur le rapporteur, je vous remercie de votre travail.
La proposition de loi constitutionnelle n'est pas adoptée.
Conformément au premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance portera en conséquence sur le texte initial de la proposition de loi constitutionnelle déposée sur le Bureau du Sénat.

Nous passons à l'examen de la proposition de loi visant à supprimer la possibilité ouverte au dirigeant d'une entreprise de déposer une offre de rachat de l'entreprise après avoir organisé son dépôt de bilan.

La proposition de loi visant à supprimer la possibilité ouverte au dirigeant d'une entreprise de déposer une offre de rachat de l'entreprise après avoir organisé son dépôt de bilan, qui a été déposée par notre collègue Sophie Taillé-Polian le 21 septembre dernier, a pour objet principal d'abroger l'article 7 de l'ordonnance du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19. Cet article a temporairement assoupli la procédure permettant aux dirigeants d'une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, ou à leurs parents ou alliés ainsi qu'à ceux du débiteur personne physique, de présenter une offre d'achat partiel ou total de l'entreprise. Ce dispositif est temporaire : il ne s'applique que jusqu'au 31 décembre 2020.
Le code de commerce interdit en principe au débiteur, à ses dirigeants ou à leurs parents ou alliés de se porter acquéreurs d'une entreprise en difficulté dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Cette interdiction s'explique par un souci bien légitime de « moralisation » de la vie des affaires. Il s'agit d'éviter, d'une part, la fraude aux intérêts des créanciers, c'est-à-dire que le débiteur ou le dirigeant ne conserve directement ou indirectement tout ou partie des actifs de l'entreprise, alors même qu'il se serait délesté du passif ; d'autre part, la fraude à l'assurance contre le risque de non-paiement des créances salariales.
En revanche, contrairement à ce que nous entendons parfois dire, cette interdiction n'est pas destinée à protéger les salariés eux-mêmes contre un détournement de la procédure de licenciement, car les formes prévues par le code du travail pour tout licenciement pour motif économique doivent être respectées.
Le droit commun prévoit des dérogations à cette interdiction, à l'article L. 642-3 du code de commerce en faveur d'abord des exploitations agricoles, ensuite, et sous de strictes conditions procédurales, des autres entreprises : le tribunal ne peut ordonner leur cession à l'un des dirigeants, à un allié ou un proche de ceux-ci ou du débiteur personne physique que sur requête du ministère public, par un jugement spécialement motivé et après avis des contrôleurs.
Dans les faits, l'exigence d'une requête préalable du ministère public impose aux dirigeants, proches ou alliés, qui souhaitent reprendre l'entreprise de lui soumettre un projet suffisamment abouti bien avant l'expiration du délai imparti aux candidats repreneurs, ce qui peut être difficile. Cette dérogation reste d'ailleurs assez peu employée. Elle n'en a pas moins révélé son utilité dans les cas où les offres d'acquisition présentées par des tiers sont, soit inexistantes, soit insuffisantes au regard du triple objectif de maintien des activités, de préservation des emplois et d'apurement du passif qui caractérise tout plan de cession.
L'assouplissement prévu par l'ordonnance est d'ordre procédural : il permet au débiteur ou à l'administrateur de former lui-même une requête en vue d'une offre de rachat, sans exiger que le ministère public la reprenne à son compte.
Ce dispositif a suscité beaucoup d'émoi en raison d'une poignée d'affaires qui ont défrayé la chronique et qui sont à l'origine, sans doute, de cette proposition de loi. Il est, toutefois, très encadré : outre que le jugement doit être spécialement motivé et rendu après avis des contrôleurs comme le droit commun l'exige, l'ordonnance rend obligatoire la présence du ministère public à l'audience, au cours de laquelle il peut présenter des observations et, le cas échéant, interjeter appel. En outre, comme c'est toujours le cas en matière de procédures collectives, l'appel du parquet est suspensif.
Au surplus, les conditions de fond régissant le choix du cessionnaire par le tribunal demeurent : l'offre choisie doit être celle qui satisfait le mieux aux trois objectifs de maintien des activités, de préservation des emplois et d'apurement du passif.
Cet assouplissement, comme nous l'ont précisé les services de la chancellerie, a été motivé par deux raisons très pragmatiques qu'il est difficile de contester. La première est d'ordre économique : on pouvait craindre que les repreneurs potentiels ne soient beaucoup moins nombreux qu'habituellement dans un contexte économique très incertain. La seconde est d'ordre moral : les dirigeants d'entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire n'en portant aucunement la responsabilité, il peut paraître légitime de leur permettre de présenter plus facilement une offre de reprise.
En outre, un examen attentif de la jurisprudence montre que les tribunaux ont fait un usage prudent de cette possibilité, le plus souvent avec l'assentiment des organes de la procédure, des salariés et du parquet, et au vu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
Par exemple, dans le cas de la société Camaïeu, le tribunal de commerce de Lille a retenu l'offre présentée par la Financière immobilière bordelaise plutôt que celle d'un consortium dont faisait partie le dirigeant de Camaïeu, en raison principalement de l'opposition du comité social et économique à cette dernière offre, justifiée notamment par le nombre légèrement plus faible d'emplois repris, et alors même que les administrateurs, les mandataires, les contrôleurs et le parquet plaidaient en faveur de l'offre du consortium.
Dans ces conditions, et après avoir entendu les acteurs concernés, je considère que la disposition critiquée ne mérite ni excès d'honneur ni excès d'indignité. En tout état de cause, il ne me paraît pas nécessaire de l'abroger, alors qu'elle est en vigueur jusqu'au 31 décembre prochain seulement. Au demeurant, cet exercice me semble un peu vain, car ce texte aurait très peu de chances d'être définitivement adopté avant cette date...
Prolonger l'application de cette mesure d'assouplissement procédural aurait pu d'ailleurs avoir du sens, éventuellement sous une forme modifiée pour dissiper toute crainte d'abus, par exemple en en subordonnant expressément le bénéfice à l'absence de toute faute de gestion de la part des dirigeants. Les difficultés des entreprises risquent d'exploser en 2021 en raison de la crise sanitaire, notamment pour ce qui concerne nos petites et moyennes entreprises, et ce dispositif aurait peut-être pu leur être utile... Les syndicats de salariés que nous avons entendus se sont d'ailleurs montrés plus ouverts à un dispositif ciblé.
Toutefois, telle n'est pas l'intention du Gouvernement d'après ce que le cabinet du garde des sceaux nous a indiqué.
Au moins l'ordonnance aura-t-elle permis aux acteurs économiques, aux praticiens des procédures collectives et aux parquets d'être désormais pleinement sensibilisés à la nécessité de faciliter les cessions d'entreprises, y compris à leurs dirigeants si cela s'avère opportun, et mieux informés des souplesses prévues par le droit commun.
Pour l'ensemble de ces raisons, je vous propose de rejeter cette proposition de loi. En application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porterait alors sur le texte initial de la proposition de loi déposée sur le Bureau du Sénat.

La proposition de loi trouve son origine dans une série d'affaires qui ont défrayé la chronique. Le dispositif aurait dû être encadré. On comprend bien que des procédures d'urgence aient été prises durant les trois premiers mois de la crise sanitaire, mais en l'occurrence, aucun garde-fou n'a été prévu, ce qui a créé des effets d'aubaine massifs inacceptables. Je comprends l'initiative de Mme Taillé-Polian.
Pour le Gouvernement, c'était « pas vu pas pris »... Il faudrait être certain que ce dispositif s'arrêtera bien le 31 décembre prochain.

Notre groupe votera cette proposition de loi, qui n'a certes qu'une dimension symbolique, car il est impossible qu'elle soit adoptée avant le 31 décembre 2020, date à laquelle l'article 7 de l'ordonnance du 20 mai 2020 cessera de s'appliquer. Par ailleurs, le cabinet du garde des sceaux a fait savoir à Mme la rapporteure que la mesure ne serait pas prorogée, ce que craignait Mme Taillé-Polian.
Néanmoins, certaines situations ont provoqué des incompréhensions et des protestations. En effet, il était possible qu'une personne mette en faillite son entreprise, fasse prendre en charge par la puissance publique un certain nombre de dépenses, notamment le paiement des salaires, puis qu'elle rachète ce qui reste de l'entreprise. Cette méthode paraît choquante, et les organisations syndicales nous ont fait part d'un certain nombre de cas où les choses se sont passées exactement comme cela.
Je me suis occupé, en tant que sénateur, d'une de ces entreprises. Selon le Comité interministériel de restructuration industrielle, avec lequel j'ai pris contact, il peut arriver que ce genre de situation ne soit en réalité ni néfaste ni condamnable : la reprise de l'entreprise par l'un de ses dirigeants peut lui permettre de perdurer, les syndicats le reconnaissent. Il n'en demeure pas moins que, dans d'autres cas, les syndicats se sont insurgés devant des procédés choquants.
Voter ce texte est un acte symbolique, mais également une mise en garde. Cela n'exclut pas de poursuivre la réflexion, et nous y sommes ouverts, car nous sommes confrontés à une crise sociale qui va devenir de plus en plus forte avec la multiplication des licenciements et des difficultés rencontrées par les entreprises.

Je m'inscris dans le droit fil des interventions de Mme Goulet et de M. Sueur.
Une règle était clairement fixée ; les exceptions, très encadrées. Avec la crise sanitaire, l'exception devient la règle. Dans certains cas, le dispositif a pu être utile à certaines entreprises. Mais d'autres, en grand nombre, ont bénéficié d'un effet d'aubaine. Vous avez cité Camaïeu ; on peut aussi évoquer Alinéa, Orchestra, Prémaman, Phildar ou Inteva Products. Ce dernier exemple correspond exactement à la situation décrite par M. Sueur : les dirigeants ont profité de l'effet d'aubaine pour effacer une partie de leur dette d'avant la crise, faciliter les licenciements de salariés, et faire prendre en charge les salaires par l'Unedic, avant de récupérer leur entreprise « allégée ».
Nous sommes convaincus que les mesures d'aides ou de facilitation à la reprise d'entreprise sont nécessaires pour faire face à la crise. Mais à force d'assouplir les règles de droit commun pour éviter les faillites, on remet en cause les dispositifs prévus pour protéger les salariés et les créanciers, et on ouvre la voie à des dérives.
Symboliquement, il est justifié de présenter une proposition de loi et de la faire voter par notre assemblée. Nous la soutiendrons.

On peut comprendre l'émoi que ces affaires ont provoqué et la volonté d'afficher un symbole qui sous-tend cette proposition de loi. Mais les choses sont claires : le dispositif prendra fin le 31 décembre prochain. Même si nous adoptions ce texte, nous n'aurions pas le temps d'aller au bout de la navette.
Je félicite la rapporteure pour son travail. Notre groupe suivra ses recommandations.

Le sujet se prête assez peu aux questions de principe. Les tribunaux de commerce connaissent bien ces situations, et les parquets interviennent de plus en plus fortement dans les procédures.
Une mission d'information sur les outils juridiques de traitement des difficultés des entreprises vient d'être mise en place par notre commission. C'est dans ce cadre que nous pourrons apporter une réponse pertinente aux difficultés actuelles. Il aurait été préférable que nous examinions cette proposition de loi à l'issue de ce travail.

Madame Goulet, je vous rassure, le dispositif prendra fin le 31 décembre prochain. La toute récente ordonnance du 25 novembre 2020 n'en a pas prolongé l'application.
Je veux rappeler que le droit commun permet déjà aux dirigeants d'une entreprise en redressement ou en liquidation de présenter une offre de reprise, sous certaines conditions. Certains d'entre vous s'en disent choqués par principe, tout en appelant à trouver les assouplissements nécessaires en temps de crise... ce qui est précisément l'objet de l'article 7 de l'ordonnance du 20 mai dernier. Soyons cohérents !
Mes chers collègues, conformément à la procédure fixée par la Conférence des présidents, il nous appartient de définir le périmètre de la proposition de loi pour l'application de l'article 45 de la Constitution relatif aux cavaliers législatifs.
Comme la proposition de loi touche, au moins formellement, à l'ensemble de l'ordonnance du 20 mai 2020, je vous propose de considérer comme recevable tout amendement portant sur les procédures de traitement des difficultés des entreprises, telles que définies au livre VI du code de commerce et au chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime.

Pour conclure, je veux rappeler que la procédure dérogatoire prévue par l'ordonnance du 20 mai 2020 va prendre fin dans quelques jours, c'est désormais acté. Selon le droit commun, hors état d'urgence sanitaire, une requête du procureur de la République est requise lorsqu'un dirigeant veut reprendre sa propre entreprise. Si le parquet refuse, le tribunal ne peut pas passer outre.
On ne peut nier que le dépôt de bilan ait pu être utilisé comme un mode de gestion de l'entreprise... La procédure permet d'empêcher de tels détournements. Notre mission d'information nous permettra d'avancer sur ce sujet important.
Mais il faut aussi dire que la majorité des dirigeants sont honnêtes ! Ils n'ont aucun plaisir à venir déposer le bilan de leur entreprise au greffe du tribunal de commerce, parce qu'une page de leur vie se tourne...
La proposition de loi n'est pas adoptée.
Conformément au premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance portera en conséquence sur le texte initial de la proposition de loi, déposée sur le Bureau du Sénat.
La réunion est close à 10 h 20.