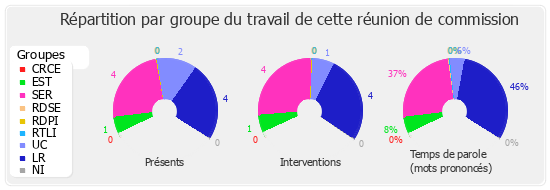Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
Réunion du 10 février 2021 à 9h30
Sommaire
La réunion

Mes chers collègues, il nous appartient de désigner un rapporteur sur la proposition de loi visant à lutter contre le plastique, qui reprend certaines propositions du rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur la pollution plastique, que Mme Angèle Préville et M. Philippe Bolo nous avaient présenté voilà deux semaines. Ses quatre articles visent spécifiquement à limiter la pollution microplastique, prolongeant certaines dispositions introduites par la loi 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite AGEC.
Cette proposition de loi sera examinée par notre commission le 3 mars prochain, avant un passage en séance publique le 11 mars suivant.
La commission désigne Mme Martine Filleul rapporteure sur la proposition de loi n° 164 (2020-2021) visant à lutter contre le plastique, présentée par Mme Angèle Préville et plusieurs de ses collègues.

Je vous propose maintenant de procéder à la désignation d'un rapporteur sur la proposition de loi visant à la création d'une vignette « collection » pour le maintien de la circulation des véhicules d'époque, qui sera examinée par notre commission le 3 mars prochain, avant un passage en séance publique le 11 mars suivant.
La commission désigne Mme Évelyne Perrot rapporteure sur la proposition de loi n° 174 (2020-2021) visant à la création d'une vignette « collection » pour le maintien de la circulation des véhicules d'époque, présentée par M. Jean-Pierre Moga et plusieurs de ses collègues.

J'en viens à la proposition de loi relative à la sécurité globale, qui, sous réserve de ce que décidera la Conférence des présidents qui se réunit cet après-midi, devrait être examinée en séance publique du mardi 16 au jeudi 18 mars prochain.
La proposition de loi comportait initialement deux articles sur la sécurité dans les transports et la sécurité routière. L'Assemblée nationale l'a enrichie et ce volet comprend désormais une petite dizaine d'articles portant notamment sur la sûreté dans les gares et dans les transports, la vidéoprotection, la sécurité ferroviaire, la sécurité routière ou encore la surveillance des drones.
Du fait de l'accroissement du nombre de dispositions concernant les transports et dans la continuité des travaux antérieurs menés par la commission, une saisine pour avis sur les dispositions du texte dans le domaine des transports nous a parue souhaitable. En effet, l'acte de partage établi en 2012 confie à notre commission compétence en matière de transport et de sécurité routière. Nos travaux s'inscriront en complément de ceux de la commission des lois, saisie au fond de ce texte.
La commission désigne M. Étienne Blanc rapporteur pour avis sur la proposition de loi n° 150 (2020-2021), adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la sécurité globale.

Par ailleurs, le président Larcher, que j'ai rencontré hier soir, m'a confirmé que l'examen au fond du projet de loi Climat, présenté aujourd'hui en conseil de ministres, échoirait bien à notre commission et non à une commission spéciale. Je remercie d'ailleurs Didier Mandelli pour le soutien qu'il m'a apporté pour que notre commission pilote l'examen de ce texte que nous examinerons mi-juin.

Nous accueillons aujourd'hui M. Hubert du Mesnil, président de Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT), qui est, depuis 2015, le promoteur public contrôlé par la France et l'Italie chargé de la réalisation des travaux définitifs de la section transfrontalière et qui en assurera l'exploitation.
Vous le savez, la liaison Lyon-Turin est l'un des mégaprojets européens d'infrastructures de transport. Cette liaison est composée d'un tunnel transfrontalier, de 57 kilomètres de long, et d'environ 150 kilomètres de lignes nouvelles.
Il s'agit d'un projet ancien, entériné en 1994. Depuis lors, quatre accords entre la France et l'Italie ont été signés sur ce sujet, la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) a précisé que « l'État confirme son engagement dans la réalisation de la liaison ferroviaire internationale fret et voyageurs Lyon-Turin » et une dizaine de kilomètres du tunnel de base ont été creusés. Pourriez-vous nous faire un point d'avancement sur le chantier ?
Le Lyon-Turin, qui a vocation à s'inscrire dans le corridor méditerranéen du réseau de transport transeuropéen de transport (RTE-T), vise trois objectifs.
Son ambition est d'abord d'assurer un report modal vers le rail, tant du fret que des voyageurs, et de réduire le temps de trajet entre Lyon et Turin. À cet égard, pourriez-vous revenir sur la ligne de la Maurienne, qui relie déjà la région Rhône-Alpes à la frontière italienne, et sur les raisons qui ont conduit à privilégier la réalisation d'une nouvelle ligne ?
Ce projet vise ensuite à sécuriser les transports dans les Alpes franco-italiennes, après les drames que nous avons connus dans les tunnels du Mont-Blanc en 1999, et de Fréjus en 2005.
Son objectif est enfin de réduire les émissions polluantes et les nuisances sonores sur ce trajet. Sur ce dernier point, pourriez-vous nous en dire plus sur l'estimation de l'impact environnemental du projet ?
Avant de vous laisser la parole, je souhaite vous interroger sur trois points.
D'abord, pourriez-vous nous éclairer sur le calendrier du projet ? L'objectif de mise en service en 2030 est-il maintenu ? La ministre italienne des transports a annoncé en décembre dernier que 2032 était une « hypothèse plus raisonnable ». Qu'en pensez-vous ? En outre, dans son rapport de juin dernier, la Cour des comptes européenne estimait que la liaison ne serait probablement pas prête d'ici là et elle estimait que le chantier connaissait un important retard, qu'elle chiffrait à quinze années.
Nous souhaitons ensuite bénéficier de votre éclairage sur le financement du projet. Le protocole additionnel de mars 2016 fixe le coût de la section transfrontalière à 8,3 milliards d'euros. Là aussi, la Cour des comptes européenne a pointé dans son rapport d'importants dérapages budgétaires, avec une augmentation des coûts de 85 %. Qu'en est-il, d'après vous ? Pouvez-vous rappeler les parts respectivement prises en charge par la France, l'Italie et l'Union européenne, tant pour le tunnel de base que pour les voies d'accès ? Sur ce dernier point en particulier, l'Union s'est dite prête à financer 55 % des voies d'accès ; comment cette nouvelle a-t-elle été accueillie côté français ?
Enfin, ma dernière question porte sur les critiques dont le projet a pu faire l'objet. Dans un référé datant de 2012, la Cour des comptes en formulait un certain nombre, à savoir la faible rentabilité socioéconomique du projet, la révision à la baisse des prévisions de trafic, les incertitudes en matière de financement et le pilotage insuffisant de l'opération. Comment avez-vous réagi face à ces observations ? Les difficultés soulevées voilà près de dix ans ont-elles été toutes réglées ?
Je suis engagé depuis longtemps sur ce projet, puisque j'ai participé, en 2001, à une étape importante, avec le ministre Jean-Claude Gayssot, quelque temps après l'accident du tunnel du Mont-Blanc. À cette occasion, la France et l'Europe ont pris conscience du problème majeur que représentait la circulation des poids lourds dans les traversées alpines.
Il y a eu une longue période d'études, de travaux de reconnaissance et d'explorations géologiques. Certains ont trouvé cette période trop longue ; pour ma part, je pense que nous avons a eu raison de prendre le temps d'étudier la constitution de cette montagne. Une partie des délais a été due aux difficultés italiennes et aux violentes oppositions s'étant manifestées dans la vallée de Suse, qui ont obligé à reprendre le projet. On s'interrogeait encore récemment sur l'attitude de nos amis italiens, mais nous sommes maintenant entrés dans une phase définitive, à savoir le creusement du tunnel principal lui-même. En effet, nous préparons les appels d'offres pour attribuer les marchés de réalisation du tunnel. Nous sommes donc dans une phase de réalisation massive, puisque ces appels d'offres pour la réalisation du tunnel représentent 4 milliards d'euros.
Par ailleurs, pourquoi une nouvelle ligne ? Cette ligne appartient au réseau européen. L'Union européenne veut réaliser, depuis longtemps, un réseau ferroviaire de grande capacité, à l'échelle européenne, pouvant traiter tant le fret que les voyageurs. Ce réseau est structuré autour de neuf corridors ; il s'agit en l'espèce du corridor sud, dit « Méditerranée », qui va du sud de l'Espagne à l'est de l'Europe. Il passe par Montpellier, remonte vers Lyon, traverse les Alpes puis continue vers l'Italie et vers l'est.
Il existe déjà une ligne allant de Lyon à Turin, via le tunnel de Fréjus, donc pourquoi en réaliser une deuxième ? Le tunnel de Fréjus date de 1871 ; cette ligne historique ne peut pas répondre aux objectifs actuels, ce sujet doit être clos de manière claire. Il y a deux raisons à cela.
D'une part, cette ligne n'est pas adaptée au fret, puisqu'elle ne permet pas un trafic de grande capacité et à grande vitesse. En effet, s'agissant d'une ligne de montagne, il faut couper le train en deux - il ne peut peser plus de 600 tonnes - et il faut prévoir deux, voire trois locomotives. C'est donc coûteux et inefficace.
D'autre part, il s'agit d'un tunnel monotube. Or la réglementation européenne exige deux tubes pour le transport de fret sur des trains de grande capacité, comme le tunnel sous la Manche. Du reste, le tunnel que nous construisons sous les Alpes est l'équivalent de ce tunnel : deux tubes indépendants à voie unique, permettant que les trains ne se croisent pas, avec des possibilités de passage d'un tunnel à l'autre en cas d'accident.
La ligne historique peut faire passer des trains, mais en très faible quantité. Le trafic annuel est aujourd'hui d'environ 3 millions de tonnes alors qu'il était de plus de 10 millions de tonnes il y a quelques années.
Sur l'impact environnemental, commençons par l'aspect négatif : chaque fois que l'on fait des travaux dans la montagne, on produit du dioxyde de carbone, donc le bilan commence par être négatif. Toutefois, il devient ensuite positif, puisque l'on supprime les camions pour les mettre sur les trains.
Aujourd'hui, 8 % du trafic passe par le rail, et 90 % par la route. En Suisse, plus de 60 % du trafic passe par le rail. Notre objectif est d'atteindre près de 50 %. On supprimera des camions, en faisant passer un million de camions sur les trains plutôt que sur la route.
Nous allons donc produire des nuisances environnementales au début, avec le chantier, puis nous redresserons la situation en supprimant des camions. On peut discuter du nombre d'années nécessaires pour que le bilan devienne positif ; je ne suis pas expert, je ne prends pas position. Je veux néanmoins limiter au maximum les nuisances environnementales liées au chantier puis faire en sorte, une fois le tunnel ouvert, de mettre le plus vite possible les camions sur les trains.
J'en viens au calendrier. L'objectif fixé par les financeurs - l'UE, à hauteur de 40 %, l'Italie et la France - est 2030. Il a été dit que l'on n'y arriverait pas. Je ne sais pas ; ce calendrier est tendu, mais nous essayons de le tenir. La crise sanitaire nous ralentit, sans nous bloquer. Nous gardons l'objectif de 2030, car il figure dans le contrat qui nous lie à l'Europe et aux deux États impliqués. Notre devoir est de faire tout notre possible pour le respecter.
Fin 2021, nous négocierons le nouveau contrat de financement avec l'UE ; nous rediscuterons donc du calendrier. Faudra-t-il garder 2030 ou décaler le programme de deux années ? Je laisse les responsables des trois entités prendre en considération nos difficultés ; elles ne sont pas énormes, mais elles sont réelles. Il y a toutefois un arbitrage entre le coût et le calendrier ; augmenter le nombre de tunneliers permet d'aller plus vite, mais coûte plus cher.
J'en viens au budget. Le coût, estimé à 8,3 milliards d'euros, est financé à 40 % par l'Europe, à 35 % par l'Italie et à 25 % par la France. Cette estimation est la même depuis que le projet a été lancé, elle n'a pas changé. En 2012, les États se sont mis d'accord sur le processus et la création du promoteur ; en 2015 : le projet a été lancé, avec cette estimation. Tiendrons-nous jusqu'au bout ? Je ne fais pas de pronostic, nous faisons tout pour maintenir le budget, mais il n'est pas vrai que le budget ait flambé.
J'appelle votre attention sur le fait que ce montant concerne le tunnel lui-même, dont nous sommes chargés. Au-delà, il y a les accès au tunnel, du côté italien et du côté français ; ce sont deux autres projets. L'objectif est d'aménager l'ensemble de l'itinéraire Lyon-Turin, mais cette estimation ne porte que sur le tunnel.
La société binationale franco-italienne TELT, totalement publique, contrôlée à 50-50 par les deux États, est chargée du tunnel. Toutefois, il faut une coordination sur l'ensemble de l'itinéraire, parce que, dans le tunnel, les trains de voyageurs circuleront à 220 kilomètres par heure et les trains de fret à 120 kilomètres par heure. Si le tunnel est terminé, mais que les accès ne sont pas aménagés, on ne pourra pas utiliser les capacités du tunnel.
Nous soutenons donc les projets d'aménagement des voies d'accès, qui font l'objet de discussions difficiles. Faut-il commencer par Lyon, par Chambéry ? Ce n'est pas de notre compétence, mais le projet des voies d'accès doit être bien conduit.
L'Union européenne est sur la même ligne, au point qu'elle a offert une contribution pour financer les voies d'accès. Nous espérons que cela accélérera l'aménagement de ces voies. C'est déjà réglé du côté italien ; du côté français, c'est plus compliqué, plus long, plus coûteux. La France souhaitait attendre la construction du tunnel pour aménager les accès, mais cela repousserait cet aménagement à une date trop lointaine. Cela n'a pas été accepté à l'échelon européen. Nous travaillons avec SNCF Réseau pour avoir plus rapidement un programme phasé d'aménagement. D'ailleurs, la Commission a fait savoir qu'elle souhaitait augmenter de 40 % à 50 % son financement, avec un bonus de 5 %, car notre société binationale est un bon élève. Cela porterait le financement européen à 55 %, ce qui est exceptionnel ; ce projet a donc une dimension européenne forte et il a cheminé grâce à la détermination forte de l'Union.
Je connais les critiques qui nous ont été adressées, notamment celles de la Cour des comptes. En l'occurrence, la notion de rentabilité a été évaluée par huit méthodes différentes ; selon que l'on s'appuie sur une année de crise ou sur une année de croissance, nous obtenons des résultats différents. Toutefois, si l'on raisonne sur le très long terme, si l'on accepte l'idée que cet ouvrage est fait pour durer cent ans, cela ne change plus grand-chose. Je ne prends pas position dans ce débat. Ces méthodes ont été discutées et les autorités nationales et européennes ont décidé qu'il fallait se lancer dans le projet ; nous le faisons le mieux possible.
La société du TELT est considérée comme un bon élève par Bruxelles. Cette société binationale est complètement publique. C'est une condition que j'avais mise pour participer au projet ; j'ai vécu de près la construction du tunnel sous la Manche et je voyais qu'il fallait une société publique. Cela dit, cette société binationale est une organisation originale et cela demande des efforts d'adaptation culturelle entre les équipes françaises et italiennes, mais, si l'on accepte les différences, cela donne des résultats très bons, car il y a un personnel de grande qualité des deux côtés.
Du reste, les entreprises qui interviennent dans les chantiers sont presque toujours multinationales. Les groupements attributaires comptent des Français, des Italiens et souvent des Suisses ; ils associent des équipes de nationalités différentes, souvent des frontaliers, et cela fonctionne bien.
Un autre sujet qui nous importe, en dehors de l'environnement, est l'intégrité ; nous avons un mécanisme strict de contrôle pour éviter toute intrusion de la mafia.

Monsieur le président, je suis heureux de votre nomination à la présidence du TELT ; en tant qu'ancien président de Réseau ferré de France, vous connaissez parfaitement notre réseau ferroviaire.
Notre commission a créé une mission d'information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux, dont ma collègue Nicole Bonnefoy et moi-même sommes rapporteurs. Nous avons entendu dans ce cadre des propos contradictoires sur l'avenir du fret ferroviaire ; certains y croient beaucoup et envisagent un doublement de la part du ferroviaire, passant de 9 % à 18 %, d'ici à 2030, quand d'autres estiment qu'il faut renoncer à cette chimère du report modal.
Le projet du Lyon-Turin est fort heureusement fondé sur la première hypothèse. Quelles sont les prévisions de trafic sur cette liaison ferroviaire et quels sont les leviers pour favoriser le report modal ? Je pense notamment aux aides à l'exploitation et à la qualité de service.
Par ailleurs, pouvons-nous espérer que le Lyon-Turin augmente suffisamment le trafic de la ligne à grande vitesse (LGV) Paris-Lyon pour que soit construite la ligne Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon (POCL), qui aménagerait le territoire et doublerait cette LGV ?
Je commence par votre question sur les prévisions de trafic et la question du report modal. Quand le projet a été lancé, la SNCF avait l'intention de développer un réseau de TGV européen. Quand les États ont repris en main le projet et quand l'Union européenne l'a inscrit dans son projet de réseau, la composante du fret est devenue dominante, même si le tunnel doit être mixte.
Ainsi, si l'on pense que le fret ferroviaire n'a pas d'avenir ni d'intérêt, il faut mettre fin au projet, qui ne peut pas se défendre si l'on a seulement la perspective du transport de voyageurs. Il y a d'autres projets de transport de voyageurs qui sont plus urgents en France, dont celui que vous mentionnez.
Ce projet n'a donc d'intérêt que si l'on croit que le report modal est possible et nécessaire. Est-il nécessaire ? Tout le monde voit bien son intérêt environnemental. Est-il possible et à quelles conditions ? Nous partons avec un handicap important, car nous sommes parmi les pays européens dont le fret ferroviaire est au plus bas. Si l'on pense que l'on ne peut pas faire mieux et qu'il faut se contenter du trafic autoroutier, il faut renoncer au projet.
Néanmoins, je ne crois pas que ce soit impossible. J'ai été très impressionné, dans les années 2000, par ce qui s'est passé en Suisse. La situation alpine de ce pays rend le trafic difficile, mais les Suisses ont refusé le laisser-aller du transport routier et ont fait ce qu'il fallait pour assurer le report modal, c'est-à-dire investir dans des infrastructures performantes de fret, avec deux grands tunnels nord-sud à travers les Alpes, déjà terminés, et réguler le trafic routier, c'est-à-dire faire payer. Ils l'ont fait avec un soutien populaire fort. Ils ont donc les mêmes difficultés que nous, mais ils ont construit leurs tunnels et, maintenant, plus des deux tiers du trafic passent par le rail. Ce qui a été fait en Suisse relève de la même logique, du même objectif - la lutte contre la pollution, le développement ferroviaire - et des mêmes difficultés que nous. Pourquoi ce qui est possible en Suisse ne le serait-il pas en France ?
Toutefois, cela ne suffit pas. Si nous pensons être aussi capables qu'eux, pour que le fret ferroviaire soit important, il faut d'autres conditions, notamment la qualité de service et l'existence de sillons. Une fois que le train a traversé les Alpes, il doit passer par Lyon puis remonter vers le nord. Les sillons réservés au trafic de marchandises doivent être de qualité. Il faut donc, pour le fret, les mêmes exigences de fiabilité et de sécurité que pour les trains de voyageurs. On le sait, quand il y a des travaux ou des mouvements sociaux, les trains de fret ne passent pas, il n'y a pas d'engagement de qualité de service. Le report modal n'aura lieu que s'il y a une volonté en ce sens et cette volonté est largement partagée.
D'autre part, un effort national est nécessaire, avec des moyens financiers, des investissements sur le réseau et des priorités en faveur du trafic de marchandises pour que ce trafic réponde aux mêmes exigences de qualité ici qu'ailleurs. En Suisse et en Italie du Nord, on est étonné de la façon dont le transport de marchandises est traité. Nous avons, en France, des TGV ultraperformants, mais notre système pour les trains de marchandises a des années de retard.
Il faut donc travailler sur tous ces registres, mais l'idée que le report modal n'est plus opportun me choque profondément.
Sur la question de la ligne Paris-Lyon, je serai moins capable de vous répondre. L'attention de Bruxelles porte sur le corridor sud - Espagne, sud de la France jusqu'à Lyon, puis traversée des Alpes. Le Paris-Lyon n'y appartient pas. Cela dit, le raccourcissement considérable de la durée des trajets devait augmenter le trafic vers Turin, puisque l'on gagnera deux heures.
Il faut réfléchir au sujet Paris-Lyon en tenant compte des perspectives de croissance du trafic italien. Je ne sais pas où en est le projet de doublement sur lequel j'avais travaillé à l'époque. Les progrès techniques et l'amélioration des outils de signalisation devraient permettre de densifier encore les lignes actuelles. Je ne peux dire comment évoluera le trafic TGV dans ce monde où tout change si vite, mais l'axe Paris-Lyon restera la flèche de notre réseau national.
Très peu de passagers empruntent aujourd'hui le Paris-Turin, car le trajet est trop long. Nous allons gagner deux heures entre Lyon et Turin et je pense, même si d'autres sont plus compétents que moi pour évoquer ces questions, que la proximité entre ces deux dernières villes devrait conduire à un développement du trafic, y compris avec Paris.

Comme vous l'avez souligné, le projet Lyon-Turin soulève de nombreuses critiques, notamment quant à sa rentabilité. Les prévisions d'évolution du trafic de passagers et de marchandises font l'objet de désaccords, tout comme le coût écologique de la ligne. Au-delà de ces critiques, qu'en est-il des toutes dernières estimations pour assurer la rentabilité économique et environnementale du projet ?
Ce dernier, tout comme le merveilleux canal Seine-Nord Europe, a été retenu par la Commission européenne au titre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE). Il est donc financé à hauteur de 40 % par des fonds européens. Souhaitez-vous également bénéficier du plan de relance européen ?

En ce qui concerne le report modal, vous avez évoqué l'exemple suisse, mais vous êtes resté assez flou sur les perspectives. Disposez-vous aujourd'hui de chiffres stabilisés ?
Avec Michel Vaspart, nous nous sommes demandé, dans le cadre de la mission d'information relative à la gouvernance et à la performance des ports maritimes, si le tunnel, les aménagements qui pourraient se faire sur l'axe routier Lyon-Turin et le canal Seine-Nord Europe ne conduiraient pas à privilégier les flux vers les ports du Nord, au détriment des ports français, notamment celui de Marseille. M. Vaspart s'intéressait particulièrement à la présence chinoise dans les ports italiens et à la question des routes de la soie. Pouvez-vous nous faire part de vos sentiments ?

Il s'agit d'un dossier essentiel pour l'économie et l'ouverture internationale de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sachant que notre histoire est tournée vers l'Italie du Nord.
L'Europe accepte aujourd'hui de financer le tunnel de base à hauteur de 50 %. Or la priorité de Bruxelles est le transport du fret, non celui des voyageurs, pour des questions non seulement environnementales et économiques, mais aussi d'ouverture vers l'Europe de l'Est. Toutefois, pour que le fret soit effectivement au coeur de cet investissement, il faut améliorer les voies d'accès au tunnel de base, soit par la création d'une ligne directe entre Lyon et Saint-Martin-La-Porte, soit par l'amélioration de la ligne Dijon-Modane, sur les bords du lac du Bourget et traversant Chambéry. Les élus de la région ont donné leur priorité à une liaison directe entre Lyon et Saint-Martin-La-Porte. Quelle est la position de TELT ?
Nous avons, avec l'Italie, et même avec l'Europe, une discussion sur les délais. Bruxelles envisage de prendre un acte d'exécution pour s'assurer qu'ils seront bien tenus. Quelles décisions, quels actes juridiques, financiers et diplomatiques précis attendez-vous pour que ce délai de 2030 soit respecté et lever ainsi les craintes de la ministre italienne des transports, laquelle s'attend à un report au-delà de 2032 ?
Je ne me sens pas capable de décider quelle est la courbe du trafic qui justifie l'existence du tunnel. Après la crise financière de 2008 et la baisse de trafic qu'elle a induite, on a pensé que le projet ne se justifiait plus. Mais deux ou trois ans plus tard, le trafic était reparti à la hausse. Nous connaissons de nouveau une période difficile. Je suis totalement incapable de la moindre prévision. Il faut faire des études, certes, mais ce n'est pas à elles de dicter ce qui relève avant tout d'une décision politique.
Cet axe aura d'abord pour rôle de faciliter les liens entre les deux régions économiques Auvergne-Rhône-Alpes et Piémont, qui ont déjà beaucoup de raisons de multiplier leurs échanges - personnes et marchandises. Si l'on élargit notre vision, cet itinéraire permet de relier l'Espagne, le sud de la France, le nord de l'Italie et le nord de l'Europe. Il s'agit d'enjeux économiques déjà considérables.
Ce qui est certain, c'est que notre projet permet de faire passer un million de camions, soit une part significative des poids lourds qui traversent aujourd'hui les Alpes par les trois axes Mont-Blanc, Fréjus et Vintimille. Cela ne sera possible que si ces camions trouvent, de part et d'autre, des itinéraires et des réseaux suffisamment prioritaires pour passer.
Ce projet s'inscrit bien dans le Green Deal européen et les choix stratégiques pour accélérer les politiques de lutte contre le changement climatique et la transition écologique. C'est aussi la raison pour laquelle la Commission insiste pour lever tous les doutes sur la réalisation de notre projet, dans les délais.
Nous bénéficions du plan de relance français à hauteur de 200 millions d'euros et nous nous inscrivons également dans la politique européenne de relance économique.
Madame Filleul, je ne pense pas que ce projet soit défavorable aux ports français. Je ne vois pas pourquoi le port de Marseille, qui dispose de capacités absolument remarquables, serait pénalisé par rapport aux ports italiens. Certes, avant la crise, les Italiens ont fait les yeux doux à la Chine. À l'époque, on attendait de la Chine financements et soutien aux grands trafics internationaux. J'ai toujours été très réservé sur ces questions : ma mission n'était pas d'accueillir plus facilement le trafic chinois. Nous avons déjà beaucoup à faire dans nos territoires.
Il est possible d'améliorer les voies d'accès, notamment l'axe Dijon-Modane. J'ai beaucoup de sympathie pour cet itinéraire magnifique, le long du lac du Bourget, mais ce n'est plus le corridor Méditerranée. Notre sujet est d'aller à Lyon, puis de descendre vers l'Espagne. Je ne me prononce pas sur l'intérêt d'améliorer la desserte de Dijon, je dis simplement que cela ne résout pas le gros problème lyonnais - traversée de la ville, gare de la Part-Dieu... Nous n'échapperons pas à un important effort d'investissement pour traiter le noeud lyonnais.
Dans le langage bruxellois, l'acte d'exécution permet à l'Europe d'intervenir dans un rôle de coordinateur des travaux. La France a tendance à dire que chacun doit rester chez soi dès qu'il est question des accès français, mais nos amis italiens souhaitent évoquer ces questions, car l'itinéraire est unique. Le rôle de Bruxelles est donc important.
Au total, la France ne finance que 25 % du coût du tunnel. À côté de la question de la rentabilité économique, on peut se demander si la France n'a pas intérêt, en ne payant que 25 % de cet ouvrage, à développer un équipement de transport ferroviaire fret de grande dimension.
Toujours est-il qu'il s'agit d'une volonté européenne durable, qui remonte à plus de trente ans. Les majorités et les gouvernements se sont succédé, mais l'Europe est toujours restée sur la même ligne.

Les Suisses ont montré de façon éclairante la nécessité de mener une politique globale. Ils ne se sont pas contentés de lancer la construction de leur ensemble de tunnels de base. Ils ont fixé, en 1992, le nombre maximal de poids lourds autorisés pour les traversées transalpines et se sont donné les moyens de faire bouger le curseur modal avant la mise en service des tunnels en amenant le ferroviaire à 60 %. Pour ce faire, ils ont non seulement mis en place la redevance poids lourd liée à la prestation, l'éco-redevance, mais aussi utilisé à plein régime la ligne ferroviaire historique.
En France, j'ai le sentiment que nous commettons une erreur de priorisation. Une fois le tunnel de base achevé, ne risque-t-on pas de se retrouver avec une cathédrale dans le désert, faute d'avoir suffisamment fait bouger le curseur modal ?

Avec le tunnel de Tende, plus petit, ma région connaît également les questions environnementales, de coût, de probité et de dialogue qui se posent entre Français et Italiens. Votre projet accuse d'ailleurs un retard de quinze ans, tout comme le nôtre.
J'aimerais revenir sur les changements politiques que vous subissez, notamment du côté italien - il me semble que la ministre des transports n'est plus en poste et qu'il n'y a toujours pas de gouvernement... En France, ce projet avait été porté à l'origine par les écologistes, ce qui est plutôt logique au regard de l'effort engagé sur le fret ferroviaire. Or j'ai du mal à comprendre l'opposition du nouveau maire de Lyon. Comme certains de mes collègues, je me demande si un projet né dans les années 1990 est toujours d'actualité aujourd'hui, notamment au regard des évolutions énormes que nous avons connues, ces dernières années, en termes de mobilité.
Nous avons obtenu, avec le président Muselier, la prolongation de ce fameux corridor européen sud entre Gênes et Marseille. Or, à chaque fois que je me suis rendu à Bruxelles pour discuter de ces questions, j'ai eu l'impression que l'Europe souhaitait davantage ce projet que la France et l'Italie. J'ai même pu croire que l'Europe leur forçait la main en expliquant qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Pouvez-vous nous rassurer sur ces différentes interrogations ?
Certaines évolutions politiques conduisent à des changements, à des questionnements, voire à des critiques. Je suis très troublé par la position des partis ou des mouvements écologiques. D'abord favorables au projet, en ce qu'il donnait priorité au report modal et au respect de la convention alpine, ils s'y opposent aujourd'hui. Report modal et protection de l'environnement sont pourtant les principales raisons d'être du tunnel. Et ces raisons sont aujourd'hui combattues par ceux-là mêmes qui les défendent, estimant que la voie actuelle suffit.
Nous n'arrivons pas à aborder ces questions de manière objective. La question de savoir combien de trains peuvent passer sur la ligne est rationnelle et appelle une réponse rationnelle, hors idéologie ou sensibilité. Il s'agit d'une analyse objective qui peut être vérifiée, expertisée. Or nous n'y arrivons pas et nous restons sur un malentendu fondamental. Nous en sommes là. Je ne sais pas si nous parviendrons à concilier nos positions, alors même que nous devrions partager la même ligne de préoccupations environnementales.
La politique italienne est assez subtile. En Italie du Nord, la volonté est très largement partagée dans les milieux économiques et politiques. Seul le Mouvement 5 étoiles s'y oppose, relayant ainsi les contestations très fortes de la vallée. Je pense que nos amis italiens ont commis une erreur en n'associant pas les territoires au lancement du projet, contrairement à ce que nous avons fait en France. Le tracé, réalisé de manière très technocratique, s'est heurté à un rejet total des élus et des habitants de la vallée, où circulait déjà une autoroute. Il n'y a pas eu de vrai débat public comme nous en connaissons. Le Mouvement 5 étoiles est resté dans cette opposition, mais sa collaboration au gouvernement Conte n'a pas freiné l'avancée du projet. Un point d'équilibre politique a été trouvé et il semble que la classe politique italienne y soit aujourd'hui globalement favorable.
Si la France a toujours avancé, on ne peut pas dire non plus qu'elle ait fait preuve d'une volonté farouche ni d'un très grand dynamisme pour aboutir. De fait, le projet a toujours été poussé par les présidents de la République successifs pour des raisons de rapprochement stratégique des régions européennes et de politique franco-italienne.
Je ne me place pas sur le terrain politique. Nos autorités publiques me fixent des objectifs que je m'efforce de remplir. Mon travail consiste à fournir aux deux États les éléments les plus précis possible pour que les politiques prennent les décisions. Ensuite, nous faisons le travail qui nous est demandé. Nous avons réussi à tenir ce cap, avec mon collègue italien directeur général, quelles que soient les péripéties politiques.
Fondamentalement, vous avez raison de dire que ce projet a tenu parce que l'Europe croit à ce réseau ferroviaire européen à grande dimension et à grande capacité. Elle croit que ce projet doit se faire pour permettre au corridor sud de fonctionner. Cette volonté a d'ailleurs permis de bousculer certaines résistances culturelles franco-françaises : nos concitoyens sont tous passionnés par le transport de voyageurs, mais bien peu par celui des marchandises. Lorsque je travaillais à Réseau ferré de France et que je voulais accorder une certaine priorité aux trains de marchandises pour leur permettre de rouler, on m'expliquait que je n'étais qu'un technocrate éloigné des problèmes des gens. Le président Huchon m'expliquait notamment que mes trains de marchandises qui ne pouvaient pas contourner Paris ne l'intéressaient pas, parce que son problème principal était d'assurer le trafic des RER. Je comprends bien la position d'un président de région, mais si les trains de marchandises ne peuvent ni traverser ni contourner Paris, il n'y aura tout simplement pas de trains de marchandises en France. Il est donc essentiel de trouver des compromis.

Vous nous avez indiqué que l'Europe soutenait ce projet, ce qui constitue la condition de sa réussite, et prévoyait même d'augmenter son financement. Vous avez également souligné que neuf sillons étaient concernés en Europe, ce qui procédait d'une volonté politique de développer le fret ferroviaire.
Il semblerait, comme l'a souligné M. Fernique, que nos infrastructures ne permettent pas aujourd'hui de desservir l'accès à ce tunnel. Quand pensez-vous que la fluidité du trafic pourra être assurée côté français sur cette infrastructure très importante pour l'aménagement même du territoire européen ?

Dans ce projet véritablement politique, la rationalité économique stricte peut être questionnée. Or vous ne m'avez pas rassuré sur un des points de fragilité énorme du projet, à savoir l'accès français au tunnel. Vous avez dit, de manière quelque peu ombrée, que votre objectif était de faire entrer un million de camions dans le tunnel. Or la réalisation de cet objectif environnemental que nous devons soutenir, a fortiori maintenant que le tunnel est quasiment achevé, nécessitera l'existence de réseaux de qualité en amont et en aval. Et c'est là qu'est la fragilité.
Je ne peux qu'inviter notre commission à recevoir une délégation suisse pour nous exposer le système mis en place. Comme l'a rappelé Jacques Fernique, les Suisses ont de la visibilité et des ressources affectées. Le directeur général adjoint du ministère suisse m'avait fait une remarque amusée, expliquant que des ressources affectées et une programmation sur quinze ans permettaient d'éviter beaucoup de bêtises, notamment de nombreux allers et retours inutiles.
On a évoqué l'ampleur des rénovations, qui pourraient s'étendre jusqu'à Dijon. Les camions auront-ils alors l'obligation d'emprunter des réseaux combinés dans des conditions acceptables ? Certains questionnent globalement le fret ferroviaire, mais il a ses champs de pertinence, notamment pour les longues distances. Demain, un camion venant d'Amsterdam pour aller en Italie sera-t-il obligé d'emprunter une autoroute ferroviaire qui passera par le Lyon-Turin ?

J'ai eu la chance, lorsque j'étais rapporteur de la loi d'orientation des mobilités, de découvrir ce chantier. Je rappelle que c'est l'un des plus grands chantiers du siècle par sa durée, par les volumes et par le nombre d'entreprises et de personnels engagés. N'oublions pas qu'il s'agit d'une prouesse technologique assez exceptionnelle, qui traduit le niveau technique de nos entreprises, de nos ingénieurs et de nos techniciens. Je crois que nous pouvons en être fiers. On a parfois tendance à oublier l'ampleur de cette belle réalisation et le niveau d'engagement des personnels concernés. Je souhaiterais que la commission puisse visiter ce chantier.
Je suis très sensible à votre témoignage. Je vous confirme que je serais très heureux de recevoir une délégation de votre commission.
Nous constatons que les personnes qui viennent voir le chantier n'ont pas la même appréciation du projet, d'abord parce qu'ils voient que cela commence à ressembler à un tunnel, que l'ouvrage est assez beau esthétiquement et que des entreprises françaises, italiennes et suisses réalisent des prouesses techniques absolument remarquables. Il s'agit vraiment d'un projet d'échelle mondiale. Les entreprises et les personnels font un travail qui n'est pas toujours facile. En outre, malgré la crise sanitaire, le chantier n'a pratiquement pas été arrêté : des dispositions extrêmement rigoureuses ont été prises, qui ont permis au chantier de se dérouler sans accident. Il faut saluer l'intelligence des entreprises ainsi que le travail de recherche et d'innovation.
Pour ce qui concerne le calendrier des accès, le projet est prêt du côté italien. Son financement va être assuré par le plan de relance italien, très largement soutenu par l'Europe. Il est prévu que, dans un premier temps, la ligne existante soit aménagée jusqu'à Turin, qui est proche de Suse. Ce ne sera donc pas difficile à réaliser.
Côté français, les choses ont été relancées il y a un peu plus de deux ans. SNCF Réseau réalise actuellement un travail pour reprendre le projet que nous avions préparé à Réseau ferré de France. Ce projet d'accès était abondant, puisqu'il prévoyait deux lignes nouvelles de Lyon jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne, l'une pour le fret et l'autre pour les voyageurs. Ce projet a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP). Il a été attaqué devant le Conseil d'État, qui l'a approuvé. Comme il est trop coûteux, le ministère a décidé de créer une commission de travail, présidée par le préfet, qui consiste à reprendre le projet qui a fait l'objet de la DUP et à le simplifier pour que la continuité du trafic soit assurée au moment de l'ouverture du tunnel, donc à l'horizon de 2030, et que l'on procède par étapes, une première étape permettant d'assurer un écoulement normal du trafic en 2030 dans le corridor qui va vers Lyon.
Deux scénarios, correspondant à deux itinéraires possibles, ont été approfondis. Le choix entre ces deux scénarios sera effectué l'année prochaine dans le cadre de la DUP. L'obstacle très important de la DUP ayant été franchi, le calendrier peut être compatible avec l'horizon de 2030-2032. Le choix entre les deux scénarios n'est pas facile. L'un accorde une priorité nette au fret et n'améliore pas beaucoup la situation pour les voyageurs dans un premier temps. Il y a un arbitrage à faire. Quoi qu'il en soit, la situation s'est plutôt bien rétablie. Quand le scénario sera choisi, nous pourrons aller de l'avant.
Il est vrai qu'il vaudrait mieux, pour un projet aussi long, que les financements soient assurés. Tel n'est pas vraiment le cas. L'Italie est le seul pays à assurer un financement pluriannuel du projet, le gouvernement Monti ayant fait voter un budget pluriannuel correspondant à 80 % de la part de l'Italie et à 35 % du coût total.
En France, nous sommes dépendants d'un vote annuel. Le financement de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afitf) doit être renouvelé chaque année, même si nous avons l'engagement politique de l'État, qui nous autorise à signer les marchés.
Un travail a été réalisé voilà trois ou quatre ans pour proposer des financements d'une autre nature, notamment l'appel à l'eurovignette et un montage financier reposant sur un emprunt, qui n'a pas été accepté. La discussion n'est pas définitivement close, le respect des critères d'endettement étant en train d'être reconsidéré. Il est sans doute un peu dommage de ne pas recourir à l'emprunt pour financer un projet qui va durer plus de cinquante ans... En tout état de cause, le sujet reste ouvert.
Pour l'instant, l'Afitf nous accorde les crédits chaque année. Jusqu'à ces derniers temps, ces crédits étaient relativement modestes, mais les sommes seront nettement plus importantes en 2021, 2022 et 2023. L'Afitf devra gérer cette difficulté. Nous n'avons pas d'inquiétude particulière, mais on ne peut pas dire qu'il y ait un financement structuré, pluriannuel et assuré. On fonctionne un peu au coup par coup.
La situation n'est pas bien meilleure sur le plan européen : le financement était assuré jusqu'en 2021 et a été prolongé en 2022. La discussion va s'engager pour les prochaines années, mais il est désormais question de ramener à trois ans le contrat que nous pensions avoir pour sept ans. Autrement dit, nous n'aurons pas non plus de la part de Bruxelles un montant assuré avec les clés de financement que j'ai mentionnées. Je n'ai pas de doute sur la volonté d'aller jusqu'au bout, mais il faut périodiquement remettre le sujet sur la table et, chaque fois, discuter les conditions et les modalités. C'est probablement une faiblesse.
Concernant la régulation, je rappelle que MM. Destot et Bouvard avaient travaillé ensemble sur une proposition de montage, avec un emprunt qui était gagé en particulier par des recettes venant des axes autoroutiers, comme l'a fait la Suisse. Le sujet est sensible. Les deux parlementaires avaient démontré qu'il était possible d'opérer un prélèvement de coût assez modéré sur un très grand nombre de camions sur un territoire très large, comprenant Vintimille. Bruxelles avait plutôt vu cela d'un bon oeil. Je pense que le sujet n'est pas définitivement abandonné, mais, pour l'instant, il ne fait pas l'objet de propositions élaborées. Il faut vraiment jouer sur les deux pistes.
Faut-il interdire le trafic de camions ? Il faut en tout cas le réguler. On peut déjà contraindre le trafic en interdisant toute une catégorie de camions - ceux qui transportent des marchandises dangereuses, ceux qui ne respectent pas les normes environnementales... - et grâce à la tarification.
La volonté de l'Europe est de supprimer la possibilité qu'un camion traverse l'Europe entière, depuis la Lituanie jusqu'au Portugal. Une partie du trafic intraeuropéen devrait passer sur le train.

On a du mal aujourd'hui à visualiser la stratégie logistique qui devrait se mettre en place pour essayer d'optimiser les flux vers cet ouvrage. On a le sentiment que c'est la logique du marché qui va s'appliquer et qu'il n'y a pas d'anticipation. Pourriez-vous nous donner des éléments d'appréciation à ce sujet ?
On peut penser que, demain, certaines liaisons aériennes pourraient être supprimées pour transférer le trafic sur la liaison ferroviaire. Le débat est-il d'ores et déjà ouvert pour anticiper au mieux ce transfert ?
Il est toujours difficile d'objectiver ce que l'on appelle « l'impact environnemental » de ce type de projets. Une évaluation environnementale de qualité du tunnel, projet emblématique aux niveaux européen comme mondial, permettrait d'apporter des clés de méthode et d'enrichir le débat politique. Qu'en pensez-vous ?
Je répondrai à vos questions avec beaucoup de modestie...
Les flux de marchandises évoluent, parce que le marché évolue. La crise obligera sans doute elle aussi à évoluer. L'emballement de l'économie a entraîné une mobilité très forte et une logistique débridée, avec une fuite en avant de tous les moyens pour obtenir les coûts les moins chers possible. On a vu à quoi cela pouvait nous mener sur le plan environnemental. J'espère que, la crise aidant, la logistique internationale sera mieux régulée et que l'emballement va pouvoir se calmer.
Il faut combiner la liberté du marché de la logistique avec une offre d'infrastructures de qualité et une régulation économique : il n'est pas normal que des déplacements ne coûtent rien. Je pense aux bateaux transportant des conteneurs de Chine à des prix défiant toute concurrence. Il faut donner aux choses leur véritable valeur. Un transport qui produit de la pollution, comme peut le faire un camion, doit la payer d'une manière ou d'une autre.
La crise vient de nous montrer que le laisser-faire ne conduisait pas forcément à l'optimisation. Les autorités compétentes, aux niveaux national, européen comme international, doivent prendre le sujet en main. Il y a certainement encore beaucoup de choses à faire si l'on veut redresser la situation et ne pas s'enfoncer dans la crise.
Nous avons bien avancé sur le sujet de l'impact environnemental : les normes sont de plus en plus nombreuses, une surveillance administrative est mise en place... Nous avons ainsi 141 points de contrôle, où l'on mesure en permanence, en collaboration avec des organismes publics et sous le contrôle des ministères, la qualité de l'eau et de l'air, l'intensité du bruit, le nombre de poussières, etc. Au-delà des beaux discours, la question de l'environnement passe par des aspects techniques très concrets et des considérations scientifiques.
L'impact environnemental passe d'abord par une maîtrise du chantier. Nous avons déjà fait beaucoup de progrès, mais on peut encore en faire beaucoup. Je n'en donnerai qu'un exemple : celui des matériaux qui sortent du tunnel. Notre objectif est que plus de la moitié de ces matériaux soient réutilisés, pour faire du béton, des remblais, du réaménagement paysager, pour boucher les carrières... Or, aujourd'hui, il n'est pas possible de faire passer les matériaux de part et d'autre de la frontière italienne, parce que les réglementations française et italienne ne sont pas compatibles. L'Europe ne peut-elle pas oeuvrer à une vision circulaire globale intégrée et à une harmonisation des règles pour que l'on puisse optimiser la gestion de nos matériaux comme on optimisera les transports de marchandises ?
Sur ce sujet, la raison peut l'emporter, surtout si l'intérêt pour tous de progresser sur l'environnement est bien perçu. Je suis en train de mobiliser les ministères compétents pour essayer de trouver une solution à ce problème - j'aurais ainsi contribué à l'Europe à ma modeste manière... J'espère que nous y parviendrons.

Merci, monsieur le président, pour la clarté de vos propos et pour cet échange particulièrement intéressant.
Je renouvelle l'invitation pour ceux d'entre vous qui le veulent dès que les circonstances le permettront.
La réunion est close à 11 h 05.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.