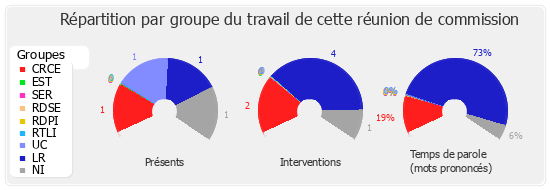Mission commune d'information sur le bilan et les conséquences de la contamination par l'amiante
Réunion du 19 octobre 2005 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
La mission a procédé à l'examen du rapport.

a indiqué que l'objet de la présente réunion était d'examiner les conclusions des deux rapporteurs, MM. Gérard Dériot et Jean-Pierre Godefroy, leur projet de rapport ayant été communiqué aux membres de la mission qui le souhaitaient. Il a rappelé que la mission avait auditionné quelque 70 personnalités concernées à un titre ou à un autre par le dossier de l'amiante, ces auditions ayant été complétées par quatre déplacements particulièrement instructifs, à Dunkerque, à Cherbourg, à Jussieu et en Corse.

a indiqué que la première partie du rapport soulignait d'abord l'indifférence quelque peu étonnante de l'ensemble des acteurs, employeurs et pouvoirs publics notamment, face à l'amiante, alors que la menace que représente cette fibre pour la santé est connue de longue date, rappelant que son utilisation dans l'industrie, en France, avait été intensive, en raison de ses qualités « exceptionnelles » et de son faible coût. Il a noté que plus de 3.000 produits à utilisation industrielle ou domestique avaient ainsi été fabriqués à base d'amiante, et que l'exposition professionnelle à l'amiante concernait, selon l'Institut de veille sanitaire (InVS), plus d'un quart des retraités masculins. Il a estimé qu'il n'était pas possible de se retrancher derrière des incertitudes sur les effets de l'amiante sur la santé, tant la suspicion qui pesait sur cette fibre était forte, avant que ses dangers ne soient maintes fois démontrés au cours du siècle.
Il a rappelé que la loi de 1893 contre l'empoussièrement des ateliers visait à lutter contre les lésions pulmonaires résultant des poussières et que la dangerosité de l'amiante avait été mise en évidence dès 1906, par un inspecteur du travail du Calvados dans une filature de Condé-sur-Noireau. Il a également indiqué que les affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante avaient été prises en compte au titre des tableaux de maladies professionnelles dès 1945. Il a ajouté que l'histoire du risque amiante avait été ponctuée d'alertes importantes qui constituaient autant d'occasions de prendre conscience du danger, notamment dans les années 1970, avec l'affaire Amisol, à Clermont-Ferrand, et celle de Jussieu, alors qu'en avril 1977, le Professeur Bignon écrivait une lettre d'alerte sanitaire au Premier ministre, M. Raymond Barre. Par ailleurs, la réglementation communautaire a fait l'objet d'une transposition qui a mobilisé les services du ministère du travail.
a constaté qu'en dépit de l'accumulation des connaissances scientifiques et médicales, il existait une discordance complète entre le risque documenté et les pratiques au sein des entreprises pour essayer de réduire ce risque. Il a rappelé les propos du professeur Claude Got, pour qui on en savait assez, sur le plan médical, pour gérer le risque amiante en 1965, et il a fait observer que des éléments convergents laissent penser que ces risques étaient d'ailleurs bien connus des industriels de l'amiante mais aussi de l'administration.
Il a indiqué le bilan humain considérable des pathologies provoquées par l'amiante, en particulier les cancers broncho-pulmonaires et les mésothéliomes. Non seulement 35.000 personnes sont mortes, en France, d'une maladie de l'amiante, entre 1965 et 1995, mais entre 50.000 et 100.000 décès sont encore attendus d'ici 2025. Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), 100.000 personnes meurent chaque année, dans le monde, du fait de l'amiante. Il a rappelé que les rapports de la fin des années 1990, celui de l'INSERM de 1996/1997 et celui du Professeur Got en 1998, avaient mis en évidence l'ampleur du drame sanitaire provoqué par l'amiante, tout en estimant qu'une telle présomption existait bien avant cette époque.
a ensuite souligné la passivité des donneurs d'alerte institutionnels de l'époque face à l'amiante. Certes, avant la loi de sécurité sanitaire de 1998, aucun organisme n'avait pour mission d'alerter les pouvoirs publics des risques qu'occasionnaient les produits toxiques, comme c'est le cas de l'InVS aujourd'hui. Il existait cependant des instances compétentes en matière de santé publique qui n'avaient pas alerté les pouvoirs publics sur les dangers de l'amiante.
Il a également mis en évidence le rôle ambigu de l'Institut national de recherche et sécurité (INRS) dans le drame de l'amiante, regrettant que cet organisme, qui devait particulièrement bien connaître l'amiante et ses effets nocifs sur la santé des salariés, comme en témoigne le nombre de ses publications consacrées à ce matériau, n'ait jamais officiellement alerté les pouvoirs publics, tandis que son directeur général de l'époque est à l'origine de la création du comité permanent amiante (CPA). Il a également rappelé la passivité de la médecine et de l'inspection du travail face au drame de l'amiante, les syndicats de salariés eux-mêmes ayant pu se trouver écartelés entre des objectifs contradictoires, c'est-à-dire la promotion de la sécurité au travail et la sauvegarde de l'emploi.
a ensuite souligné le rôle anesthésiant joué par le lobby de l'amiante, le CPA s'étant progressivement attribué le monopole de l'expertise sur ce dossier. Cette structure rassemblait, entre 1982 et 1995, des représentants de plusieurs ministères, dont celui de la santé et celui du travail, les partenaires sociaux, les industriels de l'amiante et des scientifiques. Elle a joué un rôle particulièrement ambigu dans cette affaire, qui ne saurait être réduit à celui d'un simple promoteur de la prévention en matière de sécurité au travail. Le CPA s'est montré d'une remarquable efficacité et a notamment su convaincre certains médecins de se joindre à ses travaux, ceux-ci lui fournissant une caution scientifique incontestable.
Le rapporteur a estimé que le CPA avait su profiter des carences des pouvoirs publics, qui ont fini par reprendre à leur compte son argumentaire, par exemple sur la politique d'usage contrôlé, tout en exploitant les incertitudes scientifiques du dossier. Rappelant que des premières mesures réglementaires avaient été adoptées par la Grande-Bretagne en 1931 et par les Etats-Unis en 1946, il a estimé que la réaction des autorités sanitaires françaises avait incontestablement été tardive et insuffisante, la première valeur moyenne d'exposition professionnelle n'ayant été fixée que par le décret du 17 août 1977. Il a fait observer que la réglementation de 1977 s'était malheureusement révélée peu efficace et qu'elle avait eu, paradoxalement, un effet démobilisateur. Le décret de 1977 a été en outre mal appliqué, ce que le ministère du travail n'ignorait pas. Le rapporteur a d'ailleurs noté que le Conseil d'Etat avait affirmé l'insuffisance de cette réglementation dans ses arrêts de 2004 établissant la responsabilité de l'Etat. Il a rappelé que l'usage de l'amiante n'avait été interdit que tardivement en France, soit au 1er janvier 1997.
Puis M. Gérard Dériot, rapporteur, a abordé la question des responsabilités, qui sont multiples.
Il a rappelé que, dans ses arrêts du 28 février 2002, la chambre sociale de la Cour de cassation, appelée à examiner une série de dossiers portant sur les suites données par les juridictions civiles à des demandes d'indemnisation consécutives à des maladies professionnelles dues à la contamination par l'amiante, a donné une nouvelle définition de la faute inexcusable de l'employeur en termes d'obligation de sécurité de résultat.
Il a fait observer que, dans la pratique, les arrêts du 28 février 2002 avaient facilité la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, désormais quasi systématique, mais que la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation pouvait avoir des conséquences financières très lourdes pour les entreprises, d'autant plus que les assurances refusent désormais de couvrir le risque constitué par la reconnaissance de la faute inexcusable.
Il a également indiqué que la responsabilité de l'Etat avait été établie, qu'il s'agisse de l'Etat employeur comme de l'Etat régalien, à double titre : en l'absence d'une réglementation spécifique à l'amiante, c'est-à-dire avant 1977, et à partir de 1977, en présence d'une réglementation spécifique à l'amiante mais insuffisante et trop tardive. Le Conseil d'Etat, par quatre arrêts du 3 mars 2004, a ainsi condamné l'État à indemniser les victimes de l'amiante sur le fondement de la faute pour carence dans le domaine de la prévention des risques liés à l'exposition professionnelle à l'amiante. Le rapporteur a considéré que l'affirmation de la responsabilité de l'État, si elle est naturellement essentielle pour faire toute la lumière sur ce drame qui s'est déroulé sur plusieurs décennies, ne saurait être suffisante et constituer l'explication générale d'une responsabilité collective, tellement large qu'elle éluderait la question de l'enchaînement des responsabilités des différents acteurs.
a ensuite abordé la question de la responsabilité pénale, rappelant que plusieurs plaintes avaient jusqu'à présent été conclues par des non-lieux au niveau des cours d'appel. Il a fait observer que ce « blocage » judiciaire suscitait l'incompréhension des victimes, qui, avec leurs associations de défense, en font porter la responsabilité à la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, dite « loi Fauchon », à laquelle il est reproché, notamment, de distinguer la cause directe et la cause indirecte du dommage. La « loi Fauchon » interdirait ainsi toute poursuite, d'autant plus qu'elle exige, pour engager la responsabilité, une faute caractérisée qui serait quasiment impossible à démontrer dans l'affaire de l'amiante.
S'appuyant notamment sur le témoignage de Mme Bertella-Geffroy, il a noté que la loi du 10 juillet 2000 avait rendu nécessaire la conduite d'instructions plus approfondies, ce qui ne peut que servir la cause des victimes de l'amiante. Jugeant excessif d'affirmer que la loi du 10 juillet 2000 rendait impossible tout procès pénal de l'amiante, il a estimé que certains acteurs de l'affaire de l'amiante seraient susceptibles d'entrer dans le cadre fixé par la loi pour voir leur responsabilité pénale engagée.
Il a néanmoins observé que le traitement de ces dossiers est rendu plus difficile par la modestie des moyens d'instruction de la justice pénale. Si le regroupement des affaires concernant l'amiante auprès des pôles santé publique de Paris et Marseille va dans le bon sens, il s'est interrogé sur les moyens dont ces pôles disposeront pour mener à bien l'instruction d'une affaire qui pourrait être, comme l'a montré l'exemple des Etats-Unis, la plus grosse affaire pénale du siècle.

a ensuite présenté le deuxième volet du rapport, consacré à l'indemnisation des victimes de l'amiante.
Il a rappelé qu'après l'interdiction de l'amiante dans notre pays, la prise en compte de la responsabilité de l'Etat et des employeurs avait incité les pouvoirs publics à mettre en place des dispositifs d'indemnisation spécifiques au profit des victimes de l'amiante. En 1998, a ainsi été créée une « préretraite amiante », financée par le Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA). Puis, en 2000, a été institué un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, le FIVA, qui assure aux victimes une réparation intégrale de leur préjudice.
Il a fait observer que les crédits consacrés à ces fonds avaient fortement augmenté ces dernières années, pour avoisiner, en 2005, 1,4 milliard d'euros et a indiqué que, sur vingt ans, le coût total de l'indemnisation des victimes de l'amiante devrait être compris entre 26,8 et 37,2 milliards d'euros.
a souligné, en dépit de l'augmentation des moyens accordés à l'indemnisation des victimes, que le dispositif en vigueur n'avait pas répondu à toutes les aspirations. Il a rappelé que les réflexions de la mission avaient également été nourries par les conclusions et recommandations d'une enquête commandée à la Cour des comptes par la commission des affaires sociales du Sénat.
Alors que la création du FIVA devait permettre aux victimes de bénéficier d'une indemnisation rapide, sans passer par la voie judiciaire, cet objectif n'a été que partiellement atteint puisque les recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se développent. Il a également fait observer que les indemnisations accordées par les tribunaux étaient souvent supérieures à celles accordées par le FIVA, l'écart tenant surtout à la majoration de rente dont bénéficient les victimes frappées d'une incapacité permanente en cas de condamnation de leur employeur. Il a également souligné l'hétérogénéité des décisions de justice qui conduit à des différences de traitement peu justifiées entre les victimes en fonction de leur lieu de résidence.
Le rapporteur-adjoint a estimé que deux voies méritent d'être explorées pour remédier à cette situation :
- la première consisterait à majorer l'indemnisation versée par le FIVA en accordant aux victimes le bénéfice attaché à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; cette mesure entraînerait un surcoût non négligeable mais aurait pour avantage de désengorger les tribunaux et permettrait au FIVA de consacrer ses moyens aux seuls recours subrogatoires qui présentent un intérêt du point de vue des finances publiques ;
- la seconde orientation consisterait à mieux informer les tribunaux sur le montant des indemnisations versées par le FIVA, voire à réunir les présidents de cour d'appel, sous l'égide d'un haut magistrat de la Cour de cassation, pour favoriser une harmonisation des niveaux d'indemnisation ; si ces mesures se révélaient insuffisantes, la désignation d'une cour d'appel unique pourrait être envisagée, cette mesure présentant toutefois l'inconvénient d'éloigner les citoyens de l'institution judiciaire.
Concernant le régime de « préretraite amiante », M. Jean-Pierre Godefroy, rapporteur-adjoint, a constaté que la procédure d'inscription des établissements sur les listes ouvrant droit à l'allocation de cessation d'activité était fréquemment critiquée, en raison du caractère apparemment arbitraire de certaines décisions. Citant le cas d'une entreprise de sa région, il a expliqué que la loi ne prévoyant le bénéfice de la préretraite que pour certains secteurs d'activité, il arrive que des salariés qui ont incontestablement manipulé de l'amiante au cours de leur carrière ne puissent en bénéficier. Pour corriger cette injustice, il a suggéré de compléter le système actuel par une voie d'accès individuelle au FCAATA qui permettrait aux salariés exposés à l'amiante, mais dont l'entreprise ne figure pas sur les listes, de bénéficier néanmoins de la préretraite. Afin d'identifier plus facilement les droits de chacun, des comités de site, rassemblant l'ensemble des parties concernées (Etat, CRAM, employeur, syndicats, médecins du travail, etc.), pourraient mettre en commun les informations et témoignages dont ils disposent. Il a estimé, en outre, que l'administration devrait être plus rigoureuse dans le choix des établissements inscrits sur les listes, afin que le FCAATA ne soit pas utilisé de manière abusive comme un simple outil d'accompagnement des restructurations.
Il a précisé, en revanche, qu'il n'était pas souhaitable de retenir la proposition de la Cour des comptes consistant à réserver l'ACAATA aux seules personnes malades, le FCAATA, qui vise à compenser la perte d'espérance de vie des salariés exposés à l'amiante, risquant de perdre sa raison d'être si une telle restriction était décidée.
a souligné que le financement des dépenses d'indemnisation pesait principalement sur la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale, c'est-à-dire, in fine, sur les employeurs, ceci étant à l'origine de la dégradation de la situation financière de cette branche. Il a également fait observer que le montant de la contribution de l'Etat est aléatoire, rendant tout exercice de prévision financière particulièrement délicat. Il a dès lors suggéré de définir une clé de répartition des charges entre l'Etat et la sécurité sociale et a proposé que 30 % des dépenses du FCAATA et du FIVA incombent à l'Etat, ce chiffre permettant de tenir compte de sa responsabilité en tant qu'employeur, mais aussi en tant que puissance publique.
Il a également mis en évidence la forte mutualisation des dépenses d'indemnisation, qui résulte, pour partie, de la décision de faire prendre en charge les dépenses des fonds par l'Etat et par la sécurité sociale, et qui découle également de règles légales de prescription et de règles jurisprudentielles d'inopposabilité empêchant le FIVA de récupérer auprès des entreprises responsables, par le biais de recours subrogatoires, les sommes versées aux victimes. Il a considéré que cette situation n'incitait pas les employeurs à s'engager dans des politiques efficaces de prévention des risques professionnels.
Il a noté que la création, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, d'une contribution à la charge des employeurs dont les salariés perçoivent l'ACAATA était venue atténuer cette mutualisation, mais a estimé souhaitable d'aller plus loin, par exemple lors des prochaines négociations sur la réforme de la branche, en individualisant davantage la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, afin d'augmenter la contribution des entreprises à l'origine du plus grand nombre de sinistres.
a fait observer que plusieurs interlocuteurs de la mission avaient souhaité l'extension à tous les risques professionnels du principe d'une réparation intégrale du préjudice. Il a toutefois indiqué que cette piste de réflexion ne paraissait pas pouvoir être retenue au titre des propositions de la mission, en raison du coût élevé d'une telle mesure, de l'ordre de trois milliards d'euros.
Puis il a évoqué le suivi médical post-professionnel des anciens salariés de l'amiante, qui fait partie des mesures d'accompagnement mises en place pour les soutenir, le but de ce suivi étant de détecter précocement d'éventuelles pathologies liées à l'amiante. Il a indiqué que le nombre de bénéficiaires du dispositif, qui est purement facultatif, était très limité, faute d'une information suffisante des salariés. Il lui a donc paru indispensable de réaliser un important effort d'information en direction des salariés potentiellement concernés par une exposition à l'amiante au cours de leur activité professionnelle, et a rappelé qu'une expérimentation était menée en ce sens dans trois régions.

a, enfin, présenté la troisième partie du rapport, consacrée à la prévention de nouvelles contaminations.
Il a fait observer que la question de l'amiante résiduel démontrait que le dossier de l'amiante était loin d'être clos, cette fibre demeurant omniprésente dans les bâtiments construits dans les années 1970 et 1980, en particulier dans les bâtiments publics et plus précisément dans les établissements hospitaliers et les constructions scolaires et universitaires.
Il a indiqué que certaines professions demeuraient particulièrement exposées à l'amiante, notamment les ouvriers de « second oeuvre » dans le bâtiment, les personnels de maintenance et d'entretien et bien sûr des ouvriers des chantiers de désamiantage. Il a constaté, à propos de ces derniers, que leurs conditions de travail n'étaient pas satisfaisantes, comme l'avaient montré les conclusions d'une enquête menée sur les chantiers de désamiantage en 2004, selon laquelle les trois quarts des chantiers seraient en infraction avec la réglementation.
Il a proposé deux mesures pour remédier à cette situation :
- un recensement national des salariés des entreprises de désamiantage permettant de les faire bénéficier d'un suivi médical spécifique, à l'image de ce qui existe dans le secteur du nucléaire ;
- la réduction de leurs plages horaires journalières afin de tenir compte de la pénibilité et des contraintes de leur travail.
a noté que, de manière plus générale, l'ensemble de la population fréquentant des bâtiments amiantés était susceptible de courir des risques. A cet égard, il a rappelé l'évolution législative et réglementaire relative au diagnostic et au désamiantage, notamment l'institution en 2001 du dossier technique amiante (DTA), dont l'objectif est de passer d'une logique de repérage à une logique de gestion, le DTA devant être tenu à jour par les propriétaires et transmis aux personnes susceptibles d'être mises en contact avec l'amiante encore présent. Il a néanmoins relevé que cette réglementation était mal appliquée. Il a proposé de renforcer la qualification des agents chargés du diagnostic amiante et de reprendre une des propositions du professeur Claude Got, qui visait à procéder à un recensement national des bâtiments amiantés accessibles sur Internet, même si cet objectif est difficile à atteindre du fait de l'ampleur du parc immobilier concerné. S'agissant du désamiantage, et afin de réduire le nombre des chantiers clandestins qui se sont multipliés depuis 1996, il a indiqué qu'il conviendrait de réfléchir à l'établissement d'une liste nationale de tous les chantiers de désamiantage, qui serait transmise, notamment, à l'inspection du travail. S'agissant du retrait de l'amiante non friable, qui fait l'objet d'une vigilance moindre, et conformément aux suggestions des professionnels du secteur, il a estimé que les entreprises concernées devraient se soumettre aux mêmes obligations de qualification que celles qui interviennent sur l'amiante friable.
a ensuite évoqué la question de l'exposition à l'amiante environnemental, indiquant que le rapport évoquerait les risques liés à l'ancienne mine de Canari et aux terrains amiantifères en Haute-Corse, ainsi que la question du suivi et du traitement des déchets amiantés.
Il a indiqué que le déplacement de la mission à Bastia avait permis de constater l'insuffisance de la réglementation concernant la protection des salariés du BTP travaillant sur les chantiers amiantifères et qu'il conviendrait, à cet égard, de compléter le décret du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs en contact avec l'amiante. Afin d'assurer un véritable suivi des déchets amiantés, il a également fait observer qu'il serait souhaitable d'établir un code de traçabilité de ces déchets et de favoriser la valorisation des déchets vitrifiés de l'amiante.
Abordant la prévention des nouvelles contaminations, il a considéré que le renforcement des dispositifs de prévention, avec la mise en place de l'InVS en 1998 et le plan « santé au travail » en 2005, ne devait pas occulter le manque de moyens dont pâtissent encore les organismes de veille chargés de la surveillance des risques en milieu professionnel. Il conviendrait donc, selon lui, de renforcer les moyens de l'InVS, notamment les effectifs de son département santé au travail.
Il a estimé que l'amélioration de la veille sanitaire devait évidemment porter sur les produits de substitution à l'amiante, insistant sur les risques liés aux fibres céramiques réfractaires (FCR) au contact desquelles 20.000 salariés travaillent aujourd'hui, alors que leurs effets cancérigènes ont été prouvés sur l'animal. Il a ainsi suggéré d'interdire les fibres céramiques réfractaires, sauf absence avérée de produits de substitution, et de prévoir dans ce dernier cas une procédure d'autorisation préalable, qui permettrait notamment de renforcer le contrôle de leur utilisation dans le processus de production.
Le rapporteur a noté que l'accélération de l'innovation industrielle conduit à introduire sur le marché des nouvelles molécules chimiques, dont les effets sur la santé ne sont, pour la plupart, pas évalués. Il a regretté le blocage du projet de règlement communautaire REACH par le lobby des industries chimiques, et jugé que, face à cette situation, la mise en place d'une politique de précaution revêt une grande importance. Afin de trouver un équilibre entre les impératifs de santé publique et la nécessité de l'innovation industrielle, il a suggéré d'instituer une autorisation de mise sur le marché des produits chimiques, mais aussi des produits minéraux, organiques et biologiques, inspirée de la procédure en vigueur pour les médicaments, et s'inscrivant dans le cadre du futur règlement européen.
Un large débat s'est ensuite engagé.

après avoir souligné que l'important travail de la mission avait été réalisé dans un esprit très positif, a rappelé les objectifs que s'était assigné le groupe communiste républicain et citoyen (CRC) : rendre plus lisible le drame sanitaire et humain de l'amiante, qualifié de véritable « crime sociétal », identifier les raisons qui ont conduit à cette situation, examiner les conséquences qui en ont été tirées sur le plan de l'indemnisation, surmonter le blocage des procédures pénales et établir si nous sommes en mesure d'éviter la répétition d'un tel drame. Reconnaissant que le rapport traitait de l'ensemble de ces problématiques, il a cependant regretté des jugements trop bienveillants à l'égard des employeurs, qu'il souhaiterait voir sanctionnés lorsqu'ils contournent manifestement la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il a déclaré apprécier la tonalité sans complaisance du rapport, mais a contesté que les enchaînements ayant conduit au drame de l'amiante puissent être simplement qualifiés « d'erreur de gestion », dans la mesure où il y a bien eu, selon lui, fraude et volonté de ne pas savoir. Il a également déploré que le rapport ne propose pas d'appliquer le principe de précaution aux fibres de substitution et aux éthers de glycol et mette en balance protection environnementale et innovation industrielle.
Concernant la médecine du travail, il a considéré que le rapport ne liait pas assez explicitement ses carences à son manque d'indépendance vis-à-vis des employeurs ni à son enfermement dans une seule logique d'aptitude. Sur l'inspection du travail, il a regretté que le rapport ne préconise pas le renforcement de ses moyens et se contente de renvoyer au plan santé au travail, qui n'a pas fait l'objet d'une présentation au Parlement.
Il a ensuite dit apprécier que le rapport présente une vision nuancée de la responsabilité des syndicats, qui ont été écartelés entre des objectifs contradictoires, dans un contexte de chantage à l'emploi. Il aurait néanmoins souhaité qu'il soit précisé que leur responsabilité ne pouvait être placée sur le même plan que celle des employeurs.
Abordant la question de la responsabilité pénale, il a déploré la prudence des propositions des rapporteurs, qui ne jugent pas nécessaire de réformer la « loi Fauchon », et il a estimé qu'il aurait fallu insister sur l'absence de volonté politique de voir aboutir ces affaires.
a ensuite fait part de ses remarques concernant la deuxième partie du rapport, consacrée à l'indemnisation des victimes. Il a d'abord jugé les propositions des rapporteurs trop modestes, soulignant que la revalorisation de l'ACAATA ne figurait pas parmi les propositions, pas plus que le passage à une réparation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il a souhaité que la mission prenne position plus nettement sur certains points débattus lors des travaux de la mission. Il a également demandé que la notion de « réparation » soit préférée à celle « d'indemnisation ».
Sur la troisième partie du rapport, il a approuvé les recommandations formulées en vue de renforcer la protection des salariés susceptibles d'être exposés à l'amiante, tout comme l'attention portée à l'amiante non friable.
Il a enfin suggéré que le rapport comporte une liste des personnes qui ont refusé d'être auditionnées par la mission.

a exprimé des réserves sur cette dernière proposition, rappelant que les prises de contact avaient été plus ou moins formalisées, et que certaines personnes avaient avancé, pour justifier leur refus, des arguments qui peuvent être fondés.

a indiqué que le rapport pouvait donner l'impression, par le jeu des citations, de mettre en cause, de manière déséquilibrée, certains responsables qui ont accepté d'être auditionnés, par exemple Mme Martine Aubry, alors que des personnes qui ont refusé de venir ne sont pas mentionnées.

a indiqué que l'impression éprouvée par M. Jean-Pierre Godefroy s'expliquait sans doute par la richesse de l'intervention devant la mission de Mme Martine Aubry, qui a fourni la matière de nombreuses citations, avec lesquelles la mission a parfois exprimé son désaccord.

a rappelé qu'elle avait occupé d'importantes fonctions, pendant une longue période, au ministère du travail.

a estimé que la mission avait accompli un travail de qualité, qui avait permis de dégager toutes les causes de ce drame. Elle a souhaité que les recommandations formulées en matière de prévention, dans la troisième partie du rapport, soient bien suivies d'effets et a suggéré de développer l'information des clients des magasins d'outillage et de bricolage sur les dangers de l'amiante.

a approuvé les propos de sa collègue et a fait part de son grand intérêt pour la proposition des rapporteurs consistant à introduire une procédure d'autorisation de mise sur le marché pour les produits chimiques, organiques, biologiques ou minéraux susceptibles d'être dangereux pour la santé. Elle a également souhaité que le rapport mette en valeur des recommandations concrètes à destination des particuliers et des collectivités territoriales.

a estimé que la réglementation applicable aux collectivités territoriales, notamment en matière de diagnostic amiante, était déjà très complète. Il a en revanche approuvé la suggestion relative à l'information des particuliers dans les commerces.

a fait part de plusieurs remarques :
- elle a regretté que le rapport ne décrive pas de manière plus détaillée les mécanismes biologiques à l'origine des maladies provoquées par l'amiante ;
- elle a estimé que le rapport n'indiquait pas assez clairement que les Etats-Unis avaient interdit l'amiante, puis en avaient autorisé à nouveau l'utilisation, ce qui relativise l'affirmation selon laquelle la France aurait réagi tardivement par rapport aux pays anglo-saxons ;
- elle aurait souhaité que le rapport fasse état des positions qui étaient celles à l'époque de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine ;
- elle s'est demandé si le rapport ne pourrait comporter une liste chronologique de tous les ministres de la santé et du travail en poste de 1965 jusqu'à la date d'interdiction de l'amiante ;
- elle a exprimé son désaccord avec les conclusions de la mission sur la « loi Fauchon » ;
- elle a considéré que le rapport n'évoquait pas de manière suffisamment précise la question du degré de connaissance requis pour agir ;
- elle a critiqué la manière dont la première partie du rapport présente les déclarations de Mme Martine Aubry, qui font l'objet de commentaires moins neutres que celles des autres intervenants ; elle a aussi regretté que le rapport ne précise pas les ministres sous l'autorité desquels elle a travaillé en tant que haut fonctionnaire ou membre du cabinet.

a indiqué que Mme Martine Aubry avait livré un exposé particulièrement complet, mais dans lequel la mission avait décelé des contradictions qui sont mises en lumière dans le texte du rapport.

a regretté de n'avoir pu participer plus régulièrement aux travaux de la mission même s'il a déclaré les avoir suivis par le biais des comptes rendus qui ont été publiés. Il a indiqué qu'il souhaitait que tous les groupes puissent soutenir ce rapport. Il a jugé quelque peu péremptoires les affirmations des rapporteurs sur la « loi Fauchon », rappelant que la Cour de cassation n'avait pas encore eu l'occasion de donner son interprétation de ce texte. Il a également suggéré que la date de création de l'InVS soit mentionnée dans la chronologie annexée au rapport.

a indiqué que les rapporteurs avaient formé leur conviction sur la loi Fauchon après avoir entendu de nombreux avis et qu'elle estimait que l'absence de condamnations pénales dans l'affaire de l'amiante résultait surtout d'un manque de moyens de la justice et non de l'adoption de ce texte.

a souhaité que la mission fasse preuve de prudence sur cette question dans l'attente de la décision de la Cour de cassation. Il a également regretté que les déclarations de Mme Martine Aubry fassent l'objet de critiques plus systématiques que celles des autres interlocuteurs de la mission.

a suggéré que la mission, sans revenir sur la démonstration des rapporteurs, adoucisse la rédaction du rapport.

a considéré qu'une commission d'enquête aurait pu s'exprimer plus librement, car elle aurait eu les moyens d'entendre l'ensemble des personnes concernées, et que la mission d'information devait, en conséquence, dans la rédaction de son rapport s'attacher à une certaine prudence et corriger les défauts rédactionnels relevés par ses collègues.

a estimé qu'il ne fallait pas bien sûr réserver un sort particulier à tel ou tel interlocuteur de la mission mais que la mission ne devait pas non plus s'interdire d'exprimer fermement ses appréciations. Il a demandé ensuite que la mission préconise une revalorisation de l'ACAATA, ainsi qu'une augmentation des moyens du service contentieux du FIVA, afin qu'il puisse mener à bien les recours subrogatoires nécessaires. Il a approuvé la recommandation du rapport consistant à diminuer la durée du travail des salariés du désamiantage, mais a souhaité que l'on précise que les droits des salariés ne seraient pas remis en cause à cette occasion. Il a enfin suggéré d'apporter des compléments à la proposition relative au code de traçabilité des déchets amiantés.

s'est réjouie que le rapport soit sans complaisance mais a reconnu que certains développements consacrés à Mme Martine Aubry étaient peut-être excessifs. Elle a par ailleurs estimé qu'il demeurait de réelles incertitudes quant à l'application qui sera faite de la « loi Fauchon ».
Après ce large débat, la mission a examiné l'ensemble des modifications rédactionnelles suggérées par ses membres.
Le rapport, dans la nouvelle rédaction issue de cet échange, a été approuvé à l'unanimité des présents, le groupe communiste républicain et citoyen choisissant cependant l'abstention.