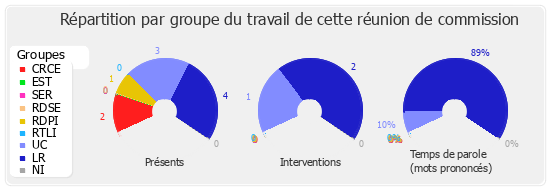Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale
Réunion du 10 janvier 2007 : 1ère réunion
La réunion
La commission a décidé de se saisir pour avis du projet de loi instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et a désigné M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis.

Puis la commission a procédé, sur le rapport de M. Jean-René Lecerf, à l'examen d'amendements sur le projet de loi n° 102 (2006-2007), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la prévention de la délinquance.
La commission a donné un avis favorable aux amendements n°s 216 à 221 de précision du Gouvernement aux articles 18 (renforcement du dispositif de contrôle des sorties d'essai des personnes placées en établissements psychiatriques), 19 (mise en place d'un traitement national des données en matière d'hospitalisation d'office), 20 (application exclusive de l'hospitalisation d'office en cas d'atteintes à la sûreté des personnes ou à l'ordre public), 21 (compétence de principe du maire en matière d'hospitalisation d'office), 23 (possibilité pour le représentant de l'Etat dans le département d'ordonner une expertise médicale) et 24 (hospitalisation d'office après un classement sans suite motivé par l'irresponsabilité pénale).
Elle a également donné un avis favorable à l'amendement n° 223 du Gouvernement à l'article 26 bis B (délit de détention ou transport de substances incendiaires) permettant à la fois de maintenir une incrimination effective de la détention et du transport de substances incendiaires ou explosives et d'encadrer le champ d'application de ce délit.

Enfin, la commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Jacques Hyest, le projet de loi constitutionnelle n° 121 (2006-2007), adopté par l'Assemblée nationale, modifiant l'article 77 de la Constitution.
a tout d'abord présenté la genèse du projet de loi constitutionnelle, rappelant que la question du corps électoral trouvait son origine dans l'équilibre auquel étaient parvenus les signataires des accords de Matignon et de Nouméa, après une période -les années 1984-1988- marquée par l'instabilité et la violence. Soulignant que la Nouvelle-Calédonie, devenue territoire d'outre-mer en 1946, avait bénéficié dès les années 1970 du développement de la production de nickel et attiré ainsi de nouveaux arrivants, il a indiqué que ce contexte avait favorisé la constitution progressive de deux camps : d'un côté, les forces indépendantistes fédérées au sein du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), dirigé par Jean-Marie Tjibaou, de l'autre, le camp loyaliste, structuré autour de Jacques Lafleur, qui crée en 1978 le Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR).
Il a rappelé que la Nouvelle-Calédonie avait connu au milieu des années 1980 une situation de quasi-guerre civile, doublée d'une forte instabilité institutionnelle, l'archipel ayant connu en seulement quatre ans, de 1984 à 1988, quatre des huit statuts qui ont existé depuis 1946. Expliquant que les négociations initiées par le Premier ministre de l'époque, Michel Rocard, avaient abouti le 26 juin 1988 à la signature de la déclaration de Matignon, suivie de l'accord Oudinot, fixant le principe d'une consultation sur l'autodétermination à échéance de dix ans et définissant une nouvelle organisation institutionnelle, il a indiqué que ces accords, approuvés à 80 % lors du référendum national du 6 novembre 1988, avaient apporté un nouvel équilibre à la Nouvelle-Calédonie. A l'approche de l'échéance fixée par les accords, les protagonistes se sont accordés sur la nécessité de repousser la consultation sur l'autodétermination, susceptible de raviver les antagonismes, signant le 5 mai 1998 l'accord de Nouméa, qui détermine pour une période transitoire de quinze à vingt ans l'organisation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, les modalités de son émancipation et les voies de son rééquilibrage économique et social.
Après avoir présenté les apports essentiels de l'accord de Nouméa (reconnaissance d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie au sein de la nationalité française, possibilité pour le congrès néo-calédonien d'adopter des lois du pays, intervenant dans le domaine législatif), il a souligné qu'ils avaient impliqué une révision de l'article 77 de la Constitution, par la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998, avant que l'accord ne soit massivement approuvé par la population de l'archipel le 8 novembre 1998 (72 % de OUI).
a ensuite indiqué que la reconnaissance d'une citoyenneté propre à la Nouvelle-Calédonie était une revendication ancienne du mouvement indépendantiste puisque, dès la signature des accords de Matignon en 1988, l'Etat, le RPCR et le FLNKS étaient convenus que seules les « populations intéressées » à l'avenir du territoire, c'est-à-dire celles qui justifiaient d'une implantation ancienne et solide, seraient autorisées à se prononcer lors des scrutins déterminants pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Il a ainsi déclaré qu'en continuité avec les accords de Matignon, l'accord de Nouméa avait clairement posé le principe de la restriction du corps électoral non seulement pour le scrutin d'autodétermination, mais aussi pour les élections aux assemblées de province et au Congrès.
Ayant rappelé que le législateur organique, conformément au nouvel article 77 de la Constitution, avait défini le 19 mars 1999 trois listes électorales distinctes, il les a ainsi décrites :
- la liste électorale pour les scrutins européens, nationaux et municipaux, le principe étant que tous les citoyens français inscrits sur les listes électorales de droit commun en Nouvelle-Calédonie peuvent participer aux référendums nationaux, à l'élection présidentielle et aux élections législatives ;
- la liste électorale pour la ou les consultations sur l'accession à la pleine souveraineté, comprenant notamment les personnes qui ont pu participer à la consultation du 8 novembre 1998, c'est-à-dire celles qui étaient déjà installées à cette date depuis dix ans dans l'archipel, ainsi que les personnes justifiant d'une durée de vingt ans de domicile en Nouvelle-Calédonie ;
- la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province, comprenant, aux termes de l'article 188 de la loi organique :
. les personnes remplissant les conditions pour participer à la consultation du 8 novembre 1998 ;
. les personnes inscrites sur le tableau annexe et domiciliées depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection ;
. les personnes ayant atteint la majorité après le 31 octobre 1998 et qui, soit justifient de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit ont un parent qui était électeur à la consultation de 1998, soit ont un parent inscrit au tableau annexe.
Après avoir défini le tableau annexe comme la liste des personnes satisfaisant aux conditions générales pour être électeurs, mais ne remplissant pas les conditions particulières pour participer au scrutin considéré, il a expliqué que la définition de ce tableau annexe était l'objet d'une divergence d'interprétation nécessitant l'adoption du présent projet de loi.
En effet, le Conseil constitutionnel, examinant la loi organique du 19 mars 1999, avait retenu pour les élections aux assemblées de province et au congrès l'interprétation d'un corps électoral glissant, permettant à toute personne d'intégrer le corps électoral spécial dès qu'elle justifie de dix ans de résidence dans l'archipel. Le rapporteur a souligné que cette interprétation n'était pas celle qui ressortait des travaux préparatoires de la loi organique, les rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant défendu l'idée d'un corps électoral figé en référence au tableau annexe de la consultation de 1998. C'est pourquoi, a-t-il rappelé, un projet de révision constitutionnelle fut rapidement soumis au Parlement et très largement approuvé par les deux assemblées avant que la convocation au Congrès ne soit ajournée, en raison de la difficulté de faire adopter par le Congrès le projet constitutionnel relatif à l'indépendance du parquet.
a souligné qu'en dépit du délai écoulé le nouveau projet de loi constitutionnelle soumis au Parlement ferait prévaloir en temps utile l'interprétation du législateur, les personnes arrivées après 1998 n'ayant pas encore atteint les dix ans de résidence permettant de participer aux élections provinciales dans le cadre du corps électoral glissant. Il a précisé que l'incidence de cette révision constitutionnelle sur les effectifs du corps électoral spécial serait limitée. Il a enfin insisté sur le fait que la définition d'un corps électoral restreint correspondait à un engagement du Président de la République, exprimé le 25 juillet 2003 à Nouméa et qu'au surplus la Cour de Strasbourg en avait validé le principe au regard de la Convention européenne des droits de l'homme (arrêt Py contre France, janvier 2005), précisant.
Après avoir rappelé que la cristallisation du corps électoral était transitoire puisqu'à l'issue du processus défini par l'accord de Nouméa, c'est-à-dire entre 2014 et 2018, soit les populations intéressées voteraient l'accession à la pleine souveraineté, soit une nouvelle organisation devrait être mise en place, avec une redéfinition de la citoyenneté calédonienne, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a formé le voeu que l'adoption de ce texte permette à tous les protagonistes de retrouver le chemin du dialogue et de la stabilité au sein de la République. Il a ainsi proposé à la commission d'adopter conforme ce projet de loi, modifié à la marge par l'Assemblée nationale, afin d'inscrire dans notre Constitution une disposition interprétative respectant l'esprit de l'accord de Nouméa.

s'est déclaré résolument hostile au projet de loi constitutionnelle présenté, estimant que les négociations engagées depuis 1988, auxquelles il a pris part, avaient abouti au principe d'un corps électoral figé pour le référendum d'autodétermination, mais d'un corps électoral glissant pour les élections du congrès et des assemblées provinciales. Il a, en outre, regretté qu'il n'ait pas été décidé de consulter, comme en 1998, la population néo-calédonienne sur le dispositif envisagé.

a estimé qu'il n'était pas opportun de procéder à des révisions de la Constitution en fin de législature, et ce quel que soit l'objet de la réforme. Déclarant qu'il convenait de se ranger à l'interprétation du Conseil constitutionnel, il s'est étonné que ce dernier soit systématiquement contourné, comme l'illustraient le référendum national de 1988 relatif au statut de la Nouvelle-Calédonie issu des accords de Matignon et la révision constitutionnelle de 1998. A cet égard, il a fait observer que la révision portait atteinte aux principes fondamentaux, aux premiers rangs desquels figurent l'égalité devant le suffrage, le droit du sol et la souveraineté parlementaire.
Il a par ailleurs relevé l'ambiguïté inhérente au statut de la Nouvelle-Calédonie, faisant valoir que l'arrêt Genelle du Conseil d'Etat du 13 décembre 2006 avait considéré que la Nouvelle-Calédonie n'était pas une collectivité territoriale au sens du titre XII et de l'article 72 de la Constitution, alors que les provinces étaient, elles, des collectivités territoriales de la République française selon la loi organique de 1999. Il s'est interrogé dès lors sur les notions de « citoyenneté néo-calédonienne » et de « populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie » qui seront amenées, aux termes de l'article 77 de la Constitution, à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté. Il a estimé qu'eu égard aux spécificités de la Nouvelle-Calédonie, il appartenait à l'archipel de déterminer son propre statut, ce qui impliquait de faire prévaloir les positions de la communauté majoritaire, acquise au maintien dans la République.

s'est déclaré favorable au projet de loi constitutionnelle, regrettant néanmoins qu'il n'ait pas été soumis au Congrès plus tôt. Il a insisté sur le fait que la révision permettait de faire aboutir un long processus auquel ont pris part de nombreux élus, toutes tendances politiques confondues. Il a fait valoir que, sur le plan juridique, la souveraineté n'appartenait pas au Conseil constitutionnel mais au peuple. Rappelant que ce dernier s'exprimait par la voie du référendum ou par ses représentants, réunis en Congrès, il a souligné qu'il était, en l'espèce, de la responsabilité des élus de réviser l'article 77 de la Constitution pour faire prévaloir l'interprétation du pouvoir constituant sur celle du juge constitutionnel. Il a ajouté qu'il était même loisible aux représentants du peuple de réduire, voire de supprimer les attributions du Conseil constitutionnel.

s'est déclaré favorable au projet de loi constitutionnelle, relevant qu'il appartenait bien au pouvoir constituant de trancher la divergence d'interprétation concernant le corps électoral.
Répondant à l'ensemble des orateurs, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a fait observer que les travaux préparatoires de la loi organique de 1999, et notamment les rapports parlementaires des deux assemblées, démontraient sans ambiguïté la volonté de définir un corps électoral figé. Il a ajouté que l'article 1er du projet de loi constitutionnelle relatif au corps électoral avait été adopté par le Sénat en octobre 1999 par 306 voix contre 7, et que parmi les voix favorables figuraient de nombreux parlementaires qui avaient suivi de près l'évolution de la situation en Nouvelle-Calédonie depuis 1988. Il en a donc appelé à la nécessaire continuité de la position du Sénat sur la question. S'interdisant de critiquer toute décision du Conseil constitutionnel, il a marqué qu'il était de la responsabilité des élus, en cas de désaccord, d'imposer leur interprétation par une révision de la Constitution, comme cela a été fait en 1993 sur le droit d'asile.
A l'issue de ce débat, la commission a proposé d'adopter sans modification le projet de loi constitutionnelle n° 121 (2006-2007), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, modifiant l'article 77 de la Constitution.