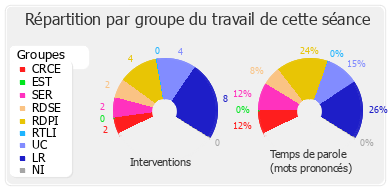Séance en hémicycle du 4 mai 2010 à 9h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Décès d'un ancien sénateur
- Organisme extraparlementaire (voir le dossier)
- Dépôt d'un rapport du gouvernement (voir le dossier)
- Questions orales (voir le dossier)
- Prise en charge des frais de transport d'un handicapé entre l'établissement et le domicile lors d'une permission de sortie (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

J’ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Félix Ciccolini, qui fut sénateur des Bouches-du-Rhône de 1971 à 1989. Vice-président du Sénat, il présida nos séances de 1983 à 1986.

J’informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation du sénateur appelé à siéger au sein du Comité national du développement durable et du Grenelle de l’environnement.
Conformément à l’article 9 du règlement, j’invite la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire à présenter une candidature.
La nomination au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement.

M. le Premier ministre a transmis au Sénat, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il a été transmis à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. Il est disponible au bureau de la distribution.

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier, auteur de la question n° 807, adressée à M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme.

Monsieur le président, madame le secrétaire d'État, mes chers collègues, l’an dernier, en pleine crise économique, sociale et immobilière, le Gouvernement, pour remotiver l’investissement et surtout l’économie de marché, arrêtait les décrets d’application de la loi Scellier portant réduction d’impôt par l’investissement locatif.
Une lecture sommaire de ce texte pourrait laisser croire à un placement tout à fait intéressant, surtout après la baisse historique du taux du livret A. Pourtant, si l’on y regarde de plus près, force est de constater que ce énième dispositif est né de la modélisation, de la fusion plus ou moins subtile des lois « Borloo » et « Robien », malheureusement empreintes d’échecs et de critiques acerbes.
Interpellés à plusieurs reprises sur les conséquences des dispositifs précédents, les ministres en charge du logement, en concertation avec les professionnels du secteur immobilier, assurent aujourd’hui encadrer et limiter les zones bénéficiaires du dispositif Scellier.
Ainsi, la révision du classement opérée conformément à l’article 48 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion devrait permettre de mieux refléter et donc de mieux appréhender l’état et les tensions du marché locatif privé. Dès lors, les aides fiscales à l’investissement locatif privé devraient se recentrer sur des zones prioritaires, des communes dans lesquelles le nombre de logements existants ne répond toujours pas à la demande.
Plus encore, cette analyse du marché de « l’habitation » et ce zonage communal devraient protéger le particulier, qui ne pourrait investir que dans les zones prédéterminées. Par cette limitation à l’investissement privé, le Gouvernement entend assurer la location au propriétaire-investisseur et donc le bénéfice de la défiscalisation, dont les conditions restrictives seront alors « facilement » satisfaites.
Madame la secrétaire d’État, j’ai été saisie par de nombreux investisseurs piégés par les premiers dispositifs, contraints aujourd’hui de revendre à perte, de se déclarer en surendettement ou acculés aux pires extrémités, notamment aux contraintes par voie d’huissier.
Pourriez-vous nous apporter certaines précisions ?
Tout d’abord, comment le zonage parviendra-t-il à réguler le marché du locatif dans la mesure où il s’agit non pas de « redistribuer » les dispositifs existants, mais de définir le domaine d’application d’un nouveau système instauré dans un secteur saturé ?
Ensuite, comment les particuliers pourront-ils être assurés d’une défiscalisation ? Comment peut-on aujourd’hui être sûr que tous les « nouveaux appartements Scellier » trouveront un acquéreur ? Je vous remercie par avance de votre réponse.
Madame le sénateur, je vous prie tout d’abord d’excuser l’absence de M. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme.
Le conseil de modernisation des politiques publiques du 4 avril 2008 a décidé de recentrer les aides fiscales à l’investissement locatif privé – dispositifs dits « Robien » et « Borloo » – sur les zones dans lesquelles les besoins de logement sont prioritaires et où il existe des tensions sur le marché du logement locatif. Cette décision suit les recommandations du rapport d’information parlementaire de juillet 2008 de MM. François Scellier et Jean-Yves Le Bouillonnec
Il s’agissait notamment de protéger les particuliers qui peuvent être incités à investir là où l’état du marché locatif ne leur permet pas de louer leur bien dans des conditions optimales.
Cette décision concerne également le nouveau dispositif d’aide à l’investissement locatif privé dit « Scellier », créé par l’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008. Désormais, il n’est plus possible pour tout nouveau programme de logements de bénéficier des dispositifs d’aides à l’investissement locatif privé hors des zones A, B1 et B2.
L’article 48 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion a limité l’application de ces dispositifs aux « communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logement » et renvoyé à un arrêté ministériel révisé au moins tous les trois ans le soin d’établir le classement. En application de ces dispositions, une révision du classement des communes entre les zones A, B1, B2 et C a été effectuée de manière à mieux refléter les tensions du marché locatif privé. Elle est entrée en vigueur le 4 mai 2009, à la suite de la publication d’un arrêté daté du 29 avril 2009.
Cette révision du zonage a permis de ne retenir que les communes pour lesquelles une tension sur le marché locatif existe et permet ainsi d’éviter la réalisation d’opérations sur des territoires sans demande locative.
L’exclusion de la zone C est un geste fort en faveur de la protection des investisseurs. Vous le savez, elle suscite chaque année de vifs débats au Parlement. Sachez que le Gouvernement ne reviendra pas sur cette exclusion.
Au demeurant, afin d’appliquer ce principe avec discernement, le Parlement a décidé de permettre au ministre chargé du logement de délivrer des agréments à certaines communes de la zone C. La délivrance d’un tel agrément permettra le bénéfice du dispositif Scellier sur leur territoire.
Lors de la préparation du décret fixant les conditions de délivrance de cet agrément et sur lequel il vient de saisir le Conseil d’État, Benoist Apparu s’est attaché à respecter les orientations fixées par le Conseil de modernisation des politiques publiques et confirmées par le Parlement lors du vote de la loi du 25 mars 2009, visant à recentrer les aides fiscales à l’investissement locatif privé sur les zones dans lesquelles les besoins de logements sont prioritaires et où il existe de réelles tensions sur le marché du logement locatif.
Aussi, les agréments ne seront accordés que de manière individuelle, après un examen attentif des éléments de fait permettant de caractériser de manière fine la situation de la commune au regard du marché locatif.
Par ailleurs, un amendement au projet de loi portant réforme du crédit à la consommation, adopté par le Sénat et complété par l’Assemblée nationale, vise à une meilleure information des investisseurs sur la portée des engagements pris en contrepartie de l’avantage fiscal. Cet amendement, déposé par plusieurs de vos collègues, dont M. Philippe Dallier, impose que toute publicité relative à une opération d’acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier d’un avantage fiscal comporte une mention indiquant que le non-respect des engagements de location entraîne la perte de cet avantage fiscal.
Cette mesure vient compléter les efforts déjà réalisés pour s’assurer que certaines dérives constatées par le passé ne se reproduiront plus.

Madame la secrétaire d'État, je vous remercie de votre réponse, qui reprend les caractéristiques du dispositif sur le plan tant législatif que réglementaire.
J’ai bien noté que, dans le cadre du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation, des mesures dissuasives ont été adoptées en vue de réguler un marché qui peut se révéler très difficile : certains de nos citoyens sont ainsi confrontés aujourd'hui à des situations tout à fait dramatiques, les biens achetés n’ayant pu être loués comme cela avait été prévu initialement.

La parole est à M. Aymeri de Montesquiou, auteur de la question n° 834, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Madame la secrétaire d’État, une fois de plus, ma question porte sur les travaux de mise à « deux fois deux voies » de la route nationale 124 entre Auch et Toulouse, et plus précisément, aujourd’hui, sur les huit kilomètres entre Auch et Aubiet.
Le désenclavement gersois est une sorte de supplice de Tantale : chaque fois que nous pensons y parvenir, il nous échappe ! Ce sont les occasions ratées, les retards innombrables, le manque de financement de l’État ou des collectivités, les reports du projet dans les contrats de plan État-région successifs, les engagements non tenus.
En 1987, j’avais trouvé les crédits, mais le conseil général a refusé de financer sa part de l’opération.
Plus récemment, les travaux sur les ouvrages d’art entre Auch et Aubiet ont été interrompus pendant des mois, faute de financement par l’État, le chantier étant alors laissé à la merci des intempéries. Aujourd’hui, ce sont les crapauds accoucheurs qui sont en cause, après que les routes de l’ouest du département ont été victimes du bombyx à cul noir !
L’enquête préalable sur la présence éventuelle d’espèces protégées a été diligentée. Mais ce qui devrait en théorie prendre quelques mois se prolonge indéfiniment dans le Gers. Je conçois que les espèces d’amphibiens rares doivent être protégées et la biodiversité respectée, mais depuis 1988 que ce projet est en cours, on aurait pu confirmer ou infirmer leur présence.
Plus gravement, l’ampleur du retard de ces travaux est très négative pour l’économie gersoise. Et si le Gers est enclavé, ce n’est pas parce que les Gersois refusent une économie moderne et donc des liaisons dignes de notre époque, bien au contraire !
De plus, les Gersois veulent des routes plus sûres, car de trop nombreux accidents endeuillent chaque année leurs familles. Ils aspirent à l’égalité des chances ; ils veulent donc un développement économique, touristique, éducatif et scientifique équitable, dont une meilleure desserte du département est une condition.
C’est l’État qui est trop souvent en cause. Je vous rappelle que le Gers ne compte en tout et pour tout que vingt kilomètres de routes à deux fois deux voies !
Les travaux sur le tronçon Auch-Aubiet ont commencé en 2004 pour les ouvrages d’art et en janvier 2010 pour les structures, grâce aux crédits du plan de relance engagés en août 2009. Ils devraient s’achever en octobre 2012, au terme de plus de neuf ans de travaux pour… huit kilomètres ! À ce rythme consternant, Auch ne pourra espérer être enfin reliée à Toulouse par une route à deux fois deux voies avant 2032 !
Madame la secrétaire d’État, précisez-moi les mesures que vous prendrez pour accélérer l’achèvement des travaux. Je veux entendre confirmer qu’ils ont un caractère prioritaire, qu’ils seront financés et qu’ils seront achevés dans les meilleurs délais. Ne décevez pas les Gersois, ils l’ont été trop souvent !

Mon cher collègue, je partage votre souci, pour avoir vu dans la Sarthe une autoroute bloquée pendant dix ans par l’Osmoderma !

Oui, Osmoderma eremita pour ceux qui connaissent le latin…
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Monsieur le sénateur, vous connaissez le contexte budgétaire que nous rencontrons actuellement et qui conduit l’État à une extrême rigueur dans l’affectation des crédits d’investissement, notamment d’investissement routier.
Dans ce contexte difficile, M. le ministre d’État a veillé à ce que l’aménagement de la route nationale 124 entre Auch et Toulouse se poursuive prioritairement. Vous l’avez rappelé, les travaux de la section Auch-Aubiet ont déjà bénéficié de 4 millions d’euros dans le cadre du plan de relance de 2009 et sont actuellement en cours.
L’appel d’offres du marché principal sera lancé au printemps, et, au troisième trimestre, les travaux correspondants prendront la suite des travaux actuels de rétablissement et de déplacement de réseaux. L’achèvement de cette opération en 2012 relève de délais normaux pour une opération de 8, 4 kilomètres et de 65 millions d’euros comprenant 2, 7 kilomètres d’aménagement sur place. Cette caractéristique, économe en espace rural, impose toujours un allongement des travaux, lié aux contraintes de maintien de la circulation.
Enfin, le programme de modernisation des itinéraires, ou PDMI, de la région Midi-Pyrénées, l’un des plus importants de France, réserve une enveloppe budgétaire de 80 millions d’euros à la réalisation d’une autre partie de l’itinéraire Toulouse-Auch, la section Gimont-L’Isles-Jourdain, traduisant la priorité qui lui est reconnue, ce qui constitue un effort tout particulier au regard des opérations retenues sur l’ensemble du territoire.

Madame la secrétaire d’État, j’aurais souhaité une réponse plus vigoureuse de votre part. Vingt-trois ans, c’est vraiment le supplice de Tantale !
Le Gouvernement utilise souvent le concept d’égalité des chances. Je ne vois pas comment le Gers peut se développer avec vingt kilomètres de deux fois deux voies !
Vous avez évoqué des crédits de 4 millions d’euros. C’est dérisoire par rapport au coût d’une route ! Je considère donc que le département est abandonné par le Gouvernement. Je ne comprends pas que l’on investisse des dizaines de millions d’euros dans des murs anti-bruit sur des autoroutes et que, par ailleurs, on abandonne totalement des zones rurales qui ne peuvent espérer aucun développement tant que les routes ne seront pas à un niveau normal. À notre époque, vingt kilomètres de deux fois deux voies, c’est absolument inacceptable pour la population gersoise !

La parole est à M. Jean Boyer, auteur de la question n° 855, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Madame le secrétaire d’État, ma question porte sur l’avenir de la route nationale 88.
Cet axe européen qui relie Toulouse à Lyon a été reconnu comme grande liaison d’aménagement du territoire lors du comité interministériel à l’aménagement du territoire de Mende, en 1993, CIAT qui avait donné un grand espoir au monde rural. La mise à deux fois deux voies de cet axe devait être réalisée dans un délai de dix ans.
Pourtant, dix ans plus tard, seulement 185 kilomètres sont aménagés, soit 40 % de l’itinéraire. D’importants retards et des blocages ont été accumulés.
Je sais bien qu’il faut être objectif et honnête et reconnaître que nous avons des difficultés financières. Mais, madame le secrétaire d’État, ne pensez-vous pas qu’il y a des priorités ? En effet, ne l’oublions pas, la route nationale 88 traverse huit départements – la Haute-Garonne, le Tarn, l’Aveyron, la Lozère, l’Ardèche, la Haute-Loire, la Loire et le Rhône –, dont quelques élus sont présents dans cet hémicycle, et relie deux grandes villes françaises, Lyon et Toulouse. À ce titre, elle contribue – cela a été souligné tout à l’heure – au désenclavement de nombreux territoires ruraux du sud du Massif central, desservant notamment Albi, Rodez, Mende, Langogne, Le Puy-en-Velay et Saint-Étienne. À l’échelle européenne, elle participe à la création d’une vraie diagonale européenne : Séville, Madrid, Toulouse, Lyon, Genève et Varsovie. C’est donc un axe fort de la construction de l’espace européen, et même, dirai-je, un cordon ombilical de nature à revitaliser de nombreux territoires au cœur de la France.
Madame le secrétaire d’État, je voudrais savoir où en est l’expérimentation pilote des principes du développement durable lancée en 2003 autour d’un itinéraire routier par le ministre de l’équipement et des transports et le ministre de l’écologie et du développement durable. Je m’interroge également sur l’abandon de cette expérimentation, dont l’objectif premier était d’inscrire le projet routier, notamment dans sa partie centrale Rodez–Le Puy-en-Velay, dans une démarche de développement durable des territoires ainsi traversés.
Pour terminer, madame le secrétaire d’État, je souhaiterais vous demander si, pour un axe de cette importance, qui a une vocation européenne, la contribution de l’Union européenne ne pourrait pas relayer celle des départements ruraux, qui connaissent de grandes difficultés économiques et financières.
Monsieur le sénateur, l’État reste très conscient de la nécessité de poursuivre l’aménagement de la route nationale 88, qui a été maintenue en totalité dans le réseau routier national en raison de son rôle majeur d’axe d’aménagement du territoire. Vous l’avez rappelé, elle constitue à l’échelon national une importante liaison routière est-ouest.
Après la mise en deux fois deux voies des tronçons proches des extrémités de l’axe Lyon-Toulouse, et afin de garantir un aménagement qui tienne compte des enjeux environnementaux des territoires traversés, l’État a mis en place en 2003, le long de cet axe, une démarche expérimentale de route durable que vous avez rappelée.
Cette démarche a conduit à la signature en mars 2007, entre le syndicat mixte d’études et de promotion de l’axe Lyon-Toulouse et les ministères chargés des transports et de l’environnement, d’une charte d’engagement destinée à favoriser, à l’occasion de l’aménagement de la section de la route nationale 88 comprise entre Rodez et Le Puy-en-Velay, un développement durable des territoires traversés. Un comité de pilotage a été mis en place.
Dans ce cadre, plusieurs opérations ont d’ores et déjà été menées ; d’autres le seront à court ou à moyen terme. S’agissant des opérations achevées, on peut ainsi citer le raccordement de la route nationale 88 à l’autoroute A75 au droit de Romardiès, mis en service au cours de l’été 2009, ou encore la construction du viaduc de Rieucros, à Mende, dont la mise en service est effective depuis la fin de l’année 2009. S’agissant des opérations à venir, on peut évoquer la rocade ouest de Mende, située entre le viaduc de Rieucros et la route nationale 88, ou encore celle du Puy-en-Velay, dont les réalisations figurent dans les programmes de modernisation des itinéraires des régions Languedoc-Roussillon et Auvergne.
L’État reste extrêmement attaché à la démarche partenariale amorcée en 2003, qui s’inscrit dans la cohérence des orientations du Grenelle de l’environnement. Dans ce contexte, le ministre d’État proposera au président du syndicat mixte d’études et de promotion de l’axe Lyon-Toulouse de réunir très prochainement le comité de pilotage pour faire un point des opérations en cours et dessiner les nouvelles perspectives.

Madame le secrétaire d’État, je dois reconnaître que votre réponse est très complète ! La traversée des sites que vous avez mentionnés, y compris le viaduc de Millau, a été un point important.
Je voulais modestement, à travers cette question, faire passer un message, au nom d’ailleurs de tous les élus du Sud-Ouest. Cet axe latéral Lyon-Toulouse est vraiment très important pour l’aménagement du territoire.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, auteur de la question n° 838, adressée à M. le secrétaire d'État chargé des transports.

Madame la secrétaire d’État, je souhaite vous interroger sur la voie auxiliaire de l'échangeur A4-A86.
Chaque jour, l’Île-de-France affiche de 100 kilomètres à 300 kilomètres de bouchons cumulés. Le tronc commun A4-A86 est répertorié comme le point noir le plus important d’Île-de-France, et même d’Europe. Plus de 280 000 véhicules empruntent quotidiennement les deux kilomètres de cette portion d’autoroute – ce matin, comme tous les autres jours, j’y étais ! –, théâtre d’une congestion récurrente aux heures de pointe.
Afin de fluidifier la circulation, une « voie auxiliaire » a été mise en place en septembre 2005 sur la bande d’arrêt d’urgence existante. Aux heures d’affluence ou en cas de circulation très dense, un système de barrières mobiles la transforme en cinquième voie de circulation. Un panneau de signalisation lumineuse placé au-dessus de cette voie indique si elle est ouverte, fermée ou en cours de fermeture.
Ce dispositif a permis d’exploiter une voie supplémentaire sans modifier l’infrastructure de l’autoroute. Une diminution des temps de parcours, sans remise en cause de la sécurité des usagers, a été effectivement enregistrée.
À l’origine, la voie auxiliaire était ouverte dès que le trafic devenait dense, afin de réguler les flux d’automobilistes en prenant particulièrement en compte l’état du trafic en aval, c’est-à-dire vers Thiais et Rungis au niveau de l’A86-A106. Aux heures creuses, la voie retrouvait sa fonction de bande d’arrêt d’urgence.
Cependant, à la suite de deux accidents matériels qui ont endommagé les barrières au mois de décembre 2009, cette voie est interdite à la circulation depuis plusieurs mois. Les glissières mobiles d’affectation qui constituent ces barrières mobiles sont en aluminium. Elles seront inutilisables tant qu’elles n’auront pas été réparées. Cette voie est donc « en panne » et la circulation y est interdite. En attendant des réparations, ce sont plus de 12 kilomètres de voie qui sont affectés par ce dysfonctionnement. Les encombrements se répercutent presque jusqu’à l’autoroute du Sud.
Depuis le dépôt de ma question, j’ai appris par voie de presse que les travaux de réparation auraient finalement commencé – je ne m’en suis pas rendu compte ! – et que la réouverture de la voie serait prévue fin mai. Les automobilistes, les Val-de-Marnais, les élus – de droite comme de gauche – et l’Association des collectivités territoriales de l’Est parisien accueillent avec soulagement la réouverture de cette voie, dont ils soutiennent même l’ouverture constante.
La presse fait état d’un coût de l’ordre de 140 000 euros pour les réparations. Si l’on considère les cinq mois d’attente liés à cette intervention et les centaines de kilomètres de bouchons provoqués, il est légitime de s’interroger sur l’efficacité de l’organisation retenue pour les réparations. Ne faudrait-il d’ailleurs pas préférer la maintenance préventive à la maintenance curative ?
Je souhaiterais donc savoir pourquoi les travaux de réparation n’ont pas été entrepris plus tôt et si des mesures préventives seront à l’avenir mises en place ; on pourrait ainsi prévoir, par exemple, de disposer d’avance de glissières de remplacement.
Madame le sénateur, vous avez appelé l’attention de Dominique Bussereau sur le dispositif de gestion dynamique des glissières mobiles qui permettait aux véhicules de circuler sur la voie auxiliaire du tronc commun A4-A86 dans les périodes de fort trafic.
Vous avez absolument raison de souligner que ce dispositif apporte des gains importants en termes de sécurité, de temps de parcours et de pollution atmosphérique. Il a montré que des mesures d’exploitation intelligentes et innovantes pouvaient se révéler aussi efficaces, plus respectueuses de l’environnement et moins coûteuses que des aménagements lourds comme des créations de voies supplémentaires.
Ce dispositif, vous l’avez rappelé, n’est malheureusement plus en service depuis quelques mois. En effet, deux accidents très importants sont survenus sur le tronc commun le 17 et le 31 décembre 2009 et l’ont fortement endommagé.
Les chocs ont détruit les mécanismes internes des barrières de tête qui ne peuvent plus être manœuvrées. Or la fiabilité de ces équipements joue un rôle essentiel en termes de sécurité ; en conséquence, la voie auxiliaire a dû être fermée dans les deux sens. Nous souhaitons bien évidemment sa réouverture dans les meilleurs délais.
Cette infrastructure, je le rappelle, est un prototype. Toute réparation est donc complexe. Les services gestionnaires s'étaient bien dotés de pièces de rechange pour les pannes simples. Mais les événements du mois de décembre ont eu des conséquences plus graves. Il a donc été nécessaire d’opérer une mise en concurrence pour la réparation et le remplacement des pièces endommagées. Les délais en sont allongés, mais notre volonté de maintenir ce service innovant et efficace n’est pas altérée.
Je souhaite donc vous l’assurer : tout est mis en œuvre pour réparer ces équipements, et nous espérons remettre en service la voie auxiliaire à la mi-mai.

Madame la secrétaire d’État, j’ai emprunté l’autoroute ce matin et je n’ai pas vraiment vu de travaux ! Par ailleurs, dans la mesure où les glissières ne sont toujours pas mises en place, pourquoi ne pas utiliser les panneaux de signalisation lumineuse pour indiquer une fermeture ou une ouverture de la voie d’urgence ? Nous aurions ainsi pu, depuis le mois de décembre, continuer à utiliser cette dernière aux heures de circulation dense. Une partie des forces de police présentes en permanence sur place sur cette autoroute dans le cadre des contrôles de vitesse aurait en effet pu surveiller l’utilisation de cette voie de sécurité.
Mi-mai, c’est dans une semaine ! Permettez-moi de douter de la réouverture du tronçon dans ces délais. J’espère néanmoins que nous saurons trouver, en cas de nouvelle « panne », des systèmes plus simples que des appels d’offres pour le remplacement des pièces endommagées !

La parole est à M. Michel Houel, auteur de la question n° 852, adressée à M. le secrétaire d'État chargé des transports.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, ma question concerne, de manière générale, la limite d’âge dans la fonction publique. Elle porte plus précisément sur l'application du décret n° 2009-1744 concernant l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique.
Aujourd'hui, le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, ou ICNA, fonctionnaires de la direction générale de l’aviation civile, la DGAC, est régi par la loi précitée. Son article 3 autorise l'exercice des fonctions de contrôle jusqu'à 57 ans, sans possibilité de report.
Bien sûr, la sécurité du transport aérien est un impératif auquel tout contrôleur est attaché. Mais les contrôleurs atteints par la limite d'âge, et désireux de prolonger leur carrière professionnelle, possèdent tous une licence de contrôle valide, et leur certificat médical a été renouvelé compte tenu des exigences auxquelles sont soumis les contrôleurs. En effet, tout au long de sa carrière, un ICNA peut exercer ses prérogatives uniquement s'il est en possession d'une licence européenne valide. Ces conditions, strictes et indispensables, éliminent donc tout risque susceptible de mettre en péril la sécurité aérienne.
Par ailleurs, il faut être cohérent ! Si l'on incite, à juste titre, les Français à travailler plus longtemps pour payer les retraites, on ne peut dans le même temps imposer un départ en retraite à 57 ans à une catégorie de salariés souhaitant poursuivre leur vie professionnelle.
J’aimerais donc connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement afin d'améliorer de manière significative cette situation pénalisante à tous points de vue.
Monsieur le sénateur, comme vous le savez, l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a inséré une nouvelle disposition permettant aux fonctionnaires exerçant des services actifs d'être maintenus en activité jusqu'à l'âge de 65 ans, sur leur demande et sous réserve d’un examen de leur aptitude physique. Le décret du 30 décembre 2009 met en œuvre cette possibilité.
Mais cette nouvelle disposition est en contradiction avec la loi du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. La limite d'âge y est fixée à 57 ans, sans possibilité de report. Celle-ci est imposée pour des raisons de sécurité inhérentes à l'activité même exercée par ces agents, quelle que soit leur affectation.
Une prolongation d'activité des agents concernés constituerait une singularité française au sein de l’Europe. Les autres pays européens ne permettent en effet pas d'exercer les fonctions de contrôleur aérien au-delà de l'âge de 57 ans. De plus, une telle évolution n'irait pas dans le sens de l'harmonisation voulue par les règlements du ciel unique européen.
C’est pourquoi le principe du droit à poursuivre au-delà de la limite d'âge de 57 ans ne peut être appliqué aux contrôleurs aériens sans que des études préalables soient menées sur les questions de sécurité et d'harmonisation européenne. Dominique Bussereau a donc proposé au secrétaire d'État chargé de la fonction publique la mise en place d'un dispositif réglementaire adapté aux contraintes particulières de cette profession. Cette réflexion ne peut se faire sans une concertation très large avec l'ensemble des acteurs concernés.
Le protocole d'accord qui déterminera les principales évolutions de la direction générale de l'aviation civile pour les années 2010 et 2011 pourrait ainsi être élaboré dans le cadre d'une discussion avec les organisations syndicales représentatives des personnels concernés sur les conditions d'une prolongation éventuelle de leur carrière au-delà de la limite d'âge actuelle.
Mais les partenaires étrangers associés dans le projet FABEC, qui vise à intégrer le contrôle aérien de l'Allemagne, la France, le Benelux et la Suisse, devront aussi être consultés, et tous ces pays fixent pour l'instant la limite d'âge des contrôleurs aériens à 55 ans ou 57 ans.

Je vous remercie de vos explications, madame la secrétaire d’État. Elles témoignent d’une avancée dans ce secteur de la fonction publique, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir ! Les questions de limite d’âge sont actuellement en débat dans le cadre européen, et nous souhaitons que l’Europe parvienne à une harmonisation des systèmes en vigueur en France, en Suisse, en Allemagne et dans tous les pays directement concernés.

La parole est à M. Antoine Lefèvre, auteur de la question n° 845, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.

Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur le dispositif d'aide individuelle à la scolarité des enfants handicapés. Le 10 juin 2009, Mme Valérie Létard parlait pour la première fois de l’institution d’un statut des AVS, ou auxiliaires de vie scolaire.
De nombreux rapports ont mis en évidence la nécessité de créer un vrai métier, qualifié et stable, de l'accompagnement scolaire et social.
En ce sens, un groupe de travail relatif à la professionnalisation et à la pérennisation des auxiliaires de vie scolaire, commun à votre ministère et au secrétariat d'État à la famille et à la solidarité, a été instauré en septembre dernier. Il avait pour mission de réfléchir à la création, d’ici au mois de septembre 2010, du nouveau métier d'accompagnant. Ce dernier permettrait d'offrir des perspectives de carrière et de mobilité à celles et à ceux qui ont fait le choix de s'engager dans cette voie.
Plusieurs réunions ont eu lieu durant le dernier trimestre 2009. Mais, à ma connaissance, le groupe de travail n’a tenu aucune séance plénière depuis le 5 janvier dernier. À ce jour, d’après vos statistiques, 180 000 élèves handicapés sont accueillis dans les établissements ordinaires du premier et du second degré. Les familles de ces enfants s’inquiètent à l’approche de la prochaine rentrée scolaire. Vous-même avez affirmé, début décembre 2009, la nécessité de professionnaliser les AVS.
La Fédération nationale des associations au service des élèves présentant une situation de handicap, ou FNASEPH, a proposé, dans l’attente de la mise en place d'une certification ou d'un diplôme d'État à long terme, la création d'un diplôme universitaire ouvert aux personnels accompagnants actuellement en poste. Elle a également suggéré l’instauration d'un GIP transversal, compétent à chaque stade de la vie du jeune, sous tutelle de l'éducation nationale ou des nouvelles directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, les DRJSCS.
Par ailleurs, une pétition, lancée sur l’initiative de certains syndicats et associations de famille, commence à circuler. Elle aurait déjà recueilli plus de 14 000 signatures.
Compte tenu des délais, il devient donc urgent d’arbitrer rapidement, monsieur le ministre !
Je vous remercie de bien vouloir m'apporter des éléments de réponse pouvant rassurer à la fois les familles et les intervenants auprès des élèves.
Monsieur le sénateur, vous attirez mon attention sur le dispositif des auxiliaires de vie scolaire auprès des enfants handicapés. Comme vous le savez, la scolarisation des enfants handicapés est une priorité du Gouvernement. À mes yeux, nous avons beaucoup progressé en la matière puisque le système scolaire de l’éducation nationale accueille aujourd’hui 40 % d’élèves handicapés de plus qu’il y a cinq ans, au moment du vote de la loi de 2005.
La présence de ces auxiliaires de vie rend possible la scolarisation de certains enfants handicapés. Dans 50 % des cas, il s’agit d’assistants d'éducation recrutés sous contrat de droit public, pour une durée maximale de six ans.
L’an dernier, le Parlement a adopté une disposition législative prévoyant la possibilité, pour certains auxiliaires de vie scolaire en fin de contrat, de continuer à assurer les mêmes fonctions dans des associations qui concluraient une convention avec mon ministère. Cette année, j’ai ainsi eu l’occasion de signer une convention avec plusieurs associations.
Il s’agissait d’une disposition transitoire, proposée afin de permettre une continuité dans la prise en charge et le suivi de l'élève par son ancien auxiliaire de vie scolaire individuel, ou AVSi. Mais vous l’avez rappelé, monsieur le sénateur, l'objectif du Gouvernement était, dès le départ, de favoriser la reprise des contrats sous une forme nouvelle, et ce afin d’éviter de perdre les compétences acquises par ces personnels et de poursuivre une logique de professionnalisation de la fonction.
Aujourd’hui, ces deux objectifs guident toujours notre réflexion, et la volonté du Gouvernement d’aboutir rapidement en la matière est absolument intacte.
Par ailleurs, je tiens à vous rassurer sur le groupe de travail dont vous avez fait mention. La dernière réunion remonte au 23 avril dernier. À l’invitation de mon ministère et de celui de Nadine Morano, elle a rassemblé les cabinets des deux ministères, les directions concernées, les principales fédérations d'associations, dont la Fédération nationale des associations au service des élèves présentant une situation de handicap, ainsi que le secrétaire général du comité interministériel du handicap.
Notre objectif est de mener une professionnalisation accrue des AVSI et d’entamer une évolution progressive vers des métiers valorisant les compétences acquises par ces personnels. La fonction d'auxiliaire de vie scolaire auprès des enfants handicapés permet d'ores et déjà d'accéder à différents métiers dans le champ, plus large, des services d’aide à la personne. Je pense notamment aux emplois de catégorie C des fonctions publiques d'État, territoriale et hospitalière. Les concours de la fonction publique sont également accessibles.
Mais vous avez raison, monsieur le sénateur, de souligner l’obligation de trouver davantage de perspectives pour ces personnels.
Nadine Morano et moi souhaitons franchir une première étape à la rentrée 2010. Nous envisageons de signer avec l'ensemble des partenaires mobilisés – et d’abord les associations – une nouvelle convention cadre nationale. Celle-ci permettrait de mettre en place un système progressif de reprise des contrats des AVSI. Cette disposition s’appliquerait aux volontaires dont les compétences auraient été reconnues par les inspecteurs d'académie.
Comme vous le voyez, cet engagement traduit une nouvelle fois la volonté du Gouvernement d’apporter une réponse aux parents d’élèves handicapés de manière à insérer ces derniers dans le système scolaire de l’éducation nationale.

Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier des éléments de réponse que vous m’avez apportés. Évidemment, nous souhaitons que les objectifs rappelés puissent être atteints pour la rentrée 2010.

La parole est à M. Nicolas About, auteur de la question n° 836, transmise à M. le secrétaire d'État chargé de l'emploi.

Monsieur le secrétaire d’État, le Gouvernement n’a rien annoncé pour l'allocation équivalent retraite, ou AER, en 2010. Certains bénéficiaires de cette mesure ont à faire face à des remboursements qu'ils ne pourront plus assumer si elle n'est pas pérennisée. Pour les personnes dans le besoin et ayant pourtant travaillé toute leur vie, l'incertitude actuelle est fortement préjudiciable. Le Gouvernement a maintenu cette allocation en 2009, et la situation de l'emploi ne s'améliore pas pour les seniors en 2010. Il est donc important d'agir au niveau des dirigeants de sociétés afin qu'ils ne licencient pas les seniors et qu'ils ne précipitent pas ceux d'entre eux qui se trouvent déjà au chômage dans la précarité la plus complète.
Lorsque ces seniors ont été licenciés, les employeurs ont mis en exergue le fait que l’allocation équivalent retraite leur permettrait, le cas échéant, d’atteindre de manière décente l’âge de la retraite. Ces licenciements ont d’ailleurs souvent sauvé l’emploi des plus jeunes salariés de l’entreprise. Le Gouvernement compte pénaliser les sociétés qui ne respectent pas le droit de travail des seniors, et c’est une bonne chose : 1 % de pénalités pourraient être destinées à financer cette allocation de manière durable.
Par ailleurs, les différentes agences Pôle emploi ont dispensé de recherche d’emploi les salariés seniors au chômage ayant atteint l’âge de cinquante-sept ans et demi. Être dégagé de recherche d’emploi par Pôle emploi ne signifie-t-il pas justement que les propositions d’emploi sont inexistantes pour ces seniors ? Si les « emplois seniors » étaient si nombreux, Pôle emploi dispenserait-il si facilement les seniors de recherche d’emploi ?
Modifier les règles pour les personnes déjà licenciées et en cours d’indemnisation chômage n’est pas humainement possible. Si de nouvelles règles doivent entrer en vigueur, il faut que celles-ci soient connues par avance à la fois des employeurs et des salariés concernés par ces licenciements. Il est donc nécessaire que la date d’application des nouvelles règles soit fixée de telle façon que ces dernières ne s’appliquent pas aux salariés licenciés percevant actuellement des indemnités chômage déjà souvent bien faibles.
Compte tenu de la situation actuelle de l’emploi, notamment pour les seniors, je vous demande, monsieur le secrétaire d'État, d’intervenir fortement en faveur d’une pérennisation rapide, en 2010, de l’allocation équivalent retraite, selon les conditions actuelles de validation.
Monsieur le sénateur, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser Laurent Wauquiez, qui est en déplacement et m’a donc chargé de vous répondre.
Je suis heureux de vous annoncer que, conformément à ce que le Président de la République avait indiqué en février dernier, lors du sommet social, l’allocation équivalent retraite, l’AER, qui garantit aux demandeurs d’emploi un niveau de ressources minimum jusqu’au moment de la liquidation de leur retraite, sera prolongée, à titre exceptionnel, jusqu’au 31 décembre 2010. Un décret est actuellement en cours de signature.
Cette allocation, versée sous conditions de ressources, se substitue à un revenu de remplacement, qu’il s’agisse de l’allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active, ou peut être versée après expiration d’une allocation chômage. Elle peut également compléter une allocation chômage d’un faible montant.
Au cours de l’année dernière, marquée par une crise économique et financière exceptionnelle, le Gouvernement avait décidé, en accord avec les partenaires sociaux, de prolonger cette allocation pour l’année 2009. Cette crise continuant à peser cette année sur le marché de l’emploi, le Gouvernement a souhaité reconduire cette allocation pour l’année 2010 : il s’agit là non seulement d’une mesure de justice sociale, mais également d’une réponse forte à la question non moins importante des demandeurs d’emploi en fin de droits à l’assurance chômage, pour lesquels, vous le savez, un accord a été conclu avec les partenaires sociaux il y a quelques jours.
Ainsi, de nouvelles ouvertures de droits pourront être accordées dès lors que la demande est déposée avant le 31 décembre 2010 et que le demandeur d’emploi remplit les critères d’attribution suivants : être demandeur d’emploi, être âgé de moins de 60 ans, disposer de ressources inférieures à un plafond déterminé et justifier d’une durée d’assurance vieillesse au moins égale à 161 trimestres.
Nous venons de demander au directeur général de Pôle emploi de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes concernées puissent bénéficier très rapidement de cette allocation.
Monsieur le sénateur, vous avez également insisté sur une question très importante, l’emploi des seniors.
Je vous indique que le Gouvernement reste très déterminé sur cette question. C’est en effet une révolution culturelle que nous avons à mener – cela n’allait pas de soi dans notre pays ! – pour faire en sorte que les seniors cessent d’être considérés comme une variable d’ajustement de nos politiques de l’emploi, comme ce fut trop souvent le cas dans le passé.
Dans cette crise, un premier résultat important a été obtenu : entre 2008 et 2009, et pour la première fois – c’est donc historique –, le taux d’emploi des seniors s’est amélioré d’un point. Certes, ce résultat reste modeste, mais il n’en est pas moins significatif.
Toutefois, nous restons très vigilants. Nous ne devons pas baisser la garde sur cette question, qui est également, on le sait, déterminante dans le cadre de la réflexion en cours sur la réforme du financement des retraites.

Je tiens à remercier M. le secrétaire d’État de sa réponse. Je me réjouis du maintien de l’allocation équivalent retraite pour l’année 2010, ainsi que de l’amélioration de la situation de l’emploi des seniors.

La parole est à M. René Vestri, auteur de la question n° 864, adressée à M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation.

Monsieur le secrétaire d'État, nombre de nos concitoyens ayant été confrontés à des difficultés de paiement, mais ayant régularisé leur situation, sont toujours fichés au FCC, le fichier central des chèques, alors qu’ils ne devraient plus l’être.
En effet, en cas de régularisation de l’incident, l’effacement anticipé était jusqu’alors soumis à l’appréciation de l’établissement ayant demandé l’inscription au fichier central des chèques. Or, à la suite de nombreuses plaintes déposées par des personnes faisant l’objet d’une inscription au FCC pour une durée de deux ans, y compris après avoir régularisé l’incident ayant conduit au retrait de carte, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, a jugé cette disposition contraire aux principes du « droit à l’oubli » et a engagé des négociations avec l’ensemble des acteurs bancaires concernés afin de parvenir à une modification de ce fichier et de permettre aux clients d’obtenir ainsi leur « défichage ».
À ce titre, la CNIL a publié sur son site Internet les résultats de ces négociations, dont une nouvelle disposition permettant de régulariser sous 48 heures une inscription au fichier des incidents de crédit de la Banque de France, alors que, auparavant, les incidents, même régularisés, restaient inscrits durant deux ans.
Cette disposition prévoit que l’établissement bancaire a désormais l’obligation de demander la radiation dans les deux jours ouvrés à compter de la disparition du motif d’inscription. Celui-ci est tenu d’informer, sans délai et par écrit, les titulaires du compte de la radiation ou de l’annulation de leur inscription au FCC. Malheureusement, l’absence d’information des agences bancaires, que le groupement d’intérêt économique, ou GIE, des cartes bancaires « CB » et les établissements qui en font partie ont laissées sans instruction, a certainement créé un dysfonctionnement, entraînant ainsi de nombreuses plaintes.
Aussi, monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous faire connaître les relais et moyens d’information que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin que la mesure obtenue par la CNIL, qui constitue une avancée considérable des droits du citoyen consommateur, soit connue de tous et produise l’effet escompté, à savoir la radiation de dizaines, voire de centaines de milliers de personnes n’ayant plus à figurer dans ce fichier ?
Monsieur le sénateur, votre question est très importante, car elle concerne nombre de consommateurs.
Vous le savez, le fichier central des retraits de cartes « CB » a été créé le 1er août 1987 par la Banque de France, en application d’une convention conclue avec le GIE Cartes bancaires « CB ». Il était régi par arrêté du conseil général de la Banque de France du 16 juillet 1987, adopté après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La Banque de France y enregistre les renseignements relatifs aux décisions de retrait de cartes bancaires « CB » qui lui sont communiquées par les établissements membres du groupement Cartes bancaires « CB » et émetteurs de ces cartes.
Vous l’avez indiqué, monsieur le sénateur, la convention entre la Banque de France et le GIE Cartes bancaires « CB » a fait l’objet d’une renégociation, dont le résultat a été soumis à la CNIL, laquelle a autorisé, en février 2010, les modifications apportées aux modalités de gestion du fichier central des retraits de cartes « CB ». Cette autorisation encadre notamment les conditions de radiation des personnes inscrites à ce fichier, et principalement l’obligation faite à l’établissement de demander la radiation dans les deux jours ouvrés à compter du constat de la régularisation intégrale de leur situation.
Les établissements de crédit concernés ont, en outre, préalablement à toute décision de déclaration de retrait, l’obligation – j’y insiste – d’informer les porteurs de carte sur les modalités de régularisation et de contestation.
Ces nouvelles dispositions sont d’ores et déjà applicables, et la Banque de France est en mesure de prendre en compte les demandes d’annulation qui lui sont transmises selon les modalités modifiées. Elles seront de nature à réduire considérablement le nombre de plaintes relatives au fichier central des retraits de cartes bancaires. Comme vous l’avez souligné, monsieur le sénateur, de nombreuses personnes pourraient être concernées par cette modification.
La délibération de la CNIL a été notifiée à la Banque de France et au GIE Cartes bancaires « CB », qui sont chargés d’en appliquer les prescriptions. Le GIE Cartes bancaires « CB » est chargé d’informer ses membres des modifications apportées au mode de fonctionnement du fichier et aux procédures d’enregistrement et de radiation. Il est, en outre, tenu de procéder sans délai à la modification des contrats conclus avec les clients détenteurs de cartes bancaires et de comptes sur lesquels fonctionnent des cartes « CB », afin d’être en conformité avec l’autorisation donnée par la CNIL.
Tels sont les éléments de réponse que je puis vous apporter, monsieur le sénateur, concernant notamment le droit à l’information.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, auteur de la question n° 898, adressée à M. le ministre des affaires étrangères et européennes.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le Haut-Karabagh est un territoire azerbaïdjanais, occupé par l’Arménie. Cette occupation a été condamnée par plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, mais celles-ci n’ont jamais été appliquées.
Récemment, le représentant français au sein du groupe de Minsk, chargé du règlement du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, s’est fait piéger par une traduction infidèle. Malgré des mises au point et des dénégations, la traduction tronquée a fait l’actualité, devenant un fait médiatique avéré, autant dire la vérité, ce qui a tout naturellement provoqué une certaine incompréhension en Azerbaïdjan. Vous connaissez, comme nous tous, monsieur le secrétaire d’État, les effets ravageurs de la rumeur…
Dans le même temps, la diplomatie européenne s’active pour que l’Arménie et la Turquie règlent leur conflit historique.
Cette agitation diplomatique se fait, semble-t-il, sans que l’Arménie soit amenée à respecter les résolutions des Nations unies, qui l’enjoignent de restituer les territoires occupés du Haut-Karabagh, et donc de facto au détriment de l’Azerbaïdjan, qui est un partenaire économique et stratégique important et stable pour la France.
Le Président Sarkozy a récemment reçu le Président arménien à Paris.
Dans un Caucase si prompt à s’enflammer, où les troupes se massent en application d’un vieux principe que nous connaissons tous – si vis pacem, para bellum –, il est urgent que la France clarifie sa position et réaffirme sa volonté de voir régler la situation de milliers de réfugiés et de personnes déplacées qui attendent dans des conditions souvent dramatiques de rentrer chez eux dans le Haut-Karabagh.
Quelles mesures la France compte-t-elle prendre pour que les accords à venir entre l’Arménie et la Turquie ne négligent pas les intérêts légitimes de l’Azerbaïdjan, et quelles initiatives entend-elle engager pour favoriser le retour des réfugiés et des personnes déplacées du Haut-Karabagh ?
Madame Nathalie Goulet, je vous prie d’excuser M. Bernard Kouchner, ministre des affaires étrangères et européennes, qui m’a prié de bien vouloir vous transmettre sa réponse sur un dossier que je connais d’ailleurs personnellement pour m’être rendu sur place en prévision d’un prochain voyage dans cette région.
La France est très attachée à la paix et à la stabilité en profondeur de l’ensemble de la région du Caucase. Avec la Russie et les États-Unis, qui coprésident avec elle le groupe de Minsk de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE, elle joue un rôle actif pour aider les parties à conclure un règlement pacifique et équitable du conflit du Haut-Karabakh. Les excellentes relations que nous entretenons aussi bien avec l’Azerbaïdjan qu’avec l’Arménie constituent un atout très important. Ces deux pays sont d’ailleurs reconnaissants à la France de ses efforts.
C’est dans ce contexte que le coprésident français du groupe de Minsk, l’ambassadeur Bernard Fassier, s’est exprimé récemment – en français en effet – devant des députés de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, à Erevan. Certains de ses propos ont été déformés ou interprétés de manière erronée en Arménie puis dans la presse azerbaïdjanaise, qui s’en est fait l’écho. Depuis lors, les autorités de Bakou, au plus haut niveau, se sont déclarées satisfaites des explications qui leur ont été données et n’ont plus accordé d’attention à cet incident.
S’agissant du règlement du conflit, la référence aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies ne suffit pas. Ces résolutions, qui remontent d’ailleurs à 1993, sont antérieures au cessez-le-feu de mai 1994. Par conséquent, elles ne recouvrent pas la totalité des territoires azerbaïdjanais occupés aujourd’hui et ne peuvent donc constituer à elles seules la base du règlement.
La France a une position très claire. Elle n’a jamais accepté l’occupation des territoires azerbaïdjanais ni reconnu l’indépendance du Haut-Karabakh. Elle a transmis aux parties fin 2007, conjointement avec ses partenaires américain et russe, un modèle de règlement possible, « les principes de Madrid ».
Ce modèle prévoit, entre autres dispositions, l’évacuation des territoires azerbaïdjanais occupés qui sont adjacents au Haut-Karabakh, la reconnaissance par l’Azerbaïdjan d’un statut intérimaire pour le Haut-Karabakh et le principe du droit au retour pour toutes les personnes réfugiées ou déplacées.
Cette proposition de règlement équitable a été renouvelée au plus haut niveau par le Président de la République, conjointement avec les Présidents américain et russe, en juillet 2009, dans leur déclaration commune sur le Haut-Karabakh au sommet de L’Aquila.
Après une année diplomatique très dense en 2008-2009, avec onze rencontres entre les Présidents Aliev et Sarkissian, dont huit avec les coprésidents et trois avec le Président Medvedev, la négociation s’est compliquée depuis le processus qui s’est engagé entre l’Arménie et la Turquie, et qui a suscité, du moins au début, de l’espoir.
La France est convaincue que la normalisation entre l’Arménie et la Turquie aurait une portée historique. C’est d’ailleurs pourquoi nous soutenons ce processus. Elle comprend les préoccupations de Bakou. Mais nous sommes convaincus que l’Azerbaïdjan n’a rien à craindre de ce processus dont il serait lui-même l’un des premiers bénéficiaires avec la Turquie et l’Arménie, à la faveur d’un retour à la stabilité et à l’ouverture des frontières dans la région. Nous entretenons, au plus haut niveau, un dialogue constant et confiant avec les autorités azerbaïdjanaises. Il y aura des prolongements dans les mois qui viennent.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse.
Je rentre du Haut-Karabakh. J’étais plus précisément à Bakou. J’ai visité les camps de réfugiés. Pour avoir bien connu ceux de la Palestine, je dois dire que ceux d’Azerbaïdjan n’ont absolument rien à leur envier !
Une solution humanitaire devrait être apportée à ces réfugiés qui ne demandent pas d’aide particulière et dont la situation, qui ne doit pas perdurer, doit être prise extrêmement au sérieux, d’autant qu’ils veulent seulement rentrer chez eux !
Par ailleurs, une visite du Président de la République en Azerbaïdjan serait certainement la bienvenue. Le Président Aliev est lui-même venu quatre fois en France dans un temps extrêmement bref.

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, auteur de la question n° 831, adressée à Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité.
Ma chère collègue, M. Georges Tron, secrétaire d'État chargé de la fonction publique, dont ce sera la première intervention au Sénat, vous répondra à la place de Mme Morano, retenue. J’en profite pour lui souhaiter la bienvenue, au nom de tous nos collègues.

Monsieur le secrétaire d'État, je souhaite attirer l’attention de Mme la secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité sur les difficultés que rencontrent encore actuellement de nombreuses familles dont l’un des membres, handicapé, est accueilli en foyer d’accueil médicalisé, pour la prise en charge de ses frais de transport entre l’établissement et le domicile, lors d’une permission de sortie.
Le 16 avril 2009, dans sa réponse à ma question écrite sur ce même sujet, Mme Nadine Morano m’indiquait que, « dans l’attente de la mise en place d’un nouveau dispositif, la CNAMTS s’est engagée à adresser une nouvelle instruction à ses caisses locales, pour garantir la poursuite de la prise en charge des frais de transport dans les conditions actuelles ».
Par ailleurs, le 14 novembre 2009, le Sénat a adopté, sans modification, l’article 33 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, qui prévoit que « les frais de transport entre le domicile et l’établissement des personnes adultes handicapées fréquentant en accueil de jour les établissements ou les foyers d’accueil médicalisés sont inclus dans les dépenses d’exploitation de ces établissements et foyers et sont financés par l’assurance maladie ».
Ce dispositif constitue une avancée indéniable, mais il est loin de répondre, malheureusement, à la diversité des situations.
Ainsi, permettez-moi de prendre un exemple concret, celui d’une famille habitant en Charente, dont un fils âgé de trente-cinq ans, adulte handicapé, se trouve en pension complète dans un foyer d’accueil médicalisé à environ soixante-dix kilomètres de chez lui, soit plus de cent quarante kilomètres aller et retour !
Les parents de ce jeune homme vivent très modestement. Mais, comme ce sont des parents très attentifs, aimants, ils ramènent leur fils deux fois par semaine au domicile familial. Non seulement c’est nécessaire à son équilibre de vie, mais cela fait partie intégrante de son projet de soins individuels.
Pour l’année 2009, ils ont reçu de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente, pour les indemniser de leurs frais de transport, seulement 772, 48 euros pour la période de janvier à avril et 181, 76 euros pour le mois de mai. Depuis, plus rien, alors que les frais de transport coûtent chaque mois à cette famille entre 400 euros et 500 euros.
Par conséquent, vous en conviendrez, monsieur le secrétaire d'État, ce qui m’avait été indiqué dans la réponse à ma question écrite et encore réaffirmé au Sénat lors de l’examen de l’article 33 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 n’a pas été appliqué dans les faits par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente. Celle-ci n’a pas poursuivi le moratoire sur la prise en charge des frais de transport !
Enfin, les dispositions de l’article 33 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 ne peuvent pas s’appliquer dans ce cas précis, puisque le jeune homme handicapé réside en pension complète dans son foyer médicalisé et non pas seulement en accueil de jour, comme cela figure dans le texte. Cette famille est donc totalement désemparée et sans solution. Les parents ont de plus en plus de mal, avec leur petite retraite et sans aucun remboursement de la caisse primaire d’assurance maladie, à prendre en charge les frais de transport de leur fils. D’autres familles, et elles sont nombreuses, ne peuvent même plus aller chercher leur enfant handicapé, ce qui, vous l’imaginez, provoque des drames humains importants.
Aussi ma question est-elle double.
Le Gouvernement va-t-il rapidement proposer des mesures pour ne pas laisser les personnes handicapées en internat, sans solution ?
Compte-t-il faire appliquer sur le terrain, avec un remboursement rétroactif des sommes dues, le moratoire que Mme Nadine Morano a demandé aux caisses primaires d’assurance maladie sur la prise en charge de ces publics jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau dispositif ?
Monsieur le président, mes premiers mots seront pour vous remercier de votre accueil. Je suis très heureux d’intervenir devant le Sénat.
Madame Nicole Bonnefoy, je vous prie tout d’abord d’excuser Mme Nadine Morano, secrétaire d'État, qui m’a chargé de vous répondre. Je suis pour ma part très conscient de l’importance de votre question dans la mesure où, sur le plan personnel, je suis également très engagé dans des affaires de cette nature, la commune dont je suis maire s’efforçant de tout faire pour alléger les contraintes du handicap pour les familles.
Le Gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre une solution pérenne pour la prise en charge des frais de transport des personnes handicapées entre leur domicile et l’établissement qui les prend en charge. En ce sens, nous avons confié à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA, le pilotage d’un groupe de travail chargé de proposer, en lien avec l’ensemble des partenaires concernés, un dispositif plus satisfaisant que celui qui existe aujourd’hui.
Cette concertation a démontré que les cas les plus complexes étaient liés aux accueils de jour en maisons d’accueil spécialisé, les MAS, et en foyers d’accueil médicalisé, les FAM. En effet, les transports y sont souvent médicalisés et les retours à domicile quotidiens, ce qui génère une charge importante pour les familles.
C’est la raison pour laquelle la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2010 a prévu de confier aux établissements de jour l’organisation de ces transports, en échange d’une dotation transport qui sera intégrée à leur budget de fonctionnement.
Le décret d’application de cet article est en cours d’examen auprès du Conseil d’État. Il sera publié dans les prochaines semaines, afin de permettre l’entrée en vigueur du transport organisé par les établissements au 1er juillet.
Si le dispositif se limite pour l’instant aux établissements d’accueil de jour, le Gouvernement a souhaité aller plus loin.
En effet, la direction générale de la cohésion sociale, DGCS, et la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, CNSA, étudient l’intégration des frais de transport dans le budget des établissements pour les autres types de publics. II s’agit notamment de personnes en internat, comme le jeune homme dont vous venez d’évoquer la situation.
En attendant, comme vous l’avez souligné, les caisses primaires d’assurance maladie se sont engagées à poursuivre la prise en charge des frais de transport dans les conditions actuelles, dans l’attente de la mise en place d’un nouveau dispositif.
J’ajoute que les situations de non-respect de ce moratoire peuvent être signalées au conciliateur de la caisse primaire, qui est parfaitement sensibilisé à ce dossier. Le Gouvernement a fait en sorte que les conciliateurs le soient tous, compte tenu des cas tels que celui que vous venez de décrire et qui ne doivent pas se multiplier.
Enfin, je veux rappeler que la prestation de compensation du handicap, PCH, mise en place depuis le 1er janvier 2006, peut également prendre en charge, sur décision de la maison départementale des personnes handicapées, MDPH, les frais de transport des personnes handicapées pour se rendre en établissement médicosocial ou retourner à leur domicile, et cela jusqu’à 2 400 euros par an.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de cette réponse.
Je note que des propositions vont être faites par le Gouvernement pour intégrer les personnes handicapées en internat et que, pour le non-respect du moratoire – ce qui est le cas avec la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente – il est possible de saisir le conciliateur. C’est ce que nous allons faire.
J’ose espérer que ce dossier aboutira pour cette famille, comme pour celles qui se heurtent au même problème et qui, sans garantie de remboursement, ne peuvent même pas aller chercher leur enfant.
Si tel n’était pas le cas, je ne manquerais pas de saisir à nouveau Mme Morano.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, auteur de la question n° 849, adressée à Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Ma question était destinée à l’origine à Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Je vous l’adresse donc, monsieur le secrétaire d'État.
La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a consacré, dans le chapitre des droits et devoirs des détenus, le principe du rapprochement familial.
Ce principe constitue une avancée majeure du droit pénitentiaire dont la mise en œuvre est, pour de très nombreuses familles, une étape décisive dans le maintien effectif de liens familiaux avec leurs proches.
L’application de ce principe, au cœur des préoccupations de nombreuses familles de détenus, est pourtant restée en suspens depuis 2009, faute pour le Gouvernement d’avoir proposé les décrets d’application indispensables à la mise en œuvre de ce droit fondamental.
Aujourd’hui, il est nécessaire d’organiser ce droit au rapprochement familial, notamment pour les détenus corses incarcérés sur le territoire métropolitain.
En effet, pour les familles vivant en Corse, le maintien de liens familiaux avec les personnes détenues sur le territoire métropolitain est devenu un véritable cauchemar.
De nombreux détenus corses sont en effet maintenus sur le territoire métropolitain sans que leur situation fasse l’objet d’une considération particulière, c’est-à-dire prenant en compte la spécificité de la séparation géographique d’avec leur famille.
Or une telle prise en compte est non seulement nécessaire, mais également fondamentale : l’exercice par ces familles de leur droit de visite est semé de difficultés, tant matérielles que financières.
Des familles sont aujourd’hui privées de leur droit d’entretenir des relations familiales avec leurs proches en raison du coût exorbitant des voyages nécessaires sur le territoire métropolitain.
En 2003, l’Assemblée de Corse avait voté, à l’unanimité, une motion demandant la mise en œuvre rapide du rapprochement familial des détenus corses, mais le gouvernement n’avait pas donné suite à cette demande.
Devant une telle situation, une solution rapide est envisageable : le transfèrement des détenus du territoire métropolitain vers les établissements pénitentiaires de Casabianda ou de Borgo, en Corse.
Cette solution est conforme à l’article 34 de la loi pénitentiaire, selon lequel « les prévenus dont l’instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d’un rapprochement familial jusqu’à leur comparution devant la juridiction de jugement. »
Monsieur le secrétaire d’État, quelles dispositions le Gouvernement entend-il prendre pour que le principe du rapprochement familial des détenus puisse être effectif rapidement, en particulier pour ceux dont la famille réside dans un territoire non métropolitain ou insulaire – c’est le cas des détenus corses –, afin que le droit de visite puisse s’exercer dans de meilleures conditions ?
Madame le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de Mme Michèle Alliot-Marie, qui m’a chargé de vous répondre.
Le maintien des liens familiaux constitue un élément essentiel de la politique d’affectation des détenus. L’article 34 de la loi pénitentiaire auquel vous venez de faire référence concerne « les prévenus dont l’instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement ». Il appartient par conséquent aux magistrats en charge de la procédure de donner leur accord à la demande exprimée par le détenu.
Chaque demande doit être abordée en fonction de ses spécificités, en application du texte de loi, ainsi que dans l’intérêt des personnes détenues, de leur famille, mais aussi de la société. Il convient également de tenir compte de la spécificité de chaque établissement. Par exemple, en Corse, si le centre pénitentiaire de Borgo et la maison d’arrêt d’Ajaccio peuvent recevoir des personnes en attente de jugement, le centre de détention de Casabianda, en revanche, ne peut accueillir que des détenus condamnés et affectés à l’issue d’une procédure d’orientation. De plus, le centre de détention de Casabianda est spécialisé dans l’accueil des auteurs d’infraction à caractère sexuel.
Par ailleurs, l’affectation en établissement pour peine prend en compte plusieurs critères, dont la volonté exprimée par le détenu, l’évaluation de sa dangerosité, ainsi que sa situation familiale, sociale et médicale.
Le maintien des liens familiaux constitue le critère quasi exclusivement retenu dans le processus d’affectation des condamnés. Dans ce cadre, nous avons notamment créé des unités de visite familiales et des salons familiaux au sein de nombreux établissements pour peine répartis sur l’ensemble du territoire. Les familles peuvent ainsi rester plusieurs jours auprès de leur proche incarcéré. Depuis 2006, toutes les constructions nouvelles en disposent et les établissements de construction ancienne en sont également dotés dès lors que l’emprise foncière le permet.
Bien entendu, une attention particulière est portée aux détenus originaires de territoires non métropolitains. Depuis l’ouverture, en novembre 2003, du quartier de détention du centre pénitentiaire de Borgo, 165 condamnés d’origine Corse y ont été transférés.

En effet, les unités de visite familiales existent, mais elles ne sont pas assez nombreuses. La liste d’attente est si longue que certains détenus ne peuvent en bénéficier !
Et pourtant, vous l’avez dit, monsieur le secrétaire d’État, le lien familial est important dans le processus de réinsertion et dans la lutte contre la récidive. Il est d’ailleurs pris en compte par la nouvelle politique pénitentiaire, dont nous nous félicitons.
Toutefois, certains points n’ont toujours pas fait l’objet des décrets d’application nécessaires. Je souhaite donc que ceux-ci soient pris rapidement. Nous pourrons ainsi nous réjouir de l’effectivité d’une loi dont nous sommes fiers.
Par ailleurs, vous le savez, les détenus corses, basques ou bretons sont, d’une certaine manière, des détenus politiques, ce qui leur confère un caractère un peu différent. Sans doute leurs particularités familiales pourraient-elles être prises davantage en considération.

La parole est à M. Roland Ries, auteur de la question n° 841, adressée à Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Monsieur le secrétaire d’État, j’ai souhaité attirer l’attention de madame le garde des sceaux sur la décision prise par le Gouvernement de retirer au tribunal de grande instance de Strasbourg une partie essentielle de ses compétences en matière civile et commerciale.
Une série de décrets, promulgués à la fin de l’année 2009, ont désigné huit tribunaux de grande instance ou tribunaux de commerce désormais seuls compétents pour statuer sur certains contentieux. Pour le Grand-Est de la France, le tribunal de grande instance et le tribunal de commerce de Nancy ont été retenus. Si le souci de spécialiser les magistrats et les tribunaux est légitime, je considère que l’exclusion de Strasbourg de la liste des tribunaux compétents n’est pas justifiable.
Cette décision va d’ailleurs à l’encontre des propres engagements de l’État, qui a financé, aux côtés des collectivités, au travers des deux derniers contrats triennaux, la réalisation d’un pôle de compétences en propriété intellectuelle, ou PCPI, à hauteur de 9 millions d’euros.
En outre, cette décision n’est pas, hélas, isolée. Elle fait suite à l’installation à Nancy des juridictions interrégionales spécialisées en matière pénale et à l’annonce, l’été dernier, du transfert de la direction interrégionale des services pénitentiaires. Elle s’ajoute au silence du Gouvernement quant à la rénovation des locaux du palais de justice de Strasbourg, pour laquelle la ville, le département et la région ont pourtant accepté de contribuer à hauteur de 7, 5 millions d’euros, bien que cet investissement relève de la compétence exclusive de l’État.
Le décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 transfère notamment au tribunal de grande instance de Nancy la compétence exclusive en matière de droits de propriété intellectuelle ou industrielle. La ville de Strasbourg joue pourtant, depuis de nombreuses années, un rôle important dans le domaine de la propriété intellectuelle. La signature de la Convention sur l’unification de certains éléments du droit des brevets d’invention, dite Convention de Strasbourg, sans oublier la présence au sein de notre agglomération du seul pôle de compétitivité français à dimension mondiale en matière d’innovations thérapeutiques et du Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle, prouvent que Strasbourg est devenue, au fil des années, une référence au niveau national et européen en matière de propriété intellectuelle.
En définitive, c’est le statut de capitale du droit dont bénéficie Strasbourg, par la présence du siège du pouvoir législatif européen, de la Cour européenne des Droits de l’Homme et d’une université dont la renommée n’est plus à faire pour l’enseignement des matières juridiques, qui est ainsi fragilisé. Le choix unilatéral de l’État, au détriment de l’Alsace en général et de Strasbourg en particulier, montre que les discours du Gouvernement sur la défense de la vocation européenne de Strasbourg et sur son rôle de métropole régionale ne sont pas suivis des décisions concrètes nécessaires pour en assurer la crédibilité.
Par conséquent, eu égard aux arguments évoqués ici, je demande une nouvelle fois au Gouvernement de revenir sur une décision que nous considérons unanimement, gauche et droite confondues, inacceptable pour notre région et pour Strasbourg.
Monsieur le sénateur, la commission présidée par le recteur Serge Guinchard a proposé de poursuivre le travail de spécialisation engagé par la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, par la création d’un pôle national du contentieux des brevets et des obtentions végétales.
La commission a suggéré de spécialiser parallèlement certaines juridictions pour connaître des autres contentieux de la propriété intellectuelle, en matière de marques, d’indications géographiques, de dessins et modèles, ainsi que de propriété littéraire et artistique.
En matière de brevets, la commission a proposé de spécialiser le tribunal de grande instance de Paris, qui traite d’ores et déjà plus de 80 % de ce contentieux.
S’agissant des autres contentieux de la propriété intellectuelle, la commission suggérait la spécialisation d’une juridiction par ressort de cour d’appel.
Lors d’un arbitrage interministériel, il est apparu nécessaire d’aller au-delà des préconisations de la commission s’agissant du degré de spécialisation à retenir, en adoptant un schéma déclinant celui des juridictions interrégionales spécialisées, les JIRS.
Le niveau de spécialisation ainsi retenu a pour effet de concentrer ces contentieux auprès des quelques juridictions amenées à connaître d’un nombre significatif d’affaires, et d’offrir une réponse judiciaire de qualité fondée sur l’expertise induite par cette spécialisation.
La spécialisation des juridictions en matière de pratiques restrictives de concurrence est prévue par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 fixe la liste et le ressort des juridictions compétentes : il s’agit des tribunaux de grande instance ou tribunaux de commerce de Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes.
Monsieur le sénateur, le Gouvernement est bien conscient des interrogations et inquiétudes qu’ont pu susciter ces transferts de compétences. Il a donc décidé d’étudier, en concertation avec les élus et les différents acteurs locaux, les compensations et précisions de compétences qui pourraient être apportées à ces transferts en termes de répartition des contentieux spécialisés.

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d’État, de votre réponse, en particulier pour sa conclusion, qui ouvre, semble-t-il, une perspective de concertation. J’ai bien noté ce point qui me paraît important.
Permettez-moi néanmoins d’attirer de nouveau votre attention sur deux aspects.
Tout d’abord, le projet de pôle de compétences en propriété intellectuelle, qui est aujourd’hui bien avancé, grâce à des cofinancements de l’État et des collectivités locales, me paraît justifier certaines interrogations, s’agissant notamment du transfert de compétences en matière de propriété intellectuelle.
La cohérence voudrait que l’on revienne sur la décision qui a été prise. Sinon, cet investissement perdrait en crédibilité, eu égard à la compétence du tribunal de grande instance de Strasbourg.
Ensuite, j’évoquerai la transformation du palais de justice de Strasbourg. Datant de l’époque allemande, sa valeur patrimoniale est certaine, mais il ne répond plus aux besoins de la justice telle qu’elle fonctionne aujourd’hui.
Ce projet est aujourd’hui à l’arrêt, dans la mesure où l’enveloppe accordée par la chancellerie n’atteint que 53, 8 millions d’euros, alors que le coût de la restructuration, bien supérieur, a été estimé dans un premier temps à 60 millions d’euros. Les collectivités locales – région, département, ville et communauté urbaine de Strasbourg – ont accepté d’apporter 7, 5 millions d’euros en complément, mais il semblerait que ce ne soit toujours pas suffisant.
Par conséquent, je souhaiterais, monsieur le secrétaire d’État, que vous alertiez Mme le garde des sceaux sur ce dossier, qui suscite bien des interrogations dans notre région.

La parole est à M. Marc Laménie, auteur de la question n° 835, adressée à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

Monsieur le secrétaire d'État, la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie a, en son article 30 consacré à l’emploi des jeunes, abaissé à deux mois la période minimum de stage étudiant ouvrant droit à une gratification obligatoire de la part de l’entreprise d’accueil.
Cette disposition augmente de façon importante le nombre de stagiaires de l’enseignement supérieur concernés. Beaucoup d’entreprises devant malheureusement faire face à des difficultés conjoncturelles liées à la crise économique, les candidats aux stages éprouvent de plus en plus de difficultés à trouver un établissement d’accueil, alors même que cette période fait partie intégrante de leur parcours d’études.
Je souhaiterais savoir, monsieur le secrétaire d'État, quelles dispositions pourraient être mises en œuvre afin de remédier à cette situation.
Monsieur le sénateur, je vous prie tout d’abord d’excuser Éric Woerth, qui, ne pouvant être présent ce matin pour vous répondre, m’a demandé de le remplacer.
La loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances prévoit la gratification obligatoire des stages étudiants en entreprise. Cette loi répond à une attente forte et ancienne des étudiants stagiaires.
Cette mesure, conformément aux engagements pris par le Président de la République, a été étendue à l’essentiel du secteur public par les décrets du 24 avril 2009 et du 21 juillet 2009, afin de favoriser l’emploi des jeunes.
Comme vous l’avez rappelé, l’article 30 de la loi du 24 novembre 2009 a abaissé de trois à deux mois la durée de stage au-delà de laquelle celui-ci ouvre droit à gratification.
Le Gouvernement est attaché au principe de la gratification des stages. Il s’agit d’éviter les abus et de rappeler que les stages et les relations de travail salarié ne doivent pas être confondus.
La gratification contribue à cet objectif, de même que l’obligation de convention de stage ou encore l’interdiction des stages hors cursus.
Sur ce dernier point, un décret est en cours de finalisation.
Nous n’ignorons pas les effets de la crise économique ni les conséquences que cette obligation de gratification a pu avoir dans certains secteurs. Ainsi, la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a exclu certains cursus de formation du principe de la gratification.
De même, le Gouvernement a soutenu la proposition de loi de vos collègues Nicolas About et Sylvie Desmarescaux, qui vise à suspendre cette obligation pour les étudiants travailleurs sociaux.
Cette proposition de loi a d’ailleurs été adoptée jeudi dernier par le Sénat.
Pour apprécier plus largement les effets de cette gratification sur l’offre de stages, Xavier Darcos avait demandé, en lien avec le ministère de l’éducation nationale et le haut-commissariat à la jeunesse, un rapport à l’inspection générale des affaires sociale et à celle de l’éducation nationale et de la recherche.
Ce rapport sera remis prochainement au Gouvernement et vous pouvez être assuré, monsieur le sénateur, que ce dernier en tirera toutes les conclusions qui s’imposent.

Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie de votre réponse. En tant que parlementaires, nous avons été nombreux à avoir été sollicités sur ce sujet. La proposition de loi de nos collègues Nicolas About et Sylvie Desmarescaux constitue une première réponse. Le rapport que vous avez évoqué permettra, quant à lui, d’esquisser des solutions pérennes.

Dans l’attente de l’arrivée de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, je vais devoir suspendre la séance quelques instants.

Ce n’est pas au Parlement à se conformer aux horaires du Gouvernement !

Ma chère collègue, les différents intervenants ayant fait preuve ce matin d’une grande concision, nous avons pris de l’avance. Mme la ministre devait initialement arriver à onze heures vingt, et l’on me fait dire qu’elle devrait finalement nous rejoindre à onze heures quinze. C’est pourquoi je n’ai pas d’autre possibilité que de suspendre momentanément la séance.
La séance est donc suspendue.
La séance, suspendue à onze heures cinq, est reprise à onze heures dix-huit.

La parole est à Mme Nicole Bricq, auteur de la question n° 850, adressée à Mme la ministre de la santé et des sports.

Ma question s’adresse à Mme la ministre de la santé et des sports, mais je ne doute pas que Mme Pécresse portera la parole du Gouvernement, et répondra précisément à mes interrogations.
Lors de son conseil d’administration du 10 décembre 2009, la direction départementale de l’action sanitaire et sociale de Seine-et-Marne a pris une mesure unilatérale qui consistait à fermer l’unité de l’hôpital intercommunal sise à La Ferté-sous-Jouarre, avec pour effet le transfert immédiat des personnes vers une commune voisine, Jouarre en l’occurrence.
Il faut regretter que, préalablement à cette notification, aucune étude d’impact n’ait été envisagée par les services de l’État pour présenter à la population un projet qui permettrait d’assurer une complémentarité entre les diverses installations, et notamment avec l’établissement de Jouarre.
Les collectivités locales, comme souvent, sont appelées à financer ce que l’État a décidé. Ainsi, le conseil régional d’Île-de-France et le conseil général de Seine-et-Marne ont attribué des fonds à l’établissement de Jouarre pour la construction d’un nouveau bâtiment et des rénovations en cours. L’hôpital de Jouarre accueille aujourd’hui 276 résidents et a vocation à en accueillir 400 dans ce cadre nouveau.
Le 20 janvier 2010, à la suite de cette décision de l’État, le conseil municipal de la ville de La Ferté-sous-Jouarre, ville principale de l’intercommunalité, a formulé à l’unanimité le vœu que soit sursis à une telle décision, en attendant l’étude et la définition pour ce site d’un projet cohérent d’intérêt général répondant aux besoins médicaux et sociaux du territoire.
La ville de La Ferté-sous-Jouarre souhaite que cette étude soit l’occasion d’une réflexion partagée entre les acteurs du développement social et sanitaire : l’État, ce qui était alors l’Agence régionale de l’hospitalisation, ARH, le conseil régional financeur, le conseil général financeur, l’hôpital intercommunal et les professionnels de santé.
Cette réflexion a pour objet de prévenir les risques de désertification médicale, sujet que vous devez connaître, madame la ministre, d’assurer et d’améliorer la permanence des soins, et d’apporter aux habitants les services et les structures d’accueil de proximité les mieux adaptés à leurs besoins, en fonction de leur âge et de leur état de santé, conformément à l’esprit de la loi « hôpital, patients, santé et territoires ».
Le 24 février, le conseil municipal de la Ferté-sous-Jouarre a adopté une motion conforme à l’orientation de Mme la ministre de la santé et des sports que je voudrais rappeler. Présentant son projet de loi, Mme la ministre a affirmé qu’il s’agissait d’un texte « pensé du point de vue du patient concrètement situé, du patient qui, sur un territoire donné, doit pouvoir accéder, quels que soient son niveau d’information et ses moyens financiers, à une offre de soins adaptée et une permanence des soins performante ».
Or, c’est précisément le contraire qui a lieu avec la fermeture de l’unité de l’hôpital intercommunal, puisqu’elle engendre une diminution importante de l’offre de soins sur ce territoire, alors que les besoins de la population ne faiblissent pas.
Voilà pourquoi il est important de savoir, madame la ministre, quelles sont les orientations de l’État et comment celui-ci recherche, dans un dialogue avec les professionnels, les collectivités publiques et territoriales et les associations œuvrant dans le secteur médical, toutes les possibilités de maintien d’un établissement médico-social à La Ferté-sous-Jouarre.
La question est posée directement aux services de l’État qui ont pris une décision dont ils n’ont pas mesuré les conséquences.
Madame Bricq, je vous prie d’excuser mon retard, lié au fait que j’ai dû remplacer Mme la ministre de la santé et des sports, empêchée.
Vous m’interrogez sur la décision de la direction départementale d’action sanitaire et sociale de Seine-et-Marne de fermer une unité d’hébergement de personnes âgées de l’hôpital intercommunal de Jouarre.
Cet hôpital avait une activité d’unité de soins longue durée et deux activités d’hébergement de personnes âgées dépendantes, réparties sur trois sites : Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, Jouarre et La Ferté-sous-Jouarre.
C’est à la fin d’octobre 2008, à la suite de dysfonctionnements constatés au sein de l’établissement, que la direction départementale d’action sanitaire et sociale de Seine-et-Marne a diligenté une mission d’enquête qui a conduit à la restructuration de l’hôpital de Jouarre.
Les deux sites d’hébergement de personnes âgées dépendantes de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux et de La Ferté-sous-Jouarre ont donc été fermés.
En ce qui concerne le site de La Ferté-sous-Jouarre, le directeur départemental d’action sanitaire et sociale de Seine-et-Marne a rencontré en octobre 2009, à sa demande, Mme Richard, la maire de La Ferté-sous-Jouarre, afin d’évoquer concrètement le devenir de ce site.
II a été proposé d’y faire un projet de résidence sociale en lien avec l’association AFTAM, « Accueil et Formation des Travailleurs Migrants ». Ce projet n’a pas été retenu.
Parallèlement, un vaste projet de reconstruction de l’hôpital a été mené sur le site de Jouarre : 13 millions d’euros ont été attribués pour la construction d’un bâtiment sur ce site. L’hôpital de Jouarre a pu ouvrir ses portes dès mars 2009, et 47 places d’unités de soins de longue durée ont été ainsi créées ainsi que 300 places d’hébergement de personnes âgées dépendantes.
Au travers de cette évolution de l’hôpital intercommunal de Jouarre, il faut surtout souligner la réorganisation d’un établissement et la reconstruction d’un nouvel hôpital. Cela passe effectivement par un regroupement des différents sites pour permettre une meilleure prise en charge des patients et une meilleure application des bonnes pratiques. Le territoire de santé va ainsi bénéficier d’une offre de soins renouvelée et répondant aux besoins d’une population âgée.
Enfin, je tiens à rappeler que ce nouvel établissement médico-social n’est distant de La Ferté-sous-Jouarre que de trois kilomètres, et ne diminue par conséquent en aucune façon l’offre de soins dans ce secteur. À la fin des travaux, c’est-à-dire à la fin de l’année 2010, ce seront 350 lits, dont 76 de long séjour et 274 d’EHPAD, qui seront disponibles.

Madame la ministre, en ces temps de rareté des deniers publics, vous avez ressorti la réponse que vous ont préparée les services du ministère de la santé. Ce n’est certes pas à vous que je vais en vouloir, mais bien des choses se sont passées depuis.
Il faut savoir que le nouvel établissement de Jouarre, situé à proximité de la ville principale mais non à l’intérieur de cette ville, est surdimensionné et se trouve dans une situation financière dégradée. Ce sont les collectivités locales qui sont appelées à financer.
J’insiste sur cette question en raison d’une polémique peu sérieuse qui s’est fait jour lors d’une campagne régionale que vous connaissez bien, madame le ministre, puisque vous étiez candidate.
Il faut donc trouver une solution dans un cadre de complémentarité de l’offre de service en adéquation avec les besoins de la population. La ville de La Ferté-sous-Jouarre a pris le mors aux dents, et s’est rapprochée du directeur de l’hôpital de Coulommiers, qui est peu éloigné, pour trouver une solution concernant l’ensemble du bassin de vie.
Depuis le décret du 1er avril 2010, l’Agence régionale de l’hospitalisation est devenue l’Agence régionale de santé, et M. Évin en a pris la direction. La nouvelle ARS va reprendre un certain nombre de compétences de l’ancienne DDASS.
Il faut souhaiter que tous les acteurs se réunissent et qu’ils trouvent une solution, car, dans ces territoires éloignés du centre de l’agglomération, le besoin des populations est important, et l’on se doit d’y répondre. C’est là le problème des structures hospitalières qui doivent être à la fois compétentes et de proximité, répondant ainsi aux besoins des populations éloignées des grands CHU ou des centres médico-sociaux. C’est un problème qui doit exister dans bien d’autres départements.

La parole est à M. Michel Billout, auteur de la question n° 859, adressée à Mme la ministre de la santé et des sports.

Monsieur le président, madame la ministre, nous allons à la fois rester dans le même département et sur le même secteur d’activité qu’est la santé. Comme ma collègue, j’aurais pu choisir bien des exemples en Seine-et-Marne pour exposer les conséquences de votre politique en matière de santé, mais je me concentrerai sur l’exemple du centre de Forcilles à Férolles-Attilly, qui me paraît particulièrement emblématique.
En effet, dans une décision du 24 novembre 2009, la commission exécutive de l’agence régionale d’hospitalisation a enjoint le centre de Forcilles de fermer son service de radiothérapie.
Or, cette décision de fermeture faisait suite à un vote favorable de la même ARH au maintien des activités de radiothérapie quatre mois plus tôt. Je m’interroge donc sur cet étrange revirement de situation et sur les pressions dont aurait pu être l’objet la commission exécutive de l’ARH. Il convient, en effet, de rappeler que le ministère de la santé ne dispose plus de compétence en matière d’octroi d’autorisations sanitaires depuis l’ordonnance du 4 septembre 2009.
En raison d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision de fermeture, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a donc ordonné le 30 mars dernier la suspension de la décision en question, en attendant qu’il soit statué sur le fond.
Cet établissement, qui bénéficie du statut d’établissement de santé privé d’intérêt collectif, particulièrement bien noté lors des visites de certification, jouit d’une expérience de 35 ans, louée par de grands professeurs de médecine, et est un maillon indispensable, selon ces mêmes professeurs, au bon fonctionnement du « réseau cancer d’Ile de France ».
Avec le plan cancer, fondé sur une logique purement arithmétique et comptable, le ministère de la santé avait décidé de fermer tous les services de radiothérapie faisant moins de 600 actes par an. Pourtant, le nombre de patients à Forcilles est en augmentation constante – les chiffres sont attestés par constat d’huissier – et l’importance de ce service pour le département de Seine-et-Marne et la région ne fait aucun doute.
La particularité de Forcilles est d’associer à la fois radiothérapie, chimiothérapie, nutrition entérale et parentérale, ainsi que lutte contre la dénutrition des malades. En supprimant le service de radiothérapie, et donc l’hospitalisation complète, les chances de guérison des malades vont s’amenuiser. En effet, la dissociation des soins en deux lieux éloignés implique l’accroissement de la durée de transport des patients allongés et appareillés, durée qui peut être conséquente dans le département de Seine-et-Marne.
Cette fermeture occasionnera parallèlement pour la sécurité sociale des coûts supplémentaires liés à la prise en charge des transferts vers d’autres centres régionaux.
S’agissant des conséquences sociales, notons qu’un tel choix provoquerait la liquidation judiciaire de l’établissement et le licenciement de 700 salariés.
Madame la ministre, je souhaiterais donc connaître votre avis sur le maintien de l’activité de radiothérapie du centre de Forcilles. Plus largement, pensez-vous que l’application d’une logique purement comptable permette de maintenir, voire de développer le service public de santé pour les Seine-et-Marnais, ainsi que la médecine publique de proximité, qui, jusqu’à présent, a démontré sa grande qualité ?
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je me réjouis de répondre à une nouvelle question relative au département de Seine-et-Marne, et je vous prie une fois encore de bien vouloir excuser ma collègue Roselyne Bachelot-Narquin, empêchée.
Vous m’interrogez, monsieur le sénateur, sur la situation des établissements de santé en Seine-et-Marne, plus particulièrement sur la fermeture programmée du service de radiothérapie du centre médical de Forcilles, situé sur la commune de Férolles-Attilly.
L’activité de traitement du cancer et de la radiothérapie a été totalement réorganisée selon des dispositifs réglementaires qui ont été publiés en 2007. De nouvelles dispositions ont été définies, conditionnant l’autorisation au respect de critères à la fois qualitatifs et quantitatifs, tels qu’un seuil d’activité fixé à 600 patients par an. Comme vous le savez, monsieur le sénateur, ces dispositions ont été prises à la suite des très graves incidents survenus à Épinal et à Toulouse, et non pour des raisons comptables.
En radiothérapie, en effet, le moindre problème peut tout de suite avoir des conséquences extrêmement graves pour les patients. Nous avons donc un impératif de sécurité, et nos concitoyens ne comprendraient pas la survenue d’un nouvel accident.
Comme vous l’avez souligné, le service de radiothérapie de Forcilles a déposé un dossier pour demander l’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer auprès du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation d’Île-de-France.
Celle-ci n’a pas donné une suite favorable à cette demande, l’établissement se situant largement en dessous du seuil d’activité minimum exigé pour assurer une sécurité optimale – 396 patients par an pour un seuil annuel fixé à 600. L’établissement a engagé auprès du tribunal administratif de Melun un recours en référé contre la décision de l’ARH.
Le 30 mars dernier, le tribunal administratif a réservé une suite favorable au recours, et la décision de l’agence a été suspendue. L’établissement de Forcilles peut donc continuer d’exercer l’activité de radiothérapie jusqu’au jugement au fond, qui sera vraisemblablement rendu dans un an.
Cependant, quelle que soit la décision du tribunal administratif, le centre médical de Forcilles doit s’engager dès maintenant dans une redéfinition de son projet médical.
L’agence régionale de l’hospitalisation encourage à ce titre le centre médical de Forcilles à développer sa filière d’excellence que sont les soins de suite et de réadaptation.
Par ailleurs, dans le cadre de son projet médical, l’établissement doit engager des coopérations avec les établissements publics et privés qui l’entourent.
J’ajoute que, en Seine-et-Marne et dans les départements limitrophes, de nombreux plateaux techniques de radiothérapie sont en mesure de prendre en charge les patients avec une sécurité et une qualité de soins optimales.

Vous avez évoqué, madame la ministre, les raisons quantitatives et qualitatives qui ont présidé à la redéfinition de la politique de lutte contre le cancer.
Toutefois, à ma connaissance, la qualité des soins dispensés au centre de Forcilles n’a jamais été mise en doute. En l’occurrence, il s’agit donc exclusivement de l’application d’une logique comptable fondée sur le nombre de patients soignés dans cet établissement.
Vous n’êtes pas sans savoir, madame la ministre, que la Seine-et-Marne est l’un des départements les plus ruraux d’Île-de-France. Cette spécificité mériterait une prise en compte un plus fine de la part du Gouvernement.
On peut effectivement se faire soigner ailleurs, mais il faut alors passer beaucoup de temps dans les transports, ce qui occasionne d’autres frais.
L’Agence régionale de santé, l’ARS, devrait avoir pour mission de définir des critères qui ne soient pas généralisés à l’ensemble du pays, mais qui tiennent davantage compte, non seulement de la qualité des soins dispensés dans chaque établissement, mais aussi des conditions géographiques dans lesquelles ils sont délivrés.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, auteur de la question n° 833, adressée à Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

M. Pierre-Yves Collombat. Madame la ministre, cette fois, c’est bien à vous que la question s’adresse…
Sourires

Comme vous le savez, depuis fin 2008, date du dépôt d’une plainte par un enseignant de l’Institut d’administration des entreprises pour trafic de diplômes, l’université du Sud Toulon-Var vit des heures difficiles. Bien que l’enquête policière soit toujours en cours, que l’inspection générale de votre ministère ait conclu à l’absence d’un tel trafic, que la chambre régionale des comptes n’ait rien trouvé à redire à la gestion du président de cette université, ce dernier a été suspendu par vos soins et remplacé par un administrateur provisoire en octobre 2009.
L’arrêté de nomination de cet administrateur précise que celui-ci est « chargé d’organiser l’élection d’un nouveau président dès que les conditions de fonctionnement de l’université permettront que cette élection se déroule en toute régularité et sérénité ».
Trois mois plus tard, les trois derniers présidents honoraires de l’université affirmaient dans un communiqué : « La gestion administrative courante est assurée. Les conditions administratives de préparation du prochain contrat quadriennal sont mises en place. » Ils en tiraient alors la conclusion suivante : « Il reste à l’université de Toulon à retrouver un fonctionnement normal, avec des responsables, présidents et vice-présidents, élus conformément à la loi, dans le respect des nouvelles dispositions sur l’autonomie des universités. »
C’est aussi la conclusion de la motion adoptée par le conseil d’administration de l’université de Toulon au début de janvier 2010, dont les considérants éclairent d’une lumière quelque peu étrange votre conception de l’autonomie universitaire : délégation à un administrateur provisoire du soin de préparer et négocier, avec ceux qui l’ont nommé, le contrat quadriennal engageant durablement l’avenir de l’université ; substitution aux élus régulièrement choisis par leurs pairs de chargés de mission nommés par ledit administrateur provisoire, sans que le conseil d’administration en soit informé.
Depuis, la polémique entre le conseil d’administration et un administrateur provisoire apparemment peu porté à la recherche de l’apaisement a repris dans la presse.
Dernier épisode : début mars, l’administrateur « provisoire » déclarait publiquement qu’il n’y avait pas de trafic de diplômes mais que c’était « une affaire d’immigration, un trafic de visas », et que des « inscriptions en master incompréhensibles » avaient facilité l’accès de certaines personnes au territoire français. Selon lui, l’affaire se déplacerait donc du terrain universitaire au terrain administratif.
Je souhaiterais dès lors vous poser deux questions, madame la ministre.
Après avoir évoqué une présomption de trafic de diplômes, puis des « dysfonctionnements consécutifs à l’engagement de poursuites disciplinaires » – je ne sais pas très bien ce que cela recouvre précisément –, on parle maintenant d’un « trafic de visas » : ne croyez-vous pas que cette succession de chefs d’accusation donne un peu une impression d’improvisation ?
Surtout, quand envisagez-vous d’organiser des élections générales, afin de rendre à la communauté universitaire de Toulon les pouvoirs réguliers qu’elle tient de la loi et de rétablir le fonctionnement normal de l’université du Sud Toulon-Var ?
Monsieur Collombat, vous avez souhaité m’interroger sur la situation que connaît l’université du Sud Toulon-Var.
Sachez que, dans cette affaire, ma seule intention est de protéger cette université. Je veux qu’elle retrouve la sérénité nécessaire à son bon fonctionnement, dans l’intérêt des enseignants-chercheurs, des étudiants, des personnels de l’université et, j’allais dire, de tout son territoire.
Dès que j’ai eu connaissance de soupçons de fraude sur les conditions d’accueil des étudiants étrangers à l’université de Toulon, j’ai immédiatement diligenté une enquête de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, l’IGAENR.
Parallèlement, les tribunaux judiciaires ont été saisis dès janvier 2009 de plaintes pour corruption émanant de membres de la communauté universitaire toulonnaise. Cette procédure judiciaire suit son cours et n’appellera pas de commentaires de ma part.
En juin 2009, un premier rapport de l’IGAENR a mis en lumière de très graves irrégularités dans les procédures d’inscription des étudiants chinois de l’université de Toulon. Ainsi, par exemple, des étudiants ayant échoué en première année ou en deuxième année dans d’autres universités avaient obtenu leur inscription en master 2 à Toulon.
La responsabilité de l’équipe dirigeante de l’université était mise en cause dans ce rapport. C’est pourquoi le recteur a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre du président et de deux vice-présidents. La décision de la juridiction disciplinaire sera rendue d’ici à la fin du mois.
Après le lancement de ces procédures disciplinaires et judiciaires, il est apparu que des pressions et des intimidations avaient été exercées à l’encontre de certains personnels de l’université qui auraient entravé le travail d’enquête de l’IGAENR. Elles ont été constatées par un rapport complémentaire de l’inspection que j’ai commandé, et qui a donné lieu à deux nouvelles décisions de ma part : premièrement, la suspension temporaire du président et de deux vice-présidents de leurs fonctions, afin que les procédures puissent suivre normalement leur cours ; deuxièmement, une nouvelle saisine du procureur de la République, cette fois-ci par mon ministère, pour délit d’entrave à la mission d’inspection, conformément à l’article L. 241-3 du code de l’éducation.
Nous sommes, monsieur le sénateur, face à une affaire très grave qui risque d’entacher la réputation de l’université de Toulon et qui peut susciter des interrogations quant à notre politique d’accueil des étudiants étrangers. Dans ces circonstances difficiles, j’ai nommé un administrateur provisoire, que j’ai chargé de rétablir le fonctionnement normal de l’université et de mener à bien les projets actuellement en cours. Il le fait dans un esprit de responsabilité et d’apaisement.
En ce moment même, comme vous l’avez souligné, monsieur Collombat, l’université est mobilisée dans la préparation de son prochain contrat quadriennal avec l’État. Je souhaite, tout comme vous, que l’université de Toulon retrouve le plus rapidement possible une organisation et une gouvernance à la fois efficace et transparente, pour que de nouvelles élections puissent avoir lieu.
Monsieur le sénateur, cette malheureuse affaire doit nous conduire à porter une plus grande attention aux conditions d’accueil des étudiants étrangers en France. C’est pourquoi Bernard Kouchner et moi-même avons demandé une mission complémentaire d’inspection sur les conditions d’accueil des étudiants chinois. Ce rapport nous sera remis dans les jours qui viennent. Dès réception de ces conclusions, je travaillerai avec tous les présidents d’universités afin qu’ils puissent prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de règles claires et rigoureuses pour l’accueil des étudiants étrangers dans leurs établissements. Ma mission est de protéger tous les étudiants, et vous pouvez compter sur moi pour continuer de l’assurer avec la plus grande vigilance.

Vous n’avez pas répondu à ma question, madame la ministre. Je ne vous ai pas interrogée sur les fautes réelles ou présumées des anciens responsables de l’université, ni sur les raisons qui vous ont conduite à suspendre ces derniers. Je n’ai d’ailleurs aucun accès particulier au dossier, et aucune envie de m’en mêler.
Je vous ai demandé, principalement, si vous comptiez organiser des élections et, accessoirement, ce que vous pensiez de la modification des chefs d’accusation.
Le calme est revenu, tout le monde en atteste, et c’est bien la moindre des choses après huit mois d’administration provisoire. Dès lors, pourquoi ne pas organiser des élections ? Que redoutez-vous ? Personne ne comprend vos réticences.
Mon but n’est pas d’apprécier l’opportunité de vos décisions. Les procédures disciplinaires, voire judiciaires auront lieu, très bien ! Que vous vous souciez de l’université, que vous vouliez réformer l’accueil des étudiants chinois ou autres, soit ! Là n’était pas ma question. Je vous ai simplement demandé pourquoi vous ne vouliez pas organiser des élections. Tout le monde les réclame. L’administrateur est-il capable, oui ou non, de rétablir l’ordre ? En attendant, la presse se fait régulièrement l’écho de nouvelles polémiques qui ne contribuent pas à redorer la réputation de l’université du Sud Toulon-Var.
Monsieur le sénateur, nous nous sommes manifestement mal compris. Je vous ai indiqué que je souhaitais que les procédures disciplinaires puissent se dérouler dans la sérénité. La juridiction disciplinaire rendra sa décision à la fin du mois.
Je vous rappelle qu’un rapport de l’Inspection générale de l’éducation nationale et de la recherche a constaté des pressions et des intimidations exercées sur les membres de la communauté universitaire, visant à empêcher ceux-ci de témoigner dans le cadre des procédures judiciaires.
L’existence de ce problème, nuisible à la sérénité et au bon fonctionnement de l’université, ne permet pas, pour le moment, d’organiser de nouvelles élections. Attendons que les procédures disciplinaires soient arrivées à leur terme ! Les élections pourront se dérouler dans la transparence et dans le respect des règles.

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, auteur de la question n° 842, adressée à M. le ministre de la culture et de la communication.

Madame la ministre, l’article 1519 H du code général des impôts, créé par la loi de finances pour 2010, détermine les conditions dans lesquelles l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, instaurée par l’article 1635-0 quinquies du même code, est applicable aux services de communication audiovisuelle qui sont autorisés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Cette taxe annuelle concernant les émetteurs de radio et de télévision s’élève aujourd’hui à 220 euros pour chaque station radioélectrique visée. Or ce montant devrait à terme atteindre 1 530 euros – augmentation non négligeable – alors que, parallèlement, les frais de gestion de ces stations ne cessent d’augmenter.
Eu égard au champ d’application de l’IFER, ce nouveau prélèvement risque de remettre en cause le fondement même du paysage radiophonique français, qui est l’un des plus diversifiés et des plus pluralistes au monde, basé sur la gratuité de fréquences attribuées à partir d’appels à candidatures très encadrés, visant notamment la nature de l’information, la promotion de nouveaux talents, les contenus locaux.
Dès lors, il est permis de se demander si cela n’aboutira pas à une remise en cause de la loi Fillioud, qui garantissait non seulement la liberté de communication, mais également le droit des citoyens à disposer d’une communication audiovisuelle libre et pluraliste. En clair, il s’agissait de faire bénéficier le plus grand nombre de citoyens, quelle que soit leur situation géographique ou économique, d’une offre culturelle diversifiée et, dans le même temps, de donner la possibilité à des opérateurs culturels de moindre envergure financière, mais dont l’intérêt est indiscutable, de diffuser des œuvres et des analyses ne trouvant pas forcément leur place dans les médias « classiques ».
Par ailleurs, faut-il préciser que cette taxe s’ajoute à la liste, déjà longue, des mesures palliatives que le Gouvernement a mises en place, à la suite de la suppression de la taxe professionnelle ?
Le 16 février dernier, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2010, le Sénat a eu un sursaut de bon sens et a adopté un amendement visant à exclure les radios associatives de cette disposition.
Pour autant, cette dernière s’appliquera bien aux stations des catégories B1 et D2, l’amendement déposé par le groupe socialiste visant à les en dispenser n’ayant pas été adopté. Les stations de catégorie C3 devront également s’acquitter de I’IFER.
L’amendement retenu, s’il a la vertu de sauver les radios les plus vulnérables du paysage radiophonique, ne saurait pour autant faire oublier le caractère inacceptable de cette nouvelle imposition qui risque de handicaper, peut-être de manière irréversible, les stations concernées. On prendrait le risque de supprimer des radios indépendantes dont on connaît le rôle irremplaçable en ce qui concerne l’information et l’animation économique des territoires, au même titre que les radios associatives.
De plus, en période de crise, les diffuseurs de programmes radiotélévisés sont des acteurs économiques locaux précieux pour les territoires sur lesquels ils sont implantés, puisqu’ils sont à la fois employeurs et acteurs sociaux, économiques et culturels.
Ma question est simple, madame la ministre : le Gouvernement a-t-il pris conscience des éléments que je viens d’évoquer ? Qu’envisage-t-il de faire pour permettre aux radios concernées d’échapper aux difficultés que j’ai soulevées ?
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser M. le ministre de la culture et de la communication, qui n’a pas pu être présent ce matin.
L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, a été instituée, comme vous le savez, au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale. Cette taxe concerne différentes catégories de réseaux, notamment les réseaux de communications électroniques.
Une instruction fiscale en cours de finalisation doit définir les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle imposition. Elle précisera que le redevable de l’IFER est la personne qui dispose d’une station radioélectrique pour les besoins de son activité professionnelle. Ainsi, les radios associatives, qui ne payaient pas la taxe professionnelle, ne seront pas soumises à l’IFER. Cette interprétation a été confirmée par le ministre chargé du budget, lors des débats qui se sont déroulés au Sénat le 16 février dernier.
En revanche, les autres catégories de radios, qui étaient soumises au paiement de la taxe professionnelle, seront redevables de cette nouvelle imposition.
Toutefois, deux dispositifs ont été prévus afin de permettre d’apprécier les effets réels de l’IFER sur les opérateurs, notamment au regard du régime antérieur de taxe professionnelle auquel ils étaient assujettis. Ainsi, les contribuables pourront demander le bénéfice d’un dégrèvement pour les impositions de 2010 à 2013 lorsque la somme de la contribution économique territoriale, des taxes consulaires et de l’IFER dues au titre de 2010 excède de 500 euros et de 10 % le montant de la taxe professionnelle et des taxes consulaires qui aurait été dû au titre de l’année 2010. De plus, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport qui tirera notamment les conséquences de la création de l’IFER.
Le Gouvernement a bien conscience que le paiement de cette taxe pourrait peser sur le budget des radios, dans un contexte économique difficile. Cependant, comme vous le constaterez vous-même, monsieur Mirassou, cette mesure est bien encadrée puisque, à l’issue de la première mise en œuvre de l’imposition, devront être examinés les ajustements qui pourront être apportés au dispositif.

Je souhaite tout d’abord souligner le départ précipité de la ministre concernée, qui a fait, selon une expression employée dans le domaine de l’aéronautique, un « touch and go » ! Je suppose toutefois que, si elle avait répondu à ma question, ses propos auraient été de même nature que ceux qui m’ont été adressés…
Certes, madame la ministre, votre réponse témoigne d’une certaine mansuétude fiscale de la part du Gouvernement, conscient des difficultés que l’application de l’IFER risque d’entraîner pour des radios et télévisions indépendantes. Mais encore faudra-t-il que ces dernières se livrent à une espèce de parcours du combattant insupportable pour pouvoir bénéficier des mesures permettant d’atténuer l’impact financier de cette imposition. C’est, en quelque sorte, l’histoire de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Je ne suis pas sûr que le syndicat concerné se satisfasse du dispositif que vous avez décrit, madame la ministre, même s’il s’agit d’un moindre mal.
Quoi qu’il en soit, il y aura deux poids, deux mesures entre, d’une part, les radios et télévisions indépendantes, qui, je le répète, garantissent le pluralisme et la vie démocratique dans notre pays, y compris dans ses territoires les plus éloignés, et, d’autre part, les grands médias, concentrant entre quelques mains les pouvoirs radiophoniques et audiovisuels et bénéficiant de largesses s’agissant de l’application des règles relatives à la publicité. En fait, on comprend bien que le Gouvernement a choisi son camp !

La parole est à Mme Bariza Khiari, auteur de la question n° 830, adressée à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Au mois de janvier dernier, la France a classé l’Algérie dans les zones à risques terroristes. Cette mesure a eu pour conséquence immédiate de renforcer les contrôles dans les aéroports pour les vols en provenance ou à destination de l’Algérie, de multiplier les mesures très contraignantes et parfois humiliantes envers les ressortissants de ce pays sur le sol français. Dernièrement, nous avons pu constater que cette décision française n’est pas restée sans conséquence sur la dégradation des relations diplomatiques de notre pays avec l’Algérie.
La politique du Gouvernement suit la ligne américaine, puisque la décision de classement a été annoncée quelques jours après celle des États-Unis. En 2003, lors du déclenchement de la guerre en Irak, la politique étrangère et de sécurité de la France a su se faire le chantre d’une vision différente des risques et des évolutions diplomatiques. Pourquoi en est-il autrement aujourd’hui ?
À la différence des États-Unis, en 2008, la France a signé avec le gouvernement algérien un accord très précis, contraignant et ambitieux de lutte contre le terrorisme. Le gouvernement algérien a, par ailleurs, effectué des efforts manifestes pour veiller à affaiblir les mouvements intégristes. Dès lors, je suis circonspecte quant aux raisons qui ont poussé le Gouvernement à choisir de placer l’Algérie dans la liste des pays à risques.
M. Domeizel, président du groupe d’amitié France-Algérie, et moi-même, en ma qualité de vice-présidente de ce groupe, sommes préoccupés des conséquences de ce classement. Le gouvernement algérien a peu goûté une décision unilatérale. L’émotion que ce choix a suscitée reste vive et creuse encore l’écart entre les deux rives de la Méditerranée. Nous devrions œuvrer au rapprochement de ces deux pays plutôt qu’à leur éloignement.
C’est pourquoi je souhaite connaître les raisons objectives qui ont conduit à procéder à ce classement ainsi que les mesures que le Gouvernement compte prendre pour améliorer les relations franco-algériennes.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, en l’absence de M. le ministre de l’intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui vous prie de bien vouloir l’excuser, je suis chargée de vous apporter la réponse suivante.
Pour permettre aux services de police d’anticiper les menaces terroristes en disposant d’une connaissance plus fine des déplacements internationaux, la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers les autorise à se faire communiquer par les transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires les informations enregistrées dans les systèmes de réservation et de contrôle des départs, c'est-à-dire les données d’enregistrement et de réservation.
Le Gouvernement a fait le choix de mettre en œuvre ces dispositions de façon expérimentale, uniquement pour les transporteurs aériens, pour les données d’enregistrement et pour les vols en provenance ou à destination directe d’États n’appartenant pas à l’Union européenne.
Un fichier des passagers aériens a ainsi été institué pour deux ans par un arrêté du 19 décembre 2006. Dans un souci d’efficacité, il a été décidé de restreindre initialement l’expérimentation à un nombre limité de pays, à savoir cinq. Cette expérimentation a été reconduite pour deux ans par un arrêté du 28 janvier 2009 et élargie à deux États supplémentaires, dont l’Algérie. Ce dispositif sera progressivement généralisé à d’autres États.
À cet égard, il convient de souligner que les États concernés ne sont pas retenus comme étant « à risques » en tant que tels. Le choix relève avant tout de considérations liées aux déplacements internationaux, sans que cela implique nécessairement un jugement sur la situation interne de tel ou tel pays.
Alors que la tentative d’attentat sur le vol Amsterdam-Détroit du 25 décembre 2009 a une nouvelle fois démontré la réalité de la menace terroriste et l’importance de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des passagers aériens, ce dispositif, expérimenté dans le strict respect des libertés publiques, constituera, à terme, un outil important de prévention du terrorisme.

Madame la ministre, je peux tout à fait comprendre que, au nom de l’efficacité et de la lutte contre le terrorisme, des mesures soient prises, mais votre réponse n’est absolument pas satisfaisante. Elle est purement administrative. Elle ne prend pas du tout en compte les liens historiques qui lient notre pays à l’Algérie et qui devraient amener le Gouvernement à faire des gestes significatifs, contrairement à ce qui se passe actuellement.
Récemment, les élus locaux des deux rives de la Méditerranée se sont réunis. Ils aspirent à ce que l’espace méditerranéen soit un nouvel espace « civilisationnel ».
Les mesures qui ont été adoptées sont vexatoires, voire discriminantes, et ne sont pas de nature à permettre le rapprochement entre les pays de la Méditerranée que nous appelons de nos vœux.
Malheureusement, face à l’adoption de ce type de mesure unilatérale à l’égard d’un pays de la Méditerranée avec lequel nous devrions entretenir des relations de fraternité, nous devons constater que l’Union pour la Méditerranée reste une coquille vide.
Bien évidemment, nous devons ensemble lutter efficacement contre le terrorisme et nous devrions prendre en compte les efforts d’ores et déjà effectués par l’Algérie en ce sens.

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à midi, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de M. Jean-Claude Gaudin.