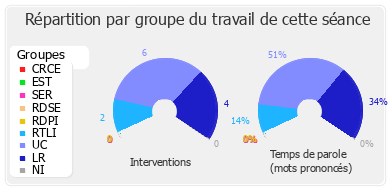Séance en hémicycle du 30 janvier 2007 à 10h00
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Remplacement d'un sénateur décédé
- Dépôt d'un rapport du gouvernement (voir le dossier)
- Décision du conseil constitutionnel
- Questions orales (voir le dossier)
- Élaboration des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à dix heures.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

J'informe le Sénat que M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, a fait connaître à M. le président du Sénat que M. Pierre Bernard-Reymond est appelé à remplacer au Sénat, à compter du 26 janvier 2007 à 0 heure, notre regretté collègue, Marcel Lesbros.
Au nom du Sénat tout entier, je lui souhaite une cordiale bienvenue.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l'article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il sera transmis à la commission des affaires culturelles, à la commission des affaires économiques ainsi qu'à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, et sera disponible au bureau de la distribution.

M. le Président du Sénat a reçu de M. le Président du Conseil Constitutionnel, par lettre en date du 25 janvier 2007, le texte d'une décision du Conseil constitutionnel qui concerne la conformité à la Constitution de la loi ratifiant l'ordonnance 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
Acte est donné de cette communication.
Cette décision du Conseil constitutionnel sera publiée au Journal officiel, édition des Lois et décrets.

La parole est à M. Alain Fouché, auteur de la question n° 1219, adressée à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable.

Madame la ministre, ma question porte sur la compétence d'élaboration des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés, qui peut être transférée aux conseils généraux en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Selon les articles L. 541-14 et L. 541-15 du code de l'environnement, ces plans tendent à la création d'ensembles coordonnés d'installations de traitement à l'échelle départementale, afin d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement.
Le conseil général de la Vienne, que j'ai l'honneur de présider, s'est doté de cette compétence et révise actuellement ce plan. Cependant, le cadre réglementaire ne lui permet pas d'atteindre correctement les objectifs prévus par la loi.
Les centres d'enfouissement techniques représentent l'outil final et incontournable de traitement des déchets au stade ultime. Le département de la Vienne, sensible depuis longtemps à cet enjeu, s'est donc doté de capacités de stockage importantes. Toutefois, il se trouve aujourd'hui pénalisé par des importations massives de déchets en provenance de départements qui ont des difficultés à se doter, sur leurs propres territoires, des installations nécessaires. Il en résulte un remplissage accéléré de ces sites d'enfouissement autorisés, au détriment des collectivités de la Vienne.
Ces flux de déchets constituent également une nuisance environnementale en générant des émissions de gaz à effet de serre, dans la logique inverse de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, qui a pour objet de limiter en distance et en volume le transport des déchets.
Par ailleurs, l'arrêté du 9 septembre 1997 et la circulaire du 17 janvier 2005 indiquent que la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement est indépendante des travaux d'élaboration du plan.
Seules les autorisations d'exploitation nouvelles de centres d'enfouissement techniques précisent l'origine géographique des déchets pouvant être admis sur le site. Leur délivrance est de la compétence exclusive du préfet, qui n'est pas tenu de se conformer strictement aux recommandations du plan et qui peut se prévaloir, dans ses décisions, d'une cohérence régionale ou interrégionale.
Dans ce contexte, et malgré des capacités dépassant largement les besoins des collectivités et des professionnels de la Vienne, des autorisations nouvelles d'exploitation ont été délivrées dans le département, et d'autres sont en cours d'instruction.
De plus, aucune réflexion ne peut être engagée sur la valorisation des déchets importés, puisque, selon la circulaire du 27 juin 2002, le caractère ultime d'un déchet ne peut s'apprécier à l'entrée d'une décharge.
Par conséquent, je vous serais reconnaissant, madame la ministre, de bien vouloir m'indiquer si vous envisagez de modifier l'article 8 de l'arrêté du 9 septembre 1997, ainsi que la circulaire du 27 juin 2002, afin de rendre opposables, dans un souci de logique et de cohérence, les orientations des plans départementaux d'élimination des déchets en matière d'importation de déchets, et de faire en sorte que les décisions des préfets en matière d'installations classées leur soient alors conformes.
Monsieur le sénateur, le sujet que vous abordez soulève plusieurs questions importantes en matière de gestion des déchets, notamment l'articulation entre la réglementation relative aux plans de gestion des déchets et celle relative aux installations classées.
Les plans de gestion de déchets visent à organiser la gestion des déchets sur un territoire en évaluant leur production, en définissant leur mode de gestion et en prévoyant les capacités de traitement thermique ou de stockage dont il faudra disposer pour assurer leur élimination.
La réglementation relative aux installations classées vise, quant à elle, à prévenir les nuisances que peut entraîner le fonctionnement des installations de traitement de déchets. Tel est l'objet de l'arrêté du 9 septembre 1997 modifié, applicable aux centres de stockage de déchets non dangereux.
Ces deux réglementations ont des objets différents, mais, comme vous le soulignez, il convient de veiller à leur mise en oeuvre coordonnée.
Ainsi, l'autorisation qui sera délivrée pour un centre de stockage de déchets fixe la quantité totale de déchets admissibles ainsi que leur provenance, sujets qui sont en règle générale évoqués dans le plan.
Par ailleurs, la loi précise que les décisions prises par les personnes morales de droit public, notamment les préfets, doivent être compatibles avec le plan. Cette notion de compatibilité est cependant moins forte que celle de conformité, et elle ne s'applique que pour des sujets dont la loi ou les règlements nationaux prévoient la prise en compte dans les plans.
Il convient aussi de considérer le contexte local. Il est bien sûr souhaitable que les déchets soient traités dans le département dans lequel ils sont produits. Cependant, plusieurs départements ne disposent pas, aujourd'hui, des capacités nécessaires, et vous savez que différentes études ont mis en évidence le risque, pour un certain nombre d'entre eux, de se retrouver en situation de pénurie au cours des prochaines années.
Dans ce cas, la solution, qui ne doit être que transitoire, passe par l'élimination des déchets dans un autre département. Une forme de solidarité est nécessaire dans les départements qui disposent de capacités supérieures à leurs besoins, et il ne serait pas raisonnable d'interdire, dans ce type de situations, l'importation de déchets extérieurs au département. La réglementation en vigueur ne le permet d'ailleurs pas.
Je rappelle que les communes accueillant les centres de traitement installés après le 1er janvier 2006 ou qui ont fait l'objet d'une extension après cette date peuvent lever une taxe de 1, 5 euro la tonne sur les déchets entrant dans l'installation. Nous avons voulu, par cette mesure, faire un geste envers les communes qui font preuve de solidarité.
Vous évoquez, enfin, la question de la valorisation de ces déchets, et notamment la notion de déchet ultime. Je confirme que cette notion est à évaluer en fonction du mode de gestion des déchets et des efforts faits pour extraire la part qui peut être recyclée ou valorisée : la vérification du caractère ultime des déchets ne peut donc se faire lors de leur mise en décharge.
Je constate que des efforts importants ont été faits, presque partout, pour valoriser davantage les déchets. S'agissant des emballages, le taux de recyclage augmente de façon continue : il a dépassé 50 % en 2004, alors qu'il n'était que de 44 % en 2001. Différentes filières ont été mises en place pour favoriser la valorisation de différents types de déchets, comme ceux qui proviennent des équipements électriques et électroniques, dits D3E, ou encore des imprimés sans adresse, pour ne prendre que deux exemples récents.
Il faut, certes, aller plus loin, et c'est bien le sens des nouvelles orientations que j'ai fixées en septembre 2005. J'ai ainsi présenté, il y a quelques semaines, un plan national de soutien au compostage domestique. Je crois que de très nombreux acteurs s'engagent dans cette voie, notamment dans les départements qui manquent d'exutoires et dans lesquels le coût de traitement des déchets résiduels est plus élevé du fait de cette pénurie.

Madame la ministre, je vous remercie de ces précisions. Le problème, en l'occurrence, est que certains départements ne veulent pas faire d'efforts.
J'ai bien noté votre volonté d'aller plus loin et de veiller à ce que les préfets se montrent attentifs à ce dossier.

La parole est à M. Bernard Murat, auteur de la question n° 1193, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Madame la ministre, les producteurs de fruits et légumes emploient environ 300 000 actifs, dont 230 000 salariés, saisonniers pour 90 % d'entre eux, et ce malgré le nombre significatif de demandeurs d'emploi non qualifiés dans notre pays.
Face aux difficultés de recrutement de saisonniers sur le territoire français, certains exploitants arboricoles font appel à de la main-d'oeuvre étrangère saisonnière, principalement en provenance de Pologne, du Maroc et de la Tunisie, par le biais d'une procédure gérée par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, l'ANAEM. Dans ce cadre, les producteurs doivent s'acquitter d'une redevance forfaitaire auprès de l'agence, mais variable en fonction du contrat du salarié : de 158 euros pour un contrat de moins de deux mois à 473 euros pour un contrat de six à huit mois.
Cette situation est tout à fait étonnante quand on en connaît les effets médiatiques quant à l'emploi des personnes non qualifiées.
Compte tenu de la pénurie de main-d'oeuvre saisonnière locale en France malgré les efforts de l'ANPE, ainsi que du coût non négligeable de la redevance pour les exploitants en difficulté économique, la libre circulation des travailleurs en provenance des pays de l'Est a été demandée lors des négociations relatives au volet emploi du plan stratégique « fruits », pour que les arboriculteurs n'aient plus l'obligation de passer par la procédure d'introduction gérée par l'ANAEM.
Ne pouvant s'engager sur la libre circulation des travailleurs en provenance des PECO, le ministre de l'agriculture a proposé un allégement de la redevance ANAEM de 50 % du montant de la redevance pour les saisonniers en provenance des nouveaux États membres. Cette proposition figure dans le plan arboricole annoncé en mars dernier.
Dernièrement, lors d'un déplacement en Corrèze, il a renouvelé son engagement, qui, à ce jour, n'a pas été suivi d'effets. Je souhaiterais donc aujourd'hui que me soient précisés les mesures envisagées et le calendrier de mise en place de cette proposition d'allégement de la redevance ANAEM pour les arboriculteurs.
Je saisis l'opportunité qui m'est offerte de m'exprimer sur cette question afin d'attirer votre attention sur le projet de réforme de l'organisation commune du marché, OCM, des fruits et légumes adopté il y a quelques jours par la Commission européenne.
Si nous pouvons nous féliciter de la préservation d'une OCM spécifique à la filière fruits et légumes et des objectifs affichés de renforcement de l'organisation de la production, le contenu du projet inquiète au plus au point : découplage des aides pour les filières de fruits et légumes transformés, outil de gestion de crise réservés aux seuls producteurs organisés, absence d'un volet de « préférence communautaire ».
Les exploitants parlent « d'une copie à revoir ». Quant au ministre de l'agriculture, il a lui-même indiqué que la proposition de la Commission manquait totalement d'ambition et était, sur certains aspects, contestable. Je vous demande donc ce que le Gouvernement compte faire pour que cette proposition soit modifiée et améliorée.
Monsieur le sénateur, je vous prie d'excuser l'absence de mon collègue Dominique Bussereau, qui est actuellement en entretien avec le Président de l'Azerbaïdjan.
Les producteurs de fruits et légumes, plus particulièrement les arboriculteurs, emploient un nombre important de salariés pour mener à bien les différents travaux saisonniers dans leurs exploitations, contribuant ainsi à maintenir l'activité dans les territoires ruraux. Le marché local du travail ne peut, à lui seul, répondre aux besoins de main-d'oeuvre de ces secteurs.
C'est pourquoi le ministère de l'agriculture et de la pêche se mobilise avec les professionnels pour apporter des réponses à leurs difficultés de recrutement.
Ainsi le ministère de l'agriculture et de la pêche a-t-il ouvert, à l'occasion du dernier salon international de l'agriculture, en partenariat avec l'Agence nationale pour l'emploi, l'ANPE, l'Association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l'agriculture et de l'agroalimentaire, l'APECITA, et l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture, l'ANEFA, un site Internet offrant à tous les employeurs des secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des services en milieu rural, la possibilité de publier gratuitement leurs offres d'emploi.
Dans l'optique de mutualiser l'emploi entre les différents secteurs économiques présents sur un territoire, le ministère de l'agriculture et de la pêche s'est également attaché à promouvoir la création de groupements d'employeurs multisectoriels grâce à des allégements spécifiques pour toute embauche en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée réalisée entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 ; c'est l'article 27 de la loi du 5 janvier 2006 d'orientation agricole.
Le ministère de l'agriculture et de la pêche s'est attaché à faire prendre en compte les spécificités du monde rural dans le processus d'ouverture progressive du marché du travail aux salariés des nouveaux États membres de l'Union européenne. Depuis le 1er mai 2006, la situation de l'emploi n'est plus opposée aux demandes d'introduction de travailleurs originaires de ces pays dans de nombreuses activités agricoles.
Sont concernés les métiers de maraîcher horticulteur saisonnier, d'arboriculteur viticulteur saisonnier ou encore d'aide saisonnier agricole.
Concernant la redevance due à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, l'ANAEM, en cas de recours à la main-d'oeuvre saisonnière originaire des nouveaux États membres, son montant doit être apprécié au regard des prestations rendues par l'agence aux employeurs agricoles. Si la demande de réduction de la redevance n'a pu être retenue dans l'immédiat, elle pourrait être réexaminée en fonction des résultats de l'ouverture progressive et maîtrisée du marché du travail aux ressortissants des nouveaux États membres et en tenant compte de l'objectif de compétitivité des producteurs français de fruits et légumes.
S'agissant du projet de réforme des « Organisations communes de marchés fruits et légumes frais et transformés » que la Commission européenne vient de faire connaître, sachez, monsieur le sénateur, qu'en l'état la proposition de la Commission n'est ni acceptable ni satisfaisante pour la France.
En effet, les outils de gestion de crise proposés ne sont pas de nature à répondre à l'ampleur et à la diversité des crises conjoncturelles auxquelles la filière des fruits et légumes est, par nature, régulièrement confrontée. La Commission n'apporte ni les moyens juridiques, ni, surtout, les moyens financiers nécessaires à la prévention et à la gestion des crises. Il est, en particulier, absolument indispensable que les mesures proposées soient opérationnelles et impliquent tous les producteurs, organisés et indépendants, d'une filière en crise.
De même, l'attractivité des organisations de producteurs doit être renforcée. Ces dernières doivent pouvoir programmer des actions dans le cadre de leur fonds opérationnel pour une part majorée de la valeur de leur production commercialisée.
Un très gros travail reste donc nécessaire pour modifier et améliorer cette proposition. Soyez assuré, monsieur le sénateur, que la France y apportera sa contribution pour aboutir à des améliorations notables donnant ainsi aux filières fruits et légumes de réelles perspectives de développement, dans un environnement économique stabilisé.

Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse. Je vous rappelle que les fruits et légumes font partie du plan nutrition-santé. Nous connaissons tous l'aspect bénéfique de la consommation des fruits et légumes sur la nutrition, en particulier sur des maladies comme le cancer. Au-delà du problème purement agricole, le volet santé mérite d'être pris en compte.
J'ai bien compris que vous alliez réexaminer ce problème et je vous en remercie. Pour votre information, je vous indiquerai que vingt saisonniers polonais employés en Corrèze pendant quatre à six mois coûtent à l'exploitant 6 720 euros. Il faut quand même le savoir, c'est du concret ! Cela ne peut plus durer plus longtemps ! Le réexamen que vous annoncez est tout à fait positif.
Quant à votre position et à celle du Gouvernement vis-à-vis de l'OCM, je n'en attendais pas moins du ministre de l'agriculture et du Gouvernement. Il faut absolument que la France fasse entendre sa voix haut et fort dans ce concert européen où l'agriculture devient une variable d'ajustement politique, ce qui est inacceptable au regard de la tradition française et de ce que représente l'agriculture dans l'économie de notre pays.

La parole est à M. Claude Biwer, auteur de la question n° 1204, adressée à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales.

Monsieur le ministre, la fin de l'année 2006 aura été particulièrement riche dans la production de rapports consacrés aux collectivités territoriales : celui qui est présenté par un membre du Conseil économique et social, CES, M. Philippe Valletoux, qui formule des propositions visant à améliorer le système de financement des collectivités, le rapport de M. Pierre Richard sur le thème des dépenses locales et, enfin, celui qui fait l'objet de la question d'aujourd'hui, le rapport d'information présenté par nos collègues députés Marc Laffineur et Augustin Bonrepaux, mesurant les conséquences des transferts de compétences sur les disparités entre collectivités territoriales. C'est bien cette aggravation des disparités qui fait aujourd'hui l'objet de ma question.
J'observe que ce rapport a été cosigné par deux parlementaires issus des rangs de la majorité et de l'opposition, ce qui me semble lui donner plus de force.
Au-delà du bilan financier des transferts de compétences, les rapporteurs affirment que, si ces transferts ont entraîné une augmentation des dépenses des collectivités territoriales - ce qui n'est pas anormal - ils ont également contribué à accroître les disparités entre collectivités, qui se sont aggravées depuis 2004.
Il est précisé dans ce rapport que les handicaps se cumulent et que plusieurs départements ou régions tendent à être perdants sur plusieurs transferts à la fois, en dépit de l'équilibre global à l'échelle du pays. Ce sont bien évidemment ceux qui ont à faire face aux dépenses sociales les plus importantes.
Les départements dont la population est peu importante voient, du fait de leur faiblesse économique, la fraction de leur jeunesse la mieux formée abandonner leur terroir pour s'installer sur les lieux de leur formation, villes universitaires ou grandes villes.
Dans ces départements, le pourcentage de chômage n'est pas plus élevé qu'ailleurs puisque ces jeunes ne sont pas pris en compte dans les statistiques locales.
On est en présence d'un effet de ciseau non négligeable entre les jeunes qui quittent leur terroir et les retraités qui y reviennent, ce qui risque d'aggraver dans les années à venir les difficultés de ces départements, qui financent les mesures sociales.
Il s'agit là, incontestablement, du principal échec de la décentralisation : faute de solidarité réelle entre territoires, les plus forts se renforcent et les plus faibles continuent de s'affaiblir.
Le rapport de nos collègues députés, en soulevant le problème des inégalités, pose, à juste titre, celui de la péréquation : la seconde est supposée corriger les premières mais nous savons bien que cela n'est pas, présentement, le cas.
Afin de remédier à la situation actuelle, ils estiment que la poursuite de l'acte II de la décentralisation suppose la création d'un ou plusieurs nouveaux outils de péréquation entre les ressources dont disposent les collectivités, par exemple, un mécanisme d'écrêtement des droits de mutation à titre onéreux, qui sont, il est vrai, très inégalement répartis entre territoires alors qu'ils progressent en France de façon très importante : plus 800 millions d'euros entre 2004 et 2005. Chacun le sait bien, ces recettes sont bien plus abondantes en Île-de-France ou en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur qu'en Lorraine, compte tenu de la flambée des prix de l'immobilier.
Je précise, à cet égard, que ces droits ont rapporté 49, 2 euros par habitant au département de la Meuse en 2005, soit 14 fois moins que pour le département des Yvelines, qui a perçu, de son côté, 684 euros par habitant.
S'agissant du produit global de ces droits, il s'élevait, la même année, à 9, 45 millions d'euros pour la Meuse contre 327 millions d'euros pour les Hauts-de-Seine : 34 fois plus, c'est énorme !
J'ajoute que, dans un département comme le mien, nous entretenons 16 mètres linéaires de voirie par habitant, alors que la moyenne en France est de 6 mètres.
En matière de santé, compte tenu des trajets et des impératifs horaires, nous avons besoin, pour intervenir rapidement, d'une ambulance pour 4 800 habitants alors que la moyenne en France est de 9 500.
Je serais heureux que le Gouvernement réserve une suite favorable aux conclusions de ce rapport. Je souhaite qu'au-delà des droits de mutation qui peuvent ne pas être des recettes pérennes, une réflexion s'engage également sur une plus grande péréquation dans la répartition de la dotation globale de financement, DGF, dont le moins que l'on puisse dire est que celle-ci comporte encore de trop nombreuses injustices.
Monsieur le sénateur, la question de la compensation financière des transferts de compétences donne lieu depuis de nombreux mois à maints débats tant sur le montant de la compensation accordée par l'État que sur l'apparition potentielle de nouvelles inégalités entre les territoires. Cette situation impose d'apporter les clarifications nécessaires. Trois points méritent d'être signalés.
Premièrement, les transferts de compétences effectués au profit des collectivités locales ont fait l'objet d'une compensation financière intégrale.
Le Gouvernement est même allé au-delà de ses obligations législatives et constitutionnelles. En effet, il a accepté pour certains transferts - et lorsque cela était plus favorable aux collectivités - de calculer le droit à compensation, non pas conformément à la loi, c'est-à-dire sur la moyenne des trois années, mais au regard des dépenses réalisées par l'État au cours de la dernière année précédant le transfert.
Au total, l'effort supplémentaire ainsi consenti par l'État s'élève à 157, 7 millions d'euros.
S'agissant du RMI, l'État a transféré avec exactitude le montant correspondant à ses propres dépenses de l'année 2003, soit près de 5 milliards d'euros. Mais, conscient des difficultés et des interrogations des collectivités locales, notamment des conseils généraux, il est allé plus loin puisqu'il a dégagé 457 millions d'euros au titre des dépenses de RMI de 2004 et doté le fonds de mobilisation départementale pour l'insertion de 1, 5 milliard d'euros, tout cela venant s'ajouter au droit à compensation.
Au total, il me paraît important de noter que la dépense des départements au titre du RMI pour l'année 2005 sera compensée à hauteur de 93, 5 %. On ne peut donc accuser l'« acte II » de la décentralisation de toutes les difficultés rencontrées par certaines collectivités.
Cela me conduit à aborder un second point, en effet très important, celui de la péréquation, qui a d'ailleurs été une priorité pendant toute cette législature.
La révision de la Constitution en mars 2003 a ainsi consacré le principe de la péréquation, puis la loi du 18 janvier 2005 a prévu de consacrer chaque année, de 2005 à 2009, 120 millions d'euros supplémentaires au titre de la dotation de solidarité urbaine. Enfin, les lois de finances pour 2004 et pour 2005 ont simplifié l'architecture des dotations de l'État.
Les départements les plus pauvres ont, comme vous le savez, bénéficié de ce mouvement de solidarité puisque de 2004, année de référence puisque c'est celle de la réforme de la dotation globale de fonctionnement, à 2006, la dotation de péréquation urbaine est passée de 9, 79 euros par habitant à 11, 81 euros, ce qui représente tout de même une augmentation de 21 %.
Pour les départements ruraux, la dotation de fonctionnement minimale par habitant a augmenté - M. Jean Boyer ne me contredira pas - de 32 %, passant de 17, 93 euros à 23, 59 euros.
La question de bon sens qui est posée est en réalité la suivante : faut-il faire encore plus et, surtout, faut-il prévoir un fonds de péréquation alimenté par les droits de mutation à titre onéreux, les DMTO, qui constituent la recette dynamique des conseils généraux ?
Le rapport de la commission des finances de l'Assemblée nationale que vous citez préconise la mise en place d'un « mécanisme d'écrêtement des droits de mutation à titre onéreux », ce qui m'amène à faire trois observations.
Première observation, la commission suggère non pas la création d'une taxe additionnelle mais un écrêtement dans les départements les plus riches. Cette proposition est donc sage du point de vue des prélèvements obligatoires, mais serait assez difficile à mettre en oeuvre pour les départements. On sait que tous les dispositifs de péréquation horizontale sont difficiles à créer et plus encore à faire vivre : à l'exception du FSRIF, le fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, tous ceux qui ont été créés dans le passé ont été finalement supprimés.
Deuxième observation, et c'est un phénomène nouveau que vous êtes nombreux au sein de la Haute Assemblée à connaître, l'impact de l'évolution des prix de l'immobilier a été visible dans la plupart des départements français, alors qu'auparavant c'était essentiellement l'Île-de-France qui était concernée. L'évolution des DMTO département par département fait ainsi apparaître une évolution moyenne de l'ordre de 75 % depuis 2002, évolution donc assez lourde dont bénéficient, avec des pointes encore plus importantes dans certains d'entre eux, la quasi-totalité des départements. De ce fait, la péréquation du produit des DMTO est moins nécessaire.
Troisième observation, cette proposition n'a pas été vraiment expertisée à ce stade. La commission elle-même n'a pas été très précise dans ses intentions. Quel devrait être le niveau de gestion, national, régional ou interdépartemental, du fonds ? Quelles seraient ses règles de répartition ? En outre, si les critères pour déterminer quels départements peuvent être dits riches sont assez aisés à établir, ils mériteraient sans doute d'être affinés.
Si une réflexion est menée sur ce sujet, elle devra donc être particulièrement concertée.
Je conclurai en signalant que la réforme de la DGF entreprise en 2004 n'a pas fini de produire ses effets péréquateurs. La DGF pour 2007 n'a pas encore été répartie par le comité des finances locales. Mais, cette année encore, l'effort en faveur de la péréquation ne devrait pas se démentir, grâce notamment à la reconduction, que nous avons eu l'occasion d'évoquer dans le débat sur la loi de finances, du contrat de croissance et de solidarité ainsi qu'au maintien à hauteur de 2, 5 % de l'indexation de la DGF.
Telles sont, monsieur le sénateur, les précisions qu'il me semblait utile de vous apporter.

Monsieur le ministre, je vous remercie des précisions que vous m'apportez. Vous confirmez que les réflexions sont bien engagées au niveau du Gouvernement et nous nous en félicitons. Toutefois, si nous insistons régulièrement sur ce thème, c'est bien parce que les « petits » départements sont aujourd'hui confrontés à des difficultés grandissantes. Je vous ai entendu évoquer ces difficultés et je crois que nous sommes sur une bonne voie.
Pour la gestion du fonds et pour la mise en oeuvre de la péréquation, je me permettrai de dire que le meilleur échelon me paraît devoir être l'échelon national, car, à l'échelon départemental ou régional, nous savons bien, les uns et les autres, ce à quoi nous nous exposons.
La dotation de solidarité urbaine a connu des augmentations beaucoup plus importantes en pourcentage que la dotation de solidarité rurale, raison pour laquelle nous regrettons parfois que le fossé ait tendance à se creuser entre zones rurales et zones urbaines. Nous espérons donc que les mesures que vous préconisez porteront leurs fruits.

La parole est à M. Xavier Pintat, auteur de la question n° 1224, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Monsieur le ministre, ma question porte sur la surveillance du littoral aquitain et la difficulté pour les élus locaux d'assurer, dans de bonnes conditions, la sécurité des personnes fréquentant les bords de mer.
Près de 20 millions de personnes sont concernées.
L'exercice de la police de baignade, assuré en partie par les CRS maîtres nageurs sauveteurs, MNS, sous la responsabilité pénale des maires devient, au fil des années, de plus en plus problématique.
Les raisons sont multiples. Elles tiennent à la présence d'une population de plus en plus nombreuse sur les côtes ; à l'indispensable et irremplaçable rôle de police qu'exercent les CRS-MNS sur les plages ; à une implantation des postes de secours qui ne correspond peut-être plus à la fréquentation touristique actuelle ; à l'essor des activités nautiques de toute nature, dépassant largement la surveillance de la baignade ; à la difficulté persistante que rencontrent les communes pour recruter des sauveteurs saisonniers disposant du brevet national de sécurité et sauvetage aquatique, le fameux BNSSA, et pour les fidéliser ; à la nécessité enfin d'assurer le commandement des postes en avant et en après-saison par les CRS-MNS.
Je rappelle que ces derniers sont les seuls à pouvoir commander les quelques postes ouverts en avant ou en après-saison. C'est pourquoi, monsieur le ministre, l'incertitude constante sur le nombre, la date et la durée du déploiement des CRS-MNS est assez mal vécue par les élus locaux, qui s'inquiètent notamment d'ores et déjà d'un désengagement prématuré de ces forces lors de l'organisation de la coupe du monde de rugby.
Aussi, dans le droit fil des politiques de modernisation de l'État, ne serait-il pas opportun de réformer la procédure d'affectation des CRS spécialisés dans le sauvetage, sur la base de règles définitives et concertées, pour pérenniser et rationaliser leur indispensable participation à la politique de surveillance des plages ?
Plus largement, monsieur le ministre, une nouvelle coordination de ces personnels pourrait à mon sens permettre de renforcer la sécurité des personnes, mais aussi la sûreté maritime, par la création d'un corps professionnel de gardes- côtes, élargi à l'ensemble de nos forces d'intervention impliquées dans l'exercice opérationnel du sauvetage en mer.
Monsieur le sénateur, chaque été, dans le cadre de la politique d'aide aux municipalités du littoral voulue par le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, d'importants renforts sont fournis par les compagnies républicaines de sécurité.
Ces effectifs, spécialistes nageurs sauveteurs, prélevés pendant la saison estivale sur les unités de service général assurent la sécurité des plages.
Leur action a, en réalité, deux volets : d'une part, réprimer les actes de délinquance ; d'autre part, assurer la sécurité de la baignade, activité pour laquelle ils sont généralement assistés de sapeurs-pompiers et de personnels non policiers, qui, eux, sont plus généralement recrutés par les communes.
Au titre de la saison 2006, dans le ressort de vingt et un départements côtiers, 106 municipalités ont bénéficié du concours de 634 nageurs sauveteurs, chiffre constant par rapport à l'année précédente.
Le bilan global de ces activités est positif puisqu'il se traduit par une baisse du nombre - treize en 2006 contre 16 en 2005 - de personnes noyées en zone surveillée.
Pour ce qui concerne plus précisément le département de la Gironde, monsieur le sénateur, il convient de relever une augmentation significative du nombre de nageurs sauveteurs affectés : ils étaient cinquante-six en 2000, quatre-vingts en 2006, soit une hausse de 30% pour votre seul département.
Pour l'été prochain, un dispositif sera mis en place entre le 30 juin et le 2 septembre, dispositif qui peut être complété par des périodes d'anticipation ou de prolongation pour les communes qui se caractérisent par la dangerosité particulière des plages et l'affluence touristique. Le nombre des nageurs sauveteurs des compagnies républicaines de sécurité devrait donc être maintenu au même niveau que l'année dernière, les effectifs de certaines plages pouvant même être renforcés.
En tout état de cause, il faudra envisager à terme un désengagement des services de la police nationale s'agissant de cette charge de travail afin qu'ils puissent se consacrer à leur mission prioritaire de lutte contre la criminalité, plus particulièrement contre celle qui est constatée dans les secteurs sensibles.
Votre département n'est pas concerné, mais je suis sûr que M. Gouteyron a été sensible au fait que, depuis plusieurs années déjà, ce ne sont plus les CRS qui assurent la surveillance des lacs en Auvergne.
S'agissant de l'intervention des communes en matière de secours, il est rappelé que le maire exerce la police spéciale des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux et fait obligation au maire de fixer une zone de surveillance adaptée à la réalité de la fréquentation constatée sur le lieu de baignade.
Cette police spéciale consiste notamment en l'organisation des postes de secours des plages. Le maire peut ainsi confier cette mission soit à des agents contractuels, soit à des membres d'associations agréées, telle la Société nationale de sauvetage en mer ou encore, comme c'est généralement le cas, à des sapeurs-pompiers. Une enquête a permis de constater que 1 200 sapeurs-pompiers volontaires étaient affectés à cette mission sur l'ensemble du littoral français.
Le maire exerce en outre ses pouvoirs de police générale. À ce titre, il est tenu de prendre notamment les mesures nécessaires d'information de la population et d'organisation des secours.
Quant à la gendarmerie nationale, si elle n'assure plus, depuis le début des années quatre-vingt, la mise à disposition de maîtres nageurs sauveteurs au profit des collectivités territoriales, elle met parfois en place des postes saisonniers qui remplissent l'ensemble des missions de sécurité publique, à savoir surveillance, enquêtes judiciaires, intervention et secours.
S'agissant de la zone de baignade et au-delà, la gendarmerie concourt à l'ensemble des missions dévolues à l'État, grâce notamment à des moyens nautiques complémentaires, comme les brigades nautiques et les brigades de gendarmerie maritime, ainsi qu'à des formations aériennes.
Dans ce contexte, je vous le dis très clairement, monsieur Pintat, la création d'un corps de gardes-côtes ne paraît pas opportune. Mais, comme vous pouvez le constater, le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, tient à assurer la sécurité de nos concitoyens sur les lieux de baignade. Certes, le dispositif évolue, mais aucun moyen n'est négligé pour atteindre cet objectif.

Je remercie M. le ministre de ces précisions et de l'assurance qu'il vient de donner quant au maintien des effectifs.
J'ai relevé aussi ses propos s'agissant de l'avant ou de l'après-saison. Pour les mois de juin et de septembre, étant donné le faible effectif par département, il faut que les maires puissent anticiper les mises à disposition.
Cependant, sur le long terme, il faut être attentif au fait que les postes de surveillance sont assurés en partie par les CRS-MNS, qui sont très appréciés, mais aussi par des employés communaux comme par des employés de la SNSM, la Société nationale de sauvetage en mer. Or, monsieur le ministre, il est difficile de fidéliser ces agents contractuels, en général des étudiants ou des personnes ayant une autre formation professionnelle, qui ne travaillent qu'aux mois de juillet et d'août. Il n'y a pas suffisamment de piscines ou de bassins non plus que d'activités nautiques pour leur permettre de faire de la surveillance à longueur d'année !
S'il devait y avoir à terme un retrait total des effectifs de police sur le territoire national, ce serait donc une vraie catastrophe : les maires ne seraient plus en mesure d'assurer la surveillance du littoral.
Il faudrait donc très sérieusement se demander qui pourrait remplacer à terme ces effectifs dont la participation nous semble quasi indispensable pour apporter professionnalisme, exercer les pouvoirs de police et diriger les postes. Mais je ne vous en remercie pas moins, monsieur le ministre, de vos assurances quant à 2007 et au court terme.
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Je voudrais simplement confirmer les propos de M. Pintat et les illustrer : ma collègue Christine Lagarde, qui est présente à mes côtés, a elle-même été recrutée par une collectivité pour devenir maître nageur.
Sourires

La parole est à M. Christian Cambon, auteur de la question n° 1226, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Monsieur le ministre, je souhaiterais appeler votre attention sur les conditions d'une éventuelle indemnisation des assesseurs appelés à composer les bureaux de vote lors des élections.
Par décret du 11 octobre 2006, le Gouvernement a procédé à plusieurs mesures de simplification en matière électorale, en particulier pour ce qui concerne la composition des bureaux de vote ; ces dispositions figurent aux articles R. 42 et suivants du code électoral.
Ainsi, désormais, un bureau de vote ne doit plus comporter, outre le président et le secrétaire, quatre assesseurs au moins mais seulement deux, et le bureau peut fonctionner valablement au cours de la journée si deux de ses membres sont présents et non plus trois.
Il s'agit là d'une innovation évidemment importante, tout à fait positive et parfaitement justifiée, tant il était devenu très difficile, dans certaines communes, de disposer de suffisamment d'assesseurs pour pouvoir ouvrir les bureaux de vote dans les conditions prévues par le code électoral.
Cette difficulté résulte, hélas ! d'une perte d'esprit civique que nous pouvons tous constater et regretter. Dès lors, le fait d'abaisser à deux le nombre minimal d'assesseurs répond à ce problème.
Toutefois, ne conviendrait-il pas d'aller un peu plus loin afin d'encourager le civisme de nos concitoyens, non seulement les jeunes mais aussi les femmes qui sont en charge de famille et que nous avons beaucoup de mal à attirer dans la surveillance de nos bureaux de vote, et de les inciter à s'impliquer davantage dans les opérations électorales en exerçant la fonction d'assesseur ? Dans cette optique, ne pourrait-on pas envisager la possibilité d'indemniser, fût-ce de manière symbolique, cette fonction ?
En effet, un dimanche d'élection - je rappelle qu'il y en aura quatre en 2007 ! - un assesseur titulaire doit être présent à l'ouverture et à la fermeture du bureau de vote, voire pendant une bonne partie de la journée s'il ne dispose pas d'un suppléant, ainsi que pendant toute la durée du dépouillement, jusqu'à la signature du procès-verbal. La journée peut ainsi durer de 7 heures 30 à 23 heures, quand ce n'est pas minuit ! En outre, dans les grandes agglomérations, notamment les jours d'élections européennes, la clôture du scrutin à 22 heures retarde d'autant le moment du dépouillement.
Or un assesseur a souvent à sa charge des frais de repas, pas nécessairement fournis par les communes, voire, éventuellement, des frais de garde d'enfant ou autres. J'indiquerai à cet égard que la commune de Saint-Maurice dans le Val-de-Marne, dont j'ai l'honneur d'être maire, s'est fait rappeler à l'ordre par la Cour des comptes parce qu'elle avait financé de modestes sandwichs pour les assesseurs ! Par conséquent, certains frais sont, je le répète, à la seule charge des assesseurs.
De plus, s'il est, par exemple, salarié, un assesseur ne peut récupérer sur son temps de travail une journée de repos consacrée au service de la collectivité.
Aussi une modeste indemnisation constituerait-elle une marque de reconnaissance de cet esprit civique, ainsi qu'un encouragement. Dois-je rappeler qu'un citoyen désigné par le sort sur les listes électorales et qui participe à un jury d'assises, bénéficie, lui, d'une indemnisation ?
Ne pourrait-on donc pas, monsieur le ministre, prévoir une indemnisation systématique et obligatoire qui ferait partie du remboursement par l'État des frais d'organisation engagés par les communes ?
Cette proposition concerne, certes, principalement les assesseurs titulaires, mais la réflexion pourrait être étendue aux assesseurs suppléants et aux délégués, ainsi qu'aux présidents de bureau de vote, lorsque ceux-ci ne sont pas des élus municipaux.
Monsieur le sénateur, dans la perspective des prochaines échéances électorales, vous vous préoccupez à juste titre des difficultés rencontrées, d'une part, par certaines communes pour trouver le nombre d'assesseurs requis dans chaque bureau de vote et, d'autre part, par les citoyens qui sont appelés à remplir ce rôle.
Le Gouvernement, comme vous le savez, a parfaitement conscience de ces difficultés. Vous avez été l'un des premiers à alerter le Gouvernement à ce sujet et votre message a été largement relayé.
C'est la raison pour laquelle, comme vous l'avez d'ailleurs rappelé, le décret du 11 octobre 2006, qui contenait des mesures de simplification en matière électorale, a réduit de quatre à deux le nombre minimal d'assesseurs présents dans chaque bureau de vote.
En outre, seuls deux membres du bureau, au lieu de trois, doivent désormais être présents en permanence pendant les opérations électorales.
Ces dispositions sont, il est vrai, très récentes, monsieur le sénateur et, si elles apparaissent de nature à répondre en grande partie aux problèmes que vous évoquez, je pense qu'il conviendra de mesurer avec précision leur impact à l'occasion des prochaines consultations électorales. En effet, ce n'est qu'après les scrutins présidentiel et législatif qu'il sera possible d'envisager d'aller plus loin si cela se révèle nécessaire.
Le Gouvernement a bien conscience, monsieur Cambon, des contraintes liées aux fonctions d'assesseur. Toutefois, il convient de garder à l'esprit que la participation au déroulement des opérations de vote, tout comme le vote lui-même, constitue aujourd'hui un engagement civique.
Dès lors, il me paraît souhaitable, à ce stade, que la participation des citoyens au bon fonctionnement de la démocratie demeure bénévole, quitte à vous proposer une « clause de revoyure » à l'issue des prochains scrutins, si les électeurs le décident, cela va de soi !

Monsieur le ministre, je vous remercie de la qualité de votre réponse et de l'esprit d'ouverture dont vous faites preuve afin que ce dossier puisse être réexaminé après les quatre scrutins de 2007.
Je rappelle, en outre, qu'en 2008 nous risquons d'avoir des élections jumelées. Or l'organisation de deux bureaux conjoints pose également des problèmes
Quoi qu'il en soit, je remercie une nouvelle fois le Gouvernement de son effort en vue de simplifier un dispositif qui soulevait beaucoup de difficultés.
Dans le Val-de-Marne, département dont je suis élu, les élections posent parfois des problèmes, y compris, comme on l'a souvent vu, des problèmes de fraude. Or s'il y en a, c'est parce que la surveillance des bureaux de vote est insuffisante !
Dès lors, je suis persuadé que c'est en prolongeant notre réflexion en ce sens que nous parviendrons à trouver les solutions adéquates pour faire en sorte que l'esprit civique demeure une valeur dans notre pays, ce qui n'est pas toujours le cas les jours d'élections.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, auteur de la question n° 1107, adressée à M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

Monsieur le ministre, ma question concerne la nécessaire modification des seuils de chiffres d'affaires définissant l'éligibilité au régime fiscal de la microentreprise.
J'aimerais d'abord préciser que les travailleurs indépendants soumis au régime fiscal de la microentreprise se réjouissent du dispositif de « bouclier fiscal » inscrit dans le projet de loi instituant le droit opposable au logement et diverses mesures en faveur de la cohésion sociale que nous allons examiner cet après-midi.
Si ce texte est adopté, leur cotisation sociale sera proportionnelle à leur chiffre d'affaires et ne pourra dépasser 14 % à 24 % de ce dernier selon la nature de l'activité.
La mise en place de ce contrat d'accompagnement généralisé permettra véritablement, selon moi, de lever un frein à l'initiative.
Permettez-moi maintenant de vous rappeler, mes chers collègues, que le tissu économique réunionnais est constitué en majeure partie de structures de petite taille.
Ainsi, 95 % des entreprises locales emploient moins de dix salariés. L'économie locale se caractérise également par son dynamisme en matière de créations d'entreprises, puisque 5 680 structures ont vu le jour en 2005, parmi lesquelles 76 % constituent des créations réellement nouvelles.
Cependant, le taux de survie des entreprises reste le plus faible de France : une sur deux seulement passe le cap des trois ans, contre deux sur trois en métropole et dans les autres départements ultramarins.
Dans un tel contexte, le régime fiscal de la micro- entreprise, en limitant les contraintes administratives et comptables, permet réellement de créer et de pérenniser des entreprises.
Je tiens néanmoins à souligner qu'en raison d'une inflation croissante et de l'augmentation du coût de la vie les seuils de chiffres d'affaires qui définissent l'éligibilité au régime fiscal de la microentreprise sont devenus trop bas et demandent à être relevés.
Aussi, la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion souhaite que les seuils de chiffres d'affaires pris en compte pour l'éligibilité au régime de la microentreprise soient majorés de 20 %.
Je souhaiterais donc, monsieur le ministre, connaître votre position sur ce dossier.
Madame la sénatrice, si vous appelez mon attention sur le régime fiscal de la microentreprise en particulier, je pense que vous faites également allusion au bouclier social que nous avons mis en place. Certes, il s'agit là de deux régimes distincts, mais je vais tout de même essayer de les associer dans ma réponse.
Comme vous le savez, le seuil annuel de chiffres d'affaires est actuellement de 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, et de 27 000 euros hors taxes pour les entreprises relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou de titulaires de revenus non commerciaux.
Bien que conscient des contraintes administratives et fiscales qui existent encore pour les plus petites entreprises - j'aurai l'occasion d'annoncer de nouvelles mesures les concernant dans les jours prochains - le ministère du budget n'envisage pas pour l'heure de modifier ces seuils de chiffres d'affaires ou de recettes.
Ces régimes, mis en place pour alléger les charges administratives des très petites entreprises, consistent à déterminer une assiette calculée de manière forfaitaire indépendamment du bénéfice réel de l'entreprise.
L'existence du régime fiscal des microentreprises ne se justifie que s'il est réservé à une catégorie d'entreprises pour lesquelles l'allégement des obligations comptables et fiscales correspond à l'extrême simplicité de leur gestion.
L'élargissement de leur champ d'application entraînerait automatiquement une extension de même nature des obligations comptables simplifiées, ce qui priverait d'un outil de gestion indispensable les entreprises dont la taille requiert un suivi plus rigoureux de l'activité, suivi qui est souvent exigé de leurs partenaires, notamment financiers, dans les phases de croissance qu'elles peuvent être appelées à connaître.
J'ajoute que les seuils actuels permettent de bénéficier de la franchise de TVA, laquelle dispense les assujettis de déclarer et de payer cette taxe. En contrepartie, ces bénéficiaires ne peuvent déduire la TVA en amont ; ce régime n'est donc pas toujours favorable à l'entreprise.
Nous avons cependant, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 du 21 décembre 2006, augmenté les abattements appliqués aux chiffres d'affaires déclarés afin de déterminer le bénéfice soumis à l'impôt sur le revenu ; cette mesure va dans le sens de votre interrogation, madame la sénatrice.
Ces abattements, qui représentent forfaitairement les charges nécessaires à la réalisation des chiffres d'affaires, sont portés à 71 % pour les activités d'achat-revente et de fourniture de logement au lieu de 68 % ; à 50 % pour les autres activités de prestations de services entrant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les BIC, au lieu de 45 %, et, enfin, à 34 % pour les activités relevant des bénéfices non commerciaux, ou BNC, au lieu de 25 %.
J'ajoute que le régime du bouclier social que nous venons de mettre en place aura un effet important de simplification, puisque, pour les activités d'achat-revente, le taux des prélèvements sociaux sera de l'ordre de 14 % ; quant aux autres prestations, BIC et BNC, ce taux sera d'environ 24 %.
Il s'agit là d'une vraie révolution dans la gestion des cotisations sociales de ces toutes petites entreprises.
Je suis, pour ma part, tout à fait ouvert, au vu d'une évaluation du dispositif, lorsque nous connaîtrons les premiers résultats du champ d'application du régime fiscal et du régime social aux très petites entreprises, à une éventuelle modification de ces régimes. Cela étant dit, pour l'instant, il convient, me semble-t-il, de s'intéresser à la manière dont ce premier pas s'effectue réellement dans ces très petites entreprises.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de toutes ces précisions et je transmettrai votre réponse aux principaux intéressés, c'est-à-dire non seulement aux chefs des petites entreprises, mais aussi à la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion.

La parole est à M. Simon Sutour, auteur de la question n° 1222, adressée à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Monsieur le ministre, comme vous le savez, le Gard fait partie des départements soumis à plusieurs risques majeurs dont les risques technologiques, le risque nucléaire en particulier, et la sécheresse.
Toutefois, le plus marquant d'entre eux, qui a malheureusement et tristement ému tous les esprits, est bien le risque d'inondation sous toutes ses formes.
Vous envisagez « d'accentuer la concurrence entre opérateurs privés » et de « permettre d'accélérer le remboursement en cas de catastrophe naturelle et de revoir les zones géographiques » ; la presse s'est d'ailleurs fait l'écho de vos déclarations à ce sujet.
Si ces intentions sont louables, il reste que la libéralisation du régime d'assurance des catastrophes naturelles ne sera bénéfique que si, in fine, le montant des indemnisations est à la hauteur pour compenser la détresse dans laquelle se trouvent les particuliers et les collectivités. Dans le cas contraire, il n'y aurait qu'un seul bénéficiaire : les compagnies d'assurance. Or tel n'est pas, j'en suis sûr, le sens de votre proposition.
Par ailleurs, si l'État continuait d'accorder sa garantie financière, avec le réassureur public, c'est-à-dire la Caisse centrale de réassurance, vous proposeriez « la possibilité de moduler le taux de prime additionnelle de la garantie catastrophe naturelle en fonction de l'exposition des biens assurés aux périls naturels au lieu d'être fixé à 12 % uniformément ». Encore une fois, cette proposition peut paraître intéressante, mais ne remettrait-elle pas en cause le principe de solidarité ? De plus, il ne faudrait pas que la modulation permette d'aller au-delà du plafond de 12 % actuel.
Enfin, le Journal officiel ne serait plus chargé de diffuser les arrêtés de catastrophe naturelle. Il reviendrait aux compagnies d'assurance de constater ces événements « sur la base de données scientifiques fournies par des organismes publics ». Toutefois, dans ce cas, les compagnies auraient-elles intérêt à déclarer « l'état de catastrophe naturelle » ? Nous pouvons en douter.
Vous le voyez, madame le ministre, bien des questions se posent quant à la mise en oeuvre de la libéralisation que vous souhaitez. Pouvez-vous nous informer de l'avancée de votre réflexion et des échéances que vous souhaitez respecter à cet égard ?
Monsieur Sutour, vous interrogez Thierry Breton sur le projet de réforme du régime de couverture des catastrophes naturelles. Vous me permettrez de me substituer à lui et de vous présenter ses excuses, puisqu'il n'a pu venir ce matin au Sénat pour vous répondre.
Le régime des catastrophes naturelles assure depuis plus de vingt ans la protection des biens contre les dégâts causés par les phénomènes exceptionnels, et je sais, pour m'y rendre occasionnellement en été, que le département du Gard n'est, hélas ! pas à l'abri de ce genre d'événements, et en particulier des inondations.
Or le retour d'expérience du fonctionnement de ce régime a conduit le Gouvernement à envisager certains aménagements du dispositif. En effet, une mission d'inspection interministérielle, mandatée par le Gouvernement, a mis en évidence un certain nombre d'insuffisances ou de dysfonctionnements ; j'en évoquerai cinq.
Premièrement, il s'agit d'un système qui manque de transparence, les assurés comme les élus s'interrogeant sur les modalités d'éligibilité de tel ou tel sinistre au régime des catastrophes naturelles.
Deuxièmement, les décisions d'accorder ou non une indemnisation, en particulier lorsque deux communes contiguës ne reçoivent pas le même traitement, sont parfois perçues comme inéquitables par les assurés et les élus.
Troisièmement, ce système reste assez complexe dans son organisation et induit bien souvent de longs délais d'indemnisation, qui ne sont pas favorables aux assurés victimes de sinistres.
Quatrièmement, lorsque les conditions de reconnaissance ne sont pas réunies, s'agissant, par exemple, de sinistres de faible ampleur, les victimes ne disposent d'aucune autre solution pour se couvrir.
Enfin, cinquièmement, ce système entraîne parfois une déresponsabilisation face à la nécessaire prévention des risques naturels.
Le projet de réforme envisagé par le Gouvernement vise à pallier ces inconvénients en améliorant le dispositif.
Parmi ces améliorations, notre objectif principal est clairement de faire en sorte que les assurés puissent bénéficier de l'indemnisation la plus rapide, dès lors que le sinistre est avéré.
Ainsi, dans ce qui n'est aujourd'hui qu'un projet, les victimes pourraient, postérieurement à un dommage, connaître les modalités de leur indemnisation sans attendre la réunion d'une commission interministérielle et la parution d'un arrêté, lequel peut d'ailleurs, pour des raisons inhérentes au fonctionnement de l'administration, prendre souvent plus d'un mois. Ils pourraient s'adresser directement à leur assureur afin d'être indemnisés.
Bien entendu, toutes ces mesures s'inscriraient dans le cadre du principe de la solidarité nationale, j'y insiste, et l'État continuerait en toute hypothèse à accorder sa garantie financière au régime, via la Caisse centrale de réassurance. Il n'est pas question que l'État soit absent du processus d'indemnisation des catastrophes naturelles : bien au contraire, il interviendra par la voie d'une garantie financière.
Conjointement avec Nicolas Sarkozy, ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, nous avons engagé une consultation sur ce projet. Nous l'avons confiée à M. Emmanuel Constans, président du comité consultatif du secteur financier, qui recevra l'appui des services du ministre de l'économie et des finances et du ministère de l'intérieur.
Le Gouvernement a bien noté que de nombreuses parties prenantes, dont les associations d'élus, souhaitaient que des consultations approfondies soient organisées sur certains aspects ; il veillera à ce que ce soit le cas.
Il proposera donc prochainement une méthode pour prolonger la concertation, afin qu'au cours de la prochaine législature - car il n'est pas possible de modifier le régime dès à présent - le Parlement puisse se saisir des dispositions législatives nécessaires afin d'améliorer le système.

Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse.
Je crois que nous pouvons tous nous accorder sur le constat : l'indemnisation des particuliers prend parfois beaucoup de temps.
S'agissant des solutions à apporter, il faut réfléchir aux propositions qui seront formulées. Je note d'ailleurs que, par rapport aux propos de M. le ministre, évoqués notamment dans la presse économique, votre réponse est plus prudente, madame la ministre. Je m'en réjouis, car nous sommes encore dans une phase de consultation. Nous disposerons bientôt d'une méthode nous permettant de résoudre les problèmes qui, à l'évidence, se posent en ce domaine et, lors de la prochaine législature, le Parlement aura à se prononcer.

La parole est à M. Philippe Richert, auteur de la question n° 1212, adressée à M. le ministre de la culture et de la communication.

Avec l'ordonnance du 8 septembre 2005, le Gouvernement a apporté au régime juridique des travaux sur les monuments historiques un certain nombre de réformes qui sont importantes et, dans leur principe, bienvenues.
Je fais bien sûr allusion à la disposition qui restitue enfin sans ambiguïté au propriétaire la maîtrise d'ouvrage des travaux, ainsi qu'à celle qui réforme la maîtrise d'oeuvre des travaux sur les monuments classés.
C'est sur cette seconde réforme que porte ma question. Aujourd'hui, je le rappelle, dès lors que ces travaux portent sur un monument appartenant à l'État, ou que celui-ci y participe financièrement, la maîtrise d'oeuvre revient obligatoirement à l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent.
Demain, avec les nouvelles dispositions, le propriétaire disposera d'une marge de choix entre des catégories de professionnels définies par décret. Il s'agit d'une réforme importante, ambitieuse, et qui va sans doute au-delà des recommandations du rapport Bady et des exigences de la Commission européenne.
Le principe du libre choix permettra de remédier aux situations difficiles que nous avons pu connaître dans le passé. Celles-ci tiennent, parfois, à des incompatibilités de personnes et, plus souvent, à la surcharge de travail chronique de certains architectes en chef des monuments historiques ; nous avons tous connu cette situation.
Si ce principe nous paraît positif, nous nous interrogeons cependant sur les modalités de mise en oeuvre de cette réforme et sur ses conséquences. Le décret actuellement en préparation apportera, je n'en doute pas, des réponses précises à ces questions. Toutefois, pouvez-vous, madame la ministre, nous préciser dès aujourd'hui les orientations qui sont prévues ?
Quelles seront les modalités de cette ouverture ? Comment prendront-elles en compte la dimension qualitative des interventions sur les monuments historiques, qui souvent se succèdent. En effet, il ne faudrait pas qu'il y ait de ruptures dans la conception des interventions.
Quelles seront les conséquences de la remise en question de leur monopole territorial sur le statut et les missions des architectes en chef et sur l'équilibre social et économique de ce corps de fonctionnaires un peu particulier, puisqu'il est rémunéré par vacations et honoraires ?
Quelles seront, enfin, les conséquences de cette marge de choix nouvelle pour les propriétaires, et surtout pour ces propriétaires un peu particuliers que sont les collectivités territoriales ? Je pense notamment aux petites communes qui auront à assumer cette nouvelle responsabilité, seront confrontées parfois à des travaux lourds et connaîtront peut-être des difficultés.
Les collectivités étant assujetties au code des marchés publics, cette liberté, en soi appréciable, ne risque-t-elle pas d'entraîner un alourdissement des procédures et des problèmes pour les petites communes ?
Telles sont, madame la ministre, quelques-unes des interrogations sur lesquelles je souhaiterais que vous puissiez nous apporter des éclaircissements.
Monsieur Richert, tout d'abord, permettez-moi d'excuser l'absence de M. Renaud Donnedieu de Vabres. Celui-ci, qui aurait été infiniment plus compétent pour répondre à votre question, se trouve retenu en ce moment même à l'Assemblée nationale, pour l'examen du projet de loi relatif à la télévision du futur, et il m'a donc chargée de vous répondre.
L'ordonnance du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés réaffirme la qualité de maître d'ouvrage, pour les travaux de restauration de monuments historiques, aux personnes publiques ou privées qui en sont propriétaires ou affectataires.
Par ailleurs, elle modifie l'article L. 621-9 du code du patrimoine et fait obligation à tout propriétaire ou affectataire d'un monument historique classé de recourir à des maîtres d'oeuvre définis par décret en Conseil d'État.
Dans ce cadre, le maître d'ouvrage propriétaire ou affectataire d'un monument historique n'appartenant pas à l'État choisira son maître d'oeuvre, selon les procédures qui lui sont applicables, parmi les architectes en chef des monuments historiques ou parmi d'autres architectes établis dans les États membres de l'Union européenne et présentant un niveau de qualification et d'expérience comparables à nos architectes en chef des monuments historiques.
Les collectivités territoriales pourront donc choisir leur architecte maître d'oeuvre selon les procédures du code des marchés publics.
Cette responsabilité confiée aux propriétaires est nouvelle, car jusqu'à présent prévalait une interprétation de la loi de 1913 autorisant les services de l'État à assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux sur les monuments classés, quel que soit leur propriétaire.
Ce retour au droit commun des prérogatives du propriétaire s'accompagne d'une formalisation du dispositif d'autorisation de travaux et de contrôle scientifique et technique permettant, dans ce nouveau contexte, de continuer à garantir les objectifs de protection et de conservation des monuments historiques, qui ont été posés par la loi de 1913 et n'ont pas été modifiés par l'ordonnance de 2005.
Les décrets d'application de cette ordonnance sont en cours d'élaboration, en concertation avec les services déconcentrés concernés par leur mise en oeuvre. Bien entendu, ils seront également soumis pour observation aux différentes catégories de propriétaires du domaine privé ou public.
Leur orientation générale consiste à privilégier une concertation, le plus en amont possible de l'opération, entre les propriétaires et les services de l'État chargés des monuments historiques qui délivrent l'autorisation de travaux.
Dans le cadre de l'autorisation de travaux, il appartiendra aux services de l'État de préciser les conditions d'expérience et de qualification exigées des candidats à la maîtrise d'oeuvre, selon les caractéristiques du monument et la nature de l'opération exigée.
À cet égard, l'objectif du Gouvernement - et la responsabilité du ministre de la culture - est de généraliser, par le dialogue entre les services de l'État, d'une part, et les propriétaires, d'autre part, la méthodologie spécifique des travaux de restauration des monuments historiques, qui a été élaborée au fil du temps par le ministère de la culture et dont le bien-fondé scientifique et la pertinence pour la qualité des restaurations ne sont plus à démontrer.

La parole est à M. Francis Grignon, auteur de la question n° 1198, adressée à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

Ma question porte sur le projet de réforme, qui se trouve actuellement à l'étude, du système de nomination des notaires en Alsace-Moselle.
Le système qui existe dans ces départements offre de nombreux avantages. Ainsi, les notaires sont nommés par le garde des sceaux sur proposition d'une commission composée paritairement de magistrats et de notaires et à partir d'une liste d'aptitudes constituée des lauréats à un concours.
Comme il est fondé uniquement sur la compétence et le mérite, le statut du notariat en Alsace-Moselle favorise l'égalité des chances et demeure un moyen de promotion sociale pour des personnes issues de milieux modestes. En effet, seul le concours permet d'accéder à cette profession, en dehors de toutes contingences financières et successorales, sauf peut-être dans certains cas de sociétés civiles professionnelles.
Par ailleurs, le statut du notariat en Alsace-Moselle est très proche de celui de certains de nos voisins européens, comme l'Allemagne, l'Italie, ou l'Espagne. Il est également très proche du statut dont se sont dotés la quasi-totalité des pays de l'Europe de l'Est nouvellement membres de l'Union européenne.
Le 8 octobre 2004, les notaires des trois départements ont, par un vote massif, manifesté clairement leur attachement à ce mode de recrutement.
À la lumière de tous ces éléments, serait-il possible de connaître les motifs de la réforme qui se trouve actuellement à l'étude, et éventuellement son calendrier, afin que tous les points de vue puissent s'exprimer lors de l'élaboration de ce projet ?
Monsieur Grignon, vous avez interrogé M. le garde des sceaux sur la situation du notariat en Alsace-Moselle, et voici les éléments qu'il m'a chargée de vous communiquer, en vous priant d'avoir l'obligeance de bien vouloir excuser son absence.
Un groupe de travail vient d'être mis en place afin de réfléchir, conjointement avec les intéressés, aux modes de nomination des notaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le même travail est effectué avec les huissiers de justice, sur leur demande, en ce qui concerne la réintroduction du droit de présentation.
Ces études ont été initialement sollicitées par les huissiers et relayées par la commission d'harmonisation du droit local. Elles se justifient également au regard de la situation particulière du notariat alsacien-mosellan. En effet, la combinaison du droit alsacien-mosellan et du droit applicable sur tout le territoire a révélé des ambiguïtés, voire des contradictions. Ainsi, la forme de société civile professionnelle a été introduite en Alsace-Moselle sans que soit changé le mode de nomination. Celui-ci a donc partiellement perdu son ancienne cohérence et est devenu moins démocratique, la nomination dans les sociétés civiles professionnelles résultant le plus souvent d'une cooptation.
Quant à l'accès à la profession en « vieille France », il est plus aisé que par le passé, les candidats à la reprise d'une étude pouvant facilement obtenir un prêt grâce au soutien de l'Association notariale de caution.
Ces travaux doivent se poursuivre dans les semaines à venir pour connaître les enjeux, les positions de chacun et les orientations possibles, et ce toujours en concertation étroite avec les représentants de la profession.
Aucune décision n'a encore été prise : la réflexion est en cours avec les représentants locaux des professions. Quant à la commission d'harmonisation du droit local et au conseil consultatif du droit local, ils seront bien évidemment consultés.
En tout état de cause, cette réforme devrait être de nature législative. Elle interviendra donc probablement au cours de la prochaine législature.
Cette question me donne l'occasion de rendre personnellement un hommage appuyé à l'ensemble des notaires pour le rôle qu'ils jouent à l'échelon international, en particulier en diffusant le mode d'organisation de leur profession et le droit continental, notamment le droit français.

Madame la ministre, j'ai bien conscience du problème posé par les sociétés civiles professionnelles.
Je vous remercie de votre excellente réponse. L'essentiel est que tous les acteurs soient associés à cette réflexion afin que l'équilibre établi ne soit pas bouleversé.

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, auteur de la question n° 1203, adressée à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

M. Jean-Claude Peyronnet. Ma question porte sur la cité judiciaire de Limoges. Il s'agit d'un serpent de mer. S'il n'est pas protégé en Haute-Vienne, cet animal y prospère malgré tout, sans doute en raison du microclimat.
Sourires

J'ai été élu président du conseil général de la Haute-Vienne en 1982 et j'ai abandonné cette fonction en 2004. Je suis aujourd'hui vice-président de cette institution à laquelle je reste très attaché.
En 1982, lorsque la décentralisation a été mise en place, les crédits de la justice transitaient par les conseils généraux. C'est à ce titre que je fus amené à rétrocéder au ministère de la justice un terrain que mon prédécesseur avait acquis en centre-ville pour construire une cité judiciaire. Je l'ai beaucoup regretté par la suite, mais c'était un engagement qu'il me fallait tenir. Voilà donc plus de vingt-cinq ans que cette affaire est pendante. En effet, le terrain acquis est toujours en friche.
En tant que président du conseil général, j'ai fait rénover, sur un terrain contigu, des bâtiments pour y loger les services sociaux et les services de l'aménagement du conseil général.
Enfin, le conseil général a récemment acquis la caserne de la Visitation - un ancien couvent -, pour regrouper des services qui étaient de plus en plus dispersés dans la ville. Ce dernier projet est en voie de concrétisation : le démarrage des travaux est prévu à la fin de cette année et l'emménagement interviendra en 2010.
Ce redéploiement libérera les bureaux actuellement occupés par des services du conseil général. Ceux qui se trouvent actuellement toujours enclavés au sein de la préfecture de Limoges et qui regroupent les services centraux ont été acquis récemment par le ministère de la justice, avec convention d'occupation jusqu'en 2010.
Les locaux construits dans les années quatre-vingt pour les services sociaux et les services de l'aménagement du conseil général occupent une surface de 4 500 mètres carrés : ils comportent 135 bureaux, des salles de réunion et 170 places de parking. En outre, ils sont absolument contigus au terrain acquis en 1982.
Madame la ministre, dans la mesure où aucune programmation de construction d'une cité judiciaire n'est prévue, alors qu'elle est indispensable au regard des conditions extrêmement précaires dans lesquelles travaille la justice à Limoges - et elle travaille bien -, l'acquisition de tout ou partie des locaux construits par le conseil général dans les années quatre-vingt serait une réelle opportunité pour la Chancellerie. En effet, ces locaux peuvent facilement être séparés en deux lots, l'un de 2 500 mètres carrés, l'autre de 2 000 mètres carrés.
Ces locaux sont situés en centre-ville, à deux cents mètres du palais de justice. Ils sont très convoités par les agents immobiliers. Je sais, pour avoir alerté depuis longtemps les magistrats de Limoges, que ces derniers ont saisi M. le garde des sceaux. Or, à ce jour, aucune décision ferme n'a été prise.
Madame la ministre, la Chancellerie laissera-t-elle passer une occasion qui ne se représentera pas et qui permettrait de résoudre le problème des locaux de l'ensemble des personnels de la justice, dans des conditions financières très raisonnables ?
Monsieur le sénateur, je vous répondrai au nom de M. le garde des sceaux, que je vous remercie de bien vouloir excuser. Il m'a informée des difficultés que vous évoquez concernant la manière dont la justice est rendue dans la ville de Limoges.
La situation pratique dans laquelle les juridictions de Limoges rendent la justice - et elles la rendent bien ! - est complexe et elle a fait l'objet de nombreuses études depuis les années quatre-vingt-dix.
Si diverses opérations d'acquisition, de location et d'aménagement d'immeubles ont été réalisées à ce jour pour permettre le desserrement ou le relogement de certaines juridictions, en particulier le tribunal d'instance, le conseil des prud'hommes et le tribunal de commerce, le problème de déficit de surfaces et de dispersion des juridictions sur sept sites distincts demeure, ce qui pose des difficultés réelles de fonctionnement entre les services.
Pour remédier à cette situation qui n'avait pas échappé à l'attention du garde des sceaux, un projet de construction d'un nouveau palais de justice a été privilégié. Celui-ci regroupera tout ou partie des juridictions de premier degré sur le terrain auquel vous faisiez référence, qui a été acquis par le ministère de la justice non pas en 1982 mais en 1987 : les transactions prennent du temps ! En outre est prévue la réhabilitation des sites conservés.
Votre proposition de reloger les juridictions de Limoges dans l'immeuble appartenant au conseil général de la Haute-Vienne n'a pas non plus échappé à l'attention des services de la Chancellerie, qui en ont examiné l'opportunité. Néanmoins, elle n'a pas été retenue, en raison, d'une part, d'une différence assez importante de niveaux entre les diverses parties du bâtiment rendant l'accessibilité et la circulation difficiles, d'autre part, du manque de fonctionnalité des locaux pour un usage judiciaire, lequel subsisterait malgré les investissements très lourds à réaliser pour l'adaptation de ce bâtiment.
Afin de mener à bien le projet retenu de construction d'une cité judiciaire, le garde des sceaux a confié, au mois de mars 2006, à l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice, une mission d'études préalables, afin d'approfondir la programmation et de réunir toutes les conditions de faisabilité technique et économique de l'opération, dont le coût est d'ores et déjà estimé à 25 millions d'euros.
À ce jour, une réunion du comité de pilotage de cette opération est prévue le 1er février 2007 à Limoges pour présenter aux chefs de cour et aux chefs de juridiction l'état d'avancement des études de faisabilité en cours.

Madame la ministre, je vous remercie de cette réponse, qui a le mérite d'être claire. La décision qui a été prise n'affecte en rien le conseil général. Celui-ci aurait évidemment donné la priorité à un service public, mais il ne manque pas d'acquéreurs pour ce terrain.
Je comprends les raisons avancées, notamment celles qui touchent à l'agencement, car il est vrai que le nombre de salles peut être insuffisant. En revanche, les arguments relatifs à l'accessibilité me semblent moins recevables, puisque ces bureaux étaient occupés par les services sociaux, qui reçoivent du public.
Néanmoins, je suis inquiet : je me demande si le serpent de mer ne continuera pas à se développer, tout en restant toujours aussi invisible. Je crains que, dans les années à venir, les atermoiements ne soient tels que la construction ne se fasse pas ou ait lieu dans des délais extrêmement longs.
Acquérir ces locaux me semblait une opportunité financièrement beaucoup plus intéressante que cette construction.
Je prends acte de cette décision. J'en rendrai compte à la présidence du conseil général, qui mettra sur le marché les locaux en question.

La parole est à M. André Vallet, auteur de la question n° 1184, adressée à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur les problèmes que crée la saturation de l'autoroute A7, en particulier entre Bollène et Orange. En effet, ce tronçon est le théâtre de nombreux accidents, notamment de poids lourds, souvent spectaculaires, parfois dramatiques.
Aujourd'hui, les différents acteurs reconnaissent la saturation de cet axe autoroutier. Une campagne a été menée auprès du public et des élus locaux. Tous dressent le même constat et s'accordent sur la nécessité de travailler sur des modes alternatifs de transport eu égard aux impératifs environnementaux et énergétiques, conformément aux engagements de Kyoto.
L'acuité des questions environnementales et énergétiques, le développement durable et les modes alternatifs de transport doivent induire des actions réelles en faveur des transports ferroviaire, fluvial et maritime. Il y a urgence et il faut rendre ces modes de transport plus attractifs.
Il s'agit, bien évidemment, non pas d'écarter le mode routier, mais d'en réguler le flux et d'en limiter le développement au profit d'autres modes de transport. À l'instar de l'Allemagne, il est toujours possible de taxer le trafic de transit, afin d'inciter les décideurs économiques à utiliser d'autres modes de transport. Mais cette solution ne peut être efficace que si d'importantes actions sont menées en matière d'infrastructures et d'organisation, afin de rendre praticables ces modes alternatifs de transport. D'ailleurs, l'évolution prévisible du coût du baril de pétrole constitue, à terme, un puissant frein à l'utilisation des véhicules à moteur.
Selon le Conseil économique et social de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, la région PACA, « une véritable politique volontariste de l'État est un préalable incontournable pour une plus grande cohérence dans les choix à opérer. Des mesures réglementaires et tarifaires incitatives doivent être mises en oeuvre, sans quoi les meilleures intentions ne déboucheront pas. »
Certes, nous ne manquons pas de bonnes intentions, mais la détermination politique est indispensable pour que notre bonne volonté se traduise dans les faits.
Les atouts du transport fluvial sont bien connus : celui-ci est moins coûteux, moins consommateur d'énergie, moins polluant et plus sécurisant par rapport à d'autres modes de transport. Selon Voies navigables de France, il semble que le trafic fluvial puisse être multiplié par cinq, sans que doive être engagé d'investissement complémentaire important.
À l'évidence, les possibilités de développement existent, mais il reste de nombreux efforts à accomplir, notamment en direction du débouché sud.
Un semblable développement vers le sud de la France permettrait sans doute de repositionner le port autonome de Marseille avec Fos, premier port de la façade méditerranéenne au service de trois régions françaises : Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et PACA.
Sur le plan ferroviaire, la percée sous le Montgenèvre permet d'espérer le transfert d'une partie du trafic de la vallée du Rhône et ouvre d'importantes perspectives s'agissant d'un axe reliant la péninsule ibérique, le nord de l'Italie et l'Europe de l'Est. Parallèlement, elle assurerait le désenclavement des territoires alpins, en particulier avec l'accès au réseau TGV via la liaison Lyon-Turin, et favoriserait le développement du port de Marseille.
Je voudrais, monsieur le ministre, que vous nous fassiez part des intentions du Gouvernement pour l'année 2007 afin de remédier à la saturation de certains axes autoroutiers, notamment de celui qui relie Bollène à Orange, pour lequel il est urgent d'agir.
Par ailleurs, je souhaite savoir si les modes alternatifs de transport ne seraient pas une solution à cet engorgement, et quelles dispositions rapides et efficaces compte prendre le Gouvernement pour rendre ces modes alternatifs de transport plus attractifs.
Monsieur le sénateur, les conséquences de la saturation du sillon rhodanien, tant pour les transports que pour les habitants des régions concernées, sont telles que les ministres chargés des transports et de l'écologie avaient demandé, en 2005, à la Commission nationale du débat public d'organiser un débat sur cette problématique. Nelly Olin et Dominique Perben ont donc présenté, le 4 décembre dernier, la décision prise par le Gouvernement.
Pour répondre, à court terme, aux difficultés d'engorgement de la vallée du Rhône, que vous mentionnez à juste titre, le Gouvernement a souhaité tirer le meilleur parti des infrastructures de transport existantes.
Il s'agit notamment d'améliorer la gestion et l'exploitation des autoroutes en recourant à des modulations tarifaires, en prévoyant des interdictions de doubler pour les poids lourds, ou encore en limitant les vitesses lors des périodes d'affluence.
Par ailleurs, des itinéraires complémentaires seront aménagés. Citons, à titre d'exemple, l'itinéraire Toulouse-Lyon, qui passe par la RN88 et qui sera progressivement mis à deux fois deux voies, l'achèvement de l'autoroute A75, ou encore la réalisation de l'enchaînement des autoroutes A48 et A51.
Dans le domaine ferroviaire et fluvial, il s'agit d'améliorer les services rendus. Ainsi, un cadencement des trains sera mis en place pour offrir une plus grande capacité et pour faciliter les correspondances. Le Gouvernement veut aussi poursuivre le développement des autoroutes ferroviaires de plaine avec, en particulier, la mise en service, au mois de mars prochain, de la liaison entre le Luxembourg et Perpignan.
Par ailleurs, tous ses efforts se concentrent sur le projet du Lyon-Turin ferroviaire pour permettre l'engagement de l'opération en 2010.
La mise en oeuvre de l'ensemble de ces dispositions permet de ne pas envisager, à court terme, l'élargissement des autoroutes A7 et A9, tel qu'il avait été soumis au débat public.
Enfin, est prévue la mise en place d'un observatoire partenarial des trafics qui permettra de mesurer le résultat des actions entreprises et d'adapter en conséquence la politique des transports dans la vallée du Rhône.
Telles sont, monsieur le sénateur, les réponses que je peux vous apporter au nom de Dominique Perben.

La Commission nationale du débat public indique effectivement, dans ses conclusions, qu'il n'est pas envisageable d'élargir l'autoroute actuelle. Cependant, elle a formulé des propositions pour 2007. Vous les avez évoquées, monsieur le ministre, mais vous n'avez pas précisé si elles allaient être mises en vigueur dans les prochains jours. Elles concernent, notamment, l'interdiction de doubler pour les poids lourds lors des périodes d'affluence - un décret sera-t-il pris en ce sens ? -, des limitations de vitesse, des modulations de tarifs en fonction du trafic.
Par ailleurs, je regrette, monsieur le ministre, que vous n'ayez pas fait allusion au transport fluvial, qui peut apporter une réponse partielle au problème qui nous préoccupe.

La parole est à M. Bernard Piras, auteur de la question n° 1199, adressée à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Je souhaite attirer l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la reconversion de certains bâtiments agricoles.
Il s'agit de bâtiments d'élevage à ossature légère, dont le toit et parfois les murs sont en amiante. Ils ne présentent donc pas un intérêt architectural ou patrimonial leur permettant de bénéficier de l'application de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme et, par conséquent, de changer de destination.
Ces bâtiments désaffectés, souvent à l'abandon, détériorent le paysage et constituent un risque important de pollution. Leur démolition s'avère donc vivement souhaitable.
Or les règles strictes auxquelles sont soumises de telles démolitions rendent ces opérations très onéreuses, ce qui conduit les propriétaires à ne pas pouvoir, ou à ne pas vouloir, entreprendre ces travaux, pourtant nécessaires. Les élus municipaux se retrouvent ainsi totalement démunis, avec des friches agricoles disséminées sur leur territoire, et ne peuvent que constater la lente dégradation des bâtiments.
Une évolution réglementaire pourrait sans doute résoudre cette difficulté : elle consisterait à attribuer un droit à permis de construire à usage d'habitation, en contrepartie de la démolition du bâtiment d'élevage, ce droit pouvant être, par exemple, de 25 mètres carrés de surfaces hors oeuvre nettes, ou SHON, pour 100 mètres carrés de bâtiment démoli. Une condition pourrait être imposée, à savoir la vocation sociale, totale ou partielle, des logements créés.
Une telle solution permettrait de prendre en compte plusieurs enjeux : l'enjeu environnemental, par l'amélioration du paysage et l'élimination de matériaux dangereux ; l'enjeu social, par l'incitation de personnes privées à investir dans du logement social ; l'enjeu territorial, par la faculté de repeupler certains secteurs ; ou encore l'enjeu économique, par la possibilité offerte aux propriétaires d'exploitations en reconversion de bénéficier d'un revenu complémentaire.
Monsieur le ministre, le Gouvernement entend-il permettre l'évolution de la législation dans ce sens ou proposer d'autres réformes permettant la disparition de ces bâtiments tout en répondant aux différents enjeux ?
Monsieur le sénateur, il est toujours possible à un propriétaire de démolir un bâtiment désaffecté. Quelquefois, un permis de démolir est nécessaire.
En fait, votre question porte sur la possibilité de reconstruire, à la place de la ruine, en zone agricole.
Les zones agricoles dites « zones A » concernent les secteurs de la commune, équipés ou non, qui doivent être protégés en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, selon l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme. La définition de celles-ci est plus restrictive que celle des anciennes zones dites « NC » des plans d'occupation des sols, puisque toute construction y est interdite, sauf celle des bâtiments relatifs à l'exploitation agricole et les constructions nécessaires au service public.
Ainsi, dans le cadre des zones A, il appartient au plan local d'urbanisme de définir les zones agricoles qui sont intégralement protégées, c'est-à-dire celles sur lesquelles toute construction, même agricole, est interdite et celles sur lesquelles ne sont autorisées que les constructions nécessaires à l'activité agricole.
Pour autant, les agriculteurs peuvent réaliser des constructions ou des installations, telles que les gîtes ruraux ou les auberges à la ferme, pour exercer des activités non agricoles qui leur permettent de diversifier leurs revenus. Cela répond en partie à votre question, monsieur le sénateur.
En effet, l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme permet, au sein d'une zone agricole, de dessiner des pastilles classées zones naturelles. Il autorise, dans ces petites zones, des constructions non agricoles, à condition que soient respectés la qualité des sites, les milieux naturels et les paysages. Cet article impose, évidemment, que ces pastilles soient de petites tailles et qu'elles n'offrent qu'une capacité de construction limitée, afin de respecter le caractère agricole global du territoire concerné.
Pour répondre totalement à votre question, monsieur le sénateur, il est possible, quand cela se justifie, d'appliquer l'article R. 123-8 du code précité autour des bâtiments à démolir, ce qui permettra, ensuite, de reconstruire. Il n'apparaît donc pas indispensable de modifier le code de l'urbanisme. Diverses solutions permettant de prendre en compte vos préoccupations existent.
Telle est la réponse que je peux vous apporter au nom de Dominique Perben.

Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse, mais elle ne me satisfait pas totalement, notamment pour ce qui concerne les bâtiments qui nécessitent un désamiantage onéreux. La faculté de les reconstruire n'étant pas offerte, les communes, plus que les agriculteurs eux-mêmes, sont confrontées à des difficultés. Le code de l'urbanisme mériterait d'être modifié afin d'apporter une solution à certaines situations.

La parole est à M. Michel Billout, auteur de la question n° 1210, adressée à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur les conditions de transfert des aérodromes civils aux collectivités locales au 1er mars 2007, selon le processus de décentralisation prévu par l'article 28 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Dans le département de Seine-et-Marne, les communes de Grandpuits et Clos-Fontaine se sont portées candidates à la reprise de l'aérodrome de Nangis-les Loges, le 28 juin 2006. Cet acte de candidature constituait un préalable indispensable à l'obtention des informations sur l'aérodrome et à l'ouverture de négociations relatives aux modalités de reprise de cet équipement.
Les communes se sont tournées vers la Direction générale de l'aviation civile, la DGAC, et le service spécial des bases aériennes d'Île-de-France pour obtenir des informations, notamment sur le montant des compensations. Aucune réponse satisfaisante ne leur a été apportée à ce jour.
Tout d'abord, l'inventaire et le diagnostic de l'état des biens appartenant à l'État devant être transférés n'ont pu être réalisés de manière précise et exhaustive, faute d'obtention d'informations sur la nature et l'étendue exacte des bâtiments concernés.
Ensuite, l'assurance du site, prise en charge auparavant par l'État pour ce type d'installation, l'État étant son propre assureur, ne fait l'objet d'aucune compensation de la charge nouvelle, qui devra pourtant être supportée par la collectivité locale candidate
Enfin - et ce point me paraît très important -, un diagnostic amiante, effectué au mois d'octobre 2005, à la demande de la DGAC, sur un nombre restreint de bâtiments dont l'État est propriétaire, relevait la présence de nombreux produits contenant cette substance dégradée. La situation est donc particulièrement dangereuse.
Un rapport assorti de préconisations a été rendu. Certaines de ces recommandations devaient être exécutées dans un délai de trente-six mois.
Les élus de ces deux communes ont constaté qu'aucune décision n'avait été prise par les services de l'État pour mener les travaux de remise aux normes. Les demandes des communes d'obtenir un engagement de l'État sur une compensation financière correspondant au montant des travaux sont restées à ce jour sans réponse.
Quant au diagnostic amiante concernant les bâtiments restants, non encore réalisé, la DGAC s'est engagée le 24 janvier dernier à en effectuer la réalisation courant 2007, bien après la signature de la convention de transfert.
Qu'en sera-t-il du financement des travaux de désamiantage après expertise ?
Un diagnostic relatif à l'état des sols et sous-sols de l'aire d'avitaillement en carburant des avions, demandé par les collectivités, n'a pas été engagé, sous le prétexte que cette mesure n'est pas obligatoire, alors même que la cuve est à simple paroi, dispositif dont la loi prévoit la disparition à l'horizon 2010.
La nappe de Champigny, qui fournit la ressource en eau potable d'une partie importante de notre département, ne mérite-t-elle pas plus d'égard de la part des services de l'État, alors qu'elle est déjà particulièrement fragilisée ? Qui, demain, sera responsable en cas de pollution des nappes phréatiques ?
Ne pensez-vous donc pas, monsieur le ministre, que la date du transfert mérite d'être reportée, afin que les communes puissent obtenir l'ensemble des informations concernant les coûts réels de gestion et de réhabilitation de cet équipement avant de prendre leur décision, ou qu'il serait inacceptable, dans ces conditions, qu'elles se le voient imposer, contre leur gré, par décision préfectorale, comme le prévoit la loi ?
Plus généralement, je souhaiterais connaître, monsieur le ministre, les mesures que vous comptez prendre pour que le transfert de propriété des aérodromes civils s'effectue dans une plus grande transparence et dans le strict respect de l'article 72-2 de la Constitution qui dispose : « Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. »
Monsieur le sénateur, permettez-moi tout d'abord de rappeler les principes prévus par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en matière de compensation des transferts de charges.
Pour pouvoir assumer ses nouvelles compétences, chaque collectivité territoriale bénéficiaire du transfert d'un équipement se voit attribuer les moyens, financiers et humains, que l'État consacrait aux missions transférées, dans le strict respect du principe de juste compensation inscrit dans notre Constitution.
En termes financiers, notamment, les collectivités concernées disposeront, à compter de l'entrée en vigueur du transfert, de ressources équivalentes aux dépenses de l'État en moyenne actualisée sur les dernières années, aussi bien en investissement qu'en fonctionnement.
L'aérodrome de Nangis-les-Loges, terrain d'aviation générale, est à ce jour exploité par l'État en régie directe. L'État y perçoit des redevances pour services rendus acquittées par les usagers, ainsi que des redevances domaniales versées par les occupants du domaine public. Sur cet aérodrome, ces produits excèdent les charges consacrées par l'État à l'exercice des missions transférées. Ce produit sera perçu par la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert, la commune de Grandpuits-Bailly-Carrois, à la disposition de laquelle, en outre, des personnels seront mis à disposition en 2007. Cette commune se verra ensuite attribuer, à partir de 2008, une compensation financière équivalente au coût desdits personnels.
L'ensemble de ces moyens permettra à la commune de faire face à ses nouvelles responsabilités, notamment en matière d'assurances.
Un diagnostic technique concernant l'amiante de l'aérodrome a été effectivement réalisé en octobre 2005 et révélait une situation relativement préoccupante. Le montant des opérations préconisées est en cours d'estimation et une solution appropriée sera proposée dans les meilleurs délais à la collectivité concernée.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre réponse. Cependant, elle ne me satisfait pas totalement.
La rétrocession de cet équipement doit avoir lieu en mars 2007, alors même que de grandes zones d'ombre subsistent, notamment quant à la présence d'amiante dans les bâtiments où travaillent aujourd'hui des salariés d'entreprises privées, ces bâtiments étant loués par l'État à ces dernières.
Il faut bien avouer que l'attitude de l'État en la matière n'est pas tout à fait exemplaire. Je vous demande, monsieur le ministre, d'intervenir fermement auprès des services concernés pour que cesse très rapidement cette situation.
Si le désamiantage doit incomber aux collectivités qui reprendront l'équipement, il est important d'avoir un diagnostic très précis et une évaluation des coûts. Or certains bâtiments sont encore en attente d'un diagnostic. Vous comprendrez donc que l'échéance de mars 2007 soit inopportune pour la conclusion d'un accord.

La parole est à M. Thierry Repentin, auteur de la question n° 1214, adressée à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

La très forte croissance du transport des poids lourds génère de grandes nuisances partout en Europe.
Certains pays de l'arc alpin, la Suisse et l'Autriche, en particulier, ont pris des mesures volontaristes afin de limiter le trafic et de promouvoir le transport combiné rail-route.
Cette prise de conscience gagne progressivement les autres pays européens, mais la France reste sourde à l'appel de ses citoyens concernant la question environnementale. C'est d'autant plus dommageable que sa position géographique centrale en fait une plaque tournante du transit routier au sein du continent européen.
Certains axes sont particulièrement encombrés, notamment ceux qui correspondent aux grandes liaisons Nord-Sud de l'Europe.
C'est le cas de deux des trois passages alpins, l'axe Nice-Vintimille et l'axe Chambéry-Turin, via la Maurienne et le tunnel du Fréjus. C'est aussi le cas de l'autoroute A31, en Lorraine, dont la gratuité ne fait qu'accroître l'attractivité vis-à-vis des autoroutes alsaciennes et allemandes payantes.
Lors du comité interministériel du développement durable du 13 novembre dernier, le Premier ministre a annoncé diverses mesures en faveur du développement durable. Il a aussi précisé que le ministre des transports lancerait prochainement un appel à projets auprès des grandes agglomérations, alors même que, dans la loi de finance pour 2007, est confirmée la suppression totale des crédits de soutien au développement des transports publics, malgré les nombreux appels de grandes associations d'élus, notamment le GART, le groupement des autorités responsables de transports, et l'AMGVF, l'association des maires des grandes villes de France, et les recommandations contenues dans le récent rapport de mes collègues Alex Türk et Pierre André.
Dans son discours du 13 novembre dernier, le Premier ministre indiquait que l'instauration de péages urbains et de nouveaux modes de gestion du stationnement serait envisageable, ainsi que le préconisent dans leurs rapports divers parlementaires, notamment notre collègue Roland Ries.
Dans les faits, l'actuelle majorité a constamment rejeté tout amendement faisant évoluer les dispositions législatives en la matière, qu'il s'agisse de l'instauration du péage urbain ou de la décentralisation du stationnement payant.
Nous ne voyons pas venir les mesures attendues et tant annoncées concernant le nécessaire rééquilibrage entre les différents modes de transport de marchandises. En France, le rail recule tous les jours face à la route, et la désertification ferroviaire de certaines zones de notre pays a déjà commencé.
L'instauration, à titre expérimental, d'une taxe sur les camions en Alsace est un franc succès et nous en convenons aisément de concert avec vous.
Cependant, il reste à appliquer cette mesure à l'ensemble du territoire national en transposant rapidement en droit français la directive du Parlement européen du 17 mai 2006 relative à la taxation des poids lourds, mesure dite « eurovignette ».
Le rééquilibrage rail-route, l'optimisation de l'usage des infrastructures, la lutte en faveur de l'environnement, tout cela passe par la généralisation de cette mesure à l'ensemble du territoire français.
Le mal est connu ; des solutions ont de longue date été proposées par la voie parlementaire et l'Europe a d'ores et déjà ouvert la route.
Quand donc allons-nous passer à l'action et donner des preuves de notre volonté d'instaurer au plus vite des mesures concrètes, comme la mise en place de l'eurovignette ou les péages urbains pour les agglomérations qui seraient candidates à des expérimentations et à la décentralisation du stationnement payant ?
Monsieur le sénateur, dans le cadre de l'actualisation du plan climat, approuvé lors du comité interministériel de développement durable du 13 novembre dernier, un appel à projets auprès des collectivités a été lancé. Il doit permettre de susciter des initiatives locales, concrètes et opérationnelles, pour répondre à l'objectif d'améliorer la qualité de vie en ville, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de rendre les déplacements plus faciles.
S'agissant des investissements des collectivités en matière de transports collectifs urbains, j'ai le plaisir de vous confirmer que Dominique Perben a trouvé un accord, à la fin de l'année 2006, avec le groupement des autorités responsables de transport et l'Association des maires des grandes villes de France, pour compléter les aides d'État affectées aux projets décidés avant 2006 à hauteur de 50 millions d'euros et solder ce dossier. Les prochaines subventions seront désormais inscrites dans les contrats de projets État-région, actuellement en cours de négociation.
Quant à la nouvelle directive, dite « eurovignette », elle est entrée en vigueur le 9 juin 2006. Elle doit donc être transposée par voie législative dans un délai de deux ans, soit d'ici au 10 juin 2008.
Quelques mesures techniques sont obligatoires, dont la plus significative, qui s'appliquera à partir de 2010, concerne la modulation des péages en fonction des normes Euro de pollution des poids lourds.
Sans attendre la transcription de cette directive, Dominique Perben a confié une mission à Jean-Pierre Beltoise afin qu'il propose des mesures pour encourager l'utilisation des véhicules les plus propres grâce à une modulation environnementale des péages. Celui-ci devrait rendre son rapport dans les prochaines semaines.
Par ailleurs, le projet de décret nécessaire à la mise en place effective d'une taxe sur les poids lourds circulant sur certaines routes en Alsace sera très prochainement transmis au Conseil d'État après une phase de concertation approfondie.
S'agissant du rééquilibrage rail-route, le débat public sur la problématique des transports dans la vallée du Rhône et sur l'arc languedocien organisé entre le 27 mars et le 20 juillet 2006 a montré que la priorité était donnée aux modes de transport non routiers, notamment à l'optimisation des infrastructures existantes.
L'évolution du budget de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, l'AFITF, dont 60 % des crédits en 2007 seront consacrés aux transports ferroviaires, maritimes et fluviaux, illustre également l'inflexion que le Gouvernement entend donner à la politique des transports. Cette évolution devra naturellement se poursuivre.
Telle est la réponse que je peux vous apporter au nom de Dominique Perben, monsieur le sénateur.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de ces éléments d'informations.
Je profite de votre présence, à la veille du débat sur le projet de loi instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, qui s'ouvrira demain dans cet hémicycle, pour vous indiquer qu'un certain nombre de parlementaires ont déposé un amendement visant à faciliter l'utilisation du chèque transport.
Cette disposition, qui a été actée, ne peut s'appliquer qu'à travers l'émission d'un titre de transport. Cet amendement tend à faire en sorte que ce dernier puisse être pris en compte sur la fiche de paye de tout salarié qui, contre un justificatif, pourrait se voir aidé par l'employeur dès lors qu'il utilise les transports en commun sur le périmètre de vie qui est le sien.
C'est une mesure de simplification qui va dans le bon sens, me semble-t-il, par rapport à votre réponse, et qui permettra de réaliser des économies : il ne sera plus obligatoire d'avoir un chèque matérialisé, en quelque sorte.
Par ailleurs, beaucoup de nos concitoyens, aujourd'hui, prennent leurs abonnements soit à un guichet automatique, soit par Internet ; un chèque transport qui serait émis préalablement les contraindrait à s'adresser à un guichet spécifique.
J'espère que M. le ministre des transports sera ouvert à cette proposition, qui doit être actuellement à l'étude dans ses services. Je vous remercie de vous faire notre interprète auprès de lui, monsieur le ministre.

La parole est à Mme Bernadette Dupont, auteur de la question n° 1209, adressée à M. le ministre de la santé et des solidarités.

Monsieur le ministre, je suis très sensible au fait que vous soyez présent alors que ma question sera la seule qui vous sera adressée.
Je souhaite aborder un sujet qui me paraît préoccupant.
Lorsque l'on connaît l'augmentation exponentielle des dépenses de sécurité sociale, que l'on sait que le Gouvernement fait du ralentissement de ces dépenses l'une de ses priorités, on peut se poser la question des dépenses entraînées du fait des hospitalisations à domicile.
En effet, quand une chimiothérapie se fait à domicile, les produits sont apportés chez le patient dans la quantité nécessaire. Or il peut s'avérer que le malade ne supporte pas le traitement, dont le coût est particulièrement élevé ; le traitement doit alors être modifié. Il peut aussi arriver, malheureusement, que le patient décède avant la fin du traitement.
Jusqu'alors, ces médicaments n'étaient pas restitués aux hôpitaux et étaient confiés soit à des pharmacies soit à des organismes humanitaires pour être expédiés vers des pays connaissant des besoins en la matière.
Or, nous le savons, un tel système doit être supprimé par le projet de loi, actuellement en discussion, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament. Dans ces conditions, quel sera le sort de ces produits ?
Par ailleurs, ne serait-il pas possible de permettre à un infirmier, ou à une infirmière, diplômé d'État, donc assermenté, d'assurer lui-même le tri des médicaments et des matériels utilisés lorsqu'ils n'ont pas été éventés ? Ce faisant, les produits ne seraient pas indûment facturés aux patients qui ne les auraient pas utilisés et les organismes de sécurité sociale ne seraient pas contraints de les rembourser.
Monsieur le ministre, cette mesure entraînerait très certainement des économies tout à fait importantes. Je vous remercie de me préciser ce qui pourrait être envisagé dans ce domaine.
Madame Dupont, à mon tour, je vous remercie non seulement de votre question, mais surtout de la proposition que vous faites au Gouvernement. Si ma réponse aujourd'hui reste, bien sûr, partielle, je suis tout à fait prêt à approfondir ce sujet avec vous.
Les structures d'hospitalisation à domicile constituent des établissements hospitaliers, qui sont régis à ce titre par la carte sanitaire. Elles permettent d'assurer des soins continus et coordonnés, différents par la complexité et la fréquence des actes de ceux qui sont habituellement dispensés à domicile, notamment les services de soins infirmiers à domicile.
Nous avons ainsi prévu un programme d'augmentation du nombre de places d'hospitalisation à domicile, qui se met en oeuvre très rapidement : en 2002, on comptait environ 3 000 places, contre 8 000 aujourd'hui, et leur nombre devrait atteindre 15 000 d'ici à 2010. Il s'agit donc d'un effort considérable pour soigner à leur domicile les malades qui ont besoin d'une hospitalisation, au lieu de les contraindre à se rendre jusqu'à l'hôpital.
La prise en charge d'une hospitalisation à domicile est assurée dans le cadre de la tarification à l'activité commune à l'ensemble des établissements de santé. Elle comprend une facturation par groupe homogène de séjour, ou GHS, certains médicaments et dispositifs médicaux étant facturables en plus de ce GHS.
Dans tous les cas, il appartient à l'hôpital d'optimiser les traitements, afin d'éviter au maximum les coûts inutiles.
À l'heure actuelle, la règle est la suivante : les procédures de récupération des matériels et médicaments, qui, effectivement, peuvent être restés inemployés, pour de multiples raisons que vous avez vous-même mentionnées, doivent être prévues au sein de la structure gestionnaire de l'hospitalisation à domicile, dans la mesure où les structures d'hospitalisation à domicile constituent des établissements hospitaliers.
Par conséquent, la règle applicable à ces établissements hospitaliers à domicile est la même que celle qui s'applique aux autres établissements. C'est la raison pour laquelle il n'existe pas, actuellement, de possibilité de restitution de tels produits, notamment à des officines, même par l'intermédiaire d'une infirmière libérale. Tous les produits doivent être repris par la structure d'hospitalisation à domicile et être ensuite utilisés ou détruits dans les règles normales de l'hospitalisation.
Au demeurant, votre souhait d'élargir les missions des infirmiers et des infirmières diplômés d'État, afin qu'ils puissent décider du sort de ces matériels, est intéressant. Je m'engage donc à étudier cette possibilité avec vous, en liaison avec les services du ministère de la santé et des solidarités.

Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. Mon souci est de limiter les dépenses inconsidérées que pourrait avoir à rembourser la sécurité sociale. À l'évidence, il serait pour le moins malvenu d'imputer un débours à un patient qui n'aurait pas utilisé des médicaments. Ce serait fort désagréable pour lui !
Il faudrait éviter ce genre de situations, qui sont préjudiciables d'un point de vue non seulement psychologique, mais également financier. En effet, le produit ainsi restitué à l'hôpital pourrait être utilisé au profit d'un autre patient et ne ferait l'objet que d'un seul remboursement par la sécurité sociale.

La parole est à M. Bernard Vera, auteur de la question n° 1213, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Le projet de décret modifiant les décrets relatifs aux obligations de service du personnel enseignant du second degré et les décrets relatifs à leurs statuts particuliers intervient alors même que la réduction drastique des effectifs, entamée il y a deux ans, entraîne une dégradation alarmante des conditions d'enseignement, en particulier pour l'éducation physique et sportive, l'EPS.
Motivée avant tout par des raisons d'économie budgétaire, cette réforme qui vise à banaliser l'affectation des professeurs sur trois établissements, à imposer la bivalence et à réduire les moyens des associations sportives, va inévitablement fragiliser l'enseignement de l'EPS.
Les règles de compléments de service dans un autre établissement, collège ou lycée de la même commune ou d'une autre commune, sans restriction de distance ni financement supplémentaire, ne feront que priver les professeurs d'éducation physique et sportive des moyens de s'impliquer pleinement dans une équipe et d'y élaborer des projets d'enseignement, ainsi que des moyens de suivre l'évolution de leurs élèves d'une année à l'autre.
La possibilité, pour ne pas dire l'obligation, qu'un professeur d'EPS effectue le complément de service dans une autre discipline ou, à l'inverse, qu'un enseignant d'une autre matière enseigne l'EPS, sans qualification avérée, n'est pas plus rassurante.
Il me paraît en effet difficile, pour un professeur d'éducation physique et sportive, enseignant quelques heures de mathématiques ou de français, d'incarner un véritable gage de réussite pour les élèves. De même, que faudrait-il penser de la possibilité pour un autre professeur d'enseigner l'EPS sans garantie de formation ? La qualification STAPS ainsi que les qualifications en sauvetage et en secourisme sont en effet requises pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive.
En outre, vous conditionnez le principe du forfait de trois heures consacrées à une association sportive au fonctionnement même de cette association et vous le laissez à l'appréciation du chef d'établissement. Vous le savez bien, cela pose inévitablement la question de la fragilisation de ces associations sportives et celle du risque de leur disparition progressive.
Je dois noter que cette dernière mesure intervient au moment même où la baisse des dotations horaires est susceptible de confronter les académies et les établissements à des choix complexes.
Il me paraît donc important de rappeler ici le rôle essentiel joué par l'enseignement de l'éducation physique et sportive, en particulier par les associations sportives, dans la formation fondamentale des élèves, notamment des jeunes filles, y compris dans les zones rurales et dans les zones difficiles.
C'est un lieu d'apprentissage du vivre ensemble, de la découverte et du respect de l'autre. Il permet à un million de collégiens et de lycéens de s'épanouir en pratiquant volontairement des activités physiques et de participer à des rencontres.
Il me semble essentiel, dans ces conditions, de renoncer à ces réformes et de rechercher, en concertation avec les enseignants et leurs organisations syndicales, les possibilités d'améliorer non seulement les conditions d'exercice du métier d'enseignant, mais également les modalités de fonctionnement des établissements.
Monsieur Vera, je vous prie d'abord de bien vouloir excuser l'absence de M. de Robien, qui m'a chargé de vous répondre en son nom.
Non, monsieur le sénateur, la lecture que vous faites de ce projet de décret n'est pas conforme à la réalité ! Il n'est en aucun cas question de remettre en cause les missions, les services ou les qualifications des enseignants d'éducation physique et sportive. Il n'est pas plus question d'obliger tous les enseignants à effectuer des services partagés entre plusieurs établissements, alors même que cela n'est pas nécessaire.
Ce projet de décret énonce au contraire plusieurs garanties, qui sont clarifiées et simplifiées par rapport à celles qui figurent dans des textes remontant à 1950.
S'agissant d'abord du complément de service effectué par des professeurs dans un autre établissement, ce qui est souvent le cas, vous le savez, dans des collèges ou des lycées de petite taille en milieu rural, le projet de décret permet la reconnaissance d'une réduction de service et d'un complément de salaire.
S'agissant ensuite plus particulièrement des professeurs d'EPS, le décret confirme que trois heures hebdomadaires sont consacrées à l'animation et à l'entraînement sportifs, conformément aux statuts de ces enseignants. En outre, ce texte apporte à ces professeurs une reconnaissance professionnelle et éducative, qui était absente des décrets de 1950. Il consacre l'importance du sport, dont les vertus sont définies et rappelées dans le socle commun des connaissances et des compétences.
S'agissant enfin, monsieur le sénateur, de la possibilité pour un professeur de compléter son service dans une autre discipline, celle-ci est bien inscrite dans ce projet de décret. Mais, cela va de soi, cette possibilité est impérativement liée à la nécessité de maîtriser les compétences nécessaires à l'enseignement d'une autre discipline. Compte tenu de la spécificité de l'éducation physique et sportive, il est obligatoire que le professeur volontaire soit titulaire des diplômes et des titres exigés pour cet enseignement, en particulier dans le domaine du secourisme et de l'aptitude au sauvetage aquatique.
Pour terminer, je vous précise que la possibilité d'enseigner dans deux disciplines, autrement dit la « bivalence », connaît un succès croissant chez les futurs professeurs. Ils étaient un peu plus de 7 500 à la session 2006 des CAPES à se porter candidat à une mention complémentaire conduisant à cette bivalence. Ils sont 8 500 à la session 2007. C'est la preuve, s'il en fallait une, que, contrairement à ce que vous déclarez, les professeurs ne se sentent pas en danger, mais se considèrent comme partie prenante d'un service public que le sens de l'innovation rend encore plus attractif, surtout lorsqu'il est au service de la réussite des élèves.

Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse, que j'ai écoutée avec beaucoup d'attention.
Certes, la reconnaissance de trois heures consacrées à l'animation des associations sportives est un élément positif : si cela n'apparaissait effectivement pas dans les décrets précédents, depuis vingt ans, force est de reconnaître que la mobilisation des enseignants a permis l'existence du forfait de trois heures.

Cela étant, ce projet de décret prévoit deux restrictions importantes.
Premièrement, la notion de forfait est précisément supprimée, ce qui ne la rend plus du tout automatique. Deuxièmement, la fixation de ces heures sera à la disposition du chef d'établissement. Dès lors, chacun le sait, avec la pression imposée par la dotation horaire globale, le risque sera grand qu'un tel choix se fasse au détriment des associations sportives, ce qui, à mes yeux, n'est pas acceptable.
Par ailleurs, je vous précise que mon interprétation de ce projet de décret, que vous semblez remettre en cause, est également celle de nombre de membres du corps enseignant en éducation physique et sportive. Vous avez fait le choix le 18 décembre 2006, puis le 20 janvier dernier, de ne pas tenir compte de l'inquiétude et de la colère qu'ont massivement exprimées les enseignants.
Vous en rajoutez même avec l'annonce de la suppression de 6 000 postes, toutes disciplines confondues, à la prochaine rentrée scolaire. C'est un chiffre plus élevé encore que celui qui est inscrit au budget pour 2007, ce qui n'est pas fait pour rassurer. En tant qu'élu du département de l'Essonne, vous comprendrez que la suppression de 500 postes dans la seule académie de Versailles me concerne tout particulièrement. Cette surenchère est une véritable provocation.
Monsieur le ministre, le 8 février prochain, les enseignants d'éducation physique et sportive, avec l'ensemble de leurs collègues, seront de nouveau dans la rue. Je serai bien entendu à leur côté pour soutenir ce que j'estime être une juste revendication. J'espère qu'à cette occasion ils seront enfin entendus.

La parole est à Mme Bernadette Dupont, en remplacement de M. Henri de Richemont, auteur de la question n° 1201, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

C'est au nom de mon collègue Henri de Richemont que j'interroge M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
L'évolution actuelle de la réglementation européenne dans le domaine des spiritueux est de nature à remettre en cause les efforts consentis par les producteurs de produits à appellation d'origine contrôlée tels que le cognac - vous comprendrez l'intérêt que porte M. de Richemont au sujet - pour lutter contre les véritables fléaux que constituent la contrefaçon et la piraterie commerciale.
En effet, après avoir assuré pendant des décennies la traçabilité de l'appellation d'origine cognac, en exigeant un entreposage de ce produit séparément des autres spiritueux dans des chais dits « jaune d'or » et en le faisant circuler sous couvert de documents spécifiques, les acquits jaunes, la réglementation française a assuré le suivi de cette appellation en habilitant l'interprofession, en charge de la gestion des mouvements et des stocks, à délivrer le certificat d'authentification de l'appellation. Le régime applicable aujourd'hui se fonde, en particulier, sur un certificat d'origine que seul le Bureau national interprofessionnel du cognac, le BNIC, est habilité à délivrer.
Ce dispositif est en tout point conforme à l'habilitation des États membres par la Commission européenne à mettre en place « un système de documents d'authentification afin d'éliminer les fraudes et les contrefaçons ». Une telle habilitation est visée au paragraphe 2 de l'article 10 du règlement CEE n° 1576/89 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses.
Toutefois, à l'occasion de la refonte du règlement précité et des négociations en cours au Conseil des communautés, il ressort que ce dispositif d'habilitation n'est pas repris. Or, devant l'ampleur des dégâts économiques causés, un tel dispositif aurait pu être harmonisé à l'échelon communautaire, en particulier pour tous les produits à indications géographiques bénéficiant d'une forte notoriété.
Monsieur le ministre, dans un contexte de lutte contre les contrefaçons, auquel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est également sensible, et dans l'attente de l'harmonisation européenne des instruments de lutte, les efforts déployés par les États membres pour protéger les consommateurs et notre économie doivent être maintenus et le dispositif communautaire repris dans le texte qui se substituera au règlement CEE n° 1576/89.
Madame le sénateur, vous posez une question au nom de M. Henri de Richemont et je vous réponds au nom de M. le ministre Dominique Bussereau, qui me prie de bien vouloir vous présenter ses excuses pour son absence de ce matin.
Dominique Bussereau, ministre de l'agriculture et de la pêche, comprend parfaitement le souhait exprimé par Henri de Richemont de voir maintenues, dans le règlement relatif aux boissons spiritueuses en cours de discussion au Conseil et au Parlement européen, les dispositions de l'article 10 du règlement CEE n° 1576/89 permettant aux États membres d'appliquer sur leur territoire des règles spécifiques concernant la circulation des produits bénéficiant d'une indication géographique. Ainsi, chaque État membre, dans la mesure où il le souhaitait, pouvait fixer ses propres règles concernant la circulation des produits.
L'actuel projet de règlement va plus loin encore. En effet, il prévoit que, dans le cadre d'une politique de qualité pour les boissons produites sur leur territoire, les États membres peuvent établir des règles plus strictes que celles du règlement pour la production, la désignation ou la présentation et l'étiquetage.
Les mesures concernant la circulation, dont le cadre général était fixé par le règlement, sous réserve de dispositions différentes prises par les États membres, ne figurent plus du tout dans le projet de règlement actuellement en discussion au Conseil et au Parlement. De fait, elles sont considérées comme relevant de la subsidiarité.
En conséquence, le régime de circulation spécifique du cognac doit pouvoir être maintenu. De même, la délivrance des certificats d'authentification de l'appellation pourra continuer à être assurée par le Bureau national interprofessionnel du cognac, dans la mesure où le futur règlement laissera aux États membres la possibilité de fixer les règles de circulation, dans la limite de l'application du principe de subsidiarité.
La réponse du ministre de l'agriculture et de la pêche me semble claire. Par ailleurs, elle répond très exactement aux voeux de M. Henri de Richemont.

Monsieur le ministre, je vous remercie de cette réponse, que je transmettrai à mon collègue.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, auteur de la question n° 1208, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Nous assistons, depuis 2003, à une dégradation constante des moyens alloués à l'enseignement technique agricole public ; cela a été évoqué à plusieurs reprises par les personnels et a été rappelé dans cette assemblée, en particulier lors du vote du budget.
Toutefois, il semble que M. Bussereau ne soit pas très réceptif à ce qui est martelé depuis trois ans. En effet, il persiste dans une politique qui ne fait qu'aggraver la situation de l'enseignement agricole, dont tout le monde reconnaît la qualité et l'efficacité en termes de débouchés.
Lors d'une précédente discussion, M. le ministre de l'agriculture et de la pêche ne reconnaissait que la suppression de huit emplois pour l'enseignement public agricole dans le budget pour 2007. Mais ce sont, en réalité, 548 emplois qui auront disparu depuis le début de la législature, dont 48 pour le budget 2007.
Dans la loi de finances, M. le ministre se glorifiait de ne remplacer que trois départs en retraite sur quatre dans ce secteur. Or le Gouvernement a plafonné le recrutement, ce qui a conduit de nombreux établissements à refuser des élèves faute de moyens pour les accueillir.
En outre, et c'est la cerise sur le gâteau, si vous me permettez l'expression, l'interdiction de redoublement pour les élèves de terminale qui n'ont pas réussi leur examen vient s'ajouter à l'ensemble de ces mesures, privant ainsi malheureusement certains jeunes d'une nouvelle chance. Cela me semble totalement anti-pédagogique et peut être lourd de conséquences pour ceux dont on n'accepte pas le moindre échec.
La situation devient grave. L'enseignement agricole public, déjà minoritaire, a vu sa part se réduire de deux points, pour ne représenter aujourd'hui que 38 % du total des effectifs.
Les conséquences de cette politique d'austérité sont inquiétantes pour les élèves et pour les enseignants : les horaires des enseignements obligatoires ont été réduits ; de nombreux dédoublements ont été supprimés dans plusieurs disciplines ; les heures de soutien, qui contribuaient à remettre à niveau les élèves en difficulté, ont été annulées dans de nombreuses formations ; les enseignements facultatifs ont été diminués de façon drastique. On assiste ainsi à des suppressions d'emplois contractuels.
Cette réalité n'est pas contestable ! Jusqu'à ce jour, comme moyen de défense pour justifier cette politique, M. le ministre invoque le contexte budgétaire difficile. Mais celui-ci dépend en fait des décisions du Gouvernement, qui a organisé sciemment la baisse des impôts pour les plus riches et amoindri ainsi les ressources de l'État.
Le prétexte de la réduction du déficit public a bon dos ! Les choix budgétaires effectués pendant toute la législature ont eu comme fil conducteur l'affaiblissement des services publics en direction des citoyens, au profit du renforcement de ce que le Gouvernement appelle les pouvoirs régaliens.
Le budget pour 2007 n'a pas dérogé à la règle. On enregistre une baisse de 10, 54 millions d'euros pour l'enseignement agricole public, quand l'enseignement agricole privé bénéficie d'une augmentation de 6, 72 millions d'euros.
Vous semblez donc prendre pour cible l'enseignement public agricole. Vous l'avez affaibli depuis trois ans, tout en déclarant qu'il obtenait de bons résultats. C'est une drôle de façon de le soutenir ! C'est surtout faire peser sur lui un risque très lourd d'être dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Comptez-vous prendre des mesures pour que cet enseignement puisse répondre aux besoins du secteur agricole, de l'aménagement et du développement de nos territoires, et pour qu'il puisse assurer sa mission d'insertion scolaire, dont tout le monde vante l'intérêt ? Cela serait d'ailleurs conforme à la loi d'orientation agricole de 1999.
Madame la sénatrice, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Dominique Bussereau, qui m'a chargé de vous répondre en son nom au sujet de l'enseignement agricole public. Il s'agit d'un domaine que je connais également.
La dotation globale horaire attribuée aux lycées agricoles publics permet de couvrir l'intégralité des enseignements obligatoires et des dédoublements prévus par les programmes dans les classes ouvertes pour l'année scolaire 2006-2007.
S'agissant du contexte budgétaire, c'est un autre débat. Mais nous assumons cette politique nécessaire de maîtrise des dépenses publiques.
La dotation a été quasiment maintenue par rapport à l'année scolaire précédente. Pour la prochaine année scolaire, le budget voté par les assemblées parlementaires garantit une stabilité des moyens.
Dans la loi de finances pour 2007, le Gouvernement a de nouveau porté une attention particulière à l'enseignement technique agricole, tant public que privé. Il a en particulier conforté l'accompagnement éducatif, pédagogique et social des élèves en consolidant trois postes particulièrement importants.
Tout d'abord, les crédits consacrés aux assistants d'éducation progressent de 5 %, ce qui est essentiel pour assurer un bon encadrement des nombreux élèves accueillis dans les internats de nos établissements. Nous le savons, c'est une spécificité de l'enseignement agricole.
Ensuite, les crédits relatifs au remplacement des personnels augmentent de 1, 8 % pour assurer la continuité pédagogique et le bon fonctionnement des établissements.
Enfin, l'aide sociale aux élèves est confortée.
En matière d'emploi, l'enseignement a également été préservé. Le taux de renouvellement des postes à la suite des départs à la retraite est plus élevé chez les enseignants que chez les autres catégories d'agents : trois départs à la retraite sur quatre seront remplacés, c'est incontestable, et ce ratio est le même qu'à l'éducation nationale. Au final, ce sont seulement huit emplois d'enseignants qui seront supprimés dans l'enseignement public et dix emplois dans l'enseignement privé.
Madame la sénatrice, ces efforts réalisés par le ministère de l'agriculture et de la pêche dans le contexte que nous connaissons constituent, à l'évidence, la traduction d'une détermination forte du Gouvernement à préserver la spécificité de l'enseignement agricole au sein de notre système éducatif, sa qualité, son ancrage dans nos territoires, en particulier dans les territoires ruraux.
En conclusion, votre inquiétude est largement entendue et nous donnons à l'enseignement agricole public les moyens d'un fonctionnement de qualité, qui est sa marque depuis fort longtemps.

Monsieur le ministre, sur ce sujet, nous ne disposons vraiment pas des mêmes chiffres !
Prenons l'exemple des heures consacrées au soutien. Pour un certain nombre de formations, elles ont disparu. Le fait est même assez marquant dans un certain nombre de secteurs. Ainsi, pour le brevet de technicien supérieur agricole, elles sont passées de cent vingt heures à soixante ! Et je pourrais vous citer d'autres exemples !
S'agissant de l'évolution des emplois, vous reprenez, dans votre réponse, ce que m'a dit M. Bussereau lors d'une précédente rencontre, à savoir que, dans le budget 2007, huit emplois contractuels seront supprimés dans l'enseignement privé. Mais, dans l'enseignement technique public, ce sont dix postes d'enseignants qui seraient supprimés et quarante-huit équivalents temps plein sur l'ensemble des personnels.
Un autre exemple montre clairement à quel point la situation est en train de se dégrader : alors que cent trente-cinq postes devaient être supprimés dans le budget 2006, en définitive, quarante-six postes de plus le seront, ce qui porte le nombre de suppressions à cent quatre-vingt-un.
Aujourd'hui, vous prétendez que la situation s'améliore ; vous comprendrez que je ne puisse accepter de tels propos.
Les crédits consacrés à l'aide sociale aux élèves ont été en diminution et le sont encore, dans la loi de finances pour 2007 par rapport à la loi de finances pour 2006, de 2 150 000 euros. Il s'agit là d'un véritable problème ! Cela est dû, nous a-t-on dit, au fait qu'en 2006 il a fallu rattraper les retards antérieurs.
Sur le terrain, la réalité est tout autre s'agissant de l'accueil des élèves, et je le constate aussi dans mon département : un certain nombre de jeunes qui auraient voulu suivre ces formations n'ont pas pu intégrer les établissements, faute de capacités d'accueil suffisantes.
Le travail qui a été engagé avec les lycées agricoles est pourtant d'une très grande richesse. Dans mon département, une réflexion a été menée, sur toutes ces terres touchées par la déprise agricole et situées particulièrement dans les zones inondables de la Loire, avec les professionnels, la chambre d'agriculture et le lycée agricole de notre agglomération. Il y avait là, pour des jeunes, un potentiel de formation et d'avenir. Or, aujourd'hui, compte tenu des moyens de l'enseignement agricole public qui diminuent, alors que, parallèlement, ceux de l'enseignement privé augmentent fortement, une barrière est en train de se dresser, qui ne nous permet pas d'envisager l'avenir dans les mêmes conditions.

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures trente-cinq, est reprise à seize heures cinq, sous la présidence de M. Christian Poncelet.