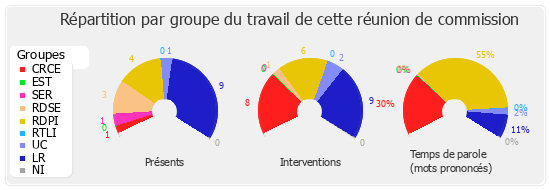Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation
Réunion du 13 novembre 2012 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
La commission procède tout d'abord à l'examen du rapport de M. François Rebsamen, rapporteur spécial, sur la mission « Egalité des territoires, logement et ville ».

Avant de présenter le détail des programmes de la mission, je formulerai, sur l'ensemble, trois observations générales.
La première porte sur la forme pour signaler que l'ancienne mission budgétaire « Ville et logement » est devenue la mission « Egalité des territoires, logement et ville » et que son périmètre a été élargi aux crédits de l'urbanisme du programme 113 « Urbanisme, paysages, eau et biodiversité » qui figuraient jusqu'à présent dans la mission « Ecologie ».
D'autres aménagements internes ont eu lieu, en particulier la création d'un programme de soutien et le transfert de l'action « Grand Paris » vers le programme « aides à la pierre ».
Si ces modifications sont réalisées dans l'objectif d'une meilleure cohérence des politiques, elles créent beaucoup de difficultés pour suivre, d'un exercice à l'autre, les consommations de crédits et la performance des programmes.
Le projet de budget s'inscrit dans une trajectoire pluriannuelle stricte en 2013 mais qui se stabilise pour les exercices 2014 et 2015. Au total, on passerait d'un budget de 8,2 milliards en 2012 à 7,72 milliards en 2015, soit un peu plus que ce qui était initialement prévu pour 2009.
Sur les cinq programmes de la mission, ceux qui enregistrent une notable diminution de crédits sont le programme relatif aux aides personnelles (- 10,9 % soit 597 millions d'euros de moins) et, dans une moindre mesure, le programme « politique de la ville » (- 6,5 % soit 35 millions de moins).
Compte tenu de la stabilité des besoins, notamment ceux des dépenses de guichet, la réduction des moyens strictement budgétaires implique de recourir à des financements externes. Depuis 2009, les programmes confiés à l'ANRU ainsi que l'amélioration du parc ancien (confié à l'Anah) sont financés principalement par la contribution d'Action logement.
Depuis la loi de finances pour 2011, le précédent Gouvernement avait également soumis les organismes HLM et les SEM à un prélèvement de 175 millions assis sur leur potentiel financier.
Le présent projet de budget pour 2013 prend acte de la suppression du prélèvement HLM à compter de 2013. Il propose une réforme des circuits de financement touchant à la fois les aides personnelles au logement, l'Anah et Action Logement.
Ainsi, 590 millions d'euros provenant de la vente des quotas carbone, devraient être affectés à l'Anah à compter de 2013.
Dans le même temps, la contribution du 1 % aux politiques de l'Etat est fixée à 1,2 milliard d'euros pour les années 2013, 2014 et 2015. Ce montant doit ensuite être réduit. Pour 2013, 800 millions d'euros au minimum seraient alloués au financement de l'ANRU, et 400 millions d'euros maximum devront servir à financer le FNAL, dans le cadre d'un « engagement exceptionnel » prévu à l'article 30 du projet de loi de finances.
En ce qui concerne Action logement, il faut noter aussi la lettre d'engagement mutuel, signée par l'Etat et le 1 %, qui prévoit qu'Action Logement pourra emprunter à hauteur d'un milliard d'euros par an sur les trois prochaines années, en ayant accès aux ressources des fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts, et qu'il consacrera au moins 1,5 milliard d'euros par an à la construction de logements sociaux.
En « contrepartie », l'Etat entend revenir à un mode contractuel de gestion des emplois des fonds d'Action Logement, cet engagement devant être traduit dans la future grande loi sur le Logement annoncée par le Gouvernement pour 2013.
Enfin, et c'est ma troisième observation générale, il est clair que le budget proprement dit du logement ne résume pas la politique menée en ce domaine. D'abord, en raison de l'importance du volet fiscal de cette politique. Pour 2013, l'ensemble des dépenses fiscales rattachées à la mission, totalisant les dépenses sur impôts d'Etat et sur impôts locaux pris en charge par l'Etat, s'élèvent à 13,559 milliards d'euros, soit 192 % des crédits de la mission, hors titre 2.
Il convient, sur ce point, de souligner le poids des mesures passées. Les dépenses fiscales liées à certains dispositifs d'aide supprimés continuent, en effet, de peser durablement. C'est ainsi que le crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts d'emprunts, qui s'est éteint en 2011, représentera, en 2013, une dépense de 1,465 milliard d'euros. Il en est de même pour les dispositifs d'aide à l'investissement immobilier locatif dont le coût fiscal s'étale sur plusieurs années, après leur disparition. Au total, ces régimes d'aide représenteront, en 2013, 1,55 milliard d'euros.
Je remarque aussi que c'est la première fois depuis longtemps que l'on observe une légère diminution du poids des dépenses fiscales. Il était de 14,1 milliards en 2012, il sera de 13,5 milliards en 2013.
Cette baisse intervient malgré la création d'un nouveau dispositif d'incitation à l'investissement locatif, proposé par l'article 57 du présent projet de loi de finances, qui doit permettre la construction d'environ 40 000 logements par an pour une dépense fiscale de 35 millions d'euros en 2014 et 145 millions d'euros en 2015.
Plus généralement, il convient d'apprécier ce projet de budget - et son ambition - au regard de l'ensemble des mesures en faveur du logement proposées dans le présent projet de loi de finances, comme les mesures sur les plus-values immobilières pour favoriser la remise de biens sur le marché ou le renforcement de la taxe sur les logements vacants. Ajoutées aux dispositions prévues en dehors du présent projet, régulation des loyers, augmentation des objectifs de la loi SRU, cession de foncier- y compris gratuitement- par l'Etat, elles devraient permettre de répondre aux objectifs de la construction de 500 000 logements par an dont 150 000 logements sociaux et de la rénovation thermique d'un million de logements par an.
J'en viens maintenant à la présentation des cinq programmes de la mission qui au total rassemblent 8 milliards d'euros.
Le programme 177 « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables » représente 15 % des crédits de la mission et enregistre une hausse de 3,2 % à structure constante. Il se caractérise par un effort très remarquable en faveur de la veille sociale et l'hébergement d'urgence. Les crédits demandés pour 2013 sont à la hauteur de la consommation constatée sur l'exercice 2011 et sont conformes aux exigences de la sincérité budgétaire.
En ce qui concerne le financement du parc d'hébergement pour les personnes sans domicile, un certain nombre de décisions importantes ont été prises par le nouveau Gouvernement, en réaction à la politique trop restrictive inspirée par la logique du « logement d'abord » prônée antérieurement. Elles incluent notamment la pérennisation de certaines places ouvertes en 2012 dans le cadre du dispositif hivernal et la création de 500 places nouvelles d'hébergement d'urgence dès 2013.
Le programme 109 « Aide à l'accès au logement » représente 60 % des crédits de la mission. Il est en diminution de près de 600 millions d'euros par rapport à 2012 en raison d'une économie réalisée sur la subvention d'équilibre que l'Etat verse au fonds national d'aides au logement (FNAL). Cette diminution n'empêchera pas l'actualisation des loyers plafonds et du forfait de charges sur l'évolution de l'indice de référence des loyers (IRL) au 1er janvier 2013 qui constitue un retour aux règles d'indexation normales alors que le précédent Gouvernement avait décidé, en 2012, de limiter à 1 % la revalorisation des barèmes des aides au logement.
Le projet de loi de finances prévoit donc un mode de financement rénové des aides personnelles pour les trois prochaines années.
De nouvelles recettes seront affectées au FNAL, à hauteur de 848 millions d'euros, dont 400 millions sous forme d'un prélèvement exceptionnel sur les versements des employeurs au titre de la participation à l'effort de construction (PEEC), dont la création est prévue par l'article 30 du présent projet de loi de finances, et 448 millions d'euros correspondant à une fraction du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, dont la création fait l'objet de l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Il est particulièrement important, à mon sens, que le Gouvernement ait affirmé le caractère exceptionnel du prélèvement.
Le programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat » traduit la volonté du Gouvernement de développer et d'améliorer l'offre de logement, aussi bien dans la construction neuve que dans la lutte contre l'insalubrité et la précarité énergétique.
En ajoutant les crédits consacrés aux aides à la pierre pour le parc locatif social (505 millions) et ceux destinés à la lutte contre l'habitat indigne (7,9 millions), on constate une progression de près de 12 % des autorisations d'engagement par rapport à la LFI pour 2012. Les crédits d'aide à la pierre font l'objet d'un recentrage social et vers les zones les plus tendues du territoire. Le montant de la ligne « surcharge foncière » passe ainsi de 190,6 à 214,9 millions d'euros.
J'attire enfin votre attention sur le projet de mise en place d'observatoires du logement à l'échelle locale prévu à hauteur de 5 millions d'euros et sur l'explosion du coût du contentieux Dalo. La dotation prévue en 2013 pour faire face aux condamnations est de 29,3 millions d'euros, elle correspond à une augmentation de 10 millions d'euros, soit + 52 %, par rapport au montant prévu par la loi de finances pour 2012.
Le programme 147 « politique de la ville » représente 6 % des crédits de la mission. Ils enregistrent une baisse de 4 % qui préserve cependant 2,5 millions d'euros pour assurer le financement du nouveau dispositif des « emplois francs ». Le budget de ce programme est incontestablement un budget d'attente. Beaucoup de dossiers ont été lancés, comme la géographie prioritaire, la redistribution du rôle des agences, l'avenir des zones franches, les nouveaux contrats de la politique de la ville avec les collectivités, la suite du PNRU. C'est donc plutôt pour 2014 que les choix budgétaires et fiscaux seront effectués.
Enfin, le nouveau programme de soutien concentre les effectifs et les crédits de masse salariale du ministère de l'égalité des territoires et du logement. Toutefois, comme pour les années antérieures, en gestion, l'ensemble des moyens de ce programme sera transféré vers le programme 217 du ministère de l'écologie.
Au total, je vous propose d'adopter les crédits de la mission qui sont à la hauteur des ambitions des objectifs de la politique du logement menée par le Gouvernement.

Quelles sont les conséquences du projet de budget sur les moyens financiers des organismes d'HLM qui conditionnent en grande partie l'activité du bâtiment ?

Je m'inquiète de la progression très rapide des condamnations au titre du droit au logement opposable !

Comment s'explique la hausse du coût du dispositif Scellier en 2013 ? Les chiffres prennent-ils en compte le « rabot » sur les « niches » ? Peut-on avoir une idée des conséquences de l'échec de la garantie des risques locatifs (GRL) sur les fonds de solidarité pour le logement (FSL) et l'augmentation du recours à ces fonds ?

Quel sera l'impact de la baisse de la contribution de l'Etat sur le fonctionnement du FNAL ? Comment peut-on économiser presque 600 millions d'euros ? Et peut-on avoir des éléments de comparaison entre le Scellier et le nouveau dispositif d'incitation proposé par le projet de loi de finances ? Enfin, comment pouvons nous limiter la hausser du coût des contentieux Dalo ?

Il n'y a plus de subvention de l'Etat pour les prêts locatifs sociaux (PLS). C'est grave notamment pour les projets de création de structures d'accueil de personnes handicapées et de maisons de retraite, car nous perdons ainsi le bénéfice de la TVA à taux réduit.

Sur les aides à la pierre, je note quand même une diminution des subventions par opération. Je suis également inquiète des conséquences de l'affaire du crédit immobilier de France sur l'accession sociale à la propriété. Ma dernière interrogation porte sur la réalité des produits qui seront tirés de la vente des quotas de CO2 et serviront à financer l'Anah.

Sur les marges de financement des organismes HLM, la suppression du prélèvement potentiel financier, qui était injuste, rendra 175 millions d'euros. Pour le Dalo, nous ne pouvons pas faire grand-chose car l'Etat est condamné en application de la loi de 2007 sur le droit au logement opposable et je crains que ces condamnations continuent d'augmenter. Mais le produit des condamnations est heureusement réinjecté dans le circuit pour la construction de logements et l'accompagnement des personnes en difficulté. Sur les dépenses fiscales liées à des dispositifs incitatifs qui sont désormais clos, l'augmentation tient à la prise en compte des nouvelles opérations précédant la clôture. Quant aux chiffres de l'estimation, ce sont ceux des documents budgétaires et le rabot ne touche pas les dispositifs anciens.
Je ne pense pas que l'on puisse établir de lien direct entre échec de la GRL et recours aux FSL. C'est plutôt la crise sociale et la paupérisation qui conduisent à augmenter ce recours aux fonds départementaux.
Pour la comparaison entre dispositifs « Scellier » et « Duflot » il faut noter, d'une part, que le second a un objectif quantitatif plus modeste et, d'autre part, qu'il est recentré géographiquement.
S'agissant des PLS, effectivement il n'y a plus d'aide de l'Etat, mais cette décision ne date pas du projet de budget pour 2013. Toutefois, je réponds à Marie-France Beaufils que les crédits d'aide à la pierre progressent bien de 450 millions à 500 millions d'euros.
Sur le CIF, je vous renvoie aux auditions organisées par notre rapporteur général...

ainsi qu'aux travaux qui vont être menés par Jean Germain.
Enfin, sur le financement du FNAL et de l'Anah, les 590 millions de produit issus des quotas carbone sont assurés pour 2013 si j'en crois les informations précises que j'ai obtenues sur le cours du quota et les estimations retenues dans le cadre de l'élaboration du projet de budget. Comme l'Anah disposera d'un financement nouveau, la contribution d'Action logement sera réorientée vers le financement de l'ANRU ainsi que vers les aides au logement et le FNAL. Elle sera complétée par un prélèvement exceptionnel sur la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction. C'est ce qui permet à l'Etat de réduire la subvention d'équilibre qu'il verse au FNAL sans diminuer les prestations d'aides personnelles au logement.

Je vous remercie pour ces réponses et je vous propose maintenant de passer à l'examen des articles rattachés.

L'Assemblée nationale a adopté hier les crédits de la mission ainsi que deux amendements créant des articles additionnels.
Le premier (article 64 ter) a trait au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL), qui a été créé par la loi de finances rectificative pour 2011 de juillet 2011. Ce fonds finance des actions d'accompagnement des ménages reconnus prioritaires et à loger en urgence dans le cadre du DALO. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale propose d'élargir le bénéfice des mesures financées par le fonds à l'ensemble des ménages en difficultés. Compte tenu des ressources suffisantes du fonds (qui proviennent des astreintes payées par l'Etat au titre du Dalo), je suis favorable à cette mesure.
Le second article (article 64 quater) concerne la taxe d'habitation sur les logements vacants que les communes peuvent instituer en application de l'article 1407 bis du CGI et à laquelle j'ai fait allusion dans l'examen des crédits. Alors que le dispositif en vigueur autorise d'appliquer la taxe d'habitation après cinq années de vacance, le texte adopté par l'Assemblée nationale réduit cette durée à deux ans. Je suis favorable à cette mesure même si cela n'épuise pas le débat que nous aurons sans doute demain lors de l'examen en commission de l'article 11 du présent projet de loi de finances.
Donc, je vous demande de bien vouloir adopter sans modification ces deux articles.

Cette modification de délai de cinq à deux ans est-elle de droit ou demande-t-elle une délibération de la commune ou de l'EPCI ?

Pour instituer la taxe d'habitation logements vacants, il faut une délibération, mais le raccourcissement du délai est automatique.
A l'issue de ce débat, la commission décide de proposer au Sénat l'adoption, sans modification, des crédits de la mission « Egalité des territoires, logement et ville » ainsi que des articles 64 ter et 64 quater du projet de loi de finances pour 2013.
Présidence de M. Albéric de Montgolfier, vice- Président
Puis la commission procède à l'examen du rapport de MM. Thierry Foucaud et Claude Haut, rapporteurs spéciaux, sur la mission « Enseignement scolaire ».

Je voudrais, à titre liminaire, excuser Thierry Foucaud, qui ne peut pas être présent aujourd'hui parmi nous, pour des raisons familiales.
L'examen des crédits de la mission « Enseignement scolaire » intervient dans un climat radicalement différent de ce qu'il était l'année dernière à la même époque. En 2013, cette mission bénéficiera de la priorité donnée par le Gouvernement à la jeunesse en général et à l'éducation en priorité.
Comme d'habitude, avec mon collègue Thierry Foucaud, nous nous sommes partagés les très nombreux sujets couverts par la mission. En son absence, après mes propres observations, je vous ferai part de son appréciation sur ce budget.
Un mot tout d'abord des grandes masses budgétaires. Hors CAS pensions, les moyens passeront de 45,4 milliards d'euros en 2012 à 45,7 milliards en 2013 puis 46,1 milliards en 2014 et 46,6 milliards en 2015. En moyenne, entre 2013 et 2015, la progression des crédits s'établit donc à + 0,86 % par an. Contrairement à ce que certains ont pu dire, cette évolution ne représente pas une fuite en avant en faveur de toujours plus de moyens, sans s'interroger sur les finalités pédagogiques des dotations budgétaires. Le Gouvernement n'a pas fait le choix de la quantité contre la qualité.
L'examen des crédits montre simplement que 2013 est une année de transition entre la période que l'on pourrait appeler de « vaches maigres » mise en oeuvre par le précédent Gouvernement et la refondation voulue par le Président de la République.
Au total, les crédits des cinq programmes de la mission « Enseignement scolaire » qui relèvent du ministère de l'éducation nationale inscrits au projet de loi de finances pour 2013 s'élèvent à 62,7 milliards d'euros, contre 60,9 milliards d'euros en 2012, soit une progression de 2,92 %.
Avant d'entrer plus en détail dans leur présentation, je rappellerai d'un mot les mesures d'urgence prises cet été pour la rentrée 2012 dans la loi de finances rectificative de juillet dernier. En juin, les opérations de préparation de la rentrée étaient évidemment très avancées et il était difficile de modifier les choses en profondeur. C'est d'ailleurs pour cette raison que plusieurs des initiatives du précédent Gouvernement sont poursuivies avant de faire l'objet, au cours des mois à venir, d'une évaluation approfondie. Je pense par exemple aux internats d'excellence ou à l'opération « cours le matin, sport l'après-midi ». Il aurait été absurde de remettre en cause dans l'urgence des orientations déjà décidées. Sur le plan pédagogique, on ne peut arrêter brutalement la réforme du lycée sans rien proposer à la place. Si le livret de compétences doit évoluer, on ne peut pas le faire sans réflexion préalable. Tout cela, le Gouvernement l'a bien compris et je crois que nous pouvons tous nous en féliciter.
Mais le calendrier ne l'empêchait pas de prendre de premières mesures. Le collectif de l'été a donc revalorisé de 25 % le montant de l'allocation de rentrée scolaire, qui est versée aux parents de 5 millions d'enfants. La dépense correspondante a été évaluée à 370 millions d'euros, à comparer à une dépense totale d'un milliard et demi d'euros. Le collectif a également majoré les crédits de la mission d'un peu plus de 89 millions d'euros, ce qui a permis de dégager des moyens supplémentaires. Je pense en particulier au recrutement de 1 000 professeurs des écoles, 1 500 auxiliaires de vie scolaire pour les élèves handicapés et 2 000 assistants d'éducation. Toutes ces personnes ont reçu une affectation dès cette rentrée.
J'en viens maintenant au contexte dans lequel nous examinons les crédits de la mission « Enseignement scolaire ». Ils constituent la première traduction législative de la refondation voulue par le Gouvernement et dont le Président de la République a défini les grandes lignes le 9 octobre dernier à la Sorbonne. Celles-ci trouveront leur traduction législative au sein de la loi d'orientation annoncée par le Gouvernement.
J'évoquerai néanmoins une des questions auxquelles une réponse a d'ores et déjà été apportée, celle des rythmes scolaires. Le nombre élevé d'heures passées en classe, la concentration du calendrier scolaire sur le plus petit nombre de semaines et son corollaire, la longueur de la journée, font de l'enseignement français du premier degré un cas à part parmi les pays de l'OCDE. Parallèlement, les résultats des élèves, tels qu'ils ressortent des comparaisons internationales, ne sont guère favorables.
Hier, les élèves ont retrouvé le chemin de leurs classes au terme des premières vacances de la Toussaint de deux semaines entières. Mais l'essentiel de la nouvelle organisation du temps scolaire est à venir à la rentrée 2013. Comme vous le savez, les élèves passeront quatre jours et demi en classe, contre quatre jours actuellement. En contrepartie de l'accueil le mercredi matin, la journée sera raccourcie. Bien évidemment, cette nouvelle organisation du temps scolaire aura une incidence directe sur les dépenses de nos communes et départements : il faudra bien financer l'accueil des enfants le mercredi matin, leur encadrement pendant l'heure dégagée en fin de journée ainsi que les modifications de l'organisation des transports scolaires.
Pour en revenir au budget, les moyens supplémentaires permettront en priorité de financer le remplacement de tous les enseignants ainsi que les recrutements annoncés, qu'il s'agisse d'enseignants, de personnels administratifs ou d'accompagnement. Ces recrutements se dérouleront dans le cadre d'une refonte complète de la formation des enseignants.
Dans le détail, les chiffres mentionnés dans la presse, voire dénoncés par certains, méritent qu'on s'y attarde un instant. D'aucuns ont joué à se faire peur en assimilant volontairement recrutements et créations d'emplois. Premier élément, l'intégralité des personnels partant en retraite sera remplacée. C'est un renversement complet par rapport aux années précédentes, au cours desquelles le ministre de l'éducation nationale s'était efforcé d'être le bon élève de la classe en appliquant avec rigueur la règle du « 1 sur 2 ». Le simple remplacement des départs prévus à la rentrée 2013 représente déjà 22 100 recrutements.
En juin 2013, une seconde série de concours sera organisée afin de recruter les enseignants destinés à pourvoir les postes de la rentrée 2014. 21 350 postes seront ouverts aux étudiants.
En tout, ce sont donc plus de 43 000 nouveaux enseignants qui seront recrutés en 2013. Ces chiffres paraissent très élevés. Mais, au total, le schéma d'emplois n'évolue guère. C'est encore plus vrai du plafond d'emplois, qui n'augmente que de 1 963 équivalent temps plein travaillés, à comparer à un total de 970 031.
Un mot de l'enseignement technique agricole. Les crédits sont reconduits en autorisations d'engagement et progressent de 30 millions d'euros en crédits de paiement, pour atteindre 1,33 milliard d'euros, soit guère plus de 2 % des crédits de la mission. L'année dernière, beaucoup, parmi nous, s'étaient inquiétés de l'hémorragie des emplois. Après les cinquante nouveaux emplois de la rentrée 2012, 200 postes d'enseignants seront créés en 2013. C'est un début de rattrapage après les coupes des dernières années, dont celles de 2012, qui avaient représenté 280 emplois. Le budget 2013 de l'enseignement agricole permet également d'opérer un rééquilibrage entre l'enseignement public et l'enseignement privé. Comme nous avions eu l'occasion de le dénoncer, l'enseignement public avait payé le plus lourd tribut à la politique de réduction des effectifs d'enseignants, puisqu'il avait dû supporter 60 % des suppressions d'emplois, alors qu'il ne représente que 37 % des effectifs. A l'inverse, à la rentrée 2013, l'enseignement public bénéficiera en priorité des postes supplémentaires : 140 sur les 200 prévus.
Le projet de budget permet également de financer, en années pleines, les revalorisations des bourses intervenues à la rentrée 2012, ainsi que celles prévues pour la rentrée 2013. L'accroissement des crédits, qui passent de 619,5 à 634,5 millions d'euros, tient également compte de l'accroissement du nombre d'élèves boursiers.
Pour terminer, je mentionnerai que la mission n'échappe pas à l'effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement courant demandé à l'ensemble des départements ministériels. Evidemment, les masses budgétaires en cause sont sans commune mesure avec les dépenses du titre 2, qui représentent à elles seules 59,55 milliards d'euros sur les 64 milliards de la mission. Mais, ici comme ailleurs, les emplois des opérateurs diminuent et ils sont appelés à rationnaliser leurs dépenses, tout comme les services du ministère.
En conclusion, ce budget témoigne d'un engagement et d'une ambition pour notre système éducatif. Je vous propose donc de donner un avis favorable à son adoption.
Après la présentation très détaillée des grandes orientations de la mission « Enseignement scolaire », je voudrais me faire le messager de notre collègue Thierry Foucaud en portant un éclairage particulier sur la politique de formation des enseignants et des personnels d'accompagnement.
2013 sera une année transitoire et deux concours de recrutement seront successivement organisés. A la rentrée 2013, les enseignants nouvellement affectés devant les classes auront été recrutés selon les modalités encore en vigueur, c'est-à-dire au niveau Master 2. Le précédent Gouvernement avait, en effet, choisi le « tout théorique », sanctionné par un diplôme élevé, au détriment de l'apprentissage du terrain complètement laissé de côté. Des jeunes professeurs se retrouvaient devant les classes, y compris les plus difficiles d'entre elles, avec pour seul soutien l'aide que pouvaient leur apporter leurs collègues.
Le nouveau système prendra ensuite le relais, pour les enseignants appelés à être affectés à la rentrée 2014. Le Gouvernement a annoncé la mise en place d'écoles supérieures du professorat et de l'éducation, sans revenir aux IUFM. Les étudiants seront recrutés en fin de Master 1 et effectueront leur année de Master 2 dans ces établissements d'un genre nouveau, au sein d'un cursus à la fois théorique et pratique. Le contenu précis de cette formation, ainsi que le contour exact des ESPE restent à définir.
Certains de ces étudiants seront recrutés en emplois d'avenir professeur. Le seul point commun avec les emplois d'avenir en général est le public auquel il s'adresse, c'est-à-dire de jeunes boursiers issus en priorité des zones défavorisées. En revanche, bien évidemment, les emplois d'avenir professeur ne sont pas ce qu'on appelle généralement des décrocheurs ou de jeunes diplômés qui n'arrivent pas à s'insérer sur le marché du travail.
Ces emplois constituent à la fois une mesure sociale et une forme de pré-recrutement dès la licence, qu'on peut rapprocher de ce qui existait autrefois pour les écoles normales ou, à un autre niveau, pour les écoles normales supérieures. L'étudiant est rémunéré, jusqu'à 900 euros par mois, contre l'engagement de se présenter aux concours de recrutement de l'éducation nationale. Les crédits inscrits au projet de budget de la mission s'élèvent à 13,8 millions d'euros, pour financer 6 000 emplois d'avenir. Le système devrait monter en puissance en 2014 puis 2015, à raison de 6 000 emplois supplémentaires chaque année.
La question sous-jacente est celle de la crise du recrutement que connaît l'éducation nationale. Selon le ministre, la baisse du nombre des candidats aux concours et la désaffection vis-à-vis des métiers de l'enseignement étaient liées à la diminution des perspectives de recrutement et au manque de considération dans lequel le Gouvernement tenait les enseignants. Nous verrons bien. En tout état de cause, un cap a été fixé. Lors de la conclusion des réflexions sur la refondation, le Président de la République a clairement rappelé ses engagements en faveur de la création de 60 000 emplois pour l'éducation sur la durée du quinquennat.
Autre recrutement financé sur les crédits de l'action « Vie scolaire et éducation à la responsabilité », celui de 2 500 assistants d'éducation, dont 500 pour, selon le projet annuel de performances, exercer une nouvelle mission dite de prévention et de sécurité au sein des « établissements les plus exposés aux incivilités et aux violences, en complément du travail des équipes de vie scolaire et des équipes mobiles de sécurité ».
Autre point d'interrogation pour l'avenir, la place de la formation continue des enseignants au sein des futures écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Cela devrait constituer une de leurs missions. Toujours est-il que les crédits sont simplement reconduits au centime près (12,95 millions d'euros).
L'examen de la politique de formation me fournit une transition pour évoquer l'accompagnement des élèves handicapés. Le nombre des auxiliaires de vie scolaire a été sensiblement augmenté dès la rentrée (1 500 emplois) et le sera encore à la rentrée 2013. Pour autant, les élèves handicapés et leurs parents ont, semble-t-il, rencontré beaucoup de difficultés à la rentrée. Entre l'absence d'AVS le jour J, l'affectation provisoire d'un AVS et son changement au bout de quelques semaines, l'inadéquation de la personne avec l'emploi proposé, les remontées du terrain sont assez négatives. Je crois qu'il existe un véritable problème de formation des personnes dont la mission est d'accompagner les élèves handicapés. Des dispositifs existent mais si vous recrutez la personne à la rentrée, par définition elle n'a pas bénéficié des 60 heures de formation auxquelles elle a droit.
Le projet de budget comporte un effort en faveur de la formation des enseignants référents des élèves handicapés. C'est une bonne chose mais il faut rapidement se pencher sur la formation des AVS, d'autant que nous devons faire face à une triste réalité : les enfants handicapés sont nombreux dans les petites classes mais un décrochage se produit vers 15-16 ans et le taux de scolarisation est beaucoup plus faible à partir de cet âge. C'est aussi le moment où le rôle des AVS change. Il relève moins de l'aide technique et plus d'un soutien éducatif. Encore faut-il que les personnes qui occupent ces emplois soient formées. N'oublions pas, par ailleurs, qu'il s'agit d'emplois précaires le plus souvent. Tout comme les élèves handicapés, les AVS ont besoin de stabilité.
En matière d'aide, il faut aussi évoquer l'éducation prioritaire. Plusieurs rapports récents ont souligné l'empilement des dispositifs, qu'il s'agisse des établissements de réinsertion sociale, des internats d'excellence mentionnés tout à l'heure, du programme Clair puis Eclair (écoles, collèges et lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite), des réseaux ambition réussite (RAR). Il faut mettre tout cela au clair et revoir le zonage de l'éducation prioritaire. Le ministre estime pouvoir le faire pour la rentrée 2014. J'espère que cela sera aussi l'occasion de s'interroger sur les moyens des RASED, qui ont beaucoup souffert des réductions de moyens des dernières années. Ce à quoi le Gouvernement répond que l'objectif de « plus de maîtres que de classes » permettra de répondre aux besoins spécifiques des élèves en difficulté.
Affaire à suivre, d'autant que la Cour des comptes a transmis à notre commission des finances un référé pour le moins édifiant. Selon l'analyse de la Cour, non seulement le système éducatif ne corrige pas les inégalités de départ, mais il contribue même à les renforcer. Je sais bien qu'il n'est pas toujours facile de déterminer le bon niveau d'allocation des moyens ou de faire bouger les choses, mais cela doit nous amener à réfléchir, surtout quand on connait le niveau du décrochage scolaire : 150 000 jeunes quittent chaque année le système éducatif sans diplôme.
Enfin, je voudrais évoquer la situation du régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privé sous contrat. Dans un référé qu'elle vient d'adresser à notre commission des finances, la Cour des comptes a constaté sa situation financière préoccupante. Tant la ministre des affaires sociales que le ministre de l'éducation nationale ont annoncé leur volonté de définir, d'ici à la fin de l'année, les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la pérennité de ce régime, dont l'objectif est, rappelons le, de garantir le même niveau de retraite aux enseignants du privé qu'à leurs collègues du public. Je crois qu'il faut que nous restions attentifs à ce dossier.
Sous le bénéfice de ces observations, notre collègue Thierry Foucaud, comme je l'ai fait à l'instant, vous propose de donner un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission « Enseignement scolaire » pour 2013.

Je ne vois pas ce qui vous permet de parler d'échec de la politique éducative du précédent Gouvernement et d'approuver ce projet de budget car il s'agit de la même politique. Les dépenses de personnel représentent déjà l'essentiel des crédits de la mission. Faut-il vraiment aller plus loin en créant des postes supplémentaires ? La situation globale de notre système éducatif s'aggrave, comme le montre le taux de maitrise du français et des mathématiques en fin d'école primaire. Je ne vois pas en quoi vous changez quoi que ce soit à cette situation. Chaque année, 150 000 jeunes sortent du système scolaire sans diplôme ; ils deviennent des chômeurs, voire des délinquants. Je crois qu'il faut remettre en cause le collège unique, en distinguant collège à vocation diplômante, destiné à ceux qui poursuivront leurs études, et collège à vocation professionnelle. Car il est évident que le collège unique ne forme pas aux métiers actuels. Il faut également en finir avec le mythe du baccalauréat pour tous. A quoi sert le baccalauréat si les jeunes ne disposent pas d'une véritable formation à leur sortie du système scolaire ?

Je trouve bienvenue la création d'emplois d'assistants de vie scolaire pour l'accompagnement des élèves handicapés. Quelles sont les mesures permettant de sortir de l'impasse que constitue le taux élevé d'absence de maîtrise du français et des mathématiques à l'issue de l'école primaire ? Pensez-vous qu'il faille davantage proposer le redoublement des élèves en difficulté ? S'agissant des emplois, quel est le nombre d'enseignants qui n'enseignent pas, par exemple parce qu'ils bénéficient d'une décharge syndicale ?

Je m'interroge sur la modification de l'organisation du temps scolaire. Ce n'est pas une nouveauté car, il y a quelques années, la semaine a été raccourcie. Les communes ont dû trouver des solutions à cette décision prise sans concertation, notamment pour résorber les surnombres. La question des transports scolaires va nécessairement se poser, comme l'a souligné notre rapporteur spécial. Je crois donc qu'il convient de mettre en oeuvre une véritable concertation avec les collectivités territoriales, voire d'envisager les modalités d'une compensation des surcoûts qu'elles devront sans doute supporter.

Je m'inquiète également des incidences financières de la réforme des rythmes scolaires pour les collectivités territoriales. Dans quelques mois, nous aurons à en supporter les effets. Y a-t-il eu une véritable analyse financière de l'impact prévisionnel des mesures annoncées et probablement déjà prises en réalité, au moment où nos collectivités vont décider de leur budget pour l'année prochaine et se trouvent déjà dans une situation difficile ? L'Etat va-t-il se reposer entièrement sur les collectivités territoriales ? Je souhaiterais, par ailleurs, appeler votre attention sur la situation des enseignants titulaires sans affectation et qui sont, par conséquent, payés tout en restant chez eux. Existe-t-il des statistiques à ce sujet, au moment où le Gouvernement procède à de nouvelles embauches ?

Mon propos s'inscrit dans le prolongement des remarques des deux orateurs qui m'ont précédé. Je m'interroge sur les conclusions qui pourraient être tirées des réflexions en cours sur les rythmes scolaires, notamment en termes financiers. D'autant que la nouvelle organisation du temps scolaire entrera en vigueur dès la rentrée 2013 et que, dans le cadre de la programmation pluriannuelle des finances publiques, les dotations de l'Etat aux collectivités territoriales sont appelées à diminuer à compter de 2014. Tout ceci va créer un effet de ciseaux. Enfin, comment s'expliquent les différences entre l'évolution des dépenses de personnel dans l'enseignement public et dans l'enseignement privé ?

Je m'associe aux remarques qui viennent d'être formulées sur les déséquilibres que vont engendrer les nouvelles charges imposées aux collectivités territoriales, qui ont déjà eu à supporter l'impact financier des contributions mises à leur charge pour assurer l'équilibre du CNFPT et de la CNRACL. Je formulerai une suggestion : faire figurer en début de rapport une synthèse sur l'évolution du nombre d'élèves ainsi que du nombre de classes par niveau. Tout cela reste assez confus. Disposer de telles données permettrait de mieux évaluer la nécessité de créer ou de supprimer des emplois d'enseignants. S'agissant des comparaisons internationales menées à bien par l'OCDE, j'avais noté l'année dernière que la France fournissait un effort financier important pour l'éducation mais que le nombre d'élèves par classe était élevé. J'en avais tiré la conclusion que les moyens n'étaient pas forcément mis au service direct de l'enseignement mais affectés à d'autres tâches. Cela confirme la nécessité de statistiques précises sur les affectations des personnels rémunérés par le ministère de l'éducation nationale. Je m'inquiète par ailleurs de la baisse du taux de scolarisation des 15-19 ans, mise en lumière par l'OCDE.

Je souhaiterais formuler deux observations. La fonction de production de l'éducation n'a pas varié depuis plusieurs décennies. On en reste toujours à plus de personnel, alors que la pédagogie devrait évoluer, à l'image des technologies. Tout se passe comme si on n'avait pas inventé l'ordinateur. Des pédagogies différentes existent. A l'université, les étudiants rendent souvent leurs devoirs imprimés. Cela commence à se faire en terminale et ce sera la règle dans dix ans. Pourquoi ne pas prélever une petite partie du facteur travail en faveur du capital, pourquoi ne pas utiliser davantage les possibilités de l'informatique dans l'éducation nationale ? Ma seconde observation découle des conclusions du rapport Gallois. L'inadaptabilité des formations professionnelles aux besoins de l'industrie n'est pas nouvelle. On a recruté des enseignants dans des filières très pointues qui se sont révélées obsolètes. Dans l'enseignement technique, il reste encore des professeurs de couture recrutés il y a trente ans. Il faut s'interroger sur les capacités des enseignants à s'adapter aux évolutions des techniques, notamment dans l'enseignement professionnel.

Je suis frappée de la façon dont certains d'entre nous abordent la question de l'évolution des rythmes scolaires. J'ai en mémoire les conditions dans lesquelles Xavier Darcos a procédé unilatéralement à une modification en profondeur de l'organisation de la semaine dans le premier degré. Je n'ai pas le souvenir que cette décision ait soulevé autant d'interrogations qu'aujourd'hui. En outre, il ne faut pas perdre de vue que l'accueil des enfants en dehors du temps scolaire n'incombe pas aux seules communes. Beaucoup de familles trouvent une nouvelle organisation. La vie scolaire est avant tout faite pour répondre aux besoins des élèves. S'agissant de l'accompagnement des élèves handicapés, les créations d'emplois sont une bonne chose mais je crois qu'on ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion d'ensemble sur la formation des auxiliaires de vie scolaire. On ne peut tout faire reposer sur leur bonne volonté. N'oublions pas que la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a eu pour objectif d'améliorer les conditions de la scolarisation des élèves handicapés. Prenons garde à ce que, dans quelques années, les parents qui ont été encouragés à scolariser leurs enfants en milieu ordinaire nous reprochent l'inadéquation des personnels d'accompagnement aux tâches qui leur ont été confiées, faute d'une formation adéquate.

Les effectifs recensés par le ministère de l'éducation nationale ne comprennent pas les personnels qui sont directement employés par les établissements publics locaux d'enseignement que sont les collèges et les lycées. Dispose-t-on de données précises à ce sujet ? Deuxième observation, je m'interroge une nouvelle fois sur la difficulté à assurer la coordination entre le ministère de l'éducation nationale et celui de l'agriculture. Pourquoi les personnels qui s'occupent de l'enseignement technique agricole ne sont-ils pas détachés auprès du ministère de l'éducation nationale, plutôt que de dépendre de celui de l'agriculture, afin d'assurer le caractère véritablement interministériel de la mission ? Sur le plan pédagogique, où en est la scolarisation à deux ans ? Peut-on véritablement parler de projet éducatif à cet âge ? Quelle serait l'incidence financière d'une éventuelle généralisation de l'accueil des enfants de deux ans ?

Comme beaucoup d'entre nous, je suis sensible au coût engendré par l'évolution à venir des rythmes scolaires pour les départements. A-t-on une idée de ce qu'il représente globalement, au niveau national ?

Je suis très attaché à l'école. Malheureusement, je ne suis pas sûr que la situation évolue aussi favorablement que ce qui est indiqué dans la note de présentation. Aussi, je m'abstiendrai lors du vote des crédits de la mission.

Je m'inquiète de l'accroissement du nombre de jeunes déscolarisés de manière de plus en plus précoce. Dispose-t-on de données précises sur ce phénomène ?
Je constate que les questions sont nombreuses. S'agissant du décrochage scolaire, question posée par nos collègues Serge Dassault et François Fortassin, le ministre entend faire de l'enseignement primaire une priorité. Former les enfants dès le plus jeune âge est essentiel. La loi d'orientation qui sera prochainement soumise au Parlement permettra de préciser les choses. Ce sera également l'occasion de s'interroger sur la place du collège au sein de notre système éducatif.
La modification à venir des rythmes scolaires est un sujet qui préoccupe beaucoup d'entre nous. A ma connaissance, il n'existe pas de chiffrage précis de l'incidence financière du passage de quatre jours à quatre jours et demi pour les collectivités territoriales. Je n'ai pas, non plus, entendu le ministre parler de compensation. L'assemblée des départements de France doit se saisir de la question, surtout dans le contexte de réduction des dotations de l'Etat.
Pour répondre à la question de Roland du Luart, il ne me semble pas que les redoublements constituent en soi une réponse aux lacunes des élèves en fin de premier degré. C'est plutôt par une détection précoce des difficultés qu'il faut agir.
S'agissant des enseignants qui ne sont pas affectés devant une classe, les crédits aux associations s'élèvent à 48,8 millions d'euros en autorisations d'engagement et à 66,1 millions d'euros en crédits de paiement. En revanche, je ne dispose pas d'information particulière sur le nombre de personnes concernées.

La plupart des postes mis à disposition ont été supprimés il y a deux ans. Il est donc impossible de connaître le chiffre des personnes qui travaillent au sein d'associations ou autres organismes.

Notre collègue Dominique de Legge s'est inquiété de la différence de traitement éventuelle entre enseignement public et enseignement privé. Il est vrai que le nombre de personnes rémunérées dans le privé diminue légèrement. C'est l'effet, en année pleine, des mesures de suppression qui avaient été décidées par le précédent Gouvernement. Dès lors, les crédits ne progressent pas, malgré les créations d'emplois, qui bénéficient aussi à l'enseignement privé.
Notre collègue Joël Bourdin s'est interrogé sur l'utilisation des nouvelles technologies dans l'enseignement. A ce sujet, un crédit de dix millions d'euros, première étape d'un plan en faveur du numérique, est inscrit au budget.
Je partage la préoccupation exprimée par notre collègue Michèle André quant aux conditions de scolarisation des élèves handicapés. J'y consacre un point particulier dans mon rapport écrit et j'ai déjà eu l'occasion d'appeler l'attention du ministre au sujet de la formation des personnels d'accompagnement.
Le nombre d'assistants éducatifs au sein des établissements publics locaux d'enseignement est stable depuis quatre ans. Il s'élève à 84 000 personnes.
L'articulation entre le ministère de l'éducation nationale et celui de l'agriculture est une question récurrente. L'enseignement technique agricole présente des spécificités, qui tiennent notamment à la place de l'enseignement privé ainsi qu'à l'enseignement dit du rythme approprié.
Enfin, la scolarisation des enfants à deux ans pourra être abordée lors des débats sur la loi d'orientation.

J'en viens maintenant au vote sur les crédits de la mission. Vos rapporteurs spéciaux proposent l'adoption des crédits.

Le groupe CRC votera les crédits de la mission, compte tenu de l'inflexion nette qu'elle marque, tout en souhaitant qu'elle puisse se généraliser aux autres missions du budget.
A l'issue de ce débat, la commission décide de proposer au Sénat l'adoption, sans modification, des crédits de la mission « Enseignement scolaire ».
La commission procède ensuite à l'examen du rapport de MM. Richard Yung et Roland du Luart, rapporteurs spéciaux, sur la mission « Action extérieure de l'Etat ».

Comme pour la plupart des autres missions, l'exercice 2013 est marqué par la nécessité de maîtriser la dépense publique pour la mission « Action extérieure de l'Etat » même si, nous le verrons, les programmes connaissent une évolution contrastée.
Tout d'abord, un mot sur la maquette, qui n'évolue que sur un point : la suppression, logique et annoncée, du programme 332 « Présidence française du G 20 et du G 8 », qui n'a plus de raison d'être.
Pour en venir aux crédits, les montants demandés pour la mission dans le projet de loi de finances pour 2013 s'élèvent à 2,961 milliards d'euros en autorisations d'engagement (AE) et à 2,970 milliards d'euros en crédits de paiement (CP). A structure constante, ces crédits affichent une augmentation de 2,1 % en AE et de 1,6 % en CP par rapport à la loi de finances initiale pour 2012, avec de fortes nuances selon les programmes, comme nous le verrons.
Le plafond d'emplois demandés en 2013 pour la mission s'élève à 12 531 équivalent temps plein travaillés (ETPT), en diminution de 49 ETPT hors transferts comparé à 2012.
Je dois préciser que le ministère des affaires étrangères (MAE) raisonne toujours, pour ce qui concerne les ressources humaines, sur l'ensemble de son périmètre, les agents pouvant bouger d'un programme à l'autre. Ils ajoutent donc aux agents de la mission « Action extérieure de l'Etat » ceux du programme 209 « Solidarité à l'égard des pays en développement » de la mission « Aide publique au développement ». En prenant ainsi en compte la totalité du ministère, le nombre d'emplois demandés s'élève à 14 798 ETPT, soit une diminution de 163 ETPT hors transferts par rapport à l'année dernière. L'essentiel des efforts de l'année portera justement sur l'évolution du réseau culturel et de coopération.
Malgré ces baisses d'emplois, la masse salariale devrait augmenter de manière significative en 2013 (+ 5,1 %), en raison, d'une part, des facteurs de variation des rémunérations propres aux agents localisés à l'étranger et, d'autre part, de l'augmentation de la contribution au compte d'affectation spéciale (CAS) pensions (+ 7 %).
Il est à noter que, selon le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, en cours d'examen par le Parlement, les sommes consacrées à la mission devraient légèrement diminuer en 2014 puis se stabiliser en 2015. En termes d'effectifs, il est prévu une diminution de 600 emplois entre 2013 et 2015.
Venons-en au programme 185 « Diplomatie culturelle et d'influence ».
Ce programme regroupe 747,6 millions d'euros d'AE et de CP, soit 25,2 % des crédits de paiement de la mission. A périmètre constant, ces crédits affichent une diminution de 0,8 % par rapport à 2012.
D'un côté, certains domaines considérés comme prioritaires ont été préservés sur le plan budgétaire. Outre l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), dont je parlerai plus tard, tel a été le cas des bourses de mobilité des étudiants étrangers en France dont la dotation est en augmentation de 1,2 % et des échanges d'expertise et échanges scientifiques.
D'un autre côté, des lignes budgétaires ont été réduites conformément à la nécessité de maîtriser les dépenses publiques. Cela se vérifie pour :
- l'animation du réseau, en baisse de 6,4 % ;
- les dotations de fonctionnement aux établissements à autonomie financière (EAF, - 4 %), ce qui correspond à une diminution de 7 % du budget de fonctionnement et de 2,5 % de la masse salariale ;
- les dotations pour opérations des EAF et les subventions aux alliances françaises, invitées à augmenter leur autofinancement (- 7 %) ;
- l'Institut français, auquel la même norme de - 7 % a été appliquée et qui est incité à développer les cofinancements d'opérations.
S'agissant de l'AEFE, je salue, dans un tel contexte, le supplément de dotation de 5,5 millions d'euros qui lui est accordé - ce qui portera sa subvention à 425 millions d'euros. Je tiens cependant à souligner que le coût de la part patronale de la pension civile devrait augmenter de 13 millions d'euros par rapport à 2012. L'agence devra donc de nouveau augmenter ses ressources propres pour faire face à ses charges. D'autre part, je relève que le système mis en place en 2012 pour que l'AEFE puisse financer son développement immobilier à l'étranger malgré l'interdiction qui lui est faite de s'endetter au-delà de douze mois sera reconduit en 2013 : l'AEFE pourra donc de nouveau bénéficier d'avances de France Trésor pour un montant de l'ordre de 12,5 millions d'euros.
Pour le reste, soulignons qu'en 2013 devrait sonner l'heure du bilan de l'expérimentation du rattachement du réseau culturel à l'Institut français, testé dans douze pays. Nous verrons quelles en seront les conclusions, mais je serais assez étonné qu'une généralisation de ce rattachement soit prônée...
Enfin, la mise en place assez laborieuse de Campus France, établissement public en charge de l'attractivité de l'enseignement supérieur français à l'étranger, touche à sa fin. Sa « mise en place effective » est intervenue le 1er mai 2012 avec la dissolution de deux de ses composantes, le GIP CampusFrance le 28 avril 2012 et l'association Egide le 1er mai suivant. Quant au transfert des bourses gérées par le centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS), dont la « résistance » explique largement le retard pris, il a eu lieu le 1er septembre, début de l'année universitaire.
Pour ce qui concerne le programme 151 « Français à l'étranger et affaires consulaires », il regroupe 357 millions d'euros d'AE et de CP, soit 12 % de l'ensemble des crédits de paiement de la mission. Ces crédits diminuent de 3 % à périmètre constant.
Cette évolution s'explique par deux raisons :
- d'une part, le fait qu'en 2013 ne se répéteront pas les élections nationales de 2012, notamment les premières élections législatives auxquels les Français établis hors de France étaient invités à participer. Il en résulte une économie de 8,5 millions d'euros ;
- d'autre part, la suppression de la prise en charge des frais de scolarité des lycéens français scolarisés dans des lycées français de l'étranger (PEC) par l'article 42 de la loi de finances rectificative de l'été dernier et effective depuis la rentrée.
Selon un tout premier bilan dressé par notre ancienne collègue Hélène Conway-Mouret, aujourd'hui ministre déléguée chargée des Français de l'étranger, seuls 9 % des élèves qui bénéficiaient auparavant de la PEC ont déposé un dossier pour l'obtention d'une bourse, soit un « effet d'aubaine » d'au moins 91 % pour une dépense qui dépassait 30 millions d'euros.
Mais je serai évidemment très attentif à la suite, c'est-à-dire à la réforme du système de bourses de scolarité sur critères sociaux au bénéfice des élèves français scolarisés à l'étranger. Selon les éléments transmis par le Gouvernement, la dotation des bourses devrait ainsi passer de 93,6 millions d'euros en 2012 à 125,5 millions d'euros en 2015, soit le montant total auparavant dévolu aux bourses et à la PEC.
Les négociations doivent s'engager prochainement afin de réviser les critères d'attribution des bourses et les quotités et il est évidemment naturel que le Parlement s'y intéresse de près.
Un mot sur la Caisse des Français de l'étranger (CFE) pour ce qui concerne la prise en charge de la « troisième catégorie » de cotisation maladie-maternité à la CFE, accessible aux Français dont les ressources n'excèdent pas 50 % du plafond de la sécurité sociale, catégorie bénéficiant d'une aide à l'inscription : pour une charge totale de 2,5 millions d'euros, l'Etat ne prenait à son compte que 500 000 euros, laissant la CFE assumer les 2 millions d'euros restants. Le même partage est prévu pour 2013. Cependant, d'après les éléments que j'ai obtenus sur l'évolution du fonds de roulement de la CFE, elle apparaît en mesure d'assumer sans dommage cette dépense.
Enfin, en 2013, vingt-cinq postes d'agents devraient être créés dans l'activité « visas » qui contribue, par l'accueil de visiteurs étrangers sur le sol de notre pays, à l'activité du secteur touristique national. Il s'agit d'une activité lucrative pour l'Etat. Ainsi, en 2011, les visas ont engendré 116,4 millions d'euros de recettes pour le budget de l'État. Une fois déduite la masse salariale, l'activité a généré une « marge bénéficiaire » de 77,9 millions d'euros.
A l'issue de cet examen, et avant que Roland du Luart n'évoque le programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde », je vous propose d'adopter les crédits de la mission « Action extérieure de l'Etat », modifiés par un amendement que je vous présenterai plus tard, en conclusion de mes travaux de contrôle sur les « ambassadeurs thématiques ».
Je vous remercie de votre attention.

Le programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » regroupe 1 856,6 millions d'AE et 1 865,7 millions d'euros de CP, soit 62,8 % de l'ensemble des crédits de paiement de la mission. Ces sommes servent à rémunérer l'état-major et les principaux services centraux du ministère. Y figurent aussi le personnel et les moyens de fonctionnement du réseau diplomatique.
A périmètre constant, les crédits du programme augmentent de 4,3 % en AE et de 4,7 % en CP par rapport à 2012. Cette nette augmentation des crédits du programme résulte de l'évolution de deux types de dépenses :
- d'une part, les dépenses de personnel (+ 32,6 millions d'euros), malgré une légère baisse des effectifs prévue en 2013 et pour les raisons qu'a exposées Richard Yung sur les facteurs de hausse spécifiques des rémunérations à l'étranger et sur les charges de pension ;
- d'autre part, les contributions financières de la France aux organisations internationales (+ 42,6 millions d'euros). A cet égard, je vous rappelle que ce programme porte les contributions obligatoires de la France aux principales organisations dont elle est membre. Par définition, ces dépenses sont peu modulables et sont, de surcroît, très sensibles aux variations de change, plus des trois quarts des contributions en valeur étant libellés en devises étrangères. La hausse budgétée pour 2013 tient d'ailleurs très largement au choix de retenir, pour 2013, un cours moyen de 1,32 dollar pour un euro (contre 1,40 dollar en 2012). Du point de vue du MAE, il s'agit donc de charges subies, dont il convient de rappeler l'importance budgétaire (plus de 70 % des crédits du programme hors dépenses de personnel). Je n'ai guère de commentaire à formuler sur ce plan, sauf pour me féliciter qu'après plusieurs exercices de sous-budgétisation manifeste au cours de la décennie précédente, d'ailleurs régulièrement dénoncées par notre ancien collègue Adrien Gouteyron, les crédits demandés apparaissent sincères depuis quelques années.
Pour le reste, un effort particulier a été fait sur une seule catégorie de charges : celles relatives à la sécurisation des postes à l'étranger, qui passent, en CP, de 10 millions à 16 millions d'euros. Selon le MAE, cela permettra de poursuivre et d'accélérer le plan de sécurisation dans un contexte sécuritaire dégradé, en particulier au Maghreb et au Sahel - même si, à mes yeux, il faudrait faire davantage encore...
Les autres lignes s'inscrivent logiquement dans le cadre de la maîtrise des dépenses publiques, mais cela ne suffit pas à compenser le dynamisme des charges de personnel et des contributions aux organisations internationales.
J'en arrive aux dépenses immobilières du ministère, auxquelles j'ai consacré mes travaux de contrôle de cette année. Les principaux problèmes qui se posent sont de deux ordres : l'achèvement du regroupement des services centraux autour de trois sites (le Quai d'Orsay stricto sensu, la rue de la Convention et La Courneuve), qui pâtit d'un problème de financement, et les modalités de règlement des dépenses de rénovation et d'entretien lourd des immeubles situés à l'étranger.
S'agissant du projet de regroupement des services du ministère conduits depuis 2006, la vente d'un bâtiment situé boulevard Saint Germain devait dégager un produit de cession de 69 millions d'euros pour le MAE, que devait lui verser le nouvel occupant de l'immeuble, en l'occurrence le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Ce dernier devait lui-même récupérer cette somme de la cession de l'ensemble immobilier Ségur-Fontenoy, dont il était l'utilisateur principal au sens domanial. Or, la décision prise par le Cabinet du Premier ministre en février 2011 d'implanter un centre de gouvernement sur le site de Ségur a privé le ministère de l'écologie de la ressource de cession espérée, et aucun dédommagement n'a été envisagé. Le ministère de l'écologie n'a donc pu régler les 69 millions d'euros escomptés au ministère des affaires étrangères, qui a fait office de « variable d'ajustement » ultime de ces opérations.
La situation n'ayant pas évolué à ce jour, le MAE n'a pu utiliser cette somme pour le financement de son projet de regroupement, ce qui demeure encore aujourd'hui très pénalisant. Il faudrait vraiment que ce dossier puisse se débloquer rapidement car il est choquant que l'ancien local des archives du ministère, c'est-à-dire 2 000 m2 en plein VIIème arrondissement de Paris, reste vacant faute de moyens pour achever l'aménagement. J'ai entendu dire que l'Assemblée nationale serait intéressée par une reprise au moins partielle de ces locaux. Il s'agira de savoir dans quelles conditions et à quel prix une telle affaire pourrait se conclure, le MAE ne devant pas toujours être « le dindon de la farce ».
S'agissant des dépenses d'entretien lourd des immeubles situés à l'étranger, le problème ne tient pas à l'absence de fonds, mais plutôt au circuit de financement. Celui-ci est atypique puisque, aujourd'hui encore, le ministère utilise à cet effet, de manière dérogatoire, le compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat », alimenté par les produits de ses propres cessions.
Cette situation vient de l'histoire budgétaire récente : en avril 2006, le contrat triennal de modernisation du ministère a comporté une clause par laquelle le MAE devait renoncer à terme aux crédits budgétaires finançant les dépenses liées à son parc à l'étranger en échange du maintien d'un retour intégral au « Quai d'Orsay » du produit des cessions de ses immeubles situés à l'étranger (effectif depuis 2003). L'objet était bien d'inciter le ministère à une gestion optimisée et dynamique de son parc, dont il pourrait ensuite profiter pleinement en termes de crédits. De plus, du point de vue du ministère chargé du budget, ces modalités permettaient la mise en place d'une procédure dans laquelle les dépenses immobilières du MAE étaient bien contrôlées.
La situation a perduré après la création, par la loi de finances pour 2009, du programme 309 « Entretien des bâtiments de l'Etat ». En effet, cette création est intervenue à un moment où le MAE ne disposait déjà presque plus, sur le programme 105, d'aucun crédit dévolu à l'entretien lourd de son parc à l'étranger du fait de l'accord de 2006. Ce ministère n'a donc pas été en mesure d'abonder le programme 309 à hauteur de 20 % des loyers budgétaires, comme il aurait dû le faire. Il est d'ailleurs à noter que cette dépense représenterait actuellement un prélèvement de près de 14 millions d'euros sur le programme 105, le montant réel des dépenses d'entretien lourd du ministère étant compris, quant à lui, entre 10 et 12 millions d'euros.
C'est cet état de fait qui a conduit le MAE à négocier avec France Domaine la possibilité (dérogatoire) d'utiliser une fraction modique des recettes de cession pour l'entretien lourd de ses immeubles sis hors de France, faculté qu'il a obtenue.
Ce mode de financement a plusieurs conséquences. D'une part, une assez grande lourdeur d'utilisation, que vous trouverez décrites en annexe de la note de présentation (même si le fonctionnement a été assoupli, en 2011, pour les dépenses d'un montant inférieur à 5 millions d'euros). D'autre part et surtout, une incertitude pour le MAE quant aux sommes dont il va réellement disposer pour des travaux qui gagneraient à être réguliers et planifiés afin d'être optimisés.
Tout va bien quand, après une année de cession exceptionnelle telle que 2011, le CAS est bien alimenté. Mais, en la matière, les années se suivent et ne se ressemblent pas. Un circuit qui marche bien quand il s'agit de financer des acquisitions par des cessions devient handicapant quand il s'agit de régler les « charges du propriétaire ».
Surtout, ce système ne saurait durer très longtemps. En effet, d'ici quelques années, les grandes opérations auront été réalisées. Le nombre d'immeubles importants que la France possède à l'étranger et qu'il serait opportun de vendre n'est pas infini. De plus, à la fin de 2014, l'exception des immeubles domaniaux sis à l'étranger doit prendre fin. A compter de 2015, si la loi ne change pas, au moins 30 % du produit des cessions devra contribuer au désendettement. Cela risque de rendre le financement des dépenses de rénovation relativement aléatoire.
C'est pourquoi il est heureux que, depuis 2012, le programme 105 comporte une ligne de rebudgétisation (très partielle) de ces dépenses. Le montant de ces crédits était alors de 2,5 millions d'euros. Cette ligne budgétaire a été reconduite dans le présent projet de loi de finances, pour un montant encore inférieur (2,3 millions d'euros). En revanche, il est inquiétant de constater qu'à ce jour, aucun rebasage n'a été effectué au titre de ces charges pour 2015 dans le cadre du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, en cours d'examen par le Parlement.
Or les économies en la matière ne sauraient être qu'illusoires, le caractère fonctionnel et la valeur de biens non entretenus correctement ne pouvant que décroître. Je tiens donc, en conclusion, à réaffirmer l'importance d'un financement adéquat et prévisible de ce type de travaux.
Un dernier mot avant de conclure pour évoquer brièvement l'opération immobilière en cours à Madrid, où je me suis rendu le mois dernier : il s'agit de céder l'actuelle chancellerie et d'en construire une autre dans le parc de la résidence - projet déjà envisagé du temps où Jean-François Deniau était ambassadeur en Espagne ! Ce dossier est l'un des deux pour lesquels une mission a été confiée, à titre expérimental, à la SOVAFIM en matière d'assistance relatif à deux dossiers de cessions à l'étranger.
Le principe de construction d'une nouvelle ambassade sur la pointe du terrain de la résidence a été validé en octobre 2011. Cependant, alors que l'opération suivait son cours, le dossier a été retardé après que le service de sécurité diplomatique et de défense du MAE eut tardivement mis en exergue, au printemps 2012, les risques inhérents à la localisation choisie.
Ce veto a conduit à reprendre les plans et à modifier très substantiellement le projet, la nouvelle chancellerie devant désormais absorber l'actuelle résidence du numéro deux de l'ambassade (elle aussi située dans le parc de la résidence). Selon les informations que m'a transmises la SOVAFIM, une fois le nouveau projet validé dans son principe par l'ensemble des parties prenantes, l'établissement des plans devrait prendre deux mois et l'obtention des autorisations d'urbanisme environ neuf mois (avec certaines marges d'incertitude).
J'insiste sur la nécessité de ne pas laisser s'enliser une telle opération et espère que le récent changement d'ambassadeur ne causera pas de nouveau retard. En effet, malgré la mauvaise conjoncture économique en Espagne, la cession de l'actuelle chancellerie devrait dégager un produit très supérieur aux coût de construction d'une nouvelle ambassade, laquelle devrait, être, par ailleurs, beaucoup plus fonctionnelle.
En conclusion, à l'issue de cet examen, je ne m'opposerai pas à l'adoption des crédits de la mission « Action extérieure de l'Etat ».
Présidence de M. Philippe Marini, Président

De manière générale, le MAE a toujours été pénalisé d'un point de vue financier. Il est à craindre qu'à la longue, cela aboutisse à installer un sentiment de fatalité et une démotivation parmi les personnels du ministère. Je veux insister sur l'ampleur des coupes au sein du programme 185, dont a déjà parlé Richard Yung : - 6,4 % sur le soutien au réseau culturel, ou encore - 5,6 % sur la coopération culturelle et la promotion du français. Ces deux postes de dépenses sont les plus touchés par l'effort financier demandé au programme 185.
Par ailleurs, je voudrais aborder trois points.
Pour ce qui concerne l'Institut français, le rattachement du réseau à l'établissement public ne constitue plus la pierre angulaire de la réforme d'il y a deux ans. Un renoncement du fait de la résistance des ambassadeurs constituerait un « détricotage » particulièrement néfaste de la loi du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat.
A propos de l'AEFE, j'insiste sur la nécessité de la réforme du système de bourses scolaires après la suppression de la PEC. Le nouveau système devra, certes, améliorer l'équité mais il ne devra pas servir à faire des économies.
Enfin, la francophonie semble, hélas, rester une variable d'ajustement budgétaire. La programmation n'est pas encourageante et affiche une diminution de 11 % d'ici à 2014 des crédits qui lui sont dédiés au sein du programme 185.

Pour en revenir à l'immobilier, je partage l'étonnement du rapporteur spécial relatif au financement de dépenses récurrentes par les cessions. Certes, en 2011, il y a eu des ventes exceptionnelles, comme à Hong-Kong. Mais cela ne se répétera pas pendant des années.
Je soutiens également l'analyse de Roland du Luart sur l'immeuble des archives du ministère, vacant depuis deux ans et demi, alors que le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie envisage de louer un immeuble très cher à La Défense ! Il faut sortir de cette situation de blocage !

Je m'interroge sur le rôle des consuls honoraires, notamment en matière de « diplomatie économique » - concept qui m'interpelle d'ailleurs.
Ainsi, à Jersey, notre consul honoraire n'est autre que le responsable de l'antenne locale d'une grande banque française. N'y a-t-il pas là de risque de conflit d'intérêts ? Bien que le sujet ne soit pas budgétaire, les rapporteurs spéciaux peuvent-ils apporter un éclairage sur cette question ?

Au sujet des bourses, dont a parlé Louis Duvernois, je voudrais d'abord rappeler que, dans l'ancien système, la PEC et les bourses s'autoalimentaient, la PEC étant un facteur d'augmentation des frais d'écolage, augmentation qui suscitait la hausse du nombre de demandes de bourses ainsi que de leur montant. Dans le nouveau cadre, les frais d'écolage devraient être mieux maîtrisés.
S'agissant des consuls honoraires, c'est un « vrai sujet ». Nous avons besoin de telles personnes, les consuls honoraires permettant de pallier l'étiolement de notre réseau consulaire. Eric Bocquet évoque la « diplomatie économique ». Il est vrai que la capacité d'une personne à disposer d'un bureau, d'un secrétariat et d'un réseau - et de les mettre à la disposition de la France - est un facteur important dans la désignation des consuls honoraires. J'ai des exemples en tête de tels consuls au profil étonnant, notamment en Inde...

Je suis d'accord avec les propos de Richard Yung. Nous pourrions demander au MAE où en est le projet de révision du décret du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires.
A Albéric de Montgolfier, je répète qu'à mes yeux, le ministère des affaires étrangères s'est fait « rouler dans la farine » lors de la « cession » de son immeuble du boulevard Saint-Germain. Il en résulte cette vacance de 2 000 m2 rue de l'Université qu'il n'a de toute façon pas les moyens financiers d'aménager. Je suis assez réservé quant au projet que l'on prête à l'Assemblée nationale. En tout état de cause, le MAE devrait, le cas échéant, recevoir cette fois une juste indemnité.
De manière générale, ce ministère a vu ses moyens rognés depuis des années et est à présent « à l'os ». Si l'on souhaite aller plus loin, c'est l'universalité du réseau qu'il faudra remettre en cause.

Le rapporteur spécial ne saurait quand même pas considérer qu'un « bon budget » est un budget qui augmente...

Non. Disons que ce budget est sincère et qu'il a été bien négocié par son ministre.

La discussion générale est close. Je donne à présent la parole à Richard Yung pour qu'il nous présente son amendement.

Merci, Monsieur le président.
Cet amendement de réduction de crédits du programme 105, modeste dans son ampleur, vise avant tout à envoyer un « message » au MAE à propos des ambassadeurs thématiques, thème sur lequel j'ai fait porter mes travaux de contrôle à la suite de quelques débats en séance publique. Le Sénat a même déjà adopté un amendement de Nathalie Goulet lors de l'examen du collectif budgétaire de l'été dernier, réduisant de 13 millions d'euros les crédits du programme, somme qu'était censée gager la suppression de ces ambassadeurs.
Que m'ont appris ces travaux de contrôle ?
Tout d'abord, que la situation de ces ambassadeurs est très diverse. Le tableau annexé à la note de présentation le montre bien. Cette diversité est statutaire : seize ambassadeurs sur vingt-huit sont des agents du Quai d'Orsay, le profil des autres titulaires variant entre la politique, d'autres administrations et des fonctions du secteur privé.
Cette diversité se constate aussi en détaillant les dossiers dont s'occupent les intéressés : une douzaine d'ambassadeurs ont des fonctions liées à une zone géographique, avec des problématiques parfois proches de celles des ambassadeurs classiques ; d'autres se voient confier un dossier thématique véritablement transversal ; certains profils enfin, correspondent à un poste de direction d'un service central du ministère - le titre d'ambassadeur venant alors comme un simple élément de valorisation. Tel est notamment le cas des ambassadeurs chargé de l'adoption internationale, ou encore chargé de la mobilité externe des cadres du MAE - qui n'est d'ailleurs curieusement pas le chef du service correspondant...
Ces travaux m'ont aussi appris - ce qui est un peu « frustrant » - que les ambassadeurs thématiques ne constituent pas un enjeu budgétaire : la somme totale engagée en 2011 par la mission « Action extérieure de l'Etat » pour l'ensemble des vingt-huit postes du tableau précédent n'atteignait pas 725 000 euros (répartis entre les 3 programmes de la mission, ainsi que sur le programme 209 de la mission « Aide publique au développement »).
Pour autant, il me semble que l'exécutif prend régulièrement quelque liberté sur le sujet. Ainsi, près de la moitié des ambassadeurs thématiques actuellement en poste n'ont pas été nommés en Conseil des ministres, comme le prescrit pourtant l'article 13 de la Constitution, mais par une simple note de service.
Au total, il me paraît donc sain que le Parlement manifeste sa vigilance sur la question et demande au Quai d'Orsay - qui paraît réticent - de « faire le ménage » au travers de l'adoption d'un amendement de réduction de crédits justement calibré.
Tel est le sens de l'amendement que je vous propose.
A l'issue de ce débat, la commission adopte l'amendement proposé par le rapporteur spécial puis décide de proposer au Sénat l'adoption des crédits de la mission « Action extérieure de l'Etat » ainsi modifiés.
La commission procède enfin à l'examen du rapport de M. Eric Bocquet, rapporteur spécial, sur la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » (et articles 70, 70 bis et 70 ter).

La mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » constitue l'un des piliers de la politique sociale portée par l'État. Elle en est un pilier en termes de publics soutenus, puisqu'elle s'adresse, entre autres, aux travailleurs pauvres, aux personnes handicapées, aux personnes sous tutelle, etc. Elle en est un pilier en termes budgétaires également, puisqu'elle rassemble environ 13,4 milliards d'euros de crédits. Elle en est, enfin, un pilier du point de vue du soutien administratif, puisqu'elle porte, au titre du programme n° 124, les crédits de l'administration support de la plupart des politiques sociales, notamment de la cohésion sociale, de la jeunesse et de la vie associative, de la ville, mais aussi du fonctionnement des ARS.
D'une façon générale, les crédits sont en augmentation par rapport à 2012, de l'ordre de 5,6 %. Cependant, cette évolution générale est contrastée entre les programmes. En réalité, la hausse résulte principalement du dynamisme de la dépense de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), qui représente à elle seule une majoration de 600 millions d'euros entre 2012 et 2013. D'autres actions, en revanche, voit leurs crédits diminuer : il s'agit en particulier du programme n° 304, car la progression des recettes fiscales affectées au Fonds national des solidarités actives (FNSA) permet une baisse corrélative de la subvention d'équilibre de l'État. Cette tendance à la hausse est prise en compte dans le cadre de la programmation triennale 2013-2015, dont le plafond de crédits s'établit à 13,74 milliards d'euros pour 2015. Sans rouvrir le débat à ce sujet, je tiens à souligner le peu de portée pratique et budgétaire d'un plafond appliqué à des dépenses de guichet contraintes, sur lesquelles le Gouvernement n'a pas de marge de manoeuvre sauf à changer les conditions d'éligibilité des publics aux différents dispositifs.
J'en viens maintenant à l'examen détaillé des programmes. S'agissant du programme n° 304 « Lutte contre la pauvreté », je voudrais faire trois principales remarques. Tout d'abord, je constate que le contexte est, à cet égard, très dégradé, ainsi que le souligne le récent rapport du Secours catholique sur la pauvreté en France.
Ma deuxième remarque est relative à la maquette, qui évolue pour accueillir trois actions supplémentaires, en particulier une nouvelle action destinée à l'expérimentation en économie sociale et solidaire pour un montant de 5 millions d'euros. C'est une évolution positive, qui correspond à une priorité politique légitime du Gouvernement ; cependant, je regrette que cette dotation capte en réalité des fonds destinés à d'autres expérimentations en matière sociale : en particulier un abondement du fonds interministériel de prévention de la délinquance.
Le programme n° 304 regroupe principalement la subvention d'équilibre de l'État au Fonds national des solidarités actives (FNSA), destinée à financer principalement la partie « activité » du RSA. Cette subvention s'établit à 373 millions d'euros, en diminution de 48,8 millions d'euros par rapport à 2012, du fait de l'augmentation corrélative des recettes fiscales du FNSA prévue par le PLFSS pour 2013. De façon générale, la prise en compte réaliste de la lente montée en charge du RSA « activité », de celle, très lente, du RSA jeunes, accompagnée de la budgétisation de la prime de Noël pour un montant de 465 millions d'euros, rend plus fiable et plus sincère le budget prévisionnel du FNSA pour 2013.
Ma troisième remarque concerne le taux important de non recours au RSA « activité », de l'ordre de 68 %. Le rapport du comité national d'évaluation du RSA, remis en décembre 2011, a permis d'apporter des premières réponses à cette question majeure pour l'avenir de la prestation. Il semble que les principales causes de non recours résident dans le manque d'information ou de connaissance du dispositif, mais aussi dans son appréhension, par la population, comme un revenu minimum et non comme un complément d'activité pour les travailleurs pauvres. C'est pourquoi, alors que l'on visait initialement 2,2 millions de bénéficiaires travailleurs pauvres, il n'y a aujourd'hui que 477 000 bénéficiaires au titre du « RSA activité » seul et 229 000 au titre du RSA « socle et activité ». Or, le non recours est certes une économie budgétaire comptable, mais il est une perte économique globale pour un territoire et signale peu ou prou l'inadaptation d'un dispositif. Par ailleurs, un sociologue a, dans un récent article de presse, mis en évidence que le phénomène de non recours est plus important que celui de la fraude s'agissant des prestations sociales.
Des projets sont à l'étude pour en permettre une meilleure orientation à destination des travailleurs pauvres, et une réforme devrait être annoncée en décembre, à l'issue de la grande conférence sociale sur la pauvreté. Parmi les pistes, mes interlocuteurs ont mentionné l'idée d'une annualisation du calcul des ressources, pour « lisser » les revenus du travail et éviter les entrées/sorties du dispositif liées à des revenus irréguliers. Il pourrait s'agir également d'une fusion complète avec la prime pour l'emploi. En tout état de cause, je souhaite que certains avantages du RSA activité soient maintenus, notamment son caractère familialisé.
S'agissant du programme n° 106 sur la protection des familles, les subventions en faveur des associations familiales sont globalement stabilisées, la dépense de protection juridique des majeurs est contenue, mais je regrette qu'aucun abondement de l'État au Fonds national de financement de la protection de l'enfance ne soit, cette année encore, prévu, alors même que l'abondement initial de 30 millions d'euros par la CNAF en 2010 a été étalé sur les trois années 2010, 2011 et 2012, et qu'aucun nouveau versement n'est prévu pour 2013. Le fonds n'est donc, en 2013, plus doté.
J'en viens au programme n° 157 « Handicap et dépendance ». Il s'agit, de loin, du programme le plus important de la mission. Deux actions expliquent ce poids budgétaire. La première est l'allocation aux adultes handicapés, qui représente la principale dépense de la mission, avec 8,15 milliards d'euros de crédits prévus en 2013, en augmentation de 8,5 % par rapport à 2012 sous le double effet de l'accroissement du nombre d'allocataires, qui devrait dépasser le cap du million de bénéficiaires cette année, et des suites de la dernière tranche de revalorisation de son montant, intervenue en septembre dernier. De façon générale, sur l'AAH, il convient de reconnaître l'effort du Gouvernement pour rendre plus fiable le budget prévisionnel, le nombre de bénéficiaires ayant été réévalué à la hausse de façon réaliste.
La seconde action majeure du programme est la contribution de l'État aux établissements et services d'aide par le travail (ESAT). Qu'il s'agisse de la subvention de fonctionnement ou de l'aide au poste, la contribution de l'État est stable entre 2012 et 2013, mais je regrette qu'il ne soit pas prévu de créer, en 2013, de nouvelles places, malgré le plan pluriannuel de création de 10 000 places entre 2008 et 2012 et les 2 000 demandes encore non satisfaites, objectif pourtant réaliste !
Le programme n° 137 « Égalité entre les femmes et les hommes » bénéficie d'une nouvelle dynamique, liée à la création d'un ministère dédié de plein exercice ainsi que celle d'un fonds d'expérimentations doté de plus de 6 millions d'euros. Comme pour l'économie sociale et solidaire, je regrette cependant que ce fonds semble capter une partie des financements destinés à des actions de promotion déjà mises en place, notamment le prix de la vocation scientifique et technique, ainsi que les contrats de mixité des emplois dans les entreprises.
Enfin, je tiens à faire deux principales remarques concernant le programme n° 124 « Conduite et soutien », qui est, avec 1,4 milliard d'euros de crédits, le second programme de la mission.
La première tient à son architecture, qui est entièrement refondue pour mieux faire apparaître la dépense par destination, et mieux mettre en évidence la mutualisation des services s'agissant des charges de fonctionnement. L'évolution est positive, même si elle limite notre capacité de suivi pluriannuel de l'évolution des crédits.
La deuxième remarque, plus critique, concerne le point sensible des réductions d'effectifs. Cette année encore, le plafond d'emplois des directions ministérielles, réduit à tous les échelons (central, régional, départemental), connaît une baisse de 126 équivalents temps plein. Pour les agences régionales de santé, le plafond d'emplois est réduit de 243 équivalents temps plein. Je regrette fortement cette évolution, d'autant plus qu'elle touche particulièrement les catégories B et C. Le ministère indique que ce processus de requalification des emplois renforce la fonction de pilotage et d'expertise de l'administration. Mais une administration opérationnelle, de terrain, dans les départements, a également besoin d'agents de catégorie B et C !
De plus, cette requalification des emplois explique qu'on assiste, malgré la réduction des effectifs, à une hausse de la masse salariale. Ainsi, les crédits destinés au fonctionnement des ARS sont en progression de 30 millions d'euros, principalement du fait de la masse salariale.
Sous le bénéfice de ces observations, et en considération, essentiellement, de mes réserves liées à l'objectif de réduction des effectifs, je m'abstiens de proposer une position à la commission, et m'en remets à cette dernière pour l'adoption ou non des crédits de la mission.

Comme les années précédentes, les crédits liés au « RSA activité » sont surévalués par la loi de finances initiale et en partie non consommés en exécution. La situation est paradoxale, alors que le RSA « socle » représente une charge croissante pour les départements.
Par ailleurs, je regrette que le fonds national de financement de la protection de l'enfance ne soit pas doté, alors qu'il a vocation à compenser la charge, croissante, liée à la protection de l'enfance dans les départements. En particulier, le fonds pourrait permettre une compensation des missions nationales, comme la prise en charge des mineurs étrangers isolés.

Comment expliquer, s'agissant des agences régionales de santé, que la réduction des effectifs de 243 équivalent temps plein s'accompagne d'une hausse des crédits ? Quel est le nombre total d'emplois dans les ARS ?

Pour répondre à Albéric de Montgolfier, nous sommes en effet frappés par la sous-consommation des crédits liée à ce phénomène de non recours. Le rapport du comité national d'évaluation a pu fournir des premières explications à ce problème déjà identifié. Ainsi, 11 % des non recourants n'ont jamais entendu parler du RSA : il s'agit, le plus souvent, d'hommes seuls en situation de grande précarité. 35 % des non recourants connaissent le RSA, en ont déjà bénéficié, mais n'en sont pas allocataires au moment de l'enquête. Ce sont les non recourants transitoires, qui sont nombreux parmi les travailleurs pauvres aux revenus d'activité irréguliers. Enfin, 54 % sont des personnes qui connaissent le RSA mais n'en ont jamais bénéficié ; il s'agit, notamment de personnes qui refusent la prestation ou pour lesquelles le gain financier est trop faible pour justifier de la demander ; on remarque ainsi qu'en dessous de 50 euros par mois, la plupart des bénéficiaires potentiels renoncer à recourir à la prestation.
Face à ce problème du non recours, le Gouvernement a mis en oeuvre depuis 2010 un plan de simplification. En effet, certaines démarches méritaient d'être simplifiées et l'ont été. Je crois qu'il faut essayer d'améliorer l'information et l'accompagnement de ce public particulier ; nous avons notamment pensé à renforcer, de ce point de vue, le rôle des centres communaux d'action sociale.
Pour répondre à la question de Jean-Claude Frécon, le plafond d'emplois total des ARS est fixé, pour 2013, à 9 038 équivalents temps plein.

Les ARS sont le résultat de la fusion de plusieurs administrations, en particulier les anciennes agences régionales des hôpitaux, ainsi que les directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Par ailleurs, on peut lire, dans la note du rapporteur, que sur les 243 suppressions de postes, 130 sont en réalité liées à une correction technique ; l'économie permise, d'un point de vue budgétaire, se limite donc à 113 postes. S'agissant de l'écart entre la réduction des effectifs et la hausse des crédits, la note précise qu'il s'agit notamment d'ajustements techniques, comme la contribution au CAS « Pensions » ou la réévaluation des dépenses immobilières locatives. Il s'agit là, sans doute, d'une remise à niveau normale résultant de la création récente de cette structure issue de plusieurs administrations différentes.
Nous en venons maintenant à l'examen des articles 70, 70 bis et 70 ter rattachés à la mission.

L'article 70 a pour objet d'assurer le financement de deux dispositifs par le FNSA. D'une part, il s'agit de prévoir la prise en charge par le Fonds de la prime de Noël accordée aux allocataires du RSA socle, mais aussi aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et des allocations liées. Cela est cohérent avec la budgétisation, pour la première fois, de la prime de Noël au sein de la mission, pour un montant total de 465 millions d'euros en 2013. Ce mode de financement, déjà prévu pour les bénéficiaires du RSA par le collectif budgétaire de fin d'année 2011, est ainsi pérennisé et intégré au sein du code de l'action sociale et des familles. Il est cohérent avec l'augmentation des ressources du FNSA permise par le relèvement des recettes fiscales qui lui sont affectées. Cependant, je regrette que le Gouvernement n'ait pas « franchi le pas » et rendu obligatoire le versement de cette prime, qui est pourtant inscrite dans le paysage des aides sociales depuis près de quinze ans. En effet, le présent article précise que les aides peuvent être accordées ; en d'autres termes, dès 2014, le Gouvernement peut, sans modification juridique, ne pas verser la prime !
D'autre part, l'article prévoit de prolonger, pour la seule année 2013, le financement par le FNSA du « RSA jeunes », pour sa partie « activité » et sa partie « socle », par dérogation au droit commun du RSA selon lequel les départements financent la partie « socle ». En effet, le « RSA jeunes », instauré en 2010, se caractérise par une montée en charge particulièrement lente : le nombre de bénéficiaires a même décru entre 2011 et 2012 et est repassé sous la barre des 10 000 ! Les conditions d'éligibilité sont très strictes et impliquent des démarches administratives compliquées. En 2013, le coût estimé du « RSA jeunes » est de 27 millions d'euros, soit 13 millions pour la partie « socle » et 14 millions pour la partie « activité ». Mais devant les incertitudes qui pèsent sur son évolution, le Gouvernement a souhaité que le FNSA continue de prendre en charge cette dépense. Pour ma part, je souscris à cette prise en charge en 2013, tout en demandant au Gouvernement qu'elle soit l'occasion de réfléchir à une évolution du régime, vers un assouplissement de ses critères ou une intégration au RSA de droit commun.
Sous le bénéfice de ces observations, je vous propose d'adopter l'article 70 sans modification.
La commission décide de proposer au Sénat l'adoption sans modification de l'article 70 du projet de loi de finances pour 2013.

L'article 70 bis, adopté par l'Assemblée nationale hier soir à l'initiative du Gouvernement, est une modification technique qui a pour objet d'étendre aux rentes d'accidents du travail et maladies professionnelles le mécanisme existant pour les avantages d'invalidité ou de vieillesse et permettant à la CAF d'être subrogée dans les droits des bénéficiaires pour obtenir le recouvrement des indus d'allocations aux adultes handicapés. Cette extension fluidifie, pour les CAF, le recouvrement des indus d'AAH. D'après les informations que j'ai pu recueillir, cette modification est demandée par les caisses depuis plusieurs années ; elle est rendue aujourd'hui possible d'un point de vue technique grâce à l'amélioration de l'adhérence entre les systèmes d'information des CAF et des organismes payeurs des rentes d'ATMP. Par ailleurs, le mécanisme de subrogation présente l'avantage de renforcer le principe de subsidiarité de l'AAH par rapport aux autres allocations de solidarité. En tout état de cause, la modification ne créé ni ne retranche de droits pour les bénéficiaires, pour lesquels le mécanisme de subrogation est transparent. Je vous propose donc l'adoption de cet article additionnel sans modification.

Sans rentrer dans le fond du dispositif, de nature technique, je m'interroge sur sa place en loi de finances. Modifiant une disposition du code de la sécurité sociale, il pourrait figurer en loi de financement de la sécurité sociale.

On peut en effet se poser la question. Cependant, il est rattaché à cette mission au titre de l'allocation aux adultes handicapés.
La commission décide de proposer au Sénat l'adoption sans modification de l'article 70 bis du projet de loi de finances pour 2013.

J'en viens à l'article 70 ter, qui a pour objet de prévoir que les crédits destinés aux expérimentations, ainsi que les résultats de ces dernières une fois achevées, sont présentés dans les documents de politique transversale « Inclusion sociale » et « Politique d'égalité entre les femmes et les hommes ». En effet, la mission « Solidarité » est caractérisée par la présence de plusieurs programmes comportant des actions d'expérimentations. Il s'agit, en particulier, du programme n° 304 « Lutte contre la pauvreté », qui comprend, à partir du projet de loi de finances pour 2013, une action d'expérimentations en matière sociale de façon générale et une action d'expérimentations en économie sociale et solidaire, pour un montant total de près de 6 millions d'euros. Il s'agit également du programme n° 137 « Égalité entre les femmes et les hommes », qui porte désormais un fonds d'expérimentations doté de 6 millions d'euros également.
Or, l'utilisation des crédits d'expérimentation est mal documentée dans le projet annuel de performances. Je regrette que nous ne soyons pas mieux informés des résultats des expérimentations que ces crédits financent, notamment au regard des perspectives de généralisation de celles considérées comme réussies. En conséquence, l'ajout de la liste, de l'objet, des crédits et des résultats des expérimentations en cours et achevées au sein des documents de politique transversale permet d'améliorer le suivi de ces expérimentations et l'information du Parlement. Je vous propose donc l'adoption de cet article sans modification.
La commission décide de proposer au Sénat l'adoption sans modification de l'article 70 ter du projet de loi de finances pour 2013.

Nous en venons au vote des crédits de la mission, pour lequel le rapporteur spécial s'abstient et s'en remet à la commission.
A l'issue de ce débat, la commission décide de proposer au Sénat l'adoption sans modification des crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».