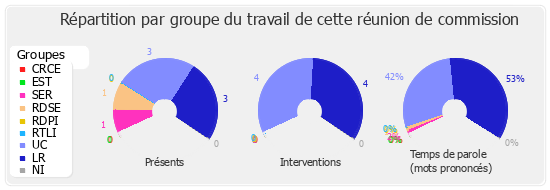Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
Réunion du 5 février 2014 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion

Je suis très heureux de vous accueillir au Sénat pour cette audition consacrée à la politique étrangère de la Russie.
Diplômé de l'INALCO et de l'Institut d'études politiques de Paris, vous avez travaillé de 1999 à 2006 à l'Institut de relations internationales et stratégiques, ainsi que comme consultant au Centre d'analyse et de prévision du ministère des affaires étrangères. Vous avez publié de nombreux ouvrages et articles sur la Russie.
Depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine en 2000, la Russie a fait un retour remarqué sur la scène internationale.
Mais si la Russie aspire à retrouver un statut de grande puissance, grâce notamment à l'utilisation de l'arme énergétique, la politique étrangère russe demeure pour l'Occident une source d'interrogation : Quels sont les objectifs véritables de la Russie sur la scène internationale ? Comment expliquer son attitude ambivalente sur les grands dossiers internationaux, comme la Syrie ou l'Iran ? La Russie représente-t-elle une menace ou un partenaire pour l'Europe ? Qu'en est-il de ses relations avec la Chine ou avec les pays de son « étranger proche » ?
Voilà des questions qui font penser à la citation de Churchill : « La Russie est un rébus enveloppé d'un mystère à l'intérieur d'une énigme ».
Pour autant, comme nous l'avons constaté lors de notre déplacement à Moscou en décembre dernier, la Russie représente un partenaire indispensable pour l'Europe et pour la France et il existe une véritable attente d'un renforcement de la coopération entre nos deux pays. Nous avons d'ailleurs lancé à mon initiative une nouvelle forme de coopération entre le Sénat et le Conseil de la Fédération de Russie, notamment dans le cadre du suivi parlementaire des réunions du G8.
Nous sommes donc particulièrement heureux de vous entendre sur la politique étrangère de la Russie.
Je vous laisse maintenant la parole.
Je suis très honoré de pouvoir m'exprimer devant la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat sur un sujet à la fois vaste, complexe et d'actualité, comme l'illustrent la crise récente en Ukraine, les dossiers syrien ou iranien, ou encore, de manière plus anecdotique, l'ouverture prochaine des jeux olympiques de Sotchi.
Je vous présenterai brièvement la situation intérieure de la Russie, du point de vue politique puis économique, avant d'évoquer la politique étrangère russe.
L'année 2013 a été de mon point de vue une année charnière, un véritable « tournant ».
Dans le domaine de la politique intérieure, nous avons assisté à l'ouverture d'un nouveau cycle à l'été 2013, caractérisé par une certaine détente du régime de Vladimir Poutine, après les signes de crispation du régime à la suite des manifestations d'ampleur de décembre 2012 qui avaient suivi l'annonce des résultats des élections législatives.
Cette relative détente s'est notamment traduite par la non incarcération de l'opposant Navalny, qui avait pourtant fait l'objet d'une condamnation par un tribunal mais qui a été laissé en liberté, par le déroulement des élections municipales à Moscou et dans plusieurs grandes villes, où l'opposition a pu faire entendre sa voix, et a même remporté les élections dans certaines villes, comme Ekaterinbourg et Petrozavodsk, par les échanges très francs entre Vladimir Poutine et plusieurs figures de l'opposition lors du club de Valdaï ou encore par les récentes lois d'amnistie et la libération de Mikhael Khodorkovski.
Il est encore trop tôt pour se prononcer sur la poursuite ou non de cette tendance, qui peut s'expliquer aussi par la volonté du régime de donner une meilleure image du pays à la veille des Jeux Olympiques. A cet égard, les élections régionales ou municipales qui se tiendront en 2014 auront valeur de « test ».
Sur le plan économique, la situation s'est détériorée puisque la croissance économique n'a été que de 1,3% en 2013, soit un niveau inférieur aux prévisions du gouvernement russe et du FMI en début d'année (3,7%), et en deçà des années précédentes (moyenne de 7% par an entre 1999 et 2008). Ce niveau est certes honorable, mais il reste très insuffisant au regard de l'effort de modernisation nécessaire de l'économie russe. Cela dans un contexte où le prix des hydrocarbures est demeuré très élevé. Cette situation, si elle devait se prolonger, serait de nature à créer des tensions, compte tenu des promesses électorales de Vladimir Poutine, notamment en matière de revalorisation des salaires, ou au regard du programme de modernisation de l'armée russe, qui devait être doté de 500 milliards d'euros sur 10 ans. Il existe donc des interrogations sur la politique économique et sur la relance de la croissance. Certes, des investissements dans les infrastructures ont été annoncés à l'automne. Mais, on peut penser que la relance de la croissance dépend avant tout de réformes structurelles, comme la lutte contre la corruption ou l'amélioration de l'Etat de droit et la réforme du système judiciaire.
La Russie dispose toutefois de marges de manoeuvre sur le plan budgétaire, de réserves de change importantes et d'une cagnotte accumulée dans le Fonds de bien-être national. La dette publique dépasse à peine 10% du PIB : Vladimir Poutine avait en effet souhaité désendetter le pays au début des années 2000. Notons que Moscou peut aujourd'hui accompagner les entreprises russes à l'export en proposant des prêts de plusieurs milliards d'euros, par exemple pour la construction de centrales nucléaires, ce que peu de pays même en Europe peuvent offrir actuellement.
Par ailleurs, il faut se garder de la tendance à analyser la Russie à travers le prisme de Moscou, car la Russie ce sont aussi les régions, qui sont nombreuses, variées et dans lesquelles existent aussi des sociétés civiles actives et des opportunités nouvelles. Les entreprises françaises y investissent d'ailleurs de plus en plus.
J'en viens maintenant à la politique étrangère de la Russie. Comment la Russie perçoit-elle le monde extérieur ? Quelles sont ses priorités en matière de politique étrangère ? Quelles sont les principales menaces ?
Deux mots caractérisent d'après moi la politique étrangère russe : souveraineté et conservatisme.
Souveraineté car la Russie a une vision des relations internationales très « XIXe siècle » avec le rôle déterminant des Etats, de la puissance.
Conservatisme car la Russie se veut le gardien de l'ordre international, du rôle de l'ONU, du multilatéralisme.
La principale crainte de la Russie est une remise en cause de l'ordre international vers un monde plus mouvant, voire le chaos, à l'image de la Syrie.
Concernant les priorités géographiques de la Russie, l'Europe reste la principale aux yeux de Moscou car la Russie se veut d'abord une puissance européenne et parce que l'Union européenne représente pour la Russie son premier partenaire commercial.
On assiste toutefois à une certaine évolution dans les discours avec un glissement progressif vers l'Asie, comme l'a illustré le Sommet de l'APEC de Vladivostok en septembre 2010. Les relations commerciales avec la Chine se développent et de nombreux contrats ont été signés, notamment en matière de fourniture d'hydrocarbures par la Russie ; il existe en outre une convergence entre les deux pays sur les principaux dossiers internationaux, comme la Syrie ou l'Iran. La crainte d'une invasion chinoise de la Sibérie est à mes yeux un mythe, puisqu'on dénombre davantage de Chinois à Moscou que dans l'Extrême orient russe, même s'il existe certaines sources de tensions entre les deux pays, comme l'influence chinoise en Asie centrale ou encore le recul des contrats d'armement russes vers la Chine. L'inversion du rapport de forces entre la Chine et la Russie soulève des interrogations à Moscou sur la manière de se positionner face à ce nouveau géant. Pour autant, la Russie ne peut pas se permettre d'avoir de mauvaises relations avec un voisin aussi important. La Russie a d'autres partenaires en Asie, comme l'Inde, mais aussi le Vietnam ou la Corée du Sud, et même le Japon, malgré le contentieux des Kouriles.
Une autre priorité de la Russie reste l'« étranger proche », c'est-à-dire l'espace post-soviétique. Le principal projet de Moscou est l'union douanière eurasiatique, regroupant actuellement la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan, qui pourraient être rejoints prochainement par l'Arménie. Il s'agit pour la Russie d'aller vers le modèle de la Communauté économique européenne, face à la constitution de grands blocs commerciaux au niveau mondial. L'Ukraine représente dans ce contexte un enjeu crucial. Le refus des autorités ukrainiennes de signer l'accord d'association avec l'Union européenne et la signature d'accords avec la Russie, conjugués avec la répression brutale du régime et l'adoption de lois attentatoires aux libertés, ont provoqué une vague de protestation dans ce pays, en particulier dans la partie occidentale, traditionnellement tournée vers l'Europe, et une situation de blocage dont il est difficile aujourd'hui de voir une porte de sortie. En particulier, l'attitude du régime a entraîné une radicalisation du mouvement d'opposition, au profit de la frange la plus radicale et nationaliste.
La Russie a démontré à cette occasion sa capacité d'entrave et son pouvoir de nuisance. Comme un joueur d'échec, « elle a réalisé un bon coup », mais sa victoire risque d'être fragile car elle ne dispose pas d'une force d'attraction comme par exemple l'Union européenne, et elle peine à entraîner derrière elle d'autres pays. La principale crainte que l'on peut avoir est celle que l'affaire ukrainienne fasse voler en éclats le relatif consensus qui s'était instauré au sein de l'Union européenne, entre les pays de la « vieille Europe » et les nouveaux Etats membres, au sujet des relations avec la Russie, notamment à la suite de la réconciliation entre la Pologne et la Russie. Or, la crise ukrainienne peut être de nature à remettre en cause ce consensus, comme on peut le constater actuellement avec l'activisme de la Pologne en faveur de la reconnaissance d'une perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et les réticences de l'Allemagne et de la France.
Enfin, concernant le reste du monde, on peut constater l'apparition de nouvelles zones d'intérêts pour la Russie, comme l'Afrique australe, avec le rapprochement entre la Russie et l'Afrique du Sud, notamment dans le domaine minier ou de l'aéronautique, ou encore en Amérique du Sud, avec le Brésil, en matière d'armement ou dans le domaine du nucléaire civil, et l'importance accordée par la Russie à l'organisation des BRICSA (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud).

La confiance envers la Russie est d'autant plus grande que l'on n'est pas un pays limitrophe... Dans le Caucase, chaque semaine, la Russie gagne du terrain sur la Géorgie, l'Arménie est quasiment sous tutelle, l'Azerbaïdjan est la seule à résister... Quels sont les rapports de force actuels, en particulier avec le groupe de Minsk ? Quelle est la tolérance vis-à-vis de l'Islam en Russie ?
Je ne reviens pas sur la situation de la Géorgie. Cette situation ne me parait pas devoir se résoudre rapidement. Toutefois, la dynamique me semble positive : depuis le départ du président Saakachvili, le dialogue politique et les échanges économiques ont repris.
Pour le groupe de Minsk, la situation sur le terrain est de plus en plus tendue : la question du Haut-Karabagh, qui met en jeu des questions de souveraineté, est, hélas, partie pour durer. Les accrochages sont fréquents mais ne dégénèrent pas. Ce conflit qui me semble sans issue immédiate ne m'apparait pas comme une priorité de la diplomatie russe aujourd'hui.
Il y a beaucoup d'islams différents en Russie - dans le Caucase du Nord ou dans la région de la Volga. Il y a aussi la question de l'immigration en provenance d'Asie centrale et à cet égard j'ai plus le sentiment d'une « caucasophobie » que d'une « islamophobie » en Russie. Cette évolution très inquiétante frappe en particulier les Tchétchènes malgré deux guerres pour le maintien de la Tchétchénie dans le giron russe. Les évolutions actuelles ne me semblent pas saines : la Russie achète la paix en Tchétchénie mais au fond la fracture entre les peuples est de plus en plus béante.
Ce rejet de l'immigration est plus qu'inquiétant : en sont victimes Ouzbèks, Kirghizes, notamment, alors qu'ils ne posent aucun problème particulier sur le plan de la sécurité.
À côté de l'islam que nous connaissons traditionnellement, émerge dans les jeunes générations un islam radical revendicatif, inspiré des modèles étrangers, débouchant parfois sur des dérives terroristes.
L'image de la France en Russie est toujours positive, mais elle a été récemment altérée par la question de l'islam, l'affaire « Depardieu » ou encore le mariage pour tous.

Une observation, pour faciliter notre compréhension de la Russie : c'est un pays immense, qui tient à sa grandeur. J'ajoute que la démocratie peut y faire peur à certains.
Conservatisme et souveraineté, nous avez-vous dit : je vois une autre orientation à la politique étrangère russe, c'est la défense des régimes autoritaires et laïcs mais maîtrisant l'islamisme, on le voit bien en Syrie. Dans les enceintes internationales, des blocs « pro-russes » se reconstituent, en Afrique (l'Angola et l'Algérie), ou encore en Amérique du Sud. Les Russes « siphonnent » les hydrocarbures des pays du Caucase, sans toucher les leurs, et gèrent avec doigté leur partenariat avec la Chine, notamment au sein du Club de Shanghai...
Vous avez raison de souligner la cohérence entre politique intérieure et extérieure russes, et la crainte à l'extérieur de la poussée du radicalisme sunnite au Moyen-Orient, sous l'influence de l'Arabie saoudite et du Qatar. Les Russes sont inquiets de ses répercussions potentielles dans le Caucase du Nord, en Asie centrale et jusqu'à la Volga. S'ils soutiennent Bachar Al Assad, c'est pour contrer cette poussée sunnite.
Ce sont les Chinois, redoutables négociateurs, plutôt que les Russes, qui « siphonnent », si l'on peut dire, les hydrocarbures des républiques centre-asiatiques, Turkménistan, Kazakhstan...

Où en sommes-nous des négociations sur l'accord de partenariat entre l'Union européenne et la Russie ? Qu'en est-il aussi des relations entre la Russie et la Turquie ?
Il serait souhaitable d'aller vers un accord de partenariat entre l'Union européenne et la Russie compte tenu de nos relations étroites. Les négociations sont toutefois dans une impasse actuellement en raison notamment du contentieux sur le troisième paquet énergétique ou des tensions sur le voisinage commun. Les dirigeants russes attendent aussi le renouvellement des institutions européennes et les nominations des futurs responsables des institutions européennes.
Malgré la rivalité historique entre la Russie et la Turquie, l'un des principaux acquis de la politique étrangère de Vladimir Poutine a été le rapprochement avec Ankara caractérisé par une normalisation politique, la Russie s'abstenant de soutenir le PKK et la Turquie les rebelles tchétchènes, et le développement des relations économiques, si bien qu'aujourd'hui la Russie et la Turquie sont des partenaires économiques importants. Il existe aussi des affinités entre Vladimir Poutine et Erdogan.

Je souhaiterais vous interroger sur l'état des relations américano-russes. Après le « reset » de Barack Obama, nous avons assisté à une détérioration sensible des relations entre les deux pays, même s'ils ont réussi récemment à s'entendre sur le dossier du nucléaire iranien ou sur la destruction de l'arsenal chimique en Syrie. Pensez-vous que l'on va vers une rivalité ou une complicité entre la Russie et les Etats-Unis ?
Que faut-il penser également de la démographie russe ?
Concernant les relations entre la Russie et les Etats-Unis, elles étaient exécrables à la fin du mandat de Georges W. Bush et le « reset » de Barack Obama avait été très bien accueilli à Moscou. Les relations se sont ensuite détériorées, notamment avec le système de défense anti-missile. Lors de la réélection d'Obama, celui-ci a souhaité à nouveau se rapprocher de Moscou mais l'affaire Snowden n'a pas permis ce réchauffement. Il existe une rivalité ancienne et des inerties de comportement, de part et d'autre, mais on constate aussi une sorte de complicité entre les deux pays, comme l'illustre la rapidité avec laquelle les diplomates russes et américains ont géré l'affaire de l'arsenal chimique syrien. Il existe aussi une réelle relation de respect entre John Kerry et Lavrov.
S'agissant de la démographie, les scénarios catastrophistes d'un effondrement ne se sont pas vérifiés et, en 2013, nous avons assisté, pour la première fois depuis 1991, à un nombre de naissances plus élevé que le nombre de décès, ce qui devrait permettre une stabilisation de la population autour de 143 millions d'habitants. Le taux de natalité est de 1,6 ou 1,7 et reste inférieur au seuil de 2 permettant le renouvellement des générations, mais le régime a mis en place une politique familiale, avec notamment une prime d'environ 10 000 dollars pour le deuxième enfant. Le vrai problème tient cependant à la mortalité qui reste très élevée, notamment en raison du tabagisme, de l'alcoolisme et du système de santé. Se pose aussi la question de l'immigration, compte tenu du besoin de main d'oeuvre estimé à 500 000 personnes par an, et de la pyramide des âges et du vieillissement de la population, ce qui supposerait de faire venir des immigrés en provenance d'Asie centrale ou d'Asie.

Les relations entre l'Union européenne et la Russie ne progressent pas, et les Sommets se succèdent sans aucun résultat concret.
Qu'en est-il de l'Ukraine qui représente un enjeu majeur pour la Russie et pour l'Europe ? Quels sont les objectifs poursuivis par la Russie ? Que pourrait faire l'Europe ?
La Russie souhaiterait faire adhérer l'Ukraine à l'union douanière mais cela semble impossible. La Russie joue un rôle efficace d'obstruction en empêchant l'Ukraine de se rapprocher de l'Union européenne et de l'OTAN mais elle ne parvient pas à l'entraîner dans son orbite. A cet égard, l'accord d'association représente un symbole mais aussi une arme. Les dirigeants russes jouent cependant avec le feu car rien ne serait pire pour la Russie comme pour l'Europe et pour l'Ukraine elle-même que l'arrivée au pouvoir d'ultranationalistes ukrainiens.

L'« ouverture » politique récente du régime russe n'est-elle pas en réalité liée à l'échéance des jeux olympiques de Sotchi et à la volonté de Vladimir Poutine d'améliorer son image et celle de la Russie ? Je décèle plusieurs contradictions : en Ukraine, une aide financière importante est proposée, en Géorgie, malgré Sotchi, les Russes continuent d'avancer, en Syrie, la Russie ne réagit pas au massacre des populations civiles par le régime...
La contradiction est un terme qui caractérise la Russie, pays complexe où même au sein du pouvoir existent des intérêts et des analyses divergentes.... La position russe sur la Syrie peut être critiquée, mais elle est parfaitement prévisible et cohérente : les Russes considèrent que l'alternative à Assad est pire qu'Assad.
Avec la Géorgie, la politique russe est, à mon avis : pas d'évolution à court terme en matière territoriale, mais un progrès par rapport à l'époque précédente, le commerce reprend, le dialogue est réengagé. La dynamique est plus positive.
L'Ukraine est un pays très important pour la Russie : c'est presque une question identitaire. Sur les 15 milliards d'aide annoncés, seuls 3 milliards ont toutefois été débloqués, et encore, pour rembourser des entreprises russes... Mais il est vrai que la Russie peut mettre l'Ukraine en faillite en quelques jours : le pays est incapable de rembourser la dette colossale accumulée par 20 ans de dirigeants incompétents et corrompus. L'Ukraine avait tout pour faire mieux que la Russie, ce qui explique la très large majorité (80%) en faveur de l'indépendance : les Ukrainiens pensaient, comme les Baltes, qu'ils feraient mieux sans les Russes. 20 ans après, c'est un échec dramatique, faute d'élites compétentes.

Je me suis rendu à Kiev sur la place Maidan où j'ai pu constater le caractère pacifique des manifestants et le caractère organisé du mouvement d'opposition, la répression brutale du régime, mais aussi la présence d'une frange plus radicale et très nationaliste. Il faut aussi tenir compte du clivage entre la partie occidentale, tournée vers l'Europe, et la partie orientale, davantage sous l'influence russe. Je crois que nous devrions suivre avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation dans ce pays.
Le régime a fait deux erreurs. Il a fait le choix de réprimer brutalement une manifestation pacifique et il a adopté des lois très attentatoires aux libertés. Cela a provoqué une radicalisation de l'opposition, avec notamment une frange très nationaliste et violente, qui rejette tout compromis. La situation paraît donc aujourd'hui bloquée.
La Russie est une fédération composée de 83 entités, qui ont des statuts variées, avec des républiques, des régions, des districts autonomes, etc. Sous la présidence d'Eltsine, nous avons assisté à un net affaiblissement du pouvoir central et à un « fédéralisme à la carte » où chacune des entités pouvait prendre autant de pouvoir qu'elle le voulait, allant jusqu'à conclure des traités bilatéraux avec l'Etat fédéral. L'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine a mis un terme à cette tendance, avec un mouvement de recentralisation, le retour vers « la verticale du pouvoir », qui s'est notamment manifesté par la dénonciation des accords bilatéraux, la création de sept districts fédéraux et la nomination de superpréfets ou encore la suppression de l'élection au suffrage universel direct des gouverneurs des régions, qui a été rétablie récemment. Pour autant, dans un pays aussi étendu que la Russie, il subsiste une grande marge d'autonomie pour les régions et l'articulation des pouvoirs, entre le niveau fédéral et fédéré, mais aussi à l'intérieur des entités, par exemple concernant les villes, fait l'objet de débats. On discute ainsi de la réduction du nombre d'entités et du mode de désignation des responsables.

Je souhaiterais vous interroger au sujet des relations entre la Russie et l'Iran.
Même si historiquement il a existé une rivalité entre la Russie et la Perse et que les relations ont été souvent tendues, notamment avec la crainte d'une invasion russe puis soviétique ou le soutien de l'URSS à l'Irak, un partenariat s'est développé à partir de 1989, notamment sur le plan économique (avec en particulier la construction de la centrale de Busher) et politique. Les relations restent toutefois assez ambiguës, comme en témoigne l'attitude de l'Iran à l'égard des propositions de compromis de la Russie concernant le programme nucléaire ou encore le refus de la Russie de livrer des missiles sol-air.
Alors qu'il pouvait encore espérer revenir au pouvoir lors des élections de 1996, le parti communiste russe stagne autour de 15 à 20% des voix lors des élections. C'est le seul véritable parti, doté d'une organisation et composé de militants, toléré par le pouvoir. Il s'agit davantage aujourd'hui d'un parti nationaliste et conservateur, comme en témoigne notamment son attitude à l'égard de la religion, bien loin de l'athéisme révolutionnaire.
La commission auditionne M. Justin Vaïsse, directeur du centre d'analyse, de prévision et de stratégie du ministère des affaires étrangères, sur les nouvelles orientations stratégiques des Etats-Unis.

Les nouvelles orientations stratégiques des États-Unis sont l'un des thèmes que nous avons choisi d'aborder cette année.
Nous avons en effet le sentiment de l'achèvement d'un cycle, qui avait débuté avec les attentats du 11 septembre 2001, et s'était traduit par un engagement fort des États-Unis au Moyen-Orient, en Afghanistan et en Irak, notamment, dans le cadre d'une guerre contre le terrorisme. La transformation de cette menace, le désengagement progressif de ces théâtres d'opérations militaires, l'articulation d'un discours sur le pivotement vers la zone Asie-Pacifique, le retour à une moindre dépendance en matière énergétique grâce à l'exploitation des énergies non conventionnelles et aux programmes d'économies d'énergie, l'affichage de priorités plus marquées de politique intérieure, comme le récent Discours sur l'état de l'Union, mais aussi la grande vigilance du Congrès sur les dépenses publiques, le montrent. Bref, tout un ensemble d'évolutions sont en cours et se combinent, semble-t-il, pour dessiner une nouvelle posture stratégique des États-Unis.
Est-ce une réalité, ou cela n'est-il qu'apparence ? Notre propos est d'en mesurer l'effectivité et l'ampleur mais aussi d'en apprécier les conséquences pour la France et pour l'Europe. Les évolutions de la première puissance mondiale, fussent-elle marginales, ont des effets qui sont loin d'être marginaux sur les autres nations.
Pour inaugurer nos travaux et nous fournir un éclairage global, nous sommes heureux de vous accueillir car vous êtes sans doute l'un des meilleurs experts français en ce domaine : à la fois parce que vous dirigez depuis mars dernier le centre d'analyse, de prévision et de stratégie du ministère des affaires étrangères, mais aussi parce que votre parcours universitaire vous a conduit à enseigner et à mener des travaux de recherche au sein de prestigieuses institutions américaines et encore récemment comme senior fellow à la Brookings Institution de Washington. Vous avez, en outre, publié de nombreux ouvrages sur les États-Unis.
Je vous laisse donc le soin de nous présenter votre analyse, puis mes collègues et moi-même vous poserons quelques questions pour compléter notre information.
Le sujet est important car le changement de posture américain modifie les données stratégiques sur l'ensemble du globe aussi bien pour ce qui concerne la zone Asie-Pacifique vers laquelle les États-Unis tournent davantage leur attention que pour le voisinage de l'Europe comme l'Afrique ou le Moyen-Orient. Il conditionne donc directement l'environnement stratégique dans lequel nous agissons.
Je vais essayer dans un premier temps de vous livrer la clef d'entrée la plus utile pour comprendre les évolutions en cours. Ces évolutions ne sont pas le fruit d'une administration ballotée par un courant isolationniste de l'opinion publique fatiguée au bout de dix ans de guerre, ni le fruit d'une administration qui serait uniquement sensible à la nécessité de réduire le budget et particulièrement celui de la défense, ni celui d'une administration qui se laisserait influencer par les préoccupations de certains alliés, mais d'une politique délibérée, celle que le président Obama a imaginée dès 2009 et qu'il a déroulée depuis lors sans beaucoup dévier.
Quand Obama est arrivé en janvier 2009, il a constaté que dans les huit années précédentes, l'Amérique s'était exclusivement consacrée à la guerre contre le terrorisme et avait englouti des sommes considérables en termes financiers, en termes de capital politique, en termes de diplomatie et d'outils de défense. Cette guerre a été très coûteuse, non seulement pour le budget mais s'est aussi traduite par une dégradation de l'image globale des États-Unis et une perte de confiance dans son leadership. Ce faisant, il considère que l'Amérique a raté ce qui se passait réellement dans le monde et notamment l'émergence de nouvelles puissances, la Chine bien sûr, mais aussi l'Inde, le Brésil et d'autres... Conclusion : l'Amérique a perdu son temps, et tel un manager prenant ses fonctions dans une grande entreprise, il effectue un bilan, détermine les secteurs rentables, coupe ceux qui génèrent des pertes et investit dans les secteurs d'avenir. Donc assez logiquement émerge l'idée du pivot, qui a une dimension plus importante que la traduction qu'en a donné Hillary Clinton dans son article de novembre 2011. L'idée du pivot, c'est bien de se retirer des guerres au sol - quand il arrive, il y a plus de 150 000 soldats américains engagés en Irak et en Afghanistan - et ce retrait pourrait être complet, mais aussi plus généralement un désinvestissement de la région du Moyen-Orient. Il faut là-dessus prendre un peu de recul historique, il n'y a pas de raison que les États-Unis soient de toute éternité le juge de paix au Moyen-Orient. Souvenons-nous que dans les années 1950 et 1960, ils étaient très peu présents et que leur implication n'a cessé de croître qu'avec celle des Soviétiques en Égypte, les guerres israélo-arabes de 1967 et 1973 et la crise du pétrole, donc essentiellement dans les années 1970. Les forces prépositionnées au Moyen orient ne datent que de la présidence Carter. Il y a donc l'idée chez un certain nombre de gens, y compris Obama, qu'il n'y a pas de raison de poursuivre une telle implication eu égard aux bénéfices à en tirer.
La question énergétique, avec l'apport des énergies non conventionnelles, pétrole et gaz de schiste, joue un peu, mais l'équation de base demeure. L'Amérique est responsable de l'ordre mondial, y compris de l'ordre sur les marchés pétroliers. Elle dépend pour son économie des prix du pétrole, qui sont mondiaux, comme ceux du gaz de plus en plus et donc, une conflagration au Moyen-Orient aurait des effets désastreux et continue à être un sujet de préoccupation des États-Unis. Ce que changent le pétrole et le gaz de schiste, c'est la teneur des discussions entre Washington et le Moyen-Orient, entre Washington et la Chine, mais ce n'est pas parce qu'ils importent de moins en moins de pétrole de cette région qu'ils se désintéressent de ce qui s'y passe.
Si l'on constate de façon très claire un désengagement, il ne s'agit pas d'un retrait, car les États-Unis conservent 35 000 hommes, une flotte de guerre considérable, des moyens d'action et des alliances. Il s'agit d'un changement de posture, d'un allègement de l'empreinte d'une moindre propension à intervenir directement. D'ailleurs leurs alliés perçoivent cette évolution.
Nous, Français, l'avons constaté en trois étapes. La première se déroule lors de l'intervention en Libye en avril 2011 avec le retrait des chasseurs- bombardiers américains de la ligne de front après deux semaines d'engagement et la mise en place d'une conduite des opérations de l'arrière (leading from behind). La stratégie d'Obama de se mettre à distance du Moyen-Orient excluait de s'engager sur un nouveau théâtre et conduisait à laisser la France et la Grande-Bretagne en première ligne en limitant l'implication des États-Unis, alors que jusqu'à présent en Irak, en Afghanistan, mais aussi en Bosnie et au Kossovo, ils prenaient la tête des coalitions. La deuxième étape se situe au Mali où pour faciliter son intervention, la France a sollicité l'aide matérielle des États-Unis, notamment pour le ravitaillement en vol et le transport de troupes. Cette aide a tardé à venir car Obama ne voulait pas laisser apparaître les États-Unis comme cobelligérants d'un conflit dans un pays africain musulman à la veille de l'inauguration de son second mandat à la présidence. Les échos du Pentagone étaient favorables, car ils comprenaient que la France effectuait un travail utile pour la stabilité de l'Afrique et pour le bien commun qu'ils n'auraient pas à réaliser quelques années plus tard si un groupe lié à Al Qaïda prenait le pouvoir à Bamako, mais le freinage venait bien de la Maison Blanche puisque cela ne correspondait pas à la ligne d'Obama. Le troisième moment, c'est la Syrie. En dépit des lignes rouges qu'il avait énoncées et de la préparation d'une intervention militaire, le président Obama a souhaité passer par le Congrès qui était une façon de s'empêcher lui-même d'intervenir : si le Congrès lui donnait l'autorisation, il était couvert vis-à-vis de son opinion publique intérieure et s'il la lui refusait, cela lui permettait de poursuivre sa politique de désengagement et éviter d'impliquer l'Amérique dans une nouvelle intervention militaire au Moyen-Orient. Un nouvel épisode, c'est l'Iran avec les négociations du 9 et du 24 novembre où l'on a vu les États-Unis exprimer la volonté de parvenir à un accord : pas à n'importe quel prix, car cela n'aurait pas été accepté ni par le Congrès, ni par les alliés israéliens et saoudiens, mais un accord tout de même qui pourrait éviter une intervention avant janvier 2017. Obama a émis le souhait d'apparaître au terme de son mandat comme un président transformateur qui aura réorienté la politique étrangère américaine, retiré les troupes au sol, réduit l'empreinte américaine du Moyen-Orient et réinvesti vers les efforts à l'intérieur (« nation building at home ») et vers les pays émergents en Asie en particulier.
S'agissant du pivot vers l'Asie, même s'il n'est pas massif, même si le transfert de troupes n'est pas très significatif, il faut tout de même mesurer la portée de l'investissement politique américain qui contraste avec celui l'administration Bush. En 2006, lors du sommet de l'APEC, Bush avait voulu faire du terrorisme l'un des points centraux, ce qui était hors-sujet et ce qui montrait une réelle déconnection par rapport aux préoccupations de ces pays. En 2009-2010 Obama réinvestit cette zone : la signature du traité d'amitié et de coopération qui permet aux États-Unis de participer au sommet de l'Asie Oriental (East-Asia Summit), l'envoi d'un diplomate permanente à Djakarta auprès de l'ASEAN, un réinvestissement qui est d'abord politique dans les instances multilatérales avant d'être militaire ou économique avec le fameux TransPacific Partnership.
De façon plus étroite, si l'on décompose le mouvement du pivot par analogie avec le basket-ball et si on s'intéresse à la partie « se tourner vers » et non plus à la partie « se détourner de », on observe que cela s'est surtout manifesté au cours du premier mandat autour d'Hillary Clinton et de Kurt Campbell et que depuis un an, il ne semble pas y avoir eu de faits nouveaux en ce domaine et l'on a vu les États-Unis moins impliqués.
Après des hauts et des bas dans les relations avec la Chine, Obama revient à une position assez classique d'équilibre avec la Chine faite à la fois d'endiguement général et d'endiguement atténué et non provocateur afin de ne pas tomber dans un piège de course aux armements.

Nous rentrons de Kuala-Lumpur, où l'on attend la visite de John Kerry et du président Obama, ce qui montre leur intérêt pour la zone.
Certes, mais après un certain nombre de ratés, comme l'absence au dernier sommet de l'APEC, ce qui a permis au président chinois Xi Jinping de rayonner. Il est temps de contrebalancer
Évidemment par rapport à ce tableau général, le secrétaire d'État John Kerry peut apparaître en décalage ou en discordance. D'abord, il est de la vieille école, s'intéresse beaucoup à l'Europe et au Moyen-Orient où il voyage régulièrement et semble contredire ce mouvement de désengagement du Moyen-Orient
Je l'analyse de manière assez cynique pour considérer que les États-Unis ne peuvent pas se désintéresser du Moyen-Orient. « Il faut que tout change pour que rien ne change ». Les chances d'aboutir à un accord israélo-palestinien sont quasiment nulles mais il faut donner l'impression de faire prévaloir l'option politique. En même temps, cela n'implique pas personnellement le président Obama. En réalité ce qui peut retenir les États-Unis au Moyen-Orient, c'est l'Iran, et éventuellement le pourrissement de la situation en Syrie.

Et nous, nous impliquons-nous davantage en Iran ? Quel est l'objet de notre attitude politique ? Faut-il aller en Iran ? Comment accompagner utilement ce mouvement de pivotement? Faut-il constituer un pivot européen de l'OTAN en matière de défense pour pallier ce mouvement de pivot ce qui semble en apparence agréer à nos partenaires américains ? Mais pour autant doit-on rester simplement en observateur au Moyen-Orient ? Et si nous nous impliquons, comment ?
Nous ne sommes pas restés inactifs. D'abord parce que le mouvement de désengagement des États-Unis est perçu au Moyen-Orient par les acteurs, comme les pays arabes du Golfe et Israël. Lorsqu'un vide se crée, il a tendance à se remplir aussitôt, c'est un principe classique des relations internationales. Quand un pouvoir s'estompe, il est remplacé par le pouvoir d'autres puissances ou par du chaos essentiellement, c'est-à-dire par les groupes terroristes comme actuellement en Syrie, par la Russie, par la montée de l'Arabie saoudite, par celle de l'axe central de structuration de la région, le conflit sunnites-chiites, mais le facteur religieux n'est pas le plus important, c'est surtout la rivalité géopolitique entre l'Arabie saoudite et l'Iran qui façonne tous les conflits de la région, le dossier syrien, le dossier iranien et pour partie le dossier israélo-palestinien. Nous avons été actifs sur le dossier syrien et sur le dossier iranien, mais on ne voit pas bien qui va remplacer les Etats-Unis comme intervenant extérieur dans les affaires de la région. En conséquence, on s'oriente probablement vers plusieurs années de chaos au moment où cette présence massive laisse un vide de pouvoir qui est déstabilisateur.

Dans le discours du Millénaire à l'ONU, Obama avait indiqué que les Etats-Unis ne pouvaient pas faire tout partout. Ne notez-vous pas une inflexion à l'égard de l'Iran et une légère « claque diplomatique » à Israël qui n'a pas réussi à faire plier John Kerry à Genève et cette inflexion a l'air sérieuse. L'aide militaire américaine à Israël se monte à 3,5 milliards de dollars, c'est un coût important pour le budget. Vis-à-vis de la poursuite des implantations de colons, pensez-vous que les États-Unis vont rester sans agir et céder une nouvelle fois au lobby israélien ?
3,5 milliards de dollars c'est énorme à l'échelle du budget d'Israël, par rapport aux dons à d'autres pays, à l'échelle du budget américain, c'est modeste. Il faut souligner la tactique d'Obama depuis 2009 et l'échec de sa tentative de faire évoluer ce pays. Il s'agit d'être irréprochable sur la sécurité d'Israël d'où l'augmentation du soutien direct à la défense et en outre le financement du système de protection anti-missiles israélien. Il n'y a jamais eu autant de soutien en matière de sécurité et de défense et cela était destiné à acheter des marges de manoeuvre sur le dossier iranien et sur le dossier palestinien. Je partage donc votre analyse du changement dans les relations entre les Etats-Unis et Israël, mais la région a considérablement changé sans d'ailleurs qu'Israël ait défini d'axes très clairs dans sa politique. Ainsi, la guerre en Syrie est-elle une bonne chose pour Israël ? Quid de la reprise du pouvoir par les militaires en Égypte ? Les Israéliens ont du mal à se positionner. Les choses ont changé parce que Obama veut régler le problème iranien par la négociation et ne pas se trouver enfermé entre une bombe iranienne d'un côté et un bombardement des sites iraniens par Israël de l'autre. L'élément qui change un peu les choses c'est aussi l'évolution de l'humeur dans l'opinion publique et au Congrès. Si la sécurité d'Israël importe toujours autant, lorsqu'il s'agit d'impliquer directement des troupes américaines, les positions évoluent.

S'agissant du pivotement vers l'Asie, comment les États-Unis équilibrent-ils leurs positions entre leurs alliés traditionnels (Japon, Corée, Philippines) et la nécessité de ménager la Chine dans les conflits d'intérêt de partage des richesses économiques de la mer de Chine ? La France et l'Europe ne risquent-elles pas d'être évincées de cette zone ? Comment assurer notre présence ? A-t-on une idée du volume des forces américaines qui a basculé vers la zone Asie-Pacifique dans les années récentes ?
Le jeu d'équilibre est difficile à jouer, notamment s'agissant des territoires japonais ou sous contrôle administratif japonais, y compris les îlots Senkaku - Diaoyu, car ces territoires sont couverts par les accords de défense américano-japonais. On voit que la Chine est en phase d'affirmation de sa présence jusqu'au premier chapelet d'îles et au-delà. Cela vaut aussi pour les Paracels. En fait, les raisons sont moins de nature économique que symbolique. Elles ont beaucoup varié selon les époques, on a invoqué des ressources pétrolières, des ressources halieutiques, la nécessité de garantir l'accès à la haute-mer des forces navales chinoises et notamment des sous-marins, car cette mer de Chine est peu profonde en raison de l'étendue du plateau continental, et les sous-marins sont facilement détectables et il existerait un passage dans la proximité des îlots. En réalité, la Chine souhaite avoir la maîtrise de sa zone naturelle d'influence sur l'eau, sous l'eau et dans les airs. On arrive à un moment où il y aura une réaction américaine. Il y a beaucoup de mise en garde dans les milieux stratégiques américains sur la possibilité d'accepter la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne (ADIZ), que la Chine ait remis la main sur les Scarborough schoals, petits récifs philippins, mais va atteindre les limites de l'acceptable et un point d'arrêt, même si la Chine agit finement en utilisant les garde-côtes, voire des pêcheurs, plutôt que l'armée populaire de libération, ou en saturant la zone de navires. Elle pousse en fait ses adversaires à la faute sans paraître elle-même responsable. Donc le jeu américain est compliqué, mais il me semble que les États-Unis devront marquer un point d'arrêt, ne serait-ce que pour conserver leur crédibilité. Tout le danger est d'accélérer la course aux armements. Les Japonais sont toujours inquiets, car leur sécurité dépend largement des États-Unis, mais ils restent confiants, car ils pensent pouvoir maîtriser la situation, notamment les discussions avec les Coréens leur paraissent facilitées, car il s'agit d'un régime démocratique. En revanche, et pour cette raison, c'est plus difficile avec les Chinois, mais ils estiment avoir le droit pour eux et bénéficier du soutien américain.
S'agissant du risque d'éviction de l'Europe de la zone, je n'y crois pas même s'il faut bien reconnaître que l'Europe est peu présente. De quoi est faite cette présence ? D'abord des communautés françaises qui sont de plus en plus nombreuses, de commerce, mais aussi de présence militaire navale, certes modeste puisqu'il ne s'agit que de quelques unités dans l'Océan Indien et le Pacifique, mais cette présence est souhaitée et appréciée de certains riverains comme l'Inde et l'Australie. Enfin, elle est faite de ventes d'armes qui ne sont jamais anodines car cela s'accompagne de formation, d'entraînement, de pièces détachées, et donc de liens plus profonds, comme avec la Malaisie. Par ailleurs, la France est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies et sera nécessairement saisie sur l'ensemble des questions qui remonteront. Je pense qu'aucun pays de la région ou les États-Unis ne souhaitent que la France ou l'Europe se désintéressent de la région, bien au contraire. La présence est appréciée notamment dans le cadre du « Shangri-La Dialogue », où s'expriment régulièrement le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées. Il serait d'ailleurs intéressant que des parlementaires puissent y participer, certains pays envoient une représentation parlementaire. Les Allemands sont peu présents mais les Britanniques le sont activement. C'est le lieu où l'on discute. Cette année il y aura un discours d'ouverture du Premier ministre japonais Shinzo Abe, mais il ne s'agit pas pour notre pays seulement de ventes d'armement, mais d'afficher notre responsabilité en tant que membre du P5 et au-delà de participer à des discussions sur des sujets plus globaux comme la cybersécurité, la liberté de circulation sur les océans, le terrorisme, les questions qui sont moins territorialisées. En cas de conflagration, il faut aussi avoir des capacités de projection, certes celles de la France sont réduites mais elles existent. Nous sommes donc présents. Les pays de la région ne souhaitent donc pas nous évincer, mais ce qu'ils ne souhaitent pas c'est que nous les obligions à choisir entre les États-Unis et la Chine ou que nous nous érigions en médiateur neutre. La réponse est aussi prescriptive, cette région est le centre de gravité de l'économie mondiale, elle devient le centre de gravité stratégique, le lieu où pourraient se déclencher des conflits majeurs. Il faut donc y assurer une présence en dépit des problèmes budgétaires et des problèmes plus pressants dans notre voisinage en Afrique ou au Moyen-Orient.
Cela étant, il y a eu jusqu'à maintenant peu de changements dans la redistribution des forces américaines, l'objectif à l'horizon 2020 est une répartition de 60% des forces navales sur la zone pacifique-Océan Indien et 40% sur la zone Atlantique-Méditerranée, mais ce but est vague et dépend aussi de la façon dont on comptabilise ces forces.
Ce qui est important à considérer, ce sont les accords bilatéraux passés avec Singapour, avec les Philippines et d'autres ainsi que les ventes d'armes de haute technologie au Japon, à la Corée du sud par exemple. Tout cela a plus d'importance que les 2500 « marines » déployés dans le nord de l'Australie qui reste tout de même assez éloignée de Pékin.

On peut sans doute être sensible à la rengaine selon laquelle le Moyen-Orient n'est plus une priorité pour les États-Unis. Il n'empêche qu'ils continuent à soutenir fortement Israël et que tant que le problème israélien ne sera pas résolu, rien ne sera résolu au Moyen-Orient qui restera une zone de tensions fortes et il sera difficile d'éviter un désarmement nucléaire de cette zone.
Sans doute, les États-Unis se positionnent-ils sur le Pacifique, mais en attendant les conflits sont ailleurs. N'occultent-ils pas délibérément l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique, qui sera le continent du XXIè siècle, alors même que deux grandes puissances, la Russie et la Chine, s'intéressent à ce fuseau-là ? Ne commettent-ils pas une erreur d'appréciation ?
Je vais probablement décevoir ceux qui sont attachés, comme moi, à la résolution du problème palestinien, mais la réalité est que ce conflit n'est pas au coeur des problèmes de la région. Ce qui structure la région, c'est l'antagonisme entre l'Iran et l'Arabie saoudite et si l'on veut résoudre les crises c'est d'abord un accord entre ces deux pays que l'on doit viser, ce qui pourrait débloquer le dossier du nucléaire iranien et celui de la guerre civile en Syrie. Sur ce dernier, je suis pessimiste car aucune des deux puissances qui soutiennent les forces en présence ne souhaitent perdre et chacune a aujourd'hui intérêt à équilibrer l'autre, sans que l'on ait de visibilité et de solution à court terme.
Pour progresser sur le dossier israélo-palestinien aussi, l'une des clefs c'est la question du Hezbollah, celle du Hamas et donc l'implication de l'Iran. La mère de toutes les crises est donc bien aujourd'hui l'antagonisme entre ces deux puissances régionales. C'est une réalité.
Grâce à nos liens étroits avec l'Arabie saoudite et les pays arabes du Golfe, nous pouvons encourager ce rapprochement, en espérant que l'accord définitif sur le nucléaire iranien s'accompagnera d'une baisse des tensions, mais on peut aussi craindre l'inverse, si les Saoudiens le considèrent comme un jeu de dupes.
S'agissant de l'Afrique, notre présence est justifiée par deux raisons. La première c'est que tant que nous conserverons des capacités militaires à y agir, nous, Français, y serons attirés. La seule façon de ne plus être impliqués au Mali ou en RCA serait de ne plus disposer de ces capacités. Comme les Américains, à partir du moment où nous disposons de ces moyens, nous sommes confrontés au dilemme classique de l'intervention, avec des critiques quel que soit le choix opéré : « damned if you do, damned if you don't ». Si l'on n'intervient pas, on est accusé de laisser faire, si l'on intervient de néo-colonialisme ou d'agir pour sauvegarder nos intérêts économiques. La seconde raison est que l'Afrique est un continent d'avenir au-delà des zones de conflits, il y a des pays qui se développent comme le Nigeria, l'Éthiopie, le Mozambique ou l'Angola... et que nous devons nous tourner vers ces pays qui nous sont moins familiers.
Les États-Unis portent assez peu d'attention à l'Afrique, hors la lutte contre le terrorisme. Les principaux acteurs ne sont pas la Russie, mais la Chine et aussi la Corée du sud, l'Inde et le Brésil qui a une véritable politique africaine.

Vous nous avez rappelé que les dirigeants américains avaient l'impression d'avoir perdu huit ans en se consacrant exclusivement à la lutte anti-terroriste, sans se préoccuper beaucoup des pays émergents et qu'ils entendaient dès lors rattraper ce retard. Cependant, un attentat majeur sur le sol américain ne serait-il pas susceptible de modifier cette nouvelle approche ? Enfin, le temps perdu a-t-il été rattrapé avec les émergents ou bien les relations sont-elles profondément affectées ?
On voit bien comment, aux États-Unis, on a ces vagues d'introversion et d'extraversion qui coïncident souvent avec une baisse ou une hausse des budgets de la défense. Généralement, ce sont les décennies paires qui sont marquées par une intervention forte dans les affaires du monde : les années 40 avec la Seconde Guerre mondiale, les années 60 avec la guerre froide et l'engagement au Vietnam, les années 80 avec Reagan et l'initiative de la guerre des étoiles, les années 2000 avec l'engagement en Afghanistan et en Irak. Au contraire, les années impaires sont des années de retour vers les préoccupations intérieures et de diminution des budgets militaires, les années 50 avec Eisenhower, les années 70 avec le retrait du Vietnam et la contraction opérée par Nixon, les années 90 dans une moindre mesure et les années 2010 où l'on voit également ce double phénomène. Il est peu probable qu'un nouvel attentat terroriste change cette orientation comme a pu le faire celui du 11 septembre 2001 car la tendance à l'introversion est tellement forte et cela ne serait pas suffisant pour transformer l'opinion publique et lui faire soutenir une intervention. Ce que fait le président Obama fait pour assurer la sécurité des États-Unis sans être obligé d'envoyer un corps expéditionnaires de 150 000 hommes, grâce à l'emploi des forces spéciales, des drones, et des moyens de cyberguerre serait utilisé davantage. Cela étant, le risque d'un attentat n'est pas exclu, il y a des tentatives fréquentes et certaines très sérieuses.
S'agissant de la relation avec les pays émergents, il est probable que le président Obama a été très optimiste. Il a ainsi tenté de promouvoir le G20 comme un instrument de gouvernance mondiale en 2009 à Pittsburgh, or le G8 existe toujours et le G20 a eu du mal à se structurer, parce que ces pays restent prisonniers d'un grand souverainisme, ils sont réticents vis à vis de la gouvernance mondiale et des solutions coopératives et à produire des efforts sur des questions comme le climat ou la régulation financière. Il y a eu aussi une certaine désillusion à l'égard de la Chine qui est venue avec Copenhague en 2009 et s'est poursuivie en 2010 avec un durcissement dans le dialogue stratégique. À cela s'ajoutent nombre de petits irritants, avec l'Inde, avec le Brésil sur la question de la NSA, avec l'Indonésie, avec l'annulation de trois visites du président Obama avant qu'il ne se déplace dans ce pays. Les relations ne se sont donc pas aussi faciles.

Pourriez-vous revenir sur la question de la production de gaz de schiste ? Certains observateurs ont considéré que cela allait bouleverser l'économie mondiale. Vous l'avez minimisée, or cela me semble pouvoir conforter la politique de désengagement du président Obama. J'ai lu aussi qu'il y avait un peu de désillusion sur l'exploitation de ces ressources aux États-Unis.
Ce que je contestais, ce n'est pas l'importance de ce bouleversement économique, mais l'assertion selon laquelle il conduirait à rendre les États-Unis de plus en plus indépendants et à se désengager des affaires du Moyen-Orient, et donc l'impact sur leur posture stratégique. Les États-Unis restent la puissance dominante et se considèrent comme responsables en dernier ressort de l'ordre et de la stabilité du monde. À ce titre, ils ne peuvent donc se désintéresser de ce qui se passe sur le marché du pétrole et donc de la stabilité du Moyen-Orient. Cela étant, dire que cela n'a aucun impact n'est pas vrai non plus. Cela a un effet dans les relations des États-Unis avec les autres acteurs. Quand Obama parle avec Xi Jinping ou avec les leaders au Moyen-Orient, tous savent qu'ils disposent de marges de manoeuvre supplémentaires et en tiennent compte, c'est donc un jeu assez subtil.
L'incidence est très significative sur le plan économique. Il y a une petite désillusion parce que le rythme d'attrition des gisements est plus important que prévu, mais il y a la mise au point de nouvelles techniques et d'autre part le pétrole de schiste est en croissance. Il y a donc un impact direct en ressources directes et indirectes, avec des ressources fiscales, du développement économique, un renouveau des industries de la chimie, des changements dans la consommation énergique avec une substitution du gaz au nucléaire ce qui a profondément affecté la filière aux États-Unis, et enfin la transformation des terminaux qui d'importateurs deviennent des terminaux exportateurs. Les répercussions sont aussi indirectes, ainsi l'arrivée des gaz de schiste sur le marché a eu pour effet une baisse des prix du charbon et en conséquence une utilisation plus massive de cette énergie par l'Allemagne au moment où elle effectue sa sortie du nucléaire. Le prix du gaz est de plus en plus mondialisé, on se rapproche du marché du pétrole. Des pays, comme la Pologne, profitent de la mondialisation du marché pour réduire sa dépendance du gaz russe. L'impact est donc profond, y compris pour l'Europe qui bien que n'étant pas producteur, profite de la baisse des prix de l'énergie, que la production de gaz de schiste induit. Mais l'impact le plus marquant sera un renouveau de la puissance industrielle américaine qui bénéficie d'un avantage compétitif avec un prix très faible de l'énergie.

Faut-il dès lors que l'Europe se lance dans la production de gaz de schiste ?
L'Europe n'a pas le même territoire que les États-Unis, cela pose la question de l'acceptabilité et aussi des questions juridiques importantes. Il n'y a peut-être pas de désavantages à attendre quelque peu, d'autant que les technologies évoluent rapidement.

Va-t-on vers une théorisation de la présence américaine en Afrique ? Par ailleurs, les incertitudes turques représentent-elles un souci pour les États-Unis ? Et, enfin, quelle est votre appréciation sur les travaux du groupe de Minsk sur la résolution des conflits du Caucase du sud ?
Je ne pense pas qu'il y aura une modification de la posture américaine en Afrique, il n'y aura pas de changement institutionnel, de modifications du rôle d'Africom. Les États-Unis sont plutôt satisfaits du modèle mis en place avec l'opération française au Mali en 2013 d'intervention d'une autre puissance qu'eux-mêmes et ils se voient le compléter avec des moyens légers comme on le voit sur les frontières au sud de la Libye à l'aide de drones, de renseignement et de forces spéciales pour contrôler la situation.
La Turquie a largement perdu sur beaucoup de fronts depuis quelques années. Sa politique était celle du « zéro problème avec les voisins ». Or aujourd'hui, elle a des problèmes avec tous ses voisins. Cette politique a été contrariée sur à peu près tous les fronts. Certaines positions notamment vis-à-vis de la Syrie et de l'Égypte des Frères musulmans ont été définies pour partie en des raisons des orientations intérieures.
Sur le groupe Minsk, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais des discussions avec les responsables du dossier ne m'incitent pas à beaucoup d'optimisme sur ce sujet.