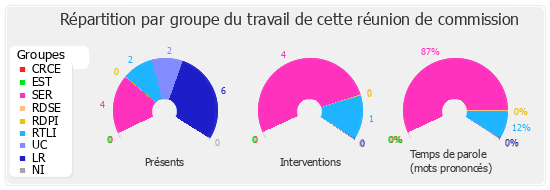Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale
Réunion du 13 janvier 2015 : 1ère réunion
Sommaire
- Audition de mme soraya amrani mekki candidate proposée par le président de la république pour siéger au sein du conseil supérieur de la magistrature (voir le dossier)
- Audition de m. jean danet candidat proposé par le président de la république pour siéger au sein du conseil supérieur de la magistrature (voir le dossier)
- Audition de mme jacqueline de guillenchmidt candidate proposée par le président du sénat pour siéger au sein du conseil supérieur de la magistrature (voir le dossier)
- Audition de m. georges-eric touchard candidat proposé par le président du sénat pour siéger au sein du conseil supérieur de la magistrature (voir le dossier)
La réunion
Audition de Mme Soraya Amrani mekki candidate proposée par le président de la république pour siéger au sein du conseil supérieur de la magistrature
Audition de Mme Soraya Amrani mekki candidate proposée par le président de la république pour siéger au sein du conseil supérieur de la magistrature
La commission procède à des auditions, en application de l'article 65 de la Constitution, de personnalités qualifiées pour siéger au sein du Conseil supérieur de la magistrature.

Conformément à l'article 13 de la Constitution, les commissions des lois des deux assemblées se prononcent ensemble sur la nomination des membres du Conseil supérieur de la magistrature proposés par le Président de la République et séparément sur celles proposées par le président de leur assemblée, les nominations étant confirmées en l'absence d'une opposition aux trois cinquièmes. Nous voterons demain matin à 8 heures et demie et dépouillerons les bulletins en même temps que la commission des lois de l'Assemblée nationale.
Nous écoutons d'abord Mme Soraya Amrani Mekki, agrégée de droit privé et de sciences criminelles, docteure de l'université de Paris I Panthéon Sorbonne et depuis 2011 professeure à l'université de Paris X Nanterre, membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, du Centre contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme, et auteur de nombreux rapports et publications.
C'est un grand honneur pour moi de me présenter devant vous pour siéger au Conseil supérieur de la magistrature, cet organe constitutionnel qui garantit l'État de droit en veillant à l'indépendance de la justice - qui est une institution, mais aussi une valeur. Cette création continue de la République, selon les termes de Jean Gicquel, a évolué par strates successives. En être membre, en tant que personnalité qualifiée, est un honneur mais aussi une grande responsabilité.
Mon parcours scientifique témoigne d'un intérêt central pour l'organisation et le fonctionnement de la justice ; mon expérience au sein de certaines institutions me fait porter un autre regard sur le système judiciaire, plus social ou sociétal : l'indépendance de la justice n'est pas faite que pour les magistrats, elle est surtout faite pour les justiciables.
Agrégée des facultés de droit et professeur à l'université Paris Ouest Nanterre La Défense, je suis ce que les universitaires appellent une « processualiste » - pour éviter de parler de « procéduriers », ce qui serait péjoratif et réducteur : le droit processuel est en effet l'étude de la science du procès. La procédure n'est pas qu'une mécanique de réalisation des droits substantiels ; elle les sert sans leur être servile. L'effectivité des droits, y compris des droits de l'homme, dépend de l'effectivité du droit au juge, lui-même déterminé par les règles que les Canadiens appellent de « pure procédure », mais aussi de l'administration de la justice et des manières de faire, des savoir-faire et des savoir-être, dont parle le directeur de l'École nationale de la magistrature (ENM). Il s'agit donc de mêler théorie et pratique du procès : pour reprendre les mots du doyen Carbonnier, « que serait la tête sans les bras ? »
J'ai débuté cette spécialisation par un travail de doctorat sur le temps et le procès civil, y compris en termes de respect des droits fondamentaux : le droit à un procès équitable requiert une certaine célérité de la justice, mais celle-ci doit rimer avec sérénité et ne pas être confondue avec la précipitation. Dans la lignée de ma thèse, mes travaux doctrinaux sont centrés sur la recherche de l'efficacité du procès civil : celle-ci passe par une réflexion sur la déjudiciarisation, rendue nécessaire pour des raisons budgétaires. D'où un incroyable essor des modes alternatifs de résolution des litiges, qui amène à s'interroger sur le coeur de la mission du juge. J'ai aussi travaillé à l'analyse économique du procès - sans comparer, comme l'ont fait certains, la justice à une entreprise, des magistrats ont considéré que devant répondre à des besoins infinis avec des moyens finis, elle devait faire des choix. J'ai aussi réfléchi à l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui ne sont pas un outil miracle de gestion des flux contentieux et qui peuvent mettre en cause l'indépendance et l'impartialité des magistrats.
J'ai également participé aux commissions ministérielles Magendie 1 et 2 sur la célérité de la procédure en première instance en 2004 et en appel en 2008, qui devaient proposer des réformes à coût constant, préservant les droits fondamentaux. J'ai aussi travaillé avec les professionnels de justice rencontrés au cours de conseils scientifiques, de colloques ou de formations continues à l'ENM.
J'ai acquis un autre regard au sein d'institutions telles que la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) - dont je préside la sous-commission Éthique, société et éducation aux droits de l'homme. Cette instance, qui donne son avis sur les projets et propositions de loi, n'est pas un Conseil d'État bis. Elle procède à l'audition d'experts d'horizons variés : anthropologues, sociologues, philosophes. Sa composition reflète la société civile, avec des associations, des syndicats, des représentants de religions et des personnalités qualifiées. Ses débats montrent un décalage - pour ne pas dire un gouffre - entre l'institution judiciaire et la perception qu'en a la société civile. L'effectivité des droits de l'homme passe par l'effectivité du droit au juge, surtout à un bon juge, ce « tiers impartial et désintéressé » selon Kojève, qui doit avoir les moyens de son indépendance et de son impartialité : tel est le rôle du Conseil supérieur de la magistrature.
J'ai aussi, depuis plus d'un an et demi, l'expérience de l'observatoire national de la laïcité, qui traite de questions sensibles, sources de tensions politiques, mais parvient à des avis, le plus souvent avec un large consensus, sur le respect des valeurs républicaines. J'ai enfin un regard sur l'indépendance des experts, en tant que membre du comité « Indépendance et déontologie » de la Haute autorité de santé (HAS), où les enjeux sanitaires et financiers sont colossaux : il s'agit de distinguer les liens d'intérêt entre experts et laboratoires des véritables conflits d'intérêts. Ses avis sont rendus dans le souci de l'indépendance en action.
J'espère que mon parcours scientifique comme institutionnel, témoignant de mon vif intérêt pour les garanties qu'offre le Conseil supérieur de la magistrature à l'État de droit, mais aussi pour ses procédures internes, pourrait lui apporter une contribution enrichissante.

Merci, Madame. Le Conseil supérieur de la magistrature doit parfois se prononcer sur des questions de déontologie, auxquelles vous avez réfléchi ; toutefois, sa compétence principale concerne les nominations et la discipline des magistrats. Comment abordez-vous cette fonction et la forte dimension de gestion des ressources humaines, qui constitue le pain quotidien du Conseil ?

Le projet de réforme du Conseil supérieur de la magistrature aligne les conditions de nomination des magistrats du parquet sur celles des magistrats du siège, afin d'échapper aux récurrentes décisions de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), qui persiste à considérer que le parquet français n'est pas constitué de magistrats. Qu'en pensez-vous ?

Les procédures d'arbitrage prévues par le Traité transatlantique sont-elles une menace pour l'État de droit ?
Examiner toutes les nominations, comme le fait le Conseil supérieur de la magistrature, s'apparente à un travail de bénédictin, qui exige une présence assidue et relève en effet de la gestion des ressources humaines. En tant que processualiste, j'ai l'habitude de faire le lien entre un travail aride et administratif et les enjeux fondamentaux qui se cachent derrière. Examiner les nominations requiert une analyse des procédures : travail préalable de la commission d'avancement, transparence, critères qui se dégagent des rapports d'activité. La participation concrète et quotidienne aux travaux me permettra de mieux appréhender ces procédures de nomination.
Le Conseil supérieur de la magistrature a évolué, depuis sa création en 1883, en strates successives, vers toujours plus d'indépendance. Le projet de loi de 2013 était extrêmement positif. Il y a une opposition assez forte entre la position du Conseil constitutionnel et celle de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), qui dans ses arrêts Medvedyev et Moulin contre France a considéré que le ministère public n'était pas une autorité judiciaire indépendante au sens de l'article 5 paragraphe 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, c'est-à-dire suffisamment indépendante pour garantir les libertés individuelles. Ces décisions ont beaucoup heurté les magistrats du parquet, qui s'estiment indépendants. Il y a pourtant une différence entre l'indépendance et l'apparence d'indépendance, que le système actuel ne garantit pas. Le projet de réforme aligne les procédures de nomination mais aussi disciplinaires des magistrats du parquet sur celles des magistrats du siège, ce qui marque une avancée. Mais il est indispensable d'en envisager les répercussions au sein du système judiciaire : l'avis conforme ne doit-il pas s'accompagner d'un droit de proposition pour les postes les plus importants ? Cette faculté d'initiative et ce nivellement des procédures entraînent-elles des mesures d'organisation internes ? Mettent-elles en cause l'existence de formations différentes au sein du Conseil ? Le fait que les magistrats du parquet, contrairement à ceux du siège, ne soient pas inamovibles, représente aussi une difficulté. Le projet de réforme du Conseil supérieur de la magistrature appelle donc à s'interroger sur le statut du parquet et même sur des équilibres de procédure pénale.
L'arbitrage n'est pas selon moi un mode alternatif de résolution des litiges, que j'interprète comme l'alternative à l'intervention d'un juge - il y a des discussions doctrinales là-dessus. J'estime en effet que l'arbitre est un juge : l'arbitrage est réglementé, institutionnalisé et l'arbitre rend une sentence qui a autorité de chose jugée même si elle n'est pas exécutoire. L'arbitrage touche des domaines publics, donc sensibles. La légitimité de la décision me semble liée aux règles de procédure - chacun voit midi à sa porte... Nous ne pouvons pas être sûrs d'obtenir une décision juste avec une procédure juste ; mais la solution est à coup sûr injuste avec une procédure injuste. L'arbitrage suppose donc des procédures extrêmement précises, respectueuses des garanties du procès équitable et des intérêts en jeu. Si l'arbitrage est préféré aux procédures étatiques, c'est pour sa souplesse et une certaine liberté, que l'institutionnalisation met à mal en mettant en place ce que le doyen Oppetit appelle une « loi de substitution ». C'est ce qui explique le recours aux modes alternatifs de résolution des litiges. Si l'arbitrage est aussi séduisant, c'est peut-être que la justice étatique n'offre pas une alternative satisfaisante.
Audition de M. Jean daNet candidat proposé par le président de la république pour siéger au sein du conseil supérieur de la magistrature
Audition de M. Jean daNet candidat proposé par le président de la république pour siéger au sein du conseil supérieur de la magistrature

Nous accueillons maintenant maître Jean Danet, docteur en droit, avocat honoraire au barreau de Nantes, maître de conférences en droit privé à l'université de Nantes et ancien directeur de l'institut d'études judiciaires, membre du comité de rédaction de la revue Archives de politique criminelle.
C'est un grand honneur de me présenter devant vous comme candidat pour siéger au Conseil supérieur de la magistrature, dont le rôle est essentiel pour assurer la séparation et l'équilibre des pouvoirs, mais aussi pour promouvoir la qualité de la justice, tant par une gestion des ressources humaines adaptée aux mutations contemporaines que par une action préventive, déontologique et, si nécessaire, disciplinaire.
À soixante et un ans, j'ai eu la chance de mener deux carrières professionnelles : après des études de droit à Nantes et à Rennes, j'ai préparé un doctorat d'État, je suis devenu avocat à Nantes en 1980, rejoignant le cabinet de Danielle Frétin et Dominique Raimbourg en 1981. J'ai soutenu en 1982 sous la présidence du doyen Jean Carbonnier ma thèse d'État, intitulée Droit et discipline de production et de commercialisation en agriculture. Puis le métier d'avocat m'a happé : je suis devenu un praticien, ajoutant à ma spécialisation en droit économique une autre en droit pénal, tant au service des victimes que des mis en cause. Élu en 1985 membre du conseil de l'ordre et devenu, à la demande de mon bâtonnier, secrétaire général, fonction qui n'était pas à l'époque professionnalisée comme elle l'est aujourd'hui, j'ai pu apprécier les vertus de la délibération collective.
En 1995, ayant été encouragé par des universitaires nantais et après qualification du conseil national des universités (CNU), j'ai été recruté à Nantes comme maître de conférences : le seul reproche que je faisais au métier d'avocat était de rendre difficile la prise de distance et le temps de la réflexion. Jusqu'à 2000, j'ai mené de front les deux métiers ; mais il m'était difficile de maintenir, en même temps, une activité soutenue de recherche, avec celle, saturée d'urgences, de l'avocat pénaliste. Choix très atypique, j'ai donc sollicité, en bonne intelligence avec mes associés, l'honorariat. J'ai consacré mes recherches à un seul objet d'études, la justice pénale : commentaires de décisions, essais, mais surtout encadrement de recherches pluridisciplinaires avec des juristes, des sociologues, des politistes, des spécialistes du budget de la justice ; ainsi, entre 2008 et 2013, j'ai coordonné un travail de recherche, bénéficiant du soutien de l'Agence nationale de la recherche (ANR), sur la réponse pénale, fondé sur une étude de terrain dans cinq juridictions, comportant des entretiens avec des magistrats mais aussi avec des élus locaux ou des policiers. Ce travail a retenu l'attention de l'inspection générale des services et de certaines directions du ministère.
Pour avoir dirigé l'institut d'études judiciaires, j'ai été amené à réfléchir aux trajectoires des étudiants en droit vers la magistrature, ainsi qu'aux questions de parité, aux différents niveaux du corps, ou de contraction des origines sociales. J'ai réalisé de nombreuses interventions à l'École nationale de la magistrature (ENM), comme dans un récent cycle de formations pour les premiers présidents et procureurs généraux. En 2010, à la demande du ministère des affaires étrangères, j'ai participé à l'évaluation de l'aide apportée par la France à la formation des magistrats dans certains pays ; mes missions au Niger et à Madagascar furent instructives : on apprend ainsi souvent sur nos propres institutions en observant celles des autres.
Mon intérêt pour la magistrature s'est accru du fait de ma participation à diverses instances de réflexion : groupe réuni par le professeur Cadiet en 2011 ayant publié un rapport intitulé Pour une administration au service de la justice ; comité d'organisation de la conférence de consensus sur la prévention de la récidive présidé par Mme Nicole Maestracci ; commission sur l'évolution du ministère public présidé par M. Jean-Louis Nadal ; groupe de travail restreint de la direction des affaires criminelles et des grâces sur les rapports de politique pénale ; colloque sur la justice au XXIème siècle. J'ai eu le privilège d'être entendu régulièrement depuis dix ans par les commissions des lois du Sénat et de l'Assemblée nationale ou des parlementaires. Universitaire libre de sa réflexion, j'ai pu observer sur mon écran d'ordinateur, mais aussi sur le terrain et dans des groupes de réflexion les évolutions de la justice ; j'ai participé à leurs délibérations et, en conséquence, parfois changé d'avis.
Siéger au Conseil supérieur de la magistrature dans les quatre années à venir serait une lourde responsabilité qui exige d'investir son énergie à son service et à celui des valeurs d'impartialité, d'intégrité et de dignité, qui s'imposent non seulement aux magistrats, mais aussi à ses membres. Nombreux sont ceux qui lui souhaitent plus d'indépendance, d'autonomie et de pouvoir, dans la gestion des nominations et des carrières, à commencer par celles du parquet ; les métamorphoses du Conseil supérieur de la magistrature ne sont pas achevées. Les travaux de la conférence internationale à l'occasion de son 130ème anniversaire montrent que tout peut être débattu : sa composition, ses pouvoirs, ses modes de saisine, les relations avec l'ENM et même le pouvoir de gestion des juridictions, voire, pour certains, sa mutation en un Conseil supérieur de justice. Sur toutes ces questions, la Représentation nationale est maître du jeu.
Une autre tâche attend le prochain Conseil : dans le champ actuel de ses compétences, il devra mener à bien certaines évolutions sans modification législative ou constitutionnelle. La qualité de ses travaux et décisions est et sera sa meilleure contribution à ces évolutions. Ses rapports d'activité donnent une idée précise de ce qui peut être fait : poursuite du dialogue avec la direction des services judiciaires, amélioration processuelles des enquêtes disciplinaires, accès du CSM à l'ensemble des études et statistiques de la Chancellerie et de l'inspection générale dans ses missions d'audit. Autant de chantiers repérés par le dernier rapport d'activité et sur lesquels le CSM peut mener un dialogue constructif. L'amélioration constante de ses méthodes concrètes d'appréciation des qualités requises pour diriger les juridictions n'est pas qu'un objectif figurant parmi les indicateurs de performance de la loi de finances. Le défaut d'attractivité de certaines fonctions, notamment au parquet, la manière d'appliquer les règles à la mobilité, l'évolution des dispositions ouvertes par la dernière réforme permettant aux justiciables de se plaindre des magistrats - une bonne chose, mais le CSM ne doit pas devenir le défouloir de toutes les colères des justiciables, y compris les moins fondées. Le Conseil doit aussi évaluer sa propre action et mener une réflexion déontologique.
Si, par ma connaissance de l'institution judiciaire acquise par les quatre points modestes d'observation que j'ai occupés - comme avocat, comme universitaire, comme chercheur et en divers lieux du débat public - je puis participer à la réflexion et à l'action du Conseil et servir ainsi la République et l'indépendance de la justice, je serais très heureux et très honoré.

Vous savez combien notre pays reçoit de décisions de la CEDH, qui portent préjudice, car elles ne considèrent pas les membres du parquet comme des magistrats indépendants. À cet égard, des réformes apparaissent souhaitables, telle que celle qui a été proposée et qui demeure en suspens. Quel est votre sentiment ?

Le Conseil supérieur de la magistrature a fait réaliser un sondage il y a quelques années mettant en évidence le divorce entre opinion publique et magistrature : plus décriés que les magistrats, il n'y avait guère que les politiques et les journalistes ! Cela ne vient-il pas d'une image - juste ou erronée - d'irresponsabilité, notamment dans le cadre de la justice pénale ? La réforme constitutionnelle prévoyant une action populaire a-t-elle remédié au moins partiellement à ce problème ou n'a-t-elle été qu'un coup d'épée dans l'eau ? Lors de rencontres de notre commission avec le Conseil supérieur de la magistrature, nous constations il y a quelques années que le nombre de procédures disciplinaires se comptaient sur les doigts d'une main : soit les magistrats sont une espèce à part, infaillible, soit il y a un problème d'irresponsabilité !
Pierre Fauchon, qui fut un grand parlementaire avant d'être membre du Conseil supérieur de la magistrature, s'inquiétait souvent de l'importance de Sciences-po Paris dans le recrutement des magistrats, estimant que les insuffisances de cette formation expliquaient certains problèmes apparus dans des affaires médiatisées. La compétence sur la forme ne supplée sans doute pas une compétence sur le fond que des études juridiques sont plus à même de fournir. La prépondérance féminine dans l'exercice de la fonction de magistrat vous inquiète-t-il ? Lors d'une conférence à l'ENM que je donnais, je n'ai vu que des femmes ! Ne faudrait-il pas une parité plus importante ?

Vous avez parlé de reproduction sociale dans la magistrature, ce que nous constatons dans une école qui n'est plus guère républicaine depuis trente ans... Que préconisez-vous pour une plus grande diversité ?
La magistrature vient de connaître une époque étrange : en son sein même, des voix en sont venues à préconiser la fin de l'unité du corps. Ce mouvement est en recul, ou du moins il est plus minoritaire qu'on ne pouvait le penser. L'attachement à l'unité du corps y a été très fortement rappelé. Elle ne me semble pas problématique ; même si des aspects peuvent être précisés sur le passage du siège au parquet, c'est un héritage de notre histoire : des procureurs recrutés d'une autre manière présenteraient sans doute plus d'inconvénients que la situation actuelle.
Dès lors, la question du statut du parquet se pose, en raison des positions de la Cour européenne des droits de l'homme. La loi du 25 juillet 2013 a inscrit dans le code de procédure pénale l'impartialité des magistrats du parquet. Sur l'indépendance, je suis, moi aussi, favorable à ce que la réforme aille jusqu'au bout, en alignant la nomination et le régime disciplinaire des magistrats du parquet sur ceux du siège. Cela ne résoudra pas tout : le parquet n'en restera pas moins une partie poursuivante, qui ne pourra pas être le seul garant ni le garant principal des libertés individuelles, mais seulement un « garant en première ligne », pour des atteintes relativement limitées, et non pas des atteintes lourdes, comme des durées de garde à vue prolongées, qui relèvent d'un juge. Mais nous pourrions trouver un équilibre et pérenniser le système français de ministère public, en assurant une certaine sérénité.
Monsieur Lecerf, j'ai lu comme vous ces sondages d'opinion : les citoyens qui font l'expérience d'être jurés d'assises disent y arriver pleins de « y'a qu'à » et de « faut qu'on », mais en sortir avec l'idée qu'il est difficile de rendre la justice. C'est pourquoi je suis un très chaud partisan des jurys populaires d'assises, qui nous ont évité un divorce profond avec l'opinion publique sur les affaires graves. Il y a beaucoup à faire : la saisine par les citoyens est une bonne chose, mais il faut que les citoyens et leurs conseils comprennent mieux ce droit. En effet, près des trois quarts des saisines depuis la réforme ont été déclarées irrecevables. La loi nouvelle met du temps à s'acclimater.
Une autre saisine disciplinaire me semble aussi importante : celle des chefs de cour, qui ne peuvent pas se voiler la face lorsque, dans des débats informels avec les bâtonniers, il leur revient aux oreilles qu'un magistrat pose des difficultés - pas forcément graves, le plus souvent liées à un comportement problématique en audience. Le Conseil supérieur de la magistrature ne doit pas être mis à l'écart de ces réalités.
Dans certaines facultés de droit, nous, universitaires, avons eu tendance à penser à tort que l'excellence devait conduire à des carrières universitaires. Non ! Les bons élèves peuvent aussi devenir magistrats. Les instituts d'études judiciaires (IEJ) n'ont pas toujours reçu les moyens adaptés à la préparation du concours de l'ENM - et c'est un euphémisme ! Ne surévaluons pas la part des anciens étudiants de sciences politiques, qui ne sont que 25 %, et qui ont, selon les chefs de cours qui les accueillent, des qualités intellectuelles excellentes et des faiblesses techniques qu'ils rattrapent relativement vite. Quant aux anciens étudiants de facultés de droit, ils présentent des faiblesses en culture générale.
Dès lors, comme les IEJ ne les y préparent pas véritablement, ces étudiants viennent à Paris s'inscrire dans un IEJ ou dans une préparation privée. Cela coûte cher : d'excellents candidats renoncent à s'inscrire pour des raisons financières. Il y a donc un manque. Le service public de l'université doit assurer la préparation au concours de l'ENM. Il est choquant que les candidats soient contraints de passer par une prépa privée, dont les cours sont d'ailleurs assurés par des enseignants de ces mêmes universités.
Quant aux résultats du concours, ils sont le reflet de la première année de droit où un tiers des étudiants sont des garçons et deux tiers sont des filles. Les universités doivent expliquer ce qu'est le métier de magistrat. Je constate que mes étudiants de première année ont des représentations fausses à cet égard. La parité, c'est aussi la question du plafond de verre. Peu de femmes accèdent aux plus hautes fonctions de la magistrature. Il faut travailler sur les deux fronts. La parité absolue n'a pas de sens, mais il faut éviter les déséquilibres trop lourds. L'attractivité des postes au parquet est liée à ces questions. Il s'agit de fonctions dures à assumer pour des femmes qui ont des contraintes familiales. Nous devons réfléchir à ces sujets. C'est l'une des tâches du CSM.
Audition de Mme Jacqueline de Guillenchmidt candidate proposée par le président du sénat pour siéger au sein du conseil supérieur de la magistrature
Audition de Mme Jacqueline de Guillenchmidt candidate proposée par le président du sénat pour siéger au sein du conseil supérieur de la magistrature

Nous accueillons Mme Jacqueline de Guillenchmidt, candidate proposée par le président du Sénat. Mme Jacqueline de Guillenchmidt présente l'originalité d'avoir été avocate, magistrate, conseillère d'État, membre du Conseil constitutionnel et membre du CSA ! Peu de personne ont une telle expérience de la pratique du droit. Il ne manquait plus, en somme, qu'une nomination au CSM... Il vous reste à nous convaincre que c'est une bonne idée.
Je suis reconnaissante au président du Sénat d'avoir proposé ma candidature au CSM.
Après avoir quitté le Conseil constitutionnel, en mars 2013, je me suis réinscrite au barreau de Paris. Si vous confirmiez ma nomination, je demanderais aussitôt au bâtonnier de me retirer de la liste des avocats parisiens car cette fonction est incompatible avec un mandat au CSM.
J'ai commencé ma carrière au barreau de Paris dans les années 70, à une époque où l'on ne comptait que 3 500 avocats à Paris, contre 22 000 aujourd'hui. J'étais avocate généraliste et traitais des dossiers variés : droit des assurances, prud'hommes, beaucoup de divorces, etc. Nous étions saisis de beaucoup de dossiers d'aide juridictionnelle - on parlait alors d'aide judiciaire -, ce qui m'a mise en prise directe avec des justiciables en détresse issus de milieux défavorisés. Puis j'ai voulu voir l'envers du décor, découvrir comment l'on rendait la justice et, après sept ans de barreau, j'ai demandé mon intégration dans la magistrature, au titre de l'article 22 de l'ordonnance de 1958. J'ai été nommée juge d'instruction à Pontoise, confrontée à la délinquance de banlieue. Pendant ces trois ans, j'ai découvert l'articulation entre le siège et le parquet. J'en garde un très bon souvenir car les relations étaient loyales et constructives. Cette expérience a eu une influence sur mes idées concernant l'unité du corps judiciaire, à laquelle je suis très attachée et que le Conseil constitutionnel rappelle régulièrement.
Ensuite, j'ai rejoint la Chancellerie, comme légiste à la direction des affaires civiles et du Sceau, au bureau du droit commercial puis au bureau des professions judiciaires et juridiques. À cette époque, la grande loi était le texte sur le redressement judiciaire et la liquidation des entreprises. J'ai participé à la rédaction du décret qui ne comportait pas moins de 240 articles... Cela a constitué une excellente formation !
En 1993, Pierre Méhaignerie m'a appelée à son cabinet comme conseillère technique puis comme directrice adjointe de cabinet. J'ai acquis une vision plus globale des dossiers et une vision plus politique. L'oeuvre législative a été importante - loi sur la nationalité, loi bioéthique,... - et j'ai eu l'occasion d'être entendue plusieurs fois par la commission des lois du Sénat.
Puis j'ai été nommée au Conseil d'État au tour extérieur ; j'y ai découvert la justice administrative. J'en garde un très bon souvenir. Siégeant à la section de l'intérieur, j'ai été rapporteure de plusieurs lois pénales, comme la loi du 15 juin sur la présomption d'innocence. Cette loi a fait des émules, peut-être trop d'ailleurs, car l'empilement des textes rend la lecture du code de procédure pénale difficile.
Quatre ans plus tard, le Président du Sénat m'a nommée membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; cinq ans et demi plus tard, toujours à son initiative, j'ai été nommée membre du Conseil constitutionnel. C'est la troisième fois qu'un président du Sénat me désigne pour siéger dans une institution. Au CSA, j'étais chargée du respect du pluralisme politique dans l'information et lors des élections, ainsi que des questions radiophoniques. J'ai fait ainsi l'expérience nouvelle de la régulation d'un secteur économique. L'enjeu à l'époque était la montée en puissance d'Internet, la convergence des médias et la régulation à appliquer à Internet. Mes interlocuteurs étaient les entreprises de l'audiovisuel et j'ai découvert les enjeux économiques de ces entreprises. J'ai ensuite passé neuf années particulièrement enrichissantes et passionnantes au Conseil constitutionnel, surtout après le bouleversement, au bon sens du terme, provoqué par la question prioritaire de constitutionnalité, qui donne plus de droits aux citoyens.
Je serais aujourd'hui heureuse de mettre mon expérience au service du CSM. Je mesure que la tâche est importante car cette institution façonne les juridictions en désignant les personnes les plus compétentes pour les diriger.

Votre parcours est impressionnant... Que pensez-vous d'une réforme du CSM afin de modifier les conditions de nomination des membres du parquet ? La CEDH considère en effet que l'indépendance des magistrats du parquet n'est pas suffisante...
Dans des décisions récurrentes, la CEDH a considéré que les magistrats du parquet n'étaient pas indépendants en raison du lien hiérarchique avec l'exécutif. La cour ne remet pas en cause leur qualité de magistrat, mais considère qu'ils ne sont pas suffisamment indépendants pour statuer sur des questions de privation de liberté. Elle a ainsi condamné la France lorsqu'un magistrat du parquet a statué sur des prolongations de garde à vue qui excédaient une durée raisonnable.
Je suis favorable à ce que l'on aligne les conditions de nomination des membres du parquet sur celles du siège, pour que le CSM ait l'initiative des nominations et désigne les chefs des différents parquets. Cela serait salutaire pour l'unité du corps judiciaire, idée à laquelle je suis très attachée. Il est aussi important que les membres du parquet aient la qualité de magistrat. Cette fonction requiert un serment et des règles déontologiques. La nomination par le CSM ne serait pas une révolution, les derniers gardes des Sceaux ont toujours suivi les avis du CSM, mais cette réforme aurait l'avantage de mettre en accord la pratique et les textes et serait bonne pour la démocratie.

Il arrive souvent aux parlementaires de s'insurger contre le dogme d'infaillibilité du Conseil constitutionnel, dont les décisions s'imposent à tous. Toutes proportions gardées, il en va de même pour le CSM, qui n'a statué qu'à dose homéopathique sur la responsabilité des magistrats.... Une réforme a rendu possible la saisine du CSM par les justiciables. Ses résultats restent incertains. Quelle est votre position à ce sujet ?
Cette question a trait directement à l'indépendance des magistrats. Si le magistrat doit être indépendant dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle, il doit être responsable de ses actes et de son comportement, comme tout citoyen. La saisine du CSM par les justiciables est une bonne réforme. Ses résultats sont minces car la réforme est récente : 300 demandes déposées, dont seule une vingtaine était recevable. Laissons-la monter en charge. Il faut expliquer aussi que cette saisine ne constitue pas une nouvelle voie de recours contre la décision mais l'occasion de saisir le CSM d'un comportement fautif du magistrat. Le succès de cette réforme serait bénéfique à la justice. On entend trop souvent dire que les magistrats sont les seuls avec les journalistes à être irresponsables. Il faudrait aussi que les justiciables soient assistés d'un avocat, bien des demandes n'étant constituées que d'une simple lettre très imprécise.
Audition de M. Georges-Eric Touchard candidat proposé par le président du sénat pour siéger au sein du conseil supérieur de la magistrature
Audition de M. Georges-Eric Touchard candidat proposé par le président du sénat pour siéger au sein du conseil supérieur de la magistrature

J'ai plaisir à accueillir M. Georges-Éric Touchard, haut fonctionnaire, ancien directeur des services du Sénat, second candidat proposé par le président du Sénat pour siéger au sein du Conseil supérieur de la magistrature.
Je suis très honoré et intimidé de me présenter devant vous, dans une salle que je connais bien, mais non depuis cette place...
Je commencerai par présenter le contexte tel qu'il m'apparaît. La tendance est à l'ouverture et à l'influence croissante du CSM. Les personnalités qualifiées sont passées de deux à six entre 1958 et 2008 ; depuis 1993 un avocat représentant le conseil national des barreaux y siège ; la majorité de membres n'est plus désignée par le pouvoir exécutif ; les magistrats sont devenus minoritaires dans toutes les formations, sauf dans les formations disciplinaires. L'ouverture, très régulée, d'une saisine directe par les justiciables, la possibilité pour les chefs de juridictions de saisir les instances disciplinaires, indépendamment du garde des sceaux, la fin de la présidence du CSM par le président de la République ou le garde des sceaux, enfin la compétence générale, de fait, de la formation plénière en matière d'indépendance des magistrats constituent des évolutions progressives, mais significatives, qui s'inscrivent dans un mouvement continu, appuyé par la doctrine. On constate aussi que la proportion de membres représentant la haute magistrature diminue, notamment en formation plénière.
Les méthodes et les procédures internes des différentes formations du CSM me semblent déterminantes pour soutenir, parallèlement à la loi, les évolutions. Cela est particulièrement sensible pour la transparence des procédures de nomination et des garanties de la défense en matière disciplinaire. Cela apparaît aussi dans un rapprochement, de fait, non négligeable entre le traitement des magistrats du parquet et ceux du siège. L'autonomie de la formation plénière par rapport à l'exécutif est de plus en plus sensible. Certains considèrent que ce mouvement est un progrès qu'il faut parachever. D'autres critiquent les lourdeurs, la dilution des responsabilités et craignent l'irruption latente de considérations politiques, voire une perte de compétence technique.
L'accentuation de ce mouvement vers un conseil de justice indépendant présente des difficultés au regard du statut juridique du CSM. Les rapports entre le chef de l'État et le CSM sont régis par la Constitution. Celle-ci ne prévoit pas de réelle séparation des pouvoir. En effet, selon l'article 64, le Président de la République est le « garant » de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Dans cette tâche, il est assisté du CSM. Mais c'est l'autorité judiciaire qui assure le respect de la liberté individuelle dont elle est la « gardienne » (article 66). Ces équilibres institutionnels, peut-être obsolètes, masquent des attentes et des interrogations. Tout d'abord une attente de moyens et d'efficacité de la part des justiciables à l'égard d'une justice qui est rendue en leur nom. Il y a aussi un double rejet, quelque peu contradictoire, de l'hermétisme et du corporatisme de la justice, ainsi que de sa politisation supposée. La pertinence de la spécificité reconnue de droit au ministère public, en matière de nomination et de discipline, est en question. Se pose aussi la question d'une nouvelle réforme constitutionnelle transformant le CSM en un conseil de justice indépendant qui serait garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Enfin, le CSM est structuré autour d'équilibres constitutifs et de pratiques de fonctionnement subtilement élaborés. L'organisation du CSM traduit fidèlement les équilibres croisés qui sont la marque de notre système judiciaire. Elle reflète l'unité des magistrats et la dualité de leurs fonctions, cristallisées par deux formations distinctes, conformément à l'article 65 de la Constitution, l'une pour le siège, l'autre pour le parquet. Il est tenu compte subtilement de la multiplicité et de la hiérarchie des juridictions au sein de chacune des formations. L'équilibre est aussi très fin dans les méthodes de travail qui tendent vers la transparence maximale des procédures de nomination et l'inclusion d'un maximum de garanties procédurales en matière disciplinaire. Une grande attention est portée aux thématiques qui concernent l'avenir de la justice : les considérations d'éthique, le respect du justiciable, l'efficacité de la justice, le souci de prévisibilité des décisions par le renforcement des motivations, la formation continue, l'ouverture aux disciplines extra-judiciaire, etc.
L'implication dans cet univers professionnel exige beaucoup de volonté. Ancien fonctionnaire du Sénat, je n'ai aucune compétence particulière dans le domaine judiciaire. Plusieurs considérations m'ont toutefois conduit à accepter de me présenter pour accomplir cette tâche. La première est l'honneur d'avoir été proposé par le président du Sénat, nomination qui s'inscrit dans le prolongement de trois nominations de fonctionnaires du Sénat à des fonctions similaires. Ensuite, une personnalité qualifiée doit être, plus ou moins selon les choix, liée au monde spécialisé concerné. Elle doit pouvoir comprendre le monde dans lequel elle est projetée pour être utile à son fonctionnement. Pour cela il lui faut disposer d'une expérience sérieuse dans une sphère professionnelle ouverte. À cet égard, mon expérience au Sénat m'a fourni certains réflexes précieux : une méthodologie, voire une culture, du travail préalable à toute décision, à travers l'étude systématique des avantages et des inconvénients d'une mesure, de ses impacts, l'audition systématique de tous les assujettis éventuels, les comparaisons étrangères, l'étude de la jurisprudence, le tout rassemblé dans un rapport aussi précis, synthétique et objectif que possible. De même, la structure du Sénat n'est pas éloignée de celle du CSM, organisé comme dans les modèles de gravitation des philosophes, en sphères de décisions emboîtées, qui s'autorégulent et s'équilibrent mutuellement : séance publique et commissions, conférence des présidents, Bureau et questure, groupes politiques de la majorité et de l'opposition, services administratifs et législatifs. Enfin, il y a la technique du rapprochement des points de vue à travers le ballet des amendements, examinés du plus éloigné au plus proche, la règle de l'entonnoir, la pratique des discussions groupées, avant de recourir, le cas échéant, au fait majoritaire, pour trancher, sans exclure l'expression des points de vue minoritaires.
J'ai fait des études de droit public jusqu'à 25 ans à l'université de Paris I ; en 1972 j'ai passé le concours d'administrateur du Sénat où j'ai exercé ma carrière de 1973 à 2008, avant de devenir conseiller spécial du président du Sénat entre 2008 à 2011. J'ai été responsable du secrétariat de la commission des Affaires étrangères et de la Défense entre 1989 et 1992, alors présidée par Jean Lecanuet, avant de devenir directeur du cabinet des questeurs et de la sécurité pendant cinq ans, puis directeur du service du secrétariat général de la présidence du Sénat pendant onze ans, auprès des présidents Monory et Poncelet.

Notre commission a conscience qu'en participant au processus de nomination des membres du CSM elle participe au recrutement des recruteurs. La fonction des membres du CSM n'est pas de réaliser un travail de doctrine sur l'avenir de la justice - le Parlement s'en charge, même si le CSM, sollicité par le président de la République, peut émettre des avis. Leur mission essentielle est de rechercher les personnes les plus qualifiées pour exercer certaines fonctions judiciaires. C'est pour cette raison que les expériences les plus diverses doivent être réunies en son sein, notamment une expérience comme la vôtre, qui vous a conduit à émettre des appréciations fondées et impartiales sur le choix des personnes.

Les fonctions de directeur du Sénat sont éminentes, quelle que soit votre modestie...Que pensez-vous du texte en suspens, relatif à la réforme du CSM, qui vise à ce que les magistrats du parquet soient désignés selon les mêmes modalités que les magistrats du siège ? La CEDH considère que les membres du parquet ne sont pas indépendants.
L'enjeu de la réforme du CSM est la sanctuarisation du rapprochement entre le parquet et le siège, notamment pour éviter les décisions défavorables de la CEDH. Les membres du parquet sont des magistrats, au même titre que les magistrats du siège ; ils prêtent tous le même serment de respecter la liberté individuelle, d'agir en toute indépendance et impartialité. La question est de concilier l'indépendance et l'impartialité avec les fonctions de parquetier. Une clarification d'ordre constitutionnel paraît nécessaire. Toutefois, dans la pratique, le fonctionnement du CSM et la jurisprudence du Conseil d'État font que les procédures qui concernant les magistrats du siège et ceux du parquet se rapprochent de plus en plus, et respectent les mêmes garanties. Certes, pour le parquet, les avis du CSM préalables aux nominations ne sont que consultatifs, mais les derniers gardes des sceaux se sont engagés à les suivre. Sa simple consultation protège contre des nominations choquantes. De plus, n'oublions pas la déontologie des magistrats, fondée sur l'indépendance et le libre arbitre. Je suis favorable à une clarification juridique. Les débats sont intéressants et permettront de progresser vers une solution consensuelle. La fin des injonctions individuelles du garde des Sceaux aux magistrats du siège représente un autre élément important. Dans les faits, la différence entre les nominations au parquet et au siège est moins grande qu'on ne le dit souvent, mais si cette évolution est sanctifiée par le droit, elle deviendra incontestable.
Je suis favorable à une clarification et à un alignement, mais il faut progresser consensuellement vers cet objectif.

Je crois comme vous qu'existe un consensus pour aligner les compétences du CSM à l'égard des magistrats du parquet sur celles dont il dispose à l'égard des magistrats du siège. Il reste à trouver une opportunité politique pour faire en sorte que ce consensus se transforme en une loi constitutionnelle. Toutefois cette réforme pose un problème. Le parquet a pour rôle d'appliquer la politique pénale du gouvernement, élu au suffrage universel. Si le parquet, devenu indépendant, s'affranchissait totalement de la politique pénale définie par le Gouvernement, cela ne constituerait-il pas une faute disciplinaire susceptible d'être sanctionnée par le CSM ?
Je ne suis pas capable de répondre à la dernière partie de la question. J'approuve toutes les considérations qui les ont précédées. N'oublions pas toutefois que les parquetiers jouissent de la liberté de parole. Certains praticiens y voient la solution du problème.

Si le parquet devient indépendant, ne sera-t-il pas nécessaire de créer une procédure pour faute si les magistrats ne respectent pas la politique pénale du Gouvernement ? Mais je comprends votre prudence à répondre...
Je suis tenté d'aller dans votre sens...pour voir comment réagirait le Conseil d'État !