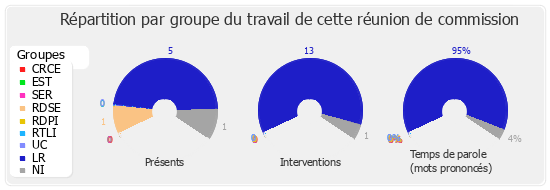Commission d'enquête sur le service public de l'éducation, les repères républicains et les difficultés des enseignants
Réunion du 28 mai 2015 à 9h00
Sommaire
- Audition de mme christine guimonnet professeur certifié hors-classe d'histoire-géographie secrétaire générale adjointe de l'association des professeurs d'histoire-géographie aphg (voir le dossier)
- Audition de m. claude berruer secrétaire général adjoint de l'enseignement catholique (voir le dossier)
- Audition de m. éric debarbieux auteur de l'ouvrage les dix commandements contre la violence à l'école 2008 (voir le dossier)
- Audition de mme natacha polony journaliste auteure de école : le pire est de plus en plus sûr 2011 (voir le dossier)
La réunion
Audition de Mme Christine Guimonnet professeur certifié hors-classe d'histoire-géographie secrétaire générale adjointe de l'association des professeurs d'histoire-géographie aphg
Audition de Mme Christine Guimonnet professeur certifié hors-classe d'histoire-géographie secrétaire générale adjointe de l'association des professeurs d'histoire-géographie aphg

Notre présidente, Mme François Laborde, m'a prié d'accueillir en son nom Mme Christine Guimonnet, secrétaire générale adjointe de l'Association des professeurs d'histoire-géographie (APHG), vieille maison créée en 1910, ce qui prouve que le sujet passionne les enseignants depuis longtemps.
Vous avez enseigné dans l'académie de Nice puis d'Amiens, à l'université de Picardie Jules-Verne et au lycée Paul-Claudel de Laon. Vous êtes venue livrer votre sentiment, nourri du travail de votre association évaluant les conditions dans lesquelles votre enseignement contribuait ou se heurtait au comportement des élèves lorsqu'il s'agit d'enseigner les valeurs qui nous rassemblent.
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, Mme Christine Guimonnet prête serment.
Je vous remercie, au nom de l'APHG, dont le président est Bruno Benoît, professeur à l'Institut d'études politiques de Lyon. Je vous donnerai la température du terrain sans langue de bois, car il est important que vous sachiez ce qui se passe en classe.
Notre métier demande beaucoup d'humilité, de remise en question, d'autoformation. Nous apprécions le contact avec les élèves, nous aimons leur transmettre des connaissances, répondre à leurs questions, leur faire visiter des musées ou des institutions où certains n'iraient jamais. Aimant profondément ce métier, je suis un peu agacée d'entendre tout le monde prétendre mieux savoir que les enseignants comment l'exercer.
L'APHG est une association professionnelle disciplinaire qui réunit des professeurs issus de tous les niveaux du système éducatif, du collège à l'université, de la ville aux zones rurales, d'établissements prestigieux comme Victor Duruy aux réseaux d'éducation prioritaire REP ou REP+, pratiquant tout type de pédagogie, et croisant les disciplines sans qu'il soit utile de l'imposer d'en haut.
Forte d'une bonne connaissance du terrain, l'APHG repose sur l'investissement bénévole des enseignants, sans décharge horaire, dans une époque paradoxale marquée par un détachement vis-à-vis du pouvoir, une multiplication de mouvements à la structuration horizontale, une montée de l'individualisme, une peur de l'engagement alors que le besoin s'en fait sentir, plus que jamais.
Une profonde crise de confiance affecte le corps enseignant. La France a la chance de disposer de personnes formées, compétentes, qui disposent d'une connaissance très développée de leur matière. Les professeurs ne comptent pas leurs heures. Loin de s'en tenir à quinze ou dix-huit heures devant les élèves, ils restent souvent trente heures dans leur établissement, sans compter les heures à la maison - une grande partie de notre travail est invisible.
Les enseignants travaillent avec des humains, non des dossiers numérotés. J'ai des élèves que je suis parfois pendant trois ans. Nos collègues sont fatigués d'entendre et de lire tout et n'importe quoi, comme s'ils n'étaient pas compétents. Nous ne sommes pas des prestataires de service ! Certains ont le sentiment d'une dépossession de leurs savoirs professionnels alors que nous devrions être écoutés en priorité. Quelle autre profession supporterait-elle un tel discours ? Un chirurgien accepterait-il qu'on lui dise comment se comporter dans le bloc opératoire ? C'est scandaleux.
Nous ne sommes pas hostiles à la réforme, mais l'éducation nationale souffre de réformite aiguë. Chaque ministre veut sa réforme. Or il faudrait des réformes plus rares, bien pensées, issues d'une réelle concertation, et dont la finalité ne soit pas purement économique.
L'ambiance d'un établissement est une alchimie : les lycées ne sont pas des entreprises et l'école n'est pas une marchandise. Pour bien réformer, il faut un audit de fond sur ce qui fonctionne bien ou mal, et non un empilement successif de mesures conçues d'en haut, par des personnes sans élèves.
Une proportion croissante d'enseignants motivés perd confiance, or celle-ci est primordiale pour la cohésion d'une société ou d'une institution. Hannah Arendt écrivait que la confiance n'est pas une illusion vide de sens. En 2010, la philosophe italienne Michela Marzano a publié Le contrat de défiance... devenu, en édition de poche, Éloge de la confiance. Lorsque l'on dit aux professeurs qu'on ira dans leur sens et que la réforme va à l'exact opposé, la confiance disparaît. Le mensonge entretient la défiance. Les enseignants se tiennent sur leurs gardes.
Pour analyser une réforme, il faut aller plus loin que le bout de son nez et appréhender les lames de fond. Les réformes offrent toujours plus de dérégulation, plus d'autonomie qui masque le désengagement de l'État. Certains rêvent d'une privatisation de l'école qui serait inacceptable en France. Les professeurs titulaires d'un concours d'État ne sont pas non plus disposés à devenir fonctionnaires territoriaux.
La défiance est aussi liée au fonctionnement du système. À la direction des ressources humaines, la DRH, de l'éducation nationale, le H reste encore à inventer.
Le fossé entre les grands discours et la réalité nourrit cette défiance. Ainsi, la formation des enseignants est déconnectée du terrain et des besoins réels. Une formatrice se déclarant contente d'être débarrassée de ses élèves offre une mauvaise entrée en matière. Il en va de même lorsqu'une conférence, en 1991, s'ouvre par le constat d'un problème dans l'éducation nationale, et de l'absence de solution. La formation continue souffre quant à elle de l'austérité budgétaire.
Les enseignants souffrent d'une déconsidération liée à l'absence de reconnaissance salariale et se sentent méprisés lorsqu'ils entendent des élus, des ministres, leur dire qu'ils n'enseignent pas pour l'argent. Serait-il donc normal de mal les payer ? Nombre d'entre eux restent pourtant sur leur lieu de travail pour aider les élèves à faire leurs devoirs, et ce, sans rémunération.
Les élèves sont pris en charge dans leur globalité, avec leurs problèmes, malgré un manque criant d'infirmières scolaires, de médecins, d'assistantes sociales. Nous sommes confrontés quotidiennement à des drames d'élèves en détresse sociale et sanitaire, à la rue ou mal nourris. L'école est le miroir de la société, elle tente d'en absorber tous les chocs. Mais ce n'est pas son rôle. Celui-ci est d'instruire les élèves. On s'émancipe par le savoir, pas par les compétences. Nous militons pour une école de l'intelligence, de l'ouverture aux autres et au monde, et nous refusons qu'elle soit au rabais et génère des inégalités.
Les enquêtes PISA comparent des systèmes et des mentalités incomparables. Aucun élève français ne supporterait la pression imposée à leurs homologues sud-coréens, qui suivent des cours jusqu'à 22 ou 23 heures.
L'école est le lieu de toutes les attentes. On nous demande du sur-mesure. Mais comment est-ce possible avec 29 ou 30 élèves par classe au collège, 35 en seconde ? On se plaint du niveau des élèves français mais le nombre d'heures diminue en français, en mathématiques, on fractionne les matières, on supprime les Rased... L'échec au collège est lié à l'absence de maîtrise de la lecture, de l'écriture, du calcul à l'issue du CM2. Comment progresser quand on ne comprend pas ce qu'on lit ? Comment comprendre quand on a appris avec une méthode absurde ? Certains élèves de terminale ne savent pas rédiger un paragraphe sans faute. L'école doit transmettre un bagage culturel que des familles ne peuvent pas toujours donner. Quand je travaillais dans la Thiérache, le principal m'expliquait que pour certains, aller au collège signifie déjà faire des études.
La réforme du collège ne devrait pas supprimer les sections bilangues, européennes, qui ne sont pas élitistes, mais les généraliser. Si seulement 20 % des collégiens suivent des cours de latin, c'est parce que les rectorats n'en ouvrent pas pour des raisons strictement budgétaires. Sous couvert de bonnes intentions, on méprise les milieux populaires. On saurait mieux qu'eux ce qui leur convient. Mais les parents de ces milieux veulent que leurs enfants aillent dans de bonnes classes, qu'ils réussissent, parce qu'ils ont compris que l'instruction est la seule chance d'émancipation sociale offerte par la République. Les élèves ont peur de ne pas s'insérer dans la société, de ne pas trouver de travail. Que signifient les valeurs républicaines pour des élèves dont les parents peinent à boucler les fins de mois ? Je préfère évoquer non les élèves qui ne travaillent pas - il y en a - mais ceux qui ont des difficultés mais peuvent réussir quand on les aide.
On entend sur l'école une accumulation de clichés. Que faisons-nous en réalité avec nos élèves ? Exigence, réflexion, progressivité dans les apprentissages - et apprentissage à partir des erreurs -, culture, lecture, bienveillance, accompagnement, utilisation des mots justes, apprentissage du travail seul ou en groupe. Le matin, j'essaie d'insuffler dans l'esprit des élèves la question « que vais-je apprendre aujourd'hui ? » Quand un sujet est ennuyeux, les professeurs déploient des trésors d'ingéniosité pour le rendre captivant.
Les attentes vis-à-vis de l'histoire-géographie sont démesurées. Les enseignants tissent un lien avec l'actualité, aident au repérage dans l'espace et le temps. Chaque semaine, je consacre un petit moment aux questions des élèves. Il faut y répondre, mais je ne peux y passer trop de temps car le programme est un corset. C'est pourquoi nous avons besoin de programmes souples et de liberté dans la mise en oeuvre.
On nous demande de travailler sur des programmes, de faire acquérir des connaissances et des méthodes, de former des citoyens, d'éduquer à l'esprit de défense, de travailler sur la presse, l'esprit critique, l'histoire des arts... C'est beaucoup dans une société où les programmes télévisés regorgent d'émissions racoleuses et parfaitement débiles, une société qui ne parle que de consommation et d'achat. L'école ne s'achète pas, ne se vend pas.
Le temps scolaire n'est ni le temps politique, ni le temps médiatique. Instruire solidement se fait dans la durée. Des polémiques navrantes ont éclaté sur le programme d'histoire. On enseigne depuis très longtemps ce qu'on nous accuse de négliger : la colonisation, la décolonisation, la guerre d'Algérie, les traites négrières, l'esclavage, son abolition, l'histoire et la géographie de l'immigration et des flux migratoires. Nous n'avons jamais enseigné un roman national, qui serait de la fiction : nous avons besoin d'un récit historique vrai. L'histoire enseignée ne devrait pas être idéologisée. Nous n'avons pas en France d'histoire officielle ni d'écriture des manuels par l'État, comme le pratiquent les régimes totalitaires, mais le pouvoir exécutif a envie d'imprimer sa marque. Les derniers programmes de lycées correspondaient à une commande politique : former des Européens. Mais l'adhésion à l'Europe comme projet économique et politique ne se décrète pas.
Nous transmettons des connaissances selon les derniers acquis de la recherche et les rendons intelligibles aux élèves. Il faut établir des distinctions claires lorsqu'on travaille sur l'histoire et la mémoire - l'expression « devoir de mémoire » est totalement contre-productive -, éviter la schématisation, le cours de morale, le discours culpabilisant - là aussi contre-productif parce que l'élève n'est pas responsable du passé. L'histoire-géographie sert à se situer dans le temps et dans l'espace, à apprendre à réfléchir, contextualiser, analyser, questionner, comprendre l'évolution des sociétés humaines... Sortir du cadre du programme, c'est réfléchir avec les élèves sur ce qui les touche ou non dans les faits historiques et leur faire comprendre que l'éloignement dans le temps influence notre perception. Lier histoire et problématiques actuelles n'est pas forcément faire preuve d'anachronisme.
Nous travaillons dans un cadre laïque, strict et clair. Nous avons conscience que certains collègues ont des difficultés. Il faut cerner les refus, des phénomènes qu'il ne s'agit ni de généraliser, ni de minimiser. Certains sont en augmentation, tel l'antisémitisme, qui remonte à une quinzaine d'années. Refuser de le voir reviendrait à nier le métier d'historien-géographe. Nous devons éviter toute instrumentalisation de l'histoire et penser dans un cadre large. L'histoire n'est pas celle de tous les élèves, mais celle qui est étudiée par tous les élèves, y compris lorsque ça ne plaît pas. L'enseignement a pour objectif d'élever les élèves par la connaissance, de les libérer des préjugés.
Nous sommes tous de la génération du livre, contrairement aux élèves. Nous devons réfléchir à la manière dont ils cherchent l'information, sur Internet. Ils ont du mal à trier entre les savoirs, vrais et faux.
Après l'attentat au siège de Charlie Hebdo, les élèves ont posé beaucoup de questions auxquelles nous avons répondu. Il a fallu gérer l'émotion et ne jamais perdre le fil de la communication lorsque des contestations ont surgi : pourquoi avoir invité à la manifestation du 11 janvier des chefs d'État ne respectant ni la liberté d'expression ni la démocratie, pourquoi l'État, qui met en avant la laïcité, parle-t-il en permanence des religions, un parti antisémite ou xénophobe peut-il être républicain, le Front national peut-il diriger le département de l'Aisne ? ... Il faut entendre les élèves afin de déconstruire les stéréotypes. Leur intimer de se taire les enfermerait dans le faisceau d'opinions qu'ils pensent être des réalités. Nous devons rappeler la prééminence de la loi et travailler sur l'histoire des religions mais ne pas en parler tout le temps. En classe, les adolescents sont des élèves et non des croyants.

Je vous remercie. Vous êtes une femme de conviction. L'amour de votre métier transparaît fortement et vous portez une saine colère sur les jugements dont les enseignants font l'objet. En entendant votre comparaison entre les enseignants et les chirurgiens, je pensais que nous passons tous par l'école, et non par le bloc opératoire. Mais les professionnels libéraux vous diront que les clients prétendent désormais en savoir plus qu'eux-mêmes grâce à Internet et ne viennent chercher chez eux qu'une confirmation.
Vous avez dit enseigner non l'histoire de tous les élèves, mais celle apprise par tous les élèves. Lorsque je présidais le conseil régional de Lorraine, je n'ai jamais imposé l'apprentissage de l'histoire lorraine. Celle que tous apprennent, c'est l'histoire de France.
Enfin, quand on maîtrise bien les livres, Internet est formidable. Il est destructeur quand on ne maîtrise pas les livres.

Vous avez dit ne pas vouloir utiliser la langue de bois. Si la colonisation, les traites négrières, les flux migratoires sont enseignés, les nouveaux programmes laissent certains sujets au choix de l'enseignant, ce qui perturbe les législateurs que nous sommes. Opérer une distinction entre des points obligatoires et d'autres laissés à l'initiative de l'enseignant, dont le christianisme médiéval, n'est pas un bon signe pour notre République une et indivisible.
Avez-vous constaté que certains types d'enseignements, tels que l'histoire, étaient contestés ? Les heures dédiées à l'éducation civique, juridique et sociale (ECJS) servent-elles à compléter le programme et qu'en sera-t-il de l'enseignement moral et civique à la rentrée prochaine ? Enfin, qu'introduire dans les programmes pour assurer la transmission des valeurs de la République ?
Les contestations de certains enseignements existent, en histoire-géographie, mais aussi en sciences de la vie et de la terre ou en français. Il ne faut ni les généraliser, ni les minimiser. L'enquête que l'APHG a menée après les événements de janvier a révélé quelques problèmes. Un collègue a rapporté que dans une classe, un élève affirmait que la liberté d'expression l'autorisait à dire que le génocide arménien n'avait pas existé, un autre qu'il était interdit d'insulter le Prophète, et tous deux que les membres de Charlie Hebdo l'avaient bien cherché. Dans une autre classe, des élèves ont réagi contre ce qu'ils estimaient être les deux poids, deux mesures, appliqués aux catholiques et juifs d'une part, et aux musulmans d'autre part.
Des contestations liées au fait religieux peuvent se manifester par le refus d'entrer dans un bâtiment religieux lors d'une sortie scolaire à but culturel, ou lors de l'étude d'auteurs critiquant les religions tels que Voltaire, ou lors de cours sur la Shoah. Il faut faire comprendre aux élèves la différence entre les contenus médiatiques et la construction des programmes. La Shoah, étudiée pendant deux ou trois heures en classe de troisième, est très évoquée dans les médias, pour des raisons historiques et générationnelles. Il faut toujours répondre aux questions, même les plus dérangeantes, et rappeler la différence entre les savoirs scientifiques et les opinions.
Avant les attentats de janvier, nous avions mené, avec mes élèves, une longue étude sur l'antisémitisme, notamment par la caricature et les théories du complot, très répandues parmi les élèves. Ils ont pu comprendre que l'histoire est l'étude du temps long, et que l'antisémitisme, qui est aujourd'hui un délit, était une opinion il y a un siècle.
L'éducation civique est en général dispensée lorsqu'elle est confiée aux professeurs d'histoire-géographie mais il est possible qu'elle fasse l'objet d'un cours d'une heure en classe complète et que l'enseignant privilégie l'histoire-géographie pour les cours par demi-groupes, qui représentent deux heures. L'ECJS est devenue une variable d'ajustement pour combler les emplois du temps. Si elle est confiée à un professeur de mathématiques, il enseignera sa matière. Elle peut servir à courir après le programme, mais pas du tout systématiquement.
Les valeurs de la République ne sont pas naturelles pour tous les élèves. Je crois beaucoup à la valeur de l'exemplarité. Le téléscopage de l'enseignement avec les affaires Cahuzac ou Thévenoud a un effet dérangeant, parce que l'élève s'interroge sur ce « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». La transmission des valeurs républicaines n'est possible que si l'exemplarité vient du sommet de l'État. On ne peut pas dispenser un catéchisme républicain, le chemin doit être parcouru des deux côtés. La République est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Ce dernier mot, comme le préambule de la Constitution de 1946, est très oublié. Comment se reconnaître dans la République et dans la France quand on est renvoyé à des origines étrangères ? Arrêtons de parler de troisième génération d'immigrés : quand on est né en France, on est Français, un point c'est tout ! Comment faire France quand une partie des élites dénigre en permanence notre pays ? La France est pleine de potentialités. Nous devons prendre à bras le corps toutes les forces vives et donner à nos élèves espoir en l'avenir. La République est vivante !

Quelle est la place des parents dans le suivi quotidien des élèves ? Ont-ils été associés aux actions sur les événements de janvier au collège ? Quel est leur comportement vis-à-vis de l'éducation nationale ?
Les délégués de parents sont présents au conseil d'établissement ou au conseil de classe. Ils ne nous disent pas grand-chose lorsqu'on demande des remontées. Si nous voyons certains parents lors de réunions, d'autres ne viennent jamais : ils ont du mal avec l'école, ils projettent leurs mauvais souvenirs, alors qu'elle n'est pas malveillante. Nous ne refusons jamais de discuter avec les parents, bien qu'il puisse être difficile de les contacter, en cas d'absentéisme par exemple. Il faut les associer, mais la rencontre doit être mutuelle, dans un rapport de confiance, afin d'éviter trop d'intrusion dans le contenu des cours.
Au lycée, nous n'avons pas associé les parents aux actions de janvier, mais des élèves ont effectué des démarches spontanées, pour coller des affichettes par exemple. Je leur ai laissé un espace d'expression. Certains ont esquissé des caricatures. Regardez ce poing levé dessiné par une élève de terminale sur un poème :
« Tu exploites le royaume de nos peurs
« Pour en devenir le dictateur,
« N'oublie pas, l'espoir émerge du noir
« Et la douleur n'est pas une victoire...
Voilà une réflexion ! Certains élèves musulmans ont été très choqués, la limite entre islam et islamisme étant évidente pour eux. Nous avons aussi des élèves ouvertement salafistes.
S'agissant des projets de programme, ils seront soumis à consultation auprès des enseignants. Chacun doit répondre individuellement, une synthèse ne relayant pas les ressentis personnels. Il nous faut des programmes réalistes, non des carcans, qui évitent les prescriptions pédagogiques normatives. Les attitudes infantilisantes à notre égard doivent cesser. Toute classe est particulière et nous devons disposer de liberté pour être inventifs. Un sujet laborieux en classe peut être traité en sortie scolaire.
Une expression telle qu'« au choix de l'enseignant » n'est pas claire. Il est important de pouvoir parler de tout. L'islam a toujours été enseigné en cinquième. L'année d'avant, on enseigne la naissance du christianisme. Il est aussi important de travailler sur les sociétés contemporaines médiévales. Aujourd'hui, on est étouffé par l'histoire contemporaine. On oublie trop à quel point l'histoire ancienne et l'histoire médiévale sont intellectuellement formatrices. C'est là que se mettent en place tous les soubassements.
Travailler sur l'histoire, c'est travailler sur les héritages, à la fois dans le temps court, le temps moyen et le temps long. Pour cela, il faut justement du temps, ménagé par une certaine souplesse dans l'application du programme. On ne peut pas demander aux enseignants de faire preuve d'exigence et mettre en avant la trop grande complexité d'un sujet.
Un exemple : il est impossible de donner un cours sur le Proche-Orient, région compliquée s'il en est, sous la forme du Reader's Digest. Il faut s'appuyer sur des cartes, distinguer les peuples, les religions, les langues, ce millefeuille qui constitue le Proche-Orient. Ensuite, on peut aborder les conflits, dont la région est riche. Il est nécessaire de réfléchir aux programmes de manière plus fine.
- Présidence de Mme Françoise Laborde, présidente -

Vous vous exprimez avec une passion qui ne semble pas toujours partagée par vos collègues enseignants. J'ai été surpris de vous entendre prôner un enseignement plus instinctif, plus intuitif. Comment cela peut-il s'articuler avec les nécessaires méthodes pédagogiques ?
Vous avez également qualifié les programmes de corset, de carcan, et appelé à davantage de souplesse. Or une éducation nationale implique des instruments nationaux et une évaluation, et non un enseignement au bon plaisir du professeur. Où placez-vous cette souplesse ? Envisagez-vous un programme allégé qui laisserait à l'enseignant 30 à 40 % de son temps pour aborder des thématiques de son choix ?
Ce n'est pas le sens de mes propos. J'entends la souplesse comme une liberté de mise en oeuvre. Ainsi, l'ère de l'histoire-bataille est révolue, et les deux guerres mondiales sont davantage abordées sous l'angle culturel. Dans ce nouveau contexte, il n'est plus possible d'imposer une seule manière d'enseigner, même si les élèves doivent apprendre la même chose sur tout le territoire.
Le programme de classe de seconde prévoit une thématique obligatoire, l'Occident chrétien médiéval, et une question au choix, les sociétés et cultures urbaines ou les sociétés et cultures rurales. Toutefois, il est toujours possible d'aborder ces deux thématiques à travers des enseignements croisés. La liberté pédagogique est par conséquent une liberté de mise en oeuvre, et non un blanc-seing.
Ainsi, pour traiter le thème de l'immigration, je suis partie de l'histoire locale de la région où j'enseignais, la Picardie. Mes élèves ont découvert, à leur grande surprise, que le principal pays d'origine des immigrés en France a longtemps été la Belgique !
J'ai ensuite élargi le propos, complété par une visite à la Cité de l'Immigration.
L'enseignant doit toujours répondre aux questions des élèves, sans prétexter un manque de temps. En terminale, il faut à la fois traiter le programme, finaliser les savoir-faire et la méthode de la dissertation et répondre aux élèves. J'ai l'habitude de terminer le traitement d'une question par une ouverture sur l'actualité : à la fin du cours sur l'Afrique, j'ai présenté l'évolution des relations entre la France et les pays africains. Là encore, la souplesse ne consiste pas à faire ce que l'on veut, parce que tous les élèves doivent avoir les mêmes connaissances.

Nous accueillons maintenant M. Claude Berruer, secrétaire général adjoint de l'Enseignement catholique.
Titulaire d'une maîtrise de lettres modernes, vous avez enseigné dans un collège public pendant un an, avant de rejoindre un établissement privé sous contrat, l'établissement Sainte-Marie-Saint-Dominique de Bourges, dont vous avez été nommé directeur en 1984. En 1991, vous avez été désigné pour occuper les fonctions de directeur diocésain de Bourges, avant de devenir directeur de l'interdiocèse du Berry-Loiret au début des années 2000 et d'être, en 2006, nommé secrétaire général adjoint national de l'enseignement catholique par la conférence des évêques de France. Responsable, devant les évêques, de l'orientation de l'enseignement catholique, le secrétariat général assure les relations avec les pouvoirs publics.
En janvier dernier, l'enseignement catholique a été associé par le ministère de l'éducation nationale, au même titre que l'enseignement public, à la grande mobilisation pour les valeurs de la République.
Dès le mois de février, anticipant la mise en place de l'enseignement moral et civique à la rentrée 2015, vous avez publié une contribution relative à la formation morale dans laquelle vous estimez que l'école doit être le lieu d'une appropriation responsable des valeurs par le développement du jugement critique.
L'enseignement catholique, qui scolarise aujourd'hui près de deux millions d'élèves en France, est un acteur majeur du système éducatif français. Aussi la commission d'enquête souhaitait-elle connaître votre point de vue sur la réalité des menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'école et sur les solutions à y apporter pour la rétablir dans sa mission d'intégration et de formation des futurs citoyens.
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, M. Claude Berruer prête serment.
La crise de l'école et, pour reprendre l'intitulé de votre commission, la perte des repères républicains sont le reflet d'une crise sociale plus globale. Plusieurs maux affligent l'école : l'individualisme, qui entrave la poursuite du bien commun ; le consumérisme ; l'hédonisme ; le relativisme, qui discrédite toute norme ; et enfin le communautarisme, qui s'oppose à l'universalisme républicain.
Il en résulte une crise de la parole, des relations entre parents, enseignants et élèves, du sens et de l'éthique, qui prend sa source dans une crise de la transcendance, c'est-à-dire l'oubli que nous vivons d'un héritage sur lequel nous devons construire le présent.
L'école du XXIe siècle doit naturellement s'adapter au temps présent et préparer les jeunes à l'avenir, en assurant leur insertion professionnelle. Mais elle doit le faire en restant fidèle à sa mission de transmission. Comme l'a rappelé Hannah Arendt, « la continuité d'une civilisation constituée ne peut être assurée que si les nouveaux venus par naissance sont introduits dans un monde préétabli où ils naissent en étrangers ». Notre responsabilité est d'installer ces nouveaux venus dans notre civilisation constituée.
Sans opposer anciens et modernes, nous devons nous demander comment former les adultes de demain en nous appuyant sur cet héritage reçu et sur notre patrimoine.
Voici ce qu'écrivait Régis Debray dans son rapport sur la laïcité rendu en 2002 : « Élargissement vertigineux des horizons et rétrécissement drastique des chronologies. Contraction planétaire et pulvérisation du calendrier. On se délocalise aussi vite qu'on se déshistorise. Un antidote efficace à ce déséquilibre entre l'espace et le temps, les deux ancrages fondamentaux de tout état de civilisation, ne réside-t-il pas dans la mise en évidence des généalogies et soutènements de l'actualité la plus brûlante ? » Rendre l'élève lucide et conscient vis-à-vis de l'actualité, telle est la mission de l'école, qui se fonde sur une mise en évidence des généalogies. L'école est le lieu du discernement.
Deuxième élément, la recherche de saines articulations dans la vie de l'école, la formation des acteurs et l'animation des classes. L'articulation entre bienveillance et exigence est la base de saines conditions d'apprentissage, où chacun se sent reconnu et respecté. J'ai souvent eu l'occasion d'échanger avec des élèves décrocheurs, qui sont amenés par un sentiment de marginalisation et d'exclusion à se mettre d'eux-mêmes en dehors de l'école. Mais il n'est pas de bienveillance sans l'exigence, qui rend possible l'autorité du maître.
L'articulation entre transmission et appropriation est tout aussi essentielle, puisque pour acquérir des savoirs et des valeurs, l'élève doit être acteur de son apprentissage. Cependant, la nécessaire autonomie doit se fonder sur l'enseignement de savoirs reconnus. Ainsi, la formation morale commence par l'énoncé de la loi, préalable à son appropriation. Autrement, l'enseignement paraîtra discrétionnaire et imposé de l'extérieur. Dans les établissements scolaires, cette articulation se décline autour d'un règlement et d'une charte. Enfin, dans l'acquisition des savoirs, elle se traduit par l'installation des fondamentaux, et l'association entre un enseignement qui transmet et le nécessaire croisement interdisciplinaire.
L'articulation entre identité et altérité prend un relief particulier à l'heure de la construction européenne, de la mondialisation et du pluralisme qui appellent une réouverture de l'école. C'est la capacité à dialoguer avec les autres tout en demandant une reconnaissance de sa propre identité. La laïcité rend cette articulation possible en favorisant une convergence vers un idéal universel et en construisant le vivre-ensemble.
L'articulation entre les responsabilités de l'école et celles de la famille, enfin. Il est légitime que les parents soient associés à la vie de l'école, mais celle-ci n'est pas la somme d'intérêts particuliers, et les associations de parents d'élèves ne sont pas des associations de consommateurs. L'école doit donner toute sa place à la famille tout en restant le lieu de la formation à l'universalité.
La dialectique entre transmission et appropriation repose sur un travail autour du socle commun de connaissances et de compétences. Mais le texte ne suffit pas : il faut que les équipes se l'approprient. Nous assistons à une croissance exponentielle des enseignements. Les sept disciplines du Moyen Âge sont devenues 8 000. À cela s'ajoute le flux d'informations déversé par les technologies numériques. Dans ces conditions, qu'est-ce que l'école au jour le jour ? Sur quel socle doit-elle reposer ? Le travail d'appropriation par les équipes éducatives est indispensable.
La rénovation de la formation des maîtres se poursuit. L'expertise disciplinaire fonde partiellement l'autorité du maître, mais elle est complétée par la gestion de la classe et de l'établissement, qui doivent être assurées en équipe. Il est indispensable de développer les capacités éducatives des maîtres, pour que les valeurs soient éprouvées dans une pratique régulièrement évaluée. Hélas !, la formation continue souffre de sous-financement depuis plusieurs décennies.
La co-responsabilité entre l'école et la famille est souvent évoquée à travers le prisme d'une prétendue démission de certains parents. Pour ma part, en tant que chef d'établissement, j'ai surtout rencontré des familles découragées et déconcertées. Que faire pour aider les parents à réinvestir leur responsabilité ?
Trop souvent, l'enseignant se sent isolé face à de nouveaux comportements de groupe. Pour y faire face, nous avons besoin d'équipes solidaires et d'un soutien de la hiérarchie aux enseignants. Le temps de service des enseignants doit être réorganisé pour ménager une place à la concertation et à l'élaboration des stratégies de formation.
Nous avons des textes qui fixent bien les missions de l'école, à commencer par le socle commun de connaissances et de compétences et le référentiel sur l'enseignement moral et civil. L'enjeu est la capacité du système éducatif à les mettre en oeuvre. Comment faciliter, par la formation et les nouveaux modes d'animation, le travail des enseignants et des équipes éducatives ?

De nombreuses personnes auditionnées par cette commission d'enquête nous ont fait part de mises en cause régulières, voire de contestations des principes républicains dans le cadre scolaire. L'enseignement catholique est-il confronté à ce type de phénomènes ? En particulier, avez-vous connu des incidents à l'occasion de la minute de silence en janvier ?
Dans une interview donnée au journal La Croix au mois de février, Pascal Balmand, secrétaire général de l'enseignement catholique, affirmait que « la formation morale relève moins de la transmission que de l'appropriation des valeurs républicaines ». Comment l'école peut-elle faciliter cette appropriation ? Quelle est la position de l'enseignement catholique sur le nouvel enseignement moral et civique, qui s'appliquera également aux établissements privés sous contrat à la rentrée 2015 ?
Plus généralement, que pensez-vous des mesures annoncées par la ministre de l'éducation nationale dans le cadre de la grande mobilisation de l'école pour les valeurs républicaines ? L'enseignement catholique est-il favorable à un renforcement de l'enseignement du fait religieux ?
Vous avez parlé de l'articulation entre l'école et la famille. Il est vrai que l'école ne peut pas tout ! Comment doit-elle et peut-elle associer les parents dans sa mission éducative ? L'enseignement catholique possède-t-il une expérience particulière dans ce domaine ?
Il y a eu des incidents à l'occasion de la minute de silence, mais rien, à ma connaissance, de dramatique. Le déroulement de la minute a été d'autant plus facile qu'elle avait bien été préparée par des temps de parole. Là où la communauté éducative avait pris l'habitude de ces moments, par exemple avec le « quoi de neuf ? », bref commentaire de l'actualité en ouvrant la journée, le débat a pu s'ouvrir.
Vous avez cité les propos de Pascal Balmand sur la formation morale. Il est vrai que nous n'imaginons pas de formation sans transmission. Nous avons conçu un enseignement moral et civique autour de fiches présentant les notions fondamentales : la dignité humaine, l'égalité, la fraternité, la justice, la liberté... Ce sont des valeurs vécues au quotidien dans les écoles. La conscience morale est informée par la capacité à agir, à s'engager dans la classe. Elle s'applique également à notre enseignement : reconnaissons-nous la dignité des élèves même lorsque nous leur donnons un zéro, proposons-nous des tarifs solidaires aux familles ?
Le référentiel d'enseignement moral et civique conçu par le ministère, articulé autour de quatre notions - sensibilité, règle et droit, jugement, engagement - nous convient. La formation morale s'enracine dans la sensibilité de l'élève, en se fondant sur sa capacité d'indignation et sa conscience innée du bien ; la loi commune doit donner lieu à une appropriation non par la contrainte mais par la pédagogie ; la culture du jugement repose sur l'idée que former, c'est rendre l'élève capable de juger par lui-même ; enfin, la culture de l'engagement consiste à s'impliquer au lieu de tout attendre de l'État et de l'institution.
Nous souscrivons aux objectifs de la mobilisation de l'école décidée en janvier. Notre centre de formation accueille aujourd'hui 200 personnes ayant participé aux journées nationales organisées par l'éducation nationale sur la laïcité. Nous avons, avec le budget dédié par le ministère, mis en place un plan de formation des chefs d'établissement. À partir du mois de novembre, les valeurs de la République, de la laïcité, de l'appropriation des savoirs seront expliquées dans soixante lieux de formation.
Sur la question du fait religieux, je vous renvoie au site dédié « Enseignement et religions ». Nous sommes favorables à la distinction entre la part de la formation qui inclut toutes les traditions, sans privilégier le catholicisme, et la formation spécifiquement catéchétique que, par vocation, nous apportons à nos élèves. En somme, nous invitons nos élèves à faire la part du savoir et du croire.
Quant aux relations entre l'école et la famille, nous estimons que les associations de parents ne doivent pas se préoccuper que de la défense de leurs enfants. Ils sont membres de la communauté éducative, à travers leur participation aux différentes instances de l'établissement.
On exprime souvent le sentiment que certains parents sont démissionnaires ; mais sont-ils réellement en mesure d'accompagner leur enfant et de suivre leur travail ? Pour pallier ces manques, certains établissements convient les parents pour les initier à ce suivi ; des kits, élaborés par une association de parents, abordent des thématiques telles que comment exercer l'autorité, la relation aux écrans, ou encore la formation à l'effort. Parents et enseignants sont co-responsables, chacun dans son domaine. Les parents ne sont pas des enseignants pour leurs enfants, pas plus que les enseignants ne sont des parents pour leurs élèves.
Lors d'une réunion avec des parents précaires organisée par ATD Quart Monde, j'ai entendu une femme déclarer qu'elle ne pensait pas avoir de légitimité à rencontrer les enseignants car « c'étaient eux les intelligents ». Peut-être pensait-on alors que ces parents étaient démissionnaires... Plutôt que de porter des jugements sur ces familles, mettons en oeuvre des stratégies pour les atteindre toutes.

L'affichage de la charte de la laïcité dans vos écoles n'est pas obligatoire. Quelle est votre perception de cette charte ?

J'ai été très attentive à vos propos sur le travail en amont, ainsi qu'aux initiatives que vous rapportez pour rapprocher les parents, afin qu'ils comprennent ce que l'on attend d'eux. Les enseignants qui ne comptent pas leur temps sont-ils rémunérés pour ces actions ?

J'ai été très sensible à vos propos sur l'appropriation des valeurs de la République et leur épreuve par le vécu au plus près des situations concrètes. En tant que membre du conseil supérieur des programmes, je me félicite de vos initiatives pour faciliter la mise en oeuvre du socle commun. De quelles facilités dispose-t-on pour cela dans vos établissements et ce temps existera-t-il dans les autres écoles de la République ?
Nous ne sommes aucunement opposés à la charte de la laïcité, mais au moins deux de ses articles ne s'appliquent pas à nos établissements : nos maîtres, qui ne sont pas fonctionnaires, ne sont pas soumis à l'obligation de neutralité, et l'interdiction des signes religieux ostentatoires n'a pas de raison d'être dans les établissements privés sous contrat. Il était difficilement concevable de l'afficher telle quelle dans nos établissement.
Contrairement au secteur public, nous avons l'habitude de recevoir les familles et les enfants au moment de l'inscription dans nos établissements. Plutôt que de leur donner un document supplémentaire à signer, nous envisageons, dès le printemps prochain, de leur présenter pendant cet entretien un document rappelant les fondements de la laïcité. Nous finalisons avec le ministère un texte de quelques paragraphes inséré dans le projet éducatif.
Quant à la rémunération des activités, les enseignants bénéficient d'aménagements pour proposer des temps de concertation ou des journées pédagogiques. Les indemnités pour mission particulières (IMP) faciliteront la concertation entre collègues. Il serait toutefois opportun d'institutionnaliser un temps de concertation au niveau national, comme dans le premier degré : le travail d'équipe sans moyens associés est peu mobilisant.
Nous avons commencé à travailler sur le socle commun avec nos responsables d'animation diocésaine et à programmer des sessions de formation. Un grand nombre de sessions de formation et de journées pédagogiques en 2014-2015 seront naturellement consacrées à l'appropriation du socle.

Considérez-vous l'autonomie réelle dont bénéficient les établissements privés sous contrat comme une force ou estimez-vous que cette autonomie ne doit pas être exagérée ?
C'est une force revendiquée. Le contrat d'association n'est pas passé entre l'État et l'enseignement catholique dans son ensemble, mais entre l'État et chaque établissement, qui bénéficie d'une autonomie juridique.
L'établissement se fixe des objectifs, une stratégie, des indicateurs de réussite associés à une évaluation interne et externe. Cette autonomie n'a de sens qu'associée à la responsabilité. Il faut l'articuler au maintien d'une culture du contrôle et de la régulation.

Nous recevons maintenant M. Éric Debarbieux, auteur de l'ouvrage Les dix commandements contre la violence à l'école (2008).
Comme le Bureau de la commission d'enquête l'a décidé, cette audition sera captée et diffusée en direct sur le site Internet du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte rendu publié dans le Recueil des travaux des commissions, accessible en version papier et sur le site Internet du Sénat.
Vous avez commencé votre carrière, monsieur Debarbieux, en tant qu'éducateur spécialisé à Tourcoing, avant de travailler comme instituteur spécialisé en institut médico-pédagogique puis en section d'éducation spéciale. Titulaire d'un doctorat en philosophie, vous êtes actuellement professeur de sciences de l'éducation à l'université Paris-Est Créteil. Vous êtes également délégué ministériel chargé de la prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire, directeur de l'Observatoire universitaire international de l'éducation et de la prévention, et membre du conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Spécialiste des questions de violence à l'école, vous avez fondé en 1998 l'Observatoire européen de la violence, devenu, en 2004, l'Observatoire international de la violence, et vous avez été chargé, en 2011, par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, M. Luc Chatel, d'une mission sur le harcèlement scolaire.
La question de la violence à l'école interpelle toute la communauté éducative. Elle représente une forme de négation des valeurs de tolérance, de respect et de dialogue que l'école de la République veut transmettre. C'est à ce titre que notre commission a souhaité vous entendre, pour qu'à la lumière de vos recherches, vous éclairiez notre réflexion sur les solutions à apporter pour aider l'école à rester le creuset de notre République.
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, M. Debarbieux prête serment.
Je suis honoré de votre invitation à m'exprimer sur un sujet important pour la République et son école. Il n'est pas facile pour moi de dire en quelques mots combien il m'a occupé, tant par des expériences de terrain que par un travail de recherche mais aussi d'accompagnement des politiques publiques. Comme vous l'avez rappelé, une mission m'avait été confiée par Luc Chatel et Vincent Peillon m'a ensuite nommé délégué interministériel, preuve que la reconnaissance d'un travail scientifique peut transcender les clivages politiques. J'indique que je quitterai mes fonction de délégué à compter de septembre, pour retourner sur un important projet de terrain, qui concernera une quarantaine de sites de la politique de la ville, pour mettre en place des actions de prévention et de remédiation de la violence à l'école. Je suis certes un chercheur, mais un chercheur de terrain, un terrain que je n'ai jamais quitté - j'étais la semaine dernière à Lille, avant-hier à Lens, et je serai bientôt à Marseille, dans des collèges.
J'appuierai mon propos liminaire sur deux rapports que j'ai remis au Premier ministre, l'un, en 2012, intitulé L'école, entre bonheur et ras-le-bol. Enquête de victimation et climat scolaire auprès des personnels de l'école maternelle et élémentaire, et l'autre, en 2013, pour le second degré : Enquête de victimation et climat scolaire auprès des personnels du second degré. Ce sont, à ma connaissance, les seules recherches quantitatives d'importance menées sur la question, et les seules bases de données construites à partir de ce que déclarent les personnels : ces enquêtes ont été menées, respectivement, auprès de 12 000 personnels du premier degré, et de 22 000 personnels du second degré.
Il est important, sur ces sujets, de se garder à la fois de l'exagération et de la dénégation. On voit parfois manipuler quelques faits divers qui servent à présenter l'école comme un lieu sans foi ni loi où les enseignants ne consentent plus à entrer dans leur classe sans être accompagnés de policiers. Ce n'est pas la réalité. Quand on interroge les personnels sur leur perception du climat scolaire, et que l'on amalgame des indicateurs comme leur bien-être au travail, leurs relations avec les autres membres du personnel, avec les élèves et les parents, leur sentiment de sécurité, pour bâtir ce que j'appelle un indice de climat scolaire, on se rend compte que près de 90 % de ceux du premier degré se sentent bien à l'école et dans leur métier. Ce taux est un peu moindre dans le second degré, mais reste tout de même de 80 %. Il est bon de le rappeler, comme je l'ai fait, pour ce qui concerne les élèves, dans un rapport qui a été à l'origine des Assises nationales contre le harcèlement, intitulé A l'école des enfants heureux, enfin presque. C'est sur cet « enfin presque » qu'il faut lutter, dans une optique d'égalité sociale, profondément républicaine.
Il existe bien sûr de grandes différences entre les perceptions qu'ont les personnels de leur métier et du climat scolaire, selon la fonction occupée. Ainsi, 53 % des personnels de direction déclarent que le climat social dans leur établissement est très bon ou excellent. Mais les enseignants des classes spécialisées ne sont plus que 7,6 % à le dire, et ceux qui enseignent dans les filières générales, 13,8 %. Parmi ces derniers, 30 % jugent que le climat scolaire de leur établissement est mauvais et 40 % pour ceux qui enseignent en classes spécialisées. Cela pose de vraies questions et demande à être interprété. Faut-il considérer qu'un tel écart témoigne d'un éloignement des personnels de direction, qui ne font pas classe et sont trop laxistes, comme on l'entend parfois dire ? Je crois plutôt, et ma conviction se fonde sur de nombreuses enquêtes de terrain, que c'est l'identification à l'établissement qui fait la différence. Celle des personnels de direction est très forte, quand les enseignants s'attachent plus à des questions liées à leur discipline qu'à la dimension collective de l'établissement. C'est là un vrai problème, et qui n'est pas sans effets sur certains débats d'actualité.
La victimation reste également très marquée par l'inégalité sociale, et beaucoup plus parmi les personnels que parmi les élèves. C'est une constante mondiale ; les recherches de Denise Gottfredson aux États-Unis rejoignent en cela les miennes. Dans les 10 % des établissements les plus défavorisés, on a quatre fois plus de risque d'être victime d'un fait de violence que dans les 10 % des établissements les plus favorisés. Dans l'éducation prioritaire, le risque d'être agressé est deux fois supérieur qu'ailleurs. Les variables socio-économiques expliquent, pour les élèves, 20 % de la variance de victimisation entre établissements, près de 50 % pour les personnels.
On est là au coeur du débat actuel, qui n'est, au reste, pas nouveau - j'avais déjà, en 1995, publié un article sur le sujet. Il existe une réelle coupure entre l'école et certaines populations. On peut, certes, en faire une interprétation totalement négative, et considérer que les enseignants se comportent dans leur école comme d'horribles coloniaux qui ne pensent qu'à punir de pauvres petits enfants innocents, mais ce n'est pas en tenant ce type de propos que l'on reconstruira la République. Il faut examiner de près cette coupure, qui n'est pas tranchée. Il existe des établissements qui, malgré une donne sociologique difficile, résistent, voire se développent, et ont montré leur capacité à « faire école », à faire sens pour leurs élèves et leurs personnels, et à créer un sentiment d'attachement. « Mon école de ma République », tel sera le titre de mon prochain livre, car pour moi, les valeurs de la République sont certes universelles, mais elles doivent se transmettre concrètement, sur le terrain, par un sentiment d'appartenance.
Il existe de ce point de vue, en France, de grandes disparités territoriales, qui sont liées à la façon dont on affecte les personnels, dont on les forme, aussi. Quand, dans un établissement de la banlieue parisienne, 60 % des personnels sont de très jeunes enseignants que l'on catapulte dans un lieu qui ne suscite en eux aucun sentiment d'appartenance et où ils ne connaissent personne, on crée inévitablement des difficultés. La France est le seul pays au monde à nommer ses personnels à l'échelle nationale. Ce n'est pas sans conséquences. Je me suis récemment rendu dans un collège situé dans un quartier très difficile, très sensible, très « multiple », dirai-je. J'y ai été accueilli par une enseignante et ses élèves qui m'ont conduit, sachant que j'ai travaillé sur le harcèlement, jusqu'à leur atelier de travaux manuels, mis en place par un parent d'élèves, qui est menuisier et fait partie de ce que l'on appelle les minorités visibles. Ils y ont construit un arbre où ils ont logé un petit singe qui prend le contre-pied des trois singes dits de la sagesse qui se bouchent les yeux, les oreilles et la bouche. « Je vois, j'entends, je parle », voilà ce qu'il veut signifier. Et ces jeunes élèves vont promener leur arbre dans les écoles primaires alentour, pour rassurer les enfants qui vont entrer au collège et leur dire que l'on y fait attention à eux. J'ai cité cette anecdote pour montrer que dans un collège populaire, il peut exister un fort sentiment d'appartenance.
On a assisté, à la fin des années 1990, à une vraie mutation du climat scolaire, liée, dans certains lieux, à une forme de délinquance que le magistrat Denis Salas a analysée, à juste titre, comme une délinquance d'exclusion, anti-institutionnelle, dont les premières victimes n'en sont pas moins ceux qui y vivent. L'opposition à l'école est devenue, pour certains élèves, une vraie difficulté, y compris dans leur vie.

Vous avez eu un parcours professionnel très riche, qui donne légitimité à votre propos. Vous vous êtes tôt intéressé à la violence à l'école, et votre expertise nous sera précieuse.
Constatez-vous une dégradation du climat scolaire, et les valeurs républicaines vous paraissent-elles suffisamment inculquées et appliquées à l'école, notamment s'agissant de l'égalité entre filles et garçons ?
Certains enseignants que nous avons entendus ont déploré le recours, selon eux excessif, aux commissions éducatives plutôt qu'au conseil de discipline et estimé que les sanctions actuelles n'étaient pas assez dissuasives pour les élèves. Qu'en pensez-vous ?
Comment rétablir l'autorité des enseignants et mettre fin aux problèmes de discipline mis en évidence par les enquêtes internationales ? Vous prônez la médiation par les pairs, et venez de nous en donner un exemple avec votre parabole de l'arbre. Quelles sont, selon vous, les conditions de sa réussite, sachant que, dans certains quartiers, le rôle qu'on a vu jouer aux « grands frères » en montre peut-être les limites ? Quel doit être le rôle d'accompagnement des adultes ? Comment parvenir, je ne dirai pas à créer une « communauté » éducative, car je ne suis pas sûr que le terme soit approprié, mais à faire travailler ensemble chefs d'établissement, enseignants et conseillers principaux d'éducation, tout en associant les parents, qui ont un rôle fort à jouer, car l'école ne peut pas tout ?
Le climat s'est-il dégradé ? C'est une question que l'on me pose depuis longtemps, dès mes premières enquêtes de victimation, en 1991. « Est-ce que la violence augmente ? » : voilà le marronnier des médias. Les enquêtes montrent que la dégradation n'est pas aussi importante qu'on l'imagine. En tout cas, pas partout. Il est vrai qu'entre les années 1980 et le début des années 2000, il y a eu des évolutions, mais qui restent variables. Cette période a été marquée par deux mutations. Celle qui a vu apparaître, tout d'abord, une violence d'exclusion, dont la caractéristique est d'être collective. Ce phénomène n'est pas général, mais il existe : il ne faut pas être dans la dénégation. Comme délégué ministériel, j'ai mis en place, avec la gendarmerie nationale, des stages sur la gestion des crises paroxystiques. Mais il ne faut pas non plus oublier que 95 % des faits de violence ne viennent pas de l'extérieur, et que ce n'est pas en repliant l'établissement sur lui-même que l'on va régler les problèmes. Dans mes premières enquêtes, 6,5 % des élèves disaient avoir été rackettés. Dans les enquêtes récentes, ce chiffre n'a pas varié. Il y a, cependant, une vraie différence. À la fin des années 1990, quand on demandait aux élèves s'ils avaient eux-mêmes racketté, 3 % d'entre eux répondaient positivement ; ils sont aujourd'hui 9 %. Dans un collège des quartiers nord de Marseille, j'ai trouvé un début d'explication. Les élèves m'ont clairement dit que l'on rackette à plusieurs, groupe contre groupe, avec tous les risques que cela entraîne pour la cohésion, car pour qu'un groupe se sente le plus fort, il faut qu'il trouve des plus faibles.
Même chose du côté des personnels. Les enquêtes menées par l'éducation nationale autour des années 2000 avaient montré une certaine augmentation des agressions - essentiellement verbales, rappelons-le - contre les CPE ou les enseignants, mais dans des zones bien circonscrites, celles où l'égalité républicaine n'est pas réalisée. Ce qui signifie que ce mouvement n'est pas fatal. Il n'y a pas de « classes dangereuses », mais des lourdeurs sociologiques, importantes à prendre en compte.
La deuxième mutation en cours est liée à la cyberviolence, qui donne des capacités immédiates de violence symbolique et verbale. Je suis membre, comme expert, du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. L'analyse est difficile à conduire, car on a souvent tendance à considérer a priori les filles comme des victimes, au risque de ne plus voir que les principales victimes de la violence à l'école sont en réalité les garçons. Certains masculinistes n'hésitent pas à faire une panacée de la restauration de l'autorité. La réalité est beaucoup plus complexe. Un garçon qui se persuade que pour être « un vrai mec », il doit se battre et qu'être puni est une gloire est susceptible de devenir un adulte maltraitant. Pour les filles, les choses sont un peu différentes, comme le montrent les enquêtes de Catherine Blaya, de l'université de Nice. Elles sont plus souvent victimes et agresseurs dans la cyberviolence, précisément. Comme si elles trouvaient, derrière leur écran, un sentiment de technopuissance qui serait comme une revanche des faibles.
Commissions éducatives versus conseil de discipline ? Je puis vous dire, comme médiateur auprès des équipes, que la cause essentielle des conflits entre direction et équipe enseignante tient à ce souci d'exclure les plus difficiles. Ma position est nuancée. Le pire, comme je le dis à mes étudiants, est de ne rien faire. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut monter systématiquement au créneau. La délégation a beaucoup travaillé sur ces questions, qui ont donné lieu à un guide de la justice réparatrice. Le problème, c'est que personne, sur ces questions, n'est formé. Bien souvent, les jeunes instituteurs ne savent pas que la seule punition autorisée en maternelle est l'isolement de l'enfant, mais en présence du professeur. Mais que faire, alors, des autres enfants ? On manque, sur ces sujets, d'une vraie doctrine. Si on avait des établissements dotés de vrais éducateurs, engagés dans un vrai projet, construit avec l'enfant et les parents, de réinsertion des élèves difficiles dans un établissement ordinaire, on pourrait voir l'exclusion comme une solution. Mais la difficulté, ainsi que le montre l'enquête de victimation, c'est que 36 % des personnels du premier degré déclarent avoir des problèmes fréquents ou très fréquents avec des élèves gravement perturbés. Il faut en tenir compte, et ne pas les considérer comme des gens qui ne pensent qu'à exclure. Il y a là un vrai problème éducatif. Le législateur a beaucoup oeuvré pour l'inclusion de tous dans l'école. Mais il faut un réel accompagnement. Est-il normal que les personnels chargés d'accompagner les enfants les plus fragiles, je pense par exemple aux auxiliaires de vie scolaire, soient des personnels précaires ? Dans d'autres pays, ce sont les personnels les mieux formés - je pense, par exemple aux « support teachers ». Il faut avancer sur ces questions, ainsi que l'ont fait d'autres pays, comme le Québec, car elles vont devenir centrales dans les années à venir.
Rétablir l'autorité ? C'est un voeu pieux. L'autorité n'est réelle que quand elle est légitime. Je suis persuadé que l'on ne rétablira pas l'autorité en excluant. Les élèves qui paraissent les plus difficiles ne sont pas forcément les organisateurs du désordre à l'intérieur de l'établissement. Le sociologue Christian Bachmann l'a bien montré. Quand on renvoie un élève, un lieutenant vient aussitôt prendre sa place. Cela est particulièrement vrai quand on touche à des questions de délinquance, comme celle du narcotrafic. Les travaux de Jacques Pain l'ont montré il y a longtemps déjà, les intrusions qui peuvent provoquer une crise paroxystique dans une école sont très souvent le fait d'anciens élèves qui ont été « mal » renvoyés et qui reviennent se venger.
Je suis plutôt partisan des sanctions réparatrices, au service de la communauté. Il ne s'agit pas, bien évidemment, d'humilier l'élève en lui faisant balayer la cour. Je pense au cas d'un jeune adolescent de 16 ans qui avait agressé son professeur, lequel, après une interruption temporaire de travail, est tombé dans une dépression grave. Que propose le juge à ce gamin, scolarisé dans l'enseignement spécialisé, qui est désocialisé et sait à peine lire ? Une peine alternative, consistant à accompagner un car de police parisien dans ses maraudes auprès des sans domicile fixe (SDF). Le gamin n'a plus jamais fait d'écart. Je cite là l'exemple extrême d'une agression, alors que l'essentiel de la violence à l'école est fait de petites violences verbales, mais c'est ce type de réponse qu'il faut développer : une justice réparatrice au quotidien. Or, les enquêtes montrent que 30 % des élèves punis ont encore des lignes à copier. C'est interdit depuis 1895 ! Ou bien qu'il y a encore des punitions collectives. Quoi de mieux pour monter les élèves contre le prof et l'établissement ! Quand le droit affirme que nul ne peut être puni pour une faute qu'il n'a pas commise, comment l'élève le comprendra-t-il ? Il y a beaucoup à inventer, car on n'arrivera à rien si l'on en reste à la sanction automatique de l'exclusion. Ce qui ne veut pas dire que certains enfants ne doivent pas être exclus, à condition que leur retour soit prévu. Pour avoir été éducateur dans ce que l'on appelait autrefois les foyers de semi-liberté, je sais combien il est difficile de tirer ces jeunes de là.
La médiation par les pairs peut être une pratique intéressante, à condition qu'elle reste une pratique préventive et ne serve pas à traiter les problèmes importants. Les adultes n'ont pas à déléguer aux élèves le soin de faire leur travail ; ce serait une cause d'échec. Une telle médiation ne peut fonctionner, ensuite, qu'avec un accord total de l'équipe, prête à s'investir et à se former. Or, ce n'est que très rarement le cas. J'avais nommé, à la délégation, une enseignante du second degré sur ces questions. Oui, la médiation par les pairs a son intérêt, de même que d'autres pratiques, comme la pédagogie coopérative, mais le vrai problème tient à l'implantation des programmes. Les méta-analyses montrent que certains programmes, y compris comportementaux, donnent des résultats, mais à condition que l'équipe soit mobilisée et le climat scolaire favorable. Cela compte plus, à la limite, que le programme lui-même. Même un programme mal ficelé, pour peu que l'équipe soit mobilisée, peut avoir un effet placebo palpable.
S'attaquer aux problèmes de violence à l'école requiert des stratégies de contournement. Il faut certes, sur des problèmes comme le harcèlement, des stratégies directes : sensibiliser, former, progresser dans la prise en charge des victimes. Mais si l'on veut faire reculer la violence à l'école, il faut aussi travailler à construire des établissements humains, avec de vraies équipes. Cette approche par le climat scolaire est une vraie nécessité. Nous y travaillons de près. Nous avons, dans 24 académies sur 30, créé des groupes spécialement dédiés à cela. Mais il est vrai que ce n'est pas facile, car on touche là à la conception qu'ont beaucoup d'enseignants de leur métier. Leurs préoccupations sont centrées sur leur discipline, et ils voient cela comme un travail en plus, qui les en détourne. Mais ce n'est pas le cas : le lien entre climat scolaire et qualité des apprentissages est démontré. En mathématiques, c'est la relation à l'enseignant qui constitue le premier facteur de la réussite. Alors que c'est la discipline qui paraît la plus abstraite, c'est pourtant celle qui est la plus sensible à ce facteur. J'ajoute qu'alors que l'on se heurte de plus en plus à une violence collective, on ne peut pas réagir seul. C'est un principe de base de la criminologie. On n'arrive à rien quand on se trouve seul face à un groupe hostile, et on a toutes les chances d'être pris pour bouc émissaire. Il y a là un vrai travail de formation à faire, et une réflexion idéologique à mener. Si l'on continue, en France, à s'empailler, comme on dit dans le Midi, sur l'enseignement du latin et du grec, on n'y arrivera pas.

Mme Blandin, qui a dû nous quitter pour se rendre au Conseil supérieur des programmes, m'a chargée de vous poser une question. La loi pour la refondation de l'école prévoit la formation des enseignants aux techniques de médiation et de résolution non violente des conflits. L'État veille-t-il à ce que les ÉSPÉ fassent figurer cette formation dans leurs maquettes, comme cela est le cas à Caen ?
J'ai, pour ma part, une question sur la cyberviolence. Vous avez dit que les filles en étaient à la fois victimes et utilisatrices. Dans quelles proportions ?
Vous avez insisté sur les différences entre établissements, selon leur implantation mais aussi le climat qui y règne. Avez-vous des suggestions concrètes pour remédier à ces différences ?

Merci de votre exposé concret, qui propose une méthode de conduite indispensable à retenir. Vous avez insisté sur les inégalités territoriales, qui compliquent la recherche de solutions. Cela étant, y compris dans les zones réputées tranquilles, il existe, à la sortie des écoles, racket et violences sur lesquels règne, parmi les élèves, l'omerta.
Mme Blandin m'interroge sur la formation des enseignants au sein des ESPÉ. C'est une question terriblement complexe. La délégation a formulé des recommandations précises, mais il demeure un réel problème, qui tient à la gouvernance des ÉSPÉ et au lien entre éducation nationale et enseignement supérieur. On voit, au sein des ÉSPÉ, se reproduire le conflit entre ceux qui s'attachent aux disciplines et ceux qui s'attachent à la pédagogie. C'est lunaire et jurassique. De même que certains pensent que l'autorité est « naturelle », alors qu'elle se construit, il en est pour penser que le travail en équipe serait naturel, et que l'idée même qu'il faudrait travailler au bien-être des élèves pour les aider à apprendre irait à l'encontre du savoir. Il existe, dans les ÉSPÉ, un tronc commun, où entre, comme le veut la loi, la gestion des conflits, mais c'est un combat de tous les instants, en dépit des circulaires successives, pour parvenir à faire comprendre l'importance de ce type de formation.
La loi est novatrice, et répond à ce que réclament à cor et à cri les enseignants, mais je crois qu'il faut s'employer, comme j'entends le faire dans les années à venir, à organiser de la formation sur sites. Il faut aussi trouver les formateurs, et ce n'est pas simple. Il en va de même que pour le harcèlement : voilà quatre ans que nous nous démenons pour former des formateurs qui pourront se rendre dans les établissements. Il y en avait peu à l'éducation nationale, quand il en existe dans les mouvements d'éducation populaire, les associations, les mouvements d'éducation à la paix, que connaît bien Mme Blandin. Nous avons fait en sorte que ces associations organisent une formation spécifique à la gestion des conflits à l'École supérieure de l'éducation nationale. Nous faisons donc des efforts, mais cela reste un combat, qu'il faut mener de façon aussi pragmatique que possible. Encore une fois, les victimes sont des victimes, elles ne sont ni de droite ni de gauche. C'est la construction d'une pensée multiple qui se joue dans cette problématique de la gestion des conflits. C'est là, dans ce multiple, qu'est la République. Je crois beaucoup, par exemple, à des pratiques comme celles des dilemmes moraux.
Je disais que l'on a tendance à considérer les filles comme des victimes, mais que ce sont les garçons, à l'école, qui sont victimes de la violence la plus brutale. S'agissant du problème spécifique de la cyberviolence, on constate que les filles exercent davantage que les garçons l'exclusion en ligne. Une étude menée par une de mes anciennes thésardes sur les punitions a montré que 80 % sont données à des garçons. « Je kiffe quand je suis puni, je suis un mec », voilà ce que lui a dit un élève qu'elle interrogeait. Les enseignants en ont conscience, sur le terrain. Il y a des élèves qui ont accumulé tant de colles que, si l'on veut monter d'un cran, il ne reste plus que l'exclusion. Si l'on ajoute à cela qu'il faut, dans certains endroits, attendre plus d'un an pour obtenir une consultation en pédopsychiatrie, on comprend que, pour un enfant en très grande difficulté il peut se passer, entre-temps, bien des choses.
Oui, j'ai des suggestions pour réduire les inégalités entre établissements. Vous avez raison de parler de méthode. Pour remédier à cette diffraction du sens qui traverse l'école de notre République, y compris entre les représentations de ce qu'est enseigner, éduquer, il faut une méthode. Nous tentons de généraliser, en coopération avec les équipes mobiles de sécurité, des enquêtes locales de climat scolaire et de victimation qui sont restituées aux équipes enseignantes. C'est une réalité qu'elles doivent regarder en face. L'idée est de localiser de plus en plus l'action, pour développer un sentiment d'appartenance. Cela passe aussi par la formation, non seulement en ÉSPÉ, mais aussi, comme je l'ai dit, sur site. Il s'agit de montrer que la transmission des valeurs de la République, cela se fait ici et maintenant.
Lorsque je fais des enquêtes de victimation auprès des personnels, 22,5 % de ceux du second degré répondent avoir été, à un moment de leur carrière professionnelle, harcelés, dont 60 % par d'autres membres du personnel. Parmi eux, 12 % disent l'avoir été depuis le début de l'année. Ce sont des chiffres supérieurs à ceux que l'on trouve chez les élèves. Il y a un vrai problème de direction des ressources humaines à l'éducation nationale, de bienveillance à l'égard des personnels. Tous les ministres qui s'y sont succédé en ont eu conscience. Songez que dans cette grande entreprise qu'est l'éducation nationale, il n'y a pas de médecine du travail. Il faut repenser la gouvernance de la machine.
Oui, il y a des inégalités territoriales. Les inégalités sociologiques justifient un certain nombre de classements. Que l'on ait deux fois plus de risques d'être victime dans l'enseignement prioritaire appelle des mesures particulières. Mais ce n'est qu'un facteur parmi d'autres. Parmi les élèves, 12 % sont victimes à répétition dans les zones d'éducation prioritaires, contre 8 % ailleurs. Cela ne veut pas dire que ces 8 % ne doivent pas être pris en compte. Mais il ne faut pas oublier non plus que 90 % des élèves disent n'avoir jamais eu de problème. Pour lutter contre le racket à la sortie des écoles, il peut être important et nécessaire de travailler avec la police, les équipes de sécurité, mais rappelons-nous que c'est avant tout en interne que les problèmes se posent, ce qui signifie que la solution est avant tout pédagogique. Mes propositions, au reste, ne valent pas que pour l'enseignement prioritaire. Ce n'est pas parce que l'air des montagnes est bon pour les asthmatiques qu'il est mauvais pour les autres, disait Fernand Oury. Le climat scolaire a son importance partout, y compris pour les élites.

Belle conclusion. Tout ce qui est expérimenté dans certaines écoles doit, en effet, pouvoir servir aux autres.
Ce que vous dites de la formation sur site est intéressant, mais je suppose qu'elle est réservée aux établissements qui le demandent, car on ne peut pas aller partout. Autre remarque : dans les établissements fragiles, il existe un fort turn over. On y met aussi beaucoup de contractuels. Si bien qu'il n'est pas dit que le bénéfice de la formation perdure.

Dans certains établissements aussi, le proviseur préfère ne pas signaler les difficultés, de peur d'être pénalisé dans sa carrière.
Avant la formation sur site, c'est une formation initiale de qualité dont l'éducation nationale a besoin. Il est vrai que certaines difficultés peuvent être dissimulées, mais cela est beaucoup moins fréquent qu'auparavant. Aujourd'hui, on nous demande beaucoup, au contraire, d'intervenir, et nous manquons de monde pour le faire. L'éducation nationale est une grosse machine, ce qui suppose non seulement de former les nouveaux enseignants, mais aussi le stock de ceux qui sont en place.
Il est, surtout, une question clé sur laquelle on n'avance pas, car elle exigerait un bouleversement profond des psychologies et de la manière dont on gère les ressources humaines à l'éducation nationale. Envoyer comme on le fait des débutants peu ou pas formés dans les établissements les plus difficiles est criminogène. C'est une situation que tout le monde, droite et gauche confondues, dénonce depuis des dizaines d'années. La réforme récente des réseaux d'éducation prioritaire va dans le bon sens. Les enseignants ont désormais des heures de formation et de concertation prévues dans leur service, cela change tout, et c'est vers quoi il faut aller. Cela permet aussi de faire appel aux enseignants qui ont des savoir-faire en interne. La réforme dite Éclair, qui permettait aux proviseurs de certains établissements de recruter certains enseignants sur profil, allait aussi dans le bon sens. C'est un tournant que beaucoup de pays ont pris, et qu'il est vain de dénoncer comme un complot néolibéral contre l'école.

Mes chers collègues, nous recevons Mme Natacha Polony, agrégée de lettres modernes, essayiste et chroniqueuse dans différents médias. Comme le bureau de la commission d'enquête l'a décidé, cette audition sera captée et diffusée en direct sur le site Internet du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte rendu publié dans le Recueil des travaux des commissions, accessible en version papier et sur le site Internet du Sénat.
Agrégée de lettres modernes et diplômée de Sciences Po Paris, vous êtes chroniqueuse au Figaro depuis 2012 et à l'émission « Le Grand journal » sur Canal+ depuis 2014. Vous présentez également la revue de presse quotidienne sur Europe 1 depuis 2012.
Spécialiste des questions scolaires, vous êtes l'auteure de deux ouvrages sur l'échec du système scolaire français, le premier paru en 2007, intitulé « M(me) le président, si vous osiez... : 15 mesures pour sauver l'école », le second, en 2011, avec ce titre assez inquiétant « École : le pire est de plus en plus sûr ».
Dans ce dernier ouvrage, vous imaginez une école de 2020 toujours plus inégalitaire, incapable de transmettre des savoirs et de former des citoyens capables d'esprit critique. Au travers cette « fiction », c'est bien le fonctionnement de l'école d'aujourd'hui que vous semblez remettre en cause...
Dans plusieurs de vos chroniques, vous vous référez à Condorcet qui, selon vous, est le premier à avoir pensé l'école de la République.
À la lumière de votre réflexion sur l'école, vous pourrez sans doute nous éclairer sur les difficultés rencontrées par l'institution scolaire et les mesures qui pourraient être prises pour y répondre.
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, Mme Natacha Polony prête serment.
Selon l'usage habituel, je vous propose de nous faire part de vos observations durant une dizaine de minutes, après quoi notre rapporteur, Jacques Grosperrin, et les membres de la commission qui le souhaitent pourront vous poser leurs questions.
Je remercie la commission d'enquête de m'avoir sollicitée car je considère que la transmission des valeurs républicaines par notre système éducatif représente un enjeu crucial.
Je suis journaliste spécialisée sur les questions de l'éducation et j'ai auparavant enseigné une année dans un établissement de l'éducation nationale puis neuf ans au sein du pôle universitaire Léonard de Vinci.
Une interrogation me taraude aujourd'hui : comment de jeunes gens ayant passé 12 ou 13 ans dans les établissements de l'éducation nationale ont-ils pu devenir des tueurs fanatisés tels que les frères Kouachi, Amédy Coulibaly ou Mohamed Merah, sans que nous n'ayons rien vu venir ?
Paru au début des années 2000, l'ouvrage collectif intitulé Les territoires perdus de la République racontait tout à l'avance, mais on n'a pas voulu entendre la parole de ces enseignants et le livre a été mis à l'index.
Personnellement, j'ai pu observer la redoutable conjonction de deux phénomènes que sont la généralisation de l'ignorance et la généralisation du renoncement.
J'ai été confrontée à l'ignorance, parfois presque revendiquée, d'étudiants incapables d'avoir une réflexion élémentaire sur des faits historiques de premier ordre.
J'ai observé le renoncement d'enseignants, réagissant aux exigences de leurs élèves, en allant demander conseil à un rabbin ou à un imam.
La charte de la laïcité ne résoudra rien, si l'école de la République ne parvient pas à nouveau à faire adhérer, non pas seulement les élèves d'ascendance étrangère, mais tous les élèves de France, futurs citoyens, à nos valeurs, à notre culture, à notre civilisation. Cela implique que nous retrouvions la mémoire de cette civilisation, qui tend à s'effacer, non pas tant pour ce qui a trait aux connaissances que pour ce qui concerne les pratiques et les usages.
Or, pour l'heure, les enseignants se refusent à faire cet effort, toute initiative allant dans ce sens étant envisagée sur le mode du soupçon.
L'éducation nationale n'est pourtant pas un service public, mais une institution dont les enseignants sont des fonctionnaires qui devraient s'investir d'une mission particulière de transmission des valeurs de la République. Pourtant la tentative d'introduire dans les concours de recrutement une épreuve intitulé « agir en fonctionnaire de la République » a suscité un tollé au nom de « l'indépendance des enseignants et de la liberté pédagogique ».
Nos enseignants, mal formés sur ces questions, se trouvent désemparés lorsque leurs élèves remettent en cause les valeurs de la République.
À l'origine véritable de l'école républicaine, Nicolas de Condorcet affirmait que la mission première de cette école était de transmettre le savoir universel qui libère, ce qui constitue l'inverse de l'endoctrinement.

Je tiens, madame, à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Votre parcours, non seulement d'enseignante mais également de journaliste, présente l'intérêt d'un double constat sur le terrain. Votre réalisme et l'acuité de votre regard sur l'éducation nationale et l'enseignement peuvent nous guider dans nos travaux. Vous rejoignez en cela le rejet d'Alain Finkielkraut du concept de l'ignorance qui permettrait l'émancipation. Un certain nombre de pédagogues ont posé les problèmes de l'éducation avec des mots tels que « révolution copernicienne » ou « mettre l'enfant au centre des savoirs »... Or ce sont les savoirs qui émancipent. Il est regrettable qu'il semble plus facile aujourd'hui, à un enseignant, plutôt que de dispenser un cours structuré, de faire chercher ses élèves pendant des heures, avec le constat, au final, que ces derniers se heurtent à un mur d'ignorance.
Vous affirmez que le rôle de l'enseignant est primordial dans le système éducatif. Nous souhaitons, la présidente et moi-même, mettre en place un code de déontologie à l'instar de celui applicable aux médecins pour consacrer l'engagement des enseignants vis-à-vis de leur métier. L'enseignement au niveau des écoles supérieures du professorat ne mériterait-il pas également une remise en question ?
Le diagnostic d'une perte d'autorité des enseignants vous parait-il justifié ? Si oui, comment l'expliquez-vous et comment y remédier ?
Dans votre livre « École : le pire est de plus en plus sûr », vous regrettez que l'école ne se concentre pas davantage sur l'apprentissage des savoirs fondamentaux. Comment, selon vous, peut-elle y parvenir ?
Plus généralement, quelles mesures pourraient être mises en oeuvre pour lutter contre « le pire » qui, à en croire le titre de votre livre paru en 2011, est de plus en plus sûr ?
La perte d'autorité des enseignants est une « vieille lune » qui fait régulièrement l'objet de pétitions de principe, de considérations abstraites. Il faut rétablir l'autorité des enseignants, mais l'autorité arbitraire d'hier ne peut plus, aujourd'hui, s'exercer sur des adolescents de 13, 14 ou 15 ans, pas plus que le châtiment corporel pour l'assurer, et nous ne les souhaitons pas pour notre école.
L'autorité découle naturellement de la clarté de la mission de l'enseignant. À partir du moment où un enseignant a conscience qu'il est dans une classe pour transmettre le savoir, parce qu'il sait, que l'élève, lui, ne sait pas et qu'il est fondamental qu'il apprenne, et parce que c'est sa liberté qui est en jeu, son autorité peut commencer à s'asseoir.
Il m'est arrivé d'entendre, au cours de ma formation en IUFM : « vous avez beaucoup plus à apprendre de vos élèves que vos élèves de vous ». On peut comprendre de manière abstraite qu'enseigner à des jeunes gens nous transforme, que c'est une expérience formidable et qu'il faut réfléchir à la beauté de l'enseignement, mais quand cette phrase s'adresse à de jeunes professeurs qui attendent de la part de leurs formateurs des réponses concrètes sur la manière d'enseigner, cette phrase est dramatique. Et je n'en ai cité qu'une parmi d'autres...
Je pense qu'il faut « réinstituer » le professeur dans toute sa dignité, en lui rappelant sa raison d'être. Cela suppose de recentrer sa mission de transmetteur des savoirs fondamentaux. Avec des pédagogies modernes comme le constructivisme, le professeur ne sert plus à rien.
J'ai le souvenir du président de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP), en 2000, qui expliquait que l'introduction des ordinateurs à l'école était une invention formidable permettant au professeur de se placer non plus en face de l'élève mais à ses côtés : « ils regardent dans la même direction, c'est la pédagogie de la main sur l'épaule ». C'est-à-dire que l'élève chemine seul et que le professeur, qui est présent non pas pour le guider mais pour intervenir de temps en temps, se transforme ainsi en animateur. Ce rôle d'animateur du groupe classe a été mis en avant par les IUFM, en leur temps. Rien de tel pour saper l'autorité des enseignants.
L'autorité d'un enseignant découle de la certitude de ce qu'est sa mission mais aussi de la qualité de son savoir. Ma fonction d'enseignante pendant dix ans m'a appris que le professeur devait posséder au décuple sinon au centuple les connaissances qu'il est censé transmettre. L'interdisciplinarité dont on nous parle depuis trente ans ne consiste pas à faire travailler sur deux disciplines en même temps. C'est la capacité d'un professeur à relier le savoir qu'il transmet à d'autres disciplines. Un professeur de français doit connaître l'histoire et la philosophie, un professeur de philosophie les sciences, un professeur de sciences doit s'être intéressé à la philosophie des sciences. C'est par cette qualité du savoir que l'autorité du professeur ne sera pas remise en cause.
Imposer un savoir dogmatique ne suffit pas, encore faut-il être en mesure de pouvoir expliquer. Mon expérience m'a également appris que les différences entre les notions de savoir, d'opinion, d'information, de sentiment, de vérité restaient à définir auprès de jeunes collégiens et lycéens, qui retiennent de la part du professeur l'expression d'une opinion parmi d'autres et non pas celle d'un savoir.
Dans la loi d'orientation sur l'école de 1989, l'article 10 met en valeur la liberté d'expression des élèves à l'école. Le Conseil d'État s'est appuyé sur cet article 10 pour expliquer, lors des premières affaires de voile, que le port du voile n'était pas incompatible avec la laïcité. À partir du moment où l'on considère que l'école est un lieu d'expression de la liberté de l'élève et non un lieu d'apprentissage de la liberté à travers le savoir, on fragilise tout l'édifice et par là-même le professeur qui ne pourra plus imposer son savoir car ce sera un savoir vérifié.
Comment se concentrer sur les savoirs fondamentaux ? En leur accordant de la place. Les problèmes d'échec scolaire au collège et au lycée, dont on constate l'étendue dès l'entrée en 6e, et de rejet des valeurs de la République sont liés en partie à la réduction du temps scolaire - en trente ans, un élève de 3e a perdu plus d'une heure de cours de français. Si certains savoirs fondamentaux ne sont pas acquis par les enfants dès l'école primaire, les professeurs de collège auront par la suite d'importantes difficultés à combler leurs lacunes.
Il est nécessaire de mettre en place une véritable recherche pédagogique, malheureusement plutôt sinistrée en France, l'Institut national de la recherche pédagogique ayant servi pendant des années à prôner des procédures idéologiques plutôt que de s'appuyer sur des recherches de terrain. Les méthodes de lecture syllabique, par exemple, sont reconnues actuellement par des spécialistes en neurosciences comme étant les plus efficaces chez les enfants issus de milieux défavorisés. Pourquoi ne pas reconnaître que la méthode globale, au cours préparatoire, donne de mauvaises habitudes aux enfants ? Comment enseigne-t-on la grammaire, l'orthographe, la conjugaison qui ne sont pas, comme je l'ai entendu dire par tant de pédagogues, « la science des imbéciles ».
Oui, si cela est acceptable de la part d'Anatole France, car, derrière ces mots, il y a une pensée fondée sur la connaissance de l'histoire et de la littérature, cela ne l'est pas de la part d'un pédagogue qui prétend remplacer la grammaire par l'observation des mots afin que l'élève puisse en déduire par lui-même la nature. Il est ainsi déconseillé au professeur de prononcer le mot « verbe » avant la deuxième partie de l'année scolaire en CP. N'est-il pas plus simple de dire à un enfant qu'on appelle verbe un mot qui porte l'action dans une phrase ? La différence entre la méthode inductive et la méthode déductive, c'est le nerf de la guerre, car c'est à partir de l'abandon progressif d'un enseignement logique et structuré que l'on se retrouve avec des enfants en carence qui ne maîtrisent pas la langue.
Or un enfant qui ne maîtrise pas la langue ne maîtrise ni la pensée, ni le monde. Il nourrit un sentiment de frustration et de rejet, qu'il exprimera plus tard d'une manière ou d'une autre.
Les méthodes pédagogiques d'apprentissage de la lecture doivent donc être revues, en se fondant sur l'évaluation des dispositifs existant sur le terrain. Des associations travaillent sur ces aspects, inventent des programmes, réfléchissent à des manuels scolaires progressifs. Je ne citerai que l'association SLECC, « Savoir lire, écrire, compter, calculer », et le GRIP, Groupe de recherche interdisciplinaire sur les programmes. En comparant les manuels produits par ces associations et les autres, on s'aperçoit facilement qu'il n'y a rien de complexe à se recentrer sur l'apprentissage des savoirs fondamentaux.
Bien évidemment, des arbitrages sont nécessaires. Il est important d'enseigner des problématiques comme la sécurité routière ou l'hygiène, mais là n'est pas la priorité. L'idée d'enseigner le français de manière transversale, dans toutes les matières, qui est restée en vogue pendant longtemps, est une aberration. Il ne sera jamais identique pour un enfant de se voir expliquer une règle de grammaire dans le cadre d'un autre cours, alors même qu'il essaie de se concentrer, et de suivre un véritable cours de français. Arrêtons de compliquer les choses ! Un enfant a besoin de simplicité, de logique. Allons voir sur le terrain les méthodes qui marchent. Les enseignants du groupe SLECC ont d'excellents résultats, et apprennent à lire à leurs élèves avant la fin du CP. Or, un enfant qui ne sait pas lire à la fin du CP a 80 % de chance d'être par la suite en difficulté scolaire, car c'est sur la base d'un socle solide de fondamentaux que l'on peut ensuite déployer les autres savoirs.
Des générations entières sont aujourd'hui perdues. Comment faire pour limiter les dégâts ? L'essentiel est que tous les enfants puissent trouver, à l'école, des enseignements qui les nourrissent et répondent à leur quête de sens et de valeurs. Pour cela, nous devons rétablir des méthodes efficaces, dès le primaire. L'institution doit reprendre conscience de son rôle. Elle se doit également de transmettre un récit national, non pas un endoctrinement, qui ressasse les vieilles images d'Épinal, mais un roman national reconstruit en fonction de notre vision moderne. C'est de cette manière que l'école peut faire comprendre aux enfants, d'où qu'ils viennent, que ce pays est à eux, et que l'histoire de France, même si elle n'est pas celle de leurs parents, est néanmoins la leur, car leur avenir est en France. Si l'on imagine que l'on va favoriser la cohésion républicaine en enseignant aux enfants ce que l'on croit être leur histoire, on se trompe et on fait même preuve de mépris, car leur peuple est la France. Je vous donnerai l'exemple d'un de mes étudiants de l'université Léonard de Vinci, d'origine antillaise, qui, ayant reçu une mauvaise note sur un devoir d'histoire, m'avait assuré de pas avoir besoin de connaitre l'histoire de France car il connaissait déjà celle de son peuple, à savoir l'esclavage. C'est la démonstration que la société nationale est aujourd'hui fracturée !
Cela doit se décliner de manière très concrète dans les classes. Chaque mot que prononce un professeur, la façon de présenter une connaissance, un livre, un texte, a toute son importance. La consolidation des piliers de l'institution doit donc avant tout se traduire par un renforcement de la formation des professeurs.

Madame, je vous remercie pour cet exposé, auquel j'adhère complètement. J'aurais néanmoins plusieurs questions à vous poser.
Premièrement, pensez-vous que l'on puisse reprocher quelque chose aux jeunes enseignants, alors qu'ils ne s'engagent à rien au moment de leur titularisation ? À cet égard, trouveriez-vous farfelue l'idée de leur faire souscrire, à l'image du serment d'Hippocrate, un « serment de Socrate » ?
Vous mentionniez par ailleurs l'importance des méthodes pédagogiques, et j'y suis très sensible. Il est vrai que dans la plupart des cas les enseignants ont recours à la méthode déductive. Or, ces méthodes ne semblent pas toujours efficaces sur des élèves ne disposant pas des capacités suffisantes. Je crois que mixer méthodes inductive et déductive peut être un facteur de réussite. Qu'en pensez-vous ?

Je m'associe aux remerciements de mes collègues. Vos propos convergent avec ce que nous observons sur le terrain. Je souhaiterais vous poser une question plus technique sur la lecture. J'ai le sentiment que les générations actuelles sont, depuis une dizaine d'années, des générations du numérique, et ne savent plus lire. Avez-vous des observations sur cette invasion du numérique et sur la façon de la combattre ?
Il est évident que l'on ne peut reprocher les difficultés actuelles aux jeunes enseignants, tout simplement parce qu'ils sont eux-mêmes le produit de cette école. Il n'est pas question d'accuser, mais de poser un diagnostic, de comprendre que beaucoup de professeurs souffrent de cette situation, d'être en permanence remis en question par les élèves. Nous devons leur redonner conscience de ce qu'est leur mission, au risque de voir disparaitre des savoirs accumulés par des générations de professeurs. Le serment peut être une solution, même si je vois d'emblée la levée de boucliers contre une telle mesure, que certains accuseraient d'un retour vers les heures les plus sombres de notre histoire. Si on s'orientait dans cette direction, il serait indispensable que les représentants des pouvoirs publics rappellent, avec fermeté, qu'un serment prêté à la République ne serait pas la même chose qu'un serment prêté à l'État français à une certaine époque.
Je crains néanmoins qu'un serment ne soit pas suffisant. La question cruciale est celle de la formation qualitative des enseignants. Trop de professeurs sont recrutés avec des savoirs flottants. Il suffit d'aller interroger les jurys de CAPES pour comprendre qu'ils sont obligés d'accepter des candidats parfois « limite », principalement par manque de candidats. La profession enseignante n'attire plus, car les conditions de travail sont déplorables.
Tant que l'institution scolaire laissera les enseignants être maltraités, injuriés ou méprisés par l'ensemble de la nation, il sera illusoire de prétendre attirer les meilleurs étudiants dans les filières d'enseignement. Cela rejoint d'ailleurs la question de la situation matérielle des professeurs : tant qu'ils ne seront pas correctement rémunérés, la fonction enseignante ne pourra pas être attractive. Les systèmes scolaires qui fonctionnent le mieux sont ceux où le métier d'enseignant jouit encore d'un certain prestige, où il est reconnu et bien rémunéré. Cela est notamment dans le cas dans un système très ouvert, où le redoublement n'existe pas, comme le système finlandais, mais aussi dans un système coercitif comme celui de la Corée du Sud. Les difficultés de l'école dépassent donc largement la question de la nécessité ou non du redoublement...
Sur la question de M. Kennel, il me semble en effet indispensable d'associer les méthodes inductive et déductive. Cela étant, je ne connais pas de professeur qui dispense des cours magistraux, que ce soit en collège ou en lycée. Je suis, de ce point de vue, extrêmement surprise lorsque j'entends la ministre de l'éducation nationale affirmer que l'on ne peut plus faire de cours magistral.
Il suffit de se rendre dans une classe pour constater que plus aucun professeur ne se contente de « débiter » son cours devant ses élèves. Or, la capacité à bien utiliser ces deux méthodes naît de l'expérience. Il faut donc réfléchir à des pédagogies efficaces pour assurer la transmission des savoirs. L'inventivité et la créativité, dès lors qu'elles visent à améliorer cette transmission et ne se concentrent pas sur d'autres questions telles que l'évaluation des compétences, la capacité à s'exprimer à l'oral ou à travailler en équipe, sont évidemment positives. Il me semble, de ce point de vue, qu'il serait utile de prendre en compte le caractère artisanal du métier d'enseignant et de développer une forme de compagnonnage. Comme tous les enseignants, au début de ma carrière, j'ai bénéficié d'un suivi assuré par une tutrice, laquelle d'ailleurs n'avait pas fait l'objet d'une inspection depuis au moins dix ans. Si j'ai pu prendre part, quelques fois, à sa classe, je ne me suis, en revanche, jamais rendue dans d'autres classes. Il m'a donc été impossible de me confronter à d'autres méthodes. Or, il me semble qu'il serait utile de développer l'ouverture des classes. Je suis consciente que, pour les enseignants, cette proposition est extrêmement violente. Tout professeur vit dans la crainte de voir son enseignement jugé par d'autres. Il faut donc travailler à la disparition de cette peur, car c'est en croisant les expériences que l'on parviendra à améliorer les méthodes pédagogiques. Le tâtonnement fait partie du métier d'enseignant. Éric Debarbieux soulignait qu'il était dramatique d'affecter les professeurs débutants dans des établissements difficiles. Certes, les jeunes enseignants peuvent être plus motivés que leurs aînés ou faire preuve de davantage d'inventivité, mais il me semble crucial d'arrêter de les envoyer au massacre. À Épinay-sur-Seine, où j'ai enseigné, tous les jeunes professeurs, notamment des disciplines littéraires, chez qui le sentiment d'appartenance aux « hussards noirs » de la République est peut-être plus marqué, étaient en situation de souffrance. Il est nécessaire de modifier ce système, même si cela risque de fâcher certains syndicats...
La question de M. Longuet soulève en effet un problème dramatique et complexe. Les écrans qui envahissent notre société sont à la fois une chance formidable et une arme de destruction massive pour les enfants.
Si j'avais les clés du pouvoir, j'interdirais les chaînes de télévision pour enfants le matin. En effet, un enfant qui se rend à l'école après avoir regardé des dessins animés est incapable de se concentrer. N'importe quel instituteur vous le dira. Il faut se pencher sur cette question. Mais les écrans peuvent aussi être une chance pour ceux qui ont été bien formés. Or, l'école forme un nombre élevé de mauvais lecteurs qui, parce qu'ils parviennent à déchiffrer les textes, ne sont pas détectés comme tels par l'institution scolaire. Cette situation résulte généralement d'une formation déficiente et de la répétition de mauvais mécanismes consistant, pour l'enfant, à regarder la forme globale du mot, en lire le début et en déduire la suite. Les difficultés rencontrées par ces élèves s'aggraveront plus tard. C'est pourquoi le taux d'illettrisme des jeunes est plus faible que celui des adultes qui ont entre 65 et 70 ans, mais que ce taux augmente avec le temps. Les méthodes d'apprentissage de la lecture constituent donc une problématique centrale qui doit se nourrir des recherches scientifiques de plus en plus nombreuses sur ce sujet.
Pour autant, la confrontation aux écrans ne doit pas être une marotte de l'éducation nationale. Un enfant bien formé pourra rapidement accéder à ce savoir. Il me semble à cet égard nécessaire de dispenser assez tôt une initiation au codage afin de sortir d'une sorte de « pensée magique » consistant à être consommateur de ces objets sans en comprendre le fonctionnement. En revanche, imaginer que l'on va révolutionner l'école par les technologies numériques est illusoire. L'utilisation systématique des nouvelles technologies a un coût et les expériences qui ont été menées, notamment dans les Landes où des ordinateurs ont été fournis à l'ensemble des collégiens, n'ont pas été concluantes. J'ai rencontré le responsable de cette expérimentation qui m'a indiqué que les performances scolaires des enfants n'avaient pas été modifiées, mais que cela avait beaucoup servi à télécharger des jeux...
L'ordinateur peut être utile dès lors qu'il est utilisé à des fins pédagogiques par des enseignants bien formés. En revanche, distribuer des tablettes ou des ordinateurs me semble relever du gadget.
Lorsque j'enseignais à l'université Léonard de Vinci, je demandais à mes étudiants de réaliser des exposés sur des sujets ennuyeux et dont l'énoncé était problématisé. Cet exercice devait me permettre d'évaluer leur capacité à s'investir dans un sujet, à en parler avec conviction tout en évitant l'écueil du copier-coller. J'avais notamment demandé à l'un de mes élèves de traiter le sujet suivant : pourquoi et comment Alexandre le Grand est-il devenu un mythe ? J'attendais une réflexion sur la première mondialisation, la définition d'un mythe, etc. Or, cet étudiant s'est contenté de lire un document dactylographié - dont j'avais pourtant interdit l'utilisation pour éviter tout plagiat - qu'il découvrait en même temps que le reste de la classe et dont je me suis rapidement aperçue qu'il n'était qu'une impression de la fiche Wikipédia d'Alexandre le Grand. À la fin de cette lecture, cet étudiant a proposé de lire un texte, dont il n'était évidemment pas en mesure d'indiquer la source ou l'auteur. Il s'agissait d'un extrait de la vie d'Alexandre par Plutarque.
Cet exemple me semble illustrer le naufrage dont l'ordinateur peut être à l'origine. Laisser les élèves seuls face aux outils numériques, c'est les inciter à la facilité. Le rôle de l'enseignant consiste, à l'inverse, à leur donner le goût du savoir et de la recherche et à leur donner les outils qui leur permettront ensuite de se repérer dans cette « forêt » qu'est Internet. Plutôt que de dépenser des dizaines de milliers d'euros pour équiper les élèves en tablettes, il serait préférable de former les professeurs aux outils numériques, qui peuvent leur être utiles, et de les aider à développer chez leurs élèves la capacité à retranscrire, transformer, réécrire une phrase. Les enseignants doivent les guider dans la recherche de sources et les pousser à développer un minimum d'esprit critique.

Ma question est en fait une remarque. Au cours des stages que j'ai effectués, j'ai pu constater que certains logiciels pouvaient permettre à des enfants rencontrant d'importantes difficultés de lecture et qui n'osaient pas en parler, par peur du regard des autres, de faire d'importants progrès en leur permettant de répondre seuls à des questions. Je regrette que l'on ait abandonné l'utilisation de ces outils.
Ces logiciels peuvent en effet constituer des outils pédagogiques utiles. Mais si ces enfants manquent de confiance en eux, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir les bons enseignants. Cela rejoint la question de la formation des professeurs. Il ne s'agit pas de « victimiser » les élèves, mais notre rôle en tant qu'adultes, le respect que nous leur devons, consiste à leur enseigner l'effort, à faire preuve d'exigence, même si cette exigence doit être bienveillante. Le travail réalisé grâce au logiciel que vous évoquez devrait être celui de l'enseignant qui pousse l'élève à tenter, à ne pas avoir peur de se tromper. Cela nécessite d'avoir des enseignants formés, notamment dans le cadre de la formation continue, qui est largement inexistante, mais il ne faut pas croire que cela va révolutionner le système scolaire.