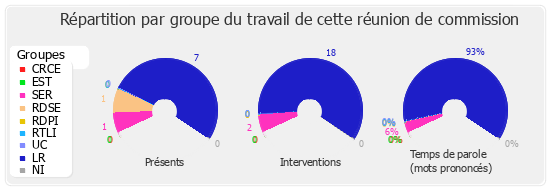Commission d'enquête sur le service public de l'éducation, les repères républicains et les difficultés des enseignants
Réunion du 19 mars 2015 à 9h00
Sommaire
- Audition de m. alain-gérard slama journaliste professeur à sciences-po (voir le dossier)
- Audition de m. alain-gérard slama journaliste professeur à sciences-po sera publié ultérieurement
- Audition de m. françois-xavier bellamy professeur de philosophie auteur de les déshérités ou l'urgence de transmettre sera publié ultérieurement
- Audition de mme gabrielle déramaux professeure de lettres modernes auteure de collège inique ta mère ! sera publié ultérieurement
- Audition de m. daniel keller grand maître du grand orient de france sera publié ultérieurement
- Audition de m. françois-xavier bellamy professeur de philosophie auteur de les déshérités ou l'urgence de transmettre (voir le dossier)
- Audition de mme gabrielle déramaux professeure de lettres modernes auteure de collège inique ta mère ! (voir le dossier)
- Audition de m. daniel keller grand maître du grand orient de france (voir le dossier)
La réunion

Mes chers collègues, nous débutons aujourd'hui nos auditions en recevant M. Alain-Gérard Slama, journaliste et enseignant à l'Institut d'études politiques de Paris.
Comme le bureau de la commission d'enquête l'a décidé, cette audition sera captée et diffusée en direct sur le site Internet du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte rendu publié dans le Recueil des travaux des commissions, accessible en version papier et sur le site Internet du Sénat.
Agrégé de lettres classiques, vous êtes éditorialiste au Figaro, chroniqueur aux hebdomadaires Le Figaro Magazine, Le Point et aux Matins de France culture. Vous travaillez notamment sur les questions politiques, sociales et sociétales.
Spécialiste des institutions, vous vous êtes notamment intéressé à l'une d'entre elles, l'école. En février 2003, vous avez ainsi été nommé expert auprès de la commission mise en place par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, Luc Ferry, et par le ministre délégué à l'enseignement scolaire, Xavier Darcos, afin de rédiger un guide destiné à faire vivre l'idée républicaine dans les écoles. La même année, vous participez aux travaux de la commission nationale du débat sur l'avenir de l'école, qui a remis un rapport au Premier ministre en octobre 2004 proposant, notamment, la mise en place d'un socle commun de connaissances, une meilleure formation des enseignants et une « éducation du citoyen ».
En 2009, en votre qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental, vous signez un rapport sur l'éducation civique à l'école dans lequel vous proposez d'asseoir les bases de l'éducation civique dès la maternelle et les premières années de l'enseignement primaire, de promouvoir un socle commun de valeurs et de faire de l'enseignement de l'éducation civique un enseignement transversal.
C'est à ces différents titres que la commission d'enquête a souhaité vous auditionner. Nous aimerions avoir votre avis sur la transmission des repères républicains et sur le rôle que doit y jouer l'école.
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, M. Alain-Gérard Slama prête serment.
Il est rare que des personnes de mon modeste niveau aient l'occasion de s'adresser à d'autres interlocuteurs que mes étudiants de Sciences-Po ou à mes lecteurs et mes auditeurs, ces derniers ne se manifestant en général que quand ils sont mécontents... Avoir enfin un contact avec les élus constitue pour moi une chance, presque une aubaine !
J'ai écouté sur le site du Sénat un grand nombre des interventions précédentes, notamment celle des anciens ministres, MM. Ferry, Châtel et Chevènement. J'ai été frappé par le fait que ces derniers se sont révélés très complémentaires. Tous ont fait du bon travail, ont fait preuve de bonne volonté et avaient une réponse à chacune des questions que vous avez posées. Par ailleurs, nous voyons bien, depuis le 7 janvier dernier, que l'opinion publique a enfin conscience des problèmes soulevés aujourd'hui par la laïcité, le lien social, l'idée de nation et de nationalité. Et cependant on a l'impression que ceci reste sans prise sur les choses.
Si je faisais un bilan des résultats obtenus par notre école, malheureusement, le constat serait celui d'un échec. Nous n'assistons pas à un progrès, mais plutôt à une régression de l'alphabétisme, à une montée de la violence, à une situation dans laquelle tant de professeurs, pleins de bonne volonté à l'instar de leur ministre, se plaignent d'être en déshérence et d'être abandonnés, et ce pas seulement dans les quartiers difficiles. Ils ne se sentent pas soutenus face à la violence, quand leur proviseur a reçu du ministère la consigne de ne pas faire de vagues. La suppression de l'indicateur SIGNA, qui recensait les actes de violence à l'école et qui avait mis en évidence leur forte hausse, est à cet égard assez frappante. Nous sommes aujourd'hui devant un mystère. Comment se fait-il que malgré tant d'efforts, tant de textes, nous n'obtenions pas les résultats que nous sommes en droit d'attendre ? La forte instabilité des ministres successifs de l'éducation nationale ne doit pas être surestimée comme facteur de cet échec.
La définition des notions me paraît essentielle. Parle-t-on tous de la même chose en matière de laïcité ? Les manifestants du 11 janvier 2015 pensaient-ils tous la même chose lorsqu'ils parlaient de laïcité ? Il en va de même en matière d'identité. Les remous suscités par le débat sur l'identité nationale en 2009 ont montré qu'il s'agit d'une question délicate. On a assisté à cette occasion à une multiplication des revendications identitaires, auxquelles il est difficile d'opposer l'argument de l'antériorité. Il y a là un vrai problème. Cette composante même de notre culture s'inscrit en faux contre tout argument invoqué au titre d'une quelconque antériorité. Un autre concept à la mode, si vous me permettez l'expression, est celui de fraternité. De quoi s'agit-il ? Le professeur Carbonnier soulignait qu'une certaine philosophie des droits de l'homme tendait à créer au bénéficie de l'autre le droit d'exiger qu'on le traite en frère. Faut-il pénaliser l'absence de fraternité ? Je ne le crois pas.
Il y a là tout un ensemble de notions que j'aimerais tenter de recadrer. Vous avez rappelé, madame la présidente, que j'ai rédigé un rapport sur l'éducation civique à l'école à la demande du Conseil économique, social et environnemental, dans lequel j'insiste sur le fait qu'il faut l'enseigner dès la maternelle. Essayer de définir les concepts que j'ai cités permettra de justifier l'enseignement dès le plus jeune âge de l'éducation civique.
Commençons par la laïcité. Il existe une véritable conception française de la laïcité, qui ne ressemble à aucune autre et qui nous a longtemps été enviée par nos voisins. Qu'entendre par laïcité ? L'État laïc n'est pas neutre, il neutralise le plus possible la sphère publique. Il sépare le plus possible l'espace public de la sphère privée. Cela se voit de façon très claire dans la loi du 9 décembre 1905. Son article premier prévoit que « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. » Ces restrictions sont claires. Par exemple, l'article 26 interdit la tenue de réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte. Cela signifie qu'il n'y a pas de confusion acceptable ou admissible entre l'espace public et un lieu qui a vocation à accueillir les passions irrationnelles - c'est-à-dire différentes de la raison politique qui a été l'idéal des Lumières. Ainsi, les processions religieuses ne sont pas interdites, mais soumises à autorisation. Il en va de même pour les crèches dans les mairies. Cet usage ne me choque pas, mais lorsque la question de droit est posée, il faut appliquer la loi. La loi Debré de 1959 sur l'école privée a été remarquablement astucieuse. Elle prévoit le financement de l'école privée, dans la mesure où il n'est pas de liberté formelle qui n'éprouve le besoin de sa consécration dans un exercice réel. Mais il y a des contraintes posées par contrat. Il y a des lieux où le caractère propre de l'établissement prime, d'autres où c'est la règle de la République qui s'impose. L'esprit de cette loi est resté. La proposition de loi étendant le principe de neutralité religieuse aux structures de petite enfance recevant des financements publics ne me choquait pas. Dès lors qu'il y a financement de l'État, ce dernier est en droit d'exiger une neutralité. Cette conception de la laïcité nous est propre : l'État neutralise la sphère publique.
Si l'on veut éviter les conflits à l'intérieur de la société, il faut que l'État « honnête homme », expression que je préfère presque à l'État de droit, favorise la tolérance réciproque. Cette tolérance permet de trouver des accommodements, tant que ce n'est pas l'État qui finance. Ce raisonnement s'applique de nos jours pour les mosquées. S'il faut surveiller ce qui s'y dit et s'assurer que l'utilisation des lieux de culte est conforme à la loi de 1905, il n'appartient pas à l'État de former les imams ; d'autres formules peuvent être trouvées.
Le second thème de mon intervention est la notion d'identité. À partir de la Révolution, l'identité repose d'abord sur un certain nombre de vecteurs issus de l'éducation. L'identité française est à la fois celle que je me construis par moi-même, dans laquelle je m'identifie à mes actes et en prends la responsabilité, mais elle repose d'abord sur l'éducation. D'autres modèles étrangers s'appuient davantage sur le sang, l'ethnicité ou la religion. Les vecteurs produits par le système éducatif ont permis de constituer la nation française à partir de populations d'origines ethniques et d'appartenances religieuses différentes. Il est vrai qu'aujourd'hui on redécouvre des revendications d'appartenance, mais le phénomène communautaire demeure un phénomène largement imaginaire. Il répond à une demande de la société qui se tourne vers l'État pour obtenir une reconnaissance, une escalade de revendications de droits, dont les effets ne sont pas heureux. Ainsi, le grand rabbin souhaiterait que les dates du baccalauréat soient déplacées en fonction des fêtes juives. Des exigences identiques se font jour dans les cantines scolaires - où des alternatives sont toujours possibles, notamment par la fourniture d'un menu de substitution. Se focaliser sur ces questions, c'est vouloir faire un problème politique de quelque chose qui a un caractère subalterne. Une identité qui se réclamerait d'une appartenance ethnique ou religieuse serait à la fois dangereuse et illégitime.
Pour répondre à ma réflexion initiale, l'échec du système scolaire, malgré tous les efforts menés, procède d'un durcissement de la demande sociale en direction de conceptions de la laïcité et de l'identité différentes de celles qui prévalent dans notre culture. Nous assistons, comme l'a très bien analysé Jean Carbonnier dans un essai intitulé Droit et passion du droit sous la Ve République, à une dérive du droit de plus en plus difficile à maîtriser.
Il me semble, moi qui me suis toujours battu contre les IUFM - que j'ai longtemps considérés comme des lieux d'improvisation pédagogique - qu'il est aujourd'hui nécessaire de renforcer la formation des maîtres, dont la bonne volonté n'est pas en cause, en recréant les IUFM.

J'aurai trois questions à vous poser.
Dans un rapport du Conseil économique, social et environnemental de 2009, vous proposiez la mise en place de cours d'éducation civique dès la maternelle. De ce point de vue, que pensez-vous des annonces récentes du Président de la République et de la ministre de l'éducation nationale ?
Dans une circulaire de 1883, Jules Ferry demandait aux enseignants de parler « hardiment », car ce qu'ils communiquent à l'enfant, ce n'est pas leur propre sagesse, mais la sagesse du genre humain. Pensez-vous que les enseignants sont suffisamment soutenus dans ce travail, qui n'est pas directement disciplinaire ?
Enfin, quelles valeurs devraient être plus précisément enseignées ? Selon quelles méthodes, quelle pédagogie ?
Vous avez à très juste titre rappelé que Jules Ferry, dans sa lettre aux instituteurs, conseillait aux enseignants de parler « hardiment » de sujets importants. Il leur disait aussi : « ne dites rien qui pourrait froisser la conscience d'un seul de vos élèves ou même des parents ». Son idée était qu'il fallait enseigner des principes fondamentaux aux élèves, tout en évitant de leur inculquer ce sur quoi tôt ou tard ils se rebelleraient, à savoir une morale d'État.
Je me souviens que lorsque j'ai publié ce rapport, les médias m'ont accusé de prôner un retour à la morale. Ce n'était pas le cas. En République, droit et morale sont hétéronomes. Il ne s'agit pas d'être machiavélien. Cela signifie simplement que le pouvoir, le politique doivent s'arrêter là où commence l'injonction morale, qui engage des choix de valeurs. Le problème réside en effet, aujourd'hui plus que jamais, dans la contradiction entre les valeurs enseignées à l'école et les valeurs des familles.
Dans un texte antérieur, écrit à la fin du Second Empire, Jules Barni, fervent républicain et résistant, disait : « on commence à comprendre aujourd'hui que la politique et la morale ne sont pas absolument identiques. Le domaine de la politique est celui du droit, c'est-à-dire de tout ce qui peut nous être légitimement imposé par une contrainte extérieure. » Je posais tout à l'heure cette question, peut-on contraindre à être fraternel ? « Ajoutez au règlement du droit naturel, droit antérieur et supérieur en soi à toute convention, mais qu'il faut bien fixer par des lois positives, celui des intérêts collectifs, auxquels il peut nous convenir de pourvoir par des conventions publiques qui deviennent aussi des lois pour chacun de nous, et vous aurez tout le domaine de la politique. Sa juridiction ne s'étend pas au-delà. » Je dirais même que c'est grâce à cela que la IIIe République n'a pas été totalitaire. Elle a restreint l'espace dans lequel la loi pouvait intervenir et laissé à l'individu des choix qui n'appartiennent pas à la société, mais à chacun. « Le reste », disait Barni, « c'est-à-dire tout ce qui dans la morale n'est pas de droit, appartient exclusivement au for intérieur, au domaine de la conscience. Que la politique, que la démocratie particulièrement, soit intéressée à l'observation de ces devoirs, qui ne regardent que la conscience, qu'elle en favorise même l'action, si c'est possible, par les moyens qui sont de son ressort, à la bonne heure ! Mais elle n'a pas le droit de les imposer par la force dont elle dispose. Lorsqu'elle méconnait la limite de sa juridiction et qu'elle empiète sur le domaine propre de la morale, elle tombe dans une tyrannie insupportable, elle est condamnée à employer les plus détestables moyens, l'espionnage des moeurs, l'inquisition des consciences, et elle favorise ce qu'il y a de plus odieux au monde, l'hypocrisie. »
Je dois dire que dans la culture politique française, la société supporte très bien les menteurs, mais elle a horreur des hypocrites. Ce qui rend d'ailleurs parfois la tâche difficile pour la gauche, car lorsque l'on prend un homme de gauche en contradiction avec les principes qu'il affirme, on lui tombe dessus !
Ma réponse à votre question est là. J'ai un peu peur aujourd'hui que l'on dérive vers la tentation d'édicter une morale d'État - ce dont je me suis bien gardé dans ce rapport de 2009. Mais on le voit, la demande sociale, les médias, la presse veulent à tout prix associer la morale à la droite, et le droit à la gauche. Il s'agissait de me diaboliser d'emblée.
Sur votre dernier point, relatif aux valeurs à enseigner, il importe de ne pas être anti-pédagogiste par principe. Il faut donner aux enfants, dès le plus jeune âge, la conscience qu'ils sont capables de distinguer entre le bien et le mal. Beaucoup de maîtres de maternelle savent le faire, mais il faut mettre en place une formation spécifique sur ces aspects et enseigner la psychologie des groupes. Les enfants doivent apprendre les rapports de civilité. L'histoire de la civilité est très intéressante à observer. Ce sont les salons, les associations, les corporations, les syndicats qui ont créé des règles de civilité, en quelque sorte pour se protéger contre l'intrusion du pouvoir. Ce sont des codes non écrits de la vie en société, au titre desquels nous nous devons d'être civilisés. Or, plus on cherche à traiter des rapports de civilité dans des textes écrits, plus on suscite l'intervention du pouvoir, la pénalisation de la société, et on en arrive à des situations caricaturales.
Par exemple, sur la question de la langue, parler le français le mieux possible constitue, dans cette logique, une politesse vis-à-vis des autres et de soi-même, du temps de gagné pour les communications, des références à tout un passé culturel partagé. J'ai été assez gêné par une loi qui voulait nous faire parler français si on voulait éviter une contravention. Nous ne sommes pas civils dans le métro pour éviter une contravention ! Mon propos peut vous paraître ultralibéral, mais il est en réalité profondément républicain.
Je crois important de faire comprendre aux enfants qu'être responsable est une condition de la liberté, que lorsqu'on prend un risque il faut en assumer les conséquences, et leur apprendre à distinguer entre la sphère publique et la sphère privée. On réécrit d'une certaine manière l'Émile de Rousseau.
Il y a enfin, bien entendu, la langue. Il convient de parler aux enfants, dès le plus jeune âge, avec un certain degré d'exigence. Les statistiques nous montrent que si les bases de la lecture, de l'écriture, ne sont pas acquises dès les premières années, il est d'autant plus difficile de les rattraper plus tard. Le problème aujourd'hui réside dans le fait que la thèse de Bourdieu et de Passeron sur les Héritiers, que j'avais combattue en mai 68 - et je le regrette -, se trouve vérifiée : les enfants qui disposent de bibliothèques chez eux, qui entendent parler un bon français, éprouvent moins de difficultés à l'école.

Je souhaiterais tout d'abord vous poser une question d'apparence simple : où est le pouvoir à l'éducation nationale ? Vous pouvez nous répondre sur la base de votre expérience et de votre pratique des différents ministres... Je partage d'ailleurs votre sentiment relatif à la bonne volonté des ministres de l'éducation nationale, qui ne donne pas de résultats.
Vous avez par ailleurs évoqué la question de la légitimité de l'identité - être là avant. Je partage totalement ce point de vue. Il existe deux approches des valeurs républicaines : une première approche, fondée sur la table de la loi, en d'autres termes la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; une seconde approche, qui pose la Révolution française comme le produit de notre histoire, avec plus de profondeur. Je crois que si l'antériorité ne légitime pas tous les droits, récuser l'héritage nous appauvrit nécessairement et fait disparaitre notre identité. Où est selon vous le point d'équilibre ?

Vous avez mis en parallèle les efforts réalisés, l'abondance de textes et les résultats très insuffisants. N'y a-t-il pas un problème de méthode ? Peut-on résoudre les problèmes de l'éducation uniquement par les textes ? Ne faudrait-il pas passer de la culture de la circulaire à la culture du contrat entre les différents acteurs ?
Vous avez également dit qu'il fallait agir très tôt auprès des élèves. Encore faudrait-il que nos jeunes soient capables d'assimiler ces concepts. Or, nous savons que 30 à 40 % d'entre eux entrent en collège sans maîtriser les fondamentaux. La ministre s'attaque à la réforme du collège, mais le coeur du problème ne serait-il pas plutôt au niveau du premier cycle ?
À M. Longuet qui pose la question du pouvoir, je répondrai que celui-ci ne peut s'incarner en une seule personnalité, fut-elle ministre. Les ministres eux-mêmes en ont quelque peu rabattu et adoptent maintenant un profil modeste. Le pouvoir se situe sans doute de manière diffuse dans l'administration. Or il est difficile de réformer l'administration en France, où nous n'avons pas la culture de l'évaluation, ainsi que l'ont montré par exemple les résultats quelques peu décevants de la LOLF.
S'agissant de l'éducation nationale, cette énorme forteresse entropique, on peut certes envisager l'introduction de certaines marges d'autonomie, à condition toutefois de maintenir en référence absolue un cadre national pour les programmes scolaires. Nous devons rester fermes sur ce point et ne pas laisser les politiques, même les parlementaires, intervenir dans l'élaboration des programmes.
Par ailleurs, nous devons concentrer nos efforts pour la formation d'enseignants compétents qui, par ailleurs, devront être soutenus face à leurs élèves.
La seconde question de M. Longuet portait sur l'importance des racines historiques de nos valeurs républicaines. Certes ces valeurs procèdent d'un ensemble doctrinal parfaitement cohérent datant de la Révolution française issu de Rousseau et du siècle des Lumières. Mais ces valeurs portent aussi en elles des siècles d'élaboration et de transmission d'un patrimoine politique et culturel. À chaque époque cette construction s'est opérée en laissant la maîtrise de l'espace aux princes et la maîtrise du temps aux écrivains et aux penseurs. Si de tous temps il y a eu des écrivains contestataires, il semblerait qu'aujourd'hui, les écrivains prennent de façon inédite une certaine distance avec le pays.
La compréhension et la pratique des valeurs républicaines ne peuvent se faire que par la transmission de ce patrimoine ; transmission qui suppose, d'une part, une bonne maîtrise de la langue et, d'autre part, j'oserais dire, un minimum de travail. La maîtrise de la langue est insuffisante chez près de 40 % des élèves entrant au collège or, lorsque les mots sont absents, c'est la violence qui s'exprime.

Je ne reviendrai pas sur la notion de laïcité, ni sur la formation des enseignants, mais pourriez-vous nous donner des précisions sur certaines idées que vous dites avoir au sujet de la formation des imams.
Leur pratique de la langue française est généralement insuffisante, et il arrive même que leur connaissance du Coran soit approximative. Pourtant, il n'est pas question de donner des cours de religion aux imams, mais plutôt de leur expliquer comment l'islam doit prendre en compte la culture française et les règles républicaines. Le cadre de ces formations pourrait être des fondations, contrôlées par des commissaires du Gouvernement, ce qui serait parfaitement compatible avec la loi de 1905. Quelques réflexions ont été lancées à ce sujet sous le gouvernement Villepin, mais elles n'ont pas eu de suite.

Ne pensez-vous pas que les difficultés viennent aussi du fait que les enseignants sont de moins en moins présents et impliqués, en raison notamment, de la diminution des heures de cours dispensées ?
Les enseignants, mal rémunérés et mal considérés, sont eux-mêmes en difficultés. Malheureusement, ceux qui se mobilisent ne sont pas forcément les plus laïques et les plus républicains. Par ailleurs, les médias ont toujours tendance à braquer leur attention sur les situations d'exception ou sur les personnalités tenant un discours extrême, même si elles ne sont pas représentatives de l'opinion générale. C'est la loi d'Olson.
Je souhaiterais citer l'initiative d'un ancien recteur de l'académie de Créteil, M. Jean-Michel Blanquer, qui avait mis en place des plages horaires réservées aux élèves en difficultés. Malheureusement, ce dispositif ne concerne qu'environ 100 000 élèves, les crédits de l'éducation nationale étant en concurrence avec ceux de la défense, bien que les deux ne soient pas sans lien.

Mes chers collègues, nous poursuivons notre séance d'auditions en recevant M. François-Xavier Bellamy, professeur de philosophie et auteur d'un ouvrage consacré aux questions éducatives.
Ancien élève de l'École normale supérieure, vous êtes professeur agrégé de philosophie. Depuis mars 2008, vous exercez aussi des fonctions électives, en tant qu'adjoint au maire de Versailles délégué à la jeunesse et à l'enseignement supérieur.
Parallèlement, vous êtes l'auteur de tribunes dans différentes publications dont Le Figaro, Valeurs actuelles et Libération, dans lesquelles vous vous intéressez plus particulièrement aux questions politiques et de société.
En 2014, vous publiez Les Déshérités, ou l'urgence de transmettre. Vous y faites part de votre étonnement face à la formation que vous avez reçue, où la transmission des savoirs est présentée comme une violence faite aux élèves.
La commission d'enquête a souhaité vous entendre pour que vous puissiez, à la lumière de votre expérience d'enseignant et de spécialiste des questions éducatives, présenter votre analyse des difficultés de l'école et des manières d'articuler ses différentes missions, qui consistent tant à éduquer à la citoyenneté qu'à instruire.
Pour vous, quelles mesures urgentes devraient être mises en oeuvre pour redonner à l'école sa fonction intégratrice ?
Comme le Bureau de la commission d'enquête l'a décidé, cette audition sera captée et diffusée en direct sur le site Internet du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte rendu publié dans le Recueil des travaux des commissions, accessible en version papier et sur le site Internet du Sénat.
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, M. François-Xavier Bellamy prête serment.
Je vous remercie infiniment, madame la présidente, de votre invitation qui me touche beaucoup. Vous avez mentionné mon expérience d'enseignant. Elle est bien modeste car je suis un jeune enseignant. Je voudrais me faire le porte-parole et tenter de relayer l'expérience de nombre de mes collègues, pour témoigner des difficultés que nous rencontrons quotidiennement dans l'exercice de notre métier et qui relèvent de l'intitulé même de votre commission d'enquête.
Ces difficultés ne sont pas étonnantes. Il est même étonnant que nous nous en étonnions car nous les avons peut-être créées. Une prise de conscience a résulté des événements dramatiques du mois de janvier, prise de conscience de l'étendue de la distance qui s'est créée entre la France et une partie de sa jeunesse, entre nos institutions et une partie de la société française, prise de conscience vécue dans la douleur par beaucoup de mes collègues qui voyaient leurs élèves incapables d'un dialogue avec eux et avec la République, incapables de partager ces repères et ces principes qui font la vie en société, qui la structurent et qui la protègent.
Il est étonnant que nous nous étonnions. Le diagnostic, nous le connaissons parfaitement. Permettez-moi de rappeler quelques éléments chiffrés que j'ai empruntés aux statistiques publiées par le Gouvernement, des organes de l'État ou par des institutions internationales.
De la dernière enquête PISA de 2013, il ressort que 22 % des collégiens en classe de 5e doivent être considérés dans une situation d'échec grave et comme incapables de participer de manière active et efficace à la vie de la société.
Une enquête publiée par la direction de la prospective et de la performance de l'éducation nationale indiquait que 20 % des élèves de 3e, soit un élève sur cinq, étaient incapables de donner un sens à une information et de décrypter un texte simple, incapables de prendre de la distance par rapport aux images publiées sur Internet. Comment s'étonner que cette distance critique devienne difficile, lorsque nous savons pertinemment, d'après nos propres statistiques, que nos élèves de 3e sont marqués par cette difficulté de décryptage d'un texte.
Une dernière statistique, la mieux connue mais dont nous parlons le moins, me paraît la plus dramatique. Elle ressort des journées Défense et citoyenneté et mesure chaque année l'illettrisme dans notre pays. Sont considérés dans une situation de grande difficulté 18 à 20 % des jeunes majeurs, incapables de déchiffrer un programme de cinéma, l'heure du film, ses acteurs ou le chemin à suivre pour se rendre dans la salle de cinéma.
Comment s'étonner ensuite de nous trouver devant une telle difficulté ? Comment s'étonner que nous ayons abandonné ces collégiens et ces lycéens, à la sortie des établissements scolaires, à la facilité du discours simpliste auquel ils sont exposés sur Internet et à la puissance de l'image devant laquelle aucune distance n'est possible sans l'expérience du texte, de la lecture et du déchiffrage ?
L'enquête PISA de 2013 met également en évidence le fait, très douloureux pour les enseignants, que notre système scolaire est devenu, en raison du poids de l'origine sociale qu'il supporte, le plus inégalitaire de l'OCDE.
Mais le système éducatif français n'est pas partout en situation de faillite et d'échec et nous pouvons être rassurés de voir encore nos enfants poursuivre leur scolarité dans des établissements dont les enseignants sont tout dévoués à leur métier. Beaucoup d'écoles réussissent à transmettre la connaissance aux élèves. Cependant, dans des lieux ou les familles se désintéressent de la scolarité de leurs enfants, nous avons abandonné nos élèves à la superficialité de certains discours et à la tentation de la violence. Tout cela, nous en étions conscients avant l'attentat de Charlie Hebdo, nous savions la difficulté à parler à nos élèves, à récupérer leur confiance quand ils sont soumis à la pression du numérique dans lequel ils trouvent non seulement une technologie d'information, mais aussi de désinformation, face à laquelle ils sont privés de tout esprit critique.
Je crois que nous sommes responsables de cet état de fait et je dirai même que nous l'avons organisé. Vous avez mentionné, madame la présidente, le petit essai que j'ai publié à la rentrée dernière Les déshérités. Dans cet essai, je fais part de mon étonnement et de celui de mes collègues, à notre arrivée à l'IUFM et tout au long de notre année de formation, de nous avoir vu imposé par l'autorité, légitime, de cette institution le principe fondamental selon lequel nous ne devions pas transmettre un savoir. Alors que nous avions auparavant suivi des formations pour partager un savoir commun, cet acte de transmission nous était présenté comme un acte de violence, une brutalité exercée sur nos élèves, un acte qui ferait peser sur eux la condescendance d'une culture qui s'imposerait à eux et les empêcherait d'être libres. Je ne condamne pas ceux qui ont tenu ce discours et trouverais tragique que le débat éducatif soit réduit à une suspicion mutuelle d'un camp contre un autre ; en tant qu'adultes, nous partageons le même désir de voir nos enfants grandir dans la liberté et l'humanité. Ce discours consistait à penser que l'autorité de l'adulte est une prévention exercée contre la liberté de l'enfant, que tout ce qui est donné à la transmission est enlevé à la liberté. C'était au départ un acte de générosité. Mais il y a faute morale du fait que, après constat d'échec, nous avons été incapables de remettre en cause ce principe.
Comment se fait-il que nous sachions mesurer l'illettrisme dans notre pays et soyons incapables de nous poser la question d'une véritable amélioration des méthodes d'enseignement de la lecture ? L'écart entre la conscience de la réalité et notre capacité à réagir, entre ce que nous savons tous devoir faire et ce que nous faisons effectivement, voilà ce qui constitue le véritable scandale éducatif. Les événements tragiques de Charlie Hebdo ont d'autant plus traumatisé les Français que l'agression venait de l'intérieur, commise par de jeunes Français qui ont quitté volontairement la République, la communauté nationale, jusqu'à exercer contre leurs propres concitoyens une violence inexplicable, injustifiable, barbare. Ce qui nous tétanise le plus, c'est de voir que ces jeunes Français avaient suivi la totalité de ce parcours républicain que nous voudrions d'intégration, mais qui est de désintégration.
Nous avons expliqué aux enseignants, qui l'ont redit à leurs élèves, que l'histoire française était coloniale, la langue française sexiste, qu'il fallait déconstruire la culture comme porteuse de stéréotypes, que le savoir était un poids qu'on leur infligeait, que la culture allait les empêcher de rester naturels. Les enseignants ont été amenés à concevoir leur propre métier comme une forme de malédiction nécessaire. On nous a expliqué que la notation était une brutalité. Nous cherchons une évaluation bienveillante, sans notes ; ceci implique que la notation serait violente et coercitive. Nous nous retrouvons aujourd'hui démunis devant cette désintégration que nous avons-nous-mêmes organisée avec les meilleures intentions du monde.
Je n'ai pas à porter de jugement mais à appeler à une prise de conscience collective qui commence par un examen de conscience. Reconsidérer la nécessité de reconstruire une école centrée sur sa mission propre : la transmission du savoir et de la culture. Une piste de réflexion pour refonder cette école ?
Au fond, la réforme de l'éducation nationale n'est pas une chose très compliquée. Nous avons dans notre histoire la trace d'un système scolaire qui a fonctionné, qui a réussi le miracle de reconstituer l'unité de notre pays au moment où la France était divisée, explosée, éclatée entre traditions religieuses et langues régionales. Les enseignants qui se dévouent à la tâche éducative n'attendent que ça : qu'on leur dise que le savoir qu'ils ont reçu et qu'ils ont envie de partager est la condition de toute éducation.
Le grand paradoxe de la mobilisation de l'école en faveur des valeurs républicaines, c'est qu'elle ne peut réussir à les transmettre avec une forme de coercition redoublée. Imposer des valeurs ou des cours de morale laïque ne fonctionnera jamais. Nous n'arriverons jamais à construire une école qui, pour n'avoir pas su former, voudrait désormais formater. Cela ne suscitera que réticence et résistance, et même une dissolution plus forte et plus vive encore de la communauté nationale. Si nous savons à nouveau structurer l'école autour de sa mission fondamentale qui est de transmettre savoir et culture, alors nous pouvons à nouveau construire une école qui éduquera car elle saura instruire. L'instruction est le seul moyen par lequel nous pouvons rebâtir une école qui à la fois reconstruise notre société et ouvre chacun de ses concitoyens à une authentique liberté.

Merci pour votre fraîcheur et votre enthousiasme réaliste, qui me séduit comme, je crois, l'ensemble des sénateurs présents ce matin. Il me semble que nous avons été souvent dans le déni et je me félicite d'entendre enfin un jeune enseignant formuler certains constats avec une telle ardeur. Je souhaiterais vous poser trois questions relatives à ces problématiques du savoir et la culture.
Tout d'abord, pensez-vous que la consolidation des savoirs fondamentaux peut participer à la transmission des valeurs républicaines ? Vous êtes professeur de philosophie, dans quelle mesure cette matière, mais aussi l'histoire, le français et les sciences de la vie et de la terre peuvent-elles contribuer à cet objectif ?
Par ailleurs, selon vous, l'école doit-elle être le vecteur des valeurs républicaines ? En filigrane, cela pose la question du rôle des parents. Comment donner aux enseignants et à l'école les moyens de mieux former des citoyens ?
Enfin, plus généralement, en termes de préconisations, quelles seraient, selon vous, les mesures qui pourraient être mises en place pour lutter contre cette perte de valeurs et retrouver cet esprit républicain?
Ces trois questions n'en font en réalité qu'une. L'école doit-elle être le vecteur des valeurs républicaines ? Je le crois personnellement et, plus largement, il me semble que l'école constitue ce que par quoi se fonde toute cité, toute chose publique, toute République. Il n'y pas de République sans école, il n'y a pas de politique sans école. Aristote, dans Les Politiques, affirme que le propre du citoyen est de parler avec les autres. Le propre de la cité consiste à parler ensemble de ce qui est bon et de ce qui est juste, d'entretenir un dialogue commun, un débat. Pour cela, encore faut-il savoir parler et parler la même langue. Il n'y a pas de politique dès lors qu'il n'y a pas de possibilité de parler ensemble avec la même langue, avec des mots permettant de raisonner communément. L'école peut former les citoyens de demain en leur transmettant cette langue commune, non seulement au sens de la capacité de parler, de la capacité à maîtriser un vocabulaire - ce qui serait déjà un grand pas en avant - mais au sens de la capacité à parler ensemble, avec un fond culturel commun, de ce qui est bon et de ce qui est juste. Selon Alain-Gérard Slama, lorsque l'on n'a plus les mots, il ne reste que la violence. Cela est vrai dans notre expérience personnelle, au sens psychique et psychologique, mais c'est vrai aussi dans notre expérience collective. Lorsque nous n'avons plus les mots pour parler ensemble, alors nous sommes tentés de régler nos différends par la violence. Lorsqu'il n'y a plus de dialogue commun, lorsqu'il n'y a plus de possibilité même d'un dialogue parce qu'il n'y a plus de langue commune, alors naît la violence, qui remplace la République. C'est quand la République se défait, quand la société se dissout, que la violence semble se rappeler à nous. De ce point de vue, il est étonnant que nous nous en étonnions... Alors que l'on a condamné la transmission de la culture, il n'est pas étonnant que « l'autre de la culture » surgisse, c'est-à-dire la barbarie. Comme vous le savez, la barbarie désigne dans son étymologie grecque « barbaros » ces sons inarticulés sortant de la bouche de celui qui n'a pas reçu la langue commune. La barbarie, c'est ce cri inarticulé qui jaillit d'une génération ou d'une partie d'une génération à qui nous n'avons pas transmis les mots pour participer à la vie citoyenne.
J'ai eu la chance, lorsque j'étais titulaire sur zone de remplacement - comme la plupart des jeunes enseignants - de découvrir un grand nombre d'établissements. J'y ai rencontré des élèves passionnants avec, comme tous les jeunes de notre temps, une grande générosité, une grande intelligence, une créativité extraordinaire. Mais j'ai rencontré aussi, cela est notamment le cas dans les zones les plus défavorisées, des jeunes à qui on n'avait pas transmis les moyens d'exprimer en actes cette créativité, cette générosité, ce désir de se donner, de participer de manière « productive et active », selon les mots de l'enquête PISA, à la vie de la société, à la vie de la cité de demain. Il y a, de ce point de vue, une grande inquiétude à avoir. Nous devons nous sentir responsables de ces jeunes qui n'ont pas reçu la capacité de parler, d'articuler un raisonnement, qu'ils aient ou non quitté le système scolaire avant la fin de leur parcours. Or, ces conditions sont fondamentales pour participer à la vie de la cité, pour comprendre les enjeux d'une élection, la possibilité de la participation citoyenne, pour prendre part, en tant qu'électeur ou en tant qu'élu, à la vie de la cité.
L'école doit être le vecteur des valeurs républicaines, je dirais même que l'école est ce par quoi se prépare toute République et qu'il n'y a pas de République sans école. Ceci ne peut fonctionner si l'école se trouve mise au service d'une éducation qui se passerait de l'instruction. C'est un paradoxe qui ne cesse de m'étonner. On a le sentiment, pardonnez-moi ce propos irrévérencieux, que les responsables politiques, qui produisent les directives, n'ont plus ou pas l'occasion d'être en contact avec des jeunes, des enfants, des adolescents, des élèves. L'idée que l'on pourrait transmettre des valeurs qui s'imposeraient d'elles-mêmes est une fiction. Les enseignants le savent très bien dans la mesure où ils encouragent, par ailleurs, l'esprit critique chez leurs élèves. Aucune valeur ne s'impose d'elle-même. Imposer à ses élèves le fait de refuser tel ou tel comportement, d'adopter telle ou telle pratique est impossible. Pourquoi faudrait-il être tolérant plutôt qu'intolérant ? Pourquoi faudrait-il être respectueux plutôt qu'irrespectueux ? Pourquoi faudrait-il être paisible plutôt que violent ?
Je prendrai un exemple qui m'a marqué personnellement dans mon itinéraire d'enseignant : le sexisme. Il est souvent affirmé que l'école doit lutter contre le sexisme, que cela fait partie de ses missions fondamentales. Comme tout enseignant, j'ai lu avec attention le document de quatre pages sur les missions de l'école adressé par Vincent Peillon aux enseignants au début du présent quinquennat. Il est d'ailleurs paradoxal de demander aux enseignants de faire tout ce que la société ne parvient plus à faire. Y figurait la lutte contre le sexisme. Je suis convaincu que cet objectif n'est ni superflu ni irréaliste et doit constituer une priorité, ayant eu l'occasion de constater dans de nombreux établissements, notamment situés dans des zones défavorisées, que le sexisme est une réalité. Les comportements, le vocabulaire et les attitudes des garçons vis-à-vis des filles sont parfois extraordinairement condescendants et violents et de nombreuses jeunes filles en souffrent. Il suffit d'ailleurs de s'intéresser à certaines productions de ce que l'on appelle les « cultures urbaines » pour constater que l'image de la femme y est souvent dégradée, maltraitée. Dans notre espace public même, nous devons reconnaître qu'à travers la publicité, le sexisme et la dévalorisation de la femme sont souvent une réalité.
Comment l'école peut-elle lutter contre le sexisme ? La solution qui nous est proposée me semble irréaliste et absurde. Nous organisons des ateliers pédagogiques, éducatifs, ludiques contre le sexisme ou des cours de morale laïque dans lesquels nous expliquons que le sexisme est contraire à nos valeurs. Or, cela ne s'impose pas d'emblée. Les adolescents nous regardent avec une forme de distance ironique lorsque nous prétendons les réunir dans les cours de récréation pour pousser un cri contre le sexisme ou bien, en tentant de « singer » ces cultures qui leur sont familières, quand nous organisons des productions culturelles, souvent de mauvaise qualité, qui ont pour finalité de montrer, à travers une morale quelque peu poussive, que le sexisme doit être combattu. Cela ne fonctionne évidemment pas.
Pour lutter contre le sexisme, les élèves doivent entendre parler, par exemple, de la figure de Jeanne d'Arc, lire quelques pages de son procès. Quelle que soit leur religion, il ne leur serait alors plus possible de considérer que les femmes sont inférieures aux hommes. L'histoire de Jeanne d'Arc est en effet la démonstration, la preuve et l'expérience, à travers la capacité qu'une jeune femme de 19 ans à humilier une assemblée d'hommes plus savants et doctes qu'elle, de l'égalité absolue entre les femmes et les hommes. En physique, il conviendrait par exemple de souligner ce que Marie Curie a pu apporter à la connaissance de cette discipline. On ne pourrait alors plus penser que les femmes sont moins intelligentes que les hommes. Si, par miracle, nos élèves avaient l'occasion de temps en temps de réapprendre par coeur un peu de notre poésie française, lire des oeuvres de Ronsard, Verlaine, Musset, Chénier, comment pourraient-ils encore mal parler à une jeune fille ou la maltraiter ?
Nous devons cependant nous garder d'idolâtrer la culture. L'homme le plus cultivé du monde peut être lâche et violent. Le peuple le plus cultivé du monde peut être barbare, de la manière la plus atroce qui soit. La culture n'empêche pas l'homme d'être inhumain, mais l'inculture empêche assurément les hommes d'être complètement humains. C'est ce qui se produit dans l'effondrement du vocabulaire commun, de la culture commune, dans la barbarie qui consiste en permanence à rabaisser les jeunes filles, à ne se rapporter à l'autre que sous la forme d'une violence absurde, déraisonnée, gratuite. Cette violence, nous la guérirons, non pas en organisant des ateliers contre le sexisme, mais simplement en recentrant l'école sur sa mission fondamentale : transmettre le meilleur de notre culture, transmettre le savoir.
En réhabilitant la pratique du par coeur, que nous avons bannie de notre école, la culture, l'effort de la mémoire, consistant à absorber et à se laisser transformer par le coeur, par les textes que l'on reçoit, cette pratique simple, qui est la mission fondamentale de l'école, transmettre un savoir, permettre à chaque enfant de participer par la mémoire à une culture qui nous est commune, nous avons de quoi lutter contre le sexisme et toutes les dérives que nous voyons surgir aujourd'hui. Cet exemple souligne combien l'école peut servir ce que nous appelons les valeurs de la République, qui constituent en réalité les éléments d'une morale commune, d'une approche commune de ce qu'il est humain de faire. Voilà, me semble-t-il, comment l'école pourrait contribuer à humaniser les hommes et à humaniser les enfants qui nous sont confiés.

Tout d'abord, bravo pour la fluidité de votre verbe.
Cela fait longtemps que j'ai cessé de m'étonner, en revanche je m'irrite de plus en plus. En effet, je me rends compte, pardonnez-moi d'utiliser la terminologie médicale, que le diagnostic est posé depuis longtemps, que le remède est connu, mais que la posologie fait défaut. La lecture du procès de Jeanne d'Arc est certes très édifiante, mais encore faut-il savoir lire. Le problème est donc bien celui-ci : il s'agit de revenir à la base, qui consiste à permettre à l'ensemble des jeunes de maîtriser ces fondamentaux. Je souhaiterais vous entendre sur ce point.

J'ai été ravi d'entendre les propos de M. Bellamy à la fois réalistes, rafraichissants, passionnés et, au final, malgré un constat que nous connaissons tous, plein d'optimisme. Je suis d'accord avec vous lorsque vous affirmez que l'école peut éduquer dès lors qu'elle sait instruire. Cela ne devrait-il pas constituer les « tables de la loi » des nouvelles ÉSPÉ ?

Vous partagez en tout l'opinion de Benoît Pellistrandi qu'il a exposée dans plusieurs tribunes, notamment du Monde et du Figaro. Il y regrettait que la transmission soit délaissée au profit du traitement des inégalités sociales à travers la création des ateliers que vous mentionnez. Selon lui, il est donc nécessaire de réhabiliter la transmission des savoirs. Je suis heureuse que deux enseignants tiennent le même langage. Par ailleurs, je m'associe à la question de Guy-Dominique Kennel.
Je vous remercie pour ces observations et ces questions.
Nous devrions reprendre conscience de la nécessité d'éduquer par l'instruction. Pour moi, le diagnostic n'est pas partagé par ceux qui sont en charge de structurer la pédagogie scolaire et de former les enseignants. Comme jeune enseignant, et à l'instar de mes collègues, quelles que soient leur sensibilité et leur origine, j'ai été marqué par ma formation. Je reçois d'ailleurs de nombreux courriers de collègues en activité ou en retraite qui vont en ce sens. Nos formateurs sont convaincus que l'école n'a pas été suffisamment réformée et que la transmission n'a pas été suffisamment déconstruite, ce qui explique la persistance des inégalités.
Prenons l'exemple de la polémique qui a suivi la suppression de l'épreuve de culture générale au concours d'entrée de Sciences-Po Paris au simple motif que la culture est discriminatoire. Pour ses partisans, il faut retirer la culture des épreuves de sélection pour ne pas reproduire ces discriminations. Je me souviens que le ministère de l'enseignement supérieur avait publié un communiqué de presse indiquant qu'il fallait entreprendre une réflexion sur la place de la culture générale dans les concours de recrutement des écoles de la fonction publique au motif que la culture serait l'occasion d'une sélection discriminatoire. Le diagnostic n'est donc pas partagé.
Pourtant, la culture est nécessaire pour l'égalité réelle. L'égalité ne se construit pas en défaisant la culture. Priver les élèves de la culture, c'est privilégier ceux qui y ont déjà accès et empêcher les autres d'accéder aux responsabilités. Il faut rappeler que c'est par le savoir que les enseignants peuvent assurer l'égalité. Le plus douloureux pour un enseignant est la suspicion qui pèse sur son travail ; les enseignants sont culpabilisés. J'ai souvenir des propos d'un formateur qui disait que nous étions les tenants d'un système « militaro-hospitalo-carcéral » - je cite son expression - et qu'en notant les élèves, nous étions les kapos d'un système ultralibéral pour préparer les masses laborieuses, prolétariat résigné parmi lequel les multinationales iront se servir. Nous ne pouvons comprendre la crise de l'éducation nationale qu'en réalisant que le système connaît une dépression collective aboutissant à une perte de sens de l'enseignement. Le savoir est présenté comme un fardeau pesant et gênant pour les élèves : si c'est un « bagage culturel », il peut donc être lourd ! La culture n'est pas de l'ordre de l'acquis mais est la condition de toute liberté, par la rencontre avec de grands auteurs qui font autorité. Lorsque l'autorité des enseignants s'effondre, les élèves n'en sont pas plus libres pour autant mais, au contraire, soumis à l'oppression des discours simplistes, aux idéologies qui les prennent, particulièrement sur Internet, en otage.
Les enseignants ont soif d'un discours politique qui redonne du sens à leur métier. Or, nous entendons la ministre de l'éducation nationale dire que l'évaluation sans note serait la seule évaluation bienveillante, ce qui signifie implicitement que noter nos élèves est malveillant. C'est une réflexion politique et non une remarque partisane, car le communiqué de presse que j'évoquais à l'instant et qui accusait les enseignants de perpétuer des discriminations provenait d'un ministre d'une autre majorité. La culpabilité infondée des enseignants est entretenue par le discours commun, notamment du monde politique dans son ensemble.
Monsieur le rapporteur, vous avez travaillé sur les questions du socle commun de connaissance. Vous rappeliez les résistances dans les classes sur la transmission des savoirs dont nous faisons parfois l'expérience. Elles sont exagérées à mon sens. Le problème n'est pas de construire l'école autour de l'élève mais de l'avoir construite à hauteur d'enfant. Plus exactement à la hauteur de ce que nous pensons être ses capacités à un moment donné, de ce qui constituera une satisfaction immédiate et instantanée pour lui. A ainsi été banni ce qui constituerait une rencontre par un intermédiaire en vue d'un progrès, que ce soit l'apprentissage par coeur, la lecture continue, le cours magistral, etc. On pense qu'une école moins difficile serait plus plaisante pour les élèves. Or, c'est catastrophique pour les élèves qui attendent justement ce qui les dépasse.
D'après mon expérience, en suivant les instructions données - organiser des débats, des ateliers participatifs, demander aux élèves de produire leur propre savoir, etc. -, on provoque l'école de l'ennui. Un élève ne vient pas à l'école pour donner son avis ; sinon pourquoi viendrait-il car il l'a déjà ? En classe de philosophie, cela ne présente aucune utilité pour un élève de venir donner son avis sur le bonheur ; il vient plutôt rencontrer les auteurs qui font autorité. Un élève vient en classe d'abord pour écouter et recevoir avant de participer. La participation ne vient que dans un second temps : nous ne sommes pas immédiatement capables de créativité. Il faut beaucoup recevoir pour pouvoir accomplir ce dont on est capable. C'est le pari de l'éducation de regarder un élève, non pas comme il est à l'instant donné, mais comme capable de choses qu'il ne maîtrise pas encore.
Entrer en classe avec le discours que vous avez quelque chose à transmettre aux élèves, c'est s'exposer à des résistances. Au contraire, avec le temps, les élèves deviennent attentifs, surtout dans les écoles défavorisées, parce qu'ils ont conscience de manquer de tout. Ainsi un collègue d'histoire, matière jugée difficile à enseigner, qui aime l'histoire de France et qui considère que chaque élève a droit de connaître l'histoire d'un pays dans lequel il grandit, rencontre-t-il l'attention et l'envie d'apprendre des élèves.
Je ne nie pas les difficultés pédagogiques. Alain écrivait que la pédagogie est la science des professeurs chahutés. J'ai moi-même été chahuté dans mes cours mais, par-delà la résistance, il y a la volonté d'être élevé.
Une phrase de Gustave Thibon m'a souvent guidé dans ma tâche d'éducateur : « celui qui ne me donne rien est celui qui ne me donne pas l'occasion de me donner ». Or l'école offre peu l'occasion de se dépasser. L'éducation est présentée par Pierre Bourdieu comme une violence, la transmission comme une coercition, la notation comme une brutalité. Pourtant, quand les élèves font du sport, ils ne décident pas de s'abstenir de compter les points au prétexte que ce serait violent pour les perdants ! De façon monstrueuse et atroce, Daesh propose aux jeunes qui s'engagent une occasion de se donner, de se sacrifier, ce qui les attire. L'école ne demande plus d'efforts, elle ne veut ni déranger, ni bousculer les élèves qui restent dans leur cocon. On pense se concilier leur amitié.
Sans être optimiste, je garde de l'espérance car j'ai vu des élèves de culture et d'origine différentes avoir soif de savoir et de culture.
J'ai confiance en la commission d'enquête pour se pencher sur cette question dans l'espoir d'un sursaut national à la suite des évènements de janvier.

Nous recevons Mme Gabrielle Deramaux, professeure de lettres et auteur d'un ouvrage au titre décapant sur son expérience d'enseignante Collège inique (ta mère !).
Titulaire d'une licence de philosophie et d'une maîtrise de lettres modernes, vous avez été admise au concours du CAPES de lettres modernes en 1998. Vous êtes, depuis cette date, professeure de français dans des collèges et lycées de région parisienne. Dans votre livre, vous racontez le quotidien d'une jeune enseignante en établissements difficiles, dans l'académie de Créteil tout d'abord, puis à Paris. Vous y regrettez l'absence de soutien de la part de l'institution et le manque de formation des enseignants.
La commission d'enquête a souhaité vous entendre, afin que vous puissiez nous faire part de ces réalités que vous vivez sur le terrain. Les événements de janvier 2015 s'inscrivent-ils, selon vous, dans une tendance de fond traduisant une perte de repères ? Si c'est le cas, quelles sont les causes de cette dérive et quelles mesures pourraient être prises pour l'enrayer ?
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, Mme Gabrielle Déramaux prête serment.
En septembre 2001, nous avions dû faire respecter dans nos classes trois minutes de silence pour les victimes des attentats du World Trade Center. Mes élèves ont entonné des chants palestiniens. Jeune professeure, interdite devant leur réaction, je les ai laissés chanter. Personne à l'époque n'a parlé de ces incidents. Et pourtant, ils furent aussi nombreux. Nous, personnels de l'éducation nationale, avions pressenti que rien ne serait plus pareil. Déjà agitée par les soubresauts du conflit israélo-palestinien, l'école subirait les répliques des violents conflits à venir.
Aujourd'hui on nous demande de mettre l'accent sur les grands principes de la République, la laïcité en particulier. C'est un combat que nous menons déjà tous les jours. Nous sommes en première ligne pour expliquer et réexpliquer inlassablement la place de l'école et celle de la religion, la séparation du temporel et du spirituel, l'étanchéité entre la sphère publique et la sphère privée. La loi de 1905, qui nous semble si naturelle, ne l'est pas pour bon nombre d'élèves, dont certains viennent de pays où la religion est présente partout car religion d'État. Nous devons en premier lieu expliquer que si nous respectons, en tant que citoyens, les lois de la République, c'est parce que nous les avons choisies et votées, parce qu'elles nous protègent, non parce qu'elles nous contraignent ou que nous craignons de quelconques représailles. Nous respectons la loi parce que nous l'avons validée et non parce que nous la subissons.
Pour faire comprendre aux élèves d'aujourd'hui l'esprit de la loi de 1905, nous avons à rappeler les grands massacres des guerres de religion qui opposèrent protestants et catholiques en France, le « plus jamais ça » garanti par une invention unique dans l'humanité, la laïcité, qui, loin d'interdire toute religion comme le pensent beaucoup d'élèves, permet à chacun d'être respecté dans ses croyances, dans sa foi comme dans son athéisme, quelle que soit son origine ou sa couleur de peau. La laïcité crée un espace protégé et commun, propice notamment à la sérénité nécessaire à l'étude et à l'instruction. C'est peu de dire qu'elle nous est plus que jamais indispensable à l'école en 2015.
Les professeurs de l'école publique enseignent depuis longtemps le fait religieux. Les programmes de français et d'histoire suivent la même progression : en sixième l'Antiquité, en cinquième le Moyen Âge, en quatrième les XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, en troisième les XXe et XXIe siècles. Lorsqu'en sixième, le programme nous demande d'étudier la Bible, nous adaptons évidemment cet enseignement à notre public scolaire et proposons une lecture comparée avec le Coran, privilégiant les points de rencontre des trois grandes traditions monothéistes, comme par exemple la figure du patriarche Abraham, ou l'étude comparée du jardin d'Éden hébraïque et coranique. De même en cinquième, la Chanson de Roland ou les épopées des croisades sont l'occasion de mettre en lumière les échanges entre la civilisation occidentale et le monde arabo-musulman. Il s'agit de mettre l'accent sur les rencontres fructueuses pour la médecine, l'architecture, les sciences, les arts et les lettres, plutôt que sur les confrontations guerrières, de poser la religion comme objet d'étude, s'instruire, discuter, débattre en apprenant à mettre de côté son histoire personnelle, ses croyances, ses traditions qui, tout aussi fortes et respectables qu'elles soient, n'ont pas leur place dans l'enceinte protégée de l'école laïque. Il nous faut lutter sans cesse contre les tentatives de confiscation du discours sur la religion et nous montrer particulièrement fermes sur le principe que la religion est un objet d'étude au même titre que la biologie ou la peinture. Dans une époque très empreinte de spiritualité, où les élèves parlent volontiers de religion, parce qu'elle fait partie de leurs pratiques quotidiennes, familiales, il est primordial de rappeler que l'école a le droit de parler de religion, de la comparer, de la critiquer, tout en garantissant à chacun le respect absolu de ses convictions personnelles.
L'autre écueil auquel est confrontée l'école d'aujourd'hui est la pensée complotiste qui rend suspecte toute parole présentée comme « officielle » : on nous ment, tout est faux, tout est falsifié ; il faut se méfier des journalistes, des politiques, des professeurs ; l'instruction dispensée à l'école est de la propagande, etc. Ce prisme pervers rend suspecte et contestable la parole du professeur. C'est au nom de ce grand complot imaginaire que fut contestée la véracité les attentats de 2015 : une sordide mise en scène orchestrée par les services secrets français pour salir l'islam, soi-disant. Tout peut être alors remis en question : le génocide arménien, la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, la décolonisation, le calvaire d'Ilan Halimi, la culpabilité de Merah, comme les bases mêmes de notre pensée, la théorie de l'évolution ou la révolution copernicienne.
Ce qui rend nos élèves perméables à ces divagations toxiques est avant tout l'appauvrissement dramatique de leur vocabulaire et donc de leur faculté à penser et exprimer le monde. Imaginez que pour beaucoup d'élèves des mots d'usage courant comme pâle ou pénombre ne sont pas compréhensibles. Même dans les bons établissements, une grande partie des élèves ne comprend que superficiellement les textes lus ou étudiés. Ils donnent le change car ils comprennent globalement mais ils n'ont pas accès à une compréhension fine d'une réalité de plus en en plus complexe. Ils sont des proies faciles pour n'importe quel manipulateur qui saura leur montrer une vision du monde simpliste, qui leur paraîtra plus lisible et donc plus crédible. L'école est le dernier creuset où se rencontrent les citoyens de demain, le seul endroit où s'écrit le roman national. Or nous avons de moins en moins de temps et de moyens pour les aider à écrire ensemble une histoire faite de paix et d'enrichissements réciproques. Jamais l'inégalité n'a été si criante entre de bons élèves toujours plus stimulés et cultivés et des élèves laissés au bord du chemin, sans bagages, sans espoir, cibles toutes désignées des bonimenteurs de tout poil.
Nous sommes particulièrement inquiets du projet de réforme annoncé, qui prévoit, entre autres, l'apprentissage d'une deuxième langue vivante dès la cinquième. Comment imaginer que ce dispositif ne creuse pas encore plus les différences, déjà insupportables entre des élèves culturellement favorisés, qui absorberont sans peine ce surcroît de travail, et nos élèves moins privilégiés, pour qui cette deuxième langue vivante en sera en réalité une troisième, puisqu'ils parlent à la maison leur langue maternelle et ont déjà à apprendre le français, ainsi qu'une autre langue à l'entrée en sixième ?
L'autre victime collatérale de ce projet sera l'enseignement du latin et du grec que plus aucun élève ne choisira désormais et qui offre pourtant l'occasion unique de jeter des ponts entre le Nord et le Sud, de part et d'autre de la Méditerranée, berceau de notre civilisation, ce vaste Empire dont nos ancêtres étaient citoyens et dont nous sommes tous aujourd'hui les héritiers. Cette réforme va à l'encontre des besoins urgents constatés sur le terrain. Nos élèves ont besoin de se sentir inscrits dans une histoire commune et de plus d'heures consacrées aux savoirs fondamentaux : savoir lire, écrire et compter pour comprendre le monde complexe qui est le nôtre et pour en devenir des citoyens armés pour les grands défis qui s'annoncent, ensemble.

Merci pour votre témoignage, tableau très réaliste de votre expérience vécue, et que l'on n'entend pas toujours de la part d'autres acteurs, plus éloignés de la pratique.
En utilisant, par jeu de mots, l'expression « collège inique », entendiez-vous remettre en cause le collège unique ? On veut éviter le redoublement, les notes, comme dans d'autres pays, où il existe cependant des voies d'orientation alternatives.
Vous décrivez dans votre livre la vie d'une enseignante au sein d'un établissement dit difficile, comment se manifeste au quotidien cette perte de repères républicains ?
Vous dénoncez l'absence de soutien hiérarchique, voire la culpabilisation des enseignants face à certains comportements d'élèves. Avez-vous constaté une évolution de ce point de vue ? Quelles mesures préconiseriez-vous pour lutter contre cette perte de valeurs ?
Je ne suis pas favorable à remettre en cause le collège unique qui réunit tous les élèves, de tous les milieux, au moins jusqu'au lycée. Je regrette toutefois que l'enseignement professionnel soit encore vu comme une voie de garage, alors que dans ce domaine des établissements de haute qualité offrent un avenir plus brillant que celui qui attend les étudiants sortant sans diplôme de l'université. Les choses commencent à bouger, mais lentement. Il faut continuer à travailler dans ce sens, donner envie aux élèves d'acquérir un métier, un savoir-faire, une place dans la société. Le collège unique, oui ! Toutefois, avec 32 élèves par classe, il est très difficile d'assurer un suivi personnalisé et ce sont les mêmes élèves qui en font les frais.
On parle de valeurs républicaines. Les deux piliers que l'école doit transmettre sont la laïcité, que j'ai évoquée, et la méritocratie. Ma génération a pu en profiter, avec l'espoir de pouvoir s'élever grâce à l'école, quelle que soit son origine, sa couleur de peau. Aujourd'hui, cela n'est plus possible, l'ascenseur social est en panne. L'école n'est pas l'endroit qui permet de faire carrière et les élèves en ont parfaitement conscience. Dans certains quartiers, le seul espoir de nos élèves réside soit dans une radicalisation religieuse qui leur assigne une place dans la société, soit dans le trafic de drogues qui n'est qu'un moyen de gagner sa vie. Il faut vivre cette situation avant de critiquer le travail des enseignants ! Lorsque l'on est abandonné, on n'a pas le choix d'une voie plus noble.
La méritocratie aussi est en panne à l'école car, quels que soient leurs résultats, les élèves savent qu'ils passeront en classe supérieure. Certains posent d'ailleurs tellement de problèmes que personne n'a envie de les garder au collège, et eux-mêmes ne le souhaitent pas. On voit dans toutes les classes, même dans les établissements de centre-ville, des élèves fantômes, qui assistent à des cours auxquels ils ne comprennent pas un traître mot. Ils sont gentils et calmes les deux premières années, beaucoup plus agités et moins calmes les deux dernières années. Il faut se mettre à leur place... Quelles perspectives leur offre-t-on ? 150 000 élèves sortent du système scolaire sans qualification. La plupart sortent moins savants du collège qu'ils n'y sont entrés, ces années d'abêtissement leur causent un dommage terrible.
Le soutien hiérarchique dépend des établissements. Je n'ai pas de poste fixe et j'exerce dans trois établissements. Ce dont nous manquons le plus, c'est de surveillants. Il est certes possible d'imposer sa loi dans une classe de trente élèves avec de l'expérience et de l'autorité, mais il est illusoire de croire que cette autorité s'étend dans les couloirs, la cour de récréation ou les toilettes, où presqu'aucun adulte ne surveille les jeunes. Il s'y passe des choses terribles, même dans les établissements considérés comme tranquilles, sans que nous puissions y mettre de l'ordre...
Trafic de drogue, prostitution, bagarres, jeu consistant à infliger une grande claque aux élèves rangés dans les couloirs en attendant leur cours, gestes de violence quotidienne, physique et verbale, car les élèves s'aboient souvent les uns sur les autres plus qu'ils ne se parlent. Si nous pouvons faire régner une certaine politesse en classe, les couloirs deviennent des zones de non-droit.
Je n'ai pas de remède à proposer pour favoriser l'enseignement des valeurs. Je ne peux que constater que nous avons besoin d'aide. Il y a le feu à tous les étages. Nous n'avons pas tant besoin de moyens supplémentaires que d'une direction claire et non changeante, car nous travaillons dans la durée. L'école doit cesser d'être le laboratoire fou d'expériences pédagogiques qui bouleversent tous les trois ans tout ce que nous venons de mettre en place et nous coûtent beaucoup de temps en réunions ou paperasse. Nous sommes plus utiles dans nos classes que dans une salle de réunion à discuter de notes, couleurs, compétences, dans un jargon dont on ne sait que faire et qui ne répond pas à nos attentes !

Vous avez exprimé votre avis sur l'enseignement d'une seconde langue en cinquième. J'ai enseigné le français jadis. Il est fondamental que notre langue soit bien comprise et bien maîtrisée. Mais dans certains collèges où les élèves n'ont pas pour langue maternelle le français, ne serait-il pas utile d'enseigner dans leur langue d'origine ? Des expériences ont été menées en Suède avec parfois de bons résultats. Il ne s'agit pas de ne pas apprendre le français, mais comment des élèves qui maîtrisent mal à la fois leur langue maternelle et notre langue pourront-ils communiquer dans de bonnes conditions avec l'extérieur ? Est-il judicieux pour eux de retarder l'apprentissage d'une seconde langue, qui serait leur langue maternelle ? Je pense en particulier à l'arabe. Des expériences ont-elles été menées, pour enseigner l'arabe comme première langue vivante après le français ?

Merci de nous avoir éclairés sur la réalité que vivent les enseignants, à qui nous devons respect et gratitude, eu égard à leur mission. Il faut en effet plus d'heures pour l'apprentissage des fondamentaux. Mais n'y a-t-il pas aussi un problème de pédagogie - hors de la doxa de la rue de Grenelle, point de salut ? Chacun connaît l'importance de « l'effet maître ». Des études, comme celle de M. Zorman, montrent que les résultats varient fortement en fonction de la pédagogie.
Monsieur Legendre, des expériences ont été menées sur l'apprentissage de la langue maternelle comme première langue vivante. Plusieurs difficultés sont apparues : la difficulté de recruter des professeurs d'arabe...
mais aussi un risque de repli communautaire. De plus, bon nombre d'élèves de confession musulmane, dont l'arabe n'est pas la langue d'origine, prennent des cours d'arabe le soir, parfois dispensés dans des écoles coraniques. Des élèves nous disent qu'ils n'ont pu faire leurs devoirs à cause du travail que représentent ces « cours du soir » et on observe que parfois, cet enseignement complémentaire consiste au mieux en une longue litanie de récitations, au pire, en des conseils pour semer la zizanie à l'école. Ces cours du soir, parfois subventionnés par l'État, via des associations, mériteraient d'être contrôlés.
Les professeurs ont la liberté de choisir la pédagogie, en lien avec les inspecteurs et leurs collègues. Le choix de la pédagogie importe moins que le nombre d'heures de cours. Il y a quelques années ont été mis en place des IDD (itinéraires de découverte), parcours croisés entre plusieurs disciplines, et les professeurs de lettres ont cédé trois heures d'enseignement pour ces projets. Depuis les IDD ont été supprimés, mais on ne nous a pas rendu nos heures de cours. Aujourd'hui, on parle de retirer les heures de soutien. Nous sommes inquiets.

Pensez-vous qu'augmenter la présence des enseignants dans les établissements permettra de diminuer la violence ? L'enseignant peut-il jouer un rôle en dehors de sa salle de classe ?
Absolument. Mais il ne faut pas croire que l'enseignant arrive cinq minutes avant son cours et repart aussitôt... Nous passons beaucoup de temps dans les établissements, sans doute beaucoup plus que nos anciens. Évidemment, le rôle du professeur ne s'arrête pas à la porte de sa classe, et nous ne laissons pas faire, mais il est très difficile de reprendre un élève que l'on ne connaît pas dans les couloirs. On s'expose à beaucoup d'insolence ou de violence. Les élèves n'admettent pas facilement qu'un professeur qu'ils ne connaissent pas le rappelle à l'ordre hors de la classe. Nous intervenons autant que possible, mais je n'ai reçu aucune formation pour gérer des adolescents et n'ai pas la compétence des surveillants.

Certains surveillants n'ont pas de formation, d'autres ont été formés. En tant que professeure et mère, vous regardez avec les deux casquettes le cursus scolaire. Quel est votre sentiment sur la vocation de l'école, l'articulation entre l'éducation et l'enseignement, l'enseignement de la morale, de la laïcité, des valeurs, la finalité de l'école ?
Lorsque j'ai commencé à enseigner, je n'étais pas encore mère de trois enfants et j'étais sans doute beaucoup plus exigeante avec mes élèves que je ne le suis maintenant. Mais je suis devenue plus exigeante en matière d'éducation et de politesse. Le professeur n'est pas un meuble, devant lequel on passe sans le saluer en entrant en classe, alors que nous nous efforçons d'appeler tous nos élèves par nos prénoms. Il est normal d'exiger qu'ils nous appellent « monsieur » ou « madame », ou de refuser qu'ils remettent bruyamment leur manteau et leur capuche quand la sonnerie approche. En retour le professeur doit être exemplaire, poli, ponctuel, courtois. Les élèves ont du respect pour des enseignants professionnellement irréprochables et sûrs d'eux. Sous ces conditions on peut instaurer un respect de l'adulte, sans cors ni trompettes. De nouveau, d'ailleurs, les professeurs vouvoient de plus en plus leurs élèves et ne commencent pas leur cours tant qu'ils n'ont pas autorisé leurs élèves à s'asseoir.

Plusieurs personnes préconisent l'instruction, la découverte des grandes oeuvres, l'amélioration du niveau culturel. Quelles sont les difficultés des professeurs à cet égard ? Vous avez évoqué les ricanements ou les propos déplacés lorsqu'on aborde la Shoah par exemple. Les enseignants n'ont-ils pas la tentation d'éviter les sujets épineux, ce qui aboutit à une déculturation des élèves ?

Si les élèves en collège maîtrisaient bien le français, votre métier serait-il différent ? Quelles seraient, en outre, vos suggestions pour améliorer le système ?
Les professeurs de lettres, d'histoire, mais aussi de sport ou de SVT (sciences de la vie et de la terre) sont les plus exposés et peuvent évidemment avoir la tentation d'éviter certains sujets. Partout ils entendent les mêmes récriminations : « Pourquoi n'adopte-t-on pas le calendrier de l'hégire ? Pourquoi les garçons et les filles ne sont-ils pas séparés en sport ? Pourquoi parle-t-on toujours des Juifs ? » etc. Certains professeurs se retrouvent en grande détresse, isolés face à des situations difficiles. Pourtant, il faut affronter ces grandes questions et donner son avis, à la fois en tant que professeur et être humain, pour montrer que la souffrance et la guerre n'ont épargné aucun peuple au cours de l'histoire, qu'il n'y a pas lieu de comparer, d'opposer ou de hiérarchiser les souffrances entre elles. Enseigner l'universalité du mal apporte beaucoup d'apaisement aux élèves. Essayons de tirer les leçons des périodes historiques difficiles pour mieux vivre aujourd'hui, proposer une espérance. Il faut montrer que la France a toujours accueilli la diversité, de grands hommes et de grandes femmes qui ont connu la souffrance et qui sont devenus des citoyens.
Ma génération arrivait au collège avec des bases solides. Nos élèves aujourd'hui ignorent à peu près tout en grammaire et en orthographe. Ce n'est pourtant pas parce que cet enseignement a été négligé en primaire. Au contraire, il est très approfondi ! Mais on ne sait où passe cet enseignement, les acquis disparaissent, sans que je sache pourquoi, et chaque année nous devons réapprendre le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect, etc. J'aimerais consacrer plus de temps à la littérature qu'à expliquer inlassablement à des élèves de troisième l'accord du participe passé...
Mes recommandations seront modestes. Nous voudrions plus de considération, et pas seulement de la part de nos élèves qui nous respectent et qui nous aiment : des liens se tissent au cours de l'année et il est touchant d'éprouver cette gratitude lorsque l'on croise d'anciens élèves dans la rue. En revanche, nous avons l'impression d'être maltraités par notre hiérarchie, on nous considère comme des pions, susceptibles d'être déplacés ici ou là. Je passe énormément de temps dans les transports, partagée entre trois établissement, sans espoir d'obtenir prochainement un poste fixe, alors que j'enseigne depuis quinze ans... C'est très décourageant. Le chemin que l'on nous propose est obscur.

Mille mercis pour votre témoignage, si vrai ! Si vous n'aviez « que » 20 élèves par classe, serait-ce pour vous une amélioration ?

150 000 jeunes sortent du système scolaire sans qualification, ce qui coûte 36 milliards d'euros à la collectivité. Or, un sur deux a redoublé ou rencontré des difficultés en primaire, ce qui montre la nécessité de maîtriser les fondamentaux. N'est-ce pas là qu'il faut mettre les moyens ? Si les fondamentaux ne sont pas acquis tôt, la rue vient concurrencer l'école, et finit par l'emporter !
J'ai enseigné dans des classes de 18 élèves, mais il manque l'esprit de classe et l'ambiance, paradoxalement, n'est pas propice à l'enseignement. Dans les zones d'éducation prioritaire (ZEP), les classes sont limitées en principe à 24 élèves, c'est très agréable. 32 élèves par classe, en collège, c'est beaucoup trop, à la différence du lycée, où les élèves sont plus calmes. Au collège Victor Duruy, on comptait cette année 39 élèves par classe, ce qui pose des difficultés insurmontables. Entre 24 et 26 élèves par classe, c'est l'optimum.
Je partage votre point de vue sur l'âge des apprentissages. L'enfant est particulièrement réceptif entre 5 et 7 ans. Ce qui n'est pas acquis pendant cette période, au CP et au CE1, est perdu. Un élève de cinquième qui n'a pas les fondamentaux aura bien plus de difficultés à les acquérir qu'un jeune enfant. Les causes individuelles de ces lacunes sont multiples : ruptures de la vie, déménagements, séparations, guerres, etc. Des enfants ayant connu la guerre civile en Côte d'Ivoire ont été placés dans nos classes sans sas de décompression, l'on croyait sans doute que l'école ferait des miracles... Mais je ne sais pas parler à un enfant soldat, lui expliquer qu'il ne faut pas taper sur son camarade parce qu'il lui a effleuré le coude... Je partage votre position : il faut mettre les moyens sur le primaire et soulager les instituteurs qui réalisent un travail exceptionnel.

Merci. Au fur et à mesure de l'avancée de nos travaux, certaines pistes reviennent : moins d'élèves en primaire, deux enseignants par classe... Nous sommes d'accord sur les bases : les fondamentaux et la politesse sont indispensables pour parvenir à enseigner les valeurs républicaines et de citoyenneté.

Nous recevons à présent M. Daniel Keller, Grand maître du Grand Orient de France. Cette audition sera diffusée en direct sur le site Internet du Sénat et son compte rendu sera publié.
Ancien élève de l'École normale supérieure, de l'Institut d'études politiques de Paris et de l'École nationale d'administration, vous êtes agrégé de lettres modernes. Après plusieurs postes au sein du ministère de l'économie et des finances, vous intégrez la direction du groupe Renault. Depuis 2010, vous êtes directeur général de Nord-Est Parisien-Car. Ce n'est pas tant à ces titres que nous avons souhaité vous entendre qu'en votre qualité de Grand maître du Grand Orient de France depuis 2013.
Cette obédience maçonnique, qui revendique près de 50 000 membres, affirme haut et fort son attachement aux valeurs républicaines : le triptyque républicain « Liberté, Égalité, Fraternité » est sa devise depuis 1848. Le Grand Orient de France attache une grande importance au principe de laïcité, qui est pour lui une valeur fondamentale. Il a ainsi présenté, le 9 décembre dernier, 25 propositions pour une République laïque au XXIe siècle, parmi lesquelles l'interdiction du port de signes et de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse à l'université, ou encore la mise en place d'un enseignement de la laïcité dans la formation des enseignants, du personnel éducatif et des chefs d'établissement.
Quel est votre avis sur l'état actuel de la transmission des valeurs républicaines, et d'abord de la laïcité, à l'école ? Comment transmettre et faire vivre ces valeurs au sein de nos établissements scolaires ?
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, M. Daniel Keller prête serment.
Merci de votre invitation. Je préside une obédience maçonnique de plus de 50 000 membres, parmi lesquels de nombreux enseignants et acteurs du monde éducatif et universitaire. Nous considérons l'école publique comme le pilier et le creuset de la République : c'est en effet à l'école qu'elle se construit et se perpétue. C'est là aussi que doit être mis en pratique le principe de laïcité. Pour de nombreux maçons, la laïcité est un principe d'organisation de la société et non une conviction qui s'opposerait à d'autres croyances. Ce principe se traduit par la séparation des Églises et de l'État, par une organisation des services publics imposant la neutralité confessionnelle à ses agents et, à l'école, à ses usagers. C'est en laissant les signes d'appartenance confessionnelle à la porte de l'école que nous la rendrons apte à transmettre des savoirs et à former des citoyens. Or, 15 % des élèves quittent l'enseignement primaire en ne sachant ni lire ni écrire : il est urgent d'agir, autrement que par des débats sur la réforme de la notation scolaire... Il est vrai qu'en tant que maçons nous déclarons tous ne savoir « ni lire ni écrire », mais c'est au sens symbolique...
Il est donc urgent de restaurer l'éthique républicaine de l'école publique. Bien entendu, nous n'avons pas d'arrière-pensées nostalgiques : il ne s'agit pas de comparer nos enseignants aux « hussards noirs de la République » d'il y a plus d'un siècle. Mais nous devons armer intellectuellement le corps enseignant en le formant aux enjeux de la laïcité et à son histoire, laquelle passe par de grandes lois qui structurent notre République, afin qu'il puisse les transmettre. La séparation du politique et du religieux, qui fonde la laïcité, est une spécificité française : le président des États-Unis prête serment sur la Bible et au Royaume-Uni, qui n'est pas une République, mais une démocratie où il fait bon vivre, le chef de l'État est aussi chef de l'Église. La laïcité nous est propre : elle résulte de notre Histoire depuis la Révolution et tout au long du XIXe siècle. Elle est davantage un contenant qu'un contenu. Il faut donc former les professeurs à enseigner ses enjeux, et à l'appliquer en milieu scolaire.
Le Grand Orient de France a pris position contre le port du voile à l'université. Certes, les étudiants sont majeurs et les universités doivent continuer s'administrer librement. Mais l'interdiction du voile s'applique déjà, dans les lycées, aux élèves des classes préparatoires, qui relèvent de l'enseignement supérieur, et aux élèves majeurs de terminale. La question se pose donc. Loin de revêtir la moindre dimension punitive, la laïcité doit constituer un facteur d'émancipation. Si les espaces de cours, à la différence d'espaces commerciaux par exemple, ne s'accommodent pas de signes religieux, c'est parce que l'université n'est pas un supermarché, mais un temple du savoir, ou triomphe la règle du libre examen, où s'épanouit l'esprit critique : toute manifestation renvoyant à un dogme - quel qu'il soit - y est donc malvenue. Nous sommes inquiets d'apprendre qu'un pays aussi proche de nous que l'Espagne aurait rétabli, au titre de l'enseignement religieux, des cours sur le créationnisme. Gardons-nous d'emprunter cette voie !
La reviviscence de certaines expressions religieuses - aujourd'hui l'islam, demain, le christianisme évangélique ? - rend notre société de plus en plus hétérogène. Il ne s'agit pas de stigmatiser une religion en particulier. Nous devons réaffirmer notre modèle de civilisation, nullement dominateur, qui repose sur des principes universels, issus de la Déclaration des droits de l'homme. La liberté d'expression en est un. Pour comprendre qu'une caricature n'a rien de blasphématoire et ne cherche pas à blesser, il faut avoir parcouru un processus complexe de civilisation. À nous de défendre notre modèle, qui a de beaux jours devant lui, à en juger par la situation des droits de l'homme dans d'autres pays.

La laïcité vous paraît-elle suffisamment enseignée à l'école ? Y est-elle suffisamment expliquée et mise en pratique ? Vous prônez une laïcité rigoureuse refusant le financement public d'établissements confessionnels ou n'ayant pas pour objet d'apporter une meilleure connaissance du fait religieux. Comment l'école doit-elle inculquer les valeurs républicaines ? N'attend-on pas trop d'elle ? Peut-elle tout faire ? Doit-elle se substituer à la famille ?

Vous considérez la laïcité comme un principe d'organisation de la société. Ne faudrait-il pas réorganiser les établissements scolaires autour de l'autorité du maître ? Le troisième acteur que constituent désormais les parents d'élèves ne fait-il pas parfois obstacle à une bonne transmission de la laïcité ? Il importe en tous cas que la formation des maîtres définisse clairement ce que doit être une laïcité plurielle.
L'idée d'un enseignement laïque du fait religieux me laisse sceptique : il est normal que les religions soient enseignées à l'école, mais dans les cours d'histoire ! Il me semble d'ailleurs que c'est le cas. Promouvoir un enseignement laïc du fait religieux contrevient à la nécessité de restaurer les valeurs républicaines à l'école. Au contraire, il faut mettre à distance ces religions qui monopolisent le débat public, comme si les questions qui leur sont propres étaient devenues l'horizon de toute réflexion, et enseigner l'histoire et le sens des valeurs républicaines.
La charte de la laïcité en milieu scolaire est bienvenue. Pour être appliquée, il faut que chacun se l'approprie, ce qui réclame un enseignement adapté. Déjà, l'école célèbre la laïcité chaque 9 décembre. J'espère que l'Assemblée nationale finira par voter, comme l'a fait le Sénat, une résolution parlementaire consacrant cette date journée nationale de la laïcité - non fériée. Cela ne changera pas le droit, mais aurait une valeur symbolique importante, comparable à la commémoration des quarante ans de la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse.
L'argent public doit aller prioritairement, et même exclusivement, à l'école publique, qui en a bien besoin pour accomplir son dur métier. Avons-nous bien fait de mettre l'élève au coeur du projet pédagogique ? L'autorité est une valeur républicaine qui doit revenir à l'école. Nous devons recréer une relation de transmission entre le maître et l'élève. L'enseignant n'est pas un prestataire de services : il s'agit d'un métier de vocation. La communauté enseignante, sentinelle de la République, doit donc se sentir soutenue et retrouver le prestige qu'elle n'aurait jamais dû perdre.
La laïcité n'est pas plurielle : c'est un principe d'organisation, qui nous distingue de théocraties comme il en existe ailleurs dans le monde. Chez nous, la religion est une affaire privée, parfaitement respectable du reste. C'est cette rupture entre le politique et le religieux que nous devons faire comprendre à toutes les familles. La laïcité ne doit pas être la rançon de l'échec économique et social des populations les plus fragiles. Elle ne règlera pas tout !

Il existe des pays islamistes, dirigés par la religion. Beaucoup d'enfants scolarisés dans nos écoles publiques ont été baignés, jusqu'à l'âge de trois ou quatre ans, dans le fondamentalisme religieux. Que faire ?
Je ne puis vous répondre ! Il y aurait environ deux mille Français en Syrie ou en Irak, susceptibles de revenir à tout moment, à l'instar de ces Tunisiens qui ont perpétré le massacre d'hier au musée du Bardo. C'est un problème d'ordre public, qui appelle une politique répressive : l'islamisme - à ne pas confondre avec l'islam, bien sûr - doit être combattu. Il s'agit d'une instrumentalisation de l'islam, qui se fait d'abord aux dépens des musulmans. Une telle politisation de la religion n'est pas sans rappeler l'Inquisition dans l'Europe du Moyen Âge. Cette dérive idéologique des religions est inquiétante et nécessite un travail éducatif, afin que les jeunes s'émancipent de l'admiration ignorante qu'ils peuvent ressentir. Bien sûr, ce n'est pas aisé, dès lors que l'information circule plus vite, sur nos médias mondialisés, que l'enseignement du maître.

Comment imaginez-vous l'enseignement des valeurs républicaines à l'école ? Cette question est au coeur de nos préoccupations. Les chartes de la laïcité sont un premier pas. L'école doit transformer les enfants en élèves puis les élèves en citoyens - mais elle ne peut pas tout faire !
Il faut instaurer dans les écoles un débat sur le triptyque que vous évoquiez - Liberté, Égalité, Fraternité - en analysant des cas concrets ou en comparant différents pays : par exemple, l'égalité entre les femmes et les hommes est loin d'être acquise partout. Les enseignants pourraient développer les structures de concertation dans les classes pour y faire vivre la République à travers des projets pédagogiques concrets : il s'agit de d'organiser des travaux scolaires autour de l'histoire de la laïcité, de la loi de 1905, pour donner aux élèves une culture de la République, par exemple en les emmenant visiter des monuments comme le Panthéon.

Merci d'avoir apporté votre pierre à l'édifice de notre commission d'enquête.
La réunion est levée à 13 h 05.