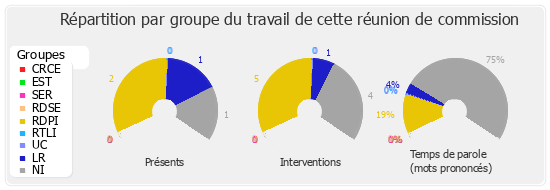Commission des affaires européennes
Réunion du 16 février 2012 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion

J'ai déjà eu l'occasion d'aborder la problématique du financement du budget européen devant vous le 9 novembre dans une communication d'étape. Je souhaite aujourd'hui vous présenter les principales propositions de ce rapport.
Auparavant, permettez-moi de faire un bref rappel de mon intervention de novembre dernier. Le budget européen se finance par des contributions versées par chaque Etat et par des ressources propres. A partir de 1970, les recettes ont reposé en grande partie sur des ressources directement affectées au niveau européen. Il s'agissait des droits de douane, des prélèvements agricoles et des cotisations sucre et isoglucose. Avec la libéralisation du commerce mondial, ces droits n'ont fait que diminuer tandis que les besoins du budget européen s'accroissaient. Au lieu d'inventer de nouvelles ressources propres, l'Europe a augmenté les cotisations nationales de chaque Etat avec une ressource TVA un peu artificielle et la contribution RNB (Revenu national brut). Aujourd'hui, les ressources propres authentiques ne représentent plus que 14 % du budget européen.
Cette situation présente beaucoup d'inconvénients. L'importance des contributions nationales fait apparaître la participation des Etats comme une dépense, et non comme une opportunité, ni comme une contribution à la construction européenne. Cela incite à des raisonnements sur le « juste retour », c'est-à-dire à un calcul purement arithmétique qui ne tient pas compte de la plus-value intrinsèque européenne, à savoir les avantages du marché unique, de l'intégration européenne, de la libéralisation des échanges. Un tel raisonnement ne prend pas non plus en compte le principe de solidarité qui est un des fondements de l'Union.
En outre, cette notion du juste retour a conduit à accorder des rabais qui ne sont plus entièrement justifiés. La Grande-Bretagne a obtenu la première des rabais, puis d'autres pays ont demandé à en bénéficier à leur tour. Ainsi, des politiques ont été menées, non pas dans l'intérêt de l'Europe, mais afin que tel ou tel pays bénéficie du « juste retour ».
Tous ces calculs ont compliqué les procédures budgétaires et ont hypothéqué la construction européenne puisque la prise en compte des contributions nationales a traduit le retour au nationalisme budgétaire alors que l'Europe, en pleine crise, prenait conscience qu'elle devait aller vers plus d'intégration dans les domaines économique et financier.
Une remise à plat s'impose donc. La Commission et le Parlement européen le demandent d'ailleurs depuis 2007. Cette question sera abordée à l'occasion des négociations sur les perspectives 2014-2020. Or, ces réformes nécessitent des décisions prises à l'unanimité du Conseil après simple consultation du Parlement européen. En outre, chaque Etat devra ratifier l'accord, aux termes de l'article 311 du traité.
Au moment où s'engageaient les négociations entre la Commission, le Conseil et le Parlement européen, ce dernier a exigé que la question des ressources propres soit intégrée aux réflexions plus générales sur les perspectives financières 2014-2020. La Commission, qui approuve cette demande, a proposé de simplifier le système et de renverser le rapport ressources propres - contribution des Etats dans le budget européen. Elle propose donc de créer deux nouvelles ressources propres, avec une véritable ressource TVA et la taxe sur les transactions financières (TTF). Elle veut aussi simplifier le système des rabais en le forfaitisant et en n'indexant pas leurs montants sur l'inflation.
La TTF européenne taxerait 85 % des transactions avec des taux différenciés et les deux tiers de cette taxe seraient affectés à l'Europe, ce qui représenterait 23 % du budget de l'Union en 2020. Pour plus de détails sur la TTF, je vous renvoie à la communication que notre collègue Fabienne Keller a faite il y a quelques semaines.
La ressource TVA serait assise sur les recettes de TVA des produits taxés au taux normal dans les vingt-sept Etats membres. Le taux effectif serait de 1 % et le taux maximum de 2 %. Le produit attendu s'élèverait à 29 milliards en 2020, soit 18 % des recettes. Si ces deux ressources propres étaient instaurées, les ressources propres authentiques passeraient de 14% à près de 60 %.
J'en viens maintenant à mes cinq propositions. Tout d'abord, il convient d'approuver les propositions de la Commission quand elle veut créer deux nouvelles ressources propres, la TVA et la TTF.
Je vous propose ensuite d'instaurer d'autres ressources propres puisque celles souhaitées par la Commission pourraient ne pas voir le jour. Il conviendrait donc de mettre en place une taxe européenne sur le tabac, une taxe européenne sur l'alcool, et d'affecter le produit des enchères de quotas de gaz à effet de serre au budget européen.
Dans un troisième temps, je propose d'étudier d'autres nouvelles ressources éventuelles à plus long terme, comme une taxe sur les jeux en ligne, un impôt européen sur les sociétés, une taxe européenne sur l'énergie ou une taxe sur le commerce des armes.
En quatrième lieu, il serait opportun de faire passer le budget européen de 1 à 2 % du RNB d'ici 2020, sans dépenses nouvelles mais par transfert de certaines dépenses du niveau national au niveau européen.
Enfin, l'Europe devrait pouvoir contracter des emprunts.
Je ne reviendrai pas sur la TTF dont l'environnement politique a évolué depuis que la Commission a présenté ses propositions. Le Royaume-Uni et la Suède y sont opposés. Le Président de la République, pour sa part, a décidé de soumettre au Parlement dans les prochains jours une taxe portant sur l'acquisition d'actions de sociétés cotées dont le siège est situé en France et dont la capitalisation est supérieure à 1 milliard. Les CDS (Credit Default Swaps) seraient taxés à hauteur de 0,01 %, de même que le trading haute fréquence.
Selon une étude du FMI, cette taxe rapporterait quatre fois moins que celle qui existe au Royaume-Uni, dix fois moins que la taxe suisse et quatorze fois moins que celle du Brésil, les périmètres des taxes étant néanmoins différents. Ce faible taux est sans doute destiné à éviter les délocalisations.
Par ailleurs, neuf pays ont écrit à la présidence de l'Union pour demander l'accélération du projet de directive européenne de taxe financière.
Pour ma part, je propose de nous en tenir aux propositions de la Commission européenne sur la TTF et sur la TVA.
Toutefois, il faut tenir compte des incertitudes qui pèsent sur les propositions de la Commission et des difficultés que cette dernière a identifiées dans la mise en place d'autres ressources propres telles qu'une taxe sur le transport aérien, un impôt européen sur les sociétés ou une taxe sur les activités financières, qui existe dans de nombreux Etats, notamment en France depuis la loi de finances de 2011.
Il me paraît donc utile de proposer d'autres ressources propres plus faciles à mettre en place à court ou moyen terme, puisque la Commission a renoncé à proposer les trois taxes dont je viens de parler. Elle a considéré qu'il était plus facile de proposer de nouvelles taxes que de transformer les taxes actuelles, compte tenu des négociations qu'il faudrait engager.
Dans cette logique, je propose des taxes relativement faciles à mettre en oeuvre. Ainsi, la fiscalité sur le tabac a déjà fait l'objet d'une harmonisation avancée dans l'Union. Il s'agirait de créer une tranche européenne sur les tabacs manufacturés à hauteur de 10 % du produit actuel, soit une rentrée fiscale de 7,5 milliards. La fiscalité sur les alcools fait aussi l'objet d'une harmonisation, quoique moins achevée que pour le tabac. Là aussi, 10 % des rentes actuelles représenteraient 3 milliards d'euros.
A partir du 1er janvier 2013, les quotas de gaz à effet de serre, qui sont aujourd'hui gratuits, seront mis aux enchères. En 2020, le produit estimé pourrait s'élever à 20 milliards d'euros : la moitié irait à l'Union et l'autre aux Etats membres.
Si l'on mettait en oeuvre la TVA voulue par la Commission, les taxes sur le tabac, l'alcool et les enchères des quotas de CO2 que je propose, et si l'on y ajoutait les droits de douane actuels, on parviendrait à un taux de ressources compris entre 50 et 60 %, sur la base des dépenses proposées par la Commission européenne pour la période 2014-2020.
Ce serait un excellent début qui ne nous exonèrerait pas de poursuivre notre réflexion sur les jeux en ligne, la taxe sur l'énergie, l'impôt sur les sociétés et la taxe sur le commerce des armes. En 2027, nous pourrions en arriver à un taux de ressources propres de 75 %, étant entendu que 25 % de RNB seraient nécessaires, puisque un ajustement serait indispensable en fonction des rentrées de ressources propres.
J'en arrive à l'importance et au rôle du budget européen. Aujourd'hui, il représente 1 % du RNB de l'Union. Comment rester crédible aux yeux du monde avec un tel montant ? Quel levier de croissance peut-on en espérer ? En intégrant toutes les dépenses de l'Europe dans le budget, il se monte, de fait, à plus de 1% du RNB. En effet, n'y figurent pas la réserve d'aide d'urgence, le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, le Fonds de solidarité, l'instrument de flexibilité, la réserve pour les crises dans le secteur agricole, les investissements dans ITER, le FED, la participation au Fonds mondial de lutte contre le changement climatique, et le GMES (Global Monitoring for Environment and Security), puisque ces dépenses sont hors du cadre financier pluriannuel. Le budget européen se monte ainsi à 1,11 % du RNB. Je ne propose donc pas le doublement du budget en sept ans. Officiellement, l'Europe s'était donné un plafond budgétaire de 1,23 % qu'elle n'atteint même pas.
Pour la période 2014 - 2020, la Commission propose de stabiliser les crédits d'engagement à 1,05 % et les crédits de paiement à 1 % du RNB, en prix constants 2011, sachant que certains Etats estiment que c'est encore trop. Nous sommes donc en présence de deux options fondamentales entre lesquelles il faut choisir.
Les Etats sont confrontés à la crise, en particulier à celle de leurs dettes souveraines. Ils savent qu'ils doivent impérativement les réduire et, par un raisonnement analogique, ils n'admettent pas d'autre attitude pour l'Europe que l'extrême rigueur budgétaire qu'ils doivent eux-mêmes observer. Ils l'acceptent d'autant moins que le budget européen est alimenté directement par le leur. Ils ont tendance à le considérer comme une dépense qu'il faut contenir au maximum et ils demandent donc à l'Europe de se mettre au diapason. Or l'Europe n'est pas dans la même situation budgétaire que nos Etats, puisqu'elle n'a pas de dette.
S'il doit y avoir une relance, elle ne peut être impulsée par les Etats qui sont confrontés à leur dette souveraine, mais par l'Europe. C'est dans cette perspective que je préconise un budget européen à 2 % du RNB en 2020, ce qui représenterait un budget de 280 milliards en crédits de paiement. En accroissant les ressources propres du budget européen, les marges de manoeuvre de chaque Etat qui doivent réduire les dettes souveraines augmenteraient, puisque la cotisation RNB de chacun serait sensiblement réduite. Il conviendrait aussi d'augmenter le budget européen afin de donner des opportunités de relance. En développant le taux de croissance, cette relance permettrait de rembourser plus facilement les dettes nationales et de lutter contre le chômage. Ce transfert de dépenses engendrerait des synergies et des économies d'échelle : une politique européenne dans tel ou tel secteur coûte en effet moins cher que des politiques nationales juxtaposées.
Pour transférer des dépenses nationales au niveau européen sans en créer de nouvelles, il conviendrait de procéder à une revue générale des politiques publiques dans chaque Etat, afin d'identifier poste par poste les actions qui pourraient être moins coûteuses et plus efficaces au niveau européen qu'au niveau national. Il faudrait alors créer des groupes d'experts comprenant des experts de la Commission, du Conseil, des experts nationaux, des parlementaires européens et nationaux.
Une Europe plus forte, dotée d'un budget plus intégré, capable d'alimenter de façon autonome le mécanisme de stabilité européen, le MES, de relancer la recherche, de réaliser les interconnexions des grands réseaux routiers, ferroviaires, d'énergie, de télécommunications, d'aider au développement des PME, devrait aider les Etats à alléger leur dette et à relancer la croissance en Europe.
Cette politique pourrait être complétée par l'autorisation donnée à l'Europe d'emprunter - sagement - pour relancer la croissance.
Telles sont les nouvelles propositions que j'ai l'honneur de vous présenter dans le cadre de ce rapport d'information.

Je suis favorable à la création d'emprunts européens, afin de financer de grandes réalisations qui pourraient contribuer à faire aimer l'Europe. Nous en avons d'ailleurs parlé lors de la table ronde du 8 février organisée par la commission des finances, notamment avec M. Patrick Artus. Je n'ai d'ailleurs pas spécialement apprécié sa position sur le sujet.
Je suis tout à fait d'accord pour faire évoluer les ressources propres : on ne peut se contenter des 14 % actuels. La participation des Etats membres au budget européen est parfois vue moins comme un engagement que comme une obligation. En revanche, les 75 % que vous projetez pour 2027 pourraient déséquilibrer les relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux. Si nous nous dirigeons vers un certain fédéralisme, il faut cependant conserver un équilibre entre les parlements nationaux et le Parlement européen, afin de favoriser la coopération et le travail en commun.

Pourquoi ne pas aborder la question sous l'angle de la subsidiarité ? Les enfants adultérins du non-respect de la subsidiarité sont des doublons qu'il convient de chasser. Il y a là une source d'économies importantes. Ainsi en est-il de la politique étrangère : chaque grand pays défend l'indépendance de sa diplomatie et pourtant l'Europe a nommé cette malheureuse Mme Ashton, ce qui génère des dépenses certaines. De même, pourquoi conserver des consulats à l'intérieur de l'Union ?

Il faut tirer toutes les conséquences de la subsidiarité et mettre un terme aux doublons. Notre rapporteur nous a parlé de ressources et de dépenses supplémentaires, mais pas assez d'économies, ce qui est un tort.

Merci pour ce travail concret et prospectif. Je suis partisan de la TTF car elle s'inscrit dans une nouvelle lecture de l'économie : les flux l'emportent aujourd'hui sur les stocks. Je regrette que vos propositions complémentaires ne prennent pas en compte l'évolution de l'économie mondiale vers l'immatériel. Pourquoi ne pas chercher les ressources nécessaires à l'Europe dans les secteurs d'avenir ? Les taxes sur le tabac et l'alcool, déjà lourdes, développent les marchés gris.
Le marché de l'Union est le plus vaste au monde, avant celui de l'Amérique du Nord, de la Chine ou du Japon. Or, l'Europe, qui a adopté une politique très libérale sous l'impulsion de l'OMC, a ouvert en grand ses portes à la concurrence internationale. Peut-être des ressources pourraient-elles provenir d'une meilleure protection de ses brevets et ses licences.

A mon tour, je félicite M. Bernard-Reymond. Comme lui, j'estime indispensable de mettre un terme à la notion de juste retour, qui n'est que le reflet d'un triste marchandage entre Etats, au détriment de la construction européenne. Lorsque des Etats ne veulent pas dépasser 1 % du RNB...

tout en maintenant les politiques actuelles au même niveau, comment aller de l'avant, comment innover ? C'est tout simplement impossible !
Lorsque j'ai été au Parlement européen, j'ai été assez sensible au discours de M. Alain Lamassoure sur les perspectives financières. Il estimait qu'il fallait mettre fin aux doublons. Pourtant, la Commission européenne propose de créer une agence en faveur des droits de l'Homme. Quel gâchis alors que nous avons la chance d'avoir un Conseil de l'Europe ! Ce doublon serait inacceptable. Il faut rationaliser le partage des compétences entre les Etats et l'Europe et imposer le plus rapidement possible la TTF et la mutualisation des dettes souveraines des Etats. En outre, la capacité d'emprunt de l'Europe permettrait de lancer des programmes de grands travaux qui redonneraient du sens à la construction européenne.

Je serais assez tenté d'adhérer aux propositions du rapporteur. Mais je suis partagé entre le souhaitable et le possible. Moi qui suis fédéraliste, je ne vois pas de mouvement en ce sens aujourd'hui en matière financière ou économique. Les traités sur lesquels nous allons délibérer resteront adoptés à l'unanimité, ce qui est le contraire du fédéralisme. Pour l'instant, l'idée de transferts supplémentaires de pouvoirs de décision se heurte à de multiples obstacles.
La plupart des gouvernements sont obligés de plafonner leurs dépenses publiques. Si l'on transférait 1 % du RNB supplémentaire des budgets nationaux vers le budget européen, d'un point de vue keynésien l'impact serait nul ! Il n'y aurait pas un euro de plus de richesse de créé.

Sauf pour les synergies et les économies d'échelle ! En outre, les agences de notation seraient obligées de tenir compte de cette évolution majeure.

Soit ! Le gain ne serait pourtant que de quelques dixièmes de points de croissance.
Sur l'affaire de l'endettement, je me demande si le plafond fixé à 3 % était vraiment nécessaire. M. Prodi, lorsqu'il était président de la Commission, n'avait-il d'ailleurs pas dit que la règle des 3 % était stupide ? Je ne le crois pas, mais c'est un simple outil qui permet d'éviter que le poids de la dette, qui est improductive par nature, n'augmente tendanciellement. Pour le reste, endettement de l'Europe ou endettement des Etats européens sont les deux visages d'une même réalité contre laquelle il convient de lutter.

Je suis d'accord avec M. Bizet : les 75 % de ressources propres pour le budget européen en 2027 sont du domaine du voeu pieux. Où en sera l'Europe à cette date ? Nous n'en savons rien. J'avais voulu donner un objectif au-delà de 2020 et je voulais indiquer que les ressources propres n'atteindraient jamais 100 %. Par souci de consensus, je suis prêt à ne plus faire référence à ce taux ni à cette date.

Nous ne discutons pas d'une proposition de résolution. Ceci dit, nous devrons autoriser la publication du rapport.

Je suis sensible aux remarques qui ont été faites et j'éliminerai de mon rapport la référence à 2027. Si nous arrivions en 2020 aux 60 %, ce que je ne crois pas, ce serait déjà très satisfaisant.
Si nous augmentions le budget européen, monsieur de Montesquiou, il faudrait que chaque Etat se livre à une RGPP pour passer du niveau national à l'européen. Cela nous permettrait de savoir quelles seraient les dépenses qui, en passant à l'échelon européen, feraient gagner en économies d'échelle, en synergies, en productivité et en image auprès de nos concitoyens. Pourquoi ne pas supprimer les consulats en Europe et pourquoi ne pas avoir des consulats européens dans un certain nombre de pays ? Certains regroupements ont eu lieu, mais il s'agit plutôt de juxtapositions sous un même toit. Peut-être faudrait-il régulièrement se demander ce qui pourrait être mieux traité au niveau européen que national et en profiter pour couper les branches mortes, car il en existe aussi au niveau européen.
Je suis d'accord avec vous, monsieur Gattolin : peut-être faut-il prévoir de nouvelles taxes plus orientées vers les flux et les technologies nouvelles, même si j'ai la faiblesse de considérer que mes propositions restent valables. Faites-moi des propositions concrètes afin que je puisse les intégrer dans mon rapport.
M. Richard a prôné une approche réaliste, mais pour faire avancer l'Europe, une part d'utopie et de volontarisme est nécessaire. Il faut en revenir à l'inspiration des pères de l'Europe et ne pas trop se demander si ces rapports vont permettre de parvenir aux objectifs fixés, sinon, je crains de ne devoir mettre un terme à mes activités...
Les initiatives de M. Lamassoure vont dans le bon sens. Il faut tordre le cou à l'idée que l'Europe est une danseuse. Si l'on ne transgresse pas le réalisme, on n'avancera pas. En transférant des dépenses à l'Europe, celle-ci gagnerait en crédibilité auprès des grandes puissances. Kissinger disait : l'Europe, quel numéro de téléphone ? Il aurait également pu demander quel était le montant de son budget. Certes, l'unanimité est une barrière. Je me suis d'ailleurs exprimé pour la suppression complète de cette règle. La Commission et le Parlement européen doivent se saisir de ce problème. Il ne faut plus que des Etats prennent le prétexte de la crise pour réduire le budget de l'Europe. Par ce biais, on flatte les populismes, les nationalismes et les anti-européens pour de basses raisons politiciennes.
La RGPP européenne que je propose permettrait de lutter contre les doublons.

Je vous félicite pour vos propositions courageuses : notre commission doit soutenir des objectifs ambitieux, c'est indispensable si nous voulons avancer un peu !
A l'issue du débat, la commission a décidé d'autoriser la publication du rapport.

Nous avons déjà abordé la question des marchés publics et des concessions de services au printemps dernier, après la publication du Livre vert de M. Michel Barnier, commissaire européen. J'étais moi-même intervenu devant notre commission. Depuis, la Commission européenne a présenté ses propositions de directive, sur lesquelles il convient que le Sénat se prononce, car elles concernent de près les collectivités territoriales.

Le Sénat a adopté en avril et juin 2011 deux résolutions relatives à la législation communautaire en matière de délégation de service public et de marchés publics : sujets très techniques mais au coeur de la vie de tous les acteurs publics, en particulier de nos collectivités territoriales. Ces deux résolutions, proposées par notre commission, ont été adoptées par le Sénat sans modification. La résolution de juin sur les marchés publics faisait suite au Livre vert de la Commission européenne. La résolution d'avril sur les concessions de services - c'est-à-dire pour l'essentiel, en France, les délégations de service public - faisait suite aux annonces de Michel Barnier dans le cadre de son initiative «Vers un Acte pour le marché unique ».
Le Sénat exprimait son scepticisme sur l'opportunité de légiférer dans ces deux domaines. S'agissant des marchés publics, les deux directives de 2004 sont très complexes et commencent seulement à être pleinement maîtrisées par ses praticiens quotidiens. Un nouveau bouleversement des règles risquerait de déstabiliser aussi bien les pouvoirs adjudicateurs que les soumissionnaires. Pour ce qui est des concessions de services, la situation est différente, puisqu'il n'existe pas à l'heure actuelle de texte communautaire. La passation de concession n'est régie que par les grands principes du traité, à savoir les obligations de transparence, d'égalité et de non-discrimination. La jurisprudence de la Cour de justice les a interprétés et la législation française a trouvé un bon équilibre avec la « loi Sapin » du 29 janvier 1993. Notre assemblée doutait donc qu'un texte européen pût apporter une plus-value, et craignait qu'une réglementation excessive ne remît en cause l'équilibre de cette loi, objet d'un large consensus dans notre pays.
Cette inquiétude était renforcée par la concomitance des deux débats sur les marchés publics et les concessions de services. Le risque était que la Commission transposât la législation des marchés publics à celle des concessions, en méconnaissance de la nature particulière de la délégation de service public, qui obéit à une autre logique que la commande publique : c'est un mandat donné à un tiers pour fournir un service public, le mandataire assumant tout ou partie du risque économique lié à l'exploitation.
Toutefois, conscient de la faible chance d'arrêter la Commission dans sa volonté de légiférer, le Sénat lui demandait de respecter deux principes : la simplification des procédures et la liberté des autorités adjudicatrices. Les résolutions abordaient aussi d'autres points sur lesquels je ne reviens pas.
La Commission européenne a finalement présenté le 20 décembre 2011 trois propositions de directives : deux d'entre elles se substitueraient aux directives « Marchés publics » de 2004, la troisième encadrerait l'attribution de contrats de concession et comblerait ainsi un vide juridique supposé. Sur les deux premiers textes, la Commission et la présidence danoise veulent aboutir très vite.
Que faut-il en penser ? Les deux propositions relatives aux marchés publics ne modifient pas profondément le droit en vigueur, mais l'aménagent et le modernisent. La rédaction en est plus claire, ce qui facilitera leur interprétation. Les procédures sont simplifiées : les pouvoirs adjudicateurs seraient autorisés à inverser les phases de sélection des candidatures et d'analyse des offres ; les PME ne devraient fournir toutes les pièces nécessaires à leur candidature que si celle-ci était retenue ; la déclaration sur 1'honneur serait généralisée en lieu et place d'attestations ou de certificats de capacité ou de non-exclusion des marchés. Toujours afin de favoriser la participation des PME, l'allotissement des marchés deviendrait obligatoire au-delà de 500 000 euros, sauf exceptions dûment motivées.
On peut aussi se féliciter que les critères sociaux ou environnementaux soient mieux pris en compte. Ainsi, en cas d'attribution selon le critère du coût le plus bas, celui-ci pourrait être évalué soit sur la base du prix, soit sur la base du coût de cycle de vie, incluant les coûts d'usage, liés par exemple à la consommation d'énergie, les coûts de fin de vie - recyclage, etc. -, les coûts environnementaux externes comme le coût des émissions de gaz à effet de serre. En cas d'attribution selon le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse, pourraient être pris en compte les qualifications et l'expérience du personnel affecté à l'exécution du marché ainsi que le processus de production et le respect des normes environnementales et sociales.
La Commission propose de réserver un chapitre spécifique aux marchés de services sociaux, qui continueraient à bénéficier d'un régime particulier très allégé, réduit à des obligations de publicité, et qui pour le reste devraient seulement respecter les principes des traités. Les Etats membres seraient donc libres d'aménager la procédure de passation la plus opportune. En outre, tous les services culturels seraient assimilés aux services sociaux. Leur spécificité est donc clairement reconnue, ce qui est une avancée notable : lors de l'examen en décembre du paquet « Almunia » sur le financement des services d'intérêt économique général, la Commission européenne n'avait reconnu que les spécificités des services sociaux, non des services culturels. Je l'avais moi-même déploré dans une proposition de résolution.
Malgré ces sujets de satisfaction, la déception domine. Le Livre vert laissait espérer un recours beaucoup plus large à la procédure négociée avec publicité préalable. L'expérience française des marchés à procédure adaptée (Mapa) plaide dans le sens d'une plus grande liberté des autorités adjudicatrices. C'est aussi leur faire confiance en les responsabilisant. La négociation permet très souvent d'aboutir à des offres plus intéressantes pour les acheteurs publics. Malheureusement, la proposition de directive ne fait qu'une timide ouverture, l'appel d'offres ouvert ou fermé demeurant la règle. Seuls les marchés de travaux pourraient recourir un peu plus facilement à la procédure négociée.
La phase de négociation est décrite très précisément, à tel point que le rapport de force entre l'acheteur public et le soumissionnaire pencherait plutôt en faveur du second. Or l'expérience montre que la négociation demande un peu de rouerie ou d'habileté. Il n'est pas sûr que ce soit encore possible.
Les seuils baissent d'environ 15 % : sans être considérable, cet abaissement augmente les contraintes.
On remarque une nouveauté : la définition des coopérations public-public - in-house, in-house conjoint, mutualisation de moyens entre collectivités... La Commission souhaite codifier ce genre de coopération, afin de l'exclure du champ de la commande publique. En France, on pense aux sociétés publiques locales, à l'intercommunalité ou aux mutualisations de moyens entre conseils généraux, communes, etc. Selon la Commission, il s'agirait d'une simple codification de la jurisprudence de la Cour de justice. En fait, les choses ne sont pas si simples : la jurisprudence de la Cour est trop récente pour que l'on puisse en tirer des conclusions définitives. En outre, la coopération public-public évolue en permanence et il serait dangereux de la figer. Enfin, la proposition de la Commission va au-delà de la jurisprudence de la Cour : elle prévoit qu'un pouvoir adjudicateur peut, sans mise en concurrence, confier une mission à un opérateur sous son contrôle et détenu à 100 % par des personnes publiques, si cet opérateur réalise pour lui au moins 90 % de ses activités. Or ce seuil de 90 % ne figure pas aussi clairement dans la jurisprudence : la Cour de justice, depuis son arrêt « Teckal » du 18 novembre 1999, demande seulement que l'opérateur effectue « l'essentiel » de son activité avec le pouvoir adjudicateur qui le contrôle. Voilà pourquoi la codification de la coopération public-public n'est pas opportune.
Le dernier volet problématique concerne la lutte contre les fraudes et les conflits d'intérêt. Tout d'abord, la définition que la Commission propose des conflits d'intérêt est extraordinairement large et pourrait remettre en cause la sécurité juridique des marchés. L'article 21 dispose en effet que « la notion de conflit d'intérêt couvre au moins toutes les situations où [les membres du personnel du pouvoir adjudicateur et les membres des organes décisionnels du pouvoir adjudicateur] ont un intérêt privé direct ou indirect dans le résultat de la procédure de passation. [...] On entend par « intérêt privé » tout intérêt familial, sentimental, économique, politique ou autre partagé avec les candidats ou soumissionnaires. ». Le pouvoir adjudicateur doit prendre des mesures pouvant aller jusqu'à l'exclusion du candidat. On imagine quelles difficultés ces dispositions pourraient poser dans de petites collectivités. Toutefois, je ne vous propose pas de nous prononcer sur ce point. La commission des Lois, compétente au fond, a fait un travail important sur les conflits d'intérêt, et examinera ces propositions en tant que de besoin.
Les Etats membres seraient également tenus de créer un organe indépendant unique, dénommé « organe de contrôle », aux pouvoirs très larges. Les pouvoirs adjudicateurs auraient l'obligation de lui transmettre tous les marchés supérieurs à un certain seuil. Il pourrait saisir la justice s'il constatait une infraction, signaler les cas de fraude, de corruption et de conflits d'intérêt. Il aurait pour mission d'examiner les plaintes des particuliers et des entreprises, et contrôlerait les décisions juridictionnelles et administratives pour vérifier qu'elles sont compatibles avec les décisions de la Cour de justice. La Commission pourrait aussi faire appel à lui dans certains cas. Le groupe de travail « subsidiarité » n'a pas jugé contraire au principe de subsidiarité la création de cet organe de contrôle, estimant qu'il pourrait être utile pour faire respecter la législation sur les marchés publics dans certains Etats membres. J'entends cet argument réaliste, mais, dans le paysage institutionnel français, cet organe hybride, mi-administratif, mi-judiciaire, détonnerait ; il serait coûteux et d'une utilité limitée, puisque les marchés publics sont déjà soumis dans notre pays à un contrôle rigoureux. Je propose donc que le principe d'un organe de contrôle soit maintenu, mais que chaque Etat puisse, avec l'accord de la Commission, choisir une autre formule mieux adaptée à sa situation. La proposition de directive offre la même souplesse sur d'autres points, autorisant par exemple les Etats membres à ne pas introduire la procédure négociée dans leur législation s'ils ne la jugent pas utile ou opportune.
Je serai plus rapide sur la proposition de directive relative aux concessions de services, dont l'esprit même est contestable. Contrairement aux assurances de la Commission, le cadre proposé n'a rien de léger : le texte comporte 53 articles et des annexes. Des pans entiers sont purement et simplement calqués sur les directives « Marchés publics », notamment en ce qui concerne la publication, la coopération public-public, le contrôle... Le seuil d'application est relativement bas : 5 millions d'euros calculés sur le cycle de vie de la concession.
Les dispositions les plus contestables concernent la négociation et l'attribution. La « loi Sapin » laisse une grande liberté aux autorités adjudicatrices dans le respect des grands principes des traités. Elle ne prévoit pas de pondération ex ante des critères d'attribution, ce qui place le délégant dans une position de force lors de la négociation. La proposition de directive bouleverse cet équilibre. Reprenant très exactement les textes « Marchés publics », elle règle dans le détail la phase de négociation et impose la pondération des critères, sauf exception. Pourtant, la Commission n'a cessé de répéter dans la phase préparatoire que la loi française était le modèle à suivre... Je vous propose donc de réitérer notre nette opposition à ce projet.
Deux autres points de moindre importance méritent notre attention. Le premier concerne les services culturels. Les propositions de directive relatives aux marchés publics les soumettent, je l'ai dit, à un régime allégé, au même titre que les services sociaux. Le texte sur les concessions prévoit lui aussi un régime allégé pour les services sociaux, mais il est ambigu sur les services culturels, comme me l'a signalé le groupe de travail sur le financement des services culturels récemment créé par la commission de la culture, et dont notre collègue Catherine Morin-Desailly est membre. Il convient de lever cette incertitude.
J'évoquerai enfin la situation particulière de GrDF et d'ErDF. La législation européenne a confirmé le monopole des opérateurs traditionnels pour la distribution de gaz naturel en zone de desserte historique et pour la distribution d'électricité. Afin de ne pas remettre en cause ces monopoles dans l'Union européenne, l'article 8 de la proposition de directive exclut de son champ ce type de concession de services, mais il est rédigé de telle manière que les opérateurs exclus doivent être eux-mêmes des entités adjudicatrices. Or ni GrDF, ni ErDF ne sont des entités adjudicatrices, mais des concessionnaires. Ce sont les communes qui concèdent la distribution de gaz à GrDF et d'électricité à ErDF. C'est un point de détail technique, mais assez sensible.
Pour toutes ces raisons, je vous propose d'adopter la proposition de résolution qui vous a été transmise mardi.

M. Piras soulève des problèmes économiques et juridiques très importants. Je suggère de renforcer un peu la formulation de la proposition de résolution sur deux points. S'agissant de l'organe de contrôle, il faudrait d'abord s'assurer que tous les Etats membres ont correctement transposé la directive « Recours ». En France - je le sais pour avoir travaillé au Conseil d'Etat sur la transposition de cette directive, et pour avoir l'expérience de ce contentieux - quelqu'un qui tenterait d'arranger un marché public aurait presque toutes les chances de se voir opposer un recours immédiat. Tout notre système se fonde sur le recours avant signature, dans des délais qui se comptent en jours, et les tribunaux administratifs consacrent beaucoup d'énergie à traiter des demandes de suspension ou d'annulation de marchés publics douteux. Dans ces conditions, je ne vois donc pas de raisons de créer un organe de plus.
En ce qui concerne les concessions, il faut avouer que le système français est un peu sur la bordure, lorsqu'il s'agit de concilier la liberté de négociation et l'égalité entre candidats. Ce n'est pas toujours évident. Il suffit de lire Le Canard enchaîné pour s'en convaincre... Mais proposer un seuil de 5 millions d'euros, c'est se moquer du monde : un compromis a été trouvé il y a quelques années pour fixer ce même seuil pour les marchés publics de travaux, où il n'y a qu'une dépense en capital, alors qu'un concessionnaire qui fait fonctionner l'ouvrage qu'il a construit doit aussi supporter des dépenses d'exploitation. Il y a donc une incohérence entre ces deux seuils.

La proposition de résolution de M. Piras est astucieuse : elle fait mine d'approuver certains aspects des textes de la Commission, qu'elle désapprouve en fait presque entièrement. Sur le fond, je suis tout à fait d'accord avec lui !

En France, les standards sont assez élevés, et l'harmonisation européenne ne doit pas nous entraîner vers le bas : il en va de même pour la sûreté nucléaire ou la protection des données. La proposition de résolution de M. Piras ne contient donc pas de contradiction à accepter le principe d'une harmonisation tout en critiquant les modalités prévues.

Le contrôle des marchés publics est efficace dans notre pays, dans d'autres pays il l'est moins. Voilà pourquoi je propose que chaque Etat puisse conserver le cas échéant un système de contrôle qu'il juge efficace, en accord avec la Commission européenne.

Pour ce qui est des concessions, vous avez raison de dire que le seuil de 5 millions d'euros est inadapté : la Commission a calqué sa proposition sur le droit en vigueur pour les marchés publics de travaux, alors que les réalités sont différentes.

Passons donc à l'examen du texte de la proposition de résolution. La rédaction de l'alinéa 11 me paraît satisfaisante : le Sénat « souhaite que chaque Etat membre puisse, avec l'accord de la Commission, choisir une autre formule que la création d'un organe de contrôle indépendant, mi-administratif, mi-judiciaire, qui serait chargé de s'assurer de la bonne mise en oeuvre de la directive ».

Pourquoi ne pas écrire que la France est déjà dotée d'un système de contrôle strict ?

Il s'agit d'une norme européenne. Sans mentionner explicitement la France, le texte de M. Piras s'applique à tous les Etats placés dans la même situation.

Je propose de reprendre l'observation d'Alain Richard dans l'exposé des motifs de la proposition de résolution. Ainsi, le sens de notre démarche sera plus clair.

A l'alinéa 24, je vous propose de préciser que le seuil de 5 millions d'euros, calculé sur la durée de la concession, est incohérent avec le seuil retenu pour les marchés publics.
La proposition de résolution, ainsi modifiée, est adoptée à l'unanimité.
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics (E 6988),
Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (E 6987),
Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'attribution de contrats de concession (E 6989),
Vu la résolution n° 128 du Sénat du 2 juin 2011,
Vu la résolution n° 96 du Sénat du 14 avril 2011,
Sur la réforme des marchés publics :
constate que les deux principes qui devaient guider les réflexions de la Commission européenne, à savoir la simplification des procédures et la liberté des autorités adjudicatrices, n'ont été que partiellement suivis ;
regrette en particulier que le recours à la procédure négociée avec publication préalable d'un avis de marché demeure limité à quelques types de marchés ;
souhaite que chaque Etat membre puisse, avec l'accord de la Commission, choisir une autre formule que la création d'un organe de contrôle indépendant, mi-administratif, mi-judiciaire, qui serait chargé de s'assurer de la bonne mise en oeuvre de la directive ;
s'oppose à une codification des critères de la coopération public-public, au risque de figer une jurisprudence encore en construction, et estime qu'une communication de la Commission européenne serait plus judicieuse sur ce point ;
approuve en revanche la modernisation des critères d'attribution des marchés, afin notamment de prendre en compte les coûts liés au cycle de vie d'un marché ou les qualifications et l'expérience du personnel ;
se félicite du maintien d'un cadre juridique allégé pour les marchés relatifs à des services sociaux ou des services culturels ;
juge également positives les dispositions tendant à réduire les charges administratives pour les soumissionnaires et celles imposant l'allotissement des marchés pour encourager l'accès des PME aux marchés publics ;
reconnaît enfin l'effort de pédagogie et de clarté par rapport aux deux directives en vigueur ;
Sur les contrats de concession de services :
prend acte de la volonté de la Commission européenne de légiférer malgré les fortes réticences exprimées par les pouvoirs publics français ;
déplore l'initiative de la Commission européenne qui, contrairement à ses déclarations, n'a pas fait le choix d'un cadre juridique léger et adapté aux particularités des concessions de services ;
constate au contraire que le régime des concessions de services serait calqué sur celui des marchés publics ;
juge en particulier que la liberté de négociation des offres par l'autorité publique délégante, qui est au coeur de l'équilibre trouvé par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dite loi « Sapin », est remise en cause par, d'une part, l'encadrement formaliste et disproportionné de la phase de négociation et, d'autre part, l'obligation de pondération des critères d'attribution ;
considère que cette conception de la négociation méconnaît la nature particulière de la délégation de service public qui n'est pas comparable à celle de l'achat public ;
souhaite que les concessions de services culturels bénéficient sans aucune ambiguïté d'un régime juridique allégé au même titre que les concessions de services sociaux ;
estime que le seuil de cinq millions d'euros, calculé sur la durée de la concession, est trop bas, car il ne tient pas compte de la nature des concessions ;
demande que les concessions de distribution de gaz naturel en zone de desserte historique et d'électricité demeurent clairement hors du champ de la proposition de directive, afin de ne pas remettre en cause le monopole, reconnu par la loi et admis par le droit européen, de GrDF et de ErDF sur ces concessions ;