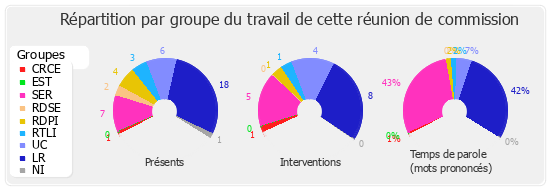Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
Réunion du 22 janvier 2020 à 9h30
Sommaire
- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république fédérale démocratique d'éthiopie relatif aux services aériens de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du costa rica relatif aux services aériens et de l'accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du mozambique
- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du tchad relatif aux services aériens et de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république d'angola relatif aux services aériens
- Nomination de rapporteurs (voir le dossier)
- Questions diverses (voir le dossier)
- Bilan et perspectives de l'opération barkhane
La réunion
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république fédérale démocratique d'éthiopie relatif aux services aériens de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du costa rica relatif aux services aériens et de l'accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du mozambique
Examen du rapport et du texte de la commission

Je vous prie d'excuser l'absence du rapporteur M. Michel Boutant, qui m'a demandé de présenter le rapport à sa place.
Nous examinons aujourd'hui plusieurs accords aériens. Ce sont des accords types, qui soulèvent assez peu d'enjeux. Le rapport de Michel Boutant porte sur un projet de loi autorisant l'approbation de trois accords bilatéraux aériens de 2017, respectivement avec le Mozambique, l'Éthiopie et le Costa Rica.
Jusqu'à présent, le transport aérien entre la France et le Costa Rica n'était régi par aucun accord bilatéral ; le transport aérien entre la France et le Mozambique d'une part, et la France et l'Éthiopie d'autre part, était réglementé par deux mémorandums d'entente sans valeur contraignante, signés respectivement en 1991 et 2008.
Les trois accords étudiés visent à moderniser le cadre juridique et à le rendre conforme aux normes internationales et au droit européen, pour renforcer la sécurité juridique des opérateurs de transports aériens.
Ces trois accords suivent le modèle classique de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), dont le Costa Rica, l'Éthiopie et le Mozambique sont tous trois membres.
Ils respectent par ailleurs le droit européen, et notamment le règlement de 2004 qui fait suite aux arrêts rendus en 2002 par la Cour de justice de l'Union européenne, dits de « ciel ouvert », sur la libre concurrence et le libre établissement.
Ils visent à assurer les quatre premières libertés de l'air énoncées par l'OACI ; le droit de survol, le droit d'effectuer des escales à des fins non commerciales, le droit d'embarquer et le droit de débarquer des passagers et du fret à destination ou en provenance du territoire des parties contractantes. Les clauses commerciales et d'exploitation prévues sont classiques pour ce type d'accords aériens : en particulier, le droit de cabotage est exclu conformément à la pratique. Ces trois accords garantissent également, comme d'habitude, l'exonération de tout droit de douane ou impôt de toute nature sur les aéronefs, leurs équipements ainsi que sur les carburants. Compte tenu de leur date de signature, ces accords ne disposent pas encore de clauses environnementales. Celles-ci sont actuellement en préparation à l'OACI.
L'accord aérien avec l'Éthiopie précise qu'en cas de force majeure -conflit armé, catastrophe naturelle, troubles politiques - et d'impossibilité d'exploiter un service sur l'itinéraire normal, la partie concernée doit s'efforcer de faciliter l'exploitation continue au moyen de réarrangements appropriés des routes aériennes. Cette disposition s'explique par l'environnement géopolitique complexe de ce pays - Érythrée, Somalie, Soudan du Sud.
L'Éthiopie peut autoriser des compagnies aériennes africaines non éthiopiennes, établies sur le territoire d'un État partie à la décision de Yamoussoukro, à opérer sur la liaison Addis-Abeba - Paris. La décision de Yamoussoukro, entrée en vigueur en 2000, vise à constituer un espace et un marché aérien unifié et libéralisé en Afrique, les signataires de cette décision s'engageant à abolir les restrictions en matière de droits de trafic entre eux. Cette disposition est néanmoins assortie d'une restriction, puisque le pays africain où est établie la compagnie en question doit avoir signé un accord sur les services aériens avec la France et ne pas avoir refusé antérieurement des droits de trafic à des compagnies françaises. Une forme de réciprocité est ainsi maintenue.
Le Mozambique, autre pays potentiellement concerné, n'a pas exprimé de volonté d'introduire cette clause dans l'accord bilatéral que nous examinons.
Les accords avec le Costa Rica et le Mozambique ne présentent donc aucune spécificité notable.
Ces accords s'inscrivent dans des relations bilatérales de nature différente. La densification du dialogue franco-éthiopien, ces dernières années, reflète la volonté politique de renforcer les liens existants avec cet État, siège de l'Union africaine, qui connaît une croissance soutenue. Les échanges commerciaux bilatéraux sont en expansion, sauf pour l'année 2018, et c'est avec l'Éthiopie que la France a le deuxième excédent commercial le plus élevé en Afrique subsaharienne : 580 millions d'euros en 2018.
Le Costa Rica, quant à lui, connaît une relative prospérité économique, avec une croissance moyenne de 3 % sur les dix dernières années et, bien que les flux demeurent modestes, il est le premier partenaire commercial de la France et de l'Union européenne en Amérique centrale. Il s'agit d'un pays au fort potentiel touristique : 70 000 Français s'y sont rendus en 2018 !
Au Mozambique, la situation économique est plus fragile, l'endettement public est élevé - 113 % du PIB en 2018 - et la balance des transactions courantes est fortement déficitaire. La croissance, en baisse, se situe autour de 3 %. Néanmoins, on estime que de belles perspectives devraient s'offrir à moyen terme, à partir des années 2023-2024. Sur le plan intérieur, le Mozambique connaît une relative stabilité après une guerre civile entre 1976 et 1992 et la signature de trois accords de paix et de réconciliation successifs en 1992, 2014 et août 2019. La France entretient avec ce pays une relation de voisinage ancienne dans l'océan indien, en raison de la proximité des départements de Mayotte et de la Réunion et de la zone économique exclusive française entourant les îles Éparses dans le canal du Mozambique.
La situation des liaisons aériennes reflète l'état de ces relations.
S'agissant de l'Éthiopie, un vol quotidien est assuré entre Addis-Abeba et Paris, opéré par la compagnie Ethiopian Airlines, aucun vol n'étant actuellement opéré en direct par Air France. En juillet 2019, une nouvelle ligne Marseille - Addis-Abeba, desservie par Ethiopian Airlines, a été inaugurée. Le trafic aérien est en très forte croissance avec un doublement du trafic direct en l'espace de cinq années. On a atteint les 160 000 passagers sur la liaison directe Addis-Abeba - Paris au cours des dix premiers mois de l'année 2018. Un renforcement de la compagnie aérienne éthiopienne répondrait à nos intérêts, puisque celle-ci a développé des partenariats avec les entreprises françaises Airbus, ADP et Air France. L'accord aérien bilatéral définit l'exploitation commerciale sur la route aérienne entre Paris et Addis-Abeba uniquement.
Pour le Costa Rica, une liaison directe est assurée par Air France entre Paris et San Jose à raison de trois vols par semaine. Le nombre de passagers transportés par la compagnie française est en forte augmentation : + 59 % entre 2017 et 2018. Le trafic direct sur la liaison Paris - San Jose a atteint 70 000 passagers au cours des dix premiers mois de l'année 2018, du fait d'une fréquence accrue et d'une exploitation continue des vols, toute l'année. Une forte proportion des passagers français - entre 54 000 et 69 000 passagers par an - effectue encore un vol indirect, via des compagnies espagnoles et américaines. Compte tenu de l'importance du secteur touristique et du nombre de passagers français voyageant sur des compagnies étrangères, il reste de la marge pour développer les vols directs entre les deux pays, ce qui devrait profiter à Air France, aucun transporteur du Costa Rica ne desservant la France. Les routes négociées concernent les liaisons aériennes entre tout point en France et tout point au Costa Rica.
Il n'existe actuellement aucun vol direct entre la France et le Mozambique, les liaisons aériennes ayant été suspendues depuis 1999. Le trafic indirect entre la France et le Mozambique est réduit ; il est estimé à 8 000 passagers transitant par l'Afrique du Sud, le Portugal, l'Éthiopie et le Qatar, sur des compagnies de ces pays. L'accord bilatéral prévoit la possibilité de vols depuis tout point de la métropole vers trois villes mozambicaines et depuis tout point du Mozambique vers trois points métropolitains. Il autorise par ailleurs des liaisons régionales entre tout point du Mozambique et tout point des départements français de La Réunion et Mayotte.
En conclusion, je recommande l'adoption de ces trois accords. La procédure de ratification éthiopienne est achevée depuis le début de l'année 2019. La partie mozambicaine a également achevé les procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord en novembre 2017. Au Costa Rica, en revanche, la procédure de ratification est toujours en cours.
L'examen en séance publique est prévu le 30 janvier 2020 selon la procédure simplifiée, ce à quoi je souscris.
Suivant l'avis du rapporteur, la commission adopte à l'unanimité le rapport ainsi que le projet de loi précité.
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du tchad relatif aux services aériens et de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république d'angola relatif aux services aériens
Examen du rapport et du texte de la commission

Nous changeons de région et nous passons aux accords aériens avec le Tchad et l'Angola, signés en 2018.
Le transport aérien entre la France et le Tchad est régi par un accord de 1963, aujourd'hui obsolète. Entre la France et l'Angola, il n'est régi par aucun accord.
Les deux accords que nous examinons sont très proches et reprennent pour l'essentiel le modèle de l'OACI, à laquelle La France, le Tchad et l'Angola sont tous trois parties.
Comme les accords précédents, ils ouvrent la possibilité d'exploiter, respectivement avec chacun des pays concernés, les quatre premières libertés de l'air précitées, en excluant également le droit de cabotage.
Ces deux accords sont conformes à la réglementation européenne, au règlement de 2004 et aux arrêts dits « de ciel ouvert ». Ils contiennent d'autres clauses également classiques, comme le principe d'égalité de traitement entre compagnies, la liberté pour une compagnie d'établir des agences commerciales sur le territoire de l'autre partie, la liberté de procéder à des transferts internationaux de recettes et la liberté de fixation des tarifs par les transporteurs. Ils incluent également des dispositions plus récentes du droit international et du droit européen relatives à la sécurité des vols : chaque partie peut demander des consultations au sujet des normes de sécurités adoptées par l'autre partie, une autorisation peut être suspendue ou révoquée en cas de non-respect des normes minimales et tout aéronef peut être soumis à une inspection au sol de la part de l'autre partie. L'obligation mutuelle de garantir la sûreté de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite, conformément aux droits et obligations résultant du droit international, est également mentionnée.
Comme les deux précédents accords, des exemptions de droits de nature fiscale et douanière figurant dans le Code général des impôts sont prévues, sur la base de la réciprocité. Ces exemptions n'impliquent aucun changement de législation.
L'accord avec le Tchad présente trois spécificités que l'on ne retrouve pas dans l'accord avec l'Angola qui, quant à lui, ne présente aucune clause particulière. D'abord, il précise que les revenus d'exploitation ne sont imposables que dans la partie où se trouve le siège social, afin d'éviter à Air France la double imposition sur le résultat d'exploitation de sa liaison entre Paris et N'Djamena. Ensuite, la définition de points intermédiaires dans le tableau des routes est, à la demande du Tchad, reportée à une date ultérieure, ce qui est sans conséquence à ce stade sur les opérations du pavillon français. Enfin, l'accord comporte un volet environnemental - facultatif dans ce type d'accord - rappelant la nécessité de favoriser un développement durable de l'aviation civile.
Le Tchad est, comme chacun ici le sait, un pays affecté de fragilités structurelles et un partenaire important de la France dans la lutte contre le terrorisme. Depuis l'été 2014, l'état-major de l'opération Barkhane est installé à N'Djamena et la France apporte un appui à la restructuration de l'armée tchadienne. La France est aussi l'un des premiers partenaires économiques du Tchad, avec environ 80 millions d'euros d'exportations françaises en 2018. Par ailleurs, la France apporte également à ce pays une aide budgétaire dans le cadre du programme du Fonds monétaire international et une aide via le Fonds d'urgence humanitaire, et les engagements de l'Agence française de développement (AFD) au Tchad se sont élevés à 77 millions d'euros en 2018 et 88 millions d'euros en 2019.
Actuellement, Air France est l'unique opérateur entre la France et le Tchad avec, depuis le printemps 2018, quatre vols directs par semaine entre Paris et N'Djamena. Depuis 2014, le trafic direct est en baisse de 24 %, avec 38 000 passagers transportés en 2018, tandis que le trafic indirect, via un pays tiers, a atteint les 8 000 passagers cette même année. La majorité des passagers transitent par le Maroc, avec la Royal Air Maroc, la Turquie, avec la Turkish Airlines et l'Éthiopie, par l'Ethiopian Airlines. Le recul d'Air France s'explique par le développement du terrorisme - une grande partie du Tchad est en zone rouge - ainsi que par la concurrence des compagnies que je viens de citer. Côté tchadien, le Gouvernement a relancé, en octobre 2018, une compagnie nationale, Tchadia Airlines, dans le cadre d'un partenariat avec Ethiopian Airlines, qui n'exploite que des avions régionaux pour des liaisons domestiques ou vers des pays voisins. À ce stade, le lancement de vols vers la France paraît peu probable, même si les compagnies aériennes enregistrées au Tchad ne figurent pas sur la liste noire des transporteurs interdits dans l'Union européenne.
Quant à l'Angola, il a le quatrième PIB d'Afrique subsaharienne. Il occupe une place importante dans le monde lusophone et joue un rôle croissant au sein des instances régionales et internationales, notamment sur le continent africain. La présence française, modeste, y est ancienne, et la coopération commerciale est dynamique, grâce à la présence de 70 entreprises françaises. L'Angola est notre septième partenaire dans la zone Afrique et océan indien, et nous sommes l'un des quinze premiers partenaires de l'Angola en 2018. Les échanges commerciaux bilatéraux, largement dominés par les hydrocarbures, restent cependant modestes : 776 000 euros en 2018.
Comme au Tchad, Air France est actuellement l'unique opérateur entre la France et l'Angola. Il exploite la desserte directe entre Paris et Luanda avec trois vols par semaine actuellement. Depuis 2014, le trafic direct est en hausse de 12 %, avec 58 000 passagers transportés en 2018. Le trafic indirect, via un pays tiers, s'élève à 15 000 passagers en 2017, flux qui a toutefois diminué de 38 % depuis 2013. La majorité des passagers transitent par un pays européen : le Portugal, avec la TAP Air Portugal, les Pays-Bas avec KLM, la Belgique, avec Brussel Airlines, et l'Allemagne, avec la Lufthansa. La crise pétrolière mondiale a entraîné une baisse de la demande et le retrait du marché de British Airways en juin 2018 et d'Iberia en juin 2016. Le principal opérateur angolais, la compagnie TAAG, exploite un réseau domestique et international. Sur le continent européen, pour l'instant, seul le Portugal est desservi. Par ailleurs, toutes les compagnies aériennes de l'Angola figurent sur la liste noire de l'Union européenne.
En conclusion, je recommande l'adoption de ces accords. Ces accords sont toujours en cours de ratification au Tchad comme en Angola.
L'examen en séance publique est prévu le jeudi 30 janvier 2020 selon la procédure simplifiée, ce à quoi je souscris.
Suivant l'avis du rapporteur, la commission adopte le rapport ainsi que le projet de loi précité, M. Alain Cazabonne et le groupe CRCE s'abstenant.

La commission nomme rapporteurs :
- M. Jean-Noël Guérini sur le projet de loi n° 222 (2019-2020) autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française, la région flamande et la région wallonne relative à l'aménagement de la Lys mitoyenne entre Deûlémont en France et Menin en Belgique ;
- M. Jean-Marie Bockel sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Turkménistan sur l'octroi de l'autorisation d'exercer une activité professionnelle aux membres de la famille des agents des représentations diplomatiques ou des postes consulaires et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique sur l'emploi des personnes à charge des agents officiels (sous réserve de son dépôt).

La prochaine conférence interparlementaire sur la politique étrangère et de sécurité commune et la politique de sécurité et de défense commune aura lieu du 2 au 4 mars prochains à Zagreb. Comme d'habitude, notre délégation sera présidée par notre collègue Joël Guerriau et sera constituée également de nos collègues Ronan Le Gleut et Hélène Conway-Mouret, qui travaillent sur la défense européenne. C'est sous la présidence croate que va se négocier le cadre financier pluriannuel et en particulier les crédits du fond européen de défense. À ce sujet, j'ai une vive inquiétude : alors qu'on commençait à imaginer une industrie de défense européenne, la présidence finlandaise a fait une proposition à 6 milliards d'euros pour le fonds européen de défense, contre 13 milliards prévus par la précédente Commission européenne. C'est une ligne rouge absolue pour la France, d'autant que les sommes économisées, réputées devoir être consacrées à la politique agricole commune, ne profiteraient pas à la France, n'étant pas sur le bon « pilier » de la PAC. Le Gouvernement est alerté, mais je demande à nos rapporteurs d'être particulièrement vigilants sur le sujet, en concertation avec la commission des affaires européennes. Je parlerai ce soir à Mme Parly de ce coup de poignard dans le dos.

Votre audition est la première d'un cycle consacré à un état des lieux, aussi complet que possible, de l'opération Barkhane. Ce cycle nous conduira à entendre à la fois des représentants de l'état-major des armées - et en particulier le général Lecointre - et les ministres de la défense et des affaires étrangères, mais aussi, afin d'ouvrir la réflexion, des chercheurs, dont certains peuvent avoir une vision plus critique de cette opération, comme on le voit dans la presse. Il nous semble en effet important que la représentation nationale puisse aller au fond des choses et ainsi appréhender précisément toute la complexité de la situation.
Le fil conducteur de ce cycle d'audition sera une triple interrogation.
D'abord, quelles sont nos options stratégiques ? Le Président de la République a annoncé à Pau la création d'une coalition Sahel devant permettre à la fois une synergie des forces déjà présentes sur le terrain, un appui international, et notamment européen, plus marqué, avec notamment les forces spéciales, et un redéploiement pour concentrer les efforts sur les régions frontalières clefs. Que peut-on attendre d'un tel sursaut stratégique, sachant que l'allié américain, qui nous apportait un soutien précieux sur le plan logistique et par ses drones, semble de son côté sur le point de réduire sa présence ? En complément de cette internationalisation, ne faudrait-il pas aussi accorder plus d'importance à la dimension locale de l'ennemi que nous combattons ?
En second lieu, si la crédibilité opérationnelle de Barkhane n'est plus à démontrer et si elle peut faire état de nombreux succès tactiques, il est clair que seule une solution politique peut tarir la source du problème. La clef de l'avenir du Sahel est entre les mains des gouvernements du Mali, du Burkina Faso, du Niger ou encore du Tchad, ainsi que des autres acteurs politiques de la région, dont l'Algérie. Vient alors immédiatement la question qui fâche : quels progrès ont été effectués dans ce domaine ? J'irai plus loin : n'y a-t-il pas de la part de ces acteurs une forme de préférence pour le statu quo, et pour que la France continue à jouer son rôle, quitte à l'insulter, comme nous l'avons constaté ici même récemment ? Le cas échéant, que faire pour les inciter à bouger ou pour rendre ce statu quo moins confortable ?
Enfin, les militaires insistent eux-mêmes depuis des années sur le rôle clef du développement pour stabiliser la région. Pour autant, la formule d'un processus de développement dont le tempo serait coordonné avec les avancées militaires et diplomatiques n'a pas encore été découverte. Faut-il changer de logiciel, ou bien ces efforts finiront-ils par aboutir ? Nous aurons bientôt un débat sur la loi relative à la coopération et au développement, et notamment sur le rôle de l'AFD, que certains critiquent.
Général d'armée (2S) Didier Castres, ancien sous-chef opérations à l `état-major des armées. - Merci pour votre invitation. J'en suis honoré, et éprouve beaucoup de plaisir à être aujourd'hui parmi vous, à un double titre. D'abord, parce que l'opération Serval est probablement unique en son genre, au moins depuis une cinquantaine d'années, tant par les risques pris, les défis logistiques à surmonter, que par sa vitesse d'exécution et les résultats obtenus. Ensuite, parce qu'après les deux années pendant lesquelles j'ai été chef du Centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) et les cinq années où j'ai été sous-chef d'état-major opérations, j'ai muri quelques réflexions sur la gestion de crise en général et en m'appuyant également sur ce que j'ai vu au Sahel, que je souhaite partager avec vous.
Je répondrai bien évidemment à toutes vos questions, avec trois précautions oratoires. La première est que je suis moins au fait de la situation que je ne l'étais entre 2012 et 2016. Il est toujours dramatique de quitter des fonctions où l'on se croyait indispensable, et de constater que le monde continue à tourner sans vous... !
Nous partageons tous ce sentiment !
Général Didier Castres. - Je ne pourrai donc pas toujours répondre à vos questions avec toute la précision que j'aurais souhaitée.
Deuxièmement, dans les interrogations que vous pouvez avoir sur l'évolution de la situation, je porte probablement une part de responsabilité, que j'assume, au titre des décisions que j'ai prises ou que je n'ai pas prises lorsque j'étais en fonction. Enfin, pour connaître la complexité de cette crise et pour avoir été en mon temps parfois violemment critiqué pour les décisions que je prenais, je prendrai garde de ne pas avoir un jugement trop tranché sur la stratégie actuellement mise en oeuvre ; d'autant que ceux qui tentent aujourd'hui d'apporter une solution à la crise sahélienne en ont hérité et ne l'ont pas choisie.
Pour en revenir de façon générale à la gestion de crise, je souhaite évoquer ce que j'ai baptisé les cinq péchés capitaux dont nous devons nous prémunir dès lors que nous décidons de nous atteler à la résolution d'une crise. Et quand je dis « nous », il s'agit d'un nous collectif incluant toutes les administrations, toutes les corporations au niveau national et international.
Le premier de ces péchés capitaux, c'est le syndrome du prêt-à-porter, qui consiste à plaquer sur les crises, quelles qu'elles soient, où qu'elles surviennent et qui qu'elles concernent, des solutions toutes faites, le plus souvent importées de crises passées, qu'elles aient été d'ailleurs résolues ou non par ce truchement. Nous avons tendance à vouloir agir en Libye comme en Somalie, en Centrafrique comme au Mali, au Yémen comme en Irak. Cela revient à accréditer l'idée selon laquelle les crises seraient des modèles mathématiques quasiment orthonormés. Or, les crises sont des organismes vivants, chacune à un biotope différent, chacune puise ses racines dans une histoire qui lui est propre. Nous devons donc nous garder de leur appliquer du prêt-à-penser idéologique et diplomatique : intervention de la force armée pour arrêter ou limiter les combats, départ du prétendu dictateur, élections démocratiques, mission de formation des forces de défense et de sécurité par l'Union européenne, déploiement d'une mission des Nations Unies, saupoudrage d'un peu d'aide au développement, et séminaires des bailleurs pour solde de tout compte....
En fait, faire du sur-mesure suppose que nous prenions le temps de comprendre la crise et de l'apprendre dans sa complexité historique, politique et sociétale avant de chercher à lui appliquer un protocole médical importé, qui est d'ailleurs souvent une pax alba, ou paix des Blancs, c'est-à-dire une simple transposition de nos propres modèles.
Quelle compréhension avais-je de l'histoire du Mali, de son organisation économique, ethnique, sociale, de l'histoire des peuples qui y vivent, quand nous avons déclenché l'opération ? Que savais-je des Daoussaks, des Peuls, des Idnanes et des Chamananas ? Rien : j'ai appris tout cela en marchant. Frédéric le Grand disait que la connaissance du pays où l'on doit mener sa guerre est la base de toute stratégie. Or, sous l'effet des réductions d'effectifs, des carrières alternées, nous avons perdu cette expertise, et les administrations peinent, ou rechignent, à aller la chercher là où elle est, c'est-à-dire chez les universitaires, les chercheurs, dans les think tanks et les ONG.
Notre deuxième erreur est une sorte de fascination militaro-sécuritaire, qui nous conduit à n'observer une crise et à ne mesurer son évolution que l'oeil rivé sur le microscope de l'action militaire. Or, si le recours à la force armée permet de rééquilibrer les rapports de forces, de limiter l'acmé d'une crise, d'interrompre des combats, d'en affaiblir les protagonistes, elle ne permet jamais de résoudre une crise. Les embrasements de violence ne sont jamais la cause des crises mais leur conséquence. Il faut donc agir sur tous les leviers qui sont à l'origine et qui alimentent ces crises, sans se laisser obséder par l'unique action militaire, et sans juger de l'évolution de la crise sur la base des seuls indicateurs opérationnels, toujours insuffisants et parcellaires, que sont les fameux metrics à l'américaine. Que tirons-nous comme conclusion, par exemple, du fait que la coalition anti Daech ait largué 100 000 bombes depuis 2013, c'est-à-dire 25 000 tonnes, soit plus de six fois le volume de bombes déversées sur Dresde en février 1945 ? Quelles conclusions tirons-nous du fait que Barkhane ait éliminé 700 terroristes depuis 2015 ? Aucune. Ces critères exclusivement militaires ne sont pas suffisants. En réalité, le début de la gestion de crise commence après l'action militaire initiale. Or, la plupart du temps, nous avons tous, journalistes, diplomates, politiques, opinion publique les yeux rivés sur cette action initiale et nous nous désintéressons de la suite.
Le troisième péché est celui de ne pas connaître, dans la grammaire des crises, la règle de « l'inconcordance des temps ». Le temps de la résolution des crises diffère du temps médiatique, du temps militaire, du temps politique, du temps diplomatique et du temps du développement. Souvent, nous prenons insuffisamment en compte les délais qu'exige la résolution d'une crise, dès lors que les populations concernées s'y entredéchirent. Ce temps ne se mesure ni avec un chronomètre, ni avec un sablier, ni même avec un calendrier des saisons mais presqu'à coups de décades, et souvent pour des résultats mitigés : plus de vingt ans au Kosovo, dix-sept ans pour l'Irak, dix-neuf ans pour l'Afghanistan, et déjà sept ans au Sahel. Ces durées sont aussi à traduire en mandats présidentiels : un président qui décide d'intervenir dans une crise en transmettra la gestion à son successeur.
À titre d'exemple supplémentaire, qui doit nous inciter à la patience, à la prudence et à la constance stratégique, je garde toujours à l'esprit la date du premier attentat revendiqué par Al-Qaeda : c'était en décembre 1992, au Movenpick Hotel d'Aden, au Yémen. Vingt-sept ans plus tard, Al-Qaeda se porte, hélas, toujours bien ! Le temps n'est donc pas compressible, et la cicatrisation des plaies qui ont déchiré les populations entre elles est lente. Quand nous nous engageons dans la résolution d'une crise, nous devons d'emblée intégrer la dimension temps et élaborer une stratégie de moyen ou long terme, résiliente sur les plans financier et capacitaire.
Le quatrième péché capital est de considérer les crises que l'on voit émerger un peu partout dans le monde, et singulièrement celles liées à la question de l'extrémisme violent, comme des phénomènes cloisonnés géographiquement - Libye, Sahel, Asie, Levant - et de penser qu'en les résolvant successivement, nous apporterons une solution à la crise globale. C'est là aussi une forme de sophisme ou d'autisme, car chaque crise interagit sur l'autre. Le centre de gravité de chaque crise est susceptible de migrer géographiquement dans l'espace physique ou immatériel et de muter génétiquement, chaque cellule étant en contact avec les autres. Il n'est d'ailleurs pas improbable que des chefs, des combattants et des technologies en provenance du Proche-Orient aient rallié le Sahel en transitant par la Libye. Nous ne devons donc pas considérer ces phénomènes comme une somme de crises mais bien comme un système de crises. Et donc, il faut tenter d'y apporter une réponse systémique, globale et englobante. Au risque, le cas échéant, de se lancer dans une interminable partie de cache-cache avec nos adversaires ou encore de se retrouver brutalement face à un phénomène qui serait devenu hors de portée.
Le cinquième et dernier des péchés capitaux que nous avons tendance à commettre est d'agir le plus souvent sous le coup de l'émotion, sous la pression des médias et de l'opinion publique et dans la précipitation, dans une forme de dérationalisation des décisions politiques - de préférer apporter à une crise une réponse médiatique plus qu'un effet stratégique... L'exemple à la fois le plus triste et le plus caricatural est celui incarné, en 2015 par cet enfant syrien, le petit Ilhan, retrouvé mort noyé, échoué sur une plage. Nous avons créé, dans l'émotion la plus forte et quasiment le jour même, une opération maritime européenne, l'opération Sophia. Mais au drame que vivent ces migrants, nous avons répondu par la formation des garde-côtes libyens et, un an plus tard, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés recensait 5 000 migrants noyés dans la Méditerranée. Nous faisons rarement de bons choix avec un oeil rivé sur les horreurs diffusées par les chaînes d'information permanentes et l'autre sur les sondages de popularité.
Bref, nous devons être lucides et réalistes sur nos capacités de toute nature à agir sur une crise et en infléchir l'issue. En Afghanistan, nous pesions 2,5 % de la coalition. En Syrie et en Irak, 2,5 % des frappes. Parfois, faute de pouvoir atteindre l'idéal, il faut savoir se contenter d'éviter le pire. Nous devons faire preuve de plus de pragmatisme dans les objectifs que nous nous fixons. Nous avons parfois tendance à croire que tout pays dans lequel nous intervenons a vocation à se transformer en un canton suisse, sous notre impulsion... Par ailleurs, il nous faut montrer de la constance et de la patience stratégique pour que nos plans produisent leurs effets. Enfin, nous devons développer une forme de résilience nationale pour en supporter l'effort. Tout cela pose la question, évoquée autrefois par M. Védrine, de savoir si diplomatie et stratégie sont encore compatibles avec nos démocraties d'opinions.
Merci pour ces propos décapants !

Qui suscitent maintes questions... Il y a exactement sept ans que Serval a été déclenchée. La question est toujours de savoir quand intervenir, et quand se retirer. Ne sommes-nous pas arrivés trop tard ? Les Touaregs avaient déjà investi depuis un an l'Azawad et le nord du Mali était déjà en difficulté. De même, il ne faudrait pas tarder à repartir. En tous cas, le temps est une donnée cruciale. Après quelques années, on a parfois l'impression de tourner en rond. Quelles sont les capacités locales à se prendre en charge ?

Voilà quelques années que nous sommes présents dans la bande sahélo-saharienne, où les attaques se multiplient, sans que les forces en présence parviennent à enrayer l'aggravation rapide de la situation. En 2019, il y a eu 499 attentats au Burkina Faso, contre 150 l'année précédente, et 118 au Niger contre 60 en 2018. Les autorités locales sont jugées incompétentes et corrompues, et les populations s'organisent en milices armées pour assurer leur propre sécurité. N'y a-t-il pas un risque que les conflits interethniques viennent encore aggraver la situation ?

Le Président de la République a annoncé à Pau la création d'une force européenne qui sera liée à l'opération Barkhane. Quels seront ses effectifs ? Quels pays y participeront ? S'agit-il surtout d'un soutien logistique ? Ne faut-il pas reprendre le dialogue avec les États du nord, et notamment l'Algérie, qui est une vraie puissance militaire et pèse dans les jeux d'influence régionaux ?

Le problème n'est certes pas militaire, au Sahel, mais politique. Il faudra que nous en débattions un jour, monsieur le président : faut-il rester, ou partir - et si oui, quand ? Le général Lecointre affirme que ce genre de crise appelle une intervention conventionnelle ; le général de Saint-Quentin, lui, considère qu'elle requiert l'intervention des forces spéciales. Il faut les deux, sans doute, notamment pour tenir sur le long terme. J'ai aimé vos propos sur le temps, et votre modestie sur les résultats, qui sont ambigus, en effet. En particulier, les communiqués réguliers du ministère sur les éliminations - 700 en tout depuis six ans, je crois - me gênent. Car depuis six ans, le terrorisme, qui était concentré au Mali, s'est étendu au Niger et au Burkina Faso. Il n'y a pas de fin, et il faudra une réponse politique. Alors, stratégie Lecointre ou stratégie Saint-Quentin ?

Merci pour vos propos si justes. L'effondrement de l'armée malienne a été analysé par des militaires français, mais leurs conclusions n'ont pas été appliquées, et nous n'avons pas su la réorganiser. Nous investissons beaucoup pour former leurs troupes. Il est vrai que l'attrition est élevée. On a l'impression d'avancer en reculant. Que faire ? C'est bien à l'armée malienne qu'il incombera, un jour, d'assurer la sécurité.

Le nombre de victimes dans les armées sahéliennes, à chaque attentat, me surprend et m'effraie : jusqu'à 80 morts !

Quelles sont les conséquences, pour nous, du progressif retrait américain ? Depuis le 1er janvier, nos drones sont armés. Quel avantage cela nous donne-t-il ? Cet avantage suffit-il pour se passer du soutien américain ?

J'ai hésité à vous applaudir, tant j'ai apprécié vos positions et vos analyses. Nous envoyons 200 militaires en renfort alors que, depuis six ans, la situation ne fait qu'empirer, même à Bamako. Les effectifs sont-ils suffisants ? Vous avez raison : nous avons tendance à imposer nos solutions. Je l'ai vu en Libye, il y a deux ans, quand M. le Drian voulait à tout prix organiser des élections, alors que le pays était détruit.

Voilà soixante ans que nous formons les armées de ces pays. Nous y avons même créé des académies militaires. Le résultat n'est guère satisfaisant, et on a du mal à imaginer que, d'un coup, vont apparaître des armées nationales fortes et efficaces - sans parler des manifestations nationales qui nous sont hostiles. Que se passerait-il si nous nous retirions ? Tout s'effondrerait, et cette bande de Sahara deviendrait une zone de non-droit, ouverte à tous les trafics.

Un professeur nous parlait hier, à propos de Lubrizol, des risques industriels, d'une manière qui converge avec vos propos, notamment sur l'éducation des futures générations. Comment faire le bilan d'une opération extérieure ? Selon quels critères ? L'opération Barkhane peut-elle être un succès alors même que notre intervention au Mali serait, globalement, un échec ? Le général Lecointre se félicitait de la concentration des efforts sur les opérations militaires et du travail de l'AFD. La concentration des forces, nécessaire pour être efficace, conduit à la dispersion sur un territoire très vaste. Plutôt que d'augmenter le nombre de soldats, pourquoi ne pas augmenter le personnel chargé d'actions de développement ?

Merci pour votre humilité, qui est une qualité de plus en plus rare. Nous disons depuis longtemps que les opérations militaires doivent avoir pour corollaire une aide publique au développement renforcée, voire que cette aide devrait précéder les opérations. Le président Cambon nous a annoncé que la Finlande proposait de diviser le Fonds européen de défense par deux. Nous subissons dans le Sahel des opérations de déstabilisation pilotées par les Russes qui, en même temps, nous disent qu'ils sont prêts à nous aider. Ne devrions-nous pas développer une action conjointe avec eux ? Nous sommes très seuls... Vous savez que je siège à l'OTAN, donc je ne suis pas russophile !

L'enjeu est politique, en effet. Nous restons pour éviter le pire. Pour sortir par le haut, il faut améliorer la gouvernance locale. Je connais bien le Mali, pour lequel j'ai une grande sympathie, d'autant qu'il a longtemps symbolisé, pour nous, un espoir, une capacité à s'en sortir, voire même une bonne gouvernance - mais tout cela est déjà loin. Pouvons-nous contribuer à régler cette question de la bonne gouvernance, qui est prioritaire par rapport aux enjeux démocratiques ?

J'ai l'impression que l'histoire se répète, car j'ai relu récemment une histoire de la guerre du Vietnam. Kennedy, en envoyant ses conseillers militaires, déclarait qu'il fallait être conscient que la guerre ne serait gagnée que par les Vietnamiens eux-mêmes. Vous avez parlé d'une réponse système. De quoi s'agit-il ?

Merci pour votre intervention, plus politique et même philosophique que militaire. La responsabilité est celle des politiques, en effet. Vont-ils enfin se montrer capables de résister à la dictature de l'émotion et du court terme pour s'attacher à la raison et au long terme ? Après l'Irak, le Kosovo, l'Afghanistan, nous allons de nouveau remettre le couvert. Vous dites que la solution ne peut être que politique. Je pense qu'elle sera avant tout économique, sociale, éducative. Ne devrions-nous pas doubler notre intervention militaire d'un effort considérable en ce sens ?

J'ai assisté à une réunion de l'Union interparlementaire où le président du Niger a expliqué avec virulence que, si la lutte contre le terrorisme passait par la force armée - merci la France - celle-ci n'était pas suffisante. Il affirmait que seuls le Niger et le Tchad faisaient ce qu'il fallait, et que les autres pays étaient à la traîne. Si nous ne progressons pas militairement, disait-il, tout peut s'écrouler dans trois mois. Ce danger est-il réel ? Les Chinois, prudents, n'ont pas pris position. Les Européens n'ont guère manifesté d'enthousiasme. Et le président nigérien de rappeler que, si la France arrête, tous ces pays tomberont...

Moi qui ai toujours la passion du rééquilibrage des relations nord-sud, il m'arrive aussi de comparer l'Afrique de l'Ouest et les anciennes colonies françaises à l'Afrique de l'Est. Les Britanniques s'en sont-ils mieux sortis que nous ?

Les États-Unis viennent de confirmer qu'ils envisagent de réduire leur présence en Afrique. Les Britanniques ont également fait savoir à plusieurs reprises qu'ils envisageaient de réduire leur participation à l'opération Barkhane. L'armée française peut-elle tenir plus ou moins seule pendant des années ? Pourquoi les pays européens ne s'engagent-ils pas sérieusement dans le Sahel ?

Je vous remercie pour votre intervention. Vous avez énoncé un certain nombre d'écueils. Pourriez-vous indiquer le placement de ces différents curseurs pour l'opération Barkhane ?

Je vous remercie également pour votre intervention. L'envoi de 200 hommes pour renforcer la force militaire française au Mali a été annoncé cette semaine. Alors que les mouvements anti-français se multiplient, comment cette nouvelle est-elle perçue sur place ? Quelles avancées sont à prévoir d'ici à l'été ?

Je rappelle aux représentants du ministère et aux collaborateurs des sénateurs qu'ils sont tenus aux mêmes règles de confidentialité que les sénateurs.
Général Didier Castres. - la plupart des questions que vous me posez sont, en partie, de nature politique ; ce qui risque de me faire sortir de mon seul avis de praticien.
Pour commencer, je pourrai résumer une partie de vos questions par celle-là : « si nous savons bien comment nous impliquer dans la résolution d'une crise, comment fait-on pour s'en désengager ? ». Pour prendre une image un peu simpliste, je dirai qu'une crise est comme une autoroute : une fois que nous l'avons empruntée, nous ne pouvons la quitter qu'avec des bretelles de sortie. En l'espèce, nous disposions probablement de deux options : la première après avoir conduit les opérations de dislocation d'AQMI dans l'adrar des ifoghas. Nous aurions pu considérer que Bamako et l'État malien n'était plus menacé et nous désengager tout en conservant un dispositif léger de réassurance au profit des forces maliennes et des forces internationales. La deuxième en juillet 2013, après le succès des élections présidentielles. Ce ne sont pas les choix que nous avons faits et désormais, à défaut d'avoir sous les yeux une bretelle évidente, il nous revient de construire une nouvelle bretelle de sortie.
Concernant l'efficacité des armées locales, il est incontestable que nous les formons depuis les indépendances et qu'elles connaissent de très sévères revers, face à des combattants qui, eux, n'ont pas été formés au sens où nous l'entendons. Je crois qu'il y a au moins deux raisons à cela. La première est quasiment historique : après les indépendances, des armées fortes représentaient une menace pour les pouvoirs en place qui donc ne faisaient pas d'efforts vis-à-vis des leurs armées et se contentaient d'une garde prérorienne. La seconde est qu'en l'absence de menaces globales et de guerre à proprement parler, le métier militaire est devenu dans beaucoup de pays, plus une rente de situation qu'une vocation. Le réveil est donc brutal et le retard à combler, important.
Mais ce n'est pas simplement un problème d'équipement comme nous l'entendons souvent, car les gens contre lesquels ils combattent sont équipés avec de l'armement élémentaire et rudimentaire. En revanche, c'est probablement une question de formation. La mission EUTM qui forme les bataillons maliens transpose et impose des modèles européens aux Forces armées maliennes dont je doute qu'ils soient adaptés à la situation locale.
Tout cela ne suffit pourtant pas à expliquer de tels revers. Il y a désormais un problème de confiance de ses soldats dans leurs chefs, dans les dispositifs qu'ils adoptent, dans leurs décisions et dans leur capacité à résister à des assauts de 100 à 200 combattants adverses.
En janvier 2013, lorsque les forces spéciales arrivent à Kona, elles rencontrent une l'arrière-garde d'une armée en débandade qui est en train de se replier vers Bamako. Un jeune capitaine des forces spéciales parvient à rassembler quelques soldats maliens, à les galvaniser et à repartir au combat. Ils arrivent d'ailleurs à bloquer l'avancée des troupes djihadistes jusqu'à l'arrivée de nos avions de chasse. J'atteste qu'ils se sont battus vaillamment. Une des solutions pour rendre les forces maliennes plus efficaces est donc l'accompagnement au combat. C'est, je crois, le projet de la force Takuba.
Mais si nous arrivions à inverser la tendance avec 200 ou 300 forces spéciales européennes, cela ne manquerait pas d'interroger sur l'efficacité des forces françaises. Par ailleurs, je souhaite un plein succès à cette initiative dont d'expérience je sais qu'elle sera longue à mettre en oeuvre. La rendre pleinement opérationnelle d'ici l'été me semble très ambitieux.
Vous m'avez également interrogé sur les conséquences d'un possible retrait du soutien américain. D'évidence, la fin de ce soutien dans les domaines du transport stratégique, du renseignement, du ravitaillement en vol nous conduira à revoir la cadence de nos opérations, leur durée et probablement aussi leurs coûts mais ce ne sera pas la fin de Barkhane pour autant. Nous disposons de nos propres drones, de ravitailleurs et d'A 400.
Mais si tel était le cas, essayons de faire de cette décision un levier pour impliquer nos partenaires européens dans cette lutte contre le terrorisme. Pour des raisons qui tiennent autant de la politique que de l'histoire, les Européens sont toujours réticents à déployer des hommes au sol pour résoudre une crise. En revanche, ils hésitent moins à fournir des capacités de deuxième échelon dès lors qu'elles ne sont pas impliquées directement dans le brouillard du champ de bataille.
Pour en revenir aux armées maliennes, nous ne devons pas écarter l'hypothèse d'un délitement brutal de l'armée malienne, à l'instar de ce qui s'est déjà passé à la fin de l'année 2012 et au début de l'année 2013. Et cet effondrement serait avant tout le résultat d'une perte de confiance des armées en elles-mêmes. Aussi, pour renforcer la combativité et la cohésion de ces forces armées, nous pourrions activer trois leviers. D'abord et cela me paraît capital, les forces armées maliennes doivent remporter une grande victoire sur le terrain, une victoire qu'elles revendiqueront comme la leur, même si Barkhane aura été mis à contribution pour y parvenir. Ensuite, nous devons étudier comment nous pourrions garantir aux unités maliennes isolées de voir arriver très rapidement en cas d'attaque des moyens d'intervention pour casser le momemtum ennemi. Dans le prolongement des annonces du Président de la République à Pau, une coalition européenne regroupant avions de chasse, hélicoptères d'attaque, moyens de renseignement serait probablement un « game changer » au Sahel. Enfin et sans en connaître toutes les difficultés techniques, je me demande si nous ne pourrions pas former des GPS officer comme cela a été fait en Irak et en Syrie et dont le rôle serait de guider l'engagement des avions.
Vous m'avez également posé une question sur les « dites » stratégies « Lecointre » et « Saint-Quentin ». Je suis étonné de cette question. A l'EMA et dans la chaîne des opérations, il n'y a qu'une stratégie : celle du chef d'état-major des armées qui, au titre du code de la défense est le commandant des opérations militaires. Mais, dans cette stratégie unique, les forces spéciales ont évidemment une plus-value incontestable que j'ai constatée sur tous les théâtres d'opérations : légèreté de leur empreinte, polyvalence, réversibilité de leur engagement, capacité d'intégration, système de commandement. Leur force réside dans leur fluidité tandis que celle des forces conventionnelles réside dans leur puissance et leur densité. Mais ces dernières sont plus difficiles à désengager et sont plus prévisibles.
Le surge de 200 hommes annoncé par le Président de la République va-t-il changer la donne ? Je ne crois pas que cette décision s'inscrive dans ce champ-là. Cette annonce a, à mon sens, essentiellement une valeur symbolique et diplomatique plus qu'opérationnelle. Elle manifeste à tous nos partenaires qu'en contrepartie des efforts que nous leur demandons, nous aussi faisons un effort. Pour autant, la conjugaison d'une concentration des efforts de Barkhane, de ceux de la force du G5 et de ce renforcement dans la zone des trois frontières produira des effets.
Et si nous retirions nos forces ? Je discutais de cette option avec un directeur du ministère de l'Europe et des affaires étrangères bien au fait de la situation. Il estimait que la présence de Barkhane et l'action de la France au Mali et plus largement au Sahel était la clé de voute et sous-tendait toute l'action internationale dans la zone. En cas de départ des Français, il prédisait une prise de contrôle rapide du Mali par les djihadistes et une extension de leur mainmise jusqu'aux pays du golfe de Guinée. Ce qui, là-aussi, pose la question de savoir pourquoi nous nous sentons aussi seuls face à de telles perspectives.
J'en viens à la question des Russes. Doit-on les associer à la recherche d'une solution à la crise au Sahel ? Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, l'Union européenne a décidé d'une opération au Tchad et en Centrafrique, EUFOR< Tchad-RCA, pour protéger les réfugiés fuyant les exactions et la famine qu'ils subissaient au Soudan. Le général Bentégeat qui était alors le président du comité militaire de l'Union européenne avait associé des Russes à cette opération. Il vante leur interopérabilité et leur efficacité opérationnelle. Il s'agissait toutefois de soldats réguliers de l'armée russe, et non de mercenaires du groupe Wagner. Dans le champ opérationnel, je ne vois pas ce qui s'opposerait à la participation de soldats de l'armée russe à nos opérations.
Nous avons désormais l'habitude de dire que la solution aux crises repose sur la mise en oeuvre d'une approche globale. Mais nous réduisons souvent cette approche globale au diptyque Sécurité - Développement. Or, je pense que la clé est aussi dans l'amélioration de la gouvernance. Mais est-il possible pour l'ancien colonisateur d'intervenir dans ce domaine au risque d'être accusé de néocolonialisme... ?
A système de crises et non somme de crises, je vous parlais d'une réponse système. Intellectuellement, cette réponse système repose sur 4 actions : cloisonner les zones touchées par l'extrémisme violent pour éviter qu'elles ne se développent et se renforcent en mettant en place des embargos ; soutenir les forces locales régulières ou pas qui ont démontré la volonté de les combattre ; former et accompagner des unités spécialisées dans la lutte contre l'extrémisme violent ; renforcer la protection des intérêts français. Mais cette stratégie n'est plus à la portée d'aucune administration ni d'aucun pays seul, que ce soit sur le plan militaire, financier ou même politique. Toutes ces crises montrent que nous sommes entrés dans la période de l'inter : de l'interministériel, de l'interagence et de l'international. Les stratégies globales nécessitent une coordination, ce qui suppose déjà une perception commune des problèmes. Or je ne suis pas sûr que nous ayons réussi à convaincre nos partenaires européens de la dangerosité de ce qui se passe actuellement au Sahel.
Faut-il croire au G5 Sahel ? Que pensez-vous de la Minusma, qui représente un budget considérable et accuse de lourdes pertes ?
Général Didier Castres. - Dans la précipitation médiatique que j'ai évoquée, nous nous sommes empressés de déclarer opérationnelle la force du G5 Sahel quasiment le jour même de sa naissance... !. Or, ne serait-ce que la professionnalisation de l'armée de terre française a pris dix ou quinze ans. Comment croire que cette force réunissant des contingents de différents pays pourrait être aussi rapidement intégrée. Il y a bien sur l'interopérabilité technique mais elle est finalement la plus facile à mettre en oeuvre. Il y a l'interopérabilité culturelle car chaque soldat combat d'une façon qui est le produit de son histoire nationale. Et c'est ce qui prend le plus de temps. Par ailleurs, sur le plan capacitaire, il est nécessaire d'avoir de la visibilité pour construire un modèle de force, or je ne crois pas que les promesses de fonds aient toutes été honorées et rendues disponibles et encore moins pluri annualisées. Il faut consacrer plus d'efforts et de minutie à cette force du G 5 Sahel. Je crois que les décisions qui ont été prises à Pau - la formation d'une coalition et la concentration des forces dans la région des trois frontières - sont porteuses de progrès dans ce domaine.
S'agissant des Nations Unies, nous faisons de façon récurrente le même constat. Faible efficacité opérationnelle rapportée à son coût et c'est probablement juste. Au fil du temps, les opérations des Nations-Unies soit deviennent un problème en soi, soit deviennent transparentes. À cela deux raisons, une philosophie onusienne qui est le maintien de la paix et donc il faut une paix existante et pas l'imposition de la paix. La deuxième, c'est d'observer quels sont les pays disposant d'armées modernes qui sont contributeurs de troupes aux opérations de maintien de la paix...
Je vous remercie, mon général, pour ces propos directs et éclairants. Si le Président de la République vous convoquait aujourd'hui pour vous demander conseil, que lui diriez-vous ?
Général Didier Castres. - Je lui dirais que beaucoup de choses ont été essayées. Qu'il reste probablement une option qui pourrait inverser la tendance mais qu'elle présente probablement plus de risques pour nos forces : c'est ce que l'on appelle le partenariat militaire opérationnel, en d'autres termes et dans le langage d'autres théâtres, les OMLT (Operational Mentoring Liaison team). C'est un risque opérationnel important, mais cela permettrait d'inverser la donne, du moins la donne psychologique. Je comprends que c'est la direction que nous allons emprunter.
La réunion est close à 11 h 25.