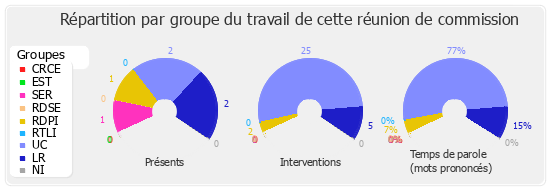Commission d'enquête Concessions autoroutières
Réunion du 9 juillet 2020 à 14h00
Sommaire
- Audition de mme ségolène royal ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie de 2014 à 2016 (voir le dossier)
- Audition de mme ségolène royal ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie de 2014 à 2016 sera publié ultérieurement
- Audition de m. dominique de villepin premier ministre de 2005 à 2007 (voir le dossier)
La réunion

Mes chers collègues, madame la ministre, nous poursuivons nos auditions sur les concessions autoroutières en entendant madame Ségolène Royal, que je ne pense pas avoir besoin de présenter. Je rappelle néanmoins que vous avez été ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie de 2014 à 2016 dans le gouvernement conduit par Manuel Valls, au moment de la négociation du plan de relance autoroutier, le fameux PRA dont nous avons beaucoup entendu parler.
Cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Elle est ouverte à la presse et fera l'objet d'un compte-rendu publié.
Madame la ministre, je vous remercie de vous être rendue à notre convocation. Après vous avoir rappelé qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du code pénal, je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites : « je le jure ».
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, Mme Royal prête serment.
Avant de passer la parole à notre rapporteur, Vincent Delahaye et aux membres de la commission d'enquête présents aujourd'hui, je vous propose de nous présenter à titre liminaire, si vous le souhaitez, quelle était votre vision du secteur autoroutier à l'époque où vous exerciez ces responsabilités.
Je vous remercie de m'avoir invitée à témoigner devant votre commission. Dans un premier temps, je me suis dit que je n'avais pas de nombreux souvenirs des modalités de négociation du protocole d'accord de 2015, car elles avaient été déléguées à ma directrice de cabinet, Élisabeth Borne, et à Alexis Kohler, qui était le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie. Toutefois, avant de venir devant vous, je me suis replongée dans ce dossier passionnant et je voudrais redonner à celui-ci une perspective historique. Cela permettra de bien comprendre quels étaient les enjeux à ce moment-là.
Je voudrais d'abord rendre hommage à Gilles de Robien car c'est lui qui avait proposé, en 2003, d'utiliser l'argent des péages pour financer l'aménagement du réseau routier non concédé et du réseau ferré, via une agence de financement des infrastructures de transports de France, l'AFITF. Il constatait en effet que la dette des autoroutes diminuait et que plusieurs milliards d'euros de dividendes allaient commencer à entrer dans les caisses de l'État au cours des années suivantes. Il avait alors engagé un bras de fer avec le ministère de l'économie et des finances. Je me permets de citer les propos qu'il a tenu devant votre commission d'enquête: « chaque ministre des Finances me reçoit avec, à ses côtés, toujours le même conseiller partisan de la privatisation des autoroutes. On m'expliquait qu'il fallait vendre les autoroutes parce que cela ferait baisser la dette de l'État. Mais j'avais anticipé ce problème et j'avais fait faire une évaluation par une grande banque parisienne et celle-ci concluait que les autoroutes étaient une manne financière pour l'État. C'est comme ça que j'ai pu résister à Bercy ». Le Premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin, avait en effet tranché en sa faveur. Puis, en 2005, le nouveau Premier ministre, Dominique de Villepin, avec le nouveau ministre de l'économie Thierry Breton, opte pour la privatisation.
Gilles Carrez, qui était alors rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, avait alors écrit dans un rapport que « l'État faisait une mauvaise affaire puisque même en percevant 20 milliards d'euros, la privatisation des sociétés concessionnaires d'autoroutes constituait une mauvaise décision du point de vue de l'intérêt général ». Dans un référé de 2009, la Cour des comptes estimait à 24 milliards d'euros la valeur globale des sociétés concessionnaires d'autoroutes privatisées.
Dans un rapport très raide de juillet 2013, la Cour des comptes indique que la négociation des avenants aux contrats de plan est déséquilibrée. L'augmentation des tarifs est supérieure à l'inflation. Les obligations des actionnaires ne sont pas respectées. Elle estime par conséquent qu'il faut impérativement réaliser une contre-expertise et mettre fin à la hausse continue et importante des tarifs.
Puis se succèdent, au cours de l'année 2014, toute une série d'évènements. L'Assemblée nationale et le Sénat, notamment, se saisissent du problème. En novembre 2014 est mise en place une mission d'information conduite par Bertrand Plancher et Jean-Paul Chanteguet à l'Assemblée nationale. Le 4 décembre, une lettre-pétition est signée par 150 députés. Le 17 décembre, un groupe de travail du Sénat est mis en place pour expertiser les recommandations de l'Autorité de la Concurrence, qui dans un rapport de septembre 2014 évoque la rentabilité exceptionnelle des sociétés concessionnaires d'autoroutes, assimilable à une rente.
C'est dans ce contexte que le Premier ministre de l'époque Manuel Valls met en place un groupe de travail parlementaire sur les autoroutes, qui associe huit députés et sept sénateurs de la majorité et de l'opposition. Une première réunion a lieu à Matignon, à la suite de laquelle le Premier ministre charge les deux directeurs de cabinet Élisabeth Borne et Alexis Kohler de conduire les négociations avec les sociétés concessionnaires d'autoroutes, représentées par Bruno Angles.
Jean-Paul Chanteguet participait au départ au groupe de travail mais il se rend vite compte que les négociations se déroulent ailleurs, sans les parlementaires. Il décide alors de démissionner. Il avait plaidé pour la mise en place d'un système de régie intéressée, dans lequel la puissance publique reprendrait la main en maîtrisant les tarifs de péages et en confiant l'exploitation à des acteurs privés mais aux conditions de l'État. Il estimait que depuis la privatisation, en 2017, 27 milliards d'euros de dividendes avaient été distribués aux actionnaires. C'est dans ce contexte houleux que la négociation avec les sociétés concessionnaires d'autoroutes aboutit à la signature, en avril, d'un protocole d'accord.

Mes chers collègues, monsieur le Premier ministre, nous poursuivons nos auditions sur les concessions autoroutières en entendant monsieur Dominique de Villepin, que je n'ai pas besoin de présenter. Je rappelle que vous étiez Premier ministre en 2006, au moment de la privatisation des sociétés concessionnaires d'autoroutes, qui sont au centre des travaux de notre commission d'enquête.
Cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Elle est ouverte à la presse et fera l'objet d'un compte-rendu publié.
Monsieur le Premier ministre, il y a toujours une étape formelle au début de ces auditions. Je vous remercie de vous être rendu à notre convocation. Je rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 43413, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite à prêter serment en levant la main droite et en jurant de dire toute la vérité, rien que la vérité.

Madame la ministre, vous nous avez rappelé des éléments historiques. Nous avons entendu Gilles de Robien, qui nous a expliqué la façon dont il avait résisté à Bercy pour éviter la privatisation des sociétés concessionnaires d'autoroutes puis comment l'opération s'était finalement réalisée sous l'impulsion du Premier ministre du gouvernement suivant, à savoir Dominique de Villepin - que nous auditionnons ce jour également.
Si nous nous intéressons au passé, notre commission d'enquête porte également sur l'avenir, et notamment sur la meilleure façon de rééquilibrer les relations de l'État avec les sociétés concessionnaires d'autoroutes historiques, qui gèrent 90 % du réseau concédé.
Effectivement, le Premier ministre Manuel Valls avait décidé, à la suite de la parution du rapport de l'Autorité de la concurrence et de celui de la Cour des comptes, qui avaient fait couler beaucoup d'encre, de créer un groupe de travail comprenant des députés et des sénateurs. Il me semble, de mémoire, que ce groupe de travail n'avait pas vocation à négocier. Il avait pour objet de fournir le point de vue du Parlement au Premier ministre et au Gouvernement, de façon à orienter, le cas échéant, les décisions qui seraient prises. Je ne crois pas qu'il ait eu pour mandat de négocier directement avec les concessionnaires, ce qui me paraît d'ailleurs normal : il appartient au Gouvernement (et non aux parlementaires) de le faire, avec l'appui de l'administration.
Je le jure.
Vous avez tout à fait raison, les parlementaires n'étaient pas chargés de participer aux négociations. Mais le Premier ministre s'était engagé par écrit à ce qu'ils soient régulièrement informés du contenu de ces négociations. C'est lorsque de premières déclarations ont été faites, affirmant que la marge de manoeuvre de l'État était très étroite, que les parlementaires ont commencé à être assez mécontents, puisqu'ils savaient, par une lettre que leur avait adressée le Premier ministre, que celui-ci n'avait au départ pas totalement écarté une remise en concurrence des concessions autoroutières ou leur résiliation. Or, sitôt la négociation avec les sociétés concessionnaires d'autoroutes engagée, ces deux hypothèses disparaissent car le rapport de force est déséquilibré au détriment de l'État, les sociétés concessionnaires ayant beaucoup plus de moyens que lui pour négocier. La Cour des comptes décrit très bien ce phénomène dans son rapport de 2013.

Vous n'avez pas du tout évoqué le gel des tarifs de péages pour l'année 2015 à l'automne 2014. Élisabeth Borne nous a pourtant indiqué que c'est vous qui l'aviez décidé en tant que ministre. J'étais un peu surpris qu'une telle décision puisse être prise par un ministre, sans accord du Premier ministre ni décision interministérielle. Aviez-vous l'accord du Premier ministre pour prendre cette décision ? Comment ont réagi vos collègues du Gouvernement et le Premier ministre, ainsi que les sociétés concessionnaires d'autoroutes, pour lesquelles une telle décision constituait une violation des contrats de concession ?
Merci infiniment, monsieur le président. Je suis très heureux d'être devant votre commission d'enquête sur un sujet aussi important. Cela permet de dire des choses qui, je crois, n'ont pas été dites. J'en suis très heureux également car il s'agit du Sénat. Comme vous le savez, mon père a été président de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées durant de nombreuses années. Il a démissionné le jour de ma nomination comme ministre des Affaires étrangères.
Il y a quinze ans, mon gouvernement a décidé, sous l'autorité du président de la République, la cession par l'État de ses participations dans les sociétés concessionnaires d'autoroutes qu'il détenait encore. Il vous appartient, dans le cadre de votre commission d'enquête, d'apprécier les conditions dans lesquelles cette décision a été prise.
Je voudrais en préambule rappeler les quatre questions qui se posaient à l'époque, en vous demandant de bien vouloir garder à l'esprit une considération essentielle : le choix de 2005 sur les autoroutes ne peut pas être dissocié de la stratégie globale choisie par mon gouvernement.
Pourquoi ce choix d'une cession ?
Ce choix est fondé sur une conviction. Pour avancer, s'adapter, se réformer, la France a besoin d'un État fort, ce qui implique une certaine idée de l'État, soumis à une triple exigence. La première était celle d'unité nationale. Le défi était de taille après le 21 avril 2002 et le référendum constitutionnel européen manqué. La deuxième était une exigence de consolidation et donc de rigueur, car il faut tenir les cordons de la bourse.
Il y avait enfin une exigence de modernisation, pour adapter la France à un monde qui bouge. Rappelons, d'un côté, l'entrée de la Chine à l'OMC, en 2001 et de l'autre les efforts de l'Allemagne dans le cadre de l'Agenda 2010. Cette idée de l'État s'incarne dans une stratégie économique que j'ai présentée lors de ma déclaration de politique générale, avec pour question centrale comment retrouver des marges de manoeuvre pour engager la bataille de l'emploi, investir dans l'avenir et se désendetter ?
Ma responsabilité était, sans renoncer aux principes essentiels, d'arbitrer entre différentes exigences, c'est-à-dire préparer l'avenir par une stratégie industrielle, une politique d'innovation et de compétitivité ambitieuse, mais aussi se désendetter pour préserver notre souveraineté. Avec Thierry Breton, nous avons mené cette bataille, désireux de créer plus de conscience collective. C'est le sens du rapport commandé à Michel Pébereau, comme de l'organisation de la première conférence des finances publiques avec les représentants des collectivités territoriales et des partenaires sociaux. Nous n'avons pas cédé face à Bercy contre le ministère des Transports. Nous avons pris en compte l'exigence de réduction de la dette portée par le ministère de l'Économie tout en donnant au ministère des Transports les moyens d'investir.
En matière de transports, nous avons voulu aussi être à l'initiative. En 2005, le secteur des autoroutes était arrivé à maturité et nous étions, pour mener à bien la modernisation de nos transports, face à une double impasse, avec d'abord une impasse de financement. On avait pu croire avec la création de l'AFIT, en 2003, que les questions de financement des infrastructures de transport étaient résolues. Malheureusement, dans les mois qui ont suivi, la capacité à investir n'était pas au rendez-vous. Les dividendes autoroutiers affectés à l'AFIT ne représentaient que 332 millions d'euros en 2005, ce qui ne nous donnait pas de marges de manoeuvre pour un plan de relance. Le budget de l'AFIT, en 2005, n'était que de 1 milliard d'euros et largement affecté à des investissements déjà lancés.
La seconde impasse était une impasse de gouvernance dans la gestion des sociétés d'autoroutes, l'État étant des deux côtés de la table, se retrouvant juge et partie, actionnaire et régulateur, concédant et concessionnaire, pris entre des exigences contradictoires. Ainsi, l'État, comme les autres actionnaires des sociétés d'autoroutes, avait intérêt à des dividendes élevés, ce qui n'allait pas dans le sens de la protection des usagers contre les hausses de tarifs. La Cour des Comptes a ainsi souligné dans son rapport de 2008 un certain nombre de dérives anciennes (coups de pouce tarifaires non justifiés et pratique du foisonnement consistant à affecter les hausses de péage aux sections à fort trafic). Les administrateurs représentant l'État au conseil d'administration des sociétés concessionnaires se trouvaient en outre tiraillés entre les intérêts de l'État concédant et ceux des sociétés, qu'ils devaient, comme tout administrateur, défendre en priorité. En particulier les représentants de l'État ne pouvaient pas participer aux décisions du conseil d'administration sur les relations avec l'État, notamment sur les contrats de concession, au titre de leurs responsabilités générales de mandataire social devant agir dans l'intérêt social du concessionnaire et dans le cadre du régime spécifique des conventions réglementées.
Ce n'était évidemment pas le cas des autres administrateurs et en particulier des actionnaires privés minoritaires. Ainsi, du fait de l'alignement sur le droit commun des sociétés d'autoroutes et de la présence d'actionnaires privés à ses côtés, l'État était en fait devenu un actionnaire en grande partie passif, soumis aux décisions des actionnaires minoritaires, se contentant d'encaisser année après année sa part de dividende. On le voit bien à travers ces difficultés de gouvernance, l'État est pleinement dans son rôle lorsqu'il est autorité organisatrice, lorsqu'il est concédant. En tant qu'actionnaire de sociétés concessionnaires, il ne peut jouer qu'un rôle limité. Dans ce contexte, nous avons jugé nécessaire de clarifier la position de l'État, de sortir de cette situation d'un État empêché financièrement et juridiquement.
Deuxième grande question, quels sont le champ et la portée de notre décision ? Gouverner, c'est choisir. Ne pas choisir, c'est s'endetter. C'est pour ces raisons de politique économique et de politique des transports que mon gouvernement a décidé de vendre les parts que l'État français détenait dans les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Notre choix a été de valoriser notre participation dans un secteur mature pour réinvestir les sommes ainsi dégagées dans le désendettement et le financement de nouvelles infrastructures. Cette cession a rapporté 14,8 milliards d'euros.
Nous avons décidé d'en affecter le produit à deux priorités, près de 11 milliards d'euros pour le désendettement de l'État (ce qui est considérable, même rapporté au stock de dette de l'époque d'un peu plus de 1 000 milliards). Je rappelle que l'endettement public a reculé de 2,8 % en part du PIB entre 2005 et 2007. En 2007, la dette publique ne représentait, selon l'Insee, que 64,5 % du PIB contre 67,3 % en 2005. Avec ce mouvement de baisse, le premier depuis le gouvernement Barre, nous avons voulu créer un électrochoc, montrer qu'il était possible d'inverser la tendance.
Pour le reste, 4 milliards ont été affectés à l'AFIT pour financer de nouvelles infrastructures, plus respectueuses de l'environnement. En 2005, un audit sur le réseau ferroviaire, le rapport Rivier, souligne sa dégradation et l'urgence d'un effort massif de réinvestissement. Sur la base de cet audit, avec Dominique Perben, nous avons mis fin à la logique d'étranglement de la maintenance du réseau. Nous avons lancé le premier plan de rénovation de notre réseau national pour améliorer la qualité des trains du quotidien. Ces décisions étaient attendues et n'étaient pas possibles avant 2005, faute de ressources suffisantes. Au-delà de ce réinvestissement massif dans les trains du quotidien, nous avons engagé la réalisation de quatre lignes à grande vitesse, Bordeaux, Rennes, Montpellier, Rhin-Rhône, inauguré la première phase du TGV Est, conclu avec les collectivités le financement de la préparation de la deuxième phase. Tous ces projets sont aujourd'hui en service.
Il faut rappeler que nous n'avons pas décidé la privatisation des autoroutes. Les autoroutes françaises font partie du domaine public. Contrairement à ce que l'on peut parfois lire ou entendre, l'État en est toujours le propriétaire. À la fin du contrat de concession, nos autoroutes ne disparaîtront pas et demeureront la propriété des Français. À la fin des contrats, soit, dans les conditions de 2005, à compter de 2028, l'État récupérera une infrastructure en très bon état, améliorée sur la base des travaux de rénovation et d'aménagement imposés par les cahiers des charges de l'État. Ce que nous avons cédé, ce sont les parts de l'État dans les sociétés chargées d'exploiter les concessions autoroutières. Cette décision, que beaucoup ont voulu présenter comme une rupture, s'inscrit en réalité dans une histoire longue, marquée par le tournant de 2001, justifié par la nécessité d'ouvrir le secteur autoroutier à la concurrence, la fin de l'adossement, et la nécessité de trouver de nouveaux financements et de se conformer au droit européen.
Le premier choix a été celui de la concession et du péage, en 1955, sous forme de sociétés d'économie mixte. Le deuxième choix, dans les années 70, fut celui de la création de sociétés totalement privées. Ce choix, fait sous Georges Pompidou, a été renouvelé sous Lionel Jospin, avec des concessions telles que l'A28 (Rouen-Alençon), l'A86 ouest ou, en 1998, le viaduc de Millau avec Jean-Claude Gayssot, ministre des Transports. Le troisième choix, le vrai tournant, a eu lieu en 2001 avec la transformation des sociétés d'économie mixte en sociétés anonymes de droit commun et, dans la foulée, l'ouverture du capital d'ASF en mars 2002, sous Lionel Jospin.
Cette politique a été poursuivie par mon prédécesseur Jean-Pierre Raffarin avec l'ouverture du capital d'APRR, en novembre 2004 et de Sanef en mars 2005. Des investisseurs privés ont ainsi pu acquérir, selon le cas, entre 50 % et 26 % du capital des sociétés, toutes les trois cotées en bourse. Pour préparer cette ouverture du capital, les relations entre l'État et ces sociétés avaient été remises à plat en deux étapes, celle de 1994 sous le gouvernement d'Édouard Balladur, avec le regroupement et la recapitalisation des sociétés, ainsi que la définition de la règle d'évolution des tarifs, sur la base de laquelle la privatisation a été faite ; celle de 2001, sous le gouvernement de Lionel Jospin, qui a consisté à supprimer certains avantages dont bénéficiaient ces sociétés, tels que la garantie de reprise de passif par l'État en fin de concession. En contrepartie, les sociétés ont bénéficié d'un allongement de la durée de leur concession. Ce schéma a été validé par la Commission européenne.
En 2005, les sociétés concessionnaires étaient déjà totalement ou partiellement privées. L'État contrôlait à peine plus de 50 % du secteur, moins de 62 % si on ne prend pas en compte la société concessionnaire déjà entièrement privée Cofiroute.
Ce que j'ai décidé en 2005, c'est de mener à son terme le processus déjà engagé de cession des parts publiques dans les sociétés concessionnaires liées à l'État par des contrats déjà signés, déjà négociés et même renégociés.
Ce choix marque-t-il un recul de l'État ? Je ne le crois pas : dans ce cadre clarifié, l'État reste gardien des intérêts publics au travers de deux responsabilités, celle de concédant et celle de régulateur. L'État reste propriétaire des autoroutes et peut assumer pleinement son rôle de concédant. C'est lui qui définit la taille du réseau, le niveau de service, les enjeux de sécurité, les principes de fixation des péages. L'État est aussi régulateur. Sous la houlette de Dominique Perben, les contrats de concession ont été modifiés pour renforcer les obligations des concessionnaires, dans le service rendu, sur les questions de sécurité, dans la gestion de crise (où l'État reprend toujours la main, à travers les préfets) ou encore l'accès du concédant aux informations. Les principales modifications ont été publiées en amont de la remise des offres finales de façon à être prises en compte dans les engagements des candidats. Il en est ainsi pour :
- le renforcement des obligations de publicité et de mise en concurrence pour la passation des contrats de travaux ;
- le renforcement des obligations d'information du concédant ;
- la présence d'un commissaire du gouvernement aux séances du conseil d'administration et aux assemblées générales ;
- l'harmonisation et le renforcement des dispositions concernant la politique d'exploitation et de sécurité ;
- la qualité du service rendu aux usagers ;
- l'augmentation du montant des pénalités de retard et d'exploitation en cas de manquement ;
- la généralisation de la clause rendant obligatoire un état des lieux neuf ans avant la fin de la concession.
Sur les clauses tarifaires, l'État n'a fait aucun cadeau. Ce sont les clauses préexistantes qui ont été maintenues. Les règles de fixation des péages sont rigoureusement les mêmes que celles définies antérieurement. En pratique, les péages ont semble-t-il augmenté moins vite après 2005 qu'avant 2005. Nous n'avons pas changé ces règles tarifaires. Pour changer la durée et les péages des concessions, il aurait fallu modifier les contrats. Ils ne peuvent l'être unilatéralement par l'État : toute modification suppose un accord avec les sociétés concessionnaires. Nous l'avons vu en 2015, lors de la tentative du gouvernement de l'époque qui a pris une décision d'un gel des péages conduisant à l'impasse. Dans un cadre contractuel, l'État ne peut pas passer en force, d'autant que pour l'examen de tout projet de modification, les administrateurs de l'État, comme je l'ai indiqué, sont légalement obligés de se déporter, laissant les autres administrateurs seuls en position de décider. Ceux-ci, et notamment les minoritaires, n'auraient jamais accepté des clauses amputant substantiellement la valeur des sociétés.
Ces contraintes ont été clairement rappelées par le ministre d'État Jean-Louis Borloo dans sa réponse au rapport de 2008 de la Cour des comptes : « les mandataires sociaux ne peuvent conclure un avenant ou un contrat d'entreprise avec l'État qu'à la condition qu'il soit conforme à l'intérêt social de l'entreprise ». Compte tenu de l'impact des clauses tarifaires sur les revenus futurs des sociétés, leur durcissement est à l'évidence difficile à faire accepter. Que l'entreprise soit publique ou privée ne change rien à la responsabilité des mandataires sociaux telle qu'elle est par exemple sanctionnée par l'article L. 242-6 du code de commerce, qui prévoit des sanctions pénales.
Troisième grande question, quelles ont été les modalités de l'opération ? Commençons par la procédure politique. J'ai présenté le cadre retenu le 8 juin 2005 au Parlement lors du discours de politique générale. Ce discours a été suivi d'un vote de confiance.
La décision d'autoriser le transfert des parts de l'État dans les sociétés d'autoroutes est une décision que j'ai prise en plein accord, bien sûr, avec Jacques Chirac, par décret, les 2 février, 16 février et 8 mars 2006. Nous avons sollicité le Conseil d'État sur la procédure à suivre. Celui-ci a rendu un avis en assemblée générale, confirmant la régularité de la procédure retenue par le gouvernement. Le Conseil d'État nous a en particulier confirmé que la poursuite de la cession des parts ne nécessitait pas de vote du Parlement, notamment parce qu'il n'y avait pas, contrairement, par exemple, au projet d'ouverture du capital d'ADP, de transfert du domaine public. Je rappelle pour autant qu'avant la cession effective des parts de l'État, le Parlement a été saisi du projet de loi de finances pour 2006, dans lequel étaient retracées les conséquences de la vente de nos participations. Le Parlement a adopté la loi de finances avec l'affectation des recettes de cession.
Partant de là, l'État s'est mis en bon ordre de marche, au niveau du gouvernement, avec l'action concertée de Thierry Breton, ministre de l'Économie et Dominique Perben, ministre des Transports, au niveau des services de l'État, avec l'Agence des participations de l'État (APE), chargée de piloter le processus de privatisation. L'APE s'entoure, pour ces opérations, de conseils financiers et juridiques de haut niveau. La Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM), de son côté, a pleinement joué son rôle dans l'élaboration des cahiers des charges et la révision des clauses contractuelles qui pouvaient en faire l'objet.
La procédure technique retenue est celle qui donne le plus de poids aux intérêts de l'État. Sachant que l'État est faible lorsqu'il négocie de gré à gré et qu'il est fort lorsqu'il lance un appel d'offres ouvert et concurrentiel pour obtenir le meilleur prix, nous avons lancé un appel d'offres ouvert et compétitif, auquel ont participé dix-huit candidats, français et étrangers, majoritairement des opérateurs industriels de premier rang et non des fonds. C'est le moyen le plus efficace pour obtenir le meilleur prix.
Enfin, nous avons fait le choix d'une gouvernance apportant toutes les garanties nécessaires et la mise en oeuvre de notre décision s'est faite sous le contrôle de plusieurs autorités. Nous y reviendrons si vous le souhaitez. Le Conseil de la concurrence, la Commission des participations et des transferts (CPT), la Commission européenne. Nous avons aussi décidé, pour rendre la procédure irréprochable, de charger Jean-Louis Fort, ancien secrétaire général de la Commission bancaire, de veiller au bon déroulement de la procédure.
Quatrième question, les intérêts de l'État ont-ils été bien préservés ? Nous avons d'abord cherché à garantir un juste prix. Quels sont les repères chiffrés réunis par l'Agence des participations de l'État, partagés à l'époque au sein de l'État lorsque nous avons lancé le processus ? Si l'on regarde le cours de bourse des trois sociétés concernées, les participations de l'État valaient 11,5 milliards d'euros avant que j'annonce leur vente le 8 juin 2005. Le rapport du député Hervé Mariton, rédigé avant cette annonce, avait évalué entre 10 et 12 milliards la valeur des participations. La Commission des participations et des transferts a estimé la valeur a minima que devait en attendre l'État à 12,8 milliards d'euros. Nous en avons obtenu de 14,8 milliards d'euros, soit 30 % de mieux que le dernier cours de bourse. Ce résultat était dans la fourchette haute de nos attentes et des modèles financiers d'évaluation des sociétés concernées.
Compte tenu de la part des autres actionnaires, cela donne une valeur totale des sociétés concessionnaires d'autoroutes de 24 milliards d'euros. Ce chiffre figure en note de bas de page dans le rapport de la Cour des comptes de 2009, qui précise la valeur globale des 7 000 kilomètres d'autoroutes publiques dont la concession a été privatisée en 2006, estimée à 24 milliards d'euros. Leur cession a rapporté 14,8 milliards d'euros à l'État. Je souligne le risque de malentendu lié à l'interprétation du chiffre de la Cour des comptes, à l'origine de nombreuses polémiques. 24 milliards d'euros, c'est la valeur de 100 % des parts des trois sociétés. 14,8 milliards d'euros, c'est la valeur des parts détenues par l'État, soit en moyenne 61,7 %. Ces deux chiffres ne se contredisent en rien. S'agissant de la plus grosse de ces trois sociétés, ASF, dont l'État ne détenait plus que 50 % du capital suite à sa mise sur le marché au prix de 24 euros par action sous le gouvernement de Lionel Jospin, nous avons obtenu 51 euros par action.
Ainsi, nous avons vendu le solde de la participation de l'État dans les sociétés concessionnaires au mieux de leur valeur à l'époque. Ce sont les soumissionnaires qui proposent, dans le cadre d'une procédure compétitive et ouverte, le prix d'acquisition, selon des méthodes classiques d'évaluation multicritères. C'est la Commission des participations et des transferts et elle seule qui valide que ces prix sont au-dessus du seuil qui garantit parfaitement les intérêts de l'État. Elle valide donc implicitement le juste prix et ses avis sont publics. Votre commission peut accéder à toutes ces données pour établir de façon transparente comment les sociétés ont été valorisées. L'Agence des participations de l'État a nécessairement conservé toutes ces données. Votre commission peut les trouver assez facilement.
Partant de là, les intérêts de l'État ont été pris en compte à chaque étape.
Premier constat, l'État a tenu ses promesses en affectant le produit de la vente au désendettement et à l'investissement. Deuxième constat, au-delà de la vente initiale, l'État continue de percevoir des taxes importantes, assises sur les péages (essentiellement la TVA), des taxes spécifiques (comme la redevance domaniale et la taxe d'aménagement du territoire affectée à l'AFIT) et l'impôt sur les sociétés. Ce sont, au total, de l'ordre de 5 milliards d'euros que l'État encaisse annuellement, soit plus de 40 % des péages.
Troisième constat, la qualité du service est assurée et l'on s'accorde à reconnaître que nos autoroutes sont parmi les meilleures d'Europe et du monde.
Quatrième constat, l'État récupérera à la fin des concessions une infrastructure autoroutière en bon état, améliorée des travaux réalisés par les concessionnaires. On voit d'ailleurs que le réseau routier et autoroutier placé sous la responsabilité directe de l'État vieillit et connaît des problèmes d'entretien importants. Je pense en particulier au réseau francilien. Aujourd'hui, le patrimoine autoroutier français concédé est en meilleur état que le patrimoine routier resté sous la gestion opérationnelle publique.
En conclusion, je voudrais formuler trois voeux devant votre commission. D'abord ne pas céder au chronocentrisme, c'est-à-dire ne pas juger avec les critères d'aujourd'hui une décision prise à une date antérieure. Il faut bien prendre en compte les paramètres qui étaient les nôtres quand la décision a été prise, et ne pas perdre de vue que les concessions sont des contrats de long terme, qu'il faudra évaluer à leur terme. Les risques imprévus ne doivent pas être sous-estimés. Enfin, le choix de 2005 ne peut être dissocié de la stratégie globale choisie par le gouvernement. Comme vous le voyez, mon gouvernement n'a pas « bradé les bijoux de famille » pas plus qu'il n'a « tué la poule aux oeufs d'or », bien au contraire. La période 2005-2007 a été une période où la France, grâce aux marges de manoeuvre dégagées, a su améliorer ses performances économiques, qu'il s'agisse de la baisse du chômage, de la réduction des déficits ou de la baisse de la dette. Nous avons obtenu dans cette période, à la fin du mandat de Jacques Chirac, les meilleurs résultats économiques des trente dernières années. En témoigne tout particulièrement la comparaison avec l'Allemagne, puisque notre bilan économique et financier était encore, en 2007, à l'avantage de la France. Je vous remercie.
Vous avez raison d'être surpris, car ce témoignage ne correspond pas à la réalité. Tout cela s'est passé il y a un certain temps. Il est normal que tout ne soit pas forcément très précis dans l'esprit de ceux qui viennent devant vous. Vous imaginez bien qu'une décision de blocage des tarifs de péages d'autoroute est prise par le Premier ministre. Il existe d'ailleurs un communiqué de Matignon sur ce sujet, daté du 27 janvier, et que j'ai sous les yeux. Vous connaissez le discours des sociétés concessionnaires d'autoroutes, qui n'ont jamais intérêt à entrer dans une négociation puisque les contrats de concession sont très déséquilibrés en leur faveur. Elles refusaient donc, depuis les premiers rapports de la Cour des comptes, de rejoindre la table des négociations.
Pour les y contraindre, il fallait prendre une décision. Le 27 janvier au matin, le Premier ministre réunit le groupe de travail de quinze parlementaires de la majorité et de l'opposition. Il leur promet de les tenir régulièrement informés des discussions engagées par le Gouvernement avec les concessionnaires. Permettez-moi de citer le communiqué : « [Ce groupe de travail] devra examiner les deux scénarios envisageables, soit la renégociation des contrats de concession, soit la résiliation de ces contrats d'autre part. Le Premier ministre souhaite qu'un point d'étape soit fait à la fin de février. Dans l'attente de l'aboutissement de ces travaux, le gouvernement a décidé de surseoir à l'application de la hausse des péages, prévue contractuellement le 1er février. Il prendra des arrêtés à cette fin ».
Les choses se sont ensuite déroulées assez rapidement, comme je l'ai constaté en faisant quelques recherches sur Légifrance pour préparer cette audition. Un arrêté est publié au Journal Officiel le 27 janvier 2015, signé par le ministre de l'Économie, le ministre des Transports et moi-même, après un arbitrage de Matignon. Miraculeusement, les sociétés concessionnaires d'autoroutes reviennent alors autour de la table, non sans émettre quelques menaces : « vous avez intérêt à céder », disent-elles à l'État, « car cela va vous coûter plus cher dans un contentieux ». Je les ai invitées à introduire un contentieux si elles le jugeaient fondé. Elles n'ont jamais attaqué l'arrêté. L'État aurait donc pu rester en position de force.
Ce ne fut pas le cas, car, comme le note la Cour des comptes, il n'avait ni les moyens ni la rigueur requise pour faire face à la pression exercée par les sociétés concessionnaires d'autoroutes, qui ne veulent pas laisser échapper le trésor qu'elles ont entre les mains. Elles allaient obtenir non seulement un rattrapage du gel des péages de 2015 mais également un sur-rattrapage - assez scandaleux - à la faveur d'un taux d'actualisation particulièrement avantageux. Je tiens à redire ici que l'État avait parfaitement le droit d'inclure dans la négociation le blocage de la hausse des tarifs, d'autant plus que l'inflation était très faible.

Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre, pour votre propos étayé et d'une très grande précision. Je précise qu'il n'est pas question ici de juger les décisions prises ni le modèle concessif mais de faire des propositions à l'État pour renforcer son rôle dans la négociation et rééquilibrer le rapport de forces entre les sociétés autoroutières et les représentants de l'État.

Rappelons que l'augmentation des tarifs devait s'appliquer le 1er février. C'est ce qui explique la date du 27 janvier : il fallait qu'une décision soit prise avant le 1er février et que l'État réponde aux sociétés concessionnaires d'autoroutes. Je n'ai pas d'éléments précis sur le sujet mais il me semblait qu'une annonce de votre part sur le gel des péages avait eu lieu par anticipation, à l'automne 2014. Avez-vous fait cette annonce en concertation avec le Premier ministre et avec ses services ? J'avais compris que tout le monde avait été mis devant le fait accompli par votre décision et que, dès lors, il fallait régulariser les choses, ce qui expliquerait la décision annoncée le 27 janvier.
Par ailleurs, vous indiquez que vous ne parveniez pas à faire revenir autour de la table de négociations les sociétés concessionnaires d'autoroutes, sans doute à la suite des rapports de l'Autorité de la concurrence et de la Cour des comptes, qui avaient suscité de nombreuses réactions. Pourquoi souhaitiez-vous discuter avec elles ? Quel était l'objectif de l'État au regard des contrats de concession ?

Monsieur le Premier ministre, vous avez indiqué que les tarifs avaient augmenté moins vite après 2005. Il convient de préciser que l'inflation était moins importante à cette période-là. Si l'on neutralise l'impact de l'inflation, le pourcentage d'évolution des tarifs est un peu supérieur.
Je vous remercie, monsieur le Premier ministre, d'avoir respecté, à une minute près, ce qui est remarquable, le temps dont nous étions convenus pour ce propos liminaire et d'avoir manifestement très bien préparé votre audition. Vos nous avez rappelé de nombreux éléments, notamment le contexte dans lequel la décision a été prise, la politique dans laquelle elle s'inscrivait, la régularité de la procédure, etc. Vous avez très bien défendu votre action et vos décisions. J'ai néanmoins plusieurs questions.
Lorsque Lionel Jospin, en tant que Premier ministre, choisit de transformer les Sociétés d'économie mixte (SEM) en SA en 2001, il ouvre le capital d'ASF. Estimez-vous que c'est une bonne décision ? L'auriez-vous prise ? Qu'est-ce qui, à vos yeux justifiait de mettre 20 % du capital de cette entreprise sur le marché ?
Il convient également de rappeler qu'avant 2001, l'État était propriétaire à 100 % des sociétés d'autoroutes, en dehors de Cofiroute. Entre 2001 et 2006, pour se rendre propriétaires d'ASF, les actionnaires dépensent 24 milliards et l'État perçoit, au titre des participations qu'il détenait alors dans ces sociétés, 14,8 milliards. Il y a donc une différence, qui vient de la mise sur le marché de 20 % du capital d'ASF par Lionel Jospin en 2001 et de la procédure suivie pour la mise sur le marché du reste des titres, puisque l'opération a eu lieu en deux temps. Une première partie a été mise sur le marché à un cours de bourse relativement faible. Un des lots - qui était le plus important - a aussi été attribué à Vinci sans concurrence. Vinci a soumis une offre moins élevée que le prix minimum fixé pour les deux autres lots qui faisaient l'objet d'une concurrence plus vive, ce qui témoigne, semble-t-il, d'un problème de procédure (lequel ne découle pas nécessairement de décisions prises par votre gouvernement). J'aimerais que vous nous disiez ce que vous en pensez.
En 2001, au moment de la transformation des SEM en SA, n'était-il pas souhaitable de mettre à jour les contrats avec les sociétés d'autoroutes ? Ces contrats avaient plusieurs dizaines d'années. Élisabeth Borne les a qualifiés de « monstres » et sans doute méritaient-ils un toilettage. Le sujet a-t-il été évoqué à l'époque ? Avez-vous manqué de temps pour le faire ou avez-vous estimé, en toute connaissance de cause, que ce n'était pas nécessaire ?
Notre commission veut aussi se tourner vers l'avenir. Que feriez-vous aujourd'hui si vous étiez Premier ministre ? Des initiatives vous semblent-elles à prendre pour préparer la fin des concessions - sachant que des évolutions sensibles ont déjà été introduites en 2015 - et faire en sorte que l'État soit plus fort dans la négociation ?
L'objectif de l'État était de donner suite aux rapports de la Cour des comptes et de l'Autorité de la concurrence, afin de rééquilibrer le rapport de force vis-à-vis de ces sociétés. Il existait un tel besoin de financement de l'AFITF, pour le réseau secondaire, qu'il était choquant de voir les sociétés concessionnaires d'autoroutes gagner beaucoup d'argent tandis que les automobilistes étaient de plus en plus taxés. Il fallait donc faire revenir les sociétés d'autoroutes autour de la table. Sans doute l'idée vient-elle de moi. Si c'est bien le cas, je suis assez contente de l'avoir eu.
Les sociétés d'autoroutes savent que je n'ai pas peur du rapport de forces et que je ne me laisse pas influencer par la crainte d'un contentieux. S'il y avait d'autres auditions sur d'autres sujets, je pourrais vous expliquer par exemple de quelle façon j'ai eu gain de cause dans l'affaire de la décharge de Nonant-le-Pin. La société Guy Dauphin Environnement (GDE) avait introduit un contentieux et m'avait dit que celui-ci couterait cher à l'État. Elle a perdu le contentieux. GDE, qui voulait mettre des déchets à Nonant-le-Pin, dans un endroit magnifique à proximité de haras, n'a pas pu le faire.
Je trouvais également très déplaisante la façon dont les sociétés d'autoroutes - même si elles sont dans leur jeu - critiquent les rapports de la Cour des comptes et de l'Autorité de la concurrence, traitant les hauts fonctionnaires qui les ont rédigés d'incompétents et de menteurs. Nous n'injurions pas de la sorte les patrons des sociétés autoroutières. Ils sont dans leur droit, ils font des affaires. Mais ils n'ont pas pour autant tous les droits, a fortiori quand ils ont face à eux des hauts fonctionnaires. Or, ils n'hésitent pas à traiter de grands commis de l'État, de bons à rien, sous prétexte qu'ils n'ont jamais travaillé dans le secteur privé. C'est inadmissible. Il fallait donc rétablir un rapport de force plus équilibré avec les sociétés concessionnaires d'autoroutes, dans l'intérêt de l'État et des usagers.
Je reviendrai d'abord sur le choix d'ouvrir le capital d'ASF et d'une façon générale sur le tournant de 2001. Il faut se souvenir que, dans cette période, le choix était aiguillonné ou plus ou moins contraint, du fait de la nécessité de se conformer aux exigences de la Commission européenne et d'un besoin de ressources financières.

Je comprends l'intérêt qu'il y avait à rouvrir une négociation avec les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Effectivement, tous les concessionnaires sont les mêmes, que nous parlions de grandes ou de petites concessions : dès lors que l'on veut négocier quelque chose, ils invoquent le contrat et menacent de recours contentieux. C'est assez classique. Le concédant n'a pas à avoir peur de cela. Il faut bien analyser la situation.
Pouvez-vous nous confirmer que vous avez été tenue informée de la négociation, même si le protocole d'accord de 2015 a été discuté par votre directrice de cabinet, Élisabeth Borne, avec Alexis Kohler pour le ministère de l'économie et Bruno Angles pour les sociétés d'autoroutes ?
Je n'ai pas vraiment suivi les négociations de ce protocole. C'était le début de l'année 2015. Il y avait la préparation de la conférence de Paris sur le climat qui m'occupait beaucoup, l'élaboration de la loi relative à la transition énergétique, etc. Le ministère de l'environnement est extrêmement lourd et la masse de travail y est colossale. Dès lors que Matignon avait délégué la négociation aux deux directeurs de cabinet, je n'avais pas de raisons de ne pas faire confiance à ceux qui étaient chargés de cette négociation. Il y avait aussi le secrétaire d'État aux Transports. Je n'ai appris qu'après qu'il n'avait pas été mis dans la boucle. Je déléguais beaucoup à Alain Vidalies. Dans mon esprit, c'était plutôt à lui de suivre le sujet des autoroutes, compte tenu de tous les autres dossiers que je devais suivre par ailleurs.
Non mais la Commission européenne était favorable à l'ouverture à la concurrence, ce qui était un argument important. Nous nous retrouvions, par rapport aux autres sociétés, dans le cadre européen, comme un cas assez isolé. Il y avait une exigence d'ouverture du cadre des concessions au privé. Il y avait une exigence de mise en conformité, concernant notamment la durée des concessions. Nous devions avoir l'aval de la Commission européenne.
Il y avait aussi une exigence d'alignement sur le droit commun des sociétés d'autoroutes et des sociétés anonymes. Peut-être aurait-il fallu revoir alors le cahier des charges et les contrats eux-mêmes. Lorsque nous héritons de la situation, en 2005-2006, il est presque trop tard : les sociétés ont toutes des actionnaires minoritaires. J'ai également rappelé le dispositif qui régissait les conventions réglementées et le dispositif d'obligation, pour les représentants de ces sociétés, en tant que mandataires sociaux, de respecter l'intérêt de l'entreprise. Nous n'étions donc pas totalement libres de nos choix à l'époque, compte tenu du droit des sociétés et du contexte dans lequel nous agissions.
Oui, il a refusé de le signer. C'est ce que j'ai vu par la suite.
Dans mon souvenir, un mouvement s'organisait en Europe et poussait en ce sens. Trois mouvements s'exerçaient ainsi en 2001, dans le sens de l'ouverture au privé, vers l'ouverture à la concurrence et en faveur de l'alignement sur le droit des sociétés (qui créait des contraintes importantes). Pour ce qui est de la contrepartie donnée à certaines sociétés, à savoir l'allongement de la durée, il fallait l'accord de la Commission européenne, qui a été obtenu. Le système était donc relativement verrouillé. Nous n'avons pas, en 2005-2006, de marges de manoeuvre importantes car nous nous retrouvons dans le cadre de conseils d'administration où notre position est difficile à faire entendre, puisque les administrateurs de l'État doivent se déporter dès lors que les débats portent sur les tarifs et la durée des concessions. En outre, les mandataires sociaux sont censés représenter l'intérêt général des entreprises. Nous ne pouvons donc pas faire exactement ce que nous aurions souhaité faire à ce moment-là.
Quant à la procédure, un seul concurrent (Vinci) a effectivement soumis une offre pour l'une des lots. Cela peut arriver dans tout appel d'offres. Tout ceci se passe en dehors de toute interférence et de toute volonté politique. La procédure est définie par l'Agence des participations de l'État et la Commission des participations et des transferts. Tout ceci se fait sous le contrôle de ces commissions, qui sont indépendantes et vérifient la conformité de la procédure. Heureusement, le pouvoir politique n'a pas le moyen d'entrer dans ces débats. De surcroît, des avis sont pris auprès du Conseil de la concurrence et de différentes instances, comme je l'ai rappelé.

Lorsqu'on lance un appel d'offres, on peut le déclarer infructueux si l'on considère que les réponses n'ont pas été satisfaisantes ou que la concurrence n'a pas suffisamment joué. En présence d'une seule réponse pour l'un des trois lots, l'État pouvait décider de remettre en jeu ce lot tout en attribuant les deux autres lots.
Non, moi, je suis disciplinée. Le Premier ministre avait décidé de la configuration de la négociation. Une fois que le protocole avait été négocié, je l'ai signé, sans avoir la curiosité de regarder son contenu.
Le prix minimum qui avait été fixé par la Commission des participations et des transferts était de 47 euros et nous en avons obtenu 51 euros. Nous sommes donc dans les clous. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ces procédures ont leurs règles, lesquelles ont été entièrement respectées. Un certain nombre d'idées reçues pèsent d'ailleurs lourdement sur ces questions. Je pense en particulier au prix. En 2008-2009, la Cour des comptes nous a reproché de ne pas avoir mis suffisamment de conseils autour de la table car nous aurions eu un seul banquier. En fait, nous avions deux banquiers, Goldman Sachs et BNP Paribas.
On nous a reproché un prix trop bas. J'ai entendu devant votre commission le plaidoyer fait par Gilles Carrez, qui estimait qu'il aurait fallu faire travailler le Commissariat au Plan, lequel aurait défendu un prix très supérieur à celui qui a été obtenu. Il faut se rappeler ce que dit le Conseil d'État dans sa décision du 27 septembre 2006, par laquelle il a rejeté le moyen lancé par François Bayrou et deux associations de défense des usagers, qui soutenaient que la valeur minimale de cession avait été sous-évaluée par la Commission des participations et des transferts, notamment du fait d'un taux d'actualisation supérieur à celui préconisé par le Commissariat général du Plan. Le Conseil d'État a démontré qu'augmenté pour prendre en compte l'inflation et la légitime prise de risque, le taux d'actualisation suggéré par le Plan aurait en réalité conduit à une valeur des titres inférieure à celle évaluée par la Commission des participations et des transferts. Le Conseil d'État a par ailleurs souligné que la valorisation retenue était supérieure, tant aux cours de bourse constatés sur les mois ayant précédé le transfert qu'aux estimations effectuées par les experts. Les deux sources majeures de polémique, sur ce dossier, dans les années qui ont suivi 2005-2006, concernant le prix (qui aurait été trop faible) et un taux d'actualisation (qui aurait été trop élevé) ne correspondent donc pas à la réalité. Partant de là, l'opinion publique ne comprend pas et a le sentiment qu'on a bradé les intérêts de l'État. Cela n'a pas été le cas.
La Cour des comptes revient aussi sur l'idée selon laquelle nous aurions obtenu un meilleur prix si nous avions au préalable désendetté les sociétés (dont l'endettement était compris entre 18 et 20 milliards d'euros). Ce n'était ni possible ni souhaitable : il aurait alors fallu injecter plus de fonds publics, pour quel bénéfice ? Les actionnaires privés ont fait le contraire en augmentant le levier financier des sociétés et donc leur endettement. Il existe ainsi un certain nombre d'idées reçues, de serpents de mer, sur ces dossiers, qui méritent d'être corrigés.
Quant à l'avenir, la première règle qui me paraît importante est la nécessité, pour l'État, de renforcer sa capacité de régulation économique des monopoles naturels. Je souscris pleinement aux propos que vient de tenir Ségolène Royal devant votre commission : il n'y a pas de fatalité. La question ne se posait pas du tout, en 2006-2008, depuis les termes qui doivent être considérés aujourd'hui, à la lumière du paquet vert de 2010 et du plan de relance autoroutier de 2015, corrigé par le plan d'investissement de 2018. Les choses se présentent aujourd'hui différemment.
Dans les années qui ont suivi la privatisation des sociétés autoroutières, l'État disposait de tous les moyens pour se faire respecter. Les propos de Jean-Louis Borloo que j'ai cités figurent dans le rapport de la Cour des comptes et montrent bien que nous avons la capacité administrative - pourvu que nous ayons aussi la volonté politique. Ségolène Royal a eu raison de dire que malheureusement, trop souvent, dans ces années-là, la volonté politique a pu faire défaut. Néanmoins, face à trois sociétés concessionnaires, vous ne m'expliquerez pas que l'État n'est pas capable d'assurer sa fonction de régulateur, alors qu'il serait un formidable mainteneur. Vous ne m'expliquerez pas davantage que remettant ces sociétés dans le giron public, tous les problèmes disparaîtraient. C'est absurde. Si l'État n'est pas capable d'être un bon régulateur, il ne sera pas un bon mainteneur. Il faut donc remettre les pendules à l'heure.
Pour autant, le sujet des autoroutes, en France, est bien plus que le sujet des autoroutes : il a une valeur symbolique et politique. Trop souvent, il a été traité au sein du ministère sous le seul angle technique. Il existe un rapport de forces avec les sociétés d'autoroutes. Ceci existe dans tous les grands secteurs de l'État. Lorsque celui-ci discute avec les constructeurs automobiles ou aéronautiques, les arbitrages ne sont pas pris dans les ministères techniques. Il n'y a pas de raison pour que, s'agissant des autoroutes, la sous-direction chargée du réseau se retrouve en première ligne dans la négociation. Cela me paraît un aspect important et un élément à corriger dans la loi.
Par ailleurs, la Cour des comptes, le Conseil de la concurrence et l'Autorité de régulation des transports (ART) ont éclairé un certain nombre de voies importantes de renforcement de la fonction de régulation. J'en retiendrai trois idées.
La première a trait au haut niveau de compétence et de professionnalisme requis. Beaucoup de ceux qui se sont présentés devant la commission l'ont rappelé : il faut une compétence technique et une compétence juridique. Gilles de Robien a eu raison de le dire. Il faut être à armes égales en termes de capacités, face aux sociétés d'autoroutes.
Il y a aussi une exigence de transparence. Elle n'a pas toujours existé au fil des années. Elle me paraît essentielle, notamment sur l'information des autorités publiques et la motivation des décisions. Dans le mandat qu'avait Dominique Perben en 2005-2006 pour renforcer les atouts de l'État dans les cahiers des charges, il y avait cette exigence de transparence et d'information, avec des clauses extrêmement exigeantes qui n'ont malheureusement pas été appliquées au cours des années suivantes.
Une troisième nécessité est une pratique rigoureuse dans la gestion des contrats et de leurs avenants, en particulier en ce qui concerne les allongements de la durée ds concessions. Nous ne parlons pas de la même chose suivant que l'on se place du point de vue de 2006 ou d'aujourd'hui car les durées ne sont pas du tout les mêmes. On a beaucoup cédé à travers l'allongement des concessions et malheureusement ces allongements ne sont pas soumis à une mise en concurrence, alors que celle-ci est souvent nécessaire à la protection des intérêts de l'État. L'ART a utilement mis en oeuvre un principe de rigueur dans la définition des investissements et de leurs modalités de prise en compte dans les avenants autoroutiers issus du plan de relance 2015.
Trop souvent, toutefois, parce que l'État n'est pas capable de trouver l'argent nécessaire, il achète en quelque sorte par du temps les travaux à réaliser, sans toujours vérifier (Ségolène Royal l'a redit) que ces travaux ne sont pas déjà prévus dans son cahier des charges. De ce point de vue, l'État régulateur s'est montré faible et cet allongement de la durée des concessions a modifié - parfois même perverti - le regard que nous portons sur elles. Ce fut une erreur. Lorsque nous avons signé, en 2006, les premières fins de concession devaient intervenir en 2027. Nous parlons aujourd'hui de durées beaucoup plus longues.
Dans un monde qui évolue extrêmement vite, comme nous le voyons, il peut exister des risques extrêmement importants. Nous l'avons vu avec la crise de 2008-2009. Nous le voyons aujourd'hui avec la crise sanitaire. Ces risques sont majeurs et peut-être ont-ils vocation à s'amplifier au cours des prochaines années. Nous n'avons pas intérêt, dans ce contexte, sans clauses de rendez-vous et sans durées raisonnables, à nous lancer dans une aventure au long cours qui joue nécessairement contre les intérêts de l'État.

Monsieur le Premier ministre, merci de nous avoir éclairés. Vous avez souligné le besoin de transparence. Ma question porte sur la façon dont les parlementaires ont été associés à ces décisions. D'un strict point de vue formel, le Parlement a été saisi au détour d'une loi de finances. Chacun connaît la procédure très cadrée de loi de finances, qui implique des délais très rapprochés.
Nous avons été confrontés à la même difficulté avec ADP et la Française des Jeux. On nous a présenté ces dispositions dans le cadre d'un texte de 220 articles, la loi Pacte, en nous donnant quinze jours pour le voter. Il ne faut pas s'étonner que de tels sujets puissent ensuite apparaître comme des serpents de mer ou ne semblent pas avoir été étudiés avec toute la transparence requise.
N'estimez-vous pas qu'il eût été souhaitable d'associer différemment le Parlement ?
Oui, je l'ai découvert par la presse. Je ne m'y suis intéressée que quand sa publication a été ordonnée par le Conseil d'État. Un point me semble particulièrement intéressant, en particulier pour votre commission : c'est suite à la saisine d'un citoyen, Raymond Avrillier, que le Conseil d'État ordonne la publication de ce document, ce qui nous le fait découvrir.
Nous pouvons débattre à l'infini de ce qui aurait été préférable. N'oubliez pas que j'arrive, comme Premier ministre, au lendemain de l'échec du référendum européen. Je dispose d'une vingtaine de mois actifs pour agir. L'ambition du Premier ministre, comme celle de Jacques Chirac, est de refaire un certain nombre de choses et de dégager des marges de manoeuvre, à un moment où l'investissement public était complètement bloqué et où il était difficile d'imaginer le moindre plan pour revitaliser la croissance.
Il fallait donc créer ces marges de manoeuvre. Dès lors, le temps est important. De plus, ce n'est pas la première fois que le capital de ces sociétés est ouvert : c'est la quatrième fois. Lionel Jospin prend une première décision. Puis, en 2003 et début 2005, Jean-Pierre Raffarin poursuit en ce sens. J'initie le quatrième mouvement de mise sur le marché d'une partie du capital des sociétés d'autoroutes. Je suis celui qui met sur le marché ce qu'il reste de ce capital, ce qui a une valeur symbolique que je reconnais volontiers. Mais c'est le même exercice. Le parallélisme des formes - auquel nous tenons dans notre pays car nous aimons le droit et les repères - m'a conduit à appliquer la même règle que mes prédécesseurs. J'ai ainsi décidé par décret, tout en veillant à ce que la représentation nationale soit saisie, à travers la loi de finances, certes, mais aussi à travers deux débats, l'un au Sénat et l'autre à l'Assemblée nationale. Chacun a pu s'exprimer sur ces sujets.
À partir de quel moment faut-il arrêter la pendule, en considérant que l'on a épuisé un sujet, pour agir ? L'État se voit parfois reprocher de ne pas agir assez vite et assez bien. Parfois, on lui reproche d'avoir agi de façon précipitée. C'est un reproche qui m'a souvent été fait. Je crois qu'il faut savoir arbitrer.
J'ai placé cette audition sous le signe de la stratégie de mon gouvernement, car ce fut bien une décision stratégique. Je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendu dans votre esprit. Gilles de Robien est un responsable politique que j'aime beaucoup. Il a été mon ministre de l'Éducation nationale. Il a fait état de ses deux rencontres avec Bercy. Ne nous trompons pas sur ce point : ce sont les rencontres habituelles de tout ministre technique avec le ministre qui tient les cordons de la bourse. Que Bercy cherche à obtenir davantage d'un ministre dans ce contexte et qu'un ministre prépare cette rencontre, je l'ai vécu en tant que ministre de l'Intérieur et en tant que ministre des Affaires étrangères. Nous étions là dans un cadre tout à fait différent, en 2005. Une stratégie requérait des marges de manoeuvre, ce qui passait par un arbitrage entre le statu quo et une décision qui change quelque chose pour créer des marges de manoeuvre et remettre la France en marche. C'est ce choix que nous avons fait, avec un certain succès : en 2007, nous sommes dans une meilleure situation que l'Allemagne. Nous n'avons pas décidé de changer un système optimal qui fonctionnait parfaitement.
Lorsque j'arrive aux affaires, les dividendes autoroutiers s'élèvent à 332 millions d'euros. Gilles de Robien estime peut-être que cela permettait de tout régler et qu'au bout de cinq ou dix ans, nous aurions disposé d'une cagnotte. Cela aussi fait rêver les Français mais c'était une cagnotte virtuelle. Cinq ou dix ans, cela aurait voulu dire s'asseoir sur un magot qui n'existait pas, en espérant qu'il finisse par se matérialiser. Si les taux d'intérêt étaient passés de 4 % à 6 %, au lieu de tomber à zéro, François Fillon aurait eu raison de dire (à tort) que l'État français était en faillite à l'été 2007, alors que j'ai laissé un taux d'endettement de 64,3 %. Nous avons voulu, avec Thierry Breton, assumer en conscience une exigence, celle du désendettement.
On dira qu'un pour cent de la dette, ce n'est pas suffisant pour mériter l'effort consenti. Mais, une fois de plus, il n'y avait pas de poule aux oeufs d'or. Que pouvions-nous faire avec 332 millions d'euros (alors que le budget de l'AFIT était de 3 milliards d'euros) ? Le TGV vers Bordeaux, Montpellier, Rennes et le TGV Rhin-Rhône n'existeraient pas aujourd'hui. De nombreux Français considèrent que nous avons rendu un grand service à notre pays en développant cet outil ferroviaire.

Monsieur le Premier ministre, alors que vous étiez nommé Premier ministre, se déroulait la mission d'information parlementaire d'Hervé Mariton, dont vous étiez proche. Il rend ses conclusions le 22 juin, quelques jours après votre discours de politique générale et reprend, sans dire explicitement qu'il faut privatiser, un certain nombre des remarques que vous faites. Y a-t-il une inspiration politique au fondement de ces conclusions, sachant que cette mission d'information n'est pas née totalement par hasard, mais après l'échec de plusieurs tentatives de privatisation, comme l'a rappelé Gilles de Robien et ainsi que vous venez de le faire. N'y avait-il pas là une mission « commandée » ? Cette décision de privatisation n'était-elle pas, en réalité, purement budgétaire ?
Il n'y avait aucune raison de penser que le travail n'avait pas été bien fait. Si un protocole est signé, on a plutôt tendance à s'en féliciter, en constatant que les négociations ont abouti.
Non. Je viens d'essayer de l'expliquer, elle était stratégique. Créer des lignes à grande vitesse, ce n'est pas une décision budgétaire. Désendetter l'État, est-ce une décision budgétaire ? C'est simplement rappeler qu'on ne peut pas faire n'importe quoi - message qui va être rappelé dans les cinq ans ou les dix ans à venir, car notre pays va connaître un tsunami économique et financier.
Nous sommes dans une situation de totale anomalie. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de chronocentrisme. De l'argent qui ne coûte rien, et les Français ayant le sentiment que l'on peut tout faire et tout se permettre sans limite de temps, c'est une situation ubuesque, qui ne durera pas. J'ai été un Premier ministre qui avait les pieds sur terre, qui a respecté une certaine pesanteur budgétaire, économique et politique et qui a fait preuve de responsabilité. Il est parfois plus simple de surfer sur la vague et de dépenser un argent qu'on n'a pas. Ce n'est pas l'idée que je me fais de l'État. Il y avait une exigence et une politique qui ont été celles de la rigueur. J'ai cité Raymond Barre tout à l'heure. Ce n'est pas un hasard si c'est la deuxième fois dans l'histoire de l'État des dernières décennies que, dans cette période (2005-2007), la dette de l'État a diminué. Ce n'était donc certainement pas une décision uniquement budgétaire. Nous avons relancé la croissance. Nous menions la bataille de l'emploi. Ce sont les entreprises qui créent des emplois parce qu'elles ont des perspectives. Il ne s'agissait pas uniquement d'appliquer une règle budgétaire comme on applique un couperet : il s'agissait d'avoir une vision et de renforcer l'économie française.
Par ailleurs, on se plaint tous les jours, aujourd'hui en France, de ne plus avoir d'industrie et de ne plus avoir de champions industriels français et européens. À travers la politique que j'ai menée à l'époque, avec Jacques Chirac (pôles de compétitivité, Agence de l'innovation industrielle, patriotisme économique), nous avons fait en sorte de défendre l'industrie française, de constituer des champions nationaux et européens capables de rivaliser dans les appels d'offres européens. C'est cela qui fait l'économie d'une nation. Nous sommes dans une époque déboussolée, où l'on dit et où l'on fait trop souvent n'importe quoi. Je le dis avec tristesse. Il peut paraître incongru qu'un Premier ministre, un président de la République, un ministre des Finances, un ministre des Transports aient pris des décisions fondées sur des exigences. Celles-ci existaient, y compris sur le plan budgétaire. Il y avait une volonté de rigueur. Mais il y avait surtout une vision.

Monsieur le Premier ministre, merci pour ce plaidoyer. Nous ne sommes pas en train de juger la politique que vous avez souhaité mener à cette époque. Nous nous demandons comment on en est arrivé à une situation dans laquelle les sociétés concessionnaires sont loin d'être perdantes. Quelles leçons retenir pour l'avenir ? Au fil du temps, ces concessions ont été prorogées un si grand nombre de fois qu'on peut se demander comment arrêter cette mécanique lorsque les échéances se profileront.
Comment l'État peut-il reprendre la main, en tout ou partie, peut-être en envisageant d'autres systèmes que les concessions (par exemple des régies intéressées) ? Comme vous venez de le dire, nous sommes aujourd'hui un peu déboussolés par différents facteurs. La pandémie n'est pas finie. Demain - 10 juillet - prend fin l'état d'urgence sanitaire. Or nous voyons que des clusters se reforment et que des pays referment leurs frontières.
Que préconiseriez-vous si vous étiez aujourd'hui aux manettes ?
Je me suis posée la question. Je pense que c'est parce qu'il contient une disposition fiscale. Le ministre du Budget, Christian Eckert, a également dit qu'il avait été écarté des discussions. Son directeur de cabinet aurait pu participer aux négociations. Cela aurait peut-être rendu les représentants de l'État plus forts. Or on découvre que le protocole contient une partie D, intitulée « Sécurité contractuelle et stabilité des prélèvements obligatoires ». Dans cette partie D, les sociétés d'autoroutes obtiennent la stabilité du régime de déductibilité fiscale des charges financières. À mon avis, la signature du ministre du Budget était obligatoire sur ce protocole, dès lors qu'il contenait des dispositions fiscales. Cet argument est d'ailleurs soulevé par Raymond Avrillier.
Supposons que le protocole soit annulé à l'issue de vos travaux. Ce serait là un point très important : l'État pourrait peut-être reprendre enfin la main, comme le suggère la Cour des comptes dans son dernier rapport sur le plan de relance autoroutier, c'est-à-dire discuter des concessions autoroutières et de la façon dont on pourrait rééquilibrer les choses au profit notamment de l'investissement dans le réseau secondaire, car au bout du compte, le système repose entièrement sur l'automobiliste. Il n'y a aucune raison qu'il paie toujours davantage un service qui ne s'améliore pas.
Il y a des ambiguïtés dans les fameux 3,2 milliards d'euros du plan de relance autoroutier. Personne n'était dupe : les sociétés qui font les travaux sur les autoroutes sont les mêmes que celles qui possèdent les entreprises de travaux publics, même si le contrôle effectué par les pouvoirs publics s'est amélioré, notamment grâce à la Commission européenne, qui a défini un certain nombre de règles.
Par ailleurs, dans le protocole, on affirme qu'à l'avenir c'est la loi qui décidera de l'allongement de la durée des concessions mais ce même protocole allonge cette durée de six ans ! Si le protocole était annulé, l'Assemblée nationale et le Sénat pourraient enfin mener un débat de fond pour déterminer l'avenir des concessions. Je pense que ce serait très salutaire.
Effectivement, madame la sénatrice, la grande question porte sur l'avenir. Vous évoquez la situation florissante des sociétés d'autoroutes. Il faut bien prendre la mesure de la situation. On a fait un procès d'intention aux sociétés d'autoroutes, au départ, au regard des dividendes considérables versés de 2006 à 2013. N'oublions pas quel est le modèle de la concession, qui s'articule autour de trois périodes. Il y a en particulier un moment à partir duquel les sociétés d'autoroutes doivent restituer les infrastructures sans contrepartie, pas même pour un euro symbolique. Il y a une naissance, une vie et une mort de ces contrats pour les sociétés d'autoroutes. À l'échéance de ces contrats, il faudra d'abord, pour les concessionnaires, avoir amorti les fonds propres. Le chiffre couramment cité est celui de 24 milliards d'euros. Il leur faudra régler l'intégralité de la dette des sociétés concessionnaires, estimée à environ 18 milliards d'euros. Il leur faudra aussi honorer les investissements de renouvellement et de modernisation soit environ 26 milliards d'euros. Enfin, il faudra rémunérer le capital investi. En cumulant la valeur des fonds propres, tout ceci représente 70 milliards d'euros. Il faut prendre en compte ce modèle particulier.
Je ne crois pas que les péages aient fait augmenter la valeur des sociétés concessionnaires. Il ne faut pas croire que l'État, seul, aurait réussi à s'arroger cette manne financière. Il faut prendre en compte les deux variables sur lesquelles agissent les sociétés d'autoroutes, à commencer par le niveau des taux d'intérêt. S'il y a un enrichissement sans cause, pour certains, des sociétés d'autoroutes, c'est en grande partie en raison des taux d'intérêt bas. L'État aurait-il pu profiter de ce contexte de bas taux d'intérêt ? C'est loin d'être évident, car l'AFIT ne peut se départir des règles de Maastricht ni se lancer dans des montages d'ingénierie financière comme le font des sociétés privées.
La seconde variable est le trafic. Depuis 2006, le secteur autoroutier a fait face à deux crises, celle de 2008 et la crise sanitaire de 2020. Les sociétés d'autoroutes ont-elles le même potentiel de croissance sur les prochaines années ? Existe-t-il une manne financière sur laquelle nous pourrions remettre la main ? Je crains qu'il n'y ait à bien des égards des illusions de ce point de vue.
Je crois que, dans l'avenir, il faut s'assurer que nous mettons en place un système où toutes les garanties sont prises. Ce sont notamment des garanties de durée, avec des clauses de rendez-vous. On cite toujours l'arrêt du Conseil d'État commune d'Olivet de 2009, qui permet, en cas de rentabilité excessive, de reprendre la main. Une clause, dans les cahiers des charges que nous avons fait insérer en 2006, permettait aussi d'éviter certains abus.
Je regrette qu'on ait allongé excessivement la durée des concessions car ceci éloigne ce rendez-vous, lequel ne pouvait avoir lieu, en 2005-2006, en tout cas pas de façon si simple que beaucoup le disent. Dans un État moderne et dans un monde globalisé où les imprévus sont nombreux, les durées longues sont très dangereuses.
Il ne faut pas abandonner les péages. Nous voyons bien que ce modèle est aujourd'hui en question, car la question de l'acceptabilité des péages est posée. Il y a un ras-le-bol des Français, en particulier au regard des trajets du quotidien. Néanmoins ce principe fonde, aujourd'hui, l'équilibre du système. Il faut réparer ce modèle et préparer un nouveau modèle. Il faut aussi remettre en concurrence l'ensemble des concessions avant leur réattribution. En respectant ces quatre règles, nous avons de quoi recaler le dispositif autoroutier.
Faut-il envisager la renationalisation des autoroutes et reprendre la main en régie, comme je l'entends ici et là ? Si l'État ne parvient pas à réaliser les moindres travaux et s'il a parfois payé très cher, à son détriment, en allongeant la durée des concessions, la délégation de travaux à des sociétés d'autoroutes alors qu'il aurait peut-être pu les faire lui-même, c'est bien parce que nous n'avons pas les moyens. L'idée de reprendre la main me paraît, sauf retour à la vertu (qui n'est pas dans l'esprit du jour) sympathique mais un peu ubuesque.

Nous partageons les souhaits d'exigence et de rigueur que vous avez exprimés. Il existe effectivement un besoin de transparence, laquelle n'a pas toujours été de mise en matière de concessions autoroutières. Vous indiquez que Monsieur Perben avait inclus cette exigence vis-à-vis des sociétés concessionnaires et que ce principe de transparence n'a pas été mis en oeuvre par la suite. Pourquoi, selon vous, le concédant, c'est-à-dire les services de l'État, ne sont pas parvenus à obtenir cette clarté - que notre commission d'enquête doit contribuer à établir ?
Nous estimons aussi que, s'agissant de contrats de longue durée, des clauses de rendez-vous sont nécessaires. Quelle serait la fréquence idéale à vos yeux ?
Selon moi, l'État devrait remettre en concurrence les concessions ou décider, dans le cadre de cette remise en concurrence, de reprendre éventuellement une partie du réseau en régie. Ce ne serait pas pour des raisons idéologiques mais pour que les recettes perçues sur l'automobiliste reviennent à l'automobiliste plutôt que d'alimenter le versement de dividendes ou les résultats économiques d'autres sociétés chargées des travaux. Ces recettes doivent revenir dans l'escarcelle de l'État et de l'automobiliste.
Je trouve le rapport de la Cour des comptes limpide de ce point de vue. Il réaffirme un discours que la Cour a toujours tenu : lorsqu'il y a des marchandages, l'État est toujours désavantagé, car les sociétés d'autoroutes, bien accompagnées, font valoir leurs contrats de concession qu'elles considèrent comme immuables.
Je prends un exemple de ce qui avait été décidé en 2006. Nous avions prévu que le commissaire du gouvernement puisse participer au conseil d'administration des sociétés concessionnaires. Depuis cette date, il pratique la politique de la chaise vide dans ses conseils. Cela montre que la question des autoroutes et du rapport avec le concessionnaire est traitée à un échelon technique et non, comme ce devrait être le cas, sous un angle stratégique. Le commissaire du gouvernement qui participerait à des conseils d'administration doit bien sûr être informé au préalable et recevoir des instructions de son cabinet, voire du ministre. C'est un travail de coordination et de préparation qui est lourd et difficile mais tel est le travail de l'État. C'est ce qui a fait défaut. Je ne veux pas taper sur un État que j'ai servi durant des décennies. Je suis moi-même fonctionnaire et j'ai un immense respect pour l'État. Mais il est vrai que de nombreuses choses se sont délitées. De nombreuses choses qui sont dans la main de l'État ne sont pas faites avec suffisamment d'exigence.
Parmi les clauses contractuelles qui avaient été décidées figuraient par exemple l'augmentation du montant des pénalités de retard et d'exploitation dues par le concessionnaire en cas de manquement à l'une de ses obligations au titre du cahier des charges, ou encore la compensation du gain éventuel lié à un décalage dans le temps des travaux prévus. En écoutant Ségolène Royal relater ce qui s'est passé en 2015, nous voyons bien que l'État n'a pas fait son travail. Je le déplore, car il a toute la capacité juridique de le faire. Cette question des autoroutes est une immense question politique dans notre pays. Je l'ai bien vu depuis que j'ai quitté Matignon. Il y a une bataille des autoroutes en France. Ce n'est peut-être pas l'équivalent de la bataille sur le voile à l'école, ni de celle du prix de l'essence ou la question des trimestres des cotisations retraite. Mais c'est une bataille importante sur le plan symbolique. L'affaire des Gilets jaunes montre que ce sont des choses qu'il faut prendre au sérieux. Or cette bataille des autoroutes résulte de trois circonstances qu'il faut avoir à l'esprit.
Il y a d'abord un enjeu de proximité, vécu par tous les Français. C'est un enjeu global, où se mêlent toutes les problématiques qui sont d'actualité aujourd'hui (environnementales, sociales, économiques, politiques). C'est une question concrète sur laquelle viennent se cristalliser tous les débats politiques. C'est enfin un enjeu de long terme, car il témoigne de l'évolution de nos sociétés et de nos économies (évolution des taux d'intérêt, rôle de la voiture dans nos sociétés).
Or, depuis 2006, de nombreuses polémiques et malentendus ont émaillé ce débat. La privatisation de 2006 est perçue dans l'opinion publique comme une rupture. On veut croire qu'avant 2006, tout était réglé. J'ai rappelé qu'il n'en était rien (impasse de financement, absence de marges de manoeuvre en matière d'investissements publics).
Après cette opération, un deuxième moment de tension et de polémique s'est produit en 2008-2009 avec les rapports de la Cour des comptes se référant au prix de vente et au taux d'actualisation. Dans les deux cas, ce sont des notes de bas de page. Voyons l'effort qu'il faut faire, en matière de communication, pour transformer des notes de bas en page en mises en cause d'une politique. C'est dire à quel point on peut affirmer n'importe quoi dans le monde d'aujourd'hui.
Une nouvelle crise est survenue avec la multiplication des rapports en 2013-2014 (Autorité de la concurrence, Cour des comptes, Sénat, Assemblée nationale), liés à la prolongation des contrats de concession, acceptée à deux reprises par l'État, en 2010 et en 2015. À chaque fois, nous retrouvons, depuis cette période, la question du déséquilibre des relations entre l'État et les concessionnaires. La Cour des comptes a calculé que le plan de 2015 allait rapporter aux sociétés concessionnaires cinq fois leur mise à travers les 3,2 milliards d'euros d'engagements initiaux.
Dans ce contexte, il me semble essentiel de remettre à plat ce dossier et en particulier les points suivants : les contrats entre l'État et les concessionnaires ; les tarifs ; l'actionnariat (public ou privé) ; la révision des causes tarifaires ; les avenants, en particulier ceux postérieurs à 2005 ; les contrôles et la régulation.
C'est tout le travail de votre commission d'enquête : il faut essayer, sur chacun de ces points, d'identifier où des dysfonctionnements ont pu se produire. J'ai le sentiment que la décision de 2005 a constitué un bouc émissaire commode. Cette présentation est pour le moins discutable, d'autant plus que de nombreux acteurs de la période antérieure à 2005 ont eu des responsabilités importantes après 2005 et connaissent donc bien le dossier.
Il y a trois anachronismes sur ce dossier : l'illusion d'un passé glorieux, qui n'existe pas ; la confusion de la distance, qui écrase les différentes strates de temps ; l'oubli des différents contextes dans lesquels on a agi.
Je crois qu'on peut établir un parallélisme, toutes proportions gardées, entre cette bataille des autoroutes et la question sanitaire aujourd'hui. On voit bien que les décisions prises par Édouard Philippe ont essuyé des critiques sur le thème d'une gestion sanitaire qui aurait été privilégiée au détriment de la situation économique. A la rentrée, on ne parlera que d'économie (sauf s'il y a une deuxième vague) et de la faillite de l'économie française. Il faudra trouver un coupable et on aura oublié le contexte dans lequel la question sanitaire se posait.
La tentation existe de rejouer indéfiniment les batailles du passé. Je suis heureux que vous puissiez recaler les choses et rappeler les contraintes qui ont existé à chacune des époques, sans céder à la facilité consistant à estimer que tous les malheurs du jour incombent à une date ou à une décision.

Madame la ministre, vos propos corroborent ce que nous avons entendu dans d'autres auditions mais cela ne peut que nous inquiéter. D'autres personnes auditionnées ont en effet souligné que l'État ne pouvait être que désavantagé dans ses relations avec les sociétés concessionnaires d'autoroutes.
Cela m'étonne, car ceux qui négocient au titre de l'État ont de l'expérience. Ils ont les mêmes formations que ceux qui leur font face. Ce sont, typiquement, des X-Ponts et des X-Mines. Comment l'État peut-il se trouver désavantagé ?
Et qui, finalement, a pris la décision de privatiser ces sociétés ? Je ne parviens toujours pas à le comprendre. J'avais trouvé particulièrement intéressants les propos de Gilles de Robien, qui avait compris ce qu'il se passait.

Merci monsieur le Premier ministre. Pour vous assurer que nous ne céderons pas à la facilité, je voudrais souligner l'engagement de notre rapporteur et le nombre très important d'auditions prévues par notre commission.
Je vous remercie, moi aussi, monsieur le Premier ministre, pour votre préparation de cette audition qui fut très riche.
Merci, chers collègues, pour votre participation.
La réunion est close à 17 h 20.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
Absolument. Il avait tout compris.

D'après ce qu'il nous a dit, il a essayé d'alerter d'autres responsables politiques. On a quand même eu l'impression que l'État vendait les bijoux de famille mais on ne sait toujours pas pourquoi cette décision a été prise ni par qui elle l'a été et dans quel but. Avez-vous pu déterminer qui était à la manoeuvre ?
La décision de privatisation a été prise par le gouvernement de Dominique de Villepin, à l'encontre de ce qu'avait préconisé Gilles de Robien. Était-ce pour des raisons idéologiques ? Je l'ignore.
À partir de ce moment-là, les sociétés d'autoroutes ont bénéficié d'un rapport de force à leur avantage. Par la suite, elles ont continué à profiter de ce rapport de force puisqu'elles étaient désormais titulaires des contrats de concession.
Elles ont d'ailleurs une expression extravagante pour qualifier la situation : elles affirment qu'à partir du moment où un contrat a été signé, celui-ci est par définition égalitaire et ne peut pas être remis en cause. Pourtant, selon moi, dès lors que les institutions de contrôle de la dépense publique de l'État, et en particulier la Cour des comptes, estiment que cela ne va pas, il faut en prendre acte et y remettre bon ordre. Ce ne sont pas des choix idéologiques. J'ai d'ailleurs cité à dessein des élus de différentes étiquettes politiques, qui ont simplement le sens de l'État, le souci de protéger le contribuable et l'usager, et surtout de réaliser des travaux sur nos routes.
Dans ma région Poitou-Charentes, les petites communes n'avaient pas les moyens de refaire leurs infrastructures. On voyait, pendant ce temps-là, plusieurs milliards de dividendes versés aux sociétés concessionnaires d'autoroutes. Cela ne va pas. Donc on rééquilibre les choses. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour ce faire.

Madame la ministre, je profite de votre présence et de votre caractère pour vous poser une question un peu iconoclaste. En vous entendant, j'ai l'impression que Bercy a une position immuable et s'inscrit systématiquement dans une logique de choix à très court terme (privatisation des autoroutes, privatisation d'Aéroports de Paris-ADP, privatisation de la Française des Jeux) : on capte une manne, à un instant donné, considérant que cela permettra d'équilibrer le budget de l'État.
Pour ma part, je suis assez choqué que l'on cherche toujours à privatiser ce qui est rentable. On pourrait ne pas s'interdire, du point de vue de l'État, d'encaisser des recettes, a fortiori lorsqu'il s'agit d'infrastructures stratégiques pour l'aménagement du territoire.
Dans cette affaire, est-ce la capacité de Matignon à s'imposer face à Bercy qui est en cause ou s'agit-il de choix politiques de l'instant ?
Sans doute est-ce un peu les deux, même si, dans ce dossier autoroutier, le ministère du Budget a été écarté. Peut-être aurait-il été plus rigoureux sur la question des tarifs et plus enclin à suivre les rapports de la Cour des comptes. C'est pourquoi il est étrange que M. Eckert ait été écarté de la négociation. Cela aurait pu permettre à l'État de peser davantage dans la négociation.
Il existe effectivement une idéologie de la privatisation, consistant à penser que ce qui est privé est mieux géré que ce qui est public. Ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas les mêmes secteurs. Il faut une complémentarité. Il faut des choses privées, des choses publiques. Il n'y a aucune raison de transférer au privé ce qui est rentable.
D'ailleurs, lorsque la crise économique liée à la pandémie de Covid-19 est survenue, il n'a plus été question de lancer le projet de privatisation d'Aéroports de Paris (ADP), ce qui prouve bien que les privatisations sont uniquement lancées lorsqu'une infrastructure rapporte de l'argent. Or ces bénéfices pourraient utilement être réinvestis par l'État là où des besoins existent.
De même, la privatisation de la Française des Jeux (FDJ) m'a beaucoup choquée. Cette entreprise avait été créée après la guerre et elle n'a pas hésité a diffusé une publicité pour vendre ses actions dans laquelle on voyait les gueules cassées de la guerre de 1914. Cela revient à instrumentaliser la souffrance des soldats. Peut-être y avait-il une partie de la FDJ que l'on pouvait privatiser mais on aurait pu avoir un système mixte pour que l'État continue de bénéficier de ses dividendes et puisse réinvestir cet argent dans l'hôpital public, puisque nous étions confrontés à la crise sanitaire.
L'État ne doit pas se dessaisir de ce qui rapporte, faute de quoi une partie de l'argent s'échappe vers les dividendes et vers les opérations boursières, en diminuant d'autant sa capacité d'intervention.

Vous avez pointé du doigt, madame la ministre, le besoin d'investissement sur le réseau secondaire, notamment dans les ouvrages d'art. La commission du Sénat de l'aménagement du territoire et du développement durable a publié un rapport sur l'état de nos ouvrages d'art. Je suis donc particulièrement sensible à cette question.
Vous soulignez également qu'il n'y a peut-être de l'idéologie dans le choix consistant à privatiser ou non une infrastructure. Pour autant, il m'apparaît utile, même dans le cas où l'on s'oriente vers des concessions, de conserver tout ou partie du réseau en gestion publique de façon à disposer d'un référentiel pour la gestion, dans le temps, de ces infrastructures.
Compte tenu notamment des recherches que vous avez effectuées sur Légifrance pour préparer cette audition, à quel(s) moment(s) clé(s) s'oriente-t-on, dans le dossier dont nous parlons ici, vers une décision qui devient quasiment irréversible - abstraction faite des pistes que vous venez de nous donner pour envisager de dénoncer les contrats et renégocier un contrat un peu plus équilibré ? Je précise que je souscris pleinement aux deux exemples que vous avez cités, Aéroports de Paris et la Française des Jeux.
Je pense que le moment clé est celui où on ne donne pas suite fermement aux demandes des parlementaires, au regard de la double hypothèse de dénonciation ou de renégociation des contrats, bien que celle-ci ait pourtant été évoquée dans la lettre du Premier ministre. Dès lors qu'on délègue ensuite la négociation aux directeurs de cabinet, avec un pilotage direct par Matignon, il n'y a plus de politique. Les sénateurs sont dessaisis, de même que les députés. Il n'y a plus de débat à l'Assemblée. Nous voyons surgir un protocole contenant deux choses choquantes.
La première est la prolongation de six ans de la durée des concessions autoroutières. C'est une poule aux oeufs d'or, un extraordinaire cadeau financier. Regardez d'ailleurs les cours de bourse des sociétés concernées au moment de cette annonce.
La deuxième incongruité est la surcompensation du rattrapage tarifaire. Celui-ci n'était aucunement obligatoire. Les tarifs doivent pouvoir augmenter, puis baisser, en fonction de l'évolution du volume de trafic sur les autoroutes et pas le beurre et l'argent du beurre. Faute d'une contradiction suffisante face à elles, les sociétés ont réussi à faire croire à tous leurs interlocuteurs au sein de l'État que les tarifs devaient augmenter tous les ans.
La Cour des comptes et la Commission européenne indiquent pourtant clairement que les tarifs peuvent augmenter ou diminuer. Si la rentabilité augmente, une partie devrait pouvoir est reversée à l'État. C'est ce qui aurait dû être prévu dans le contrat de concession, avec une décision annuelle de l'État pour examiner quelle a été l'évolution du trafic et protéger les automobilistes.
Une baisse des tarifs autoroutiers devrait vraiment être possible, bien que cela ne se soit jamais produit. C'est ce que j'aurais aimé que nous négociions. Mais cela n'a pas été négocié, car il existe une forme de consanguinité entre les personnes autour de la table, du côté de sociétés d'autoroutes et des représentants de l'État. Les participants à la négociation se tutoyaient... Il n'y avait plus de liberté de penser.
Je vais vous raconter une anecdote au sujet des négociations avec les sociétés concessionnaires d'autoroutes en 2015. La première réunion a lieu dans le bureau du Premier ministre. Nous voyons arriver tous les patrons des sociétés d'autoroutes. Je connaissais certains d'entre eux. Face à eux se trouvent les ministres et leurs directeurs de cabinet. Il n'y ni la Cour des comptes ni nos conseillers ni les parlementaires, alors que les sociétés d'autoroutes viennent avec leurs avocats et leurs lobbyistes.
Devinez qui a pris la parole au nom des sociétés d'autoroutes ? C'était Alain Minc. Alors que je m'étonne de sa présence auprès des sociétés d'autoroutes, il me répond que c'est lui qui les représente. Il conduit alors la discussion, en employant toutes les techniques du business, alors que tel n'était pas l'état d'esprit des représentants de l'État. Dans un premier temps, il invoque la crise. La deuxième partie du raisonnement est connue : il évoque les contrats qui lient l'État aux sociétés concessionnaires d'autoroutes. « La parole de l'État, c'est très important. Si vous ne respectez pas la parole de l'État, vous ne serez vous-même plus respecté, monsieur le Premier ministre ». Dès lors, il n'y a plus de marge de manoeuvre. On voit d'ailleurs que ce discours est repris par ceux qui ont négocié pour le compte de l'État : « il n'y a pas de marge de manoeuvre », disent-ils. « On a signé. Il y a des contrats ».
Troisième élément du discours des sociétés, la privatisation constitue une très mauvaise affaire pour les sociétés d'autoroutes. « Finalement, cela nous a coûté beaucoup plus cher que cela ne nous a rapporté ». Plus c'est gros plus cela passe. Je ne me suis pas privée de leur dire alors, « si c'est une mauvaise affaire, rendez-les nous ! ».
Un autre exemple illustre cette confusion des genres. Lorsque j'ai eu à traiter le problème des rejets de boues rouges en Méditerranée, l'entreprise concernée est venue pour que je négocie avec elle. Son lobbyiste était l'ancien directeur général des collectivités locales du ministère de l'Intérieur. Ces interlocuteurs sont d'emblée dans le rapport de force et dans la discussion d'affaires à leur profit. Nous devons, face à eux, être armés, solides et surtout ne pas être isolés. Les missions d'information et les commissions d'enquête parlementaires devraient être intégrées à ces discussions.
Certains hauts fonctionnaires pensent qu'ils savent mieux que nous. Le problème vient de cet affaiblissement de l'autorité politique : « non, on va faire différemment », « non, il y a peut-être d'autres solutions », « non, vous n'avez pas lu tous les scénarios possibles », « non, les parlementaires n'ont pas dit cela », « non, la Cour des comptes n'a pas dit cela, vous allez faire ce que la Cour des comptes a dit ». Lorsque vous voyez la réponse du ministère au référé de la Cour des comptes de 2019 sur le plan de relance autoroutier, les bras vous en tombent !
C'est comme si la Cour des comptes était un adversaire. Or, elle n'est pas un adversaire mais un partenaire. Il faut s'appuyer sur ses observations pour améliorer le fonctionnement des institutions et obtenir des arbitrages intelligents avec les autres ministères. Lorsque j'étais ministre, il m'est arrivé plusieurs fois de modifier de ma main les réponses aux référés et aux observations de la Cour des comptes que me préparaient mes services pour lui donner raison, car l'état d'esprit qui domine est toujours celui selon lequel l'administration a raison sur tout. C'est un état d'esprit particulier qu'il faut faire évoluer.

Madame la ministre, et madame la présidente de région, je n'ai pas le sentiment, comme d'autres collègues ici probablement, en tant qu'ancien maire et président d'un conseil départemental (celui du Pas-de-Calais) d'un rapport de forces tel que celui que vous décrivez entre le politique et l'administration qui sert la collectivité. J'ai plutôt l'impression qu'un équilibre des forces s'établit et que chaque fois que le politique est faible, naît effectivement le risque d'une dérive de l'administration, qui pourrait s'autoriser un certain nombre de choses. Partagez-vous ce point de vue, s'agissant des collectivités territoriales ? Pourquoi n'arriverions-nous pas à un tel équilibre au niveau de la haute fonction publique et des ministres qui représentent l'État sur des sujets aussi importants et délicats que la négociation de ces contrats de concessions autoroutières ?
Je crois que la différence vient du fait que lorsqu'on a à régler des problèmes de proximité, on partage en priorité des points de vue quant aux résultats à obtenir, dans l'intérêt des habitants d'un territoire. Cela crée des synergies. Cela dit, globalement, pour le reste des dossiers, l'administration est à l'offensive, dynamique, compétente, etc. Sur ce sujet des autoroutes, les choses n'ont pas fonctionné comme elles auraient dû.

Au fur et à mesure que nos travaux avancent, nous avons un peu le sentiment qu'il y a un avant 2015 et un après 2015 dans le contrôle exercé sur les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Partagez-vous cette impression d'un moment important, en 2015, de rééquilibrage dans le dialogue vis-à-vis des sociétés d'autoroutes (même s'il reste du chemin à faire) ?
Oui, forcément, puisqu'elles ont obtenu tout ce qu'elles voulaient. Même le versement à l'AFITF est déductible de l'impôt sur les sociétés. C'est l'État qui en paie la moitié, ce qui est extravagant.
Un rééquilibrage s'est produit dans la mesure où la loi prévoit désormais une autorisation législative pour l'allongement des concessions mais cet allongement leur a été donné, ce qui reporte l'échéance à...
Il faut continuer de discuter et de négocier. Surtout, il faut suivre les recommandations de la Cour des comptes. L'important, ce sont les marges de manoeuvre dont on dispose. Il faut cesser d'être naïf et adopter, au profit de l'État, l'état d'esprit « business » qui anime les sociétés. La Cour des comptes demande qui contrôle les projets d'investissement. Les concessionnaires ont promis 3,2 milliards d'euros d'investissements dans le cadre du plan de relance autoroutier. Ils avaient déjà promis d'autres investissements auparavant. Ces travaux sont-ils réalisés ? C'est la première chose à vérifier. Relevaient-ils déjà de l'obligation des concessionnaires ou s'agissait-il de travaux supplémentaires ?
Pourrions-nous faire réviser cette liste, en fonction par exemple des attentes des élus locaux ? Si l'on découvre que, parmi les 3,2 milliards d'euros de travaux prévus, une grande partie d'entre eux était de toute façon à la charge des sociétés, je pense qu'il faut le dire. Je ne sais pas quelle est la part de ces travaux qui relevaient en fait de leurs obligations contractuelles. L'ART pourrait le dire. Elle a d'ailleurs commencé à s'y atteler.
Cet argent pourrait être récupéré pour l'AFITF. Nous pourrions demander parallèlement aux élus locaux d'établir la liste des chantiers à réaliser sur leurs territoires. Cela accélérerait les investissements et la sortie de crise. Les élargissements d'autoroutes ont été présentés par les sociétés comme des investissements supplémentaires alors qu'ils font partie de leurs obligations de concessionnaires : lorsque le volume augmente, elles doivent élargir les voies. Cela n'apporte pas de services nouveaux à l'automobiliste.

Il y aurait beaucoup de choses à relever dans vos observations, dont nous pourrions débattre. Il est vrai que du point de vue des rapports entre les élus et l'administration, j'ai toujours plaidé pour que la décision revienne aux élus. Ils sont parfois coincés par l'administration ou pris de court. C'est un peu l'impression que j'ai en vous écoutant, à propos de ce protocole de 2015. Vous aviez d'autres dossiers importants à traiter par ailleurs et peut-être avez-vous manqué de vigilance.

Ne regrettez-vous pas de ne pas avoir regardé les choses d'un peu plus près ?
En 2015, nous avons négocié l'accord de Paris sur le climat. J'ai porté la loi de transition énergétique que je voulais absolument pouvoir promulguer en août, justement avant la conférence de Paris sur le climat. Il y avait des textes d'application à prendre. Et puis le dossier des autoroutes était piloté directement par Matignon. Si un groupe de personnes négocie et fait bien ce travail, je n'ai pas de raison de m'inquiéter. Je ne suis pas tentaculaire. Je délègue beaucoup.

Mais a posteriori, vous nous dites que le protocole n'est pas équilibré. Lorsqu'on signe un contrat, on estime que son contenu est équilibré. Quand on signe un avenant ou un protocole, cela signifie que les deux parties sont d'accord, sauf que dans le cas présent les hypothèses retenues étaient très favorables aux sociétés d'autoroutes, notamment le taux d'actualisation de 8 %. Ce n'est pas ce que proposait le concédant mais c'est finalement a été retenu dans le protocole. L'application de ce taux d'actualisation joue beaucoup sur la rentabilité et sur les retours que peuvent en attendre les concessionnaires.
Ce point n'a jamais fait l'objet d'une discussion ni d'un arbitrage interministériel.

On commence à en parler. La situation a sans doute évolué depuis lors. C'est la raison pour laquelle il nous semble qu'il y a un « avant » et un « après » 2015. Le concédant estime qu'il existe un rapport de forces déséquilibré au profit des concessionnaires alors que ceux-ci expliquent que l'État est trop puissant et qu'il y a trop de contrôles.

C'est le discours qu'ils nous ont tenu. Cela ne veut pas dire que nous les croyons.
Si les autoroutes sont une mauvaise affaire, qu'elles nous les rendent !

Elles ne nous ont pas dit que ce n'était pas intéressant pour elles. En outre, tous ceux qui s'intéressent aux concessions savent que c'est vers la fin des concessions que le concessionnaire dégage le plus de revenus. Au début, la concession est mise en place car la puissance publique ne souhaite pas ou n'est pas en mesure d'investir. Le concessionnaire se rémunère sur la durée du contrat - plus ou moins longue selon l'importance de l'investissement initial.
En tant qu'élu pragmatique, je n'ai pas d'opposition à ce principe, a fortiori dans l'état actuel de nos finances publiques. Si le réseau secondaire est dans l'état que nous connaissons, c'est aussi parce que le budget de l'État ne nous permet pas d'effectuer les investissements nécessaires. Si un partenaire accepte de réaliser ces investissements à notre place et se rémunère de façon normale, il n'y a rien de choquant à cela. C'est le niveau de rémunération qui doit être discuté.

Bien sûr. Nous porterons aussi un regard sur ce niveau de rémunération dans notre rapport.
Je vous entends également dire que la Cour des comptes n'est pas toujours considérée comme un partenaire par les ministères, alors que cette institution sert effectivement l'intérêt général et apporte des éléments qui doivent renforcer l'État concédant. Si l'on considère qu'il existe un déséquilibre en faveur des sociétés d'autoroutes (qui viennent avec leurs avocats, leurs lobbyistes, etc.), comment faire ? Le plan de relance autoroutier, en 2015, portait sur 3,2 milliards d'euros. Le plan d'investissement autoroutier défini par la suite était initialement doté de 2 milliards. Son montant a été ramené à 800 millions d'euros car l'ART a examiné avec attention les opérations proposées par les sociétés concessionnaires et en a retiré un certain nombre, considérant qu'elles figuraient déjà dans les contrats. Nous nous sommes rendus auprès de l'Autorité de Régulation des Transports et de la DGITM. Nous avons appris que des discussions étaient en cours, car je demandais si ces investissements prévus dans les contrats avaient effectivement été réalisés. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de compensation qu'ils ne doivent pas l'être.

Nous sommes en train d'examiner cet aspect.
En dehors des pouvoirs conférés à l'ART dans le domaine autoroutier, que serait-il possible de faire pour rééquilibrer le rapport de force entre l'État et les sociétés d'autoroutes ?
Il y a des choses très simples à faire, en commençant par le contrôle des travaux réalisés dans le cadre du plan de relance autoroutier.

C'est en cours. L'ART et la DGITM s'y attellent, de façon très détaillée. Il s'agit notamment d'examiner la nature des travaux et la date à laquelle ils ont été réalisés, en comparant avec la date à laquelle ils devaient l'être. Des investissements seront demandés aux concessionnaires, le cas échéant, pour réaliser des travaux complémentaires.
Par ailleurs, il ne faut pas allonger la durée des concessions. C'est un cadeau énorme. Les sociétés n'en disent pas mot car c'est le point financièrement le plus avantageux pour elles. L'État pourrait vendre cet allongement, remettre en concurrence la concession, en obtenant des tarifs plus avantageux ou des prestations supplémentaires pour l'automobiliste. J'ai demandé par exemple aux sociétés d'autoroutes pourquoi le péage du dimanche soir n'était pas gratuit. Les gens attendent des heures au péage et paient cher l'autoroute. Je leur suggérais de rendre le péage gratuit pour toutes les voitures électriques. Les concessionnaires n'ont rien fait. En remettant le service en concurrence, je suis sûre que nous obtiendrions des prestations pour l'automobiliste et peut-être des prix inférieurs.
La variabilité des tarifs, en fonction du volume de véhicules en circulation, doit aussi s'appliquer, ce qui n'a jamais été fait. Lorsque le volume de véhicules en circulation s'est accru, les sociétés ont vu leur chiffre d'affaires s'accroître mais ont continué d'augmenter les tarifs. L'automobiliste a continué de payer.

Dans ce que vous dites, il y a des choses que je partage et des éléments qui sont peut-être plus discutables.
J'ai pour ma part l'impression que les services de l'État sont assez bien coordonnés aujourd'hui : la DGITM et l'ART travaillent de plus en plus main dans la main. Ce n'est peut-être pas le cas vis-à-vis du Conseil d'État et de la Cour des comptes, ce qui est moins surprenant dans la mesure où ce sont des institutions indépendantes.
Il faut aussi que le ministère du Budget soit plus impliqué.

Merci madame la ministre et merci monsieur le rapporteur.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.

Mes chers collègues, monsieur le Premier ministre, nous poursuivons nos auditions sur les concessions autoroutières en entendant monsieur Dominique de Villepin, que je n'ai pas besoin de présenter. Je rappelle que vous étiez Premier ministre en 2006, au moment de la privatisation des sociétés concessionnaires d'autoroutes, qui sont au centre des travaux de notre commission d'enquête.
Cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Elle est ouverte à la presse et fera l'objet d'un compte-rendu publié.
Monsieur le Premier ministre, il y a toujours une étape formelle au début de ces auditions. Je vous remercie de vous être rendu à notre convocation. Je rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 43413, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite à prêter serment en levant la main droite et en jurant de dire toute la vérité, rien que la vérité.

Merci monsieur le Premier ministre.
Après votre propos liminaire, je passerai la parole à notre rapporteur, Vincent Delahaye, qui vous posera des questions précises.
Merci infiniment, monsieur le président. Je suis très heureux d'être devant votre commission d'enquête sur un sujet aussi important. Cela permet de dire des choses qui, je crois, n'ont pas été dites. J'en suis très heureux également car il s'agit du Sénat. Comme vous le savez, mon père a été président de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées durant de nombreuses années. Il a démissionné le jour de ma nomination comme ministre des Affaires étrangères.
Il y a quinze ans, mon gouvernement a décidé, sous l'autorité du président de la République, la cession par l'État de ses participations dans les sociétés concessionnaires d'autoroutes qu'il détenait encore. Il vous appartient, dans le cadre de votre commission d'enquête, d'apprécier les conditions dans lesquelles cette décision a été prise.
Je voudrais en préambule rappeler les quatre questions qui se posaient à l'époque, en vous demandant de bien vouloir garder à l'esprit une considération essentielle : le choix de 2005 sur les autoroutes ne peut pas être dissocié de la stratégie globale choisie par mon gouvernement.
Pourquoi ce choix d'une cession ?
Ce choix est fondé sur une conviction. Pour avancer, s'adapter, se réformer, la France a besoin d'un État fort, ce qui implique une certaine idée de l'État, soumis à une triple exigence. La première était celle d'unité nationale. Le défi était de taille après le 21 avril 2002 et le référendum constitutionnel européen manqué. La deuxième était une exigence de consolidation et donc de rigueur, car il faut tenir les cordons de la bourse.
Il y avait enfin une exigence de modernisation, pour adapter la France à un monde qui bouge. Rappelons, d'un côté, l'entrée de la Chine à l'OMC, en 2001 et de l'autre les efforts de l'Allemagne dans le cadre de l'Agenda 2010. Cette idée de l'État s'incarne dans une stratégie économique que j'ai présentée lors de ma déclaration de politique générale, avec pour question centrale comment retrouver des marges de manoeuvre pour engager la bataille de l'emploi, investir dans l'avenir et se désendetter ?
Ma responsabilité était, sans renoncer aux principes essentiels, d'arbitrer entre différentes exigences, c'est-à-dire préparer l'avenir par une stratégie industrielle, une politique d'innovation et de compétitivité ambitieuse, mais aussi se désendetter pour préserver notre souveraineté. Avec Thierry Breton, nous avons mené cette bataille, désireux de créer plus de conscience collective. C'est le sens du rapport commandé à Michel Pébereau, comme de l'organisation de la première conférence des finances publiques avec les représentants des collectivités territoriales et des partenaires sociaux. Nous n'avons pas cédé face à Bercy contre le ministère des Transports. Nous avons pris en compte l'exigence de réduction de la dette portée par le ministère de l'Économie tout en donnant au ministère des Transports les moyens d'investir.
En matière de transports, nous avons voulu aussi être à l'initiative. En 2005, le secteur des autoroutes était arrivé à maturité et nous étions, pour mener à bien la modernisation de nos transports, face à une double impasse, avec d'abord une impasse de financement. On avait pu croire avec la création de l'AFIT, en 2003, que les questions de financement des infrastructures de transport étaient résolues. Malheureusement, dans les mois qui ont suivi, la capacité à investir n'était pas au rendez-vous. Les dividendes autoroutiers affectés à l'AFIT ne représentaient que 332 millions d'euros en 2005, ce qui ne nous donnait pas de marges de manoeuvre pour un plan de relance. Le budget de l'AFIT, en 2005, n'était que de 1 milliard d'euros et largement affecté à des investissements déjà lancés.
La seconde impasse était une impasse de gouvernance dans la gestion des sociétés d'autoroutes, l'État étant des deux côtés de la table, se retrouvant juge et partie, actionnaire et régulateur, concédant et concessionnaire, pris entre des exigences contradictoires. Ainsi, l'État, comme les autres actionnaires des sociétés d'autoroutes, avait intérêt à des dividendes élevés, ce qui n'allait pas dans le sens de la protection des usagers contre les hausses de tarifs. La Cour des Comptes a ainsi souligné dans son rapport de 2008 un certain nombre de dérives anciennes (coups de pouce tarifaires non justifiés et pratique du foisonnement consistant à affecter les hausses de péage aux sections à fort trafic). Les administrateurs représentant l'État au conseil d'administration des sociétés concessionnaires se trouvaient en outre tiraillés entre les intérêts de l'État concédant et ceux des sociétés, qu'ils devaient, comme tout administrateur, défendre en priorité. En particulier les représentants de l'État ne pouvaient pas participer aux décisions du conseil d'administration sur les relations avec l'État, notamment sur les contrats de concession, au titre de leurs responsabilités générales de mandataire social devant agir dans l'intérêt social du concessionnaire et dans le cadre du régime spécifique des conventions réglementées.
Ce n'était évidemment pas le cas des autres administrateurs et en particulier des actionnaires privés minoritaires. Ainsi, du fait de l'alignement sur le droit commun des sociétés d'autoroutes et de la présence d'actionnaires privés à ses côtés, l'État était en fait devenu un actionnaire en grande partie passif, soumis aux décisions des actionnaires minoritaires, se contentant d'encaisser année après année sa part de dividende. On le voit bien à travers ces difficultés de gouvernance, l'État est pleinement dans son rôle lorsqu'il est autorité organisatrice, lorsqu'il est concédant. En tant qu'actionnaire de sociétés concessionnaires, il ne peut jouer qu'un rôle limité. Dans ce contexte, nous avons jugé nécessaire de clarifier la position de l'État, de sortir de cette situation d'un État empêché financièrement et juridiquement.
Deuxième grande question, quels sont le champ et la portée de notre décision ? Gouverner, c'est choisir. Ne pas choisir, c'est s'endetter. C'est pour ces raisons de politique économique et de politique des transports que mon gouvernement a décidé de vendre les parts que l'État français détenait dans les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Notre choix a été de valoriser notre participation dans un secteur mature pour réinvestir les sommes ainsi dégagées dans le désendettement et le financement de nouvelles infrastructures. Cette cession a rapporté 14,8 milliards d'euros.
Nous avons décidé d'en affecter le produit à deux priorités, près de 11 milliards d'euros pour le désendettement de l'État (ce qui est considérable, même rapporté au stock de dette de l'époque d'un peu plus de 1 000 milliards). Je rappelle que l'endettement public a reculé de 2,8 % en part du PIB entre 2005 et 2007. En 2007, la dette publique ne représentait, selon l'Insee, que 64,5 % du PIB contre 67,3 % en 2005. Avec ce mouvement de baisse, le premier depuis le gouvernement Barre, nous avons voulu créer un électrochoc, montrer qu'il était possible d'inverser la tendance.
Pour le reste, 4 milliards ont été affectés à l'AFIT pour financer de nouvelles infrastructures, plus respectueuses de l'environnement. En 2005, un audit sur le réseau ferroviaire, le rapport Rivier, souligne sa dégradation et l'urgence d'un effort massif de réinvestissement. Sur la base de cet audit, avec Dominique Perben, nous avons mis fin à la logique d'étranglement de la maintenance du réseau. Nous avons lancé le premier plan de rénovation de notre réseau national pour améliorer la qualité des trains du quotidien. Ces décisions étaient attendues et n'étaient pas possibles avant 2005, faute de ressources suffisantes. Au-delà de ce réinvestissement massif dans les trains du quotidien, nous avons engagé la réalisation de quatre lignes à grande vitesse, Bordeaux, Rennes, Montpellier, Rhin-Rhône, inauguré la première phase du TGV Est, conclu avec les collectivités le financement de la préparation de la deuxième phase. Tous ces projets sont aujourd'hui en service.
Il faut rappeler que nous n'avons pas décidé la privatisation des autoroutes. Les autoroutes françaises font partie du domaine public. Contrairement à ce que l'on peut parfois lire ou entendre, l'État en est toujours le propriétaire. À la fin du contrat de concession, nos autoroutes ne disparaîtront pas et demeureront la propriété des Français. À la fin des contrats, soit, dans les conditions de 2005, à compter de 2028, l'État récupérera une infrastructure en très bon état, améliorée sur la base des travaux de rénovation et d'aménagement imposés par les cahiers des charges de l'État. Ce que nous avons cédé, ce sont les parts de l'État dans les sociétés chargées d'exploiter les concessions autoroutières. Cette décision, que beaucoup ont voulu présenter comme une rupture, s'inscrit en réalité dans une histoire longue, marquée par le tournant de 2001, justifié par la nécessité d'ouvrir le secteur autoroutier à la concurrence, la fin de l'adossement, et la nécessité de trouver de nouveaux financements et de se conformer au droit européen.
Le premier choix a été celui de la concession et du péage, en 1955, sous forme de sociétés d'économie mixte. Le deuxième choix, dans les années 70, fut celui de la création de sociétés totalement privées. Ce choix, fait sous Georges Pompidou, a été renouvelé sous Lionel Jospin, avec des concessions telles que l'A28 (Rouen-Alençon), l'A86 ouest ou, en 1998, le viaduc de Millau avec Jean-Claude Gayssot, ministre des Transports. Le troisième choix, le vrai tournant, a eu lieu en 2001 avec la transformation des sociétés d'économie mixte en sociétés anonymes de droit commun et, dans la foulée, l'ouverture du capital d'ASF en mars 2002, sous Lionel Jospin.
Cette politique a été poursuivie par mon prédécesseur Jean-Pierre Raffarin avec l'ouverture du capital d'APRR, en novembre 2004 et de Sanef en mars 2005. Des investisseurs privés ont ainsi pu acquérir, selon le cas, entre 50 % et 26 % du capital des sociétés, toutes les trois cotées en bourse. Pour préparer cette ouverture du capital, les relations entre l'État et ces sociétés avaient été remises à plat en deux étapes, celle de 1994 sous le gouvernement d'Édouard Balladur, avec le regroupement et la recapitalisation des sociétés, ainsi que la définition de la règle d'évolution des tarifs, sur la base de laquelle la privatisation a été faite ; celle de 2001, sous le gouvernement de Lionel Jospin, qui a consisté à supprimer certains avantages dont bénéficiaient ces sociétés, tels que la garantie de reprise de passif par l'État en fin de concession. En contrepartie, les sociétés ont bénéficié d'un allongement de la durée de leur concession. Ce schéma a été validé par la Commission européenne.
En 2005, les sociétés concessionnaires étaient déjà totalement ou partiellement privées. L'État contrôlait à peine plus de 50 % du secteur, moins de 62 % si on ne prend pas en compte la société concessionnaire déjà entièrement privée Cofiroute.
Ce que j'ai décidé en 2005, c'est de mener à son terme le processus déjà engagé de cession des parts publiques dans les sociétés concessionnaires liées à l'État par des contrats déjà signés, déjà négociés et même renégociés.
Ce choix marque-t-il un recul de l'État ? Je ne le crois pas : dans ce cadre clarifié, l'État reste gardien des intérêts publics au travers de deux responsabilités, celle de concédant et celle de régulateur. L'État reste propriétaire des autoroutes et peut assumer pleinement son rôle de concédant. C'est lui qui définit la taille du réseau, le niveau de service, les enjeux de sécurité, les principes de fixation des péages. L'État est aussi régulateur. Sous la houlette de Dominique Perben, les contrats de concession ont été modifiés pour renforcer les obligations des concessionnaires, dans le service rendu, sur les questions de sécurité, dans la gestion de crise (où l'État reprend toujours la main, à travers les préfets) ou encore l'accès du concédant aux informations. Les principales modifications ont été publiées en amont de la remise des offres finales de façon à être prises en compte dans les engagements des candidats. Il en est ainsi pour :
- le renforcement des obligations de publicité et de mise en concurrence pour la passation des contrats de travaux ;
- le renforcement des obligations d'information du concédant ;
- la présence d'un commissaire du gouvernement aux séances du conseil d'administration et aux assemblées générales ;
- l'harmonisation et le renforcement des dispositions concernant la politique d'exploitation et de sécurité ;
- la qualité du service rendu aux usagers ;
- l'augmentation du montant des pénalités de retard et d'exploitation en cas de manquement ;
- la généralisation de la clause rendant obligatoire un état des lieux neuf ans avant la fin de la concession.
Sur les clauses tarifaires, l'État n'a fait aucun cadeau. Ce sont les clauses préexistantes qui ont été maintenues. Les règles de fixation des péages sont rigoureusement les mêmes que celles définies antérieurement. En pratique, les péages ont semble-t-il augmenté moins vite après 2005 qu'avant 2005. Nous n'avons pas changé ces règles tarifaires. Pour changer la durée et les péages des concessions, il aurait fallu modifier les contrats. Ils ne peuvent l'être unilatéralement par l'État : toute modification suppose un accord avec les sociétés concessionnaires. Nous l'avons vu en 2015, lors de la tentative du gouvernement de l'époque qui a pris une décision d'un gel des péages conduisant à l'impasse. Dans un cadre contractuel, l'État ne peut pas passer en force, d'autant que pour l'examen de tout projet de modification, les administrateurs de l'État, comme je l'ai indiqué, sont légalement obligés de se déporter, laissant les autres administrateurs seuls en position de décider. Ceux-ci, et notamment les minoritaires, n'auraient jamais accepté des clauses amputant substantiellement la valeur des sociétés.
Ces contraintes ont été clairement rappelées par le ministre d'État Jean-Louis Borloo dans sa réponse au rapport de 2008 de la Cour des comptes : « les mandataires sociaux ne peuvent conclure un avenant ou un contrat d'entreprise avec l'État qu'à la condition qu'il soit conforme à l'intérêt social de l'entreprise ». Compte tenu de l'impact des clauses tarifaires sur les revenus futurs des sociétés, leur durcissement est à l'évidence difficile à faire accepter. Que l'entreprise soit publique ou privée ne change rien à la responsabilité des mandataires sociaux telle qu'elle est par exemple sanctionnée par l'article L. 242-6 du code de commerce, qui prévoit des sanctions pénales.
Troisième grande question, quelles ont été les modalités de l'opération ? Commençons par la procédure politique. J'ai présenté le cadre retenu le 8 juin 2005 au Parlement lors du discours de politique générale. Ce discours a été suivi d'un vote de confiance.
La décision d'autoriser le transfert des parts de l'État dans les sociétés d'autoroutes est une décision que j'ai prise en plein accord, bien sûr, avec Jacques Chirac, par décret, les 2 février, 16 février et 8 mars 2006. Nous avons sollicité le Conseil d'État sur la procédure à suivre. Celui-ci a rendu un avis en assemblée générale, confirmant la régularité de la procédure retenue par le gouvernement. Le Conseil d'État nous a en particulier confirmé que la poursuite de la cession des parts ne nécessitait pas de vote du Parlement, notamment parce qu'il n'y avait pas, contrairement, par exemple, au projet d'ouverture du capital d'ADP, de transfert du domaine public. Je rappelle pour autant qu'avant la cession effective des parts de l'État, le Parlement a été saisi du projet de loi de finances pour 2006, dans lequel étaient retracées les conséquences de la vente de nos participations. Le Parlement a adopté la loi de finances avec l'affectation des recettes de cession.
Partant de là, l'État s'est mis en bon ordre de marche, au niveau du gouvernement, avec l'action concertée de Thierry Breton, ministre de l'Économie et Dominique Perben, ministre des Transports, au niveau des services de l'État, avec l'Agence des participations de l'État (APE), chargée de piloter le processus de privatisation. L'APE s'entoure, pour ces opérations, de conseils financiers et juridiques de haut niveau. La Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM), de son côté, a pleinement joué son rôle dans l'élaboration des cahiers des charges et la révision des clauses contractuelles qui pouvaient en faire l'objet.
La procédure technique retenue est celle qui donne le plus de poids aux intérêts de l'État. Sachant que l'État est faible lorsqu'il négocie de gré à gré et qu'il est fort lorsqu'il lance un appel d'offres ouvert et concurrentiel pour obtenir le meilleur prix, nous avons lancé un appel d'offres ouvert et compétitif, auquel ont participé dix-huit candidats, français et étrangers, majoritairement des opérateurs industriels de premier rang et non des fonds. C'est le moyen le plus efficace pour obtenir le meilleur prix.
Enfin, nous avons fait le choix d'une gouvernance apportant toutes les garanties nécessaires et la mise en oeuvre de notre décision s'est faite sous le contrôle de plusieurs autorités. Nous y reviendrons si vous le souhaitez. Le Conseil de la concurrence, la Commission des participations et des transferts (CPT), la Commission européenne. Nous avons aussi décidé, pour rendre la procédure irréprochable, de charger Jean-Louis Fort, ancien secrétaire général de la Commission bancaire, de veiller au bon déroulement de la procédure.
Quatrième question, les intérêts de l'État ont-ils été bien préservés ? Nous avons d'abord cherché à garantir un juste prix. Quels sont les repères chiffrés réunis par l'Agence des participations de l'État, partagés à l'époque au sein de l'État lorsque nous avons lancé le processus ? Si l'on regarde le cours de bourse des trois sociétés concernées, les participations de l'État valaient 11,5 milliards d'euros avant que j'annonce leur vente le 8 juin 2005. Le rapport du député Hervé Mariton, rédigé avant cette annonce, avait évalué entre 10 et 12 milliards la valeur des participations. La Commission des participations et des transferts a estimé la valeur a minima que devait en attendre l'État à 12,8 milliards d'euros. Nous en avons obtenu de 14,8 milliards d'euros, soit 30 % de mieux que le dernier cours de bourse. Ce résultat était dans la fourchette haute de nos attentes et des modèles financiers d'évaluation des sociétés concernées.
Compte tenu de la part des autres actionnaires, cela donne une valeur totale des sociétés concessionnaires d'autoroutes de 24 milliards d'euros. Ce chiffre figure en note de bas de page dans le rapport de la Cour des comptes de 2009, qui précise la valeur globale des 7 000 kilomètres d'autoroutes publiques dont la concession a été privatisée en 2006, estimée à 24 milliards d'euros. Leur cession a rapporté 14,8 milliards d'euros à l'État. Je souligne le risque de malentendu lié à l'interprétation du chiffre de la Cour des comptes, à l'origine de nombreuses polémiques. 24 milliards d'euros, c'est la valeur de 100 % des parts des trois sociétés. 14,8 milliards d'euros, c'est la valeur des parts détenues par l'État, soit en moyenne 61,7 %. Ces deux chiffres ne se contredisent en rien. S'agissant de la plus grosse de ces trois sociétés, ASF, dont l'État ne détenait plus que 50 % du capital suite à sa mise sur le marché au prix de 24 euros par action sous le gouvernement de Lionel Jospin, nous avons obtenu 51 euros par action.
Ainsi, nous avons vendu le solde de la participation de l'État dans les sociétés concessionnaires au mieux de leur valeur à l'époque. Ce sont les soumissionnaires qui proposent, dans le cadre d'une procédure compétitive et ouverte, le prix d'acquisition, selon des méthodes classiques d'évaluation multicritères. C'est la Commission des participations et des transferts et elle seule qui valide que ces prix sont au-dessus du seuil qui garantit parfaitement les intérêts de l'État. Elle valide donc implicitement le juste prix et ses avis sont publics. Votre commission peut accéder à toutes ces données pour établir de façon transparente comment les sociétés ont été valorisées. L'Agence des participations de l'État a nécessairement conservé toutes ces données. Votre commission peut les trouver assez facilement.
Partant de là, les intérêts de l'État ont été pris en compte à chaque étape.
Premier constat, l'État a tenu ses promesses en affectant le produit de la vente au désendettement et à l'investissement. Deuxième constat, au-delà de la vente initiale, l'État continue de percevoir des taxes importantes, assises sur les péages (essentiellement la TVA), des taxes spécifiques (comme la redevance domaniale et la taxe d'aménagement du territoire affectée à l'AFIT) et l'impôt sur les sociétés. Ce sont, au total, de l'ordre de 5 milliards d'euros que l'État encaisse annuellement, soit plus de 40 % des péages.
Troisième constat, la qualité du service est assurée et l'on s'accorde à reconnaître que nos autoroutes sont parmi les meilleures d'Europe et du monde.
Quatrième constat, l'État récupérera à la fin des concessions une infrastructure autoroutière en bon état, améliorée des travaux réalisés par les concessionnaires. On voit d'ailleurs que le réseau routier et autoroutier placé sous la responsabilité directe de l'État vieillit et connaît des problèmes d'entretien importants. Je pense en particulier au réseau francilien. Aujourd'hui, le patrimoine autoroutier français concédé est en meilleur état que le patrimoine routier resté sous la gestion opérationnelle publique.
En conclusion, je voudrais formuler trois voeux devant votre commission. D'abord ne pas céder au chronocentrisme, c'est-à-dire ne pas juger avec les critères d'aujourd'hui une décision prise à une date antérieure. Il faut bien prendre en compte les paramètres qui étaient les nôtres quand la décision a été prise, et ne pas perdre de vue que les concessions sont des contrats de long terme, qu'il faudra évaluer à leur terme. Les risques imprévus ne doivent pas être sous-estimés. Enfin, le choix de 2005 ne peut être dissocié de la stratégie globale choisie par le gouvernement. Comme vous le voyez, mon gouvernement n'a pas « bradé les bijoux de famille » pas plus qu'il n'a « tué la poule aux oeufs d'or », bien au contraire. La période 2005-2007 a été une période où la France, grâce aux marges de manoeuvre dégagées, a su améliorer ses performances économiques, qu'il s'agisse de la baisse du chômage, de la réduction des déficits ou de la baisse de la dette. Nous avons obtenu dans cette période, à la fin du mandat de Jacques Chirac, les meilleurs résultats économiques des trente dernières années. En témoigne tout particulièrement la comparaison avec l'Allemagne, puisque notre bilan économique et financier était encore, en 2007, à l'avantage de la France. Je vous remercie.

Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre, pour votre propos étayé et d'une très grande précision. Je précise qu'il n'est pas question ici de juger les décisions prises ni le modèle concessif mais de faire des propositions à l'État pour renforcer son rôle dans la négociation et rééquilibrer le rapport de forces entre les sociétés autoroutières et les représentants de l'État.

Monsieur le Premier ministre, vous avez indiqué que les tarifs avaient augmenté moins vite après 2005. Il convient de préciser que l'inflation était moins importante à cette période-là. Si l'on neutralise l'impact de l'inflation, le pourcentage d'évolution des tarifs est un peu supérieur.
Je vous remercie, monsieur le Premier ministre, d'avoir respecté, à une minute près, ce qui est remarquable, le temps dont nous étions convenus pour ce propos liminaire et d'avoir manifestement très bien préparé votre audition. Vos nous avez rappelé de nombreux éléments, notamment le contexte dans lequel la décision a été prise, la politique dans laquelle elle s'inscrivait, la régularité de la procédure, etc. Vous avez très bien défendu votre action et vos décisions. J'ai néanmoins plusieurs questions.
Lorsque Lionel Jospin, en tant que Premier ministre, choisit de transformer les Sociétés d'économie mixte (SEM) en SA en 2001, il ouvre le capital d'ASF. Estimez-vous que c'est une bonne décision ? L'auriez-vous prise ? Qu'est-ce qui, à vos yeux justifiait de mettre 20 % du capital de cette entreprise sur le marché ?
Il convient également de rappeler qu'avant 2001, l'État était propriétaire à 100 % des sociétés d'autoroutes, en dehors de Cofiroute. Entre 2001 et 2006, pour se rendre propriétaires d'ASF, les actionnaires dépensent 24 milliards et l'État perçoit, au titre des participations qu'il détenait alors dans ces sociétés, 14,8 milliards. Il y a donc une différence, qui vient de la mise sur le marché de 20 % du capital d'ASF par Lionel Jospin en 2001 et de la procédure suivie pour la mise sur le marché du reste des titres, puisque l'opération a eu lieu en deux temps. Une première partie a été mise sur le marché à un cours de bourse relativement faible. Un des lots - qui était le plus important - a aussi été attribué à Vinci sans concurrence. Vinci a soumis une offre moins élevée que le prix minimum fixé pour les deux autres lots qui faisaient l'objet d'une concurrence plus vive, ce qui témoigne, semble-t-il, d'un problème de procédure (lequel ne découle pas nécessairement de décisions prises par votre gouvernement). J'aimerais que vous nous disiez ce que vous en pensez.
En 2001, au moment de la transformation des SEM en SA, n'était-il pas souhaitable de mettre à jour les contrats avec les sociétés d'autoroutes ? Ces contrats avaient plusieurs dizaines d'années. Élisabeth Borne les a qualifiés de « monstres » et sans doute méritaient-ils un toilettage. Le sujet a-t-il été évoqué à l'époque ? Avez-vous manqué de temps pour le faire ou avez-vous estimé, en toute connaissance de cause, que ce n'était pas nécessaire ?
Notre commission veut aussi se tourner vers l'avenir. Que feriez-vous aujourd'hui si vous étiez Premier ministre ? Des initiatives vous semblent-elles à prendre pour préparer la fin des concessions - sachant que des évolutions sensibles ont déjà été introduites en 2015 - et faire en sorte que l'État soit plus fort dans la négociation ?
Je reviendrai d'abord sur le choix d'ouvrir le capital d'ASF et d'une façon générale sur le tournant de 2001. Il faut se souvenir que, dans cette période, le choix était aiguillonné ou plus ou moins contraint, du fait de la nécessité de se conformer aux exigences de la Commission européenne et d'un besoin de ressources financières.
Non mais la Commission européenne était favorable à l'ouverture à la concurrence, ce qui était un argument important. Nous nous retrouvions, par rapport aux autres sociétés, dans le cadre européen, comme un cas assez isolé. Il y avait une exigence d'ouverture du cadre des concessions au privé. Il y avait une exigence de mise en conformité, concernant notamment la durée des concessions. Nous devions avoir l'aval de la Commission européenne.
Il y avait aussi une exigence d'alignement sur le droit commun des sociétés d'autoroutes et des sociétés anonymes. Peut-être aurait-il fallu revoir alors le cahier des charges et les contrats eux-mêmes. Lorsque nous héritons de la situation, en 2005-2006, il est presque trop tard : les sociétés ont toutes des actionnaires minoritaires. J'ai également rappelé le dispositif qui régissait les conventions réglementées et le dispositif d'obligation, pour les représentants de ces sociétés, en tant que mandataires sociaux, de respecter l'intérêt de l'entreprise. Nous n'étions donc pas totalement libres de nos choix à l'époque, compte tenu du droit des sociétés et du contexte dans lequel nous agissions.

La Commission européenne souhaitait qu'il y ait de la concurrence parmi les sociétés concessionnaires, qui étaient alors publiques. N'y avait-il pas d'autres pays européen dotés du même système de sociétés publiques ?
Dans mon souvenir, un mouvement s'organisait en Europe et poussait en ce sens. Trois mouvements s'exerçaient ainsi en 2001, dans le sens de l'ouverture au privé, vers l'ouverture à la concurrence et en faveur de l'alignement sur le droit des sociétés (qui créait des contraintes importantes). Pour ce qui est de la contrepartie donnée à certaines sociétés, à savoir l'allongement de la durée, il fallait l'accord de la Commission européenne, qui a été obtenu. Le système était donc relativement verrouillé. Nous n'avons pas, en 2005-2006, de marges de manoeuvre importantes car nous nous retrouvons dans le cadre de conseils d'administration où notre position est difficile à faire entendre, puisque les administrateurs de l'État doivent se déporter dès lors que les débats portent sur les tarifs et la durée des concessions. En outre, les mandataires sociaux sont censés représenter l'intérêt général des entreprises. Nous ne pouvons donc pas faire exactement ce que nous aurions souhaité faire à ce moment-là.
Quant à la procédure, un seul concurrent (Vinci) a effectivement soumis une offre pour l'une des lots. Cela peut arriver dans tout appel d'offres. Tout ceci se passe en dehors de toute interférence et de toute volonté politique. La procédure est définie par l'Agence des participations de l'État et la Commission des participations et des transferts. Tout ceci se fait sous le contrôle de ces commissions, qui sont indépendantes et vérifient la conformité de la procédure. Heureusement, le pouvoir politique n'a pas le moyen d'entrer dans ces débats. De surcroît, des avis sont pris auprès du Conseil de la concurrence et de différentes instances, comme je l'ai rappelé.

Lorsqu'on lance un appel d'offres, on peut le déclarer infructueux si l'on considère que les réponses n'ont pas été satisfaisantes ou que la concurrence n'a pas suffisamment joué. En présence d'une seule réponse pour l'un des trois lots, l'État pouvait décider de remettre en jeu ce lot tout en attribuant les deux autres lots.
Le prix minimum qui avait été fixé par la Commission des participations et des transferts était de 47 euros et nous en avons obtenu 51 euros. Nous sommes donc dans les clous. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ces procédures ont leurs règles, lesquelles ont été entièrement respectées. Un certain nombre d'idées reçues pèsent d'ailleurs lourdement sur ces questions. Je pense en particulier au prix. En 2008-2009, la Cour des comptes nous a reproché de ne pas avoir mis suffisamment de conseils autour de la table car nous aurions eu un seul banquier. En fait, nous avions deux banquiers, Goldman Sachs et BNP Paribas.
On nous a reproché un prix trop bas. J'ai entendu devant votre commission le plaidoyer fait par Gilles Carrez, qui estimait qu'il aurait fallu faire travailler le Commissariat au Plan, lequel aurait défendu un prix très supérieur à celui qui a été obtenu. Il faut se rappeler ce que dit le Conseil d'État dans sa décision du 27 septembre 2006, par laquelle il a rejeté le moyen lancé par François Bayrou et deux associations de défense des usagers, qui soutenaient que la valeur minimale de cession avait été sous-évaluée par la Commission des participations et des transferts, notamment du fait d'un taux d'actualisation supérieur à celui préconisé par le Commissariat général du Plan. Le Conseil d'État a démontré qu'augmenté pour prendre en compte l'inflation et la légitime prise de risque, le taux d'actualisation suggéré par le Plan aurait en réalité conduit à une valeur des titres inférieure à celle évaluée par la Commission des participations et des transferts. Le Conseil d'État a par ailleurs souligné que la valorisation retenue était supérieure, tant aux cours de bourse constatés sur les mois ayant précédé le transfert qu'aux estimations effectuées par les experts. Les deux sources majeures de polémique, sur ce dossier, dans les années qui ont suivi 2005-2006, concernant le prix (qui aurait été trop faible) et un taux d'actualisation (qui aurait été trop élevé) ne correspondent donc pas à la réalité. Partant de là, l'opinion publique ne comprend pas et a le sentiment qu'on a bradé les intérêts de l'État. Cela n'a pas été le cas.
La Cour des comptes revient aussi sur l'idée selon laquelle nous aurions obtenu un meilleur prix si nous avions au préalable désendetté les sociétés (dont l'endettement était compris entre 18 et 20 milliards d'euros). Ce n'était ni possible ni souhaitable : il aurait alors fallu injecter plus de fonds publics, pour quel bénéfice ? Les actionnaires privés ont fait le contraire en augmentant le levier financier des sociétés et donc leur endettement. Il existe ainsi un certain nombre d'idées reçues, de serpents de mer, sur ces dossiers, qui méritent d'être corrigés.
Quant à l'avenir, la première règle qui me paraît importante est la nécessité, pour l'État, de renforcer sa capacité de régulation économique des monopoles naturels. Je souscris pleinement aux propos que vient de tenir Ségolène Royal devant votre commission : il n'y a pas de fatalité. La question ne se posait pas du tout, en 2006-2008, depuis les termes qui doivent être considérés aujourd'hui, à la lumière du paquet vert de 2010 et du plan de relance autoroutier de 2015, corrigé par le plan d'investissement de 2018. Les choses se présentent aujourd'hui différemment.
Dans les années qui ont suivi la privatisation des sociétés autoroutières, l'État disposait de tous les moyens pour se faire respecter. Les propos de Jean-Louis Borloo que j'ai cités figurent dans le rapport de la Cour des comptes et montrent bien que nous avons la capacité administrative - pourvu que nous ayons aussi la volonté politique. Ségolène Royal a eu raison de dire que malheureusement, trop souvent, dans ces années-là, la volonté politique a pu faire défaut. Néanmoins, face à trois sociétés concessionnaires, vous ne m'expliquerez pas que l'État n'est pas capable d'assurer sa fonction de régulateur, alors qu'il serait un formidable mainteneur. Vous ne m'expliquerez pas davantage que remettant ces sociétés dans le giron public, tous les problèmes disparaîtraient. C'est absurde. Si l'État n'est pas capable d'être un bon régulateur, il ne sera pas un bon mainteneur. Il faut donc remettre les pendules à l'heure.
Pour autant, le sujet des autoroutes, en France, est bien plus que le sujet des autoroutes : il a une valeur symbolique et politique. Trop souvent, il a été traité au sein du ministère sous le seul angle technique. Il existe un rapport de forces avec les sociétés d'autoroutes. Ceci existe dans tous les grands secteurs de l'État. Lorsque celui-ci discute avec les constructeurs automobiles ou aéronautiques, les arbitrages ne sont pas pris dans les ministères techniques. Il n'y a pas de raison pour que, s'agissant des autoroutes, la sous-direction chargée du réseau se retrouve en première ligne dans la négociation. Cela me paraît un aspect important et un élément à corriger dans la loi.
Par ailleurs, la Cour des comptes, le Conseil de la concurrence et l'Autorité de régulation des transports (ART) ont éclairé un certain nombre de voies importantes de renforcement de la fonction de régulation. J'en retiendrai trois idées.
La première a trait au haut niveau de compétence et de professionnalisme requis. Beaucoup de ceux qui se sont présentés devant la commission l'ont rappelé : il faut une compétence technique et une compétence juridique. Gilles de Robien a eu raison de le dire. Il faut être à armes égales en termes de capacités, face aux sociétés d'autoroutes.
Il y a aussi une exigence de transparence. Elle n'a pas toujours existé au fil des années. Elle me paraît essentielle, notamment sur l'information des autorités publiques et la motivation des décisions. Dans le mandat qu'avait Dominique Perben en 2005-2006 pour renforcer les atouts de l'État dans les cahiers des charges, il y avait cette exigence de transparence et d'information, avec des clauses extrêmement exigeantes qui n'ont malheureusement pas été appliquées au cours des années suivantes.
Une troisième nécessité est une pratique rigoureuse dans la gestion des contrats et de leurs avenants, en particulier en ce qui concerne les allongements de la durée ds concessions. Nous ne parlons pas de la même chose suivant que l'on se place du point de vue de 2006 ou d'aujourd'hui car les durées ne sont pas du tout les mêmes. On a beaucoup cédé à travers l'allongement des concessions et malheureusement ces allongements ne sont pas soumis à une mise en concurrence, alors que celle-ci est souvent nécessaire à la protection des intérêts de l'État. L'ART a utilement mis en oeuvre un principe de rigueur dans la définition des investissements et de leurs modalités de prise en compte dans les avenants autoroutiers issus du plan de relance 2015.
Trop souvent, toutefois, parce que l'État n'est pas capable de trouver l'argent nécessaire, il achète en quelque sorte par du temps les travaux à réaliser, sans toujours vérifier (Ségolène Royal l'a redit) que ces travaux ne sont pas déjà prévus dans son cahier des charges. De ce point de vue, l'État régulateur s'est montré faible et cet allongement de la durée des concessions a modifié - parfois même perverti - le regard que nous portons sur elles. Ce fut une erreur. Lorsque nous avons signé, en 2006, les premières fins de concession devaient intervenir en 2027. Nous parlons aujourd'hui de durées beaucoup plus longues.
Dans un monde qui évolue extrêmement vite, comme nous le voyons, il peut exister des risques extrêmement importants. Nous l'avons vu avec la crise de 2008-2009. Nous le voyons aujourd'hui avec la crise sanitaire. Ces risques sont majeurs et peut-être ont-ils vocation à s'amplifier au cours des prochaines années. Nous n'avons pas intérêt, dans ce contexte, sans clauses de rendez-vous et sans durées raisonnables, à nous lancer dans une aventure au long cours qui joue nécessairement contre les intérêts de l'État.

Monsieur le Premier ministre, merci de nous avoir éclairés. Vous avez souligné le besoin de transparence. Ma question porte sur la façon dont les parlementaires ont été associés à ces décisions. D'un strict point de vue formel, le Parlement a été saisi au détour d'une loi de finances. Chacun connaît la procédure très cadrée de loi de finances, qui implique des délais très rapprochés.
Nous avons été confrontés à la même difficulté avec ADP et la Française des Jeux. On nous a présenté ces dispositions dans le cadre d'un texte de 220 articles, la loi Pacte, en nous donnant quinze jours pour le voter. Il ne faut pas s'étonner que de tels sujets puissent ensuite apparaître comme des serpents de mer ou ne semblent pas avoir été étudiés avec toute la transparence requise.
N'estimez-vous pas qu'il eût été souhaitable d'associer différemment le Parlement ?
Nous pouvons débattre à l'infini de ce qui aurait été préférable. N'oubliez pas que j'arrive, comme Premier ministre, au lendemain de l'échec du référendum européen. Je dispose d'une vingtaine de mois actifs pour agir. L'ambition du Premier ministre, comme celle de Jacques Chirac, est de refaire un certain nombre de choses et de dégager des marges de manoeuvre, à un moment où l'investissement public était complètement bloqué et où il était difficile d'imaginer le moindre plan pour revitaliser la croissance.
Il fallait donc créer ces marges de manoeuvre. Dès lors, le temps est important. De plus, ce n'est pas la première fois que le capital de ces sociétés est ouvert : c'est la quatrième fois. Lionel Jospin prend une première décision. Puis, en 2003 et début 2005, Jean-Pierre Raffarin poursuit en ce sens. J'initie le quatrième mouvement de mise sur le marché d'une partie du capital des sociétés d'autoroutes. Je suis celui qui met sur le marché ce qu'il reste de ce capital, ce qui a une valeur symbolique que je reconnais volontiers. Mais c'est le même exercice. Le parallélisme des formes - auquel nous tenons dans notre pays car nous aimons le droit et les repères - m'a conduit à appliquer la même règle que mes prédécesseurs. J'ai ainsi décidé par décret, tout en veillant à ce que la représentation nationale soit saisie, à travers la loi de finances, certes, mais aussi à travers deux débats, l'un au Sénat et l'autre à l'Assemblée nationale. Chacun a pu s'exprimer sur ces sujets.
À partir de quel moment faut-il arrêter la pendule, en considérant que l'on a épuisé un sujet, pour agir ? L'État se voit parfois reprocher de ne pas agir assez vite et assez bien. Parfois, on lui reproche d'avoir agi de façon précipitée. C'est un reproche qui m'a souvent été fait. Je crois qu'il faut savoir arbitrer.
J'ai placé cette audition sous le signe de la stratégie de mon gouvernement, car ce fut bien une décision stratégique. Je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendu dans votre esprit. Gilles de Robien est un responsable politique que j'aime beaucoup. Il a été mon ministre de l'Éducation nationale. Il a fait état de ses deux rencontres avec Bercy. Ne nous trompons pas sur ce point : ce sont les rencontres habituelles de tout ministre technique avec le ministre qui tient les cordons de la bourse. Que Bercy cherche à obtenir davantage d'un ministre dans ce contexte et qu'un ministre prépare cette rencontre, je l'ai vécu en tant que ministre de l'Intérieur et en tant que ministre des Affaires étrangères. Nous étions là dans un cadre tout à fait différent, en 2005. Une stratégie requérait des marges de manoeuvre, ce qui passait par un arbitrage entre le statu quo et une décision qui change quelque chose pour créer des marges de manoeuvre et remettre la France en marche. C'est ce choix que nous avons fait, avec un certain succès : en 2007, nous sommes dans une meilleure situation que l'Allemagne. Nous n'avons pas décidé de changer un système optimal qui fonctionnait parfaitement.
Lorsque j'arrive aux affaires, les dividendes autoroutiers s'élèvent à 332 millions d'euros. Gilles de Robien estime peut-être que cela permettait de tout régler et qu'au bout de cinq ou dix ans, nous aurions disposé d'une cagnotte. Cela aussi fait rêver les Français mais c'était une cagnotte virtuelle. Cinq ou dix ans, cela aurait voulu dire s'asseoir sur un magot qui n'existait pas, en espérant qu'il finisse par se matérialiser. Si les taux d'intérêt étaient passés de 4 % à 6 %, au lieu de tomber à zéro, François Fillon aurait eu raison de dire (à tort) que l'État français était en faillite à l'été 2007, alors que j'ai laissé un taux d'endettement de 64,3 %. Nous avons voulu, avec Thierry Breton, assumer en conscience une exigence, celle du désendettement.
On dira qu'un pour cent de la dette, ce n'est pas suffisant pour mériter l'effort consenti. Mais, une fois de plus, il n'y avait pas de poule aux oeufs d'or. Que pouvions-nous faire avec 332 millions d'euros (alors que le budget de l'AFIT était de 3 milliards d'euros) ? Le TGV vers Bordeaux, Montpellier, Rennes et le TGV Rhin-Rhône n'existeraient pas aujourd'hui. De nombreux Français considèrent que nous avons rendu un grand service à notre pays en développant cet outil ferroviaire.

Monsieur le Premier ministre, alors que vous étiez nommé Premier ministre, se déroulait la mission d'information parlementaire d'Hervé Mariton, dont vous étiez proche. Il rend ses conclusions le 22 juin, quelques jours après votre discours de politique générale et reprend, sans dire explicitement qu'il faut privatiser, un certain nombre des remarques que vous faites. Y a-t-il une inspiration politique au fondement de ces conclusions, sachant que cette mission d'information n'est pas née totalement par hasard, mais après l'échec de plusieurs tentatives de privatisation, comme l'a rappelé Gilles de Robien et ainsi que vous venez de le faire. N'y avait-il pas là une mission « commandée » ? Cette décision de privatisation n'était-elle pas, en réalité, purement budgétaire ?
Non. Je viens d'essayer de l'expliquer, elle était stratégique. Créer des lignes à grande vitesse, ce n'est pas une décision budgétaire. Désendetter l'État, est-ce une décision budgétaire ? C'est simplement rappeler qu'on ne peut pas faire n'importe quoi - message qui va être rappelé dans les cinq ans ou les dix ans à venir, car notre pays va connaître un tsunami économique et financier.
Nous sommes dans une situation de totale anomalie. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de chronocentrisme. De l'argent qui ne coûte rien, et les Français ayant le sentiment que l'on peut tout faire et tout se permettre sans limite de temps, c'est une situation ubuesque, qui ne durera pas. J'ai été un Premier ministre qui avait les pieds sur terre, qui a respecté une certaine pesanteur budgétaire, économique et politique et qui a fait preuve de responsabilité. Il est parfois plus simple de surfer sur la vague et de dépenser un argent qu'on n'a pas. Ce n'est pas l'idée que je me fais de l'État. Il y avait une exigence et une politique qui ont été celles de la rigueur. J'ai cité Raymond Barre tout à l'heure. Ce n'est pas un hasard si c'est la deuxième fois dans l'histoire de l'État des dernières décennies que, dans cette période (2005-2007), la dette de l'État a diminué. Ce n'était donc certainement pas une décision uniquement budgétaire. Nous avons relancé la croissance. Nous menions la bataille de l'emploi. Ce sont les entreprises qui créent des emplois parce qu'elles ont des perspectives. Il ne s'agissait pas uniquement d'appliquer une règle budgétaire comme on applique un couperet : il s'agissait d'avoir une vision et de renforcer l'économie française.
Par ailleurs, on se plaint tous les jours, aujourd'hui en France, de ne plus avoir d'industrie et de ne plus avoir de champions industriels français et européens. À travers la politique que j'ai menée à l'époque, avec Jacques Chirac (pôles de compétitivité, Agence de l'innovation industrielle, patriotisme économique), nous avons fait en sorte de défendre l'industrie française, de constituer des champions nationaux et européens capables de rivaliser dans les appels d'offres européens. C'est cela qui fait l'économie d'une nation. Nous sommes dans une époque déboussolée, où l'on dit et où l'on fait trop souvent n'importe quoi. Je le dis avec tristesse. Il peut paraître incongru qu'un Premier ministre, un président de la République, un ministre des Finances, un ministre des Transports aient pris des décisions fondées sur des exigences. Celles-ci existaient, y compris sur le plan budgétaire. Il y avait une volonté de rigueur. Mais il y avait surtout une vision.

Monsieur le Premier ministre, merci pour ce plaidoyer. Nous ne sommes pas en train de juger la politique que vous avez souhaité mener à cette époque. Nous nous demandons comment on en est arrivé à une situation dans laquelle les sociétés concessionnaires sont loin d'être perdantes. Quelles leçons retenir pour l'avenir ? Au fil du temps, ces concessions ont été prorogées un si grand nombre de fois qu'on peut se demander comment arrêter cette mécanique lorsque les échéances se profileront.
Comment l'État peut-il reprendre la main, en tout ou partie, peut-être en envisageant d'autres systèmes que les concessions (par exemple des régies intéressées) ? Comme vous venez de le dire, nous sommes aujourd'hui un peu déboussolés par différents facteurs. La pandémie n'est pas finie. Demain - 10 juillet - prend fin l'état d'urgence sanitaire. Or nous voyons que des clusters se reforment et que des pays referment leurs frontières.
Que préconiseriez-vous si vous étiez aujourd'hui aux manettes ?
Effectivement, madame la sénatrice, la grande question porte sur l'avenir. Vous évoquez la situation florissante des sociétés d'autoroutes. Il faut bien prendre la mesure de la situation. On a fait un procès d'intention aux sociétés d'autoroutes, au départ, au regard des dividendes considérables versés de 2006 à 2013. N'oublions pas quel est le modèle de la concession, qui s'articule autour de trois périodes. Il y a en particulier un moment à partir duquel les sociétés d'autoroutes doivent restituer les infrastructures sans contrepartie, pas même pour un euro symbolique. Il y a une naissance, une vie et une mort de ces contrats pour les sociétés d'autoroutes. À l'échéance de ces contrats, il faudra d'abord, pour les concessionnaires, avoir amorti les fonds propres. Le chiffre couramment cité est celui de 24 milliards d'euros. Il leur faudra régler l'intégralité de la dette des sociétés concessionnaires, estimée à environ 18 milliards d'euros. Il leur faudra aussi honorer les investissements de renouvellement et de modernisation soit environ 26 milliards d'euros. Enfin, il faudra rémunérer le capital investi. En cumulant la valeur des fonds propres, tout ceci représente 70 milliards d'euros. Il faut prendre en compte ce modèle particulier.
Je ne crois pas que les péages aient fait augmenter la valeur des sociétés concessionnaires. Il ne faut pas croire que l'État, seul, aurait réussi à s'arroger cette manne financière. Il faut prendre en compte les deux variables sur lesquelles agissent les sociétés d'autoroutes, à commencer par le niveau des taux d'intérêt. S'il y a un enrichissement sans cause, pour certains, des sociétés d'autoroutes, c'est en grande partie en raison des taux d'intérêt bas. L'État aurait-il pu profiter de ce contexte de bas taux d'intérêt ? C'est loin d'être évident, car l'AFIT ne peut se départir des règles de Maastricht ni se lancer dans des montages d'ingénierie financière comme le font des sociétés privées.
La seconde variable est le trafic. Depuis 2006, le secteur autoroutier a fait face à deux crises, celle de 2008 et la crise sanitaire de 2020. Les sociétés d'autoroutes ont-elles le même potentiel de croissance sur les prochaines années ? Existe-t-il une manne financière sur laquelle nous pourrions remettre la main ? Je crains qu'il n'y ait à bien des égards des illusions de ce point de vue.
Je crois que, dans l'avenir, il faut s'assurer que nous mettons en place un système où toutes les garanties sont prises. Ce sont notamment des garanties de durée, avec des clauses de rendez-vous. On cite toujours l'arrêt du Conseil d'État commune d'Olivet de 2009, qui permet, en cas de rentabilité excessive, de reprendre la main. Une clause, dans les cahiers des charges que nous avons fait insérer en 2006, permettait aussi d'éviter certains abus.
Je regrette qu'on ait allongé excessivement la durée des concessions car ceci éloigne ce rendez-vous, lequel ne pouvait avoir lieu, en 2005-2006, en tout cas pas de façon si simple que beaucoup le disent. Dans un État moderne et dans un monde globalisé où les imprévus sont nombreux, les durées longues sont très dangereuses.
Il ne faut pas abandonner les péages. Nous voyons bien que ce modèle est aujourd'hui en question, car la question de l'acceptabilité des péages est posée. Il y a un ras-le-bol des Français, en particulier au regard des trajets du quotidien. Néanmoins ce principe fonde, aujourd'hui, l'équilibre du système. Il faut réparer ce modèle et préparer un nouveau modèle. Il faut aussi remettre en concurrence l'ensemble des concessions avant leur réattribution. En respectant ces quatre règles, nous avons de quoi recaler le dispositif autoroutier.
Faut-il envisager la renationalisation des autoroutes et reprendre la main en régie, comme je l'entends ici et là ? Si l'État ne parvient pas à réaliser les moindres travaux et s'il a parfois payé très cher, à son détriment, en allongeant la durée des concessions, la délégation de travaux à des sociétés d'autoroutes alors qu'il aurait peut-être pu les faire lui-même, c'est bien parce que nous n'avons pas les moyens. L'idée de reprendre la main me paraît, sauf retour à la vertu (qui n'est pas dans l'esprit du jour) sympathique mais un peu ubuesque.

Nous partageons les souhaits d'exigence et de rigueur que vous avez exprimés. Il existe effectivement un besoin de transparence, laquelle n'a pas toujours été de mise en matière de concessions autoroutières. Vous indiquez que Monsieur Perben avait inclus cette exigence vis-à-vis des sociétés concessionnaires et que ce principe de transparence n'a pas été mis en oeuvre par la suite. Pourquoi, selon vous, le concédant, c'est-à-dire les services de l'État, ne sont pas parvenus à obtenir cette clarté - que notre commission d'enquête doit contribuer à établir ?
Nous estimons aussi que, s'agissant de contrats de longue durée, des clauses de rendez-vous sont nécessaires. Quelle serait la fréquence idéale à vos yeux ?
Je prends un exemple de ce qui avait été décidé en 2006. Nous avions prévu que le commissaire du gouvernement puisse participer au conseil d'administration des sociétés concessionnaires. Depuis cette date, il pratique la politique de la chaise vide dans ses conseils. Cela montre que la question des autoroutes et du rapport avec le concessionnaire est traitée à un échelon technique et non, comme ce devrait être le cas, sous un angle stratégique. Le commissaire du gouvernement qui participerait à des conseils d'administration doit bien sûr être informé au préalable et recevoir des instructions de son cabinet, voire du ministre. C'est un travail de coordination et de préparation qui est lourd et difficile mais tel est le travail de l'État. C'est ce qui a fait défaut. Je ne veux pas taper sur un État que j'ai servi durant des décennies. Je suis moi-même fonctionnaire et j'ai un immense respect pour l'État. Mais il est vrai que de nombreuses choses se sont délitées. De nombreuses choses qui sont dans la main de l'État ne sont pas faites avec suffisamment d'exigence.
Parmi les clauses contractuelles qui avaient été décidées figuraient par exemple l'augmentation du montant des pénalités de retard et d'exploitation dues par le concessionnaire en cas de manquement à l'une de ses obligations au titre du cahier des charges, ou encore la compensation du gain éventuel lié à un décalage dans le temps des travaux prévus. En écoutant Ségolène Royal relater ce qui s'est passé en 2015, nous voyons bien que l'État n'a pas fait son travail. Je le déplore, car il a toute la capacité juridique de le faire. Cette question des autoroutes est une immense question politique dans notre pays. Je l'ai bien vu depuis que j'ai quitté Matignon. Il y a une bataille des autoroutes en France. Ce n'est peut-être pas l'équivalent de la bataille sur le voile à l'école, ni de celle du prix de l'essence ou la question des trimestres des cotisations retraite. Mais c'est une bataille importante sur le plan symbolique. L'affaire des Gilets jaunes montre que ce sont des choses qu'il faut prendre au sérieux. Or cette bataille des autoroutes résulte de trois circonstances qu'il faut avoir à l'esprit.
Il y a d'abord un enjeu de proximité, vécu par tous les Français. C'est un enjeu global, où se mêlent toutes les problématiques qui sont d'actualité aujourd'hui (environnementales, sociales, économiques, politiques). C'est une question concrète sur laquelle viennent se cristalliser tous les débats politiques. C'est enfin un enjeu de long terme, car il témoigne de l'évolution de nos sociétés et de nos économies (évolution des taux d'intérêt, rôle de la voiture dans nos sociétés).
Or, depuis 2006, de nombreuses polémiques et malentendus ont émaillé ce débat. La privatisation de 2006 est perçue dans l'opinion publique comme une rupture. On veut croire qu'avant 2006, tout était réglé. J'ai rappelé qu'il n'en était rien (impasse de financement, absence de marges de manoeuvre en matière d'investissements publics).
Après cette opération, un deuxième moment de tension et de polémique s'est produit en 2008-2009 avec les rapports de la Cour des comptes se référant au prix de vente et au taux d'actualisation. Dans les deux cas, ce sont des notes de bas de page. Voyons l'effort qu'il faut faire, en matière de communication, pour transformer des notes de bas en page en mises en cause d'une politique. C'est dire à quel point on peut affirmer n'importe quoi dans le monde d'aujourd'hui.
Une nouvelle crise est survenue avec la multiplication des rapports en 2013-2014 (Autorité de la concurrence, Cour des comptes, Sénat, Assemblée nationale), liés à la prolongation des contrats de concession, acceptée à deux reprises par l'État, en 2010 et en 2015. À chaque fois, nous retrouvons, depuis cette période, la question du déséquilibre des relations entre l'État et les concessionnaires. La Cour des comptes a calculé que le plan de 2015 allait rapporter aux sociétés concessionnaires cinq fois leur mise à travers les 3,2 milliards d'euros d'engagements initiaux.
Dans ce contexte, il me semble essentiel de remettre à plat ce dossier et en particulier les points suivants : les contrats entre l'État et les concessionnaires ; les tarifs ; l'actionnariat (public ou privé) ; la révision des causes tarifaires ; les avenants, en particulier ceux postérieurs à 2005 ; les contrôles et la régulation.
C'est tout le travail de votre commission d'enquête : il faut essayer, sur chacun de ces points, d'identifier où des dysfonctionnements ont pu se produire. J'ai le sentiment que la décision de 2005 a constitué un bouc émissaire commode. Cette présentation est pour le moins discutable, d'autant plus que de nombreux acteurs de la période antérieure à 2005 ont eu des responsabilités importantes après 2005 et connaissent donc bien le dossier.
Il y a trois anachronismes sur ce dossier : l'illusion d'un passé glorieux, qui n'existe pas ; la confusion de la distance, qui écrase les différentes strates de temps ; l'oubli des différents contextes dans lesquels on a agi.
Je crois qu'on peut établir un parallélisme, toutes proportions gardées, entre cette bataille des autoroutes et la question sanitaire aujourd'hui. On voit bien que les décisions prises par Édouard Philippe ont essuyé des critiques sur le thème d'une gestion sanitaire qui aurait été privilégiée au détriment de la situation économique. A la rentrée, on ne parlera que d'économie (sauf s'il y a une deuxième vague) et de la faillite de l'économie française. Il faudra trouver un coupable et on aura oublié le contexte dans lequel la question sanitaire se posait.
La tentation existe de rejouer indéfiniment les batailles du passé. Je suis heureux que vous puissiez recaler les choses et rappeler les contraintes qui ont existé à chacune des époques, sans céder à la facilité consistant à estimer que tous les malheurs du jour incombent à une date ou à une décision.

Merci monsieur le Premier ministre. Pour vous assurer que nous ne céderons pas à la facilité, je voudrais souligner l'engagement de notre rapporteur et le nombre très important d'auditions prévues par notre commission.
Je vous remercie, moi aussi, monsieur le Premier ministre, pour votre préparation de cette audition qui fut très riche.
Merci, chers collègues, pour votre participation.
La réunion est close à 17 h 20.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.