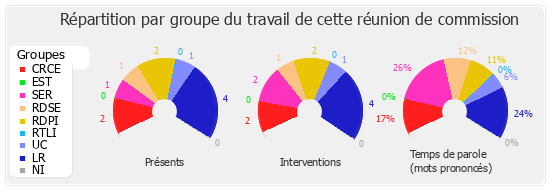Délégation sénatoriale à la prospective
Réunion du 28 janvier 2021 à 8h30
Sommaire
- Audition de m. olivier babeau professeur à l'université de bordeaux président de l'institut sapiens sur le thème « les nouvelles technologies et la crise de la covid-19 » (voir le dossier)
- Désignation de rapporteurs (voir le dossier)
- Examen du rapport d'information sur les mobilités dans les espaces peu denses à l'horizon 2040 (voir le dossier)
La réunion
Audition de M. Olivier Babeau professeur à l'université de bordeaux président de l'institut sapiens sur le thème « les nouvelles technologies et la crise de la covid-19 »
Audition de M. Olivier Babeau professeur à l'université de bordeaux président de l'institut sapiens sur le thème « les nouvelles technologies et la crise de la covid-19 »

Bienvenue à notre invité Olivier Babeau. À bien des égards, la crise que nous traversons aura servi de révélateur des forces et des faiblesses de nos sociétés. Parmi celles-ci arrive, en bonne place, notre dépendance aux nouvelles technologies numériques.
Soyons clairs : s'il y a « dépendance », c'est d'abord en raison des nombreux avantages que nous apportent ces outils : au-delà du strict domaine médical, où le numérique est devenu incontournable pour la recherche vaccinale ou encore la modélisation épidémiologique, ces outils nous ont permis de travailler à distance, de rester en contact avec nos proches, de payer sans contact, de commander en ligne nos repas et nos cadeaux de Noël etc. Le meilleur des gestes barrières, c'est une connexion Internet.
Mais surtout, le numérique nous offre des solutions techniques pour freiner la propagation de l'épidémie. On pense bien sûr à des applications de contact tracing comme TousAntiCovid, mais ce n'est sans doute que le début, car l'épidémie pourrait se prolonger, et d'autres pourraient venir ensuite. Devra-t-on demain voyager avec un passeport vaccinal numérique ? Scanner un QR Code à l'entrée des magasins ou du métro ? Porter un boîtier qui « bipe » quand on s'approche à moins d'un mètre de son interlocuteur ?
C'est là que la « dépendance » devient problématique : quel prix sommes-nous prêts à payer pour notre sécurité sanitaire, en termes de libertés publiques ? Le recours à des technologies intrusives par certains pays - notamment en Asie - explique-t-il leur succès dans la lutte contre la Covid-19 ? Ce modèle est-il transposable ? Comment garantir le bon usage des outils mis en place et des données collectées ? Cela ne va-t-il pas renforcer notre dépendance à l'égard des GAFA ? Notre rôle, à la délégation à la prospective, est précisément de nous interroger sur de tels scénarios. Ils peuvent sembler lointains - mais qui aurait prédit notre situation actuelle il y a tout juste un an ?
C'est dans ce cadre que nous entendons ce matin Olivier Babeau, professeur à l'université de Bordeaux et président-fondateur de l'Institut Sapiens, un think tank - ou « think tech », comme il le désigne - qui entend « replacer l'humain au coeur du numérique ».
L'audition de ce jour permet aussi de donner le coup d'envoi aux travaux de nos collègues Christine Lavarde, Véronique Guillotin et René-Paul Savary, qui présenteront dans quelques mois un rapport sur le rôle du numérique dans la prévention et la gestion des épidémies, à la suite des rapports de 2012 et 2015 faits par Fabienne Keller et Roger Karoutchi. Nos trois rapporteurs pourront donc s'exprimer à l'issue du propos introductif de M. Babeau, à qui je cède maintenant la parole.
Je salue l'ambition de ce rapport et sa grande nécessité. J'aborderai toutefois le sujet avec la modestie, la précaution et le doute qui s'imposent lorsqu'il s'agit de prédire l'avenir. Rappelons-nous l'enthousiasme suscité par l'invention du téléphone, cet appareil qui allait permettre d'écouter le théâtre à distance ! L'usage des technologies n'émerge qu'au contact de la société ; la technologie transforme la société, et réciproquement. L'évolution des technologies est assez facile à prédire : de fait, les prévisions faites en 1900 pour l'an 2000 se sont avérées exactes, qu'il s'agisse de l'enregistrement des informations à distance, des différentes façons de voler, etc. Il en va tout autrement des évolutions sociologiques et des rapports humains, qui sont bien plus difficiles à prédire.
Depuis un an, les tendances qui existaient se sont vérifiées, elles sont apparues clairement. Il n'y a rien eu de nouveau mais ça s'est prodigieusement accéléré. Cette crise, tragique, est aussi passionnante pour un think tank comme l'Institut Sapiens qui cherche à comprendre les grandes tendances. L'apocalypse a d'ailleurs le sens d'un dévoilement, d'un découvrement.
Une chose est apparue très clairement, et vous le signaliez Monsieur le Président : l'ambivalence des technologies. Les technologies sont de très bons serviteurs mais de très mauvais maîtres. Elles aident ou elles remplacent, elles servent ou elles dominent, elles libèrent ou elles aliènent, elles peuvent clarifier mais elles peuvent apporter beaucoup d'opacité et de confusion dans l'information, elles servent la concurrence mais elles peuvent aussi la tuer, elles mettent en relation les humains ou elles cloisonnent les relations. Bref, les technologies nous sauvent mais nous rendent en même temps beaucoup plus dépendants d'elles, comme un prêteur à l'égard de l'emprunteur. Ce sont les mécanismes de cette dépendance qu'il faut aujourd'hui penser et auxquels il faut trouver les parades. Mon dernier livre, rédigé avant la crise mais largement confirmé par celle-ci, a pour fil directeur l'idée que la technologie aboutit à une polarisation du monde dans toutes ses composantes, en matière économique, sociale et politique.
En matière économique, la tendance des grandes plateformes à prendre de plus en plus de place n'a pas attendu la crise. Elle résulte directement de la « loi de Metcalfe », selon laquelle l'utilité d'un réseau est égale au carré du nombre d'utilisateurs : c'est une exponentielle, qui permet au gagnant de tout prendre. Vous avez intérêt à aller sur Google parce qu'il y a les meilleurs résultats ; il y a les meilleurs résultats parce que c'est là que tout le monde va. De même, vous irez sur le site de rencontres, le service de VTC, etc. où il y aura déjà le plus de monde. Il y a donc une logique de monopole naturel que ces plateformes n'ignorent pas : elles surinvestissent au début de leur vie, car elles savent qu'à la fin, il ne peut en rester qu'une.
Le pouvoir économique de ces grandes plateformes se retrouve dans leur capitalisation boursière, que l'on a vu exploser pendant le confinement : la valeur d'Apple dépasse celle de l'ensemble du CAC 40 français, et les valeurs technologiques américaines dépassent l'ensemble de toutes les capitalisations boursières européennes. Les dix plus grandes entreprises du monde sont, aujourd'hui, des entreprises de technologies. Cette capitalisation des grandes entreprises du numérique traduit leur capacité à concentrer et à capter la valeur - mais pas forcément à la créer, comme le montre l'exemple de Google et des médias, où une gigantesque agence de publicité en ligne tire un revenu de contenus qu'elle n'a pas créé et dont elle ne rémunère pas les auteurs.
La crise a aussi accéléré le développement du e-commerce qui, je suis désolé de le dire ici, ne va faire qu'aggraver la crise des centres-villes. Il n'y a pas de signe d'une quelconque inversion des tendances : 19 % des Français déclarent qu'Internet est devenu leur circuit principal d'achat de produits alimentaires en 2020, contre 10 % en 2019. Durant le premier confinement, les achats en ligne ont progressé de 37 % en valeur - et, c'est sans doute la bonne nouvelle dans tout cela, cette hausse n'a pas seulement profité à Amazon mais aussi à des acteurs nationaux comme Fnac-Darty ou Boulanger. Quelque 41 millions de Français ont acheté sur Internet en 2020, soit un million de plus qu'en 2019. Attention : le e-commerce ne représente toujours que 10 % du commerce de détail traditionnel, et les ventes en ligne auprès d'enseignes de magasins physiques continuent de progresser : c'est l'omnicanal, ou cross-canal, qui profite notamment aux enseignes de bricolage.
S'agissant de la polarisation sociale, nous assistons à un effet bien connu des sociologues et des économistes, que j'appelle l'effet Matthieu, en référence à l'Évangile (13:12) : « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a ». Ceux qui sont connectés et reliés à la mondialisation, ceux dont le travail et les connaissances utilisent les technologies comme levier, ceux-là gagnent en salaire, en niveau de vie, en perspectives. Ceux qui ne sont pas ou mal connectés, dont les compétences sont plutôt remplacées par ces nouvelles technologies, ceux-là sont menacés. Nous sommes passés d'une société « en diamant » dans les années 1970, avec une très grosse classe moyenne et peu d'extrêmes, à une société « en sablier » depuis les années 1990, où les « emplois du milieu » et la grande cohésion sociale que cela apportait ont disparu au profit d'une polarisation croissante, avec beaucoup de riches et beaucoup de pauvres, et une mobilité sociale de plus en plus difficile. Et il ne suffit pas d'avoir accès au savoir -aujourd'hui, tout le savoir du monde est accessible gratuitement ou presque -, encore faut-il savoir l'utiliser, sur quel site aller, comment choisir l'information, etc. Le confinement a donné une bonne illustration des travaux de David Goodhart sur les Anywhere et les Somewhere : les premiers n'avaient besoin que d'une connexion Internet pour pouvoir travailler n'importe où, là où les seconds ont dû continuer à se déplacer pour aller travailler.
L'exposition aux écrans a aussi explosé. En particulier, les enfants de 6 à 12 ans ont passé plus de 7 heures par jour devant un écran pendant le confinement, soit une multiplication par quatre par rapport à une période normale - heureusement, cela inclut les devoirs à distance. D'après l'Anses, deux tiers des adolescents de 11 à 17 ans présentent un risque sanitaire préoccupant et 49 % un risque sanitaire élevé lié à l'obésité et au surpoids, à cause de la sédentarité et du temps passé sur les écrans, naturellement au détriment de l'activité physique. Selon l'OMS, la France est classée à la 119ème position sur 146 pays en termes d'activité physique.
Pour les adultes, le temps d'exposition moyen journalier a été de 5 heures pendant le confinement. 25 % des Français passent désormais plus de 7 heures par jour devant un écran - en réalité, nous sommes sans doute plus proche de 80 % de notre temps éveillé... Tout ceci doit interroger. On pensait par ailleurs que la télévision serait balayée : il n'en a rien été, les Français passent toujours 3 heures et 45 minutes par jour devant leur seul téléviseur, auquel il faut ajouter le temps passé devant un écran d'ordinateur ou un smartphone. Les foyers français possèdent en moyenne 6,4 écrans aujourd'hui, contre 6 écrans il y a dix ans.
Enfin, et même si les perspectives sont plus lointaines, nous devons être attentifs à ces technologies qui auront demain la capacité de remplacer massivement des emplois. Je pense notamment à l'informatique quantique : Google vient de réussir à faire fonctionner un microprocesseur quantique qui fait en 3,2 secondes ce que les meilleurs ordinateurs actuels font en 10 000 ans. Des chercheurs de Shanghai ont conçu un microprocesseur cent mille milliards de fois plus rapide que les ordinateurs actuels. Les exponentielles définissent notre époque : un tout petit progrès technique entraîne des conséquences phénoménales, au-delà même de ce qu'on peut concevoir.
S'agissant enfin de la polarisation politique, la crise a confirmé ce que l'on pouvait déjà se dire depuis un bon moment : le 21ème siècle donne la prime aux régimes dits « illibéraux », qui utilisent à plein et avec joie toutes les nouvelles technologies numériques de surveillance et de contrôle. Ces « technodictatures » trouvent dans le numérique les outils dont les dictatures du passé ont sans doute rêvé. L'objectif de Pékin est de pouvoir identifier, à terme, n'importe lequel des 1,3 milliard de citoyens chinois n'importe où sur le territoire en moins de trois secondes, grâce aux caméras de reconnaissance faciale. Le pays en compte déjà 400 millions aujourd'hui, et un milliard d'ici deux ans. En parallèle, la Chine a mis en place un système de « notation sociale », qui emporte des conséquences directes et lourdes : interdiction de voyager à l'étranger ou de prendre le train, sonnerie de portable particulière, amendes, impossibilité d'envoyer ses enfants à l'université, etc.
Tout ceci doit être pris avec précaution compte tenu des incertitudes liées aux chiffres communiqués par la Chine. Il reste néanmoins que, pour l'instant, l'efficacité de ces régimes dans la gestion de l'épidémie paraît réelle. Ce qui nous pose un véritable problème : existe-t-il, dans ce monde qui exige des réponses extrêmement rapides et innovantes, qui ne laissent pas forcément de temps à la délibération, une place pour nos régimes démocratiques ? Avons-nous encore une carte à jouer, et si oui, laquelle ?
Je termine mon propos en évoquant l'effet Dunning-Krunger, ce biais cognitif par lequel plus on est ignorant d'un sujet, plus on se croit compétent : c'est bien ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On avait pensé qu'ils permettraient une épiphanie du débat démocratique, et on a eu au contraire une balkanisation et une hystérisation des débats, la création de bulles cognitives, et l'inefficacité de la modération et de la censure - celle-ci ne faisant que reporter les débats ailleurs.
Pour conclure, la tempête a toujours pour effet de révéler les faiblesses du bateau : c'est exactement ce que cette crise est en train de nous faire.

Merci pour ces propos à la fois éclairants et inquiétants. Je vous rejoins sur les commerces de centre-ville : il y a bien un enjeu majeur, sinon de disparition, au moins de transformation. Des commerçants alimentaires travaillant avec la principale plateforme de e-commerce me faisaient récemment part de leur inquiétude car ce partenariat était aussi, pour la plateforme, un moyen de collecter une grande masse de données sur chacun de leurs clients, permettant de définir leur profil en fonction de leurs goûts et de leurs habitudes avec, derrière, la possibilité de se passer des commerçants.

Vos propos ont le mérite de nous mettre face à une réalité inconfortable, que l'on pressent tous mais que vous dites clairement. Un sujet m'interpelle particulièrement : le déclin de l'activité physique. Avant, nos enfants se dépensaient en allant faire des cabanes à l'extérieur, c'était tout simplement naturel. À cause des écrans, ce n'est plus du tout le cas et c'est une vague à laquelle nous n'arrivons pas à résister malgré toute l'énergie que nous déployons.
L'usage de technologies intrusives par la Chine et d'autres pays asiatiques dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 n'est-il pas aussi un moyen supplémentaire, voire un prétexte, pour restreindre encore plus les libertés ? Arrivera-t-on, ici, à trouver un équilibre satisfaisant entre l'utilisation intelligente de ces technologies et le respect des libertés ? Quel prix serons-nous prêts à payer ?
S'agissant du bon usage des données, l'exemple de la campagne de vaccination est éloquent : le site VaccinTracker, développé par un ingénieur informatique de 24 ans, aussi à l'origine de CovidTracker, permet de voir en temps réel le nombre de doses achetées, reçues, utilisées, etc., de savoir à quel moment chacun pourrait être vacciné en fonction de son âge, de son état de santé, de son département, etc. Cette utilisation des données est à la fois bien plus transparente et bien plus efficace que ce qu'a fait l'État : ne devrions-nous pas nous en inspirer dans la perspective des prochaines crises ?
Sur l'obésité, votre remarque me fait penser à la citation du biologiste Edward Osborne Wilson : « le vrai problème de l'humanité est le suivant : l'homme a un cerveau du paléolithique, des institutions du Moyen-Âge et des technologies de niveau divin ». L'obésité est là parce que notre cerveau n'est pas fait pour être confronté à autant de calories. Ceci dit, nous apprenons, nous développons de nouvelles règles : l'éducation à l'activité physique en fait partie, comme la limitation de l'accès aux écrans, ces nouveaux défis auxquels la génération de nos parents n'avait pas été confrontée. Je suis confiant, mais cela va nécessiter des aides, car chacun comprend bien qu'il y a derrière cela de très fortes inégalités sociales.
Sur le succès des « technodictatures », plusieurs effets se cumulent : la disponibilité des technologies de contrôle, qu'il a suffi de renforcer, et une culture de la discipline préexistante.
Mais c'est peut être également ici, dans la crise du progrès scientifique que connaissent les sociétés occidentales, qu'il faut chercher une partie de l'explication. Dans le baromètre Ipsos-Institut Sapiens que nous avons mis en ligne, à la question « Pensez-vous que les générations du futur vivront mieux que celles d'aujourd'hui grâce à la science et à la technologie ? », près de 62 % des Français répondaient « oui » en 2013. Ils ne sont plus que 50 % aujourd'hui. Un Français sur deux n'a plus confiance dans le progrès scientifique, et il est difficile de ne pas les comprendre : depuis 30 ans, ils ont vu les technologies progresser, mais pas forcément leur situation s'améliorer.
D'où l'échec complet de StopCovid, faute d'adhésion de la population à cette solution. D'où les cris d'orfraie que l'on a entendus à l'évocation de l'idée d'un passeport vaccinal. Pourtant, il ne me semble pas absurde qu'on vous demande, au moment de mettre votre enfant à la crèche, qu'il ait été vacciné : il y a en effet des externalités négatives terribles.
Tout ceci est lié à une crise de confiance vis-à-vis de la science, mais aussi vis-à-vis de nos institutions et de ceux qui nous représentent. La situation est extraordinairement paradoxale : un tiers de l'humanité dispose d'un profil Facebook, les GAFA vous connaissent mieux que votre mère, mieux que vous-même, au point de prévoir ce que vous allez faire, et nos débats politiques tournent autour de l'idée de donner ou pas telle ou telle petite information isolée à l'État... Nos démocraties doivent inventer un arbitrage intelligent et innovant entre sécurité et libertés. Nous n'avons tout simplement pas le choix. Il s'agit d'inventer les conditions institutionnelles de séparation des pouvoirs, de cloisonnement des systèmes, pour tirer le meilleur parti des données - par exemple, si la RATP consentait à l'open data, il est certain qu'une application très innovante ne tarderait pas à apparaître - tout en protégeant les droits, les libertés, la vie privée. C'est en fin de compte une question de souveraineté : hier, celle-ci portait sur le territoire, la nourriture, les hydrocarbures, les métaux ; aujourd'hui, ce sont les données, où elles sont stockées, dans quels tuyaux elles passent - par exemple les câbles sous-marins -, qui a les moyens de les exploiter grâce à l'intelligence artificielle, etc.

Les données communiquées aux Français par les pouvoirs publics sont finalement très réduites : c'est le nombre de personnes contaminées, hospitalisées, en réanimation, et décédées. Ces données sont anxiogènes, n'apportent pas vraiment d'information intéressante au niveau individuel, comme le risque de contracter le virus en fonction de son état de santé, de son lieu de résidence, du type de lieux fréquentés, etc. D'où ma question : pourquoi n'a-t-on pas collecté et utilisé ces données ? Aurait-on pu le faire ? Est-ce un problème d'organisation ou bien un obstacle juridique, lié par exemple à l'opposition de la CNIL ? Une utilisation des données et des technologies plus poussée aurait-elle pu éviter les dégâts causés par les confinements successifs ? Je pense par exemple aux dégâts psychologiques chez les jeunes dont la presse se fait l'écho ce matin.

Une remarque tout d'abord : les pays asiatiques ont déjà été confrontés à des crises sanitaires de ce type, qui ne se sont pas toujours bien passées malgré leur recours à des technologies intrusives. Une question ensuite : pourrait-on envisager, grâce aux technologies, un confinement individuel des sujets à risque, pour éviter un confinement général ?
S'agissant des données : on utilise d'abord celles dont on dispose, même si elles sont imparfaites. Un peu comme les économistes mesurent la croissance du PIB, alors même qu'on connaît les limites de cet indicateur : pour augmenter la croissance, il suffit de casser une vitre, ou qu'il y ait davantage de morts sur la route. Je ne jette donc pas la pierre au Gouvernement : au début de l'épidémie, on ne savait rien ou presque des modes de transmission du virus. Une première étude américaine a permis d'y voir un peu plus clair, mais les résultats étaient difficilement transposables à la France. Il a fallu attendre décembre pour qu'une étude de l'Institut Pasteur permette d'y voir plus clair : le pire, c'est évidemment les lieux privés et les repas.
La CNIL et les règles de protection des données personnelles ralentissent-elles notre capacité à agir ? La réponse est oui, c'est malheureusement très clair. Disposer d'institutions qui assurent le bon respect de la règle à tout moment, c'est aussi nous priver de cette capacité de « bac à sable » indispensable à l'innovation, qui est toujours une transgression.
Vous avez raison, nous aurions pu avoir une communication plus positive, par exemple sur le nombre de vie sauvées et non pas seulement de vies perdues. C'est arrivé trop tard, et trop peu. Ceci dit, nous nous sommes rendu compte que le choix n'était pas entre la mort et la vie, mais entre les morts directes et les morts indirectes, qui sont beaucoup plus difficiles à comptabiliser, comme par exemple les suicides étudiants. D'une manière générale, on regarde toujours les moyennes, alors qu'il faudrait regarder les écarts-types : dans cette crise, certaines personnes ne sont quasiment pas touchées, au-delà du petit désagrément de ne pas pouvoir aller au restaurant depuis octobre, d'autres voient le travail d'une vie s'effondrer.
Par « confinement individuel », entendez-vous un confinement en fonction des risques courus par chacun, ou plutôt un confinement laissé à la libre appréciation des individus ?

Le confinement individuel reposerait, d'une part, sur une prédiction des risques, de façon graduée, grâce aux applications numériques, permettant notamment de remonter avec précision les chaînes de contamination, d'autre part, en effet, sur la prise des mesures d'isolement qui s'imposent pour ces personnes, de préférence avant qu'il ne soit trop tard et qu'elles soient contaminées. Confiner les personnes à risques - celles qui sont fragiles, ou celles qui sortent beaucoup et voient beaucoup de monde, etc. - me semble toujours préférable à la fermeture complète d'un pays et de l'économie. Ceci nous rapproche du débat sur le passeport vaccinal, qui viendrait remplacer des mesures collectives qui deviennent de plus en plus insupportables. La pandémie devient chronique, on ne peut plus parler d'état d'urgence, il faudra vivre avec pendant longtemps au rythme des campagnes vaccinales, et le numérique pourra nous aider - sinon, nous risquons une révolution.
Je partage tout à fait votre inquiétude : si les choses continuent ainsi, il y aura sinon des soulèvements, au moins des désordres sociaux de plus en plus forts. Les transgressions se multiplient déjà, avec l'apparition de restaurants clandestins, comme les speakeasies à l'époque de la Prohibition.
S'agissant du recours aux technologies de contact tracing, oui, leur utilité me semble évidente, mais pas dans l'état actuel de la pandémie. Elles ne sont efficaces qu'au moment où les contaminations sont encore peu nombreuses. En revanche, nous devrions nous préparer à les utiliser le plus tôt possible lors de la prochaine pandémie : il faudrait le faire accepter aux Français, grâce à des applications leur donnant toutes les garanties de non-traçage en fonction des risques.
Et s'il se confirme que les personnes vaccinées ne sont plus contagieuses, en effet, il faut absolument leur permettre de vaquer normalement à leurs occupations. Encore faut-il se souvenir que l'esprit humain a tendance à surestimer les très faibles probabilités, et à sous-estimer les très fortes : je ne sais pas si les gens tireraient les bons enseignements d'une application qui leur dirait qu'ils ont tel ou tel risque d'attraper une maladie.

Merci pour votre présentation synthétique. L'histoire semble s'accélérer avec la pandémie que nous vivons. Vous avez évoqué la puissance économique et financière des groupes du numérique, les fameux GAFA. Cela nous interpelle au niveau politique. Dans son ouvrage récent : L'âge du capitalisme de surveillance, l'universitaire américaine Shoshana Zuboff, professeur à Harvard, écrit : « Les capacités du numérique perfectionnent la prédiction et le contrôle comportemental permettant à la connaissance parfaite de supplanter le politique comme moyen collectif de prise de décision ». C'est assez sidérant. Jamais dans l'histoire de l'humanité aucune entité économique, pas même un État n'avait disposé de tels moyens de contrôle de la population au sens large. Compte tenu du nombre de personnes aujourd'hui connectées, cette question interpelle la planète toute entière. Se pose désormais la question de la régulation. En octobre dernier aux États-Unis, un rapport parlementaire concluait à la nécessité de prendre des mesures pouvant aller jusqu'au démantèlement des grands groupes du numérique. Cela interpelle les États.

Comme beaucoup des outils créés par l'homme, le numérique peut apporter le meilleur comme le pire. Il renforce l'hyperindividualisme dans nos sociétés. Mais il permet aussi de conserver des liens sociaux. Il permet d'accéder facilement au savoir, et parallèlement, chacun peut estimer être devenu un « sachant » en faisant simplement quelques recherches sur Internet. Sans adopter les méthodes de contrôle d'Internet en vigueur dans les pays dictatoriaux, quels garde-fous doit-on mettre en oeuvre collectivement pour éviter les dérives ? Certains garde-fous sont individuels, par exemple en limitant volontairement au sein de son foyer le temps d'exposition des enfants aux écrans. Mais ce n'est pas duplicable à grande échelle. Il faut donc des garde-fous collectifs, redonner des règles pour éviter le pire dans une société passée du losange au sablier, et qui risque d'aller vers davantage de tensions demain sur les enjeux de maîtrise du numérique. Cela va au-delà de la question de l'accès.

Comment peut-on réguler les grandes plateformes numériques qui ont acquis un pouvoir extraordinaire ? Peut-on accepter qu'un censeur nous déconnecte, sans autre critère que celui de la valeur marchande ? Dans le domaine des livraisons, Amazon est devenu un géant. Il peut refuser de livrer des secteurs enclavés. Dans le domaine des mobilités, certains opérateurs du numérique tentent, en se lançant dans le MaaS (Mobility as a Service), d'orienter les choix. La puissance publique est parfois contrariée : ainsi, un fonctionnaire de ma région me disait récemment qu'on ne savait pas empêcher l'application Waze d'envoyer un flux de véhicules traverser un petit village pour désengorger l'autoroute en cas d'embouteillage.

J'éprouve une certaine déception à entendre un universitaire nous expliquer que l'avenir de la société française est de prendre la forme du sablier, avec une très faible capacité des individus placés d'un côté du sablier à passer de l'autre côté. La révolution du numérique est en cours depuis de nombreuses années. Je n'ai pas vu que le système d'enseignement ait beaucoup changé depuis l'apparition du numérique. Or, l'enseignement repose sur une transmission d'informations. N'a-t-on pas raté quelque chose dans l'évolution de nos méthodes d'enseignement ?

Nous avons entendu une critique très acerbe du monde digital. Il est certain que les États n'ont pas su accompagner la révolution technologique. Mais les créateurs de l'iPhone n'avaient pas eux-mêmes imaginé les applications qui seraient faites de leur propre invention. Le décalage entre la technologie et son utilisation peut être très important. Dans ces conditions, n'est-il pas illusoire de penser que le politique pourra, de manière prospective, intervenir pour encadrer ces nouvelles libertés ? De quelles pistes pourrait disposer le politique dans ce contexte ?

Pour prolonger les propos de mon collègue Éric Bocquet qui a cité l'excellent livre de Shoshana Zuboff, je m'interroge sur la viabilité du modèle dans lequel nous évoluons depuis les années 1990, qui a vu les géants du numérique devenir de plus en plus puissants, ce qui peut finir par devenir toxique. Croyez-vous qu'une régulation soit possible ? Au niveau européen, de nouveaux textes sont en cours de discussion mais il me semble que l'on ne va pas assez loin. Par ailleurs, croyez-vous raisonnable que l'on ait confié les données de santé des Français logées dans le Health Data Hub à un géant américain, qui est donc placé sous juridiction américaine, sans réfléchir aux conséquences que cela pouvait avoir à long terme ?

Ne pensez-vous pas pertinent que l'État constitue lui aussi une véritable plateforme ? Son actif le plus important n'est peut-être plus un actif physique mais repose sur la mise en relation. L'État dispose de nombreuses données provenant de multiples sources mais hésite à les utiliser : ministère de l'agriculture, services fiscaux, agence nationale de l'habitat, etc. À côté du modèle de l'État-entreprise du capitalisme chinois et à côté du modèle de l'entreprise-État des géants du numérique, peut-on inventer un modèle alternatif, en y mettant de la régulation mais aussi de la démocratie. L'affaire de la suspension du compte Twitter de Donald Trump est le symbole d'une prise de pouvoir par les géants du numérique.
Merci pour ces excellentes questions. Pour répondre à l'interpellation du sénateur Alain Richard, je précise que prévoir n'est pas souhaiter. Dans mes livres, je n'appelle en aucun cas de mes voeux une société en sablier, bien au contraire. J'insiste pour que l'Université remette dans ses programmes la culture générale, en particulier en début de cursus. Je propose qu'on fasse de l'épistémologie et de l'histoire des sciences à l'école, qui montre que les découvertes sont parfois combattues au début : Pasteur a été très critiqué. Il faut davantage enseigner la science. On doit en outre faire confiance à l'être humain pour s'approprier les nouveaux outils numériques. C'est l'éducation qui permettra de développer l'esprit critique. Par le passé, la donnée était rare et chère, mais elle était sourcée et on pouvait avoir confiance en elle. Désormais elle est abondante et le nouveau défi est de sélectionner les informations. Une réforme de l'éducation pour prendre en compte le nouveau contexte est donc nécessaire.
Mais, pour répondre aux enjeux du numérique, il convient aussi de mener la réforme de l'État qui continue à avoir le monopole de la violence légitime. Or, des plateformes numériques s'immiscent dans ce qui était dévolu à l'État. Facebook dit maintenant le vrai et le faux, décide de ceux qui ont droit de parler et de ceux qui n'ont pas ce droit. Facebook ne s'est rendu compte de son rôle social et politique qu'après son lancement. Le but initial de Facebook était et reste de faire du commerce. Le texte proposé par la Commission européenne, le DSA (Digital Services Act) propose une solution certes limitée mais qui constitue un juste milieu. Les réseaux sociaux ne seront plus considérés comme de simples hébergeurs, mais ils ne peuvent non plus être assimilés à des éditeurs qui vérifient tout ce qui est publié avant publication et en assument la responsabilité. En revanche, les réseaux sociaux ont une obligation de résultat ex post. Si une publication contrevient à la loi, le réseau social doit intervenir et le faire rapidement.
Le démantèlement des GAFA me paraît compliqué à mettre en oeuvre : si Google ne fonctionnait plus, on ne pourrait tout simplement plus travailler dans le pays ! Mais on a la possibilité de fixer des règles.
Concernant la réforme de l'État, j'estime qu'il conviendrait que l'État soit pensé moins comme une administration que comme une instance politique. Ce n'est pas parce qu'on a toutes les données qu'on peut prendre des décisions. La loi doit aussi fixer les priorités. Pour prendre un exemple : les opérateurs de télécoms ont des obligations en matière de couverture du territoire. Pourquoi ne pas imposer aussi des obligations aux géants du numérique ? Ne confondons pas fonction publique et service public : un opérateur privé peut rendre un service public. L'Institut Sapiens a fait un rapport consacré à l'Estonie, montrant que la modernisation de l'État y était passée par la mise en place de plateformes.
Je défends aussi l'idée que les parlementaires devraient pouvoir s'appuyer sur une structure comme le NAO (National Audit Office) britannique, équivalent de la Cour des Comptes, pour disposer d'une véritable puissance de feu dans l'évaluation des politiques publiques et jouer un rôle de contrepouvoir.

Je vous propose de procéder aux désignations des rapporteurs sur nos futurs travaux consacrés, d'une part, à l'avenir des réseaux sociaux, d'autre part, aux transformations liées au télétravail.
J'ai reçu les candidatures de Julien Bargeton, Catherine Morin-Desailly et Vanina Paoli-Gagin aux fonctions de rapporteurs sur la question des réseaux sociaux. Pour l'avenir du télétravail, j'ai reçu les candidatures de Céline Boulay-Espéronnier, Cécile Cukierman et Stéphane Sautarel.
Je précise que nous envisageons de tenir des tables rondes de prospective sur ces deux sujets en mars et en avril. Nos collègues de la délégation aux entreprises examinent actuellement les nouvelles formes d'organisation du travail dans les entreprises et nous pourrions être amenés à nous rapprocher d'eux sur la question du télétravail.
Il en est ainsi décidé.

Nous pouvons désormais passer à l'examen du rapport sur les mobilités dans les espaces peu denses dont nous avons largement débattu lors de notre précédente réunion.

Les remarques faites lors de la dernière réunion de la délégation ont permis d'enrichir le rapport et de présenter des scénarios. J'attire votre attention sur les compléments qui ont pu être apportés grâce à quelques experts que j'ai sollicités.
Le risque social de mobilités à plusieurs vitesses selon les territoires est élevé. Le manque de moyens y contribue. Les expérimentations dans les territoires peu denses sont intéressantes mais on peut se demander s'il ne s'agit pas d'un palliatif sous perfusion, à défaut de politiques structurelles de mobilités dotées de réels moyens.
J'ai ajouté un élément qui m'a frappé : le prix des carburants est aujourd'hui particulièrement bas en euros constants par rapport aux années 1970 ainsi qu'en ramenant ce prix au pouvoir d'achat des ménages. Mais le prix du carburant reste une donnée sensible car il s'agit là d'une dépense contrainte.
Dans les espaces peu denses, nous devons nous demander quelle approche retenir : faut-il privilégier des solutions partielles pour les 15 à 20 % de la population qui sont des « assignés territoriaux » et qui n'ont pas de moyens de transports et de liberté de mouvement ? Dans le scenario intitulé : « rien de neuf », on imagine en effet que seules les ruptures technologiques apporteront des solutions nouvelles. Aujourd'hui sur un territoire non connecté à Internet, la valeur immobilière est faible. Demain, un territoire non couvert par des livraisons à domicile ou avec une mobilité uniquement en voiture ne connaîtrait-il pas le même risque ?
L'absence de solution de mobilité adaptée constitue encore un obstacle et un frein dans la vie quotidienne qu'il convient d'examiner avec attention. Cela constitue une nécessité sociale et écologique, mais aussi une condition de la cohésion territoriale dans la République.
Enfin, j'ai précisé qu'il fallait organiser les mobilités à la bonne échelle, soit plutôt celle des bassins de mobilité que celle des périmètres administratifs existants. J'ai également insisté sur la nécessité d'inventer des solutions en matière de financement, sans entrer cependant dans le débat sur la gratuité.
En conclusion, je voudrais redire l'importance ne pas opposer les transports individuels aux transports collectifs. Il ne faut pas condamner la voiture, mais envisager de nouvelles modalités pour son utilisation.

Les territoires peu denses, dans leur grande diversité, méritent toute notre attention. Les questions climatiques ou de relief y ont leur importance.
Pouvons-nous considérer le rapport comme adopté ? Il est adopté.
La réunion est close à 10 heures.