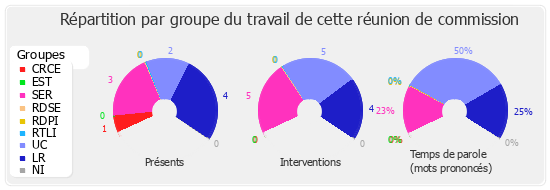Mission d'information Conditions de la vie étudiante
Réunion du 11 mars 2021 à 14h00
Sommaire
La réunion

Madame la présidente, mes chers collègues, nous commençons aujourd'hui les travaux de notre mission d'information sur les conditions de la vie étudiante. C'est une façon de montrer tout l'intérêt que nous portons à votre travail que de commencer par l'Observatoire de la vie étudiante (OVE). Je précise que Mme Ronzeau est accompagnée de Mme Élise Tenret, chargée de mission auprès de l'OVE.
Nous avons fait appel, sur les réseaux sociaux, à des témoignages d'étudiants : nous en avons déjà recueilli 389 qui sont de grande qualité et très touchants. Ils expriment de manière concrète le sentiment des étudiants et des étudiantes, qui complètera je pense votre approche plus statistique et scientifique. La confrontation des deux sera très stimulante. Avec l'accord de M. le rapporteur, nous mettrons en ligne ces témoignages. Il est important de montrer que notre mission prend en compte les ressentiments et la détresse des étudiants. Ils nous parlent de façon très concrète de la façon dont ils vivent la crise.
Nous partageons un objectif commun : comprendre la gravité de la situation actuelle liée à la crise, mais dans le sens où elle peut aussi dévoiler des difficultés structurelles sur lesquelles nous aimerions nous pencher également.
Nous saisissons, à la lecture des études de l'OVE et de ces témoignages, l'extrême diversité des situations. Cette diversité est, d'une part, territoriale : les situations sont différentes selon qu'on est étudiant en outre-mer, dans la région parisienne ou dans une petite université éloignée des grandes métropoles. Elle est, d'autre part, liée à la variété des cursus.
L'OVE a été créé en 1989 par le ministère de l'éducation nationale afin de mieux comprendre les conditions de la vie étudiante. Vous rendez tous les trois ans des enquêtes « Conditions de vie » attendues et très suivies. La dernière date de 2020. La presse en a publié certains pré-rapports et pré-conclusions : vous nous direz, madame la présidente, si vous avez pu aller plus loin que ce qui est déjà connu. Vous parvenez à établir de façon précise et statistique les conditions de vie économiques des étudiants : ces informations sont très éclairantes. Elles révèlent de très grandes disparités.
Après l'intervention du rapporteur, nous vous donnerons la parole, puis nous aurons un temps d'échanges avec mes collègues.

Monsieur le président, madame la présidente, mes chers collègues, il nous paraissait très important de commencer ces travaux en auditionnant Mme Ronzeau pour aller au-delà du ressenti ou des témoignages que nous avons pu entendre, et dont notre président a évoqué la force. Ils atteignent le nombre de 389 pour une enquête lancée il y a 48 heures à peine, ce qui montre que le travail que nous menons à travers cette mission d'information est particulièrement d'actualité. Je vais commencer en vous posant quelques questions.
Le 28 janvier dernier, vous avez présenté les résultats de l'enquête sur les conditions de vie des étudiants que vous avez effectuée en 2020. La dernière édition de cette enquête remontait à 2016. Quatre ans après, sur la base d'un questionnaire recueillant 60 000 réponses, vous avez tiré certaines observations. Vous avez concomitamment rendu publics les constats d'une enquête complémentaire portant spécifiquement sur la vie étudiante pendant le premier confinement, réalisée en juillet 2020, et qui vient compléter et approfondir certaines réponses de l'enquête générale. Cette enquête complémentaire a été effectuée à partir des réponses des 6 000 étudiants ayant accepté d'être à nouveau contactés.
Comme l'a dit M. le président, nous essayons d'analyser la situation entraînée par la crise sanitaire, mais aussi les facteurs plus structurels qui la précédaient et lui succéderont peut-être si rien n'est fait. Mes questions iront dans ce sens.
Par rapport à l'édition de 2016, les résultats de l'enquête générale 2020 - hors prise en compte de l'enquête complémentaire portant sur la période de confinement - font état d'une certaine amélioration, s'agissant de la plupart des critères évalués (satisfaction dans les études, perspectives d'insertion, budget, logement, santé) : pourriez-vous présenter ces résultats et avancer des éléments d'explication à cette tendance ?
Deuxième question : la période de confinement a remis en cause les résultats de l'enquête générale, principalement sur quatre points, qui reviennent régulièrement dans les témoignages que nous avons reçus : les conditions d'études, la situation économique, le logement et l'état de santé - y compris psychologique. Pour chacune de ces thématiques, dans quelle proportion le confinement a-t-il infléchi, inversé ou amplifié les constats initialement dressés ?
Troisième question : observez-vous des différences entre les étudiants selon les types d'établissements fréquentés (université, classe préparatoire, grande école...) ou les filières de formation suivies (médecine, Institut national supérieur du professorat et de l'éducation [Inspé], sciences humaines et sociales...) ? Selon le sexe (homme/femme), la nationalité (étudiants français/étudiants internationaux) ou la situation sociale (étudiants boursiers/étudiants non boursiers) ?
Par ailleurs, au-delà des effets immédiats de la crise sanitaire, identifiez-vous des conséquences plus structurelles sur la vie étudiante ?
Par rapport à la situation actuelle, quels leviers d'action à destination des pouvoirs publics préconisez-vous à court et moyen termes pour répondre à la situation des étudiants ?
Les effets du reconfinement de l'automne dernier, puis de la reprise très partielle en présentiel en début d'année, peuvent-ils déjà être mesurés par l'OVE ?
Dernière question : pour l'édition 2020 de l'enquête générale, les problématiques des violences sexistes et sexuelles, les questions de racisme et de discriminations ont été intégrées pour la première fois aux questionnaires envoyés. Même si cela ne permet pas d'observer une évolution dans le temps, pourriez-vous néanmoins nous fournir les enseignements que vous en auriez tirés ?
Nous allons essayer, avec ma collègue, de répondre au mieux : comme vous le constatez dans vos questions, le sujet est complexe et très vaste. Cette année, nous avions déjà lancé cette enquête au long cours, qui suit des analyses régulièrement répétées tous les trois ou quatre ans depuis 1994. Dans ce contexte, je voudrais revenir en introduction sur des points que vous avez évoqués.
Commençons par notre mission principale. L'OVE dispose d'abord de données statistiques spécifiques, qui ne sont pas vraiment disponibles auprès d'autres institutions ou opérateurs car, en France, on étudie surtout la population jeune et pas spécifiquement la population étudiante - ce qui crée des biais par rapport à l'approche de la jeunesse, notamment sur le plan économique. L'OVE a également la capacité de faire remonter le ressenti des étudiants : comment vivent-ils leur expérience, leur parcours de vie et leur parcours d'étude ? Ainsi que le confirme l'enquête 2020, nous constatons au fil des années des évolutions, mais elles sont relativement lentes. Je mets à part le confinement et les conséquences de la crise de cette année : nous y reviendrons. On veut se rapprocher d'une réalité qui, sinon, transparaît peu. Les relais intermédiaires (associations, syndicats, élus des conseils universitaires) peinent à traduire les besoins, les difficultés ou les attentes des étudiants. La vie étudiante ne se limite pas à ce qui se passe sur les campus : on en a aujourd'hui une acception large, à la différence de celle qui prévalait dans les années 1980. On s'intéresse à l'expérience étudiante, c'est-à-dire à la construction d'un parcours d'étude mais aussi au parcours d'autonomie et de construction de la personne humaine en lien avec ses pairs, les enseignements-chercheurs et l'environnement. Ce dernier doit, lui aussi, être analysé de façon concomitante.
Je souhaite aborder un second point, qui va revenir à plusieurs reprises dans notre présentation : il est impossible de parler aujourd'hui « des étudiants » ou d'une « population étudiante ». Cela n'a aucun sens, et c'est d'autant plus vrai après la crise. La pression démographique aboutit à un nombre d'étudiants en augmentation considérable depuis les années 1970. Dès lors, les universités et les établissements d'enseignement supérieur ont dû s'adapter, et la différenciation entre les catégories d'étudiants s'est progressivement imposée. Elle s'est fortement accrue depuis la crise et s'est révélée de plus en plus importante entre catégories d'établissements. On ne peut parler d'un système à deux vitesses, mais on observe une réalité complexe, qu'il faut analyser comme telle sans procéder à des généralisations, comme peuvent le faire les médias.
Les résultats de l'enquête 2020 s'inscrivent dans la durée et dans les constats précédents de 2016. Je précise ici qu'on a exploité 60 000 résultats (complétés et exploitables), mais nous avions consulté 250 000 étudiants avec un panel représentant l'ensemble de l'enseignement supérieur, et pas seulement les universités. On observe une stabilisation, mais certains points particuliers ont donné lieu à des progrès - dans des proportions raisonnables toutefois. Ainsi, lorsqu'on analyse le sentiment des étudiants par rapport au déroulement de leurs études (satisfaction quant à leur organisation et à ce qu'elles leur apportent), on voit qu'en 2020, 64 % sont satisfaits ou très satisfaits. C'est une amélioration par rapport à 2016 où le chiffre était de 60 %. En 2020, 10 % sont insatisfaits, pour 11 % en 2016. En ce qui concerne le contenu de la formation, 71 % des étudiants étaient satisfaits. 2020 allait donc dans un sens positif. C'est également le cas pour les perspectives d'avenir : en 2016, 54 % des étudiants estimaient leurs chances d'insertion en France bonnes ou très bonnes contre 14 % qui les estimaient mauvaises ou très mauvaises, et en 2020, on est passé respectivement à 68 % et 8 %. À l'étranger, l'écart est similaire : en 2016, 40 % estimaient les chances d'insertion à l'étranger bonnes ou très bonnes, 21 % mauvaises ou très mauvaises ; en 2020, nous passons respectivement à 45 % et 18 %.
Je veux évoquer un dernier élément positif, qui porte sur la situation financière et économique des étudiants (indépendamment de la crise actuelle). Dans l'ensemble, pendant l'année universitaire, la proportion d'étudiants qui déclarent connaître des difficultés financières importantes ou très importantes est d'un cinquième. Cela représente, par rapport aux 23 % de 2016, une baisse modeste mais significative, car ce type d'écart enregistre, sur une population plus grande, de vraies évolutions. En 2020, 26 % des étudiants déclaraient ne pas avoir assez d'argent pour couvrir les besoins mensuels, contre 29 % en 2016.
Plus généralement, lorsqu'on examine la situation économique des étudiants, on doit se souvenir de la différence avec les estimations réalisées par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) sur la population jeune. Il n'y a ainsi pas de budget étudiant au sens strict, mais une reconstitution des ressources perçues par les étudiants, qui proviennent de trois origines principales : les aides familiales, les aides publiques, et les activités rémunérées, qui se sont progressivement renforcées.
Concernant cette activité rémunérée, il faut prendre garde à ne pas faire trop de raccourcis. On entend toujours qu'un étudiant sur deux travaille, que les étudiants ont du mal à satisfaire leurs besoins... C'est plus complexe : d'abord, la dernière enquête indique que 38 % des étudiants travaillent et, ensuite, le panel d'activités rémunérées va du baby-sitting, qui procure des revenus modestes mais souvent réguliers, aux stages liés à leurs études, notamment les études de santé, en passant par une série de « petits jobs » (vente, commerce). L'analyse doit se concentrer sur ce qui crée problème dans l'activité rémunérée, à savoir l'intensité et le rythme de l'emploi (nombre d'heures et de jours par semaine), qui peuvent contrarier, ou non, la possibilité de suivre les études. Ce facteur majeur a entraîné des conséquences très négatives sur le budget et la situation économique des étudiants en 2020. Cette notion relève donc d'un examen économique, et c'est une de nos limites : nous ne disposons pas des outils de mesure qui conviennent dans le domaine économique.
Voilà donc une piste pour les décideurs dans un avenir proche : remettre à plat un système largement illisible, y compris de la part des étudiants eux-mêmes, qui ont des droits mais ne savent pas toujours à qui s'adresser. On l'a observé avec les mesures d'urgence, certes nécessaires, prises pendant la crise. Il va falloir remettre de la cohérence et redonner du sens à la politique de soutien financier, en ciblant les populations les plus fragiles.
Au-delà de ces trois points, on enregistre peu de modifications dans le domaine du logement. On observe toujours une répartition entre la cohabitation familiale (avec les parents, séparés ou non) d'une part, et la location ou la colocation d'autre part. Je rappelle d'ailleurs que les locations en résidence universitaire ne représentent que 12 % des logements occupés par les étudiants pendant la période universitaire. Le logement pose globalement des difficultés majeures. C'est toujours vrai dans l'enquête 2020 : le montant du loyer est le premier poste de dépenses des étudiants, très variable en fonction du lieu de résidence et des caractéristiques de l'étudiant - qui peut être boursier ou non, recevoir ou non une aide de la famille... Dans ce domaine, il est nécessaire d'examiner l'ensemble des aides et des mesures de soutien, y compris l'aide personnalisée au logement (APL), qui sont parfois décalées par rapport à la réalité vécue par les étudiants, notamment dans les métropoles urbaines en raison du mode de logement.
Au-delà du constat de stabilité et d'amélioration - partielle mais importante -, des points de fragilité touchent à l'état de santé des étudiants. Ils sont apparus dès l'enquête 2016 et se trouvent très confortés en 2020. En arrière-plan, il faut avoir conscience que les étudiants se sentent et se perçoivent en bonne santé (70 % en 2020 contre 62 % en 2016). Le renoncement aux soins s'explique ainsi souvent par le fait qu'ils espèrent une amélioration spontanée de leur état de santé, ce qui est caractéristique d'une population jeune qui n'a pas forcément intégré les potentielles difficultés de santé. Cela change avec la crise sanitaire. L'évolution dans le domaine des fragilités psychologiques est par ailleurs frappante : la part des étudiants déclarant de telles fragilités est passée de 20 à 30 % entre 2016 et 2020. Le renoncement aux soins est passé à 33% pour des raisons financières. Nous faisons donc état d'une alerte, confirmée et amplifiée par les conséquences de la pandémie.
Pour l'OVE, l'exercice est compliqué et inédit : on faisait des constats sur la base de données très riches mais il se trouve que ceci s'est passé au printemps 2020. Nous n'avons pas pu anticiper une durée aussi importante de la crise, ni des effets de plus en plus importants au fur et à mesure des confinements, déconfinements et couvre-feux. Nous avons toutefois prévu, à l'avenir, d'exploiter les propos des étudiants grâce à des équipes de recherche (économistes et statisticiens) qui vont effectuer un travail approfondi.
Pour avancer et avoir une matière première plus utile sur la crise, nous avons relancé, auprès de 6 000 étudiants déjà contactés pour la première enquête de 2020, une enquête courte visant à percevoir ce qui leur arrivait. En ressortait, et en ressort encore, un bouleversement dans l'espace : l'unité de lieu entre formation, recherche dans les laboratoires et vie étudiante a disparu, ce qui déstructure totalement l'identité étudiante. On a entendu des mots très forts sur la « perte de sens ». Qu'est-ce qu'être étudiant, en effet, lorsqu'on ne peut plus ni aller en cours, ni se voir dans des lieux de socialisation et qu'on est coupé du lien avec l'enseignant-chercheur, ou qu'on est revenu dans sa famille ? Tout ceci est brassé dans un ensemble anxiogène dû à l'incertitude liée à la crise. Ces conditions de bouleversement se sont traduites dans les réponses à cette deuxième enquête.
Élise Tenret va vous présenter des éléments de réponse à la deuxième question, sur ce qui s'est passé et qui ressort de notre enquête sur le confinement.
Merci de nous donner l'opportunité de vous présenter nos travaux. Monique Ronzeau a présenté les résultats de notre enquête réalisée de mars à mai 2020. On était déjà dans une situation de confinement, mais on a interrogé les étudiants sur leur situation antérieure en leur demandant de faire un effort d'imagination pour que leurs réponses correspondent à la période antérieure au confinement. En juillet, nous avons lancé une « post-enquête » sur la vie d'étudiant confiné : nous avons réinterrogé 45 000 étudiants parmi ceux qui avaient accepté la première enquête, parmi lesquels 6 130 ont répondu. Cela nous a permis d'établir un bilan du confinement après la session d'examens et d'analyser la façon dont ils avaient vécu cette période.
La première observation est que de nombreux étudiants ont changé de logement - c'est probablement la population la plus touchée par ce phénomène -: c'est ce qu'ont déclaré 44 % des étudiants, très souvent pour se rapprocher de leur famille.
Ensuite, en ce qui concerne les conditions d'études, on observe un passage massif, voire exclusif, au numérique, avec les inconvénients que cela entraîne, et notamment des difficultés d'équipement : ils n'avaient pas forcément d'ordinateur personnel, de connexion internet ou d'espace au calme pour travailler. Ces problèmes se sont accrus pendant le confinement.
Par ailleurs, concernant leur situation économique, un tiers des étudiants ont déclaré avoir perdu leur activité rémunérée, ce qui représente plus de 200 euros de perte financière en moyenne.
S'agissant de l'état de santé, un tiers des étudiants présentent des signes de détresse psychologique, ce qui est la même part que dans l'enquête générale. Cela montre de probables interférences entre les deux enquêtes : on les a interrogés entre mars et mai 2020, à un moment où ils étaient déjà confinés. Il est donc difficile de faire la part des choses entre la réponse propre au confinement et celle liée à l'enquête générale.
Je reviens sur le logement. Le retour au domicile parental n'a pas été sans poser de problèmes : les étudiants font parfois état de conflits. D'autres ont été confrontés au décès d'un proche. De nombreuses difficultés propres à la crise ont ainsi été mesurées en juillet 2020.
Je veux dire un mot sur la situation économique. Dans un premier temps, l'arrêt des activités rémunérées a débouché sur un effet de sidération, qui d'ailleurs n'a pas touché exclusivement les étudiants. Mais on s'est vite aperçu que la situation économique générale et la difficulté des entreprises à se projeter avaient un impact immédiat sur la réponse qu'attendaient les étudiants. Ceux qui ont réussi à retrouver des « petits jobs » (livraison à domicile, etc.) s'en sont mieux sorti. En revanche, la situation a été beaucoup plus difficile pour les étudiants dont l'activité rémunérée reposait sur des formes plus solides d'emploi, comme parfois le salariat. Cette déstabilisation a coïncidé avec la nécessité de quitter un logement, en raison d'un loyer trop élevé par exemple.
Notre enquête montre que les étudiants évoquent un cumul de facteurs de stress et de faiblesse psychologique. La crise est multiforme, et ces dimensions qui s'entrechoquent ont toutes produit des effets en même temps. La fermeture des locaux universitaires, l'arrêt des activités rémunérées, et donc l'isolement et, finalement, la difficulté psychologique à le surmonter : tout ceci s'est cumulé dans un espace-temps très resserré. Cela ressort de façon évidente de notre deuxième enquête.
À cet égard, les étudiants ont reconnu les mesures d'urgence qui ont été prises. À la question de savoir s'ils estimaient avoir reçu beaucoup d'informations de la part de leur établissement, et suffisamment d'aides, la réponse était plutôt positive. Je parle ici du premier confinement : la situation s'est ensuite compliquée. Beaucoup ont rencontré des problèmes de connexion numérique, mais moins que ce qu'on pouvait penser. Cela s'est assez bien passé car les établissements ont réagi par des plans d'acquisition de matériels, et les collectivités territoriales sont montées en puissance pour aider à l'équipement des étudiants. En somme, face à cette situation, les acteurs de la vie étudiante se sont assez sensiblement et fortement mobilisés. Grâce aux établissements d'enseignement supérieur, qui ont particulièrement utilisé la contribution à la vie étudiante et de campus (CVEC), et grâce au ministère, qui a mis en place des aides via des centres régionaux d'oeuvres universitaires de scolaires (Crous) très réactifs dans le déploiement des dispositifs, le pire a été évité.
L'analyse de la situation qui prévaut depuis est plus complexe. Plus la crise dure et plus s'observe un double phénomène. Certains psychologues ont parlé d'un phénomène de glissement, comme on a pu l'évoquer pour les personnes âgées : une espèce d'usure et de fatigue - qui sort bien des témoignages que vous avez reçus - s'est installée. Elle n'était pas encore perceptible dans notre enquête sur le confinement. On observe ici un décalage, et nous avons l'intention de continuer l'analyse. Ces signes d'anxiété et de difficulté à organiser son temps personnel ne constituent pas une surprise : on constate des conséquences négatives similaires dans les premières études sur le télétravail. Les étudiants, en outre, ne se trouvaient pas dans un cadre de travail qui les aurait préparés à cela. Ils ont le sentiment général de ne plus savoir situer leur formation et les études qu'ils poursuivent. Cela remet en cause les choix d'orientation ou le fait de se projeter au-delà du master et d'aller en doctorat : tout est en train de bouger entre licence, master et doctorat. Les priorités ne sont plus perçues de la même façon, parce que l'avenir proche est incertain.
Cela me conduit à aborder la question du déroulement du confinement selon les différentes catégories d'étudiants. Il ne s'est bien sûr pas passé de la même façon pour tous. Des différenciations s'observaient déjà avant : elles se sont confirmées et développées. Certaines catégories ont plus souffert que d'autres : les étudiants étrangers ont été les premiers à être affectés, car ils ont été coupés de l'aide familiale, voire d'un petit travail qu'ils avaient trouvé en arrivant en France. Le soutien des pairs en leur faveur n'était, au surplus, pas autant organisé que ce que l'on a pu observer avec les associations françaises ou certaines filières, par exemple dans les instituts universitaires et technologiques (IUT). Ensuite, les étudiants les plus âgés (plus de 26 ans), engagés dans des études doctorales, ont, pour certains, perdu une source de revenus. Enfin, les étudiants primo-entrants à l'université ont été particulièrement touchés : la génération inscrite à la rentrée 2020 n'a rien connu de l'université. Les grandes écoles s'en sortent beaucoup mieux, pour des raisons évidentes d'encadrement pédagogique et d'organisation, avec un accompagnement personnalisé. Ce dernier constitue à la fois un défi et une nécessité absolue pour les universités. Finalement, les différences qui ressortent de notre enquête se sont clairement accentuées.
Comme l'a très bien rappelé Monique Ronzeau, les travaux de l'OVE contribuent à montrer qu'il n'existe pas un « étudiant moyen », mais bien plutôt une diversité d'étudiants. Les différences d'orientation en fonction de l'origine sociale sont importantes : les classes préparatoires, les grands établissements ou les écoles de commerce accueillent des étudiants plus favorisés tandis qu'on trouve des profils moins favorisé dans les sections de technicien supérieur (STS) ou en IUT. L'orientation est également différente selon le sexe. D'autres variables peuvent être oubliées alors qu'elles sont importantes : l'origine migratoire permet de distinguer différentes orientations selon les étudiants, avec une orientation plus importante des enfants descendant de deux parents immigrés dans des filières courtes professionnelles.
Les filières, alimentées par des profils d'étudiants différents, se caractérisent aussi par des expériences différentes de l'enseignement supérieur : dans certaines d'entre elles, comme la santé ou les classes préparatoires, les emplois du temps sont très chargés, alors qu'ils peuvent être plus légers ailleurs en termes d'heures de présence en cours. Cela permet alors d'exercer des activités rémunérées. Ainsi, dans la filière sciences humaines, les étudiants exercent plus fréquemment des activités concurrentes des études.
L'âge des étudiants influe également sur la cohabitation. Plus ils sont jeunes, plus ils ont de chance d'être cohabitants - au même titre d'ailleurs que les élèves de classe préparatoire. La variable de cohabitation est fondamentale. On parlait des difficultés à mesurer les ressources des étudiants : tout ne passe pas par des transferts monétaires, mesurables et quantifiables. L'hébergement (logement, nourriture) des enfants étudiants est aussi une composante de l'aide familiale. Lorsqu'on examine le budget strictement financier des étudiants, on a l'impression que les plus pauvres sont les étudiants de classe préparatoire. Or ils sont jeunes et souvent cohabitants. Leur budget est certes très faible, mais si on n'intègre pas toutes les aides qui ne sont pas des transferts financiers, cela fausse la vision. À l'inverse, des étudiants qui semblent très riches car ils disposent de fortes ressources peuvent être en fait plus vulnérables car ils sont soumis à un fort volume d'heures de travail, concurrentes des études. Les ressources des étudiants sont à cet égard très différentes de celles qu'on peut mesurer dans d'autres populations.
Sur l'état de santé, on perçoit aussi des inégalités en fonction de ces différentes caractéristiques. Les étudiants qui se déclarent satisfaits de leur état de santé général sont moins souvent des femmes (65 %) que des hommes (76 %), moins souvent des étrangers (66 %) que des Français (70 %), et proviennent moins souvent de milieux sociaux populaires (66 %) que supérieurs (76 %).
La variable territoriale est également très importante : l'expérience étudiante est très différente selon le lieu d'habitation. Les différences de loyer d'un lieu à l'autre, que l'on peut mesurer dans l'enquête « Conditions de vie », sont ainsi très fortes.
Il est difficile de faire un portrait général des étudiants, mais il faut avoir ces différents éléments en tête pour comprendre la diversité de la population étudiante.
J'ajouterai une précision sur les catégories d'établissement. Les plans d'investissement d'avenir (PIA) ont profondément restructuré la carte des établissements d'enseignement supérieur. Si on s'intéresse au côté universitaire, on voit que les grandes universités fusionnées n'avaient pas attendu la crise pour investir dans l'innovation et l'ingénierie pédagogiques ou le distanciel intelligent. Ces établissements ont donc réussi à faire leur transition plus facilement que d'autres.
C'est très important, en particulier pour la recherche. On a observé, dans certaines universités, une forme de latence, qui a bloqué le fonctionnement général des établissements. Cela ne s'est toutefois pas produit partout de la même façon : il existe bien une différenciation entre établissements. Elle n'est pas en soi un problème, dès lors qu'on en a conscience et que des mesures d'accompagnement personnalisé sont envisagées : peut-être faudra-t-il une action renforcée dans les établissements qui, eux, n'avaient pas les moyens, ou n'avaient pas inscrit dans leurs projets le développement de ces mesures. On parle de « maturité numérique » dans la digitalisation des enseignements, et on observe à cet égard de très gros écarts entre les établissements. Certes, ils se sont tous tant bien que mal attelés à la tâche : ce tâtonnement est logique et compréhensible en cas de crise. Il faudra néanmoins prendre en compte toutes ces différences au niveau structurel par la suite.
On ne reviendra pas au statu quo ante en termes d'organisation. Dans le domaine de la vie étudiante, on sait d'ores-et-déjà que la crise actuelle aboutira à réinterroger la notion de campus. On aura forcément non pas du distanciel - qui est une catastrophe totale - mais un modèle hybride qui reste à définir. Il ne sera pas homogène selon les territoires et les établissements. On aura à inventer, comme dans beaucoup d'autres pays, un équilibre et une complémentarité entre présentiel d'un côté, et enseignement et formation à distance de l'autre.
Cela suppose la formation des enseignants-chercheurs. Il ressort ainsi des témoignages que certains étudiants ont fortement ressenti que leurs enseignants étaient aussi perdus qu'eux.
Je vais donner la parole à ma collègue, qui enseigne à Dauphine et peut nous éclairer sur le vécu de l'enseignant-chercheur confronté à l'écran noir des étudiants qui ferment leur caméra pendant les cours à distance.
Je crois que les étudiants nous le disent : cela a été période très difficile pour les enseignants. Ce n'est pas le coeur du métier que de transmettre à un écran noir, ce n'est pas pour cela qu'on a été formé. La souffrance des étudiants provient en partie de leur isolement et ils le disent dans l'enquête : le contact avec les autres étudiants, le fait de constituer un « groupe-classe » et de pouvoir échanger leur a particulièrement manqué. Ils ont déployé des stratégies pour retrouver un peu de collectif, mais cela reste très imparfait, et c'est une souffrance des deux côtés.
Qu'est-ce qui va devoir être pris en compte à l'avenir ?
Nous avons connu trois temps.
D'abord l'urgence du démarrage de la crise : il a fallu que les établissements et les étudiants s'adaptent et que des aides financières nouvelles soient développées.
Nous traversons aujourd'hui une deuxième phase, qui est celle de la crise qui dure et provoque l'usure. On a le sentiment que les étudiants sont très inquiets, et de façon de plus en plus atone. Les questions ne sont plus celles du début, quand on pensait que tout allait redevenir comme avant et qu'il fallait réagir dans l'urgence. Ils attendent de façon assez indéterminée et essayent de survivre - je parle des plus touchés par cette crise.
Vos travaux vont nourrir le troisième temps : l'anticipation et la réflexion sur la sortie de crise. Elle devra consister à redéfinir des axes, comme la formation des enseignants-chercheurs ou l'organisation générale des établissements. Le campus physique ne peut plus être pensé comme avant, des questions complexes d'immobilier et d'implantation sur les territoires se posent en arrière-plan. L'évolution du rapport de l'étudiant à son établissement devra aussi être prise en compte. La différence entre universités et grandes écoles tient aussi à ce que les étudiants de ces dernières ont manifesté une reconnaissance pour leur établissement. Cette reconnaissance s'est très vite délitée pour les étudiants des universités, et en particulier dans les disciplines de sciences humaines et sociales (SHS), droit et Inspé. Pour ces derniers, la situation est très inquiétante, car il s'agit des futurs enseignants : un effort significatif devra être ici fourni.
Ces questions structurelles dépassent la réponse aux difficultés conjoncturelles liées à la crise. Il faudra examiner l'équilibre entre pilotages national et local - c'est-à-dire pour ce dernier, le lien entre l'établissement d'enseignement supérieur, les Crous et les collectivités. L'échelon du territoire a été sollicité dans l'urgence dans la gestion de la crise. On le voit ces dernières semaines : des plateformes se mettent en place en collaboration avec les collectivités, plusieurs régions ont constitué une coordination, au départ informelle, mais qui désormais se traduit par des actions plus pérennes. La région agit aussi avec les services de l'État : les nouveaux « vice-chanceliers » à l'enseignement supérieur vont jouer un rôle important dans la diffusion de certaines mesures.
Il faudra capitaliser cet acquis et poursuivre cette coordination et cette mobilisation intéressante dans la durée.
Par ailleurs, assurer la rentrée universitaire prochaine sera difficile. L'enjeu principal est la socialisation des anciens et des nouveaux étudiants qui reviennent. Il faudra recréer le lien social et la possibilité de revenir sur un site universitaire en reprenant des habitudes d'étudiants, des liens avec les enseignants et les pairs. Aujourd'hui, ce n'est pas évident. On a des témoignages poignants de déconnexion avec ces réalités. Certes, les jeunes ont une réelle faculté d'adaptation, mais elle ne peut pas tout : il faudra faciliter les choses par des dispositifs de médiation et de remédiation. Que se passera-t-il au niveau de Parcoursup pour ceux qui ne savaient pas quelle filière choisir et vont arriver à l'université un peu par hasard ? Il faudra traiter ce sujet au niveau de l'accueil des nouveaux inscrits dans l'enseignement supérieur à la rentrée 2021.
Pour terminer, des éléments encourageants montrent que le système a bien réagi et a évité une catastrophe. Mais il faut aller au-delà. Des étudiants dont la mesure en volume est complexe, ont décroché, même si ce décrochage potentiel ne s'est pas vérifié au moment des examens. De ce point de vue, les chiffres sont bons et pratiquement identiques aux années précédentes dans de nombreux établissements : ce signe montre qu'on a les moyens d'aller chercher ces étudiants. Le décrochage psychologique est, lui, plus difficile à cerner et à mesurer.
L'enjeu de la rentrée est fondamental : on ne peut pas se permettre de la rater. Je ne suis pas d'accord, à titre personnel, avec le terme de « génération sacrifiée ». Elle est éprouvée, peut-être traumatisée, mais certainement pas « sacrifiée ». Il y a eu des cours, il y aura des diplômes et des examens. Mais ces éléments ne permettront pas de tout résoudre. Il faudra retravailler avec les populations concernées pour qu'elles ne deviennent pas une génération mise entre parenthèse.

Vous avez abordé la question du décrochage à la fin de votre propos. Vous dites qu'on ne voit pas de chiffres de déconnexion cette année. Mais, indépendamment de la période de crise sanitaire, les chiffres sur le décrochage s'améliorent-ils entre 2016 et 2020 ?
Secondement, vous avez dit que les étudiants étrangers figuraient parmi les étudiants les plus en souffrance actuellement. Avez-vous des données sur les étudiants français à l'étranger, et qui sont dans la même situation que les étudiants étrangers en France ?
Les données de l'enquête OVE ne permettent pas de mesurer objectivement le décrochage. Pour cela, il vaut mieux se tourner vers la sous-direction des Systèmes d'information et des études statistiques (SIES) du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche, qui dispose de données sur les effectifs de réussite et les réorientations. Les nôtres se concentrent sur les perceptions des étudiants et sur la façon dont ils ont ressenti les effets de la crise. À l'issue du premier confinement, on leur avait demandé comment ils voyaient ses effets sur la poursuite de leurs études : 57 % estimaient qu'elle serait affectée négativement. 25 % environ des étudiants ont décidé de modifier leurs projets d'orientation - au-delà du décrochage, le confinement a eu des conséquences de plus long terme sur les trajectoires. 4 % souhaitaient interrompre leurs études et 9 % les prolonger, peut-être parce qu'ils estimaient que leur insertion serait plus difficile.
Sur la question des étudiants français à l'étranger, on dispose de peu de données. On sait cependant qu'à l'issue du premier confinement, 72 % des étudiants qui avaient prévu une mobilité internationale ont dû l'annuler. De même pour les stages : 78 % des étudiants qui avaient un stage prévu n'ont pu le réaliser dans les conditions initiales. 23 % ont dû adapter les modalités de leur stage, 17 % l'ont vu reporté, voire complètement annulé (après juillet), et, pour 38 %, il était déjà annulé en juillet.
Sur les étudiants français à l'étranger, l'OVE n'a pas beaucoup d'éléments mais nous essaierons d'en avoir un peu plus quand on analysera l'année complète. Ce qu'on disait tout à l'heure sur les étudiants étrangers et les conséquences en termes de mobilité s'est passé au moment où la crise a produit ses premiers effets. Cette année, chacun s'est réorganisé. Par exemple, le processus Erasmus a été revu. Les dispositions sur l'année en cours changent un peu la donne. Nous essaierons d'avancer là-dessus, mais les deux enquêtes, en dehors des chiffres cités par Élise Tenret, ne fournissent pas d'autre précision.

S'agissant de ces témoignages que nous allons mettre en ligne car ils sont passionnants, je retiens l'intérêt des étudiants pour la démarche initiée par le Sénat qui valide notre initiative.
La plupart des témoignages vont dans le sens que vous décriviez. Quelques expressions fortes sont à retenir : « je suis épuisé », « la situation est juste horrible », « je suis déprimé », « je n'y arrive plus », « je lâche prise », « on nous envoie au casse-pipe » - cela revient à plusieurs reprises -, « ce qu'on fait n'a plus de sens », « n'a plus de valeur », « à quoi ça sert ? »... De grosses angoisses ressortent quant à la valeur qui sera accordée par les futurs employeurs, et dans la vie professionnelle, à la qualité des diplômes délivrés pendant cette période si particulière. On sent qu'ils sont déjà dans l'après-crise, et se demandent ce que vaudront les années d'université 2020-2021 sur le marché de l'emploi. C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre.
En ce qui concerne les examens, beaucoup d'étudiants nous disent qu'ils se sont bien passés, car les modalités en ont été un peu arrangées. Un témoignage, que je ne lirai pas dans son intégralité dit en substance : « on nous a demandé de travailler comme si on était dans une salle alors que ce n'était pas le cas ». Ce que vous nous dites sur le niveau des examens est sans doute vrai, mais il faudra regarder dans le détail : il y a quand même eu quelques aménagements, des aides à la maison. Ce bilan positif peut être relativisé.
Ces témoignages montrent que les étudiants ont l'impression d'avoir été désemparés et oubliés pendant très longtemps.

J'ai une question concernant l'analyse des résultats : avez-vous pu faire des analyses par strate territoriale différenciée, notamment entre métropoles, zone rurales, outre-mer ? Vous avez évoqué des différences entre grandes universités fusionnées et universités de proximité. Je crois que vous avez évoqué certains clivages, mais n'y en a-t-il pas d'autres, par exemple d'origine territoriale ou structurelle ?

Avez-vous constaté une différence entre les filles et les garçons ? Vous avez parlé d'étudiants non satisfaits et d'étudiants en difficulté : sont-ce les mêmes ? S'agissant de la satisfaction des étudiants que vous avez évoquée, certains secteurs (médecine, droit, etc.) sont-ils plus touchés et plus en difficulté que d'autres ? Le critère de la catégorie sociale est-il pertinent pour analyser ces insatisfactions ?
Je voulais revenir sur le décrochage : certains jeunes ont complètement raté leur année, sont découragés et vont décrocher. Je pense qu'il est très compliqué, lorsqu'on a des soucis financiers, de logement et de santé, de faire des études difficiles. Comment ceux qui le souhaitent vont-ils être aidés dans leur démarche de réorientation ? Y aura-t-il des conseillers spécialisés ou des enseignants pour les accompagner ?

Merci pour votre exposé. Ce n'est peut-être pas une génération sacrifiée, mais c'est tout de même une drôle de vie étudiante. On a la sensation que nos étudiants sont résignés. Or pendant ce moment bien particulier des études, on est tout sauf résigné : c'est le moment où on a un appétit d'apprendre énorme ! Pour leur condition psychologique, c'est inquiétant.
Par ailleurs, vous avez dit, dans votre exposé, qu'on ne pouvait plus parler de « population étudiante ». Pouvez-vous revenir sur ce point ?

Merci pour les informations que vous nous avez apportées. Je suis d'autant plus intéressée que le premier intervenant a posé une question sur les étudiants ultramarins. Nombre d'entre eux font leurs études dans l'Hexagone, mais aussi à l'étranger.
Concernant la prévention des suicides, avez-vous eu accès à des informations précises ? Mettez-vous en place des espaces de parole ou de prise en charge psychologique des étudiants ? Avez-vous des données sur ce sujet ? Je crois que le Gouvernement a proposé de permettre à des étudiants d'avoir trois consultations chez le psychologue. Qu'en est-il précisément ?

Je souhaitais évoquer les différences entre les secteurs. Un secteur se fait entendre et, en son sein, une promotion particulière : celle qui vient de se heurter à la réforme de la première année des études de santé, qui consiste désormais en des parcours accès santé spécifiques (PASS) et des licences accès santé (LAS) au plan national. Disposez-vous d'éléments plus précis sur cette promotion qui vit au centuple les difficultés, notamment en termes de détresse psychologique ? Le contenu des programmes a en effet été testé cette année dans des conditions tout à fait imprévues. Envisagez-vous également des études complémentaires sur cette catégorie particulière ?
Par ailleurs, on aborde beaucoup les questions psychiques, qui sont réelles. Mais peut-on mesurer l'impact de la crise sur l'état de santé physique des étudiants, qui prend la forme d'une moindre activité physique et de problématiques d'accès à alimentation de qualité correcte ? Ce sont des sujets assez classiques de suivi et surveillance médicale des étudiants, car quand on est jeune, on ne se met pas toujours dans une situation impeccable vis-à-vis de sa santé, ce qui a été aggravé par la période. Des chiffres pourraient donner lieu à des préconisations, des prises en charge et un accompagnement supplémentaires, notamment en termes de prévention.

Je parle au nom de Stéphane Piednoir, rapporteur pour avis des crédits de l'enseignement supérieur pour la commission de la culture et de l'éducation.
La question de mon collègue se situe dans le prolongement de celle de Victoire Jasmin : avez-vous pu mesurer ou sentir le besoin de consultation de psychologues, en priorité sur les campus ? Vous faites bien une différence sur la mise en difficulté des étudiants, principalement en fonction de leur lieu d'étude et de leurs établissements encadrants, d'où cette question sur les campus.

Merci, mesdames, pour vos témoignages et pour les informations que vous avez partagées avec nous. Qu'avez-vous pu observer pendant les deux confinements sur l'implication des représentants des étudiants ? Je vous pose cette question car je suis sénateur de l'Hérault, dans l'académie de Montpellier. Jusqu'à mon élection au Sénat, je siégeais aux conseils d'administration de deux universités et à celui du Crous. Je me suis rendu compte, lors du premier confinement, que les représentants des étudiants étaient complètement absents. Nous avons eu beaucoup de difficultés pour rentrer en contact avec les étudiants pour connaître et identifier leurs besoins, contact qui se résumait aux assistantes sociales des Crous. Les représentants des étudiants ont été absents dans les grandes villes comme Montpellier, et, dans les petites et moyennes villes, où la vie estudiantine et associative est moins structurée, cela a été le vide sidéral. Ce sont en général dans ces villes qu'on trouve les premiers cycles, et ce sont eux qui étaient les plus précarisés et avaient le plus besoin d'aide. Nous avons été démunis : il a fallu quelques semaines de tâtonnement pour identifier des associations, pas nécessairement étudiantes ou universitaires, afin d'aller au contact de ces populations très éloignées de nous. Avez-vous une vision générale du rôle qu'ont pu jouer les associations estudiantines ? J'ai la sensation qu'elles ont été un peu plus présentes et actives lors du second confinement que pendant le premier.

J'ai d'abord une question sur les plateformes de tchats. Des politiques et des associations en ouvrent afin que les étudiants puissent répercuter leurs difficultés. En avez-vous mesuré l'importance ? Sont-elles visitées ? Les étudiants se sont-ils approprié ces outils ? Sont-ils de nature à résoudre certains problèmes en libérant la parole et en l'encourageant ?
Vous avez fait état des différences entre les grandes métropoles urbaines et les autres territoires. Avez-vous des unités de mesure pour mesurer ces différences ?
On a enfin beaucoup parlé des associations qui apportent une aide alimentaire aux étudiants : pouvez-vous y revenir plus précisément ?

J'avais deux questions : pourquoi les universités n'ont-elles pas rouvert, alors que les départements ont maintenu les collèges ouverts, de même pour les régions avec les lycées. Seul l'État a maintenu les universités fermées.
S'agissant de l'accompagnement des étudiants dont on a parlé en vue de la sortie de crise, la jeunesse est souple, innovante et intelligente : je fais confiance aux étudiants pour repartir du bon pied dès qu'on les laissera reprendre leur avenir en main. Je m'inquiète plus, lorsque je lis les témoignages, sur la souplesse des enseignants. N'ont-ils pas besoin d'accompagnement pour un enseignement qui peut aussi être en distanciel ? On a l'impression, dans tous les témoignages et sur nos territoires, que les élèves se sont sentis lâchés par leurs enseignants. Ils ont été accompagnés par leur famille, certains par leurs animaux de compagnie, mais on a du mal à comprendre ce qui s'est passé avec ces enseignants. Dans beaucoup de branches professionnelles, y compris dans cette institution, tout le monde a dû s'y mettre : il a fallu s'organiser pour des réunions, des échanges en visioconférence, etc. On est étonné de voir que des choses restent impossibles dans le milieu des enseignants.

Madame la présidente, avant de vous donner la parole, je rappellerai à mes collègues que vous n'êtes pas décisionnaire mais que vous présidez un observatoire. Par conséquent, vous ne décidez pas des politiques publiques.
Je voudrais faire une remarque sur la temporalité de nos enquêtes. Vous posez des questions légitimes que nous nous posons aussi, mais qui par définition n'ont pas pu trouver de réponse puisque nous n'avons pas fait d'enquêtes depuis juin dernier. Ce que je vais vous dire relève plus du travail interne à l'OVE, de notre expérience et des contacts que nous avons avec différents établissements, mais pas de données statistiques d'enquête qui répondraient de façon plus précise à vos interrogations.
Nous débattons très souvent sur le premier point : comment arriver à prendre en compte la dimension territoriale de la vie étudiante ? C'est très compliqué, pour la simple raison que nous sommes un observatoire national, qui procède à des enquêtes nationales. Cela signifie que la construction statistique de notre enquête n'a pas de sens si, par exemple, les étudiants d'Île-de-France sont 10 % à avoir répondu alors qu'ils sont 50 % en PACA. Lorsqu'on commence à mélanger la notion de territoires, on aboutit à des résultats dépourvus de signification.
Je rappelle que des observatoires locaux de l'enseignement supérieur et des structures intermédiaires locales, comme les comités de pilotage de la vie étudiante, existent et commencent à bien fonctionner. On peut s'appuyer sur eux pour recueillir des données. Il se trouve que l'OVE a parfois des partenariats pour aller plus loin avec des régions à dimension significative. Cela a été le cas avec l'Île-de-France dont les étudiants représentent 25 % des inscrits de l'enseignement supérieur : ce focus a du sens, statistiquement parlant.
Pour répondre à la première question posée sur l'analyse par territoire : on la regarde évidemment, mais cela dépend de l'exploitation des réponses, selon qu'elles émaneront de tel ou tel type d'établissement, de tel ou tel territoire. C'est le premier élément de réponse. Le second, c'est que nous venons d'exploiter un premier niveau, avec les réponses de l'enquête 2020, et nous sommes en train de démarrer la véritable exploitation des données qui aboutira à une publication plus complète et approfondie, en particulier sur ce que vous évoquez et qui est géographiquement plus facile à repérer : la taille des universités, les regroupements face aux universités éclatées sur un territoire rural, par exemple. C'est en cours. Nous n'avons pas de réponse, mais c'est un élément très intéressant car la notion de territoire explique beaucoup de choses. Elle sera essentielle dans la redéfinition des problématiques de l'enseignement supérieur à la sortie de cette crise.
Une autre question portait sur le fait de croiser les réponses concernant la satisfaction et l'insatisfaction avec les critères du sexe et de la catégorie sociale. Élise Tenret va vous présenter les premiers éléments de cette analyse, que l'on approfondira.
La question portait notamment sur la satisfaction à l'égard des études. Nous disposons de beaucoup de chiffres, y compris sur la projection en termes d'insertion. Ces variables socio-démographiques jouent sur la satisfaction des études, mais aussi l'insertion telle qu'elle est envisagée. Ainsi, 63 % des enfants d'ouvriers et d'employés estiment avoir de bonnes chances en France, contre 76 % pour les enfants de cadres supérieurs. Sur la satisfaction des études, on a les réponses par type d'établissement. Plus d'étudiants sont satisfaits dans les grands établissements, les écoles d'ingénieur, et les classes préparatoires (plus de 75 %), que dans les filières universitaires (autour de 60 %).
Je l'ai dit tout à l'heure, mais le seuil dans les Inspé est parmi les plus bas de l'ensemble universitaire.
En effet, c'est 52 % depuis la dernière enquête.
Entre étudiantes et étudiants c'est un peu compliqué : il faut recroiser avec d'autres variables. Les étudiantes sont plus diplômées et suivent très bien en licence et en master, puis cela se complique en doctorat, pour d'autres raisons. Il faut affiner l'analyse. Ce n'est pas aussi schématique, mais il y a des différences, y compris selon les classes sociales. Des nuances doivent être aussi apportées : des dispositifs dans les filières professionnalisantes encouragent au contraire une ouverture sociale.
Sur le fait que l'on ne puisse plus parler de population étudiante : c'est le cas depuis longtemps. Je ne suis pas sûre d'ailleurs que cette population ait jamais existé, sauf à l'époque de la création des nouvelles universités, dans les années 1970. On avait alors des regroupements avec des petits effectifs, et encore, très marqués par la filière et les anciennes facultés. Tout ceci n'existe plus car il n'y a pas grand-chose de commun entre les étudiants, y compris du point de vue de la vie étudiante. Les emplois du temps, les filières éclatées (médecine, Inspé, IUT - déjà très intégrés dans un milieu professionnel) les empêchent de se croiser. L'âge, le fait d'être cohabitant ou pas, le parcours scolaire antérieur jouent également beaucoup. Au total, au moins cinq variables marquantes expliquent qu'il n'y a pas « une population étudiante ».
Au titre de l'inspection générale à laquelle j'appartiens, nous avons mené une étude sur la mise à plat des aides financières et fiscales accordées aux étudiants. On a tout de suite vu qu'une mesure générale prévoyant le même impact pour toutes les catégories étudiantes atténuait voire anéantissait l'effet réel pour ceux qui en avaient le plus besoin. C'est pour cela qu'on a autant de mal. Se pose un problème de communication : comment garder le lien avec des populations qui ne se manifestent pas forcément ? Vous avez ouvert une espèce de boîte de Pandore avec des témoignages spontanés qui font apparaître une réalité commune, mais en règle générale, les étudiants sont entre eux, ou entre pairs de plusieurs filières proches, et les croisements sont très rares entre les différentes formations.
Cela me permet de répondre à la question sur les syndicats étudiants. Nous partageons votre constat. Rappelons qu'ils sont représentés dans des instances dédiées, avec un très faible taux de participation, que ce soit au niveau national ou local. Il y a donc déjà un problème de fond, et toutes les discussions autour du vote électronique des étudiants s'inscrivent dans la démarche qui consiste à redonner du sens à la représentation étudiante institutionnelle. En ce qui concerne la réponse apportée aux étudiants, je ne suis pas sûre qu'elle se soit améliorée depuis le premier confinement. Des déclarations nationales existent, mais dans la réalité, les initiatives sont plutôt venues de micro-regroupements avec des étudiants motivés qui se sont appuyés sur d'autres types de relais, et cela a marché. Il y a donc un vrai problème qu'il faudra régler - même si ce n'est pas l'urgence immédiate : le rôle de relais des syndicats étudiants n'a pas correspondu à ce qui a été attendu. Beaucoup de remontées vont dans ce sens.
Sur le décrochage, là encore, on ne peut mesurer quoi que ce soit de précis. Je reprends ce que vous avez mentionné sur les examens. Je ne parlais que de l'aspect « connexion », et pas du contenu. Je ne me risquerai pas à former des jugements sur la qualité des copies rendues aux examens, avec une aide ou pas. En revanche, la crainte était qu'on observe beaucoup de déconnexion et de décrochage : c'est cet aspect-là que j'évoquais.
Quels sont les dispositifs de soutien aux étudiants dans le supérieur ? Ils sont nombreux. Des services d'orientation existent, des dispositifs ont été mis en place par les conseils de formation universitaire et fonctionnent bien. Divers dispositifs vont être activés, notamment dans le cadre de la procédure Parcoursup, au fur et à mesure des étapes. Le terrain est assez balisé : autant, pour les psychologues, c'est compliqué, autant, pour le système d'orientation, des dispositifs montent en puissance, en collaboration avec les responsables de filière et de formation au niveau des instances universitaires. C'est probablement plus cadré dans les grandes écoles.
En ce qui concerne les tendances suicidaires, je laisse la parole à Élise Tenret.
On a mesuré dans l'enquête 2016 que 8 % des étudiants avaient pensé à se suicider au cours de douze derniers mois. Ce chiffre est beaucoup plus élevé que celui relatif à la population des jeunes, puisqu'il est de 3 % des jeunes de 15-30 ans en population générale. C'est ce que dit de façon récurrente Yannick Morvan, psychologue qui travaille à l'OVE : la population étudiante est très vulnérable en termes de pensées suicidaires.
Nous ne disposons pas de statistiques précises sur les suicides. En revanche, dans les remontées des cas que nous connaissons, nous ne notons pas de chiffres marquants sur un nombre de suicides qui serait plus élevé. Toutefois, ce n'est pas statistique : on ne dispose pas véritablement d'une mesure tout à fait fiable. Les affaires de Lyon sont plus compliquées quand on les regarde de près : il y a peut-être aussi des situations individuelles derrière. C'est un sujet complexe car les chiffres dont nous disposons sont difficiles à interpréter. On ne peut s'avancer que sur une tendance marquée en termes de pensées suicidaires.

Pour reprendre la question de Sonia de La Provôté, cette tendance n'est-elle pas plus lourde dans le domaine des études de médecine ?
Vous pensez à la réforme de cette année ?

Pas seulement. Je pense aussi à la charge de travail qui leur est demandée et à la responsabilité qu'on leur impose.
Non, je ne crois pas. J'ai lu l'enquête détaillée, et de mémoire, je ne crois pas que ce soit lié aux études de santé.
Le chiffre que j'ai donné date de 2016 et ne prend pas en compte la réforme. Je ne saurais pas vous répondre plus précisément.
Il est vrai que la réforme des études de santé a entraîné d'énormes difficultés. Nous ne les avons pas encore mesurées : la réforme s'est faite en cours d'année et ne faisait pas partie de l'enquête. Cela dit, j'ai connaissance de retours montrant que les étudiants sont totalement perdus et ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ont en revanche très bien compris les places réservées aux différentes catégories d'étudiants. Cette affaire n'est pas complètement réglée et va susciter des discussions au plus haut niveau.
Nous allons, à l'OVE, travailler en priorité sur deux sujets : la santé mentale des étudiants, en collaboration avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), et la précarité. Un groupe de travail se met en place avec des économistes et d'autres spécialistes. Nous disposerons alors de statistiques sur l'année complète. En tout cas, l'année écoulée a été probablement encore plus compliquée pour les étudiants en santé que pour les autres.
Sur les mesures qui existent, j'ai parlé des dispositifs d'orientation, mais on doit aussi noter le succès des plateformes d'écoute. Si elles ont été longues à se mettre en place, elles ont bien fonctionné. Elles se sont appuyées sur les nombreuses initiatives locales qui se manifestent actuellement. Le ministère a annoncé un « chèque psychologue » ainsi que des plateformes de contact avec des psychologues, réparties sur le territoire. Cette semaine, une plateforme nationale démarre. Cela donnera de la visibilité sur ce qui se passe réellement, notamment en termes de demande, car les besoin semblent forts, à tous les niveaux. La question a été posée de savoir si on préférait le contact d'un psychologue sur place ou dans le campus. Étant donné que les psychologues n'y sont plus, ce contact n'est pas évident. Mais il l'est encore moins dans la famille. Les plateformes ont fonctionné grâce à cela : elles constituaient un relais qui permettait d'être écouté sans avoir à aller plus loin dans des confidences qui n'étaient pas adaptées au cercle familial. Il faudra donc pérenniser ces dispositifs.
Les services de santé universitaires ont été saturés dès le premier confinement. Mais des questions de fond se posent sur ce sujet. L'université a-t-elle vocation a avoir un service de santé avec tous les spécialistes sur un campus dont on sait qu'il est éclaté sur le territoire ? Ne faut-il pas plutôt privilégier des relais et des professionnels de santé travaillant ensemble en réseau et prenant en charge, avec un suivi, un même étudiant ? Une vraie réflexion d'ensemble doit être menée au niveau national avec les acteurs de la vie étudiante.
Sur les plateformes de tchat, je n'ai pas d'éléments sauf ce que chacun peut savoir en lisant les témoignages sur internet. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Si c'est utile pour les étudiants, pourquoi pas ! Mais tout ne doit pas être mis sur le même plan. Pour les situations les plus graves, il faut de vrais processus de prise en charge et de suivi. Un accompagnement personnalisé est donc nécessaire, et c'est une question de moyens.
Cette question se posera à la rentrée, de même que tout ce qui touchera aux questions d'alimentation. Les Crous ont fait beaucoup d'efforts dans ce domaine. Il y a eu une révolution en termes de respect des normes, notamment environnementales. On a constaté une ambition de proposer des repas à la fois variés et équilibrés. Les progrès ont été significatifs, mais la période était tellement particulière qu'un bilan s'impose. Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (Cnous) y procèdera. Dominique Marchand, que vous entendrez sans doute, envisage de regarder les évolutions récentes en s'interrogeant sur les conséquences à tirer du panier à 1 euro, tout en ayant à l'esprit qu'il faut aller plus loin dans la réflexion sur la restauration. Les étudiants avaient en effet déserté les restaurants traditionnels Crous. Il faut trouver la bonne réponse à leurs besoins.
Concernant la fermeture des établissements et les enseignants qui n'auraient pas été au rendez-vous : je trouve que c'est un peu sévère. Là aussi, les situations diffèrent. Cela s'est très bien passé dans certains secteurs et moins bien dans d'autres, comme on peut le voir à travers certains témoignages d'étudiants. Je pense que le sujet central est la formation des enseignants, qui n'avaient pas suffisamment anticipé ce genre de situation. « Tout le monde devait s'y mettre », certes, mais ce n'est pas la même chose de donner des cours prévus en présentiel et les transformer en trois semaines en cours à distance. Des techniques permettent de capter l'intérêt de l'étudiant, mais en trois semaines, c'était très difficile. Je crois qu'on paye aujourd'hui le retard de certains établissements de l'enseignement supérieur à affronter la numérisation qui est inéluctable à plus ou moins long terme.
Dans la durée, nous avons besoin de bilans plus fins. Il nous faut aller au-delà des témoignages individuels - certes nécessaires pour appréhender la réalité vécue par les étudiants - et examiner précisément les points faibles à relever. La Conférence des présidents d'université (CPU) envisage d'ailleurs des bilans plus précis à partir de témoignages recueillis. Ceux-ci n'ont toutefois pas fait remonter les choses qui ont fonctionné, et il y a en a ! La difficulté est qu'il faut aujourd'hui traiter les urgences. Vous connaissez la formule : un train qui arrive à l'heure, on n'en parle pas...
On éprouve encore cette difficulté de mesure, qui va se résoudre : sur l'année complète 2020-2021, l'OVE, la CPU, les Crous et les collectivités territoriales, qui s'investissent dans des plans de vie étudiante, auront à coeur d'aller au-delà du premier niveau de remontée pour analyser les effets structurels de la crise. Le sujet de la formation des enseignants est fondamental.
Une question portait sur le rapport au corps et à l'activité physique : on n'a pas spécifiquement interrogé les étudiants sur leur activité physique, mais sur leur alimentation et leur consommation d'alcool. Ainsi que nous l'avons noté dans l'enquête « confinement », un quart des étudiants ont jugé que leur alimentation avait été moins satisfaisante pendant ledit confinement, et en particulier ceux qui ne sont pas rentrés chez leurs parents - ceux qui sont retournés au domicile familial déclarent avoir plutôt été satisfaits de leur alimentation. De plus, 14 % ont déclaré avoir consommé plus d'alcool qu'habituellement. Parmi ceux qui étaient seuls, 10 % ont déclaré consommer de l'alcool tous les jours, contre 5 % dans l'ensemble, et 1 % en temps normal. On a donc observé une hausse de cette consommation pendant le confinement.
Sur les questions en lien avec la précarité : un quart des étudiants dont les difficultés financières se sont aggravées pendant le confinement ont déclaré ne pas avoir toujours mangé à leur faim pour des raisons financières. Cela nous permet de voir les effets de cette période sur la santé physique et l'alimentation des étudiants.
Je voulais aussi revenir sur la question des enseignants, puisque je me sens un peu concernée ! À partir des chiffres de l'enquête, je voudrais rappeler que lors du premier confinement, malgré toutes les difficultés entraînées par les cours en ligne, 77 % des étudiants ont déclaré avoir eu des échanges avec leurs enseignants, que 73 % avaient disposé de supports de cours mis à leur disposition, et que 69 % déclarent avoir eu des cours ou des réunions de travail en visioconférence. Je ne viens peut-être pas d'une université représentative et je ne peux m'exprimer pour l'ensemble de mes collègues, mais du côté des enseignants, le confinement a occasionné un surplus de travail massif (scanner les copies de tous les étudiants page par page pour leur faire un retour, les recevoir en visio, faire des cours sur le logiciel à distance avec des partages d'écran très compliqués...). Je ne crois pas qu'on puisse dire que les enseignants ne se sont pas investis. Il faudrait sans doute une formation, et les situations étaient différentes selon les universités et les moyens dont elles disposaient. Les étudiants n'étaient pas complètement satisfaits : seulement 39 % l'étaient - ce qui représente beaucoup moins que le pourcentage normal. Mais les insatisfaits sont plus nombreux parmi ceux qui avaient une mauvaise connexion internet, qui n'avaient pas d'ordinateur personnel à disposition et qui, en somme, ne jouissaient pas de bonnes conditions de travail. Des choses n'ont peut-être pas été mises en place assez rapidement à l'université, mais vu l'investissement collectif que cela a demandé et l'épuisement dans lequel sont mes collègues, il paraît difficile de dire que les enseignants ne sont pas complètement impliqués.
Nous n'avons pas répondu à la question sur les violences sexistes et sexuelles. Ce sont en effet de nouvelles questions introduites dans l'enquête cette année, sur la suggestion d'une équipe de l'Institut national des études démographiques (Ined) qui avait travaillé sur l'enquête Virage (violences et rapports de genre). L'intérêt de prendre en compte ce sujet dans une enquête généraliste comme celle de l'OVE est que cela évite des biais liés aux enquêtes spécialisées, qui pourraient influencer le taux de réponse. On a distingué les propos, les attitudes ou les propositions à caractère sexuel, d'un côté et, de l'autre, les étudiants victimes d'attouchements et de rapports sexuels forcés. 4 % des étudiants ont été victimes de violences : 3 % ont subi des propos, attitudes et propositions à caractère sexuel et 1 % des attouchements ou des rapports sexuels forcés. Ces prévalences peuvent paraître faibles en pourcentage, mais quand on les rapporte à 3 millions d'étudiants, on aboutit à de nombreux cas en réalité. On voit des effets sur la suite des études : les étudiants touchés auront plus de mal à se concentrer, et pour certains vont abandonner leurs études. Beaucoup d'étudiants gardent ces violences pour eux, n'en parlent pas, ou seulement à leur entourage et non aux services ou acteurs universitaires.
Par ailleurs, la question sur les discriminations est posée depuis l'enquête 2016, dans laquelle on a introduit d'une part l'origine migratoire des étudiants, et d'autre part le sentiment d'avoir été traité différemment : c'est ainsi qu'est posée la question. On demande ensuite aux étudiants la variable qui a joué, selon eux, dans ce traitement différent. On n'utilise pas le terme de discrimination : on se cale sur les enquêtes de l'Ined, cela évite de créer des biais dans les réponses. On mesure que 19 % des étudiants considèrent avoir été moins bien traités que leurs camarades pour la notation, l'orientation et le rapport avec les enseignants ou avec les camarades. Pour 23 % de ces étudiants, cette différence est liée à leur origine ou à leur nationalité, pour 12 % à leur couleur de peau, pour 11 % à leur sexe ou identité de genre, pour 10 % à leur apparence, et pour 7 % à leur religion. Ces chiffres sont stables entre 2016 et 2020.
Dans l'enquête, nous avons introduit des questions sur les agressions verbales, les insultes ou les injures pour ceux qui avaient déclaré des discriminations en raison de leur nationalité, origine, couleur de peau ou religion. Parmi ces étudiants, six sur dix ont déclaré avoir fait l'objet de moqueries, plaisanteries répétées, mise à l'écart ou rejet, et un sur trois a déclaré avoir subi des agressions verbales, insultes ou injures.

J'avais une dernière question sur le programme d'études complémentaires que vous allez engager à la suite de cette enquête générale. J'ai noté la mise en place d'indicateurs de précarité, ainsi qu'un travail sur la santé mentale ?
Il y aura aussi un travail d'exploitation de toute l'enquête, beaucoup plus important, avec un groupe de travail qui examinera l'ensemble des sujets.

Nous sommes au Sénat et la relation aux territoires nous intéresse tout particulièrement. Vous avez dit à plusieurs reprises que cette crise a interrogé la relation des universités et, généralement, des établissements avec les territoires. Vous nous avez aussi dit que la notion de grand campus universitaire - différent des campus de grande école qui ont réagi à leur manière - était questionnée, car on se demande si ce format peut encore répondre à certaines interrogations. Peut-on faire une opposition entre le grand campus universitaire et le modèle du campus éclaté ? Élu des Hauts-de-Seine, je pense spontanément à Nanterre, mais dans le département un autre système existe : l'université Jean Monnet est plutôt composée d'annexes, dont une à Sceaux. Peut-on opposer ces deux modèles ?
Par ailleurs, dans ma commune, je voulais rentrer en contact avec la population étudiante, mais ce n'est pas possible : la mairie n'a pas les moyens de toucher les étudiants qui habitent chez eux. On connaît les campus et les résidences, mais il n'est pas facile de joindre les étudiants qui vivent dans la commune et auxquels la mairie aimerait apporter une aide. Il faudrait passer par les universités, ce qui n'est pas possible. Quand on a l'ambition ou l'envie de les aider, matériellement on ne peut pas, puisque la population étudiante, pour un maire, est complètement insaisissable.
Quand j'ai évoqué les grands campus, je pensais plus à la réorganisation en cours et à la fusion d'universités, ce qui n'est pas tout à fait la même chose en termes de conséquences sur la répartition territoriale. Si je prends par exemple Bordeaux, il reste un campus central, mais des antennes ou des sites délocalisés demeurent. On doit distinguer deux aspects. J'évoquais les établissements fusionnés qui sont à la pointe des établissements de recherche dans les classements internationaux. Ils sont peu nombreux, mais ont acquis ont dimension internationale qui leur permet d'impulser et de porter des politiques, notamment sur le numérique. J'écoutais en arrivant François Germinet, le président de l'université de Cergy-Pontoise, qui évoquait ces dimensions de différenciation entre les établissements. Il faudra prendre en compte les deux types d'évolution.
Pour revenir à ce que vous évoquez : on souffre depuis très longtemps d'une absence de vraie définition de ce qu'est un campus universitaire français. Nous n'avons pas l'histoire ni la culture anglo-saxonne, nord-européenne, voire suisse. On doit peut-être se poser des questions liées à l'urbanisation, à la nécessité d'équité de traitement sur le territoire, à la façon dont on veut créer une véritable vie étudiante à Paris et dans l'Île-de-France. Sur la question numérique, de nombreux exemples à l'étranger montrent qu'on peut parfaitement organiser une vie étudiante avec des outils numériques - qui ne doivent être exclusifs mais peuvent aider.
Vous évoquez aussi le fait qu'une mairie ne connaît pas la population étudiante de son territoire. Cela est vrai depuis très longtemps et évolue très peu. Soit l'étudiant est sur un « campus » (antenne ou site), soit il est dans une structure locale et habite ou travaille sur un autre territoire. Il n'y a pas de lieu fixe et unique auquel serait relié l'étudiant. Seul le niveau de la région peut disposer de ce type d'élément. La crise a mis en relief la nécessité de joindre concrètement les étudiants. Comment fait-on ? Aucun étudiant ne consulte sa boîte mail institutionnelle, tout passe par les réseaux sociaux ! Des exemples à l'étranger, où l'on utilise les mêmes outils que les étudiants pour les joindre, les faire travailler ensemble et les faire se rencontrer virtuellement, fonctionnent très bien. Nous n'en sommes, en France, qu'au début et n'avons pas encore les outils appropriés. Il faut faire attention à ne pas tomber dans du gadget et des plateformes inutiles qui s'essouffleront d'elles-mêmes. Pour en avoir discuté avec le nouveau bureau de la CPU, les universités sont très conscientes de ces enjeux. Il faut utiliser ce qu'on va apprendre de cette crise, mais aussi les innovations potentielles qu'elle dégagera pour progresser sur cette dimension de vie étudiante. C'est la première fois depuis longtemps que la vie étudiante est au coeur des préoccupations des établissements : j'en suis très satisfaite. Jusqu'ici ce n'était pas leur priorité - je ne dis pas qu'il ne se passait rien, mais ce n'était pas un élément de stratégie. C'est en train de changer en raison de la crise mais aussi parce la qualité de la vie étudiante devient un facteur d'attractivité internationale. Plusieurs articles de sociologues sont publiés pour aller vers une évaluation du bien-être et de la qualité de vie étudiante. Combien de fois a-t-on perçu les difficultés dans les universités sur le manque de possibilités d'accueil ? Le seul vrai campus qui existe à Paris est la Cité Universitaire, et il n'est pas sur le même créneau. Cela sera réinterrogé de façon assez profonde, notamment par les établissements d'enseignement supérieur.

Je voudrais simplement rajouter quelque chose qui concerne notamment les étudiants ultramarins dans l'hexagone. La Poste est le seul moyen, pour les personnes qui n'ont pas accès à internet, d'envoyer des choses à leurs enfants, courrier ou colis.

En effet, je veux prolonger l'intervention de Victoire Jasmin, pour dire que c'est un problème que j'ai identifié pour les étudiants étrangers et ultramarins lors du premier confinement : quand les bureaux de poste sont fermés, les parents ne peuvent envoyer de l'argent, par Western Union, par exemple.

Parfait. C'est arrivé à bon port et sans recommandé !
Merci beaucoup encore, madame la présidente, madame. Nous clôturons cette première séance très roborative.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
La réunion est close à 16 heures.