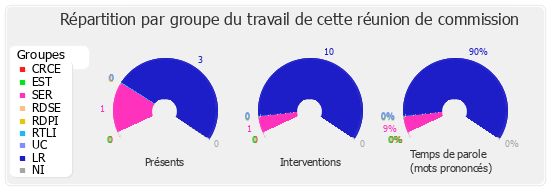Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale
Réunion du 20 novembre 2014 : 2ème réunion
Sommaire
La réunion
Au cours d'une première réunion tenue dans la matinée, la commission procède tout d'abord à l'audition, au cours d'une table ronde, de confédérations syndicales.

Nous remercions ce matin les confédérations syndicales françaises les plus représentatives qui ont accepté notre invitation à échanger sur la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et tirant les conséquences du remodelage de la carte des régions. L'un des deux rapporteurs, M. René Vandierendonck, a auditionné en septembre les fédérations syndicales de la fonction publique territoriale. Avec Jean-Jacques Hyest, l'autre rapporteur, nous avons souhaité adopter une approche plus globale cette fois-ci, en auditionnant les confédérations. Les forces vives représentatives des salariés français ont en effet des choses à dire sur l'organisation territoriale la plus appropriée à une politique porteuse de croissance et d'emploi. Les régions ont en la matière un rôle moteur, certes, mais les métropoles, les agglomérations, les villes, articulées aux départements, ont également leur rôle. Le législateur ne peut ignorer leur point de vue. Vous pouvez naturellement ajouter toutes les considérations sur la fonction publique territoriale qu'il vous plaira.
Merci de nous recevoir. La CFTC a déjà eu l'occasion, notamment lors de la grande conférence sociale de juillet dernier, de donner un avis favorable au principe de la réforme territoriale. Notre pays a besoin de clarifier les compétences de ses territoires pour une meilleure administration, lisible par les citoyens et les 1,8 million d'agents territoriaux chargés de la faire fonctionner. Mais à quel prix ? Nous sommes nombreux à ne pas y voir clair, et la présentation en trois tronçons législatifs successifs ne nous aide pas. Mme Lebranchu était favorable à une seule loi.
Le mille-feuille reste peu lisible, et n'a pas profité du choc de simplification - nous saluons à ce propos les récentes déclarations du président du Sénat M. Gérard Larcher en faveur de la clarification des compétences. Le mauvais exemple de la métropole lyonnaise renforce nos craintes : la loi devait préciser le régime des agents, mais à quelques semaines de la mise en oeuvre du nouveau dispositif, les agents du conseil général du Rhône ne savent toujours pas quel sera leur avenir. Alors que ces changements ont des conséquences directes sur la vie familiale, la mobilité fonctionnelle, l'organisation du temps de travail, le droit syndical, les avantages sociaux - parfois durement négociés - M. Gérard Collomb a indiqué qu'il n'avait « pas les moyens de préserver le régime antérieur des agents » - dont le coût a été évalué à 20 millions d'euros pour la métropole.
Les agents territoriaux sont à 75 % des cadres de catégorie C, dont la rémunération est souvent très proche du Smic, les fonctionnaires n'étant pas tous privilégiés. Certains perdront, selon leurs calculs, presque un mois de traitement. Est-ce la réforme que vous nous proposez ? La mise en oeuvre du premier volet de la réforme territoriale tourne au fiasco. Marseille Métropole demain, le Grand Paris et ses sous-territoires après-demain, préparent de nouvelles usines à gaz. Pour les régions, nous craignons le pire.
Nous ne rentrerons pas dans le débat politique entre élus locaux, car c'est votre prérogative. Nous pensons plutôt aux agents publics qui font tourner les services publics. Combien seront concernés à terme par les différents volets de la réforme ? Sans doute des centaines de milliers, dont un quart ou un tiers de contractuels. Or ils n'y sont pas associés ! Et comment pourraient-ils l'être lorsque les informations d'un jour sont démenties le lendemain, que le puzzle est monté, démonté, remonté autrement, et que la complexité des régimes juridiques s'accroît ? Nous applaudissons à la fusion de collectivités pour un meilleur service rendu à la population, mais quid des doublons de postes, quid des cadres dont les fonctions d'encadrement croîtront, quid des agents mis au placard et des risques psycho-sociaux qui vont avec ? La mutualisation des services implique certes la diminution des effectifs, mais selon quel protocole procéder à cette saignée ? Il aurait été préférable de se poser toutes ces questions plus tôt...
Les mobilités peuvent certes être un accélérateur de carrière pour ceux qui sauront saisir les opportunités, mais les agents de catégorie C - largement majoritaires - privilégient leur lieu de vie et leurs choix familiaux : quel accompagnement, quel plan de formation, quelles compensations à la mobilité a-t-on prévu pour eux ? Certains articles du texte seraient de nature à nous rassurer, mais l'expérience en la matière n'incite pas à la confiance... Car non seulement les agents publics sont depuis plusieurs années la première variable d'ajustement - les études montrent que leur pouvoir d'achat est en berne - mais ils vont se voir imposer des changements à l'impact très lourd sur leur carrière et leur vie.
Pour ces raisons, nous appelons les parlementaires à intégrer dans la loi les mesures d'accompagnement social indispensables à la mutation nécessaire de nos territoires, dont les agents publics territoriaux vont être les premiers à subir le choc alors qu'ils devront en même temps en être les moteurs.
Merci de nous recevoir. Nous représentons les agents publics, mais aussi les salariés, partenaires sociaux et assurés sociaux. Tous ont une attente très forte. Les agents estiment majoritairement que l'action publique n'est plus ce qu'elle a été, n'est pas ce qu'elle pourrait être, ni ce qu'elle devrait être. Tous expriment une forte attente de sens et de qualité de service rendu. Ils rejoignent en cela les usagers, citoyens et salariés des entreprises qui comptent, pour le développement économique de leurs territoires, sur une action publique lisible et démocratique. Voilà l'enjeu premier de cette réforme, la condition de la cohésion sociale et du consentement à l'impôt.
Le redécoupage territorial est à notre sens un faux débat, dont l'aspect politique a quelque peu décrédibilisé ceux qui l'ont animé, en faisant passer les intérêts particuliers avant l'intérêt général.
La réforme ne doit pas se faire contre l'État. Nous sommes plutôt dans une dynamique de construction positive, non pas en opposant les pans de l'action publique les uns aux autres, mais en trouvant une cohérence entre eux. Bref, il faut dépasser les logiques de chapelles. Ce qui peut conduire à remettre en question les rôles respectifs des régions et des services de l'État. Prenons le temps de réfléchir à la nouvelle organisation que nous ciblons, et de détailler le processus permettant d'y arriver.
Du reste, la question de la transition entre l'ancienne organisation territoriale et la nouvelle est peu abordée. Or il y a un risque de superposer des complexités, de brouiller le message envoyé à nos concitoyens. Sur tous ces points, écoutons les agents publics, professionnels concernés au premier chef.
La question de l'équilibre des territoires est importante. Mais que prendre en compte ? Le PIB ? L'équité régionale ou infrarégionale ? Se retrouver loin du centre de décision de sa région peut être un problème. Réfléchissons aux inégalités entre territoires urbains et territoires ruraux, et aux outils de péréquation. Rediscutons du sens de l'action publique avec les citoyens. Le débat public a été quelque peu instrumentalisé : qui parle au nom de qui ? Les tentatives de mariage forcé entre territoires ont fait émerger un certain rejet de l'autre. La qualité du débat public comptera dans la réussite de la réforme.
Les métropoles soulèvent un certain nombre de questions. Quel équilibre trouver dans les régions à plusieurs métropoles ? Comment les régions dépourvues de métropole survivront-elles ? Comment les choses se passeront-elles hors des métropoles ? Certaines compétences restent partagées entre les régions et les métropoles : qui décidera ? Comment faire émerger l'intérêt général ? Les choses, en la matière, ne sont pas si claires.
Pacte d'avenir pour la Bretagne, Pacte Lorraine : l'État, les collectivités, les partenaires sociaux ont commencé à travailler ensemble et sont déjà parvenus à prendre des décisions intelligentes et consensuelles. Nous devrons nous en inspirer, et faire en sorte que la réforme ne casse pas cette dynamique.
Les transferts de compétences sont à envisager à un double point de vue : l'efficacité de l'action publique, d'une part ; la mise en oeuvre par les agents, d'autre part. Nous devrons nous donner des moyens financiers et entreprendre le dialogue social indispensable pour réussir la transition. Ces transferts auront aussi un impact sur le secteur privé, sur les conventions collectives des entreprises de transport ou sur la capacité des entreprises à répondre à des marchés publics dont le périmètre se sera agrandi. Anticipons : réalisons des études d'impact, mettons l'accent sur la responsabilité sociale de la commande publique.
L'action sociale des départements est un filet de protection majeur en période de crise : préservons-le. Du reste, séparer totalement l'économique et le social, n'est-ce pas réduire notre capacité à agir ? Attention également aux politiques structurantes pour la cohésion sociale, et qui feront l'objet de schémas prescriptifs : petite enfance, prise en charge du vieillissement... Nous ne pourrons faire l'impasse sur les questions financières et fiscales. Ayons le courage d'une véritable réforme de la fiscalité locale, qui ne se limite pas à du rafistolage.
Les regroupements d'acteurs publics ne conduiront pas mécaniquement à des structures plus efficaces. Regrouper pour faire des économies, peut-être, mais encore faut-il le faire intelligemment. Cela impose d'intégrer tous les partenaires sociaux à la réflexion. C'est pour l'heure une grande faiblesse de la réforme. Son aspect européen ne peut non plus être éludé. Il faudra réorganiser le recours aux fonds européens comme le Feder, et réfléchir globalement au financement de l'économie et du social.
N'oublions pas que chaque territoire est différent, et soumis à des contraintes qui lui sont propres : territoires regroupés, non regroupés, territoires d'outre-mer... Examinons les processus de transfert de compétences en en tenant compte.
La position de la confédération Force ouvrière et de l'ensemble de ses fédérations et unions départementales est la même depuis 2012 : nous sommes catégoriquement opposés à la réforme territoriale et à une logique de République des territoires. Le bloc constitutionnel que forment l'État, les régions, les départements et les communes est progressivement remplacé par une association Europe-régions-intercommunalités-grosses communes. Ni le président de la République, ni un président de conseil régional n'ont, seuls, mandat pour redécouper un territoire. Le référendum local par lequel les Alsaciens ont refusé la fusion de leurs départements en une collectivité unique sera abrogé par la réforme : c'est un scandale du point de vue de la démocratie.
Après dix années de retrait des services publics de proximité et de désertification, cette réforme annonce un abandon encore plus grand des territoires par la puissance publique. Les élus locaux, conseillers généraux, maires et conseillers municipaux sont les derniers représentants de la puissance publique à proximité du citoyen. Refuser de passer d'un élu pour 104 habitants à un élu pour 2 000 habitants est d'autant plus important que nous n'avons plus de services publics de proximité. Faire des intercommunalités à plus de 20 000 habitants aggraverait le phénomène et ouvrirait la porte à tous les poujadismes, à tous les extrémismes et à tous les communautarismes.
Nous sommes attachés au maintien de régions à taille humaine et anti-communautaristes. La procédure retenue ne nous convient guère, mais l'attribution aux régions de capacité d'adaptation réglementaire nous inquiète davantage encore : il est hors de question de se réveiller demain ou après-demain avec un Smic alsacien et un autre breton. Ce serait l'anéantissement de l'égalité de droit républicaine. Or c'est bien ce vers quoi nous allons : les élus favorables à la collectivité alsacienne unique arguaient de l'absence de salaire minimum en Suisse et en Allemagne et du besoin d'accroître la compétitivité de leur - admirable possessif - territoire !
Au vu de tous les textes de transfert de missions de l'État vers les collectivités, votés ou en préparation - formation professionnelle, santé, transition énergétique -, nous serons très attentifs à ce que le mandat des conseils départementaux pour 2015-2020 ne soit pas celui de la disparition totale des missions départementales. La réforme de l'administration territoriale de l'État (Réate) a transformé le préfet de département en sous-préfet de région, au point que d'aucuns se demandent s'il existe encore un représentant de l'État au niveau départemental. Constitutionnellement, la suppression des conseils départementaux entraînerait celle des départements. Plus de préfets, plus de conseils généraux : la disparition institutionnelle serait scellée.
Nous revendiquons avec fierté le principe d'un élu pour 104 habitants. Dans certains départements, il faudrait regrouper plus de 200 communes pour parvenir à 20 000 habitants, chèvres et vaches comprises. C'est une aberration totale !
Le personnel des collectivités n'aura jamais connu un tel mouvement de mobilité forcée, géographique ou fonctionnelle. En 2005, nous avons négocié un cadre national pour le transfert des agents de l'État aux conseils régionaux ou généraux. Les mobilités à venir sont incertaines au niveau local et dépourvues d'encadrement au niveau national. Les conférences territoriales de l'action publique pourront de surcroît faire évoluer les missions des collectivités tous les trois ou six ans... Ce mouvement brownien de l'ensemble du personnel privera celui-ci de toute garantie de respect de ses droits fondamentaux. Cette évolution, je doute que le Parlement l'accepterait pour le secteur privé. Et pour cause : elle est inadmissible.
Si cet abandon devait malgré tout être validé, le minimum serait qu'un cadre national protège tous les agents publics - contractuels ou agents sous statut pour ceux qui ont la chance d'en avoir un - des mobilités géographiques non consenties, comme de toute dégradation de son contrat ou de son statut. Mon organisation m'a donné à l'unanimité mandat pour employer des mots forts : cette réforme est antirépublicaine.
La CFE-CGC est attentive aux évolutions de la cartographie des régions susceptibles d'améliorer la situation économique, l'emploi, les services publics et la cohésion sociale. La société civile doit être entendue et quel que soit le découpage envisagé, les moyens nécessaires doivent être donnés aux organisations syndicales pour remplir leur mission auprès des salariés.
Parmi les missions des représentants des salariés de l'encadrement et des agents de la fonction publique, la protection sociale collective et individuelle dans le milieu professionnel constitue des préoccupations intemporelles. Quelles que soient les nouvelles configurations, nous demandons que le pouvoir d'achat des salariés ne soit pas obéré par des levées locales d'impôts en sus de la fiscalité nationale, déjà fort lourde. Enfin, nous serons vigilants à ce que les liens entre les citoyens et l'État, et entre les grandes métropoles et les milieux ruraux, ne soient pas distendus.
Les objectifs du projet de loi ne divergent pas nécessairement des nôtres, mais nous portons sur le texte un regard critique. L'organisation territoriale et la cohérence de l'action publique doivent certes être améliorées, mais la réforme doit rester lisible par les citoyens. Davantage de clarté est nécessaire pour les acteurs de la puissance publique comme pour les organismes sociaux paritaires, les corps intermédiaires et les citoyens, afin de faciliter l'accès aux services publics de proximité que sont, prioritairement, l'assurance maladie, l'assurance chômage et l'assurance vieillesse.
La réorganisation territoriale ne sera pas sans conséquence sur les services rendus aux salariés par les organismes sociaux paritaires. Les articles 2 et 3 du projet de loi rendent les régions compétentes en matière de soutien économique. Elles devront pouvoir s'appuyer sur les partenaires les plus proches des entreprises que sont les organisations syndicales, et notamment la seule organisation syndicale représentative des salariés au niveau de l'encadrement. La CFE-CGC disposant d'une implantation dans chaque région, elle est au plus près des problèmes de financement des entreprises.
Le texte autorise la délégation de compétence à d'autres collectivités territoriales ou groupements, ce qui est contraire aux objectifs de clarté et de cohérence. La possibilité offerte aux régions d'entrer au capital de sociétés commerciales est louable, mais il faudra préciser les conditions d'entrée, le taux de détention de capital maximal et de cession par la région afin d'éviter certaines dérives clientélistes et de faire de la région le dirigeant de fait d'une entreprise privée.
Le chapitre 1er du titre II traite de la suppression de la clause de compétence générale et définit strictement les compétences dévolues au département. La fin du chevauchement de compétences est une nécessité, mais les possibilités de dérogations restantes sont trop nombreuses. Le chapitre 4 fait du sport, de la culture et du tourisme des compétences partagées entre les collectivités territoriales. L'article 29 crée un guichet unique pour les aides et subventions qui devaient être limitées à ces compétences partagées. Cependant, les collectivités pouvant déléguer l'instruction, la gestion et l'attribution de subventions et d'aides relevant de leurs compétences propres, les effets de la suppression de la clause de compétence générale sont annulés... Pour rendre cet article efficace, sans doute pourrait-on créer des guichets uniques transparents et identiques dans toutes les régions. L'égalité citoyenne et territoriale serait assurée et l'article 29 plus en cohérence avec l'article 26 créant les maisons de service au public.
Le titre IV est relatif à la transparence financière des collectivités territoriales. L'intention est bonne. Elle permettra aux contribuables de mieux cerner la pertinence du rapport adressé par la collectivité à la chambre régionale des comptes. Le chapitre 2 précise la responsabilité financière des collectivités territoriales et prévoit leur participation au paiement des condamnations prononcées sur le fondement des traités européens. Or, en l'absence de sanction des décideurs, c'est en définitive le contribuable qui en assume le coût.
La CFE-CGC estime que ce texte ne répond pas à l'ensemble des questions que pose la réunion de plusieurs régions. Beaucoup d'organismes sont découpés à ce niveau : caisses d'assurance retraite, centres des relations avec les entreprises... La fusion de régions réduit-elle le nombre de ces organismes ? Modifie-t-elle leur composition ?
représentante de la CGT, membre du Conseil économique, social et environnemental. - Merci de nous recevoir. La CGT a déjà exprimé au niveau confédéral son désaccord avec les finalités de cette réforme, qui reprend le sens et les contenus d'un certain nombre de réformes successives. Nous pourrons vous faire parvenir nos propositions en matière sociale, économique, environnementale et démocratique : elles répondent aux défis d'aujourd'hui et de demain.
La restructuration de la puissance publique s'accélère, entraînant un bouleversement du vivre-ensemble et du faire-société. Le présent texte prolonge une logique d'organisation du territoire autour de quelques grands pôles d'excellence et du couple métropole-région - où doivent se concentrer les activités économiques et la production de richesses - au service d'une finalité supposée universelle quoique mal définie : la compétitivité. Pôles de compétitivité, autonomie des universités, loi hôpital patients santé territoires - bientôt prolongée par une autre -, création des métropoles, transition énergétique - qui se résume à ouvrir la maîtrise de la production d'énergie au secteur marchand... Le big bang institutionnel se profile, avec la création des métropoles, le redécoupage des régions, la remise en cause des conseils généraux, le renforcement des intercommunalités, la redéfinition des missions et des prérogatives respectives de l'État et des collectivités territoriales, la réorganisation des administrations centrales et des services déconcentrés... Tout cela participe d'une vision élitiste de l'organisation territoriale qui attise des volontés régionalistes et remet en cause l'unité républicaine, l'égalité territoriale et la cohésion sociale.
Les réformes devraient avoir pour objectif de corriger les inégalités sociales et territoriales, de renforcer les services publics, de promouvoir un aménagement équilibré des territoires, le progrès social et le développement économique. Au lieu de cela, ses résultats sont la paupérisation, la précarisation du salariat, l'explosion du chômage, l'intensification de la pauvreté, le rétrécissement des services publics, le recul du potentiel industriel, le renforcement des inégalités et la mise en concurrence des territoires et des femmes et des hommes qui y vivent et y travaillent.
Simultanément, la réforme de l'État remet en cause les fonctions de régulation économique et de redistribution sociale du service public. L'État s'est désengagé de bon nombre de ses prérogatives, a abandonné ses leviers d'intervention économique et n'a plus, faute de personnel en nombre suffisant, les moyens d'assumer certaines de ses missions, en particulier de contrôle. Nous avons moins d'État, et l'État s'est placé au service des intérêts financiers en établissant un environnement législatif, réglementaire, fiscal et social propice à l'essor marchand et à la financiarisation de l'économie. Les exonérations sociales et fiscales, les mesures de simplification, les milliards d'euros d'aides nouvelles accordées aux entreprises au moyen du pacte de responsabilité - que le gouvernement finance par une amputation équivalente des dépenses publiques - en sont quelques illustrations.
La réforme est préparée dans une opacité bien peu démocratique. Les consultations engagées par le Gouvernement depuis le début de l'automne ne sont pas à la hauteur des enjeux. Vous-mêmes, vous auriez pu solliciter l'avis du Conseil économique, social et environnemental (Cese), qui aurait pu s'appuyer, pour émettre des préconisations qui fassent consensus, sur les débats des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (Ceser). Enfin, la reconquête de la confiance de nos concitoyens ne peut faire abstraction d'une consultation des organisations syndicales.
Ce projet de loi ne renforce pas la démocratie sociale dans les territoires. Les conseils de développement sont insuffisants et leur composition doit être revue. Qu'est-il prévu pour l'avenir des Ceser ? Certes, des réformes sont souhaitables. Mais lesquelles ? Quels seront les leviers de l'État pour conduire une véritable politique industrielle, ou une véritable politique écologique des transports ? C'est pourtant l'État qui est censé fixer les objectifs stratégiques déclinés par les collectivités territoriales. Il ne suffit pas de distribuer des aides financières aux entreprises... La CGT réclame d'ailleurs une évaluation et un contrôle systématiques de toute aide publique versée à une entreprise.
Les décisions prises actuellement auront des conséquences négatives sur la qualité du service public, sur l'investissement public et donc, sur l'économie et l'emploi. Les réformes engagées ont pour vocation d'inscrire les territoires dans la compétition économique mondiale pour appliquer le dogme de la baisse du coût du travail sans s'attaquer à celui du capital. Elles auront pour conséquence une baisse inédite des dépenses sociales et publiques et l'ouverture au secteur marchand de nouveaux espaces. Pourtant, c'est l'intérêt général qui devrait être la clé de voûte de la refonte de l'action publique. Celui-ci réclame une vigoureuse réindustrialisation, porteuse d'une nouvelle croissance assise sur le travail, la consolidation et le renforcement des services publics, un aménagement équilibré et solidaire des territoires, la mise en place d'une démocratie sociale effective et une réforme fiscale incluant la fiscalité locale.
La réorganisation territoriale doit répondre de manière durable aux besoins sociaux, économiques et environnementaux. Pour cela, il faut mettre l'accent sur la coopération et la mutualisation au lieu d'inciter à la mise en concurrence qui aboutira à la balkanisation des territoires, entre espaces urbains drainant les richesses et les financements publics et espaces ruraux voués à la désertification. Une telle politique requiert un État stratège garant de l'intérêt général et de l'effectivité des droits fondamentaux.

Merci pour ces propos, qui ont révélé certaines préoccupations partagées, portant sur les garanties sociales lors des mutualisations et des regroupements, sur la nécessité de maintenir la solidarité entre les territoires et la proximité des services publics, ou sur la question de l'accès des PME aux marchés publics. Le débat sur la carte des régions a pu vous paraître réducteur : à nous aussi ! C'est pourquoi le Sénat a insisté pour que le Premier Ministre vienne remettre en perspective cette réforme au cours d'une journée de débats au sein de notre assemblée. La carte des régions ne peut pas être établie indépendamment d'une réflexion sur la répartition des compétences.
Nous sommes sensibles au souci que vous avez exprimé de maintenir un maillage suffisant d'élus dans notre pays, qui reste très jacobin. À certains égards, l'élu local reste l'antidote à la culture centralisatrice. Nous souhaitons une bonne articulation entre la réorganisation des collectivités territoriales et la réforme de l'État. Bien sûr, nous veillons à ce que cette réforme ne soit pas un mécano administratif élaboré à huis clos par les représentants des collectivités territoriales et de l'État. C'est pourquoi vous êtes ici ! Nous aurions aimé saisir le Cese. Malheureusement, le Parlement inscrit ses travaux dans un calendrier qu'il ne maîtrise pas. C'est le Gouvernement qui aurait pu saisir ce Conseil. Nous essayons de compenser cette lacune par le présent échange. De plus, nous recevrons tout à l'heure M. Delevoye, président du Cese, qui est la troisième assemblée de notre République.

Vous n'avez pas cédé à la tentation de défendre des intérêts catégoriels, tout en évoquant les préoccupations des quelque 1, 8 million d'agents territoriaux. Ceux-ci disposent d'un statut commun, ce qui devrait faciliter les mutations et transferts. À la faveur de la réorganisation des compétences, ne pouvons-nous pas envisager de nouvelles avancées de la décentralisation ? Par exemple, ne serait-il pas cohérent de confier aux régions, qui sont déjà chargées de la formation professionnelle, la politique de mobilisation pour l'emploi ? Le RSA est payé par le département et géré par les CAF : baroque ! Il paraît que le revenu d'activité remplacera à la fois le RSA et la prime pour l'emploi (PPE). Comment organiser cela ?

Sans en être surpris, je suis impressionné par la qualité de votre réflexion collective. Vous avez soulevé la question de l'équité territoriale : un rapport a été rendu à Mme Pinel sur l'ingénierie territoriale. Comment un chef-lieu de canton peut-il espérer pérenniser une fonction publique territoriale de qualité ? « Je suis condamné aux débuts de carrière et aux rebuts », se désole l'élu d'une collectivité reculée. Réfléchissez-vous à la manière de rendre les postes plus attractifs ? Faut-il passer par une bonification indiciaire ? Y attacher des missions spécifiques ? Comment gérer la fonction publique territoriale en échappant au système de l'escalator ? Il est presque impossible, par exemple, de recruter sur profil une équipe enseignante pour un collège du 93 sur la base d'un projet dérogeant aux critères des commissions paritaires. Est-il normal que la liberté d'administration des collectivités territoriales conduise à de telles disparités dans les régimes indemnitaires ? Entre un poste d'attaché dans une commune de grande ruralité et un poste de 32 heures tranquilles dans un conseil régional, l'écart peut être de 600 euros !

Je me réjouis que votre réflexion soit aussi approfondie. Nous avons besoin de vos contributions ! Comment gérer au mieux la période de transition inhérente à l'application de cette réforme ?
La politique de l'emploi dépend de l'État et doit rester de sa compétence exclusive. Les dépenses publiques et sociales décidées par l'État doivent être assurées par l'État. Les politiques d'accompagnement social et professionnel des publics en difficulté peuvent être prises en charge par les collectivités territoriales, et en particulier par les conseils généraux, à condition qu'on leur en donne les moyens : il s'agit d'éviter que ne se reproduisent des transferts de dépenses sociales sans compensation, comme ceux de l'APA ou du RSA. La préparation des assises du travail social est l'occasion de réfléchir à la thématique « quelle politique de travail social » ?
Des conférences territoriales de l'action publique existent : n'est-ce pas dans cette enceinte que doivent être définies les mesures transitoires ? Cette réforme est précipitée, improvisée. Il faut approfondir le débat. En réalité, c'est la deuxième loi qui comptera : l'important, c'est la répartition des compétences. Le découpage, en lui-même, est accessoire. On a mis la charrue avant les boeufs...
Les schémas régionaux prévus par le projet de loi ne clarifient pas suffisamment les compétences. Les classes moyennes, que nous représentons, ne veulent pas d'un accroissement de la fiscalité. Comment la transition sera-t-elle financée ? L'objectif de ce projet de loi est de dégager des économies d'échelle.
Le préfet de la région Rhône-Alpes a indiqué récemment que la mise en place de la métropole de Lyon générerait des surcoûts plus importants que toutes les économies à prévoir... La période de transition nous réserve des surprises !
Il serait intéressant de faire la liste des missions effectivement transférées par l'État aux régions depuis l'acte II de la décentralisation en 2004. Ces transferts interviennent parfois discrètement, de manière perlée, par des amendements ou des cavaliers législatifs qui ne donnent lieu à aucune concertation, à la faveur de lois thématiques. C'est ainsi que la territorialisation de certaines politiques publiques - l'école, l'énergie, la santé - progresse sans le moindre débat. Le projet de loi dont nous discutons crée un droit d'adaptation normatif ou réglementaire pour les treize régions, dont les exécutifs pourront adapter les règles nationales « à leur territoire ». Souhaitons-nous que treize barons puissent adapter à leur guise, sur « leur territoire », les règles de la République ? Nous sommes viscéralement attachés à l'égalité des droits, tout particulièrement en matière sociale. Nous ne sommes pas jacobins, mais Républicains, oui ! Nous défendons une décentralisation obligatoire : un conseil général ne doit pas « pouvoir décider » de gérer le RSA, ou les routes, selon sa fantaisie. L'État peut décentraliser certaines missions, à condition qu'il s'assure qu'aucune adaptation ou privatisation n'est possible. Nous sommes totalement opposés à une décentralisation de la politique de l'emploi.
Nous avons abordé la réforme du RSA avec le Gouvernement pour la première fois en février dernier lors des assises de la fiscalité. Nous sommes tous d'accord avec les conclusions du rapport Lefebvre : une fusion entre le RSA et la PPE est de fait impossible, car elle susciterait des difficultés sans nombre. Pourtant, on nous a annoncé cette semaine que la décision était prise ! On fusionne d'abord (au mépris du consensus dégagé) et on avise ensuite... Cette décision est à l'image de cette réforme territoriale. À quoi sert la concertation ?
De 2005 à 2008, l'État a garanti un cadre national. Nous ne remettons pas en question la libre administration des collectivités territoriales, mais souhaitons que l'État fournisse un cadre national à la fonction publique territoriale, dont nous défendons la spécificité et où nous souhaitons voir se multiplier les titularisations. Toute mobilité doit respecter le statut. Nous risquons d'avoir treize APA différentes dans treize zones régionales, gérées tantôt par les intercommunalités, tantôt par les métropoles, tantôt par les conseils généraux. Il ne s'agit plus d'une réforme territoriale mais d'une déformation de l'État, qui met en péril l'égalité.
L'intégration totale ou partielle du régime indemnitaire dans le traitement soumis à pension réduirait les inégalités entre collectivités.
Il ne s'agit pas de s'interdire toute fiscalité supplémentaire mais de reposer la question fiscale toute entière. Que financer en priorité ? Les salariés sont prêts à faire des efforts, s'ils savent pourquoi. Le flou qui règne sur la liberté du pouvoir réglementaire nous alerte : place à l'intelligence collective ! Certes, les frontières entre les responsabilités de l'État et celles des régions bougent, mais il ne faut pas les figer. Ce qui compte, c'est la qualité de la relation entre l'État et les régions. En matière d'emploi, il faut garantir l'égalité nationale et prendre en compte les réalités locales. État, région, partenaires sociaux doivent réfléchir ensemble. Les frottements entre l'État et la région ne se régleront pas uniquement par une profusion de textes réglementaires ou législatifs.
La première problématique, sur le RSA, avant la question de sa fusion avec la PPE, c'est de s'intéresser à la personne. Nous devons avoir une vision globale des allocataires et ne pas aborder le RSA avec une logique de guichet. Simplifier le dispositif est bienvenu, pourvu que cela n'occulte pas la question de son financement, qui n'est assuré qu'à 40 %.
Nous pouvons interpeller les collectivités territoriales sur leur responsabilité en tant qu'employeurs. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) est un outil précieux, qu'il faut utiliser ! La liberté d'administration ne garantit pas la capacité à gérer les parcours professionnels...
Certes. Le dialogue social est essentiel également, au sein de la fonction publique territoriale. Il peut prendre la forme d'accords, pas forcément nationaux. La discussion avec les agents les aide à parler des difficultés qu'ils rencontrent. La départementalisation des CAF pourrait être un exemple inspirant.
La loi s'adresse à tous les citoyens avant même de s'adresser aux fonctionnaires. Pour autant, il est parfois difficile de comprendre qui fait quoi, et la situation ne va pas s'arranger avec ce projet de loi, qui crée encore plus de niveaux de décentralisation sans clarifier totalement les compétences - d'autant qu'il y aura toujours des compétences partagées. C'est ce qui explique la désaffection de nos concitoyens pour la politique. Quant à donner de nouvelles compétences économiques aux régions, lesquelles envisagez-vous effectivement de transférer : Pôle Emploi ?

Les régions sont chargées de la formation professionnelle. Pourquoi ne s'impliqueraient-elles pas aussi dans les politiques de soutien à la recherche d'emploi ?
S'il y avait de véritables dispositifs territoriaux de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, cette question-là serait réglée.
Nous devons intégrer la GPEC dans la définition des politiques publiques. Quel est l'impact sur l'emploi des schémas régionaux de santé ?
Si l'on considère que, pour l'entreprise, le bon niveau d'intervention est la région, pourquoi ne pas raisonner de même pour l'emploi ? Les conseils généraux ont eu du mal à gérer le RSA, dans son aspect paiement comme dans son aspect accompagnement. La gestion d'un dispositif législatif revient naturellement à l'État, et relève plus de la déconcentration que de la décentralisation.
L'évolution du statut, voire sa disparition - annoncée par nombre de leaders politiques, surtout à droite - font l'objet d'un travail avec les syndicats, sous l'égide de Mme Lebranchu. La variation des régimes indemnitaires est liée à l'inégalité des territoires. Intégrer le niveau indiciaire dans le calcul des retraites éviterait que les rémunérations soient beaucoup plus faibles dans les territoires les moins bien dotés. Comment gérer au mieux la période de transition ? Elle est très anxiogène pour les agents, qui devront bénéficier d'un accompagnement individuel des mobilités.
La commission procède ensuite à l'audition, au cours d'une table ronde, d'organisations patronales et d'organismes consulaires.

Nous entendons à présent les représentants des forces vives - employeurs, organisations syndicales, associations intervenant dans le domaine social et médico-social - sur le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Nous ne souhaitons pas débattre de ce texte entre élus uniquement, mais entendre les attentes des acteurs économiques à l'égard des collectivités territoriales. Comment améliorer l'efficacité des politiques publiques ?
Cette réforme est très importante pour les entreprises d'artisanat et les chambres des métiers et de l'artisanat, pour qui la proximité, la réactivité, la rapidité de décision et la simplification des procédures sont fondamentales.
La fiscalité représente un coût pour les entreprises. Les collectivités se plaignent des baisses de dotations de l'État : il ne faudrait pas qu'elles augmentent les impôts locaux, qui viseraient en priorité les entreprises... Il faut rationaliser. Dans le Nord-Pas-de-Calais, nous avons une chambre unique pour la région : nous avons fusionné les trois établissements pour mutualiser les fonctions de back-office. C'est un exemple à reprendre ailleurs.
Merci pour cette audition, et pour cette réforme, qui est une occasion historique. Les missions importantes des collectivités doivent être articulées avec celles que nous assumons pour l'Etat et les entreprises. Nous avons le désir ardent de voir se préciser qui fait quoi dans les territoires régionaux. Deux questions se profilent : comment prendre en compte les missions des chambres de commerce et d'industrie, réaffirmées par la réforme de juillet 2010, par rapport aux compétences nouvelles des régions et des métropoles ? Comment prendre en compte la proximité et l'équité entre territoires ?
Cela passe d'abord par la nécessaire co-construction des politiques publiques économiques avec la région. Le leadership régional est sain ; il ne doit pas être remis en cause, mais nous revendiquons une participation effective - elle est du reste inscrite dans le texte dans le cadre du schéma régional du développement économique et de l'innovation et du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire. Dans l'élaboration des schémas de développement du tourisme ou pour l'accessibilité des services, nous sommes un peu oubliés... Evitons également les doublons, que nous ne pouvons plus nous permettre, comme la prolifération des agences, souvent redondantes avec les services des chambres.
Il faut faire confiance au réseau consulaire, avec qui les régions ont l'impérieuse obligation de contractualiser. Cela se fait déjà : j'ai là la convention que j'ai signée avec la région Bourgogne. Mais il faut continuer, autour du triangle : « définir, dérouler, évaluer les politiques » - car il s'agit de fonds publics des deux côtés.
En tant qu'établissement public de l'État, nous devons appliquer sa politique, tout en contractualisant avec les régions : sans doute y a-t-il une petite ambiguïté à lever dans le texte. Nos missions gagneraient à y être réaffirmées, afin qu'elles soient claires pour tout le monde !
Le MEDEF et les entreprises soutiennent une réforme qui apportera plus d'efficacité, diminuera le nombre de strates territoriales et facilitera le développement économique et social. Le découpage des régions doit avoir du sens, et non suivre des logiques électorales. Nous en attendons une définition du « qui fait quoi ». Nous le savons bien dans les entreprises, une décision, même sous-optimale, vaut mieux qu'une absence de décision. Ce débat a été lancé il y a longtemps : il y a urgence. Pour assumer des responsabilités plus importantes en matière économique, il faudrait associer ces non-électeurs que sont les entreprises, qui ont parfois des solutions à préconiser et ont besoin d'être informées rapidement, sur la fiscalité par exemple. Nous voyons donc d'un très bon oeil le principe du rendez-vous tous les trois ans. Les économies se font par la mutualisation, mais aussi par la réduction, comme celle des organismes de développement, au nombre de 600 en Rhône-Alpes !

Nous sommes d'accord pour promouvoir le recentrage des actions de développement économique et la rationalisation du paysage institutionnel, sans cacher nos objectifs d'optimisation des coûts. Les rapports des juridictions financières abondent sur la prolifération des organismes - soit dit sans préjudice de leur savoir-faire : notre pays ne peut plus se payer le luxe de cette dispersion. L'image du millefeuille territorial fait oublier que dans l'angle mort des différentes couches se logent les agences qui vivent sur la bête.
Dans cet angle mort se situent aussi nombre de syndicats intercommunaux dont la petite taille pose problème : je le vois bien dans mon domaine d'activité.

La région vous semble être le bon échelon à condition qu'il soit ouvert à la co-construction. Mais les entreprises ont aussi besoin d'interlocuteurs locaux : villes et intercommunalités. La région peut être le planificateur stratégique, mais la mise en oeuvre - la mobilisation du foncier, par exemple - nécessite d'autres interlocuteurs. Vous nous dites que lorsqu'ils sont trop petits, ils manquent d'ingénierie, cela vous pénalise ?
Un bon exemple des bénéfices à tirer de la régionalisation est la formation. Les conseils régionaux ont développé l'apprentissage - très important pour l'artisanat - après une analyse préalable des besoins ; ils en ont ensuite confié la gestion à des opérateurs tels que les chambres de métiers et de l'artisanat. Ce schéma pourrait être étendu à l'économie : la stratégie définie par la région s'appliquerait à travers des conventionnements.
Un autre échelon légitime est celui des métropoles ou des communautés de communes, qui ont la proximité suffisante pour adapter les politiques aux territoires.
La question du niveau de compétence pour assurer l'équité des territoires se pose : à trop limiter la région à un rôle purement stratégique, nous risquons de décliner sa vision dans le désordre ; il faut donc que cette stratégie soit suffisamment prescriptive. Cela se pose dans les mêmes termes entre chambres de commerce et d'industrie régionales et territoriales. Le problème est d'autant plus important que les régions sont plus grandes.
La politique de formation doit être co-construite avec les partenaires sociaux. J'ai peur que les relations entre les régions et les métropoles soient compliquées et que les deux entités se fassent la guerre...

Les chambres consulaires doivent savoir que nombre de nos collègues se préoccupent de leurs capacités d'investissement en termes de formation : des amendements seront déposés pour les sauvegarder.

Nous partageons tous, même les départementalistes, le constat qu'il y a trop d'acteurs sur le terrain. Mais dans votre discours, entre les régions et les intercommunalités, le fait départemental semble avoir disparu : le même raisonnement doit-il s'appliquer pour les chambres consulaires départementales ? Puisque la région est le pôle principal de la politique de formation, ne faut-il pas qu'elle le soit aussi pour la politique de l'emploi, ainsi que pour les universités et la recherche ? Les pôles de compétitivités ont été une vraie chance ; les liens entre entreprise et recherche sont un facteur de réussite. Vous parlez de réglementation : pensez-vous qu'une décentralisation du pouvoir réglementaire au niveau régional améliorerait les choses ?
Il ne peut pas y avoir de déconnection entre la formation et l'activité économique. Former pour former n'a pas de sens ! Notre logique consiste à être suffisamment souple pour nous adapter aux évolutions des besoins : beaucoup d'emplois ne sont pas pourvus et c'est cela qui doit guider la politique de formation.
Concernant les chambres départementales, la question se pose plus en termes d'organisation que de structure : dans le Nord-Pas-de-Calais - pour montrer l'exemple, peut-être - nous avons une chambre unique, mais tout en maintenant des sites dans tous les arrondissements, pour préserver des interlocuteurs de proximité. D'autres régions ont préféré garder une chambre par département, mais, dans tous les cas, les fonctions support sont mutualisées. Pourquoi garder des structures départementales ? Parce qu'il y a toujours un préfet de département et des politiques économiques départementales. La chambre unique du Nord-Pas-de-Calais a ainsi une convention avec le Nord et une autre avec le Pas-de-Calais.
Sur la question de la politique de l'emploi et de la formation, effectivement liées, entre niveaux national et régional, l'exemple de la Bourgogne est éclairant : nous devons faire face à la problématique très particulière des sous-traitants, très nombreux en milieu rural, mais sans perdre de vue la cohérence nationale de la politique de l'emploi.

La politique de l'emploi recouvre des notions très différentes : les caractéristiques de l'indemnisation du chômage sont déterminées par les partenaires sociaux dans la convention de l'UNEDIC - cela ne peut pas être délégué à la région. La création de Pôle Emploi était fondée sur l'idée que le rapprochement entre l'indemnisation et le soutien à la recherche d'emploi aurait pour conséquence que l'institution ainsi créée aurait intérêt à être efficace dans la seconde fonction pour faire des économies dans la première : le caractère théorique de ce raisonnement n'échappe aujourd'hui à personne. Mais avec une telle articulation, quelle dimension pourrait-elle être confiée aux régions sans casser Pôle Emploi ? La gestion des contrats aidés dans le secteur médico-social marchand, associatif ou public, aujourd'hui du ressort des DIRECCTE, pourrait-elle être confiée aux régions ?
En Haute-Savoie, la vallée de l'Arve compte plusieurs dizaines d'entreprises artisanales sous-traitantes de grands groupes et dont l'efficacité est reconnue dans le monde entier. Elles appellent une politique adaptée localement, comme la région de Toulouse pour l'aéronautique. Sans mettre en cause la politique nationale, nous ne pouvons pas échapper à la nécessaire cohérence entre politique de formation et caractéristiques de l'emploi au niveau local.
La loi sur la formation nous permettra d'agir pragmatiquement. Nous sommes confrontés à un véritable défi : définir une politique adaptée aux besoins régionaux, pour que les 300 000 à 500 000 emplois actuellement non pourvus le soient. L'apprentissage est malheureusement victime de règles invraisemblables. Les Allemands ont été pragmatiques : ils ont réorienté des fonds consacrés à la formation longue vers l'apprentissage et l'ont autorisé dès quatorze ans. En France, il faut attendre dix-huit ans. À cause de ces règles absurdes, plus personne ne veut embaucher d'apprentis. Arrêtons de vouloir amener tout le monde à bac + 5 ; arrêtons d'attendre bêtement que les jeunes aient dix-huit ans et passent quatre ans à traîner dans la rue, au lieu d'être pris en charge pour apprendre savoir-faire et savoir-être. Mais je m'écarte peut-être du sujet...

Faut-il renforcer le pouvoir régional pour débloquer l'apprentissage, construire une osmose avec les entreprises et récupérer des moyens alloués aux filières longues de l'éducation nationale ?
Nous revenons à la co-construction. Les accords signés entre le réseau consulaire et les régions depuis deux ou trois ans intègrent de plus en plus la dimension de la formation.
Je ne veux pas la mort du département, mais je veux que les compétences soient clarifiées. Nous voyons bien que le social et la proximité relèvent du département. C'est à vous, et non au MEDEF, de décider ce qu'il doit faire exactement.

Mais lorsqu'une compétence a été confiée à un niveau, les autres ne doivent plus pouvoir y toucher.
Oui. Je suis à cent pour cent pour la fin de la clause de compétence générale. La proximité peut être très bien traitée par la mutualisation. Le rôle d'interlocuteur des entreprises est enfin reconnu pour la formation. Il faudrait que ce soit le cas aussi pour l'aménagement du territoire, le transport, la mobilité... d'autant que les entreprises sont de gros contributeurs dans ces domaines.
Vraie avancée dans ce domaine, nous travaillons avec les communes dans le cadre des écoles supérieures de commerce. Les pôles de compétitivité ont été une réussite, du point de vue de la liaison entre universités, entreprises et collectivités.
La question de l'échelon départemental se pose aussi pour le réseau consulaire ; à nous de voir quel est le bon maillage : le département ou le bassin - qui a plutôt ma faveur. Nous devons éviter la prolifération des agences. De 265 chambres, nous sommes arrivés à une centaine aujourd'hui, mais nous devrons redéfinir notre maillage en fonction des compétences dévolues aux nouvelles structures.

Nous l'entendons tous les matins : je cherche des gens, mais je n'en trouve pas, ou alors inadaptés. Sauf exception, Pôle Emploi ne résout pas ce problème. Nous avons fait les missions locales, les maisons de l'emploi pour les jeunes...
Les écoles de la deuxième chance !

C'est extrêmement coûteux, surtout pour l'État. Ne pensez-vous pas que la région serait l'acteur adéquat - avec tous ses partenaires - pour assurer la politique de l'emploi consistant à permettre aux demandeurs d'emploi de trouver du travail ? Nous pourrions alors supprimer des structures annexes qui sont une source de dépenses publiques considérables, plus peut-être que les collectivités locales qui sont souvent mises en accusation.
Elles ont souvent à gérer une situation qu'elles n'ont pas créée et qui est due à l'absence de liaison entre la formation et les besoins d'emplois du territoire ; c'est donc cette dernière question qui est essentielle.

Les chiffres sont alarmants : le nombre de titulaires d'un bac professionnel qui s'inscrivent à l'université et ne finissent pas leurs cursus, le nombre de décrocheurs, inscrits en filière générale mais qui n'arrivent pas jusqu'au bac... Certes, nous pouvons connaître des années fastes où les crédits du Fonds européen de développement régional financent à 50 % l'école de la deuxième chance, mais cela ne durera pas. Le service public d'orientation et d'adaptation à l'emploi doit être au niveau régional, puisque c'est à ce niveau que - tout le monde le dit - seront concentrées les aides à la création d'emplois. Les organisations syndicales, que nous avons entendues avant vous, nous l'ont dit : elles suivront de près les futures conventions, qui ne devront pas seulement fixer un nombre de créations d'emplois, mais bien des actions spécifiques de formation et une gestion prévisionnelle des compétences par bassin d'emploi.

Le but de l'action publique n'est pas de conserver des fonctions et des fonctionnaires dans leurs ministères.

J'avais posé une question sur la décentralisation du pouvoir réglementaire.
Oui, dans le cadre d'une cohérence nationale. Notre pays s'apprête à franchir une nouvelle étape dans la décentralisation. Passer de 22 régions à 13...
Disons entre 13 et 15. Cela renforcera les pouvoirs des régions. Notre réseau consulaire gère près d'un quart des apprentis de ce pays à travers ses centres de formation des apprentis, avec des résultats plutôt meilleurs que la moyenne ; il gère l'alternance, où un tiers des formations dispensées ne sont pas renouvelées, afin de les adapter constamment. Nous ne sommes pas installés dans un fromage, nous cherchons à coller à la réalité du terrain : nous formons ainsi des soudeurs pour Areva...
Ce n'est pas la mode, mais c'est un métier très technique. Peut-être devrons-nous arrêter dans un ou deux ans.
Je suis plus réservé sur la régionalisation des normes : d'une part, bon nombre d'entre elles dépendent du niveau européen ; d'autre part, même les entreprises artisanales peuvent travailler dans plusieurs régions : se plier à une norme différente à chaque fois nous compliquerait la tâche. En fait, ce que nous réclamons, c'est moins de normes, plutôt qu'un changement de compétence.
Je comprends que vous ne vouliez pas gérer l'indemnisation du chômage et ainsi hériter d'un déficit d'une trentaine de milliards d'euros ; pourtant, la manière dont on la gère pourrait déterminer un plus ou moins rapide retour à l'emploi.

Merci pour cette audition très riche : les chefs d'entreprise ont montré que leur efficacité se traduisait aussi par la maîtrise des horaires.
La commission procède enfin à l'audition, au cours d'une table ronde, d'associations oeuvrant dans le domaine social.

Nous souhaitions entendre la voix des associations oeuvrant dans le domaine social, car le débat sur les collectivités territoriales ne peut pas rester dans l'entre soi de leurs représentants. Comment percevez-vous la réforme de l'organisation territoriale d'un point de vue social et médico-social ?
Merci de votre invitation : nous avons déjà eu l'occasion d'être entendus par la Commission des affaires sociales, jamais par celle des lois. Nous en sommes heureux, car la réforme qui se profile nous concerne au premier chef. Elle semble avoir cantonné un peu rapidement le domaine du social et du médico-social à la compétence de principe du département. Le projet de loi aurait pu aller au-delà d'une redéfinition des frontières des collectivités territoriales. Il aurait été souhaitable que les citoyens soient placés au coeur du système, dans une région soucieuse de la transparence et de la lisibilité de son offre d'aides et de soins. Nous aurions ainsi pu avoir une vision stratégique et gestionnaire plus affinée que ce que le texte nous propose. La politique sociale est en train d'évoluer. Il est impératif que l'organisation administrative du territoire ne vienne pas contredire cette évolution. Ceux qui s'adressent aux associations ont des demandes de plus en plus globales qui touchent à plusieurs domaines à la fois. Les réponses doivent se faire transversales, comme le plan de lutte contre la pauvreté, adopté dernièrement, qui prend en compte l'ensemble des phénomènes intéressant la pauvreté. La réforme devrait être une excellente occasion de décloisonner les secteurs pour répondre à la complexité de la demande.
La prévention est une donnée qui commence seulement à être prise en compte dans la mise en oeuvre des politiques sociales. Elle ne représente que 4 % des dépenses nationales de santé. Le projet de loi sur la santé de Mme Touraine corrige ce manque en fixant un objectif net et précis. Tous les acteurs des politiques sociales doivent intégrer cette vision de moyen terme. Quand il s'agit de handicap ou d'insertion, les mesures, réparatrices, sont souvent d'urgence. Il nous manque une vision plus structurelle de l'évolution des besoins. La réforme territoriale devrait se saisir de cet enjeu et doubler les politiques sociales d'une fonction de prévision. La question territoriale est accessoire ; l'essentiel, c'est le fond des politiques mises en oeuvre.
Sans avoir une vision claire des compétences qui seront attribuées aux régions, nous pouvons dégager un certain nombre de principes qui devront présider à leur répartition. Premièrement, il faut inscrire les politiques sociales dans la durée, au niveau local, territorial et national. Deuxièmement, face à la complexité croissante des besoins, l'accompagnement des citoyens est indispensable pour qu'ils ne s'égarent pas dans le labyrinthe de leurs droits. Je sais, pour avoir exercé les fonctions de délégué à l'emploi au ministère du travail, que l'accompagnement professionnel et social des demandeurs d'emploi a été très difficile à mettre en place. On en parle depuis trente ans, et c'est seulement aujourd'hui que Pôle Emploi commence à expérimenter son dispositif dans les régions. Troisièmement, rien ne pourra se faire sans décloisonner les politiques sociales pour qu'elles se complètent entre elles - politique du logement, de la ville, du développement économique. La région pourra combiner ces différents domaines, favoriser la transversalité et leur désenclavement. Quant aux citoyens, il est important de les faire participer à la mise en oeuvre de ces politiques. La loi reste muette sur le sujet. Allons vers plus de démocratie participative.
Enfin, nous n'avons arrêté aucune position sur le sujet délicat de la clause de compétence générale. Il nous semble souhaitable de la faire disparaître, mais il est encore trop tôt. Les compétences sont trop enchevêtrées. Dans un contexte budgétaire contraint, il serait dangereux d'un point de vue financier de faire disparaître cette clause dès maintenant.
Votre invitation est une agréable surprise. La réforme touche l'ensemble de nos adhérents et nous y avons été peu associés. Nous n'avons pas d'opposition ni d'accord de principe sur les périmètres géographiques ; cependant, nous regrettons le manque de réflexion en amont. Par conséquent, nous considérons que le projet de loi en l'état actuel n'est qu'une première étape qui doit être suivie d'un travail sur les compétences. Elles devront être clarifiées pour gagner en efficacité. À l'heure actuelle, les écoles, les collèges et les lycées obéissent à des logiques différentes en matière d'accessibilité. Idem pour les transports ou l'emploi : une harmonisation est indispensable. On perdra également en efficacité si l'on éloigne les centres de décision, avec pour seul souci l'organisation géographique. Les agences régionales de santé n'ont pas montré tout leur potentiel. On peut les rendre plus efficaces sur un territoire plus vaste. Les personnes en situation de handicap ou les personnes qui souffrent d'isolement ont besoin de dispositifs de proximité. Il faut mettre le citoyen au coeur de l'action et des politiques. Enfin, je ne suis pas certain qu'en rapprochant des régions ou des collectivités en difficultés financières, on développera les moyens de l'action sociale. Nous souffrons déjà d'un déficit d'accompagnement financier. Ne le creusons pas. Certes, les grandes régions pourront bénéficier des fonds européens. Il faudra néanmoins veiller à ce que les besoins des personnes en situation de handicap soient pris en compte dans la répartition de ces fonds. C'est prévu dans les textes européens ; ce n'est pas toujours appliqué.
Ce projet de loi nous a été imposé sans concertation en amont. Reste à définir le périmètre dans lequel nous pourrons en examiner les conséquences, compétence par compétence.
Au nom de l'APF et de son président M. Alain Rochon, je vous remercie pour cette invitation : nous n'avons pas été habitués à échanger avec la commission des lois.
Je souhaiterais vous faire part d'un certain nombre de constats, d'alertes et de points de vigilance face à un projet de loi qui veut donner une meilleure visibilité aux institutions territoriales. Les personnes en situation de handicap et leurs familles sont concernés ; pour autant, il est difficile de mesurer l'impact des nouvelles dispositions sur leur quotidien. Les maisons départementales des personnes handicapées sont gérées par le département. Elles offrent aux handicapés des solutions qui relèvent de leur droit spécifique - accompagnement, soins, etc. - et ont un statut de groupement d'intérêt public que nous voudrions sauvegarder. Tous les acteurs sont représentés dans la commission exécutive de ces établissements - le conseil général, les services de l'État et les associations. Sur quelle collectivité départementale s'adosseront-ils financièrement et administrativement ? Pour nous, l'échelon de proximité le plus adéquat pour l'ensemble des usagers en situation de handicap est celui qui leur permet de se déplacer vers leur lieu d'accès au droit. Qu'adviendra-t-il également de la stabilisation des équipes dans laquelle la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a tant investi ? Nous craignons que cet acquis se délite. À Lyon, à compter du 1er janvier 2015, les compétences sociales seront transférées du département vers la métropole. Nous nous retrouverons donc avec deux interlocuteurs dans les MDPH. Il faudra trouver de nouveaux agents pour une nouvelle instance, la Maison métropolitaine et départementale des personnes en situation de handicap.

Lyon reste un cas particulier où la métropole prend toutes les compétences du département. Dans l'éventualité d'une seule MDPH pour le département du Rhône et pour la métropole de Lyon, il faudra s'organiser, sans que cela relève du domaine législatif.
Je parlais des personnels.

Dans ce cas, oui, il ne sera pas facile de faire venir des fonctionnaires d'État. Toutes les MDPH ne fonctionnent pas idéalement.
Les moyens de fonctionnement posent problème. Un budget de 66,3 millions d'euros est prévu dans le PLF 2015, alors que la CNSA consacre 64 millions d'euros au fonctionnement des cent MDPH. Comment re-ventiler ce budget en cas de variation du nombre de ces établissements ? La CNSA joue un rôle important pour l'harmonisation des pratiques dans l'ensemble du territoire. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées garantit l'équité des droits accordés aux personnes dans l'ensemble du territoire. Il faut maintenir ces dispositifs. Vous examinerez dans quelques mois le projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement. Nous saluons la création des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie, dispositif qui reprendra a minima les prérogatives des actuels conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées et des comités départementaux des retraités et personnes âgées. Il s'agit d'un dispositif consultatif distinct de celui d'accès au droit. Comment s'opéreront les transferts de compétences entre le département et la future collectivité territoriale dans le domaine de l'hébergement des adultes en situation de handicap ? C'est le premier poste budgétaire des conseils généraux. La question vaut aussi pour l'aide à domicile et les services d'accompagnement à la vie sociale. Quel impact le droit d'option des départements pourra-t-il avoir sur la gestion des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, et sur les conventions élaborées par les agences régionales de santé avec leurs partenaires ? Enfin, le transfert des compétences transversales interroge la cohérence des interventions sociales sur un même territoire. Par exemple, les transports scolaires ne seront plus gérés par le département, mais par la région, au 1er janvier 2015. Pour un élève en situation de handicap, le département rembourse une aide aux familles ; il organise ce transport scolaire quand le service public échoue à répondre au besoin. Qui financera cela dans le nouveau système ? Le département au titre de la compétence sociale, ou la région au titre de la compétence des transports ?

Vous êtes en attente d'éclaircissements ; ce n'est pas surprenant, car le projet de loi ne modifie pas les compétences du département en matière sociale. L'avenir des départements a été interrogé. Il est utile de savoir ce qui vous préoccupe.
L'équité territoriale ne doit pas être un vain mot, mais une réalité.
Le secteur associatif dans le domaine du handicap s'est construit au plus près des personnes, dans un territoire restreint. Les associations ont ensuite grossi et se sont rapprochées les unes des autres. Le fait régional est nouveau en France, même s'il a des racines historiques profondes. La loi dite « Hôpital, patients, santé et territoires » a créé les agences régionales de santé, consolidant ainsi le fait régional dans notre domaine. Les lois de décentralisation des années 80 ont consolidé le mouvement associatif au niveau du département. Il n'est pas simple de structurer au mieux les réponses aux situations de handicap : il faut fédérer des personnels pour qu'ils travaillent ensemble, mettre en place des structures, etc. Toute modification de la logique des pouvoirs publics percute nos organisations. La question de l'organisation territoriale est présente dans nos réseaux, puisque nous avons été incités à nous rapprocher et à nous concentrer au-delà de l'échelle départementale. Le transfert des compétences aux métropoles ne se fera pas de la même manière selon que les organisations agissent au niveau du département ou sont implantées au coeur de la métropole. La métropole lilloise regroupe peu ou prou l'ensemble des associations ; ce n'est pas le cas dans le Rhône. La question du transfert des centres d'aide par le travail au département a fait débat, ces deux dernières années. Il est fondamental de définir une politique claire sur le sujet. Quel que soit le découpage des territoires, la question de l'égalité de traitement des personnes se pose. Elle n'est pas correctement assurée. Une solidarité financière entre les territoires contribuerait à améliorer la situation. La question de la région est centrale pour nous.

Vous êtes tous les jours au contact des collectivités et vous connaissez leur architecture. Le Parlement n'a pas envisagé de modifier les compétences du département dans le domaine social. Toutes les métropoles ne sont pas destinées à remplacer le département ; le cas lyonnais est spécifique. Rien n'a été décidé en Ile-de-France. Vous avez relié la réforme territoriale à celle de l'État, insistant ainsi sur la nécessité d'adapter les structures de l'État aux nouvelles donnes territoriales. Ce sont là des problèmes qui relèvent de l'administration ; malgré la décentralisation et le transfert de responsabilité au département, nous n'envisageons pas de toucher au bloc du médico-social. Les interlocuteurs resteront les mêmes. Le vrai problème est dans l'opposition d'une région en charge de l'insertion économique et d'un département responsable de l'insertion sociale. Vous redoutez que la compétence sociale soit donnée à de grandes intercommunalités, mais nous savons bien qu'on ne fait pas d'action sociale à 20 000 habitants.

Comme toujours, les interlocuteurs du mouvement social ont réussi à prendre le pouvoir. C'est eux qui ont auditionné notre rapporteur ! Il n'y a pas lieu de porter la discussion sur la décentralisation, car aucun pouvoir n'est transféré de l'État aux collectivités locales. Au Sénat, nous souhaitions étudier les possibilités d'un rééquilibrage du texte par des mesures de décentralisation. Jusqu'à présent, notre réflexion s'est concentrée sur la région, dont on veut faire une collectivité en charge du développement économique et territorial. Il faudrait ajouter l'emploi aux compétences de la région. Il serait bon également de pouvoir mesurer l'effet qu'auraient des mesures de décentralisation dans le domaine des politiques sociales. Nous ne nous sommes pas engagés dans cette voie pour l'instant, car les départements sont asphyxiés par un service de prestations sociales sur lequel ils n'ont que peu de prise. Nous risquons d'avoir à faire face à des besoins considérables sans avoir les moyens suffisants d'y répondre. Dans les départements, l'expansion des charges sociales n'est pas compensée par des ressources qui sécuriseraient les besoins. Vous ne souhaitez pas que le domaine du social et du médico-social passe au département. Manifestement, vous n'êtes pas pressés de faire évoluer la décentralisation. C'est du moins ce que confirme votre silence sur ce point.

J'ai présidé l'Association pour adultes et jeunes handicapés, l'APAJH. Les lois successives ont mis les associations face à leurs responsabilités. En période de budget contraint, les départements se laissent parfois aller à une politique d'immixtion dans la gouvernance des associations. Il faudrait clarifier le rapport entre les associations et leur chef de file, département ou région. On ne peut pas mettre en danger le rôle et la mission publique des associations. Comment les préserver ?
La relation entre les associations gestionnaires et leurs autorités de tarification est un vrai sujet. Le statut même de ces associations a fait l'objet de nombreux débats. Je n'ai jamais vu d'ingérence dans la gouvernance des associations que je dirige. Je doute que cela soit lié à la réforme de l'organisation territoriale.
M. Bas évoque la décentralisation. Nous nous posons plutôt la question de la recentralisation d'un certain nombre de compétences au niveau régional, notamment depuis la création des agences régionales de santé.
Elles ne décident rien. Le délégué territorial de l'ARS dialogue avec les associations, peut s'opposer à certaines décisions, mais ne peut en prendre.
C'est plus compliqué. Certains établissements sont financés par les conseils généraux.

Il y a en effet des établissements à triple tarification, comme les établissements pour personnes âgées : tarification de l'hébergement et de l'allocation personnalisée par le conseil général, et tarification des soins par l'ARS. Mais comment faire autrement ?
C'est pour cela que nous posons la question de la recentralisation de cette compétence au niveau régional. En matière de handicap, les sources de financement ont été empilées au fil du temps. Concrètement, l'impossible fongibilité des budgets pose problème, par exemple pour créer des places médicalisées dans les départements qui ne font que de l'hébergement. Pire : lorsqu'un département a trop de places en établissement et service d'aide par le travail, je ne peux les redéployer sur d'autres types d'établissements en raison de la nature différente des crédits - budget de l'État dans un cas, budget de la sécurité sociale dans un autre. Mais vous avez raison : la question de la recentralisation n'est pas d'actualité, compte tenu des craintes que vous avez mentionnées.

Dans le fonctionnement des établissements, certains domaines relèvent du département, d'autres nécessitent une coordination régionale. Il serait utile de disposer d'une note détaillée sur tous ces sujets.

Nous vous remercions. Vous trouverez dans les débats du Sénat la trace de vos interventions !
La réunion est levée à 13 h 20
La réunion est ouverte à 16 heures