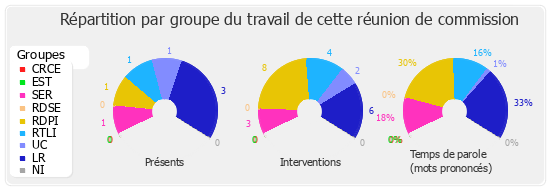Commission des affaires européennes
Réunion du 12 mars 2015 à 10h05
Sommaire
- Justice et affaires intérieures
- Coopération policière dans la lutte contre le terrorisme : communication de m. michel delebarre et de mme joëlle garriaud-maylam (voir le dossier)
- Action de l'union européenne contre les sites internet faisant l'apologie de la violence terroriste : communication de m. andré gattolin et de mme colette mélot (voir le dossier)
- Énergie
- Environnement - suivi des résolutions européennes du sénat - biocarburants : communication de m. jean-yves leconte (voir le dossier)
- Nomination de rapporteurs (voir le dossier)
La réunion

Notre ordre du jour appelle en premier lieu une communication de nos collègues Michel Delebarre et Joëlle Garriaud-Maylam sur la coopération policière dans la lutte contre le terrorisme.
Cette communication est une nouvelle étape dans notre série de travaux que nous avons engagés concernant la lutte contre le terrorisme. Nous formaliserons une proposition de résolution européenne, le 18 mars. Nous pourrons ainsi regrouper les suggestions de nos rapporteurs. Nous finaliserons cette proposition avec la commission des lois, le 25 mars. Elle sera ensuite inscrite en séance publique le mercredi 1er avril.
La coopération policière constitue un enjeu crucial dans la lutte contre le terrorisme. L'action au niveau des États membres est essentielle. Comme le souligne le traité, la sécurité nationale relève de la seule responsabilité de chaque État membre. Le traité indique également qu'il est loisible aux États d'organiser entre eux et sous leur responsabilité les formes de coopération qu'ils jugent appropriées. Les échanges entre les services de police des États membres sont en pratique nombreux souvent sur un mode bilatéral.
Parallèlement, l'Union s'est dotée de différents outils afin d'assurer un niveau élevé de sécurité comme l'exige le traité. On songe en particulier à l'agence Europol, à laquelle une délégation de notre commission a rendu visite l'an passé.
La mise en oeuvre opérationnelle de ces outils apparaît toutefois insuffisante. Les renforcer est donc une exigence pour rendre la lutte contre le terrorisme plus efficace au niveau européen.
Je passe la parole à nos rapporteurs.

Évoquons, d'abord, l'évolution de la coopération policière européenne. C'est le traité d'Amsterdam en 1997 qui a fait de l'Union « un espace de liberté, de sécurité et de justice ». Cet espace devait faire l'objet de mesures appropriées, notamment en matière de prévention et de lutte contre la criminalité. Le traité a transféré dans le « premier pilier », c'est-à-dire dans la méthode communautaire, les politiques d'asile, d'immigration et de coopération judiciaire en matière civile. Mais la coopération policière et judiciaire en matière pénale a continué à relever du « troisième pilier », c'est-à-dire du domaine intergouvernemental.
Cette situation a pris fin avec le traité de Lisbonne en 2007. Dans son article 3, le traité sur l'Union européenne (TUE) dispose que « dans ses relations avec le reste du monde, l'Union contribue à la protection de ses citoyens ». Dans son article 4, il énonce que « l'Union respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre. » Quant à l'article 73 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), il précise « qu'il est loisible aux États membres d'organiser entre eux et sous leur responsabilité les formes de coopération et de coordination qu'ils jugent appropriées entre les services compétents de leurs administrations chargées d'assurer la sécurité nationale. »
Mais l'Union européenne n'avait pas attendu le traité de Lisbonne pour créer Europol afin d'activer la coopération policière en Europe.
L'idée de mettre en place un office européen de police remonte à 1991. Elle fut lancée par le Chancelier allemand Helmut Kohl. Le traité de Maastricht de 1992 en a mentionné expressément la création.
La convention instituant cet office a été signée en 1995, ratifiée avec retard par les États membres, et l'office n'a commencé à fonctionner pratiquement que le 1er juillet 1999.
Dès le départ, il n'était pas question de faire d'Europol une sorte de « FBI européen » mais de créer un organe chargé du traitement des renseignements au niveau de l'Europe pour lutter contre certaines formes graves de criminalité transnationale.
L'office était organisé en « étoile » avec :
- une « Unité centrale » située à La Haye et composée d'officiers de liaison des États membres et d'agents d'Europol ;
- des « Unités nationales d'Europol » constituées dans tous les pays membres et servant de relais de transmission entre Europol et les autorités compétentes au niveau national ; pour la France, par exemple, « l'Unité nationale Europol » siège à Nanterre ;
- une « autorité de contrôle commune » indépendante chargée de surveiller l'activité de l'office pour s'assurer que le stockage, le traitement et l'utilisation des données dont disposent les services d'Europol ne portent pas atteinte aux droits des personnes.
Depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam en 2010, l'office européen de police est une agence européenne dotée d'un budget et d'un effectif communautaire. Pour l'heure, le Conseil des ministres JAI est responsable du contrôle global et de la définition des orientations d'Europol. Parmi les grandes priorités qu'il fixe chaque année, on retrouve le terrorisme, le trafic et la production de stupéfiants, la traite des êtres humains, les filières d'immigration clandestine, le trafic d'armes à feu, le blanchiment de capitaux, la criminalité organisée, la cybercriminalité, etc.
Le Conseil désigne le directeur et les directeurs adjoints. Le conseil d'administration d'Europol est constitué d'un représentant de chaque État membre.
Il faut signaler qu'en 2009, une nouvelle décision institutive a prévu que le Parlement européen votera le budget d'Europol et donnera, au directeur de l'office, décharge sur l'exécution du budget ; d'autre part, le Parlement européen peut demander que le président du conseil d'administration et le directeur d'Europol soient auditionnés.
Europol est une sorte de « méta moteur » de recherche, qui contenait, à la fin de l'année 2014, 250 000 documents environ concernant quelque 80 000 personnes. Depuis sa création, l'office a effectué quelque 300 000 recherches et initié plus de 11 000 enquêtes.
J'en viens à la réforme d'Europol.
Le 17 juillet 2013, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement relative à la réforme d'Europol.
Les objectifs annoncés étaient les suivants :
- mettre Europol en conformité avec les exigences du traité de Lisbonne en définissant son cadre législatif et en instaurant un mécanisme de contrôle de ses activités par le Parlement européen en association avec les parlements nationaux en tenant compte de la nécessité de garantir la confidentialité des informations opérationnelles ;
- réformer la gouvernance d'Europol : le conseil d'administration d'Europol pourrait adopter ses décisions à la majorité simple et non plus à l'unanimité comme aujourd'hui ; d'autre part, à côté de l'actuel conseil d'administration, l'office se verrait doté d'un « Comité exécutif » composé d'un représentant de la Commission européenne et de trois autres membres du conseil d'administration élus en son sein ;
- confier au contrôleur européen de la protection des données la supervision du traitement des données à caractère personnel traitées par l'office ;
- intensifier l'échange d'informations entre Europol et les États membres.
On relèvera que la Commission européenne avait initialement prévu la fusion d'Europol et du collège européen de police (CEPOL) en s'appuyant sur une déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission de juin 2012 préconisant « la fusion d'agences lorsque les missions de celle-ci se recoupent et que des synergies peuvent être créées ». Très rapidement, tant le Conseil que le Parlement européen se sont opposés à cette initiative qui a été, semble-t-il, abandonnée.
Mais c'est la question du contrôle parlementaire d'Europol qui a principalement retenu l'attention du Parlement européen et des parlements nationaux. La proposition initiale de la Commission prévoyait que le contrôle des activités d'Europol par le Parlement européen s'effectuerait par l'intermédiaire d'une « cellule de contrôle parlementaire ». Cette cellule spécialisée serait destinataire du rapport d'activité annuel consolidé sur les activités d'Europol, des programmes de travail annuel et pluriannuel, enfin du rapport annuel du contrôle européen de la protection des données sur les activités de contrôle d'Europol.
Après l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté le 29 juin 2011 une résolution européenne soutenant l'idée d'une « commission mixte » composée de représentants du Parlement européen et des parlements nationaux et demandant que les parlements nationaux soient destinataires des mêmes documents que le Parlement européen. Dans une résolution législative du 25 février 2014, le Parlement européen a précisé pour sa part : « Le contrôle des activités d'Europol par le Parlement européen, associé aux parlements nationaux, se fait par l'intermédiaire du groupe de contrôle parlementaire conjoint, issu de la commission compétente du Parlement européen, constitué par des membres titulaires de ladite commission ainsi que par un représentant de la commission compétente du Parlement national de chaque État membre et un suppléant. Les États membres dont le système parlementaire est bicaméral peuvent être représentés par un représentant de chaque chambre. »
En 2013 et en 2014, le Parlement européen et les parlements nationaux se sont accordés sur la solution préconisée par le Parlement européen. Le Sénat sera pour sa part attentif au fait que le « groupe conjoint » devra comporter deux représentants par pays afin de tenir compte des États à système bicaméral.
La procédure dite du « trilogue » est en voie d'achèvement. Selon la présidence lettonne, le projet de règlement sur la réforme d'Europol devrait être adopté définitivement à la fin du premier semestre 2015.
J'évoquerai, enfin, la lutte contre la cybercriminalité.
Dans son dernier rapport pour 2014, le Centre européen sur le cybercrime d'Europol a dressé un bilan de la cybercriminalité. Parmi les principaux enseignements qu'il a tirés de son étude, on relève tout d'abord une « popularisation » de la cybercriminalité.
La cybercriminalité était en effet à l'origine le fait de groupes puissants disposant d'importantes compétences techniques. Désormais, on peut trouver sur la toile des modes d'emploi de la cybercriminalité c'est-à-dire notamment des informations sur les méthodes permettant de s'introduire sur les sites en contournant les verrouillages ou d'inoculer des virus.
Europol considère cette menace comme particulièrement sérieuse. Cette « popularisation », en cassant les barrières à l'entrée du marché de la cybercriminalité, peut donner au piratage une dimension qu'il sera très difficile de juguler.
La seconde menace, identifiée par Europol, concerne les objets connectés. L'agence européenne s'attend à une vague de « cybermeurtres » via le piratage d'objets tels que notamment les pacemakers dont le niveau des impulsions peut être modifié. Ce piratage peut aussi concerner les pompes à insuline ou les défibrillateurs par exemple. Autre possibilité de cybercriminalité par le biais d'objets connectés : les véhicules connectés ou autonomes qui peuvent être transformés en armes létales s'ils venaient à être piratés. Dans son rapport, Europol souligne que « l'Internet des objets représente un nouveau vecteur d'attaque et tous ceux que nous considérons comme criminels travaillent pour l'exploiter. »
Enfin, Europol constate ce qu'il appelle la montée en puissance de l'« Internet caché ». Cet « Internet caché » fournit des solutions d'anonymisation et de chiffrement. Il est un lieu de trafics illégaux comme les drogues, les médicaments, les armes mais aussi les documents d'identité ou les contenus pédopornographiques. Les sites de l'« Internet caché » sont aussi des lieux où peuvent s'échanger des informations sur les « exploits de piratage » ou les failles des objets connectés.
Europol estime que le droit européen doit très rapidement s'adapter aux évolutions des menaces de la cybercriminalité. Il relève que la grande majorité des sites ou des hébergeurs sont installés en dehors du territoire de l'Union européenne, le plus souvent dans des pays qui ne disposent pas des outils juridiques permettant une lutte efficace.

Je voudrais maintenant évoquer la lutte antiterroriste.
Tous les ans, au mois de mai, Europol publie un rapport annuel sur la lutte antiterroriste. La publication de mai 2014 concerne donc l'année 2013. Au cours de cette année, précise le rapport, on a répertorié :
- 7 personnes décédées sur le territoire de l'Union à la suite d'attaques terroristes ;
- 152 attaques terroristes ;
- 537 arrestations ; le nombre d'arrestations a d'ailleurs presque doublé entre 2012 et 2013 ;
- des poursuites judiciaires pour faits de terrorisme qui ont concerné 313 personnes.
Pour l'office européen de police, la France est un des pays européens les plus exposés au risque terroriste. En 2013, 225 personnes y ont été arrêtées pour cause d'activités terroristes (sur un total européen de 537 !) ; 63 actes terroristes y ont été identifiés (sur un total européen de 152 !).
À la fin de l'année 2013, Europol estimait qu'entre 1 200 et 2 000 Européens étaient retournés sur le territoire de l'Union après un séjour sur un des théâtres d'opérations du Moyen-Orient ; dans le cas de la France, sur l'année 2013, cet effectif aurait augmenté de 75 % en quelques mois.
Un point sur l'opération « Archimède ».
Entre le 15 et le 23 septembre 2014, Europol a procédé à une opération sans précédent contre le crime organisé. Cette opération « Archimède » a mobilisé plus de 20 000 policiers et a été menée dans toute l'Europe. Coordonnée par l'office, elle a associé les 28 pays de l'Union européenne, les États-Unis, l'Australie, la Suisse, la Serbie et la Colombie, mais aussi Eurojust, FRONTEX et Interpol.
Neuf secteurs du crime organisé étaient particulièrement visés parmi lesquels le trafic d'êtres humains, le trafic de cocaïne et d'héroïne, l'organisation de l'immigration illégale et la cybercriminalité.
L'opération a débouché sur 1 027 arrestations, le sauvetage d'une trentaine d'enfants, ainsi que la saisine de 600 kg de cocaïne, 200 kg d'héroïne et 2 300 kg de cannabis.
Pour Rob Wainwright, le directeur d'Europol, « Il s'agit de la plus importante attaque coordonnée jamais organisée en Europe contre le crime organisé. Nous avons voulu nous attaquer à l'infrastructure dans son ensemble et non à de simples cas isolés. La communauté des forces de l'ordre est montée à bord de cette opération pour répondre à ces menaces de manière plus forte que nous l'avions fait jusqu'à présent. Des entreprises criminelles parmi lesquelles les plus graves ont été perturbées à travers l'Europe. »
Nous souhaiterions, en conclusion, formuler un certain nombre de propositions qui seraient, selon nous, de nature à améliorer notre dispositif de coopération policière en Europe pour renforcer la lutte contre le terrorisme.
Ne sera pas abordée ici la question du Code frontières « Schengen » ni celle du PNR puisque ces sujets ont déjà été traités par nos collègues André Reichardt et Simon Sutour même s'il est évident que l'amélioration du contrôle des entrées et des sorties dans l'espace Schengen, responsabilité partagée au niveau de l'Union européenne, conditionne l'efficacité de la coopération policière.
Notre première proposition concernera Europol. On sait qu'Europol est avant tout un instrument de collecte et d'échange de données. Mais cet instrument ne peut fonctionner que s'il est alimenté par les États. On sait qu'à cet égard, certains États de l'Union sont plus actifs que d'autres. Nous pensons qu'il conviendrait de mieux exploiter les capacités d'Europol en faisant en sorte que les services nationaux des États membres fournissent plus systématiquement les informations nécessaires. Une nouvelle législation européenne, peut-être plus contraignante, pourrait être de nature à améliorer la situation.
Nous savons que le siège d'Europol abrite un Centre européen sur le cybercrime qui constitue un outil plutôt performant notamment dans la lutte contre la criminalité organisée sur Internet. Nous souhaitons que le Centre inscrive dans ses priorités, au même titre que la lutte contre la diffusion d'images et de vidéos pédopornographiques, la lutte contre la diffusion de la propagande et du prosélytisme terroristes. Dans ce cadre, il nous paraîtrait intéressant de créer, au sein d'Europol, une unité européenne sur le modèle de la « plate-forme de signalement » française PHAROS pour porter certains contenus terroristes ou extrémistes à l'attention des réseaux sociaux aux fins de leur suppression.
Autre proposition : elle concerne les équipes communes d'enquête. Celles-ci ont été créées par une décision-cadre du Conseil en 2002. Elles associent pour des opérations limitées dans le temps des personnels d'un ou plusieurs États membres auxquels peuvent se joindre des représentants d'Europol, d'Eurojust ou même d'Interpol. Dans la lutte contre le terrorisme, nous estimons que ces structures pourraient être efficaces et nous proposons de mettre en place des dispositifs facilitant le recours, par les États membres, à ces équipes communes d'enquête.
Nous voudrions aussi souligner la nécessité de tarir les sources de financement du terrorisme, en particulier à travers le blanchiment des capitaux et le trafic d'armes. À cet effet nous demandons au Gouvernement de favoriser l'adoption rapide de la proposition de 4e directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. En ce qui concerne le trafic d'armes à feu, la Commission européenne a annoncé de nouvelles propositions législatives pour 2015. Nous souhaiterions que le Gouvernement soit vigilant sur les suites qui seront données à cette annonce.
Enfin, nous appelons de nos voeux une évaluation systématique de l'efficacité de l'ensemble des instruments dont dispose actuellement l'Union européenne pour lutter contre le terrorisme. L'ensemble des instruments, cela signifie bien sûr les législations mais aussi les agences ou autres organismes européens qui oeuvrent dans le domaine de la sécurité intérieure du territoire de l'Union européenne. Rappelons que cette procédure d'évaluation systématique est prévue par l'article 70 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Je voudrais faire plusieurs observations. Tout d'abord, j'ai le sentiment que nos formations en informatique ne sont plus à la hauteur des enjeux au regard des questions de sécurité informatique. Nos programmeurs et nos informaticiens n'ont pas été formés aux questions de sécurité. Nous devons, par exemple, lutter contre les « back-doors » qui sont des portes d'entrée privilégiées pour le piratage informatique. Nos politiques européennes de formation sont trop segmentées alors que nous devrions disposer d'une véritable approche européenne de l'Internet. Je plaide pour une formation à la sécurité informatique dans le cadre du programme européen « Erasmus ». Ce dont nous avons véritablement besoin, c'est d'une « culture européenne de la sécurité informatique ».
S'agissant d'Europol, je me demande si la réforme de la gouvernance, avec notamment la règle de la majorité simple au conseil d'administration de l'office, ne risque pas d'avoir un effet dissuasif sur la coopération policière entre les États membres. N'oublions pas que nous sommes dans un domaine qui reste, à bien des égards, très régalien.
Enfin, je soulignerai l'importance des moyens financiers et humains. Europol voit son champ d'intervention constamment élargi alors que son budget reste constant depuis plusieurs années.

En tant que membre de la commission sénatoriale d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux « djihadistes », je constate que le partage d'information en matière policière entre les pays est souvent difficile. J'ai compris qu'Europol était avant tout un grand fichier informatisé et pour reprendre une expression qui a été utilisée un « méta moteur de recherche ». Mais est-il suffisamment alimenté ? Les États membres transmettent-ils toutes les informations nécessaires ? En bref, peut-on considérer que l'office européen de police fonctionne bien ?

Je m'interroge, quant à moi, sur le point de savoir si les organismes européens tels qu'Europol savent faire preuve d'anticipation par rapport aux problèmes qui se posent en matière de sécurité intérieure. Je relève aussi qu'un nombre non négligeable d'États européens considèrent que leur sécurité dépend avant tout du « protecteur américain ». Cette vision n'est pas sans conséquences sur le fonctionnement des services de police ou du renseignement desdits États ainsi que sur la coopération européenne !

Je pense, comme M. André Gattolin, que la question des moyens est fondamentale pour un organisme tel qu'Europol. Je rappelle que nous souhaitons une nouvelle disposition législative, plus contraignante, pour faire en sorte que les services nationaux des États membres fournissent plus systématiquement les informations nécessaires à l'office européen. La recherche et le développement devraient aussi être renforcés à Europol. Je soutiens avec force l'idée de créer une formation à la sécurité informatique dans le cadre du programme européen « Erasmus ». Je voudrais aussi souligner la nécessité d'assurer aux spécialistes en la matière un meilleur niveau de rémunération : pourquoi ne pas utiliser, dans ce domaine, la « réserve citoyenne d'appui aux écoles et aux établissements scolaires » que la ministre chargée de l'éducation nationale a prévu de créer dans chaque académie ? Autre piste de réflexion : la coopération policière est parfois très efficace au niveau infra-étatique. Il m'a été dit à New York que des liens très étroits existaient à cet égard entre la ville de New York et d'autres grandes villes comme Paris, Barcelone ou Madrid. Sur la gouvernance d'Europol, la réforme envisagée pourrait avoir l'effet souhaitable d'accélérer les procédures.

Je voudrais exprimer une inquiétude : trop souvent les meilleurs étudiants en mathématiques choisissent de devenir informaticiens pour améliorer leur situation professionnelle. Il y a certainement des éléments à revoir dans notre système éducatif.

Le président Jean Bizet a raison. Beaucoup de bons mathématiciens français s'installent à la City de Londres par exemple !

Ce sont les responsables d'Europol, eux-mêmes, qui considèrent que l'office européen de police est un « méta moteur de recherche ». C'est un système qui fonctionne en « gigogne ». Je voudrais aussi signaler que l'Union européenne coopère de façon très satisfaisante avec des pays comme la Norvège ou les États-Unis dans le domaine policier. Il reste que ce domaine, régalien par excellence, pose parfois des problèmes délicats. On connaît tous la guerre des polices. Elle existe aussi entre les États membres notamment en matière de cybercriminalité. Il faut donc rester prudent. Une véritable intégration européenne dans le domaine de la police est un long parcours.

Merci à tous pour ce débat très riche. Je propose que la proposition tendant à créer une formation à la sécurité informatique dans le cadre du programme européen « Erasmus » soit intégrée dans la résolution européenne sur le terrorisme.

Nous allons maintenant entendre une communication de nos collègues André Gattolin et Colette Mélot sur l'action de l'Union européenne contre les sites Internet faisant l'apologie de la violence terroriste.
Cette communication constitue le dernier volet de nos réflexions sur ce thème avant l'examen, le 18 mars, de la proposition de résolution européenne.
Nous savons que, malheureusement, Internet est un outil privilégié d'embrigadement et d'apologie des crimes terroristes. L'action contre ces sites doit bien sûr déjà se faire au niveau national. Je rappelle que la loi du 13 novembre 2014 a prévu des procédures administratives qui permettent d'obtenir des fournisseurs d'accès le filtrage de sites internet diffusant des contenus illégaux.
Mais cette action doit aussi nécessairement se déployer au niveau européen et international. Nos rapporteurs vont donc nous expliquer ce que fait l'Union européenne dans ce domaine et ce qu'elle pourrait faire pour contribuer à éradiquer cette propagande odieuse et inacceptable.
Je leur donne la parole.

Le terrorisme djihadiste qui frappe la France et l'Europe a su faire sien ce dont on parlait encore il y a quelques années comme d'une révolution, l'Internet et le numérique. Et il en utilise les différents aspects : Internet permet tout à la fois aux djihadistes de porter des attaques contre nos systèmes d'information, mais aussi et surtout de diffuser leur propagande. Ils le font avec une facilité, une ampleur et une vitesse que seuls permettent aujourd'hui les plateformes de diffusion et les réseaux sociaux, et souvent dans un relatif anonymat et avec une absence de contrôle et de régulation des contenus.
Avant d'évoquer avec vous ce second point, je laisse André Gattolin vous montrer pourquoi et comment il nous faut renforcer la sécurité de nos systèmes d'information.

Lorsque nous avons été chargés de cette mission sur la lutte contre le terrorisme sur Internet, j'ai proposé que nous étudiions la question de la cybersécurité et des cyberattaques afin de déterminer si elles étaient le fait ou non de terroristes djihadistes. C'est également pour nous l'occasion d'évoquer le projet de directive européenne sur la sécurité des réseaux et de l'information, en discussion à Bruxelles depuis plus de deux ans déjà et qui avait été l'objet d'une résolution du Sénat adoptée le 19 avril 2013, à l'initiative de Jacques Berthou et Jean-Marie Bockel.
Actuellement, parmi l'ensemble des cyberattaques constatées, il est difficile de distinguer celles qui sont le fait de terroristes, dans le sens où il ne s'agit pas d'un phénomène majeur, ou du moins pas encore. Les cyberattaques sont surtout perpétrées par des criminels de droit commun qui détournent des biens ou des fonds.
À côté de ces cybercriminels de plus en plus rompus techniquement, les djihadistes ne doivent pas pour autant être négligés bien qu'ils semblent, pour l'instant, à un stade moins avancé. L'objet de leurs attaques est autre, ils visent le plus souvent l'accès à l'information. On peut, à ce titre, évoquer l'attaque qu'a subie le journal Le Monde au début de l'année. Mais on peut très bien imaginer qu'une attaque qui viserait à désorganiser n'importe lequel de nos systèmes d'information (administration, grand groupe privé) puisse être mise en oeuvre dans le but de créer la panique ou le désordre dans la population.
Nous avons auditionné Jean-François Beuze, qui est le président de Sifaris, une entreprise spécialisée dans la gestion des risques des systèmes d'information (elle assure la sécurité de grands établissements financiers et, par ailleurs, de Charlie Hebdo). Pour lui, « les djihadistes sont dans un mode start-up ». En effet, même si cette « cyber-activité » semble encore naissante, les terroristes disposent de compétences et d'outils, et ont largement la capacité de trouver les moyens financiers pour assurer leur plein essor. Dès lors, la menace peut facilement et rapidement atteindre une ampleur critique. Ceci est d'autant plus probable que ces djihadistes pourraient recruter des mercenaires pour réaliser ce « travail », si l'on peut dire les choses comme cela.
Face à cette menace, quels sont nos moyens de défense ?
Tout comme en matière de police, la cybersécurité relève d'abord de la responsabilité des États. Depuis 2009, notre pays dispose d'une Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Selon Guillaume Poupard, son directeur général, l'Exécutif français a pris la mesure du danger que représentent les cyberattaques pour la France. Ainsi, l'Agence, qui a vu ses effectifs passer de 100 à 400 personnes en 5 ans, dispose de moyens assez significatifs pour protéger non seulement les administrations, mais aussi ce qu'on appelle des acteurs de taille critique.
Cependant, tous les pays européens ne sont pas aussi avancés dans la lutte contre les cybermenaces. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-Bas font également partie des pays dits en capacité. On peut encore y ajouter la Suède, le Danemark, voire la Norvège bien qu'elle ne fasse pas partie de l'Union européenne. On peut aussi évoquer l'Estonie qui avait subi une violente attaque en 2007, l'Espagne qui s'est impliquée plus tardivement mais qui depuis s'investit beaucoup et, enfin, l'Italie, dont les grands groupes privés sont compétents sur le sujet. Les autres pays estiment, en revanche, qu'ils ne disposent pas des moyens suffisants pour assurer leur cyberdéfense et préfèrent se tourner vers l'OTAN ou l'Union européenne. Pour cette raison, l'adoption prochaine de la proposition de directive sur la sécurité des réseaux et de l'information est non seulement importante, mais surtout pressante !
Que propose ce texte ? Principalement trois choses :
Tout d'abord, la nécessité pour chaque État membre de désigner une autorité nationale compétente en matière de sécurité des réseaux et de l'information, d'élaborer une stratégie nationale de cybersécurité et d'établir un plan national de réponse aux crises cyber, accompagné de la mise en place d'une équipe dédiée à ces questions.
Deuxièmement, la directive permettrait un renforcement de la coopération européenne en matière de gestion de crise cyber et de réponse aux incidents. Cela passerait par la mise en oeuvre de trois mesures : tout d'abord, la création d'un « réseau européen des autorités nationales de cybersécurité » ; ensuite, l'instauration du principe de notification obligatoire par ces autorités à leurs homologues européens et à la Commission européenne de tous les incidents de sécurité informatique rencontrés au niveau national ; et, troisièmement, la constitution d'un réseau informatique d'échange d'informations sensibles. Je précise que la participation à ce réseau devrait se faire sur la base du volontariat.
Enfin, et c'est capital, le texte promeut l'instauration du principe de notification obligatoire d'incidents informatiques significatifs par les opérateurs économiques d'importance critique visés par la directive-cadre du « paquet » Télécom. Il prévoit également la possibilité pour l'autorité nationale de cybersécurité ou pour des prestataires qualifiés de conduire des audits réguliers.
Cette proposition de directive a été présentée par la Commission européenne le 7 février 2013. Le Conseil et le Parlement européen ont, chacun, adopté une position. Les discussions se font désormais en trilogue avec la Commission. Nous ne pouvons que demander au Gouvernement de favoriser une adoption rapide !

J'en viens maintenant à la question de l'emploi d'Internet pour développer et diffuser un contre-discours face à la propagande djihadiste pour lutter contre la radicalisation. Là encore, bien que Daesh diffuse des vidéos sur l'ensemble de la planète, la réponse est plus souvent nationale. Mais cela ne veut pas dire que l'Europe doit rester inactive, ni qu'elle l'est !
La stratégie de l'Union européenne de lutte contre la radicalisation et le recrutement de terroristes de 2005 a été révisée en 2014. Elle prévoit notamment de renforcer le contre-discours, de lutter contre la radicalisation sur Internet, d'impliquer l'ensemble des acteurs de première ligne, et de soutenir les travaux du réseau européen de sensibilisation à la radicalisation (RSR, ou RAN pour l'acronyme anglais Radicalisation Awareness Network). Des lignes directrices, qui déclinent cette stratégie, ont été adoptées au Conseil JAI des 4 et 5 décembre 2014. Elles encouragent par exemple l'élaboration de campagnes de communication ciblées au niveau de l'Union, la création d'un forum avec les acteurs majeurs (publics et privés de l'Internet) ou le soutien aux initiatives de désengagement.
Le RSR a été créé en 2011 par la Commission européenne et organise son activité autour de huit groupes de travail composés de praticiens européens d'horizons très divers et impliqués dans la problématique de la radicalisation. Son objectif est de faire émerger des pratiques innovantes en soutien à l'action des États membres. Un groupe s'occupe plus particulièrement du suivi d'Internet et des réseaux sociaux et travaille sur la question de savoir quel contre-message peut être envisagé sur Internet et les médias sociaux, alors que le message djihadiste est largement banalisé. Bien que cet outil soit limité, il présente des vertus et ne doit pas être négligé. Surtout, il convient d'associer pleinement à cette démarche les grandes entreprises d'Internet et des réseaux sociaux comme Google, Facebook, Twitter... Car, que ce soit en Europe ou en Amérique, que ce soient les acteurs publics ou privés, nous manquons de capacité en matière d'élaboration et de diffusion d'un contre-message !
Si l'Europe peut faire beaucoup pour mettre en relation l'ensemble de ces acteurs, elle pourrait s'inspirer de nos voisins britanniques qui ont développé une stratégie de contre-discours depuis plusieurs années déjà. Notre travail nous a montré que la Commission européenne a créé un « groupe d'orientation dédié à la communication stratégique » (SSCAT - Syria Strategic Communications Advisory Team). Il s'agit d'un réseau d'experts - pour la plupart britanniques - qui a pour objectif de proposer des solutions s'insérant dans une logique de contre-discours. Le Service d'Information du Gouvernement, le SIG, participe à ce réseau et c'est une très bonne chose. Certes, là encore, il ne s'agit que de la mise en relation des acteurs et de la diffusion des connaissances, mais je rappelle à nouveau que dans ce domaine, en application du traité de Lisbonne, l'Union européenne ne peut venir qu'en appui de l'action des États membres. Toutefois, ces initiatives méritent d'être mieux connues, car cela montre que l'Union européenne ne reste pas passive face au terrorisme !
Enfin, avant qu'André Gattolin n'aborde la question de la suppression des contenus, et dans la continuité de ce qui a été dit sur la coopération policière par nos collègues Joëlle Garriaud-Maylam et Michel Delebarre, je voudrais mentionner une section spécifiquement dédiée à la surveillance du web, créée par Europol en 2007 et dite « Focal point check the web ». Il s'agit d'une unité qui pratique la recherche d'informations en langue arabe ayant trait au terrorisme islamiste sur Internet en vue de favoriser leur partage entre les autorités compétentes des États membres. La base d'informations « Check the Web » référencie ainsi les sites islamistes observés, les communiqués et les publications diffusés par les organisations terroristes, les traductions et les analyses de ces communiqués et publications. Or, nous avons appris que seules 4 personnes arabisantes travaillent dans cette unité ! On ne peut pas se limiter à cela et face à l'importance qu'a pris le phénomène de radicalisation djihadiste dans nos sociétés, cette section doit voir ses moyens renforcés.

Pour finir, nous voulions évoquer la question de la suppression des contenus faisant l'apologie du terrorisme sur Internet, car c'est la question la plus sensible.
Je rappelle que c'est d'abord en application des règles nationales que cela peut se faire. En l'état actuel, il n'existe pas de législation européenne couvrant à la fois l'apologie du terrorisme et l'ensemble des opérateurs en matière de suppression des contenus illicites sur Internet. Il y a d'ailleurs une certaine hétérogénéité des positions en Europe et notre « modèle » est difficilement exportable. Certains États membres comme la Suède y sont farouchement opposés. D'autres, comme le Royaume-Uni, ont passé des accords avec les grands opérateurs pour supprimer certains contenus. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, prône une collaboration accrue en France comme en Europe avec les grandes entreprises de l'Internet.
Ces acteurs de l'économie mondiale semblent avoir pris conscience que le fait d'être associés à la propagande djihadiste est mauvais pour leur image. Et ils paraissent désormais assez enclins à une certaine forme de régulation. J'ajoute que, comme l'expliquaient différents intervenants lors de la table ronde organisée par la commission d'enquête sur la lutte contre les réseaux djihadistes à laquelle j'ai participé, cette coopération fonctionne, et même bien ! Lorsque, suite à un signalement sur la plateforme PHAROS, l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication demande, par exemple, à Youtube ou Dailymotion de supprimer une vidéo faisant l'apologie du terrorisme, la plupart du temps, ils le font. Et je souligne que, dernièrement, les signalements concernant l'apologie du terrorisme ont explosé sur PHAROS : de 614 en 2013, on est passé à 1 662 en 2014 et près de 30 000 depuis les attentats de janvier !
Une autre piste consisterait à s'inspirer de la législation concernant la pédopornographie : la directive du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, impose aux États membres de faire supprimer les pages Internet contenant ou diffusant de la pédopornographie qui sont hébergées sur leur territoire. Le cas échéant, si ces pages sont hébergées à l'étranger, ce texte enjoint les États de s'efforcer d'obtenir la suppression de ces pages et les autorise à mette en place un blocage de l'accès.
Ce qui a fonctionné pour la pédopornographie, c'est la suppression des contenus sur l'Internet accessible à tous. En revanche, la conséquence a été la migration des pédopornographes vers l'Internet caché qu'on appelle aussi « dark web ». Ils bénéficient là d'un anonymat total et échappent à tout contrôle et même à toute surveillance. Ils y côtoient des trafiquants d'armes, les marchands de drogue, les gens qui font du trafic d'êtres humains, autant de catégories qui emploient comme monnaie d'échange le bitcoin, dont les flux sont difficiles à suivre. Si on décide la suppression complète des pages et des sites Internet faisant l'apologie du terrorisme djihadiste, attention à ce que les conséquences ne soient pas pires que les résultats escomptés !
Le fait que les djihadistes communiquent au grand jour sur Internet est une source d'information précieuse pour nos services de renseignement. Il ne s'agirait pas de les priver d'informations précieuses. À titre d'exemple, en réaction à l'attaque contre Charlie Hebdo, les « Anonymous » ont « défacé » le profile Facebook de 400 djihadistes, privant ainsi nos services du suivi de ces personnes.
Il convient donc de réfléchir à l'équilibre voulu entre surveillance et prévention. C'est la raison pour laquelle une plus grande association des entreprises de l'Internet nous parait être une solution plus efficace.

En effet, qu'ils soient opérateurs, moteurs de recherche ou encore plateformes de diffusion, ces acteurs peuvent jouer un rôle plus important dans l'usage d'Internet. Je pense à la surveillance, au signalement, voire le déréférencement de sites et à la suppression de contenus ou de pages qui seraient contraires à un certain nombre de valeurs ou de principes démocratiques.
Ces entreprises ont, de par l'importance d'Internet aujourd'hui dans la diffusion des informations, une responsabilité dans la lutte contre le terrorisme. On pourrait également évoquer le cryptage des données et leur « interceptabilité ». Certes, après l'affaire Snowden, le contexte est compliqué, mais je crois que l'Europe devra prochainement se poser la question d'une législation sur ce sujet et ses enjeux. La Chine et les États-Unis, pour ne citer qu'eux, ont développé chacun une approche. On ne comprendrait pas que l'Union européenne ne fasse pas de même.
Mais nous devons aussi nous montrer pragmatiques car il nous faut agir vite ! Et une association, une collaboration peuvent être plus rapidement mises en place qu'une législation. C'est pourquoi le Gouvernement devrait proposer que le système de signalement/suppression prévu par PHAROS, et qui passe par le partenariat, puisse connaitre un écho au niveau d'Europol. En complément, il faut véritablement structurer au niveau européen le dialogue avec les géants de l'Internet.

Pouvez-vous nous donner des précisions sur l'internet caché ? Cela semble un système fou...

Cela fonctionne selon un système dit « en onion ». Les connexions sont reportées de point en point de par le monde, de telle sorte qu'il est impossible d'identifier une adresse IP ou un internaute. À cela s'ajoutent le chiffrement et le cryptage des données.
Suite à l'affaire Snowden, qui a montré l'usage par les services de renseignement américains des données recueillies par de grandes entreprises privées américaines, beaucoup de ces grandes entreprises ont perdu en crédibilité. Depuis, elles ont développé des systèmes de protection de leurs données avec chiffrement et cryptage. Il devient très difficile de trouver une information et cela demande des moyens considérables. Alors que chacun, moyennant un petit investissement technique, peut s'équiper d'un système permettant d'accéder à l'Internet caché.
Pour en revenir aux djihadistes, Guillaume Poupard de l'ANSSI nous a montré un « guide du djihadiste sur Internet » qui explique comment se comporter sur le web. Ce qui est frappant, c'est que chaque recommandation est ponctuée d'une Sourate du Coran qui la justifie !

Je partage votre avis sur l'équilibre à trouver entre surveillance et fermeture des sites Internet. Je rappelle que les Britanniques ont choisi non seulement de ne pas fermer certains sites pour les surveiller, mais ils ont même créé de faux sites pro-djihad pour attirer certaines personnes.
J'ai pu rencontrer des représentants de grandes firmes Internet à Washington et je peux témoigner qu'ils sont tout à fait prêts à coopérer et à fermer certains sites. Pour ne prendre que l'exemple de Twitter, j'ai appris que durant la seule semaine dernière, 2 000 comptes de djihadistes ont été fermés et qu'on estime à 90 000 le nombre de comptes diffusant des informations relatives au Djihad. Et suite aux dernières fermetures, les djihadistes ont lancé leur propre système Facebook, qui est évidemment plus difficile à surveiller.
Concernant le contre-discours, je crois qu'il faut aussi s'adresser aux enfants. C'est important.
Enfin, s'agissant des petits États qui ne peuvent pas assurer seuls leur cybersécurité, certes l'Union européenne doit pouvoir les aider, mais je crois qu'il faut qu'ils bénéficient aussi d'une aide des grands pays. Beaucoup n'ont pas les moyens de se défendre et il ne faudrait pas qu'ils deviennent des chevaux de Troie dans l'Union européenne.

En matière de contre-discours, le site du Gouvernement « stop djihadisme » est le contre-exemple de ce qu'il faut faire. Je reviens des États-Unis où j'étais en déplacement pour la commission d'enquête sur la lutte contre les réseaux djihadistes. Pour les Américains, il est clair que ce n'est pas aux États de porter le contre-discours, mais bien aux acteurs du web et aux communautés. J'ajoute que dans ce pays, les différentes communautés, qui ont une place importante dans la société, ont noué des liens très forts avec les géants d'Internet.
Les Américains ont de l'avance sur nous, ils ont commencé à agir après les attentats du 11 septembre 2001 et je pense qu'on peut s'inspirer d'eux. Vous avez évoqué « check the web » et ses quatre personnes arabisantes. Aux États-Unis, c'est 300 personnes qui surveillent le web !
Quant aux services de renseignements, ils estiment que l'on doit utiliser la formidable puissance de ces entreprises et leur faculté d'adresser une réponse personnalisée aux internautes pour atténuer la portée du message djihadiste.

Nous sommes convaincus que nous avons du retard dans la réponse à apporter au message djihadiste. Le site du Gouvernement « stop djihadisme » a été fait dans l'urgence. Il n'est évidemment pas LA réponse. Il doit y avoir d'autres moyens, il faut muscler notre propre message.
Je crois que nous devons insister sur le fait que l'Europe doit s'impliquer beaucoup plus. J'ai travaillé il y a quelques mois sur les Mooc, ces formations en ligne massives et ouvertes. C'est la même chose : nous avons beaucoup de retard, il faut agir et l'Union européenne n'est pas assez impliquée. Sur la lutte contre le djihadisme, il est même urgent d'agir !

Concernant les communautés aux États-Unis, je suis d'accord. Mais il faut bien voir qu'elles disposent d'un véritable statut et de financements par le biais de fondations. Néanmoins, il faut favoriser la création et la diffusion d'un contre-discours par d'autres acteurs que l'État.
Sifaris, l'entreprise que nous évoquions, a passé un accord avec une entreprise qui lui permet d'effectuer une veille par mots-clés dans plusieurs langues et dialectes. Les entreprises privées ont un rôle à jouer dans la lutte contre le terrorisme.

L'ordre du jour appelle une communication de M. Leconte, consacrée au suivi de la résolution européenne relative aux biocarburants, adoptée par notre commission le 10 décembre 2013 et devenue résolution du Sénat le 14 janvier 2014.

Il me paraît utile de rappeler tout d'abord le sens précis des concepts.
Le terme « biocarburant » désigne tout carburant obtenu à partir de la biomasse, par opposition aux produits d'origine pétrolière. Seuls sont concernés aujourd'hui les biocarburants utilisés dans les transports.
Ceux de première génération sont obtenus à partir de produits qui pourraient servir à l'alimentation humaine mais utilisés pour fabriquer du bioéthanol ou du biodiesel. Obsolète aujourd'hui, le vieux terme « agrocarburant » désigne exclusivement cette première génération de biocarburants.
Les biocarburants de deuxième génération sont obtenus par transformation de produits dénués d'usage alimentaire. La principale filière transforme la cellulose, une substance qui représente à elle seule plus de la moitié de toute la biomasse disponible sur terre. Les déchets organiques gras (provenant par exemple d'usines transformant du poisson) permettent d'obtenir du biodiesel ou du biokérosène. Les conditions techniques de la deuxième génération permettent tout juste actuellement d'aboutir en laboratoire à des prix de revient comparables à ceux de la filière pétrolière. L'outil industriel n'est donc pas encore disponible, mais pourrait être créé au cours des années à venir.
Enfin, les biocarburants de troisième génération sont synthétisés par des micro-algues. Ce processus devrait aboutir pendant encore très longtemps à des prix de revient prohibitifs excluant l'usage de tels biocarburants dans les transports.
Les cultures destinées aux biocarburants de première génération sont importantes pour certaines exploitations agricoles. La plus grande entreprise de transformation appartient au président de la FNSEA. Le sujet est donc d'importance pour les pouvoirs publics.
Au plan mondial, seul 1 % de la surface agricole utile sert à cultiver des matières premières utilisées pour obtenir des biocarburants de première génération. J'ajoute que le processus industriel aboutit à un sous-produit destiné à l'alimentation animale, si bien que l'Union européenne s'est approchée aujourd'hui de l'autosuffisance pour l'alimentation du bétail, précisément grâce aux biocarburants de première génération. Il reste qu'au changement d'affectation des sols agricoles directement induit par le remplacement de cultures destinées à l'alimentation par une production à usage de biocarburants, peut venir s'ajouter ailleurs une déforestation permettant de fabriquer des ressources alimentaires qui cessent d'être obtenues sur le terrain ayant subi un changement direct d'affectation des sols. D'où un bilan carbone moins satisfaisant qu'il n'y paraît de prime abord. J'ajoute que les moteurs ne peuvent pas toujours accepter n'importe quel taux d'incorporation de biocarburants. Cela complique l'activité mondiale de l'industrie automobile : la situation est très différente en Chine, en Europe et au Brésil par exemple.
À propos des biocarburants les plus évolués, je souhaite simplement évoquer le risque de voir certains brevets achetés par des pétroliers, afin de neutraliser toute innovation en ce domaine.
Avant d'aborder les principaux points du débat, j'observe enfin que toutes les générations de biocarburants requièrent une certaine surface de sols. L'installation de panneaux solaires offre systématiquement un meilleur bilan carbone.
J'en viens au sort actuellement fait aux trois aspects de la résolution adoptée : le plafond d'intégration des biocarburants de première génération ; la prise en compte du changement d'affectation des sols indirect ; la place faite aux biocarburants de deuxième génération.
Afin d'inciter à la transition des énergies fossiles vers les énergies renouvelables, la directive du 23 avril 2009 fixe à 10 % la part que les énergies renouvelables devront prendre dans la totalité des sources d'énergies utilisées pour les transports au sein de l'Union européenne. Les biocarburants font partie des énergies renouvelables, ce qui justifie leur prise en compte pour apprécier la satisfaction ou non de l'objectif global que je viens de rappeler. Toutefois, le conflit entre alimenter les moteurs et les estomacs incite à ne pas miser exclusivement sur les biocarburants pour que les véhicules dotés de moteurs thermiques satisfassent à l'objectif d'énergies renouvelables.
Le texte initial de la Commission européenne tendait à ramener à 5 % le plafond de prise en compte des biocarburants de première génération incorporés dans les produits distribués à la pompe. En première lecture, le Parlement européen avait remonté cette limite à 6 %. La résolution européenne avait opté pour 7 %, un niveau confirmé par le Conseil.
Mais la nouvelle commission ENVI vient d'adopter un amendement tendant à ramener ce plafond à 6 %. Surtout, sa rédaction reprend une disposition déjà votée en première lecture, tendant à subordonner la prise en compte des biocarburants conventionnels au respect du plafond d'intégration. Cette condition mérite que l'on s'y attarde un peu. Dans la rédaction de la Commission européenne, ainsi que dans celle du Conseil, la prise en compte des biocarburants est limitée au plafond inscrit dans le projet de directive, soit 5 % dans le texte initial et 7 % dans la rédaction du Conseil. Tout État membre était libre d'incorporer plus de biocarburants conventionnels, mais leur prise en compte serait limitée au plafond, soit 7 % selon le Conseil. Or, d'après la version reprise par la commission ENVI, l'éventuel dépassement du plafond supprimerait toute prise en compte des biocarburants conventionnels dans la contribution à l'objectif de 10 % d'énergie renouvelable dans les transports.
J'en viens au changement d'affectation des sols indirect (CASI). Ce phénomène mérite d'être pris en compte, mais le quantifier reste un exercice impossible. Notre assemblée avait donc approuvé la proposition formulée par la Commission européenne tendant à conduire des études complémentaires susceptibles de permettre sa prise en compte ultérieure. En revanche, la nouvelle commission ENVI a réagi de façon particulièrement virulente, bien qu'elle ne possède évidemment pas la maîtrise technique du sujet.
J'aborde ainsi le dernier point traité par la résolution européenne : la place à réserver aux biocarburants de deuxième génération, dont la montée en puissance est souhaitable mais contrariée jusqu'à présent par l'absence d'outil industriel.
Le Parlement européen a introduit un seuil de 2,5 % à l'horizon 2020 lorsqu'il s'est prononcé le 11 septembre 2013 en première lecture. Favorable à l'essor de cette source renouvelable d'énergie, mais réaliste quant aux possibilités à moyen terme, notre commission avait exprimé sa sympathie pour l'objectif de 2,5 % à l'horizon 2020. Le Conseil s'est prononcé en faveur d'un objectif purement indicatif, limité à 0,5 %, assorti d'un coefficient multiplicateur destiné à encourager le décollage de la filière industrielle.
La teneur en biocarburants avancés est le seul thème où la commission ENVI recommande un compromis avec le Conseil, ce qui préfigure vraisemblablement la rédaction définitive de la nouvelle directive.
En conclusion, nous en sommes presque revenus à la fin de la première lecture devant le Parlement européen, où la nouvelle commission ENVI a repris une position identique à celle d'il y a un an et demi malgré le renouvellement du Parlement européen et le changement de rapporteur, M. Torvalds ayant remplacé Mme Lepage.
En définitive, la seule position stable est celle du Conseil, qui n'a guère de raison de se déjuger après avoir très largement revu la mouture issue du Parlement Européen et acceptée par la Commission européenne d'alors.
Il parait donc vraisemblable que l'esprit de la résolution du Sénat soit largement satisfait dans le texte définitif, comme à la fin de la première lecture.

Le sujet est d'importance, puisque 25 000 à 30 000 emplois sont concernés en France. Vous avez eu raison de souligner à quel point il est difficile de quantifier le facteur CASI. D'ailleurs, l'ingénieur agricole qui avait proposé la première valorisation est ensuite revenu sur ses calculs. Cette observation n'enlève rien à l'intérêt du passage aux biocarburants de deuxième génération. J'observe à ce propos que l'instabilité juridique dont la France n'a que trop le secret risque de décourager l'initiative dans un domaine où notre pays est en tête au niveau de l'Union européenne. Le plus pertinent est sans doute d'aller vers la deuxième génération de biocarburants. Mais qui opèrera cette évolution sinon les industriels qui fournissent aujourd'hui les produits de première génération ?

À l'aune de ce qui se passe dans le reste du monde, le débat européen laisse rêveur : alors qu'on fait très simplement le plein de bio-éthanol au Brésil, en Europe on veut développer les énergies renouvelables tout en freinant leur montée en puissance ! Les obstacles auxquels se heurtent les collectivités territoriales qui veulent implanter des éoliennes sont édifiants.

Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler de biocarburants, la méthanisation obtenue à partir de déchets mérite d'être mentionnée aujourd'hui. Le marché d'intérêt national de Rungis comporte une installation exemplaire pour le chauffage de ces installations grâce à la méthanisation. Nous pourrions nous y rendre.

La France n'est pas indépendante sur le plan de l'alimentation, puisqu'1 million d'hectares sont cultivés en Amérique latine pour obtenir du soja destiné aux élevages intensifs de Bretagne.
La guerre des surfaces est une réalité !

La contribution actuelle des biocarburants à notre indépendance énergétique est très relative puisqu'elle représente au maximum 15 % des produits achetés à la pompe. J'observe d'autre part qu'un moteur flex-fuel a un rendement plus faible, d'où une pollution accrue.

Notre débat fait apparaître des lignes de force : la France est un leader européen dans ce domaine ; les industriels ont besoin de stabilité juridique ; l'Union européenne doit avoir des politiques rationnelles. Bien sûr, le Sénat reste très attentif aux travaux du Parlement européen, notamment sur le facteur CASI.

En définitive, les déchets constituent la principale source d'espoir en matière de biocarburants. Encore faut-il que les pétroliers ne gênent pas le progrès de cette filière.

Sur le projet d'une Union des marchés de capitaux, je vous propose de constituer un binôme qui pourrait être composé de Jean-Paul Emorine et Richard Yung.
Eric Bocquet pourrait nous faire un point sur la question de l'application du salaire minimum en Allemagne au transport routier européen.
Pascale Gruny et Patricia Schillinger pourraient analyser la question importante des relations entre l'agence européenne de sécurité des aliments et les agences nationales.
Je vous propose par ailleurs de désigner André Gattolin pour siéger au sein de notre groupe de suivi sur les négociations commerciales avec les États-Unis. La commission des affaires économiques procédera de son côté à une nomination de façon à maintenir la parité entre nos deux commissions.
La réunion est levée à 12 h 05.