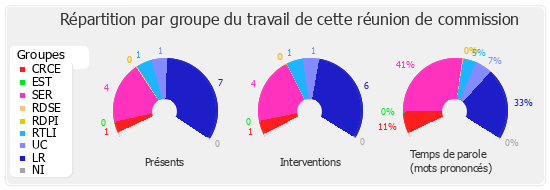Commission d'enquête Évaluation politiques publiques face aux pandémies
Réunion du 2 septembre 2020 à 9h35
La réunion

Mes chers collègues, nous poursuivons nos travaux avec une audition consacrée ce matin aux questions éthiques mises au jour lors de la gestion de la crise sanitaire. Je vous prie d'excuser l'absence de M. le président Milon, retenu dans son département et que je serai amené à remplacer pour les auditions du mois de septembre.
Nous entendons ce matin le docteur Sophie Crozier, neurologue, coordinatrice pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de la démarche éthique, et le professeur Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale, faculté de médecine, président du Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique de l'Université Paris-Saclay, directeur de l'Espace éthique de la région Île-de-France.
Les questionnements éthiques, qui conduisent à mettre en balance des impératifs entre lesquels il est difficile d'établir une hiérarchie, sont revenus à plusieurs reprises dans nos travaux à propos de ce que certains ont appelé le tri des malades, mais aussi du confinement des résidents dans les Ehpad ou encore, plus classiquement, à propos des essais cliniques.
Je vais maintenant, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, vous demander de prêter serment. Je rappelle que tout témoignage mensonger devant une commission d'enquête parlementaire serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du code pénal.
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, Mme Sophie Crozier et M. Emmanuel Hirsch prêtent serment.
Je tiens d'abord à vous remercier de me donner l'opportunité d'échanger avec vous sur quelques-unes des nombreuses questions éthiques qui se sont posées durant la crise sanitaire.
Je m'exprimerai principalement aujourd'hui en tant que médecin hospitalier de terrain impliqué dans la démarche éthique au quotidien au sein de l'AP-HP, ainsi qu'en tant que coordinatrice au sein de l'AP-HP. Cette structure met en relation les différentes structures éthiques de l'AP-HP, en permettant un partage d'expérience. Je m'exprimerai également au nom de mes collègues, qui m'ont transmis de nombreux témoignages.
En tant que coordinatrice de la démarche éthique, je vous ferai part de l'enquête qui a été menée. Les résultats sont en cours d'analyse, et je pourrai vous les communiquer par la suite. Il s'agit principalement d'évaluer le rôle des structures éthiques des hôpitaux durant la crise.
Par ailleurs, j'ai participé aux travaux réalisés par l'Espace éthique Île-de-France, que le professeur Emmanuel Hirsch évoquera plus longuement. Surtout, en tant que membre du Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, j'ai participé à des groupes de travail ayant rédigé, du 13 mars jusqu'à fin mai 2020, des contributions au sujet des décisions prises en matière de confinement et de déconfinement. Elles sont accessibles sur le site du CCNE.
Il me semble aujourd'hui plus intéressant d'évoquer quatre grandes questions éthiques qui se sont posées aux professionnels de santé. Je tiens à le préciser, nombre des questions éthiques soulevées durant cette période sont des questions « habituelles », si l'on excepte l'une d'elle, sur laquelle je reviendrai. Elles ont pris une ampleur un peu particulière du fait de l'importance de la situation.
Je centrerai mon propos sur les pratiques soignantes. Tout d'abord, nous nous sommes interrogés sur les pratiques soignantes dégradées, dans un contexte de tensions liées à des pénuries : comment respecter les valeurs soignantes, face à un rationnement lié à un manque de moyens chronique ? Ensuite, j'évoquerai la priorisation et le tri, pratiques également habituelles liées à des moyens limités. Par ailleurs, les décisions prises, l'information et la communication constituent un enjeu important, pour les professionnels de santé, du questionnement éthique. Enfin, question moins habituelle, nos missions ont-elles changé durant cette crise, notamment en termes de sacrifice individuel au nom de l'intérêt collectif ? En effet, vous le savez, les soignants ont mis leur vie en danger durant la pandémie.
S'agissant des pratiques soignantes « dégradées », terme utilisé dans la contribution du Comité consultatif national d'éthique du 13 mars dernier, il est important de rappeler que l'épidémie s'est déroulée et se déroule toujours dans des conditions de tension importantes dans les structures hospitalières publiques, liées à des restrictions budgétaires, des fermetures de lits, une insuffisance du nombre de personnels soignants, qui ont donné naissance à ces pratiques dégradées.
La crise a aggravé la situation : d'une part, l'hôpital n'a pas pu faire face à la prise en charge des patients Covid et de tous les autres patients ; d'autre part, certains moyens ont cruellement manqué.
Il est en effet admis aujourd'hui qu'il existait, malgré une mobilisation des pouvoirs publics durant la crise, une réelle pénurie de matériel de protection, de moyens humains, de lits, de respirateurs et de médicaments, ce qui a conduit les soignants à prendre en charge des patients dans des conditions extrêmement difficiles, avec des procédures dites dégradées et affichées comme telles. Nous recevions régulièrement des procédures qui s'adaptaient à la pénurie, qu'il s'agisse des masques ou des médicaments.
Nous avons dû réorganiser complètement nos hôpitaux et déplacer du personnel soignant, lequel ne disposait pas toujours des compétences requises au regard des missions qui lui étaient confiées. Cela a engendré non seulement une grande anxiété chez les soignants, mais aussi une possible perte de chances pour les patients.
J'évoquerai également la pénurie de médicaments, notamment dans certains traitements utilisés en réanimation. Je pense aux sédatifs comme le midazolam, qui est aussi utilisé pour assurer les fins de vie. Une telle situation a abouti à la modification de la procédure des prises en charge, et à l'utilisation de molécules que nous n'avions pas l'habitude d'utiliser, ce qui a abouti à une prise en charge dégradée, puisque nous n'avons pas pu assurer un accompagnement correct des symptômes d'inconfort.
Autre exemple de tensions très fortes entre les principes fondamentaux des soignants et les décisions prises par des commissions et des tutelles parfois éloignées du terrain, la question des visites, en particulier dans des situations de fin de vie. Dans certains cas, les visites n'étaient autorisées qu'après le décès, ce qui a été extrêmement difficile pour les familles et les patients.
Une telle interdiction a-t-elle eu plus d'effets positifs que négatifs ? Comment être sûrs que ces mesures restrictives privilégient vraiment l'intérêt collectif ? Cette question rejoint bien évidemment celle des visites dans les Ehpad. L'isolement n'a-t-il pas eu un effet particulièrement délétère ? Même s'il est difficile à évaluer, la question mérite d'être posée. Le CCNE, qui a d'ailleurs été saisi de ces questions fin mars, a rendu une contribution précisant qu'une réflexion au cas par cas était essentielle, en s'appuyant sur l'intérêt individuel des patients et de leurs proches.
Autre sujet, les transferts de patients dans des régions parfois très éloignées - je me fais l'écho des représentants des usagers - se sont avérés extrêmement compliqués, la participation des patients et des familles étant quasiment absente.
Pour autant, le maximum a été fait avec les moyens disponibles. Nous avons géré la pénurie, en faisant le moins mal possible, en nous appuyant sur une immense conscience professionnelle des soignants, une solidarité et un dévouement incroyables, malgré des risques majeurs particulièrement angoissants, ainsi qu'une capacité de réorganisation au prix de reports ou d'annulations de jours de congé. Je tiens ici à rendre hommage à tous mes collègues qui se sont mobilisés pour faire face à cette crise.
La quasi-totalité des moyens humains et matériels a été redistribuée au secteur Covid, au détriment des autres patients, ce qui pose l'une des questions éthiques les plus importantes, celle de la priorisation.
Je le précise, la priorisation des patients durant la crise a existé. Il serait inexact et malhonnête de la nier. Elle a d'ailleurs toujours existé, les ressources en santé, en particulier les lits de réanimation, n'étant pas illimitées. Ce sujet - le triage - a fait l'objet de nombreuses publications. Il se fonde sur des critères plus ou moins explicites selon les pays, les hôpitaux et les praticiens. En réalité, la véritable question éthique, c'est de savoir sur quels critères ces choix ont été faits. Comment peut-on les justifier ? Il conviendra d'analyser les retours d'expériences et les éventuelles pertes de chances.
Dans le texte émis par le Comité consultatif national d'éthique en mars 2020, cette question a été soulevée de façon très claire. La réponse apportée était la suivante : « Des moyens pérennes supplémentaires sont désormais une absolue nécessité, plus particulièrement pour faire face à la crise sanitaire en cours [...]. Pour les formes graves, il faut envisager l'éventualité que certains moyens techniques et humains deviennent limitants si la crise épidémique s'accroît de façon majeure. Les ressources telles que les lits de réanimation et leur équipement lourd sont déjà des ressources rares qui risquent de s'avérer insuffisantes si le nombre de formes graves est élevé. Ainsi, lorsque des biens de santé ne peuvent être mis à la disposition de tous du fait de leur rareté, l'équité qui réclame une conduite ajustée aux besoins du sujet se trouve concurrencée par la justice au sens social qui exige l'établissement des priorités, parfois dans de mauvaises conditions et avec des critères toujours contestables : la nécessité d'un «tri» des patients pose alors un questionnement éthique majeur de justice distributive, en l'occurrence pouvant se traduire par un traitement différencié des patients infectés par le Covid-19 et ceux porteurs d'autres pathologies. Ces choix devront toujours être expliqués, en respectant les principes de dignité de la personne et d'équité. Il conviendra aussi d'être vigilant à la continuité de la prise en charge des autres patients. »
Au-delà de ces questions de triage, je voudrais revenir sur un point qui me semble important et qui n'a peut-être pas été perçu comme une forme de priorisation. Je pense à la priorisation effectuée dans le cadre de la réorganisation de nos hôpitaux, à savoir l'organisation des plans blancs. Il a en effet été décidé qu'il convenait de réorganiser tous nos moyens en faveur des patients malades du Covid. Ainsi tous nos services se sont-ils réorganisés courant février : fermeture des activités chirurgicales et des consultations. Pour tous les autres patients souffrant de maladies chroniques ou aiguës, l'accès aux soins, qu'il soit assuré par l'hôpital ou la médecine libérale, n'a pas été possible pendant cette période.
Pour ma part, je suis responsable d'une unité de soins intensifs neuro-vasculaires prenant en charge des AVC. Mon service a constaté une réduction de 70 % des admissions pour des accidents vasculaires cérébraux. Le constat a été le même dans le monde entier. Pour ce qui concerne les maladies chroniques, les dépistages de cancer ont été beaucoup moins fréquents, tout comme les diagnostics de cancer, y compris chez l'enfant.
L'accès aux soins pour tous les autres patients, qu'il s'agisse des hospitalisations, des consultations, des diagnostics, du suivi ou de la prise en charge du handicap, a donc été extrêmement difficile. La vie de certaines personnes mérite-t-elle plus d'être vécue ? Ainsi, le décompte quotidien des morts du Covid pouvait interroger sur la priorisation et la valorisation de ces morts par rapport aux autres causes de décès. En d'autres termes, on pouvait se poser la question de savoir si la mort d'un patient Covid était plus importante ou avait plus de valeur que la mort d'un autre patient.
En réalité, la question éthique qui me semble essentielle est celle de savoir comment, lors de l'élaboration des plans blancs, ces questions ont pu être posées. Comment prioriser tel ou tel patient ? Quelle place laisser aux patients et à leurs représentants dans ces choix ?À ma connaissance, la démocratie sanitaire a été très absente durant cette crise, les patients et les représentants des usagers n'ayant pas été, dans la majorité des cas, associés aux choix effectués.
Mon troisième point aura trait aux décisions, à l'information et à la communication. Nous avons ainsi été confrontés à une tension éthique concernant la loyauté des recommandations édictées. S'agissant du port du masque, l'information et la communication ont été tellement contradictoires que cela a engendré un climat de doute. Depuis le début, un certain nombre de citoyens et de soignants estimaient nécessaire, conformément à un principe éthique majeur dans les situations d'incertitude, de prendre des mesures de précaution et de se protéger, y compris avec un morceau de tissu, comme les Italiens. Or nos recommandations ont varié dans le temps en fonction de l'évolution de la pénurie.
Pourquoi ne pas avoir assumé le manque de moyens ? Était-il plus dangereux de dire la vérité ? Pourquoi avoir voulu cacher la situation ? Quelles conséquences auraient eu la révélation de la pénurie ? Dans ce contexte, l'héroïsation et le vocabulaire militaire prennent tout leur sens : les soignants étaient des héros partant au front, dans la mesure où nombre d'entre eux mettaient leur vie en danger.
Le CCNE a abordé ce point dans le cadre de sa première contribution. Certes, l'absence de protection par des masques ou des surblouses aurait pu aboutir à un droit de retrait catastrophique pour la prise en charge des patients. Quoi qu'il en soit, la question mérite d'être posée.
À mon sens, le manque de matériel de protection et de tests a conduit à une forme de sacrifice des soignants, au nom de l'intérêt collectif. Or les soignants, contrairement aux militaires, n'ont pas signé pour cela ! Ils n'ont pas toujours bien vécu une telle héroïsation au regard des sacrifices imposés.
Nos missions de soignants ont-elles changé pendant la crise ? Un professionnel de santé doit-il être prêt à donner sa vie pour ses patients ? Peut-on demander de tels sacrifices à des professionnels de santé pendant une crise ? Ces questions méritent d'être discutées avec les acteurs de terrain, en toute transparence. Dans ce cadre, serons-nous capables d'affronter une nouvelle vague ou, dans quelques années, une nouvelle crise ?
J'en arrive à ma conclusion : que retenir des questions éthiques soulevées durant la crise ? Cette dernière a mis en lumière le manque de moyens de l'hôpital public et l'insuffisance en matière d'anticipation. Certes, il est très probable que des leçons soient tirées en matière de mesures de protection. Comment continuer à ne pas donner les moyens qui sont nécessaires à l'hôpital ?
Les professionnels de santé ont dû faire face à des dilemmes éthiques majeurs, notamment de priorisation contrainte, dans un contexte de grande fragilité de l'hôpital. Je le souligne, la démarche éthique a fonctionné dans les hôpitaux qui avaient déjà des structures éthiques. Sinon, ces dernières ont été peu associées aux cellules de crise, et simplement sollicitées pour répondre à deux questions : celle des limitations et des arrêts de traitement, à savoir l'accompagnement des patients qui n'étaient pas admis en réanimation, et celle des visites. Très clairement, la démarche éthique nécessite d'être développée.
Par ailleurs, la participation des soignants de terrain et des usagers a été très insuffisante. Ce manque de démocratie sanitaire nous questionne. Certes, il y avait urgence, mais on peut se demander si l'anticipation n'aurait pas permis de remédier à une telle situation.
Il convient donc de renforcer les moyens humains et d'anticiper les besoins. Il faut plus de démocratie sanitaire et une communication plus loyale. Il est nécessaire de placer la réflexion éthique au coeur de la gestion de la crise.
professeur d'éthique médicale, faculté de médecine, président du Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique de l'université Paris-Saclay, directeur de l'Espace éthique de la région Île-de-France. - Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de m'associer à votre réflexion, dont nous attendons beaucoup. L'approche éthique est une approche démocratique, qui a été au rendez-vous. Le Président de la République a fait le choix courageux de prendre en compte les vulnérabilités, ce qui a suscité de nombreux débats sur l'impact économique et sociétal. Mais la concertation a fait défaut, et nous l'attendons.
Nous avons la chance de bénéficier d'un Conseil scientifique Covid-19 présidé par le président du Comité national consultatif d'éthique, Jean-François Delfraissy, qui rend des avis tout à fait importants. Le 27 juillet dernier, il a soulevé, dans son avis, trois questions éthiques de fond, à savoir la gouvernance opérationnelle - information, acceptabilité du débat, concertation -, l'actualisation de la concertation, toujours chaotique et décevante aujourd'hui, et la participation citoyenne. À cet égard, permettez-moi de faire référence aux années sida, avec la mobilisation du tissu social et associatif.
Je vous présenterai un court diaporama. En matière d'éthique, il n'est pas possible de parler de manière distancée, chacun ayant ses conceptions et ses valeurs. Celles de notre République ont été en grande partie défendues par l'État, les professionnels de santé, mais aussi l'ensemble de la société, on ne l'a pas assez souligné. Vous retrouverez le plan de mon intervention dans le diaporama.
S'agissant des principes, je conteste l'affirmation selon laquelle on ne pouvait pas se préparer. D'ailleurs, certains se sont préparés. La vraie question est de savoir s'ils ont été sollicités, notamment dans le champ éthique.
Un consensus sur des valeurs éthiques partagées sera indispensable pour préserver la cohésion de la société, dont certains indices peuvent aujourd'hui nous faire douter.
Dans son avis remarquable du 5 février 2009 intitulé Questions éthiques posées par une possible pandémie grippale, le CCNE affirme : « La préoccupation de l'Espace éthique de l'AP-HP rejoint celle des deux instances élaborant conjointement le plan pandémie grippale en France, qui soulignent l'importance de construire ce plan sur des valeurs éthiques partagées. » Qu'avons-nous mis en place à cet égard, tant aux niveaux sociétal que professionnel ?
Une situation aussi exceptionnelle pourrait conduire à remettre en question la hiérarchie des valeurs qui fondent les recommandations relatives à l'éthique, notamment dans le domaine de la santé. Faut-il aller jusqu'à considérer la remise en question de la hiérarchie de nos valeurs comme une exigence éthique ? C'est une question fondamentale : l'éthique doit être non pas distante de la réalité, mais incarnée et concrète, pour assumer des responsabilités.
À cet égard, je vous fais part de toute ma reconnaissance d'avoir associé mon intervention à celle de Sophie Crozier, qui est non seulement docteur en médecine, mais aussi docteur en éthique. Elle fait partie des personnes qui, sur le terrain, savent défendre des valeurs face à des choix souvent redoutables.
Comment hiérarchise-t-on des choix ? Au nom de quels principes et de quelles valeurs ? Quelle pédagogie sociale et quelle pédagogie professionnelle sont-elles nécessaires pour mobiliser ce type de discernement ?
« Le contexte, quel qu'il soit, ne peut modifier les principes éthiques, même si une situation inédite comme celle provoquée par la lutte contre l'épidémie peut contraindre seulement à les hiérarchiser provisoirement, mais de manière argumentée en toute transparence. »
Le discernement, c'est d'abord l'argumentation et la pluralité des points de vue. On parle d'ailleurs de collégialité dans la décision. Dès lors, pourquoi ne pas associer les représentants des malades, qui ont été totalement exclus, victimes d'un véritable déni de démocratie sanitaire, comme je l'ai montré dans un article publié dans Le Monde en juillet dernier ?
Dans le numéro de juin de la revue Espace éthique Île-de-France, nous proposions : « Face à l'imprévisible : prévoir s'adapter, inventer ». Mais où est le retour d'expérience ? Peut-être est-il confiné entre experts gouvernementaux ! Pourtant, certaines personnes ont été héroïsées, valorisées, par rapport à des engagements forts.
Depuis 2006, l'Espace éthique publie une revue scientifique, PandÉmiqueS, qui est en ligne sur notre site. Nous avons donc fait preuve d'anticipation, tout comme l'équipe de Roselyne Bachelot, qui avait une vraie appétence pour les questions éthiques. Quant à Xavier Bertrand, il avait créé un Comité d'initiative et de vigilance civiques sur une pandémie grippale et les autres crises sanitaires exceptionnelles. Malheureusement, cette structure n'a duré qu'un an.
Nous avons également publié un ouvrage collectif important en 2009, intitulé Pandémie grippale : l'ordre de mobilisation, que je vous invite à lire. À peu près tout ce qui s'est passé avait été anticipé dans une approche mêlant sciences humaines et sociales. Quelle a été la sollicitation des représentants des sciences humaines et sociales pour éclairer le discernement et les arbitrages politiques ?
J'ai également participé à un retour d'expérience sollicité par la Commission européenne, qui comportait des propositions concrètes, précises et consensuelles.
Dès février-mars, l'équipe de l'Espace éthique, soit sept personnes, qui s'appuient sur un réseau national de professionnels et d'associatifs, ont suivi au quotidien certains sujets concrets et urgents, avant de publier une première synthèse de leurs travaux. Permettez-moi d'en présenter le sommaire.
Avec la question des Ehpad, que nous avons suivie avec beaucoup d'attention, nous sommes au coeur de ce dispositif. Par ailleurs, les situations de handicap ont également constitué un sujet fondamental. Nous nous sommes aussi penchés sur la précarité, les personnes migrantes et les sans-abri, pour qui les valeurs de notre République ont été scandaleusement mises de côté. Autres questions importantes, l'aide à la décision en situation d'urgence ou de crise, ainsi que l'éthique et les décisions en réanimation.
Nous avons été sollicités pour la première fois par des instances gouvernementales le 16 mars, Grégory Émery, conseiller à l'époque du ministre de la santé, m'ayant demandé un certain nombre d'éléments d'argumentation. Nous avons composé un groupe de travail avec une trentaine de personnes très représentatives du milieu de la réanimation. Nous n'avons pas été dans l'improvisation, qu'il s'agisse de la fin de vie ou des décisions de limitation et d'arrêt de traitement. On ne peut pas dire aujourd'hui que les professionnels ont eu besoin d'inventer l'éthique ! Certes, certains ont été un peu surpris par les événements. Quoi qu'il en soit, les référentiels sont là, et les sociétés savantes se sont mobilisées avec beaucoup de véhémence et d'intelligence.
Attitudes, pratiques en fin de vie et après le décès : le docteur Crozier a évoqué tout à l'heure le midazolam, à propos duquel j'ai saisi le CCNE. Nous nous sommes aussi penchés sur la cérémonie funéraire, sur nos valeurs et nos symboles.
Autres points : communication et médiation en temps de crise et projet de recherche Covid-Ethics. Nous ne sommes pas dans l'éthique « d'en haut », mais dans l'éthique « d'en bas », de terrain, enracinée dans le sol. Nous avons eu énormément d'appels téléphoniques, mais nous ne faisons pas de la consultation en matière d'éthique. Quand une équipe est en difficulté, on identifie la question et on la met en contact avec d'autres équipes qui ont une expertise. Néanmoins, l'urgence éthique a parfois justifié des déplacements, et nous avons visité un certain nombre d'établissements. Ainsi, nous organisons avec le Conseil régional d'Île-de-France, les 7 et 8 octobre, un grand colloque de retour d'expérience.
Je tiens à le souligner, la seule instance publique qui m'ait sollicité en tant que directeur de l'Espace éthique est le Conseil régional d'Île-de-France. Je n'ai eu de contact qu'à trois reprises avec Valérie Pécresse, qui a monté un conseil stratégique Covid, auquel je participe et qui tient compte de manière évidente des questions éthiques et sociétales. Par ailleurs, Jean-François Delfraissy m'a demandé de participer à la réflexion dans le cadre de l'avis qu'il a rendu. En outre, nous avons publié, avec l'ARS Île-de-France et les associations, un document important.
Dans les semaines et les mois qui viennent, nous aurons des éléments encore plus tangibles à porter à votre connaissance, si vous le souhaitez. Dans la mesure où les instances publiques ne nous ont pas sollicités, nous avons publié 24 articles dans la presse grand public et nous avons été invités à un grand nombre de plateaux télé. Il y avait donc une audience pour les questions d'éthique, mais ce qui s'est passé dans la sphère des médias ne s'est pas reproduit avec les instances publiques.
Dans le diaporama, vous pouvez lire les titres des articles que nous avons publiés. Il ne s'agissait pas d'articles généraux sur l'éthique, mais d'articles s'intéressant à des sujets concrets, notamment aux renoncements en matière éthique et juridique.
L'Espace éthique a été saisi par le CCNE à propos des pratiques de sédation terminale dans le contexte du Covid-19. Je rends hommage au Comité consultatif national d'éthique pour ses avis transitoires et sa réactivité. Je suis fier de notre société, qui bénéficie d'instances aussi réactives. Nous avons également créé un site grand public, où l'on trouve environ 90 articles représentatifs de toutes les questions éthiques qui se sont posées dans le cadre de la pandémie.
Sera publié fin septembre un ouvrage collectif de 900 pages, intitulé Pandémie 2020 Ethique, société, politique, qui comporte 99 articles couvrant absolument tout le champ des enjeux éthiques sociétaux.
Concernant la gouvernance et les pratiques du soin, il est tout à fait déplorable d'entendre certains appeler à une invention de l'éthique, alors qu'il existe tout un ensemble de textes de référence, tout un ensemble de principes, qu'il suffit de mettre en oeuvre.
Je vous prie de m'excuser, j'ai un problème technique avec le diaporama.

Concernant la place des patients, je reviens sur la question de la démocratie sanitaire. Cela a été souligné au cours de nos auditions, la personne âgée vivant en Ehpad doit être considérée comme une personne à part entière. Vous avez comparé la situation avec les années sida. Toutefois, lors de l'épidémie de sida, les patients étaient circonscrits dans un espace particulier. Dans le cadre de l'épidémie de Covid, comment les patients pourraient-ils être représentés par des associations de patients ?
Ma deuxième question concerne le renoncement aux soins, qui a été important. Ainsi, les décès par mort subite ont doublé pendant la période Covid, du fait d'une absence de consultation des patients. Le plan blanc a été appliqué partout de façon totalement uniforme, dans l'attente d'une vague qui n'est parfois pas venue. Qu'en est-il actuellement ? Dans la mesure où l'épidémie continue, le renoncement aux soins est-il toujours aussi massif ? On le sait, ce serait catastrophique.
Troisième question, quel est votre avis, professeur, s'agissant des essais cliniques ? Nous avons assisté à une accélération des procédures, qu'il s'agisse de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, ou des comités de protection des personnes, les CPP, qui ont été sollicités. Comment jugez-vous une telle évolution en matière éthique ? En tant que rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour la branche maladie, j'avais entendu le professeur Raoult, qui nous avait apporté différentes précisions sur les essais randomisés et les essais comparatifs. Convient-il de revenir à la dimension éthique des CCP, qui a été perdue au fil du temps ?
Quatrième question, comment jugez-vous les limites à la liberté de prescrire définis par le ministre ?
Effectivement, la place des patients a été insuffisante durant la crise. Je ne peux pas comparer la situation à celle de l'époque sida, puisque j'étais encore relativement jeune. Certes, un mouvement majeur consacrant les droits des patients est né à ce moment.
Comment les patients âgés ont-ils été représentés ? S'ils l'ont peu été, c'est parce qu'il n'existe pas d'association spécifique des personnes vulnérables vivant en Ehpad. Surtout, l'idée selon laquelle, dans l'urgence, on ne peut pas penser l'éthique a dominé. Or tel n'est pas le cas ! Malheureusement, les cellules de crise ont fonctionné avec une grande efficacité, mais sans que l'éthique ait son mot à dire. L'éthique est souvent considérée comme un supplément d'âme, comme « la cerise sur le gâteau ». La rapidité de réorganisation sur le terrain a été incroyable, mais n'a pas laissé place, au nom de l'urgence, à la réflexion éthique.
S'agissant du renoncement aux soins, plusieurs explications ont été avancées. Les patients ont eu peur d'être contaminés, malgré l'information, peut-être un peu tardive, sur les filières Covid et non Covid à l'hôpital. En outre, on ne peut pas le nier, l'accès aux soins n'était pas toujours assuré, en raison du manque de moyens. Les interventions chirurgicales étaient annulées, les infirmières compétentes étaient déplacées dans les unités de réanimation.
Ce renoncement aux soins perdure-t-il? Je ne le pense pas, mais je n'ai pas de données à vous fournir sur ce sujet. Aujourd'hui, tout fonctionne comme avant, mais, avant, c'était déjà compliqué. Les tensions étaient majeures, avec de très nombreuses fermetures de lits. Ainsi, la moitié de notre unité de soins intensifs est fermée depuis des années. C'est un sujet de préoccupation majeure. En cas de nouvelle vague, on ne pourra pas annuler de nouveau la prise en charge des malades.
Nous ne pouvons pas imaginer aujourd'hui les conséquences de l'absence de prise en charge des patients non Covid. Je pense que la mortalité va augmenter, mais pas seulement. On ne peut pas faire fi du vécu des patients qui ont été angoissés pendant des mois, en raison d'une absence de prise en charge.
S'agissant des essais cliniques, nous vous communiquerons les réponses que nous avons rédigées. Je ne suis pas chercheuse en sciences fondamentales, mais j'ai appris, durant mes études de médecine, que, dans le cadre des essais randomisés, notamment pour évaluer un essai thérapeutique, le fait d'avoir un groupe contrôle est tout de même une approche préférable. Je ne comprends donc pas forcément l'assertion du professeur Raoult.

Plutôt qu'un plan blanc national, vous pensez qu'un plan blanc différencié serait préférable ?
Excellente question ! Bien sûr !
J'ai reçu un courrier extrêmement problématique du Conseil de l'ordre d'un département de France dans une région qui n'a pas été parmi les plus touchées. Il informait les médecins que les tous les patients des Ehpad en détresse respiratoire ne pourraient plus être admissibles à l'hôpital et qu'il ne fallait pas les y envoyer, mais envisager des soins de support. Certaines décisions prises en région, alors même que ces régions n'étaient pas touchées par l'épidémie, ont été extrêmement discutables d'un point de vue éthique. Il faudra en tirer les leçons.
Si la partie introductive de mon propos a pu paraître un peu abrupte, je souhaitais la pondérer avec des textes de référence. J'ai beaucoup d'admiration pour les décideurs publics, auxquels je pose une question, sans les remettre en cause : pourquoi n'ont-ils pas adossé leur action sur des gens qui auraient pu leur donner des éléments d'arbitrage ? En effet, un certain nombre d'instances auraient pu apporter, dans le cadre d'une consultation, un peu plus ouverte, certaines analyses.
Pour nombre d'entre nous, la référence est celle des années sida, qui ont été vécues comme une aventure douloureuse, qui a donné lieu à une mobilisation de la société et à une inventivité médicale et scientifique sans précédent. Françoise Barré-Sinoussi et Jean-François Delfraissy étaient aux manettes dans différents domaines de l'expertise, ce qui témoigne à la fois d'une conscience éthique d'enjeux nationaux et planétaires et d'un sens de la relation à la personne malade et au milieu associatif.
J'avais ainsi proposé que le Conseil national du sida et des hépatites virales soit saisi, avec le Comité consultatif national d'éthique. Cette instance a une réputation et un savoir- faire qui auraient pu nous éclairer.
Dans les années sida, il y a eu une mobilisation associative. Rappelez-vous, en 1984, la création de l'association Aides par Daniel Deferre. Rappelez-vous aussi que les intellectuels et la société civile étaient présents au travers d'un certain nombre de représentants. Or, pendant le confinement, les intellectuels ont été peu présents, si ce n'est pour critiquer, de manière très contestable. Aujourd'hui, on a l'impression d'un chacun pour soi, alors qu'à l'époque la dimension politique de la pandémie était guidée par des intérêts supérieurs. Il y a aujourd'hui des associations de victimes du Covid-19, mais nous ne sommes qu'au début de la réalité du Covid et il n'y a pas encore de véritable projet.
Sans doute y a-t-il eu également des maladresses : était-ce à l'État d'intervenir aussi directement dans tous les domaines, de manière prescriptive et parfois paternaliste, avec toutes les contradictions qui ont émaillé, par exemple, les discussions sur le masque ?
S'agissant de la représentativité, les CRSA, les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, étaient désespérées de ne pas pouvoir se concerter au moment où leur expertise et leur représentativité auraient permis d'apporter quelque chose. L'Espace éthique était le réceptacle au quotidien de ce que vivaient les professionnels et les personnes malades, qui était inaudible.
On a pris des décisions, sans toujours les suivre, en les pondérant parfois. Je pense notamment à ce qui s'est passé pour les personnes autistes. Comment expliquer cette inintelligence du réel, qui aurait pu être corrigée par des expertises ?
La démocratie sanitaire, avec la loi du 4 mars 2002, a permis de développer des savoirs expertaux, lesquels, fort heureusement, se sont exprimés. Qu'est-ce qu'un savoir utile dans le contexte d'une pandémie et de quelle manière le reconnaître et l'intégrer ? Si j'avais été Premier ministre, j'aurais organisé une concertation avec les acteurs de terrain, dont j'aurais tiré un travail de pédagogie. Aujourd'hui, les gens sont sans repères, ils ne se sont pas approprié les données de la crise. Je mets en cause un confinement intellectuel : pourquoi les propositions formulées notamment par Jean-François Delfraissy ont-elles été sans suite ?
Concernant l'expertise scientifique, l'enjeu est fondamental. Il y a des règles et des principes, et il est primordial de préserver un rapport de confiance entre la société et les scientifiques. Or on a créé une ambiance de désarticulation, dont nous aurons du mal à surmonter les conséquences dans les mois qui viennent.
Il aurait fallu réunir tous les comités d'éthique des organismes scientifiques, afin de rendre immédiatement une résolution. L'Office français de l'intégrité scientifique aurait pu aussi être saisi, et je ne vous parle pas du Conseil national de l'ordre des médecins concernant les aspects déontologiques.
Aujourd'hui, l'OMS et la déclaration d'Helsinki sur la recherche médicale admettent, dans les situations d'urgence, des approches compassionnelles argumentées, ce qui n'est pas contradictoire avec des approches expérimentales en vue d'une évaluation.
Nous avons également un interlocuteur marseillais, dont les compétences épistémologiques, mais aussi dialectiques sont grandes. Il s'agit non pas uniquement des décisions scientifiques qu'il prend, mais de toute la déstabilisation d'une société.
En conclusion, je rends hommage à tous les professionnels qui ont sauvé des vies humaines, dans le cadre de protocoles un peu discutables. L'éthique de la recherche, l'éthique de l'intégrité scientifique, renvoie vraiment aux valeurs de la République. Je le rappelle, lors du dernier G7, l'Académie nationale des sciences a rendu un avis sur l'intégrité scientifique et la démocratie.
On ne pourra pas se permettre de refaire ce qui a été fait. La décision du confinement a été assumée dans le cadre d'un arbitrage courageux. En matière d'éthique, il convient de toujours envisager les conséquences.
Dans une situation de crise, nous sommes tous vulnérables, non pas éthiquement, mais politiquement. La démocratie est directement en cause. Dans une situation de danger plus ou moins bien identifiée, c'est notre cohésion et notre cohérence qui sont menacées. J'attends donc des politiques qu'ils adossent leurs décisions sur des relais, afin que ces dernières soient mieux intégrées par la population.

Docteur Crozier, vous avez évoqué quelques retours d'expérience, notamment concernant les transferts. Dans le cadre de cette commission d'enquête, des chefs de service ont affirmé que, lorsque les transferts ont eu lieu, ils étaient absolument nécessaires. D'autres chefs de service de cliniques privées nous ont dit que leurs cliniques, au même moment, étaient vides. Je vous pose la question : ces transferts étaient-ils utiles ?
Vous avez également évoqué la priorisation. J'ai moi-même recueilli un témoignage à cet égard : dans l'est de la France, au début de la crise, l'équipe de réanimation ne s'est pas déplacée pour une patiente atteinte d'un cancer du sein qui avait suivi une chimiothérapie, ce qui a entraîné son décès.
Ma question est simple : par rapport aux retours d'expérience des praticiens, des usagers, des familles et des patients, y aurait-il matière à engager des recours ? J'aimerais savoir où est la limite de l'urgence et de la force majeure, notions qui ont été souvent avancées. Pour vous, où est à la frontière entre le manque de moyens et l'obligation de moyens ?
S'agissant des transferts, nous avons besoin des retours d'expérience pour savoir si les transferts étaient pleinement justifiés. Je ne dispose pas des informations nécessaires pour vous éclairer sur ce point. En revanche, j'ai posé la question de la participation des familles. J'ai eu écho d'une lettre de revendication de la famille d'un patient de l'AP-HP par le biais de la représentante des usagers. Cette famille se plaignait de ne pas avoir été associée à la décision du transfert. Il était en effet très douloureux de ne pas pouvoir se déplacer et de ne pas être auprès d'un proche extrêmement malade voire en fin de vie.
Vous posez la question de la limite de l'urgence et de la force majeure. Il s'agit bien entendu d'une question essentielle, qui doit être posée. Durant cette crise, nous avons manqué d'anticipation, notion évoquée tout à l'heure par le professeur Hirsch. Nous aurions pu anticiper le choix de privilégier à tout prix le secteur Covid.
Par ailleurs, je le rappelle, le nombre de patients atteints du Covid était comptabilisé tous les jours, ainsi que le nombre de décès. Il y avait des comparaisons européennes et mondiales : il fallait montrer quel système de santé affronterait le mieux le Covid. Mais qu'en était-il des autres patients ? En a-t-on parlé et le fera-t-on un jour ? C'est un vrai sujet !
Il y a eu une focalisation majeure sur les patients atteints du Covid, alors que ceux qui souffraient d'autres maladies graves nécessitant des traitements n'étaient pas pris en charge. Certaines vies valent-elles plus la peine d'être vécues que d'autres ? C'est une question éthique fondamentale, à laquelle je ne peux pas répondre, car elle nécessite une large discussion, et pas seulement entre médecins, comme cela s'est passé dans les cellules de crise. En effet, les décisions ont été prises de manière très verticale, sans associer les représentants des usagers ni les acteurs de terrain.
Les lits de réanimation sont une ressource rare, il y a des dizaines d'articles sur la question du tri en réanimation. Dans le contexte du Covid, les lits disponibles étaient encore moins nombreux pour les patients non Covid. On a eu un mal fou à trouver des soins de suite. Tous les patients qui n'avaient pas le Covid étaient des mauvais malades. Même aux urgences, quand vous arriviez avec un symptôme, on pensait immédiatement Covid, y compris pour une douleur abdominale, symptôme d'une péritonite. Cet éclairage a donc vraiment perturbé notre jugement, et il nous faut réfléchir sur cet aspect.
À cet égard, permettez-moi de vous lire un extrait d'une lettre adressée le 20 mars à tous les médecins d'un département par le conseil départemental de l'ordre : « Malheureusement, au vu des dernières recommandations, les patients de maisons de retraite et Ehpad présentant des comorbidités et en détresse respiratoire ne seront bientôt plus admissibles à l'hôpital. Il sera envisagé pour eux des soins de confort. Nous avons conscience que ces choix éthiques à venir seront douloureux, mais inévitables. »
Dire qu'il n'y a pas eu de priorisation et qu'on a pu prendre tout le monde en charge est faux ! Oui, il faut une priorisation, il faut que cela soit pensé dans le cadre d'une justice distributive de type utilitariste. En France, on ne veut pas penser la priorisation. La logique actuelle, qu'on appelle la loterie naturelle, c'est « premier arrivé, premier servi », ce qui est extrêmement discutable d'un point de vue éthique.
Cette crise peut nous éclairer sur les questions de priorisation qui se posent tous les jours dans nos hôpitaux parce qu'on manque de moyens, de façon chronique pour la réanimation. Si nous ne voulons pas penser ces questions, nous serons amenés à prendre des décisions qui ne seront probablement pas correctes.
On parle de triage, de priorisation et de hiérarchisation des choix. Il y a des personnes qui étaient hospitalisées et n'ont pas voulu de la réanimation, compte tenu des conséquences qu'elle aurait pour eux. C'est un point à prendre en considération. Il n'y avait pas le temps de la négociation, il fallait prendre des décisions dans l'urgence, parfois sans voir la personne. Il était très difficile d'être en relation avec les familles, qui ne pouvaient souvent pas venir et qui risquaient d'être contaminées en venant.
Il convient donc de « décharger » l'a priori critique concernant des décisions médicales, qui sont en général des décisions collégiales, mais dans un contexte dégradé. Nous l'avons constaté, les cellules dédiées à la codécision éthique n'ont pas été fonctionnelles, dans la mesure où la plupart des services de réanimation possèdent une véritable culture éthique.
Permettez-moi de prendre l'exemple de l'Institut Gustave Roussy, qui possède un comité d'éthique tout à fait extraordinaire et pluridisciplinaire. L'ARS y avait réquisitionné les lits de réanimation. Sans doute certains patients n'ont-ils pas eu la chance d'accéder à une réanimation, alors que certains lits sont restés vides.
Face à la pression politique et à l'inquiétude, lorsqu'on vous dit, à titre de précaution, de fermer certains services pour redistribuer les moyens en faveur des patients atteints du Covid, vous le faites. Sinon, on vous reproche de ne pas l'avoir fait. L'éthique a posteriori, c'est facile ! La décision responsable a priori est beaucoup plus complexe.
Quant aux comités de protection des personnes, qui ne sont pas des comités d'éthique, mais des comités d'instruction de dossiers scientifiques comportant un aspect éthique, ils ont plutôt bien fonctionné. Confrontés nuit et jour à des sollicitations, ils ont pris des décisions auxquelles je rends hommage, même si elles ont parfois été un peu rapides. Quoi qu'il en soit, leur instruction n'a pas été dysfonctionnante.
Je le rappelle, certaines autorités ont développé des essais d'une manière discutable. L'étude rendue par l'INSERM conclut, au travers d'une méta-analyse extrêmement détaillée, à l'inefficacité des molécules utilisées à l'époque.

Je tiens tout d'abord à vous remercier de la franchise de vos constats. En effet, six mois après le début de l'épidémie, la pénurie et les phénomènes de priorisation sont parfois remis en cause.
Je voudrais revenir sur la question des systèmes politiques et de la réponse qu'ils ont apportée à l'épidémie. Au niveau mondial, selon les régimes politiques, la réponse a été très différente. Elle a ainsi fait l'objet d'une instrumentalisation et de phénomènes de propagande, les régimes plus autoritaires tenant à démontrer la plus grande efficacité de leurs décisions.
Dans la première phase violente de cette épidémie, la population était très apeurée et souhaitait que la réponse apportée soit la plus efficace possible. Quand survient une épidémie, est-il plus efficace d'avoir une réponse autoritaire plutôt qu'une réponse de santé publique fondée sur l'empowerment ? Pour les responsables publics, c'est une vraie question. En effet, s'il est plus efficace d'être un peu autoritaire, pourquoi ne pas l'être ?
êÉvoquons de nouveau la question de l'épidémie de sida. Vous avez parlé d'une sorte d'avènement de la démocratie sanitaire. Rappelez-vous les débats sur le dépistage obligatoire, qui était défendu par nombre de responsables politiques, au nom de l'efficacité, et aurait été totalement contreproductif ! Rappelez-vous également la tentative de tirer au sort les patients qui bénéficieraient d'un traitement ! L'histoire ne s'est donc pas écrite sans heurts, et je ne suis pas sûr que les acquis de cette période soient bien ancrés dans notre système politique et de santé.
Le développement du complotisme, la perte de valeur de la parole publique et des institutions ont introduit une certaine complexité, qui rend difficile l'appropriation de la parole des autorités par notre population. Bien évidemment, les épisodes concernant le masque ont été particulièrement dramatiques à cet égard. Comment apporter des arguments qui démontreraient que la participation de la population, la démocratie sanitaire, serait plus efficace pour prendre en charge l'épidémie ?
Je veux également vous interroger sur la parole des médecins, qui ont encore du poids dans l'opinion publique. Leurs interventions ont été contradictoires. On a eu le sentiment que les fondements éthiques reposaient moins sur l'intérêt des patients que sur d'autres types d'intérêt, ce qui a ouvert la porte à de multiples contestations, qui ne paraissent pas toujours infondées.
Par ailleurs, M. Hirsch est revenu sur la question de la gouvernance opérationnelle. Actuellement, c'est le secrétariat général de la défense nationale qui assure le pilotage de la lutte contre l'épidémie, ce qu'un ancien ministre de la santé a mis en cause à l'Assemblée nationale. Quel regard portez-vous sur cette question ?
Comment penser l'adhésion de la population à des mesures contraignantes ? C'est une question que nous nous sommes posée dans les groupes de réflexion du CCNE.
L'un des éléments majeurs a été la question des moyens disponibles au moment où les décisions ont été prises. Si nous avions eu les moyens, si nous avions anticipé, les mesures auraient probablement été moins restrictives et aucune mesure autoritaire n'aurait été prise. Ce qui a posé problème, c'est le manque de loyauté. En tant que soignants et citoyens, nous avons très mal vécu les directives contradictoires qui évoluaient au fil du temps, mais non pas en fonction des connaissances scientifiques. On pouvait en effet imaginer que, par principe de précaution, il eût fallu protéger. D'un point de vue éthique, si l'on pense qu'il y a un risque, la stratégie habituelle est d'adopter le principe de précaution. Or nous n'avons pas pu appliquer ce principe, parce que nous n'en avions pas les moyens.
S'agissant de l'adhésion de la population à ces mesures, ces discours étant contradictoires, nous avons tous perçu un manque de loyauté. Nous nous sommes interrogés pour savoir si les recommandations que nous recevions étaient vraiment en accord avec ce que nous savions de la circulation d'un virus.
Si on veut faire mieux la prochaine fois, la question de l'anticipation, notamment pour ce qui concerne les mesures de protection, constitue un élément majeur, tout comme l'association de personnes diverses aux décisions de priorisation.
En outre, c'est vrai, la parole des médecins a été discréditée, en raison d'une surmédiatisation, à laquelle il conviendra de réfléchir.
Monsieur Jomier, en tant que médecin et politique, vous avez certainement la réponse à la question que vous avez posée.
Concernant la démocratie sanitaire, la loi du 4 mars 2002 est une conquête des années sida, qu'on le veuille ou non. Elle a pris naissance dans le cadre d'un débat démocratique et d'initiatives qui ont permis de redéfinir les légitimités. Si j'avais une suggestion à vous faire, ce serait d'actualiser cette loi en fonction de ce qui s'est passé, notamment pour reconnaître des droits aux personnes représentatives dans le contexte d'une pandémie ou d'une crise sanitaire. J'actualiserais également la loi du 2 février 2016 sur la fin de vie, dont on connaît les écueils et les carences.
J'attends également beaucoup de l'évolution législative s'agissant des Ehpad et des personnes en situation de perte d'autonomie. N'oublions pas l'esprit de fraternité et d'engagement démocratique de malades qui disaient « il y a plus malade que moi ».
Par ailleurs, le triage a fait l'objet d'évolutions intéressantes, puisque, progressivement, dans les régulations du SAMU, on a intégré la compétence de gériatres.
En outre, certains Ehpad se sont autocensurés et n'ont pas fait appel aux services d'urgence. À ce titre, la pandémie a été révélatrice de l'image que la société se fait de ses vulnérabilités, pour ne pas dire de ses marginalités.
Selon moi, les décideurs politiques ont plutôt bien agi, dans la mesure où leurs marges de manoeuvre étaient très limitées. Les discours politiques étaient empreints d'une valeur morale tout à fait exemplaire. Sans doute des positions éthiques ont-elles éclairé nos politiques, leur permettant d'ajuster certaines décisions initiales. Le clair-obscur ne peut déboucher que sur des controverses, comme cela a été le cas pour le masque.
Ne l'oublions pas, certaines décisions ont une plus grande valeur symbolique que d'autres. Par exemple, pour ce qui concerne les transferts, il ne s'agissait pas uniquement d'un problème de santé publique, mais aussi de communication : nous avions besoin de voir que l'État agissait et faisait preuve d'une certaine inventivité.
Malheureusement, la pandémie intervient après les gilets jaunes, c'est-à-dire dans un contexte de crise de légitimité, de défiance, de suspicion, de crainte de manipulation voire d'instrumentalisation de la crise.
Mon sentiment personnel, c'est que les décideurs politiques, les responsables de l'État, ont assumé trop directement un certain nombre de décisions. Ils auraient pu se reposer sur d'autres autorités. Décider du détail de tout, d'une manière évolutive, n'est pas propre à rassurer.
En termes de visibilité de la décision politique, les arguments ont manqué, même si nous avons assisté à de très belles prises de position d'Édouard Philippe, qui a fait preuve de pédagogie. Il reste aujourd'hui crédible, ne serait-ce que parce qu'il a donné le sentiment de respecter le public dans sa capacité de comprendre et de s'approprier un certain nombre de questions.
La vraie question est la suivante : sommes-nous, en tant que citoyens, vraiment acteurs de la lutte ? Avons-nous compris les enjeux en termes d'intérêt général et d'intérêt supérieur ? De ce point de vue, l'échec me paraît total. Si les choses évoluent mal, nous vivrons une crise de délitement de la cohésion de notre société. D'ailleurs, un certain nombre de personnes sont prêtes à sortir du bois pour utiliser une telle situation .
Par conséquent, comment responsabiliser les acteurs et reconnaître la multiplicité des compétences et l'esprit d'initiative du terrain ? Notre Premier ministre semble avancer dans cette direction. Je comprends mal pourquoi on n'a pas pris en compte cette intelligence du réel détenue par les gens qui sont sur le terrain. Pourquoi ne pas avoir lancé des états généraux ou des consultations sur internet ? À ma profonde stupéfaction, cela n'a pas été fait.
Pour finir, je dirai que j'ai confiance dans l'État, dans nos responsables, non pas par conviction, mais par nécessité. Ce qui manque aujourd'hui, c'est un projet.
L'application StopCovid fait partie de vos préoccupations. Je suis membre du comité pilote d'éthique du numérique. Lorsque j'observe la défiance à l'égard de cet outil, je me dis que cette construction théoriquement intéressante par des gens de très grande qualité a aujourd'hui toutes les chances d'aboutir à un flop. Quand on est dans une situation d'urgence et d'intérêt national, les susceptibilités concernant des données confidentielles qui sont partagées toute la journée sur internet pourraient être revues. Malheureusement, il n'existe pas de parole publique pour étayer cette position, dérogatoire à des valeurs transcendantes. Si j'admire les politiques qui sont aux commandes, je les admirerais davantage s'ils s'employaient à discuter et à tenir compte de l'expertise de la société.

Docteur Crozier, vous avez parlé tout à l'heure de perte de chance. Au-delà de certaines plaintes médiatiques, êtes-vous confrontée à un afflux de plaintes concernant ce problème de perte de chance ?
Ma deuxième question n'a peut-être rien à voir avec l'éthique. Vous avez dit que le nombre d'admissions à l'hôpital à la suite d'accidents vasculaires cérébraux avait chuté durant la pandémie. Or je pensais qu'il y avait eu un nombre important d'accidents thromboemboliques liés au Covid. Je relève ainsi une discordance entre la situation réelle et ce que nous en savons.

Certes, il fallait gérer l'urgence. Pour autant, le sensationnel véhiculé par les médias a créé des biais, tant au niveau juridique que sanitaire. On l'a constaté, les familles n'étaient pas forcément prises en compte.
Cette pandémie a permis de mettre en évidence une méconnaissance concernant la démocratie sanitaire, certains leviers n'ayant pas été mobilisés. L'emballement de la communication concernant les orientations stratégiques n'a servi ni soignants ni aux familles. Il y a eu des plaintes, parce qu'il y avait probablement de vraies raisons de porter plainte, mais aussi parce que les discours disproportionnés et la centralisation des décisions n'ont pas toujours été pertinents. Nous devrons donc apprendre à travailler différemment.
Dans le cadre d'un plan blanc, il faudrait mettre en place des plans de continuité d'activité partagée. Nous avons des groupements hospitaliers de territoire, ainsi que des complémentarités entre le privé et le public, qui auraient peut-être pu éviter certains transferts.
Ni les conférences régionales de la santé et de l'autonomie ni la Commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé n'ont été sollicitées. Une réflexion doit être menée pour apprendre à travailler ensemble et à mieux nous connaître.

Cette audition nous place « au coeur du réacteur ». Nous avons commencé à aborder les questions d'éthique hier, à propos des personnes âgées très vulnérables, notamment celles qui sont en fin de vie. On meurt mal aujourd'hui en France, c'est votre confrère Régis Aubry qui le dit depuis des années, et je pense qu'il a raison.
Vous avez parlé, madame Crozier, de loyauté et du danger qu'il y aurait à dire la vérité. Alors que vous êtes si convaincue et si convaincante - on sent bien la révolte que vous avez en vous - êtes-vous entendue par le pouvoir en place et les autorités politiques ?
Par ailleurs, M. Jomier a évoqué ce problème, faut-il poursuivre dans la voie de la pédagogie ou bien imposer certaines mesures ? Dans certains cas, on le voit bien, les directives sont floues.
Monsieur Hirsch, s'agissant du retour d'expérience que vous avez évoqué, quelles questions éthiques reviennent le plus souvent dans la bouche des soignants ? Pouvez-vous nous donner quelques indications en la matière ?

Professeur Hirsch, vous avez évoqué les avis du Conseil scientifique, mais aussi et surtout ceux du Comité consultatif national d'éthique sur la pandémie grippale, qui remontent à 2009.
Vous l'avez souligné, les sciences humaines et sociales ont été les grandes oubliées pendant la crise. Comment serait-il possible de mieux gérer le temps de l'urgence en s'appuyant sur l'exigence éthique ?
Ce que vous avez appelé la « démocratie sanitaire », qui regrouperait non seulement les usagers et les familles, mais aussi l'ensemble des équipes médicales, les experts ARS et la communauté des élus, constitue-t-elle une piste d'amélioration ?
Au demeurant, vous avez tempéré votre propos en disant que l'éthique a posteriori, c'était facile. Dans l'urgence, sous les feux des médias, notre compréhension de la situation est souvent perturbée.

Une métaphore guerrière a été utilisée à plusieurs reprises par le Président de la République au début de cette crise sanitaire sans précédent. Elle était synonyme d'appel à la responsabilité, de discipline et d'obéissance.
Pensez-vous que ce vocabulaire a eu un impact sur la gestion de la crise et permis une réponse adaptée ? J'ai personnellement le sentiment qu'elle a plutôt créé un choc psychologique très important, encore présent aujourd'hui, amplifié par le fait que les armes faisaient défaut à ce moment précis et que les soldats n'étaient pas associés à la stratégie au combat.
Par ailleurs, la crise du coronavirus nous a montré qu'aucun expert, aucun chercheur, aucun spécialiste, pourtant très présents sur les plateaux de télévision, n'ont pu se substituer à une réflexion commune. Qu'en pensez-vous ?
S'agissant des pertes de chance et des plaintes, je ne pourrai pas vous répondre aujourd'hui. Sans doute les représentants des usagers auraient-ils des réponses à vous donner, car les choses commencent à remonter.
Au-delà des plaintes, c'est-à-dire des personnes qui feront la démarche de demander réparation ou de signaler une perte de chance, on ne peut pas ne pas faire de retour d'expérience et ne pas penser les très probables pertes de chance pour les patients atteints du Covid et pour tous les autres patients. Ce travail prendra du temps.
Je le répète, les pertes de chance ont largement dépassé la question des décès. Les retards dans les prises en charge de cancers ou de maladies vasculaires constituent un vrai problème. J'ai échangé hier soir avec la représentante des usagers de l'AP-HP, qui fait partie de notre coordination de la démarche éthique. Pour le moment, elle n'a pas de chiffres à sa disposition.
S'agissant des accidents vasculaires cérébraux, vous avez entièrement raison, et je souhaite souligner deux points importants. Les patients atteints d'un Covid sévère ont pu présenter des maladies thromboemboliques, principalement des embolies pulmonaires, mais aussi des accidents vasculaires cérébraux. La majorité d'entre eux ont été pris en charge dans les unités dédiées au Covid, donc pas dans nos unités.
Par ailleurs, l'accident vasculaire cérébral est une pathologie qui survient chez des personnes âgées de plus de 75 ans, nombre d'entre elles venant donc d'établissements de santé comme les Ehpad. Ces dernières, de toute façon, ne nous ont pas été adressées.
Pendant la période du confinement, on a observé partout une activité extrêmement réduite. Nous avons interpellé nos collègues français, il y a eu des échanges au niveau international. Surtout, les patients arrivaient avec des retards de prise en charge que je n'avais pas vus depuis dix ans : il y a eu un renoncement aux soins, les gens n'ont pas osé déranger, alors qu'ils avaient des symptômes d'AVC.
Madame Jasmin, certes, il y a eu un emballement médiatique qui a été à l'origine de biais dans la perception de ce qui se passait réellement sur le terrain. Ce focus sur le Covid a eu un impact sur nos pratiques soignantes. Nous finissions par ne plus faire que ce diagnostic, ce qui était problématique. C'est certain, les professionnels devront se remettre en question.
Concernant la centralisation des décisions, je suis entièrement d'accord avec vous. L'approche du cas particulier, même avec des recommandations, est un principe garant du respect de la dignité de la personne.
Quant à la coopération, il s'agit d'un élément essentiel. Notre difficulté à coopérer entre hôpitaux publics, entre hôpitaux publics et privés, entre hôpitaux et médecine de ville était connue. Espérons que cette crise accélère ce qui était engagé depuis longtemps par le ministère de la santé. Nous devrons tirer les leçons de la crise et apprendre à travailler ensemble, pour améliorer de façon globale nos pratiques soignantes. Je reste convaincue de l'importance de faire exister la démarche éthique.
Je ne le pense pas.
Pour le moment, la situation des hôpitaux publics est la même qu'avant la crise. C'est peut-être même pire, les soignants étant épuisés. Ils ont perdu leur motivation et leur confiance envers les pouvoirs publics, ce qui est tout de même extrêmement préoccupant.
Madame Meunier, il me semble qu'un discours de loyauté et de vérité est meilleur, dans ce contexte, pour ce qui concerne l'adhésion à des recommandations. Le doute des professionnels concernant la loyauté des directives a vraiment posé problème. À titre personnel, j'estime que cette absence de loyauté a eu des conséquences majeures. L'adaptation des directives à la pénurie a mis en danger les personnels soignants et la population. Cet aspect doit être questionné.
Vous me demandez si j'ai été entendue. Non, je ne suis pas entendue ! Quand, à d'autres occasions, j'ai pu alerter sur les difficultés de l'hôpital public - je suis très engagée dans la défense de l'hôpital public depuis des années -, la pénurie de personnel et de moyens, les restrictions budgétaires qui conduisent à une paupérisation de l'hôpital et l'abandon des professionnels qui travaillent dans des conditions épouvantables, je n'ai pas été entendue !
Monsieur Husson, je suis entièrement d'accord avec vous, la métaphore guerrière a permis de faire comprendre le sacrifice des soignants, qui tombaient faute d'armes pour se défendre. Il faudrait évaluer le choc psychologique qu'elle a provoqué auprès des citoyens. Des sociologues s'intéresseront sans doute à la question, car l'un des « bénéfices » du confinement a été une grande production intellectuelle, qui éclairera peut-être, dans les prochaines semaines, ces questions essentielles.
Nous sommes dans une période post-confinement : les conditions sont-elles réunies pour assumer la situation actuelle ? Nous découvrons les politiques publiques au jour le jour, il y a un manque de pédagogie. La dimension du respect de l'autre dans le port du masque n'a pas été assez promue par les responsables politiques. Or, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a découvert cette question. Si les médias ont assumé un rôle de pédagogie, avec parfois des excès, c'est par absence d'initiatives de pédagogie sociale. Le monde de la culture n'a pas été mobilisé par exemple, pour apporter une ouverture, un horizon. Les tribunes d'intellectuels n'ont pas été transposées dans les décisions publiques.
Pendant le confinement s'est posée la dialectique entre liberté et égalité. En termes de valeurs, il y a eu des valeurs inconditionnelles qui ont été affirmées, dont le respect des plus vulnérables. Il faut montrer que le respect de la vie comme valeur est une richesse pour la société. Il est regrettable que ces sujets ne soient pas davantage abordés dans le débat public. La reconnaissance exprimée à l'égard des professionnels de santé a été exceptionnelle. Mais qu'en est-il des endeuillés ? On n'a pas suffisamment pris en compte et valorisé tous ceux qui ont été affectés. Une cérémonie de deuil aurait pu être organisée. La défense de la démocratie a surtout été présentée sous l'angle de la santé publique mais bien d'autres pans auraient dû être mis en avant. Il y a une dimension éthique fondamentale dans les souffrances qui ont été vécues du fait du confinement et de l'isolement. L'accompagnement des personnes qui ont souffert aurait pu être valorisé.
La métaphore de la guerre a été employée. Ce qui est important c'est la mobilisation et l'esprit d'engagement. C'est un discours, on peut le contester. Si on se mobilise dans un contexte démuni, en l'espèce sans équipements de protection suffisants, cela demande une forme d'humilité de la part des autorités publiques. Lors de la grippe H1N1, le ministère de l'intérieur a eu une position centrale. Aujourd'hui, les enjeux de santé et d'humanité ont été au rendez-vous pendant la crise.
Il est possible de concilier le temps de l'urgence et le temps de l'éthique. Les professionnels avaient besoin d'approfondissements pour s'interroger sur ce qu'ils font et sur ce qu'ils sont. Aujourd'hui, on semble prendre des mesures par défaut, comme sur le port du masque, plutôt qu'avec un volontarisme soutenu et fondé sur un projet. Par exemple, pendant la grippe H1N1, il y a eu des réunions dans des municipalités aux États-Unis pour trancher des questions éthiques, en particulier sur la priorisation des patients.
Les interrogations éthiques doivent permettre d'éclairer les enjeux et de les documenter. L'une des questions était de savoir si on pouvait prendre des décisions en examinant chaque cas individuel face à l'urgence et à la cohorte des patients. Les Samu ont mis en place des dispositifs et on en tirera des enseignements, pour autant qu'on veuille bien le faire.
Je souhaiterais que la commission d'enquête prenne bien en compte le faire que l'éthique doit être incarnée par les professionnels, ce qui suppose qu'ils en aient les moyens. S'il n'y a pas de concertations et que le Conseil national de l'ordre des médecins n'est pas un peu plus présent, on ne progressera pas. J'en appelle à la concertation de l'ensemble des instances éthiques compétentes pour tirer les leçons de la crise sanitaire.

Comment s'est-on laissé imposer certaines décisions prises par les autorités sanitaires ? On a vécu des épisodes grippaux, nous avons des connaissances en santé publique, en particulier les médecins. Comment se fait-il que nous n'avons pas pu infléchir la communication du Gouvernement pour assumer le manque d'équipements de protection ? Comment se fait-il que les médecins ne soient pas montés au créneau sur le port du masque ?
Sur les visites des patients, notamment ceux en fin de vie, se pose une question éthique plus large. On aurait dû solliciter les sciences humaines et sociales car sur ce sujet, il paraît évident qu'on a franchi une ligne rouge. Il y a eu une perte de valeurs considérable sur le renoncement aux visites des personnes en fin de vie. Quel regard devons-nous avoir sur ce sujet ?

Je vous remercie pour vos propos très marquants. J'ai conduit une mission pendant la crise sanitaire sur le logement et l'hébergement d'urgence, avec ma collègue Dominique Estrosi Sassone. Le secteur de l'hébergement a connu de grandes difficultés pendant la crise. Le personnel n'avait pas d'équipements de protection, la priorité étant donnée aux professionnels du secteur sanitaire, avant le secteur social. Or ils ont dû prendre en charge des malades car personne ne voulait venir les chercher. Avez-vous identifié des enjeux éthiques sur ce secteur ?
Je souhaite aussi évoquer la cacophonie qui a résulté des expressions contradictoires des médecins dans les médias. Pour les citoyens, cela a été difficile à vivre. Aujourd'hui nous assistons à des manifestations anti-masques, c'est grave. Comment se fait-il en outre que des médecins doivent encore faire des pétitions pour que soit précisée la stratégie du dépistage ? Pourquoi le ministère de la santé a-t-il été au premier rang dans la gestion de la crise ? Cela a marqué les décisions qui ont été prises. Par ailleurs, que pensez-vous de la concurrence qui a pu exister entre les pompiers et le Samu ?
Concernant la mobilisation des sciences sociales, nous sommes aujourd'hui en déficit de recherche en sciences humaines et sociales et c'est un problème qui dépasse la crise sanitaire.

Le problème de fond est celui d'un système de santé en souffrance depuis des années, au sein duquel les professionnels sont peu et mal entendus. Alors, dans ce système, lorsqu'une pandémie survient, les problèmes sont exacerbés. En matière d'éthique, la crise a révélé la faiblesse de la démocratie sanitaire. Avec les modifications qui se sont opérées dans le système de santé, le pouvoir n'est qu'entre quelques mains.
Nous avons besoin de ce retour d'expérience car il faut que nous puissions faire la part des choses entre la non connaissance du virus, puis une connaissance progressive, et des décisions qu'il faut analyser pour ne pas réitérer les erreurs commises. C'est très important car la méfiance naît au sein de la population lorsque les décisions sont dictées par la pénurie plutôt que par la connaissance scientifique.
Sur les transferts de patients, il est important de creuser cette question d'un point de vue éthique car des urgentistes nous ont dit que, pour certains patients, ils constituaient une perte de chance. Il y a certes l'état physique du patient mais aussi son état psychologique, lié notamment à l'éloignement de sa famille.
Concernant le traçage des patients, une question éthique se pose. Il y a la nécessité de suivre les personnes contaminées par le virus mais aussi la nécessité de préserver les libertés. Quel est votre avis sur ce sujet ?
Enfin, je pense qu'on aurait besoin de se pencher sur la notion d'expert. Aujourd'hui, tout le monde se proclame expert sur les réseaux sociaux et dans les médias !

Madame Crozier, quel est votre opinion sur le fait que, selon certains médecins, le renoncement aux soins est venu des messages diffusés par la direction générale de la santé de ne pas se rendre chez son médecin sauf si on y était convoqué ?
Monsieur Hirsch, vous nous disiez que vous aviez été peu sollicité sur les questions éthiques pendant la crise. Vous-même, avez-vous contacté certaines institutions et quelles ont été leurs réponses ?

Le philosophe André Comte-Sponville a publié une tribune dans laquelle il explique que le confinement traduit une politique de précaution pour protéger principalement les populations âgées, au prix d'un effort considérable de la société. Il en conclut que c'est un basculement éthique inédit. Qu'en pensez-vous ?
Ensuite, les libertés individuelles ont été profondément encadrées pendant le confinement, notamment la liberté de culte. Le Conseil d'État a même considéré que certaines de ces restrictions étaient excessives. Où doit-on fixer le curseur entre protection de la santé et préservation des libertés ?
La question des rites funéraires et des hommages aux morts est essentielle dans notre civilisation. Où doit-on mettre le curseur entre le principe de précaution et les rites funéraires que toute société pratique vis-à-vis de ses morts ?

Ma question porte sur le rapport entre la responsabilité et l'éthique. Nous vivons dans une société de plus en plus judiciarisée et des décisions ont été dictées par la crainte du contentieux. Comment percevez-vous d'un point de vue éthique l'intensification de cette judiciarisation ?
Je vous remercie pour toutes ces questions. Concernant la communication sur les équipements de protection individuelle, elle pose la question éthique de la désobéissance à des ordres absurdes. C'est une question qui n'est pas nouvelle. On se la pose régulièrement dans nos pratiques soignantes. J'espère que cette crise va nous conduire à être en capacité d'interroger des consignes absurdes. Si on avait un doute sur la contagiosité du virus alors il fallait se protéger. Les Italiens ont vite réagi en disant qu'il fallait se protéger le visage, même avec un bout de tissu. Début mars, il n'y avait pas de consigne de port du masque pour les soignants dans mon service. C'est à ce moment-là que des soignants ont été contaminés. La question est aussi de savoir si les responsables politiques ne se sont pas défaussés sur des médecins pour prendre des décisions et les médecins n'ont pas toujours émis des recommandations basées sur le principe de précaution.
Sur les questions de logement et d'hébergement, je n'ai pas de compétence mais cela pose évidemment des questions éthiques. Ce sujet me fait penser à la question de la priorisation des équipements de protection. Ils ont été donnés d'abord à l'hôpital mais au sein même de l'hôpital, on nous culpabilisait de les utiliser. On se disait que certains services en avaient plus besoin que nous. On a donc mal fait, en réutilisant les masques par exemple, car nous avions intégré le fait qu'il y avait une pénurie.
Sur le système hospitalier, les problèmes qui se posent aujourd'hui dépassent la crise sanitaire. C'est le moment de revoir ce système, de revoir l'accès aux soins. La gouvernance du système hospitalier est une question essentielle sur laquelle il va vraiment falloir avancer.
La concurrence entre les pompiers et le Samu est un problème politique, même s'il peut poser des questions éthiques. Sur les éventuelles pertes de chances liées aux transferts de patients, il faudra évidemment savoir ce qu'il en a été. Par ailleurs, toute la dimension psychologique de la crise devra être étudiée.
La question du traçage des patients a émergé dans un climat de méfiance et de défiance, ce qui peut expliquer que très peu de personnes ont adhéré à ce dispositif. Il y a là une question de communication et de verticalité de la décision.
Sur la définition de l'expert, on pourrait y passer des heures. S'agissant de la communication de crise en général et de l'attribution du qualificatif d'expert, il y a une responsabilité des médecins et il faudra absolument qu'on s'interroge pour ne pas reproduire ces discours contradictoires.
La parole publique a effectivement eu un effet sur le renoncement aux soins. Si cette crise peut apporter des améliorations dans les échanges entre la médecine de ville et l'hôpital ce sera très bénéfique. Une autre source du renoncement aux soins vient du fait que les patients ne voulaient pas déranger les médecins en pleine crise. Il y a donc eu une part d'autocensure.
Je n'ai pas rencontré d'autres institutions que le conseil régional d'Île-de-France et le conseil scientifique. J'ai eu des échanges directs avec Jean-François Delfraissy. J'ai adressé des documents à la direction générale de la santé et j'ai eu quelques échanges avec les services de la mairie de Paris. Cela montre que la concertation est possible. Nous la poursuivons, notamment avec les associations.
Le retour d'expérience est très intéressant, nous continuons à y travailler et il faudra en tirer des enseignements. Certains services ont été très affectés pendant la crise, en raison de décisions prises qui ont remis en cause des valeurs éthiques fondamentales. Pour d'autre, la cohésion a été maintenue en s'accrochant à ces valeurs ou en s'interrogeant collectivement sur des questions éthiques. La crise a tout autant aggravé les fragilités que permis de renforcer la cohésion des équipes professionnelles.
La question de l'accueil des plus vulnérables est fondamentale. Les gymnases ou les campements étaient mal équipés pour protéger les personnes. Des structures d'accueil ont dû être fermées par manque d'équipements de protection. Les maraudes et les Samu sociaux n'ont pas déserté, il faut leur rendre hommage. Ils attendent de la reconnaissance, plus que des indemnisations.
L'image de la personne hébergée en institution a beaucoup évolué avec la crise : on s'est aperçu que ce sont des personnes qui ont encore des relations sociales.
Je suis un admirateur d'André Comte-Sponville. Bernard-Henri Lévy s'est aussi exprimé sur la crise. Leurs positions pourraient être analysées, notamment sur la critique du biopouvoir. Ce sont des questions que beaucoup de personnes se posent : comment en débat-on socialement, au-delà des tribunes ? Il faut en discuter, maintenant que la sidération est passée. Le confinement a déjà été un moment de réflexion. C'est la première pandémie que l'on a vécue de chez soi, en direct, avec l'écran de télévision pour seul horizon. On peut aussi s'interroger sur la transparence de l'information, sur la manipulation de l'information, notamment de l'information scientifique.
Je pense que ce qui est en jeu, ce sont les valeurs de la République. La pandémie est une circonstance inattendue qui fait émerger des questions politiques et éthiques qu'on ne doit pas évacuer. Nous avons vécu une période extraordinaire, marquée par la dureté abyssale de ceux qui ont vécu des souffrances irréparables, de ceux qui sont dorénavant en fragilité économique et sociale. On doit témoigner des solidarités. De mon expérience, jamais la demande d'éthique, de sens et de politique n'a été aussi forte. Je vous remercie de nous avoir associés à vos travaux et de vos nombreuses questions qui nourrissent notre réflexion. Nous sommes inquiets de repères qui s'effondrent, qui font que la question du sens de la vie en société est peut-être de plus en plus contestée.

Je vous remercie.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
La réunion est close à 12 h 35.