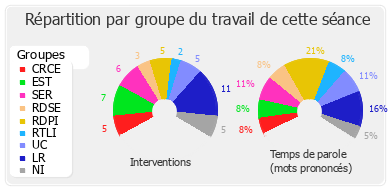Séance en hémicycle du 17 novembre 2020 à 14h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Financement de la sécurité sociale pour 2021 (voir le dossier)
- Mises au point au sujet de votes (voir le dossier)
- Alimentation locale et durable (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à quatorze heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.


Avant de passer au scrutin, je vais donner la parole à celles et ceux de nos collègues qui ont été inscrits par les groupes pour expliquer leur vote.
J’indique au Sénat que, compte tenu de l’organisation du débat décidée par la conférence des présidents, chacun des groupes dispose de sept minutes pour ces explications de vote, à raison d’un orateur par groupe, l’orateur de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe disposant de trois minutes.
La parole est à M. Stéphane Ravier, pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avec un solde déficitaire de 49 milliards d’euros en 2020 et un déficit prévu de 27 milliards d’euros en 2021, les dépenses de la branche maladie explosent. Si vous aviez effectué des réformes structurelles pour préparer l’avenir, « prévoir pour anticiper » constituant l’essence même de l’action de tout gouvernement, nous pourrions tolérer un déficit de cette ampleur ; seulement là, ce n’est pas le cas.
La forte diminution des recettes est due à un ralentissement économique majeur engendré par un confinement aussi forcé qu’économiquement suicidaire. Nous sommes le pays européen qui impose les mesures les plus drastiques et les plus incohérentes à l’encontre de ses entreprises. Un exemple : les fleuristes pourront, ce vendredi, vendre des sapins en extérieur, pendant que les foires aux santons, toutes en extérieur elles aussi, sont interdites. Ou comment rayer de la carte quatre cents emplois, mais aussi une profession, une passion, une culture, une identité !
Si nous voulons redresser les comptes sociaux, il va falloir retrouver la raison et la liberté de travailler pour tous les commerçants, les artisans et les indépendants.
D’autres conséquences dramatiques, humaines celles-là, sont annoncées. Santé publique France a publié un rapport qui indique : « La santé mentale des Français s’est significativement dégradée entre fin septembre et début novembre, avec une augmentation importante des états dépressifs pour l’ensemble de la population. »
Car ce n’est plus un Président qui nous dirige, mais le Premier Soviet entouré d’un politburo contrôlant chaque pan de notre vie quotidienne. §nous impose l’heure de sortie et l’heure de retour à notre domicile, avec qui et où nous pouvons nous déplacer, qui a le droit de travailler, qui a économiquement le droit de vivre ou de mourir, ce que nous pouvons consommer, ce que nous devons penser, ce que nous pouvons exprimer et même où nous devons prier.
Et tout cela, en s’étant affranchi du devoir démocratique de rendre compte devant le Parlement ! Incapable de contrôler l’épidémie, votre gouvernement a décidé de contrôler le peuple. La République soviétique française est « en marche » !
Nouvelles exclamations.

Je rappelle que j’ai proposé deux pistes pour améliorer la situation financière et sanitaire. J’ai ainsi déposé une proposition de loi visant à verser le montant des amendes du confinement aux hôpitaux – cela représente au moins 165 millions d’euros. J’ai aussi cosigné une proposition de loi visant à indiquer le lieu de fabrication des médicaments et de leurs principes actifs sur leur conditionnement et notice. Il faut une transparence dans l’information et il faut soutenir la réorientation des dépenses de santé vers des médicaments français. Il en va de notre souveraineté, et donc de notre sécurité sanitaire.
En trois ans, la Macronie a fabriqué un million de pauvres supplémentaires, soit dix millions au total, et cent mille sans domicile fixe de plus ! Le voilà, le nouveau monde antisocial d’Emmanuel Macron, car tout ne peut pas être mis sur le dos du pangolin.

Pour répondre à cette France en souffrance, il est temps de rétablir une véritable politique de solidarité et de justice sociale, en appliquant la priorité nationale à l’embauche, en tordant le bras à la Commission de Bruxelles, …

M. Stéphane Ravier. … en luttant contre la fraude sociale et fiscale qui nous coûte chaque année 150 milliards d’euros de manque à investir.
Marques d ’ impatience sur diverses travées.

Je refuse de cautionner cette gestion court-termiste des comptes sociaux. Mon vote sera donc défavorable !

M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche, pour le groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission des affaires sociales a entrepris l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2021 en responsabilité. Cette position l’a conduite à approuver certains des choix opérés par le Gouvernement et à s’opposer fermement à d’autres, tout en alertant sur ceux qui devront être faits demain, mais ne sont pas pour autant présents dans ce texte.
C’est en responsabilité que le Sénat a accepté des tableaux d’équilibre aux déficits historiques et un endettement record, considérant que l’urgence du moment est de tout faire pour éviter l’effondrement de notre économie et de répondre par la solidarité nationale à ceux que la crise prive de leur emploi ou revenu.
C’est en responsabilité que le Sénat a mené une « opération vérité » sur les charges respectives de l’État et de la sécurité sociale. À la sécurité sociale, les effets de la conjoncture sur les recettes et les dépenses de l’hôpital ; à l’État, la reprise de la dette hospitalière, les dépenses de Santé publique France et les compensations des mesures de compétitivité ou de pouvoir d’achat. Ce débat n’est ni théorique ni le fruit d’une vision corporatiste de la sécurité sociale. S’il faut un jour augmenter les cotisations, agir sur le niveau des prestations ou rembourser la dette, il faut que ce soit l’équilibre des assurances sociales qui le commande, et non la charge des transferts du budget de l’État.
Dans le même esprit, le Sénat a alerté sur les années à venir. Nous sommes comme anesthésiés par une mobilisation massive d’argent public, mais le réveil sera douloureux et nous n’avons pas souhaité l’occulter. Il faudra redresser la barre, certes pas aujourd’hui, ni même peut-être demain, mais certainement dès après-demain, en tout cas le plus tôt possible pour l’avenir même de la protection sociale et la préservation de cet acquis si précieux dans la crise.
Cela implique certes une réponse massive, mais pas forcément de laisser toutes les vannes ouvertes. La commission n’a pas toujours été audible sur ce point, mais elle maintient sa position et ne manquera pas de la rappeler le moment venu.
C’est encore en responsabilité que nous avons accepté la réforme de l’accès précoce aux médicaments ou la pérennisation des maisons de naissance, mais aussi fait part de nos interrogations sur l’allongement du congé de paternité et de nos questionnements, sinon de nos doutes, sur la capacité du Gouvernement à donner corps à ce projet porteur d’espoirs qu’est la nouvelle branche autonomie. Prenons garde aux promesses non tenues qui alimentent une défiance déjà très forte chez nos concitoyens !
De la même manière, la fraude aux prestations comme aux cotisations sape les fondements de notre contrat social et, à l’initiative du rapporteur général de notre commission, le Sénat a substantiellement enrichi le volet fraude de ce projet de loi.
La nécessité d’une réforme des retraites devant l’évolution de notre démographie s’était imposée avant la crise ; elle demeure d’actualité. La crise n’a pas fait disparaître ce problème, elle n’a fait que l’amplifier. Nous verrons si le Gouvernement mais aussi tous ceux à qui la position de la commission a fait pousser des cris d’orfraie ne sont pas contraints d’y revenir… Je rappelle que le texte transmis au Sénat sur le système universel de retraite n’a pas été retiré ; certains membres du Gouvernement ont rappelé l’actualité de cette réforme. Il faudra bien la mener un jour.
Nous ne pouvons pas non plus tarder sur la réforme du système de santé, dont la crise a certes montré les forces et l’excellence, mais aussi les rigidités et les cloisonnements.
L’innovation est coûteuse ; elle nous invite à revoir les organisations, à révolutionner les parcours, ou elle remettra en cause un modèle solidaire auquel nous sommes tous ici profondément attachés.
Il y a bien un modèle social « à la française » qui n’a pas fait défaut pendant la crise et continue à soutenir les malades, les retraités et les plus précaires. Pour qu’il continue de le faire demain, des réformes sont nécessaires. C’est le discours que la commission a souhaité porter.
Animé de cette même conviction, le groupe Les Républicains votera ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Olivier Henno et Mme Valérie Létard applaudissent également.

M. le président. La parole est à Mme Colette Mélot, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.
Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous avons examiné la semaine dernière le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Les débats ont été l’occasion de dresser un premier état des lieux de notre système de santé, huit mois après le début de l’épidémie de covid-19.
Nul ne pouvait prévoir cette crise. En revanche, il nous appartient à tous de réagir de façon responsable pour en limiter les dommages. Cette responsabilité partagée, nous la devons aux soignants, aux infirmiers, aux aides-soignants, au personnel des Ehpad (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), à tous les malades de la covid-19 hospitalisés. Nous la devons aussi à toutes les victimes collatérales de la crise sanitaire, les commerçants, les restaurateurs, les artisans, les artistes et tant d’autres dans de multiples secteurs qui font face aux répercussions économiques et sociales des mesures sanitaires. Des mesures graves mais nécessaires, qui appellent un financement exceptionnel, limité aux quelques années à venir.
Aussi, le texte que nous avons examiné comporte un certain nombre de mesures d’urgence, mais n’élude pas la question de réformes plus structurelles, issues notamment du Ségur de la santé.
Tout d’abord, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) pour 2020 est revalorisé de 10 milliards d’euros, auxquels s’ajoutent 2, 4 milliards votés à l’Assemblée nationale et 800 millions au Sénat, ce qui permet d’atteindre 218, 9 milliards d’euros contre les 205 milliards prévus initialement.
Une contribution exceptionnelle des organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) sera mise en place au titre des années 2020 et 2021, sachant que le Sénat a adopté une mesure de différenciation des taux applicables selon le caractère lucratif ou non de l’organisme visé. Alors que la crise sanitaire a provoqué une forte augmentation des dépenses de la branche maladie, les organismes complémentaires ont économisé 2 milliards d’euros de remboursement durant la crise. Aussi, il nous semble que cette contribution est justifiée.
D’autres mesures conjoncturelles importantes ont été adaptées à l’évolution de la crise et votées. Il s’agit de la prolongation du dispositif d’indemnité en cas d’activité partielle et de la création d’un dispositif complémentaire d’exonération des bénéfices pour les secteurs fermés totalement ou situés dans les zones de couvre-feu et ayant subi une baisse d’activité. À l’initiative du Gouvernement, les conditions de baisse d’activité ont été assouplies pour les secteurs dépendants des secteurs les plus affectés. Il s’agit d’une mesure très attendue par de nombreuses entreprises, notamment dans le secteur culturel.
La concrétisation des conclusions du Ségur de la santé constitue l’une des principales avancées du PLFSS pour 2021.
Au premier rang figure la revalorisation des salaires des personnels soignants, paramédicaux et non médicaux à l’hôpital et en Ehpad. Ces mesures sont essentielles pour améliorer l’attractivité des métiers du soin et du secteur médico-social.
Nous saluons également l’adoption d’une enveloppe de 200 millions d’euros dédiée au secteur de l’aide à domicile, qui sera versée aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Le Sénat a adopté plusieurs amendements visant à rationaliser le dispositif proposé par le Gouvernement.
Nous saluons aussi la dotation du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé de 6 milliards d’euros, dont le champ des bénéficiaires a été étendu aux cabinets libéraux.
En réponse au problème de l’engorgement des urgences, le texte prévoit la mise en place d’un forfait payant de 18 euros en remplacement du forfait de réorientation jamais appliqué. Nous sommes sceptiques sur l’efficacité d’un tel dispositif qui pourrait se traduire par un renoncement aux soins et une aggravation de l’état de santé des patients les plus précaires. Néanmoins, nous saluons l’adoption des mesures d’exonération de ce forfait, notamment pour les personnes souffrant d’une affection de longue durée (ALD). Le Sénat a également adopté un nouveau dispositif, défendu par notre groupe, permettant à titre expérimental le développement de l’offre de téléconsultation en amont du passage aux urgences dans les établissements de santé.
Je voudrais saluer la création d’une dotation finançant une mission d’intérêt général dédiée à la prise en charge des femmes victimes de violences. Hier, le ministère de l’intérieur a rendu un premier bilan à la suite du Grenelle des violences conjugales, indiquant une hausse de 16 % du nombre de victimes en 2019.
Plusieurs dispositions visent à favoriser l’accessibilité des soins sur l’ensemble du territoire. Je pense notamment à l’amendement adopté par le Sénat qui vise à encourager la poursuite d’activité des professionnels de santé situés dans les déserts médicaux qui choisissent de continuer à exercer au-delà de l’âge légal de départ à la retraite. L’instauration d’une durée légale minimale de quatre mois de stockage pour les médicaments à intérêt thérapeutique majeur va également contribuer à renforcer la continuité des soins, notamment pour les malades du cancer.
Le texte prévoit des mesures importantes concernant la politique familiale.
Nous saluons ainsi l’adoption du doublement du congé de paternité. Les amendements visant à assouplir cette mesure ont tous été repoussés. Nous savons qu’il existe de fortes disparités de prise de ce congé selon le type de contrat de travail.
Le versement de la prime de naissance a été avancé avant la fin du mois civil suivant le sixième mois de grossesse. C’est une mesure très attendue qui permettra aux familles de mieux préparer l’accueil de l’enfant.
Enfin, nous sommes bien sûr favorables à la généralisation des maisons de naissance qui seront aussi des lieux de prévention, d’éducation thérapeutique et de formation pour les sages-femmes.
Nous saluons les avancées adoptées en matière de prise en charge de la dépendance et d’adaptation de la société au vieillissement de la population, mais nous restons dans l’expectative de la loi sur le grand âge et sur le financement de la cinquième branche, sachant que plus de 6 milliards d’euros sont attendus pour couvrir les besoins.
Le Sénat a fait le choix de supprimer la reprise des 13 milliards d’euros de dette hospitalière par la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades), en considérant que cette dette relève de l’État. Nous le regrettons.
Nous avons des réserves au sujet des dispositions relatives à la réforme des retraites. Si nous sommes favorables sur le fond au recul progressif de l’âge d’ouverture des droits à 63 ans, il ne nous paraît pas opportun d’introduire dans le contexte actuel une telle mesure paramétrique au détour d’un amendement.
Forts de ce constat partagé, une large majorité de notre groupe s’abstiendra et certains d’entre nous voteront en faveur de ce projet de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe INDEP. – M. François Patriat applaudit également.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, après cette première lecture au Sénat, non seulement le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 n’a bénéficié que de peu d’amendements répondant aux défis sanitaires et sociaux, mais il repart lesté d’amendements régressifs.
Il nous a fallu défendre les quelques avancées que nous avions saluées, comme l’allongement du congé de paternité, et qui sous couvert de considérations économiques ont fait l’objet de tentatives pour en contraindre l’accès.
Alors que nous devrions consacrer l’essentiel de nos débats à construire la protection sociale de notre temps et à proposer les pistes de financement la rendant possible, ce projet de loi a moins que jamais suivi ce cheminement logique, seul susceptible de ne pas faire du PLFSS un outil d’austérité.
Comme d’habitude, le Gouvernement détermine l’enveloppe fermée des ressources et refuse toutes les propositions pour en desserrer l’étau par une taxation plus juste des revenus et des patrimoines.
La crise économique n’a que trop focalisé nos débats sur la politique d’exonération des cotisations sociales – celle-ci n’a rien de nouveau, mais elle connaît dans ce contexte une explosion inédite.
Si l’intervention de l’État en soutien de l’économie est nécessaire – elle devrait cependant être modulée, conditionnée, et exclure de l’aide ceux qui profitent du contexte pour licencier –, nous regrettons que n’aient pas été au centre de nos débats la crise sociale et les mesures sociales à prendre immédiatement pour contrer le basculement dans la pauvreté, le chômage, la précarité et la dégradation de l’état de santé de la population.
À chaque proposition de mesures sociales nouvelles, nos amendements sont déclarés irrecevables puisqu’ils entraînent des dépenses, et lorsque nous proposons de nouvelles ressources, celles-ci sont rejetées pour des raisons dogmatiques.
Pour le Gouvernement et la majorité du Sénat, il n’est donc pas d’actualité, par exemple, de réintégrer pour les oubliés du Ségur les revalorisations ou les primes covid. Ces travailleurs sociaux et médico-sociaux – assistants familiaux et bien d’autres – qui ont contribué, en première ligne, à répondre à la crise sanitaire resteront donc des invisibles.
Il n’est pas plus d’actualité de rechercher des ressources supplémentaires pour financer la cinquième branche, ou mettre fin à la destruction de l’hôpital public et à la marchandisation des champs du social et du médico-social, facteur de croissance des inégalités.
Nous pouvons certes acter l’adoption de quelques amendements : la différenciation des taxes selon le statut des organismes complémentaires, même si nous récusons l’augmentation de leur fiscalité ; une mesure destinée à lutter contre le non-recours aux prestations par les personnes en situation de précarité sociale ; ou encore le rétablissement de l’opposabilité des accords de la branche du domicile garantissant l’égalité territoriale.
Nous nous félicitons aussi de la suppression du transfert vers la sécurité sociale du financement de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), ainsi que de la suppression de la surcotisation salariale des sapeurs-pompiers.
La crise sanitaire inédite que nous traversons rend encore plus inacceptable l’absence de volonté politique de récupérer les milliards d’euros de l’évasion fiscale, d’imposer la moindre contrepartie ou conditionnalité sociale et environnementale aux plus grands groupes qui distribuent, y compris cette année, des milliards d’euros en dividendes, et enfin de soumettre à l’impôt les profits fabuleux d’Amazon, alors que le confinement est une incroyable aubaine pour cette entreprise.
Tous les amendements pour y remédier ont été rejetés, les nôtres comme ceux d’autres groupes que nous avons soutenus. Dès lors, comment combler ce déficit de ressources qui, face à des prestations dynamiques et à la création d’une nouvelle branche, fabrique le fameux trou de la sécurité sociale ? Pour la majorité du Sénat, il s’agit de le faire, toujours, en freinant les nouveaux droits sociaux ou en revenant sur la couverture des anciens, comme ce fut le cas en matière de retraites par un amendement adopté à la toute fin de l’examen de ce texte.
Or tous les partenaires sociaux refusent la réouverture inopportune, voire indécente, de ce dossier au vu des urgences immédiates de la crise actuelle et alors même que ce projet est contesté par une majorité de Français et d’organisations syndicales. Alors que la France enregistre des centaines de milliers de nouveaux chômeurs et que la moitié des retraités ne sont plus dans l’emploi au moment de la liquidation de leur retraite, la majorité sénatoriale n’a rien de plus urgent à proposer que de reculer l’âge de la retraite, véritable obsession idéologique.
Protestations sur les travées des groupes UC et Les Républicains.

Cela n’aurait jamais dû être un sujet dans le cadre de l’examen d’un projet de loi qui devait s’attacher à 2021 ! Permettez-moi tout de même de rappeler la position des écologistes sur le projet gouvernemental de réforme des retraites, lequel répond si bien aux attentes de la droite que celle-ci en demande la mise en œuvre rapide, passant outre l’échec probable et annoncé d’une conférence de financement avec les partenaires sociaux.
Cette contre-réforme vise à transformer profondément la logique solidaire, à unifier par le bas, et à livrer ce risque aux produits de retraite par capitalisation de grands groupes à l’affût de ce qui n’est, pour eux, qu’un marché lucratif.
Les écologistes défendent le système par répartition et par annuité, militent pour la réduction du temps de travail, y compris sur l’ensemble de la carrière, s’opposent aux allongements successifs de l’âge légal de départ à la retraite et pour le bénéfice du taux plein. Ils proposent une prise en compte inédite de la pénibilité des activités en vue de réduire les années d’écart d’espérance de vie en bonne santé entre catégories socioprofessionnelles – je rappelle que cet écart est de presque dix ans entre un ouvrier et un cadre.
Nous sommes des opposants résolus à cette réforme, et nous le resterons si elle devait revenir devant le Sénat, même avec des modifications à la marge qui ne feraient que préserver son économie générale.
Nous défendons une autre réforme, …

… qui s’appuie sur un paramètre volontairement occulté, devenu tabou – je sais que ce tabou fait frémir cette assemblée ! – et verrou d’une réforme progressiste.

Je veux parler de la contribution des revenus du capital (Protestations sur les travées des groupes UC et Les Républicains. – Applaudissements sur les travées des groupes GEST et SER.), qui demeure l’une des clés essentielles de l’équilibre d’un régime solidaire…

Mme Raymonde Poncet Monge. … tant pour cette branche que pour les quatre autres branches de la protection sociale.
Brouhaha.

Encore faudrait-il qu’ils se taisent !
Une raison de plus pour que le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vote contre ce projet !
Applaudissements sur les travées du groupe GEST, ainsi que sur des travées des groupes SER et CRCE.

M. le président. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d’abord d’avoir une pensée pour nos concitoyens touchés par le virus et leurs familles, ainsi que pour les salariés et les entreprises des secteurs les plus exposés. J’aurai une pensée, enfin, pour les deux millions de professionnels de santé mobilisés, alors que notre pays est frappé par la deuxième vague d’une épidémie mondiale.
L’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale est toujours un exercice particulier. Il l’est d’autant plus aujourd’hui qu’une crise sanitaire sans précédent a bouleversé nos sociétés.
Ce PLFSS devait être exceptionnel ; il l’est à bien des égards.
Il est exceptionnel par les moyens qui sont mis en œuvre pour lutter contre l’épidémie, en soutenant la modernisation de nos hôpitaux et les personnels soignants. Grâce à ce texte, ce sont 1, 8 million de professionnels et, parmi eux, l’ensemble des personnels paramédicaux des hôpitaux et des Ehpad qui bénéficieront d’une revalorisation salariale inédite et tant attendue. La traduction des accords du Ségur de la santé constitue ainsi une avancée majeure et les 19 milliards d’euros dédiés à l’investissement permettront de s’assurer que notre système de soins devienne plus efficient et plus moderne.
Il est exceptionnel, aussi, par l’ambition des mesures sociétales qu’il permet de concrétiser.
Ainsi, nous nous félicitons de l’adoption de certaines dispositions essentielles, en particulier l’allongement du congé de paternité de quatorze à vingt-huit jours, dont sept jours obligatoires. Cette réforme historique répond à une demande de la société de mieux impliquer le deuxième parent dans l’éducation des enfants et de rééquilibrer les tâches familiales dès la naissance.
Par cette disposition, et malgré des débats parfois vifs, notamment sur le caractère obligatoire du congé, nous mettons en œuvre, mes chers collègues, un outil efficace pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. Nous nous en réjouissons ! L’article 35 de ce texte répond également aux besoins des familles adoptantes, en allongeant le congé de dix à seize semaines.
La pérennisation des maisons de naissance est une autre belle concrétisation de ce projet de loi et donnera aux sages-femmes les possibilités nouvelles qu’elles méritent.
De même, l’adoption de l’amendement, porté par notre groupe, visant à s’assurer de la juste mise en œuvre de la peine de privation de la pension de réversion ou de veuf pour les conjoints survivants coupables de violences conjugales, est une avancée essentielle. La lutte contre ces violences se doit d’être menée en profondeur et nous nous félicitons que ces mesures soient prises dès à présent.
Enfin, nos débats ont aussi dessiné les prémices d’un nouvel engagement. Je pense à celui qu’a pris M. le secrétaire d’État chargé de l’enfance et des familles, concernant le remboursement des capteurs de glycémie pour les enfants de moins de quatre ans insulinodépendants et insulinorequérants.
En permettant la mise en œuvre de la cinquième branche dédiée à l’autonomie, le PLFSS concrétise enfin une avancée majeure.
Nous entendons les critiques qui ont pu être émises sur son financement ou sa gouvernance, mais les faits sont là, mes chers collègues : promesse de longue date maintes fois repoussée par les gouvernements successifs, cette nouvelle branche dédiée au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap était réclamée depuis vingt ans. C’est d’ailleurs, rappelons-le, la première fois qu’est créée une nouvelle branche depuis 1945.
La CNSA, qui sera chargée de la gestion de cette cinquième branche, sera dotée de recettes propres, ce qui permettra justement de répondre aux espoirs et aux attentes légitimes qu’elle suscite.
Le soutien accru aux secteurs les plus touchés par la crise sanitaire est un élément central de ce PLFSS. Je pense en particulier au tourisme, à la restauration, au sport, à la culture et à l’événementiel, dont l’activité est fortement réduite, pour ne pas dire inexistante, depuis plus de huit mois.
L’introduction d’un dispositif complémentaire d’exonération au bénéfice des entreprises des secteurs dits « S1 » apparaît également essentielle au regard des difficultés que rencontrent un certain nombre d’entreprises et, à travers elles, des millions de salariés.
Ce texte, par les avancées multiples qu’il concrétise, répond donc à la gravité de la situation, mais les débats au sein de notre assemblée ont aussi mis en lumière un certain nombre de désaccords sincères.
Je pense notamment à la suppression de l’expérimentation sur la pratique des IVG instrumentales par les sages-femmes, qui permettrait de pallier le manque de médecins pratiquant l’avortement, en particulier dans les territoires ruraux. Cela constitue un recul non négligeable.
De plus, l’encadrement de la reprise partielle de la dette des établissements de santé assurant le service public hospitalier répond à un devoir de solidarité, en permettant à ces établissements de santé publics d’investir. La suppression de cette disposition en séance publique nous paraît aller à l’encontre de la nécessité de les accompagner en favorisant la pérennité de leur financement.
Enfin, alors que nous débattions des mesures concrètes visant à lutter contre l’épidémie, sauver notre système de santé et soutenir les secteurs les plus touchés, la majorité sénatoriale a fait le choix de cliver sur une mesure controversée.
Je veux redire, au nom du groupe RDPI, notre opposition à l’amendement adopté par la majorité sénatoriale visant, notamment, à repousser l’âge de départ à la retraite à 63 ans. Nous nous y opposons tant sur la forme que sur le fond.
Nous regrettons la volonté de la majorité sénatoriale de profiter de cette crise sanitaire pour imposer aux Français une réforme paramétrique des retraites, laquelle aurait nécessité une large concertation associant l’ensemble des partenaires sociaux.
Nous nous interrogeons également sur le moment choisi pour faire une telle proposition, discutable sur le fond, alors que notre pays traverse une crise économique et sociale sans précédent, qui bouleverse notre quotidien et frappe un grand nombre de secteurs.
Les discussions sont d’ailleurs toujours en cours entre le Gouvernement et les partenaires sociaux. Il est donc particulièrement inopportun de vouloir accélérer le rythme d’une réforme profonde, qui nécessite du temps.
J’y insiste, nous regrettons ces mesures, tant la période que nous vivons implique, selon nous, un devoir de responsabilité afin d’apporter des réponses concrètes aux difficultés rencontrées par nos soignants, nos TPE, nos PME, nos indépendants et notre jeunesse, laquelle, nous le savons, lutte pour entrer sur le marché de l’emploi aujourd’hui encore plus qu’hier.
Pour conclure, je dirai que, en dépit des nombreuses avancées que comporte ce texte, les modifications apportées par la majorité sénatoriale suscitent plusieurs désaccords importants.
L’année 2020 restera exceptionnelle ; la question des retraites, remise chaque année sur la table par la majorité sénatoriale, n’avait aucunement sa place au sein de ce PLFSS 2021 ambitieux, examiné en période de crise.
Pour toutes ces raisons, le groupe RDPI s’abstiendra sur ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.

M. le président. La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, c’est un budget de la sécurité sociale bien différent de ceux votés ces dernières années que nous achevons d’examiner en première lecture aujourd’hui. Et pour cause : après les événements qui se sont produits, éprouvant durement notre système sanitaire déjà fragilisé par la situation préalable de nos hôpitaux et notre économie, ce PLFSS ne pouvait être comme les autres.
Nous sommes, bien sûr, face à un budget de crise. À cet égard, le groupe RDSE ne peut que saluer la sincérité des comptes présentés par le Gouvernement, malgré des désaccords au sein de cet hémicycle.
Ces comptes sont douloureux, avec un déficit du régime général de la sécurité sociale de 49 milliards d’euros. C’est inédit, presque vertigineux ! Telle est la conséquence naturelle d’une chute spectaculaire des recettes et d’une augmentation tout aussi spectaculaire des dépenses. Oui, la pandémie et ses multiples conséquences ont durablement aggravé les comptes de la sécurité sociale, lesquels connaissaient une embellie depuis quelques années. Mais des choix ont été faits pour tenter de préserver la santé de nos concitoyens et de nos entreprises, des mesures qui étaient nécessaires. En ce sens, il s’agit aussi d’un PLFSS de responsabilité.
Malgré le contexte, ce PLFSS de crise ne renonce pas à tout et fait émerger de bonnes mesures, par lesquelles j’aimerais entamer mon propos.
Tout d’abord, il prévoit 8, 8 milliards d’euros pour la revalorisation des salaires, avec notamment une augmentation visée de 15 % pour les aides à domicile, et de 183 euros par mois pour les personnels hospitaliers et des Ehpad. Ce rattrapage était attendu.
Ensuite, il contient une avancée sociale majeure qui a fait débat au sein de notre hémicycle, avant d’être adoptée à la quasi-unanimité : l’allongement du congé paternité. La vision patriarcale de la société a vécu. Les pères ne veulent plus être traités comme des parents de seconde zone. Aujourd’hui, l’arrivée d’un enfant est un événement qui bouleverse l’existence des deux parents, qui cherchent ensemble à construire une parentalité fondée sur la proximité affective.
Je ne reviendrai pas sur les nombreux bienfaits de cette mesure sur le développement de l’enfant. Je rappellerai seulement qu’il s’agit d’une véritable avancée pour l’égalité entre les femmes et les hommes, avancée très attendue par les jeunes générations. Nous pouvons collectivement être fiers du large soutien que lui a apporté le Sénat.
Le groupe RDSE se réjouit également de l’adoption d’une mesure, que nous avons soutenue, visant à faire des maisons de naissance des lieux de formation et de prévention, et à les déployer sur le territoire.
Nous saluons, par ailleurs, l’accord trouvé avec le Gouvernement sur le soutien aux entreprises touchées par le couvre-feu et le reconfinement, en particulier celles qui dépendent de secteurs directement touchés.
Attaché à la défense de la ruralité et des terroirs, le groupe RDSE se félicite aussi des mesures de soutien apportées au secteur agricole, notamment au bénéfice des travailleurs occasionnels et des jeunes agriculteurs. Nous nous félicitons particulièrement de l’allégement des cotisations sociales pour les non-salariés de la culture de la vigne ayant subi des pertes de chiffre d’affaires, combat porté par ma collègue Nathalie Delattre.
Concernant l’organisation de notre système de santé, il me faut évoquer l’adoption d’un amendement, que nous avons été nombreux ici à porter, prévoyant de réduire d’un an le report de la convention médicale actuelle entre l’assurance maladie et les médecins libéraux. Nous avons beaucoup parlé de l’hôpital, alors que les appels à remettre les généralistes au cœur du système se multiplient, à juste titre : les liens ville-hôpital sont les garants du bon fonctionnement de notre système de soins.
Nos médecins libéraux sont nos personnels de premier recours, mais ils se sentent aujourd’hui oubliés. Repousser trop loin les négociations conventionnelles sur leurs conditions de travail et de tarification ne serait pas un bon signal.
Les mesures de transparence adoptées par le Sénat vont aussi dans le sens d’une avancée, avec notamment une plus grande lisibilité demandée aux agences régionales de santé (ARS) sur l’utilisation des deniers publics et l’allocation des ressources financières aux activités de santé.
Enfin, je souligne une autre mesure d’importance sur un sujet que le Sénat porte depuis plusieurs années : l’instauration d’un stock minimal de quatre mois pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur. Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient et mettent en danger la santé de nos concitoyens. La question de la responsabilité de l’État et des laboratoires ne doit pas être occultée. Ce sont des actes que nous attendons, et je me réjouis que le Sénat tienne ferme ses positions.
Cela étant dit, je m’abstiendrai à titre personnel sur ce PLFSS, mais la majorité du groupe RDSE votera contre.
Pas plus que la réduction de la durée de prise en charge à 100 % des actes de téléconsultation, que nous ne pouvons soutenir dans le contexte d’une pandémie exceptionnelle qu’il serait illusoire de croire achevée dans six mois, et pas plus le maintien du forfait patient urgences (FPU) qui, sans être assorti de mesures en amont, ne remplira jamais son rôle de désengorgement des urgences et ne fera qu’accroître le reste à charge des patients ou le renoncement aux soins, nous ne soutiendrons les dispositions votées par la majorité sénatoriale au sujet des retraites.
Certes, il existe un problème structurel, nous partageons ce constat. Mais dans cet hémicycle où nous prônons sur toutes les travées, les bienfaits de la concertation, il nous semble important de défendre, pour une réforme d’une telle ampleur, un débat et un véhicule législatifs à la hauteur de l’enjeu.
Pour conclure, je dirai que ce PLFSS voit émerger de bonnes mesures et quelques marqueurs pour l’avenir, telle la création de la cinquième branche autonomie, même si son financement reste encore à préciser.
Cependant, d’une part, l’État persiste à ne pas compenser certaines charges indûment confiées à la sécurité sociale, contrairement à l’esprit de la loi Veil de 1994. D’autre part, l’augmentation de l’Ondam est cette année conjoncturelle, et vise surtout à répondre à la crise.
Permettez-moi de rappeler, madame la ministre, que des changements majeurs sont attendus, notamment depuis le Ségur de la santé. Aucun texte n’y a, pour l’heure, répondu. Espérons donc que, dans les prochains mois, une nouvelle réforme d’organisation du système de santé verra le jour pour concrétiser, conformément aux engagements du Gouvernement, les attentes fortes des Français, des professionnels et des élus. Cette organisation doit laisser davantage de place à la proximité, à la décentralisation et à la souplesse pour les acteurs de terrain. Espérons aussi qu’elle ne subisse pas le sort des réformes des retraites et du grand âge, trop de fois reportées.
De grands défis vous attendent : ils ne doivent plus être repoussés.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, après cinq jours d’examen de ce PLFSS pour 2021, c’est la déception et la colère qui dominent au groupe CRCE. L’absence, jusqu’au bout, du ministre de la santé n’est pas pour nous apaiser !
Déception et colère, car ce PLFSS n’est pas à la hauteur de la crise que nous affrontons et de ce qu’elle a révélé. Il ne résout aucun des problèmes soulevés par les personnels soignants et non soignants des secteurs de la santé et du médico-social.
Vous qualifiez d’extraordinaire ce PLFSS, madame la ministre, parce qu’il débloque les 8 milliards d’euros du Ségur de la santé et 4 milliards d’euros pour la covid-19. Mais vous oubliez de dire que c’est conjoncturel, et que vous avez prévu de « serrer les boulons » dès la crise passée.
Vous avez refusé, comme la majorité de droite du Sénat, de faire entrer de nouvelles recettes taxant le capital, qui profite de la crise. Les grands groupes du CAC 40 peuvent dormir sur leurs deux oreilles, notamment Sanofi, laboratoire pharmaceutique parmi les leaders européens qui va pouvoir continuer à fermer ses sites de recherche et de production en France et licencier à tour de bras, tout en versant des dividendes indécents à ses actionnaires !
Aucune intervention de l’État n’est envisagée pour avoir la maîtrise publique de la production et de la distribution des médicaments, alors que la crise de la covid-19 a révélé plus fortement que jamais une pénurie de médicaments, et que vous refusez de constituer des stocks suffisants.
Quant aux mesures censées renforcer notre système de santé, pallier les difficultés et les manques criants de personnel, de matériel, de locaux, elles vont à l’encontre de l’intérêt commun.
Au lieu d’ouvrir des lits d’amont et d’aval, vous imposez un forfait à 18 euros pour, soi-disant, lutter contre la saturation des urgences, ce qui est une absurdité économique et pose un grave problème de santé publique.
Au lieu d’œuvrer pour un meilleur maillage de l’offre de soins dans les communes, vous portez un coup grave aux centres de santé, en exigeant un conventionnement sélectif par les ARS pour toute nouvelle ouverture dans les zones surdotées.
C’est un obstacle supplémentaire pour les centres de santé. Vous faites preuve, une nouvelle fois, d’une méconnaissance totale des valeurs qui les fondent, après l’introduction il y a deux ans de la possibilité pour les libéraux d’y exercer leur activité ! Face aux départs de plus en plus nombreux de professionnels de santé, aucun plan de formation et de recrutement n’est envisagé. Inutile, dès lors, d’espérer une amélioration de leurs conditions de travail.
Pourtant, chacune et chacun, ici, a rendu hommage aux médecins, aux infirmières et infirmiers, aux aides-soignantes et aides-soignants, aux brancardiers. Mais quelle traduction réelle dans ce PLFSS ?
Alors que la psychiatrie et la pédopsychiatrie sont sinistrées, ce PLFSS n’ouvre même pas sur une grande loi de santé mentale et poursuit une réforme tarifaire à base de tarification à l’activité (T2A), ce qui aggravera la situation !
Il n’y a pas davantage de mesures significatives pour mettre en œuvre le fameux « tester, tracer, isoler ». Et aucune prise en charge à 100 % pour les masques, devenus obligatoires dès l’âge de 6 ans.
Quant à votre cinquième branche, ce n’est rien de moins que l’exclusion de la perte d’autonomie des principes de la sécurité sociale et la privatisation du système.
Finalement, ce PLFSS pour 2021 est un rendez-vous manqué, malgré quelques mesures positives que nous avons soutenues, comme l’allongement du congé paternité – mais nous en avons souligné les limites.
Rendez-vous manqué, madame la ministre, car le gouvernement auquel vous appartenez reste sur les mêmes orientations politiques qui ont conduit notre système de santé là où il en est aujourd’hui.
Vous refusez d’investir dans le système de santé pour ne pas augmenter la dette transmise aux futures générations. Mais si l’investissement consiste à construire des hôpitaux, des Ehpad, des centres médico-psychologiques (CMP), les futures générations seront bien contentes d’avoir cette créance pour leur prise en charge, dans un contexte de vieillissement de la population !
À cause de ce refus de suivre une autre voie, le jour d’après, avec vous, sera pire que le jour d’avant !
Cette voie conduit notre système de santé dans le mur, et pas seulement l’hôpital, car rien n’est prévu non plus pour la médecine de ville face au manque cruel de généralistes, et rien sur la mise à contribution des établissements privés pour la prise en charge des malades de la covid-19.
Hélas, quoique mortifère, cette voie est également suivie par la majorité de droite du Sénat qui a aggravé les mesures régressives de ce PLFSS en votant, en pleine crise de la covid, le recul de l’âge de départ à la retraite à 63 ans et l’allongement de la durée de cotisations à 43 annuités.
Exclamations sur les travées des groupes Les Républicains et UC.

C’est totalement indécent, au moment où les plans de licenciement explosent et où de nombreux jeunes en recherche d’un travail vont devoir pointer à Pôle emploi. Le prétexte du comblement du déficit de la caisse des retraites ne tient pas, car il se double d’un refus d’envisager d’autres recettes.
Pour l’ensemble des membres de notre groupe, ce PLFSS, c’est non !
Non à un budget insuffisant ! Non à un budget décalé de la réalité de la crise sanitaire !
Protestations sur les travées des groupes UC et Les Républicains.

Non au manque de reconnaissance des professionnels des secteurs de la santé et du médico-social ! Non à l’absence de plan de formation et de recrutements ! Non, enfin, au refus de mise à contribution des plus riches et des dividendes !
Nous disons, au groupe communiste républicain citoyen et écologiste, qu’un budget de la sécurité sociale pour 2021 tenant compte de la pandémie de covid-19, et s’inscrivant dans l’avenir, est possible.
Avec la suppression des allégements de cotisation patronale d’assurance maladie du CICE et sur les bas salaires, la suppression de la taxe sur les salaires des hôpitaux et Ehpad publics, nous pourrions, mes chers collègues, récupérer 50 milliards d’euros pour financer la prise en charge à 100 % des soins, le recrutement immédiat de 100 000 personnels dans les hôpitaux et les Ehpad, et revaloriser de 300 euros les salaires des personnels, ce qui améliorera véritablement l’attractivité de ces métiers.
C’est ainsi que l’on peut préparer la société de demain à faire face aux pandémies, sans lui imposer le confinement comme seul horizon.
En ce 75e anniversaire de la sécurité sociale, mes chers collègues, je conclurai en citant ces propos d’Ambroise Croizat, le bâtisseur de la sécurité sociale
Ah ! sur les travées du groupe Les Républicains.
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe CRCE et des travées du groupe SER.

M. le président. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour le groupe Union Centriste.
Applaudissements sur les travées du groupe UC. – Mme Catherine Deroche applaudit également.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 s’achève, nous laissant estourbis et pantois, quelque peu sonnés, je dois dire. Est-ce le manque de sommeil, l’intensité parfois des échanges, la valse des milliards, l’incongruité à vouloir prévoir l’avenir budgétaire, alors que personne ne sait où nous allons ? Ou encore les innovations, souvent importantes, introduites par ce texte, et quelques inévitables déceptions ?…
« Mieux vaut une amère vérité qu’un doux mensonge », dit un proverbe russe. Alors, regardons la réalité en face !
La crise sanitaire sans précédent de l’année 2020, qui n’a pas justifié pour le Gouvernement l’élaboration d’un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, tandis que le Parlement a planché sur quatre projets de loi de finances rectificative (PLFR) successifs, appelait des mesures d’ajustement budgétaire afin d’amortir, autant que faire se peut, le surcoût engendré par l’épidémie de covid, et les dispositions du Ségur de la santé.
Ainsi, le fait marquant de ce PLFSS est sans aucun doute cet abyssal déficit de 49 milliards d’euros de premiers secours.
À situation exceptionnelle, remèdes exceptionnels ! Ainsi, chronologiquement fut d’abord votée une contribution des organismes complémentaires en santé. La modulation pour les organismes mutualistes a entraîné, dès la première heure, un manque à gagner de 400 millions d’euros. J’ai alors songé que, dans nos collectivités territoriales, on ne votait pas une mesure sans connaître son impact budgétaire. Il serait bon que les parlementaires disposent systématiquement des mêmes outils d’appréciation. C’était une remarque préliminaire…
L’un des objets de ce PLFSS était de permettre la mise en œuvre des mesures du Ségur de la santé, en particulier l’augmentation salariale des personnels des établissements de santé et des Ehpad, et le financement de la prime exceptionnelle pour les personnels des services d’aide à domicile.
Je veux dire un mot, ici, pour tous ceux qui se sentent oubliés du Ségur, exclus de la reconnaissance nationale. Nous sommes nombreux, sur l’initiative de notre collègue Élisabeth Doineau, à avoir cosigné un courrier vous demandant, madame la ministre, d’accorder une bienveillante attention à tous ces « autres » professionnels qui ont, aussi, fait leur part. La santé est un système vaste et complexe qui va bien au-delà des murs de l’hôpital, et les applaudissements symboliques des Français sont allés, dans les moments les plus durs, à chacun des acteurs de cette longue chaîne humaine.
Dans la suite de nos débats, l’article 6 t er a marqué la volonté forte du Gouvernement d’aider les employeurs par une exonération totale de contributions sociales. Cela illustre le « quoi qu’il en coûte » qui, dans les heures de grand doute et de désespoir, doit être une planche de salut. Le champ de cette mesure est large. Espérons seulement qu’il n’y ait pas trop de trous dans la raquette… Merci, madame la ministre, de mettre en œuvre ces véritables outils de solidarité nationale.
Je note l’adoption, aux articles 13 et suivants, de l’exonération des cotisations sociales pour les salariés non agricoles des exploitations viticoles, ainsi que la pérennisation et le relèvement du taux du dispositif d’exonération pour les travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi, dits « TO-DE ». Espérant pour ces filières que ces mesures puissent prospérer, je souligne ainsi un exemple concret de soutien aux professionnels.
Puis vint le moment de créer cette fameuse « cinquième branche », cette décision de traiter à part entière la dépendance, de donner un cadre aux futures mesures du grand âge et de la perte d’autonomie. De nombreuses questions et inquiétudes subsistent sur son financement, qui ne pourra pas reposer principalement sur la contribution sociale généralisée (CSG), son périmètre et sa gouvernance.
Était-ce le moment ? Le rapport Libault prévoyait cette création à l’occasion de l’extinction de la dette sociale, afin que puisse être utilisé le produit de la CRDS pour soutenir cette branche. Cette extinction a été reportée, hélas, à un horizon lointain. Fallait-il différer encore ?
Nous nous interrogeons aussi sur le transfert de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Le périmètre est-il amené à évoluer ultérieurement ?
Notre collègue Jocelyne Guidez, par ses remarques sur l’AEEH, nous invite par ailleurs à nous interroger sur la portée symbolique des dispositions. Un individu porteur d’un handicap est-il d’abord porteur de handicap, ou d’abord un enfant ? Puis, porteur de handicap ou retraité ? C’est la difficulté de classer les êtres humains dans des cases…
Ce texte apporte des avancées attendues et des propositions innovantes – versement anticipé de la prime de naissance ; création des maisons de naissance ; hôtels hospitaliers –, ainsi que cette mesure fort médiatisée visant à allonger le congé de paternité à vingt-huit jours, dont sept obligatoires.
Me singularisant un peu dans cet hémicycle, j’ai exprimé ma crainte que l’on aggrave ainsi le fossé existant dans notre société entre ceux qui ont un salaire et ceux qui n’en ont pas. Cependant, le Sénat, dans son immense majorité et sa très grande sagesse, a franchi ce pas.
Médicaments innovants, stocks, téléconsultation, pénurie de professionnels de santé, répartition territoriale des médecins, dette hospitalière, médecine hospitalière, médecine de ville, médecine privée, sport et santé, périnatalité, concertation sur l’âge de la retraite… tout le champ des sujets d’une brûlante acuité dans ce contexte sanitaire a été longuement balayé.
Je souhaite enfin m’attarder sur un sujet particulier, un de ceux que nos concitoyens attendent de voir évoqués, même s’il ne fit pas beaucoup frémir le banc des ministres : la fraude.
Notre collègue Nathalie Goulet a déposé de nombreux amendements relatifs à ce problème car elle maîtrise parfaitement ce dossier, qui est par ailleurs pointé dans nombre de rapports publics et officiels. Alors que le simple croisement de fichiers permettrait de mettre fin à bien des pratiques malhonnêtes, on se demande si l’atonie des débats ne confirme pas une forme de banalisation de la fraude.
Madame la ministre, devant tous ces amendements qui ont été déclarés « satisfaits », je réponds que nous ne sommes pas satisfaits ! Pour lutter contre la fraude, il faut plus que des lois, il faut une volonté ! Beaucoup de mesures relèvent du réglementaire, à vous de les prendre ! Plus que jamais, en période d’austérité et de rigueur, les Français vous attendent sur ce sujet.
Madame la ministre, avant de conclure, je veux souligner le nombre d’amendements partis au panier au titre de l’article 40 de la Constitution et consorts, ou repeints en une « demande de rapport ». Entendez derrière tout cela que nombre de sujets, remontés de nos territoires, ne trouvent pas d’écho ! Comment pouvons-nous les porter ?
Je vous donne un exemple : les préparations magistrales de mélatonine, qui permettent aux enfants autistes de trouver le sommeil, ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Sur ce sujet, on nous rétorque « article 40 », « rapport », quand ce n’est pas une question écrite qui reste sans réponse… C’est pourtant le souci de milliers de parents, qui ont besoin de dormir un peu pour faire face à un quotidien difficile ! Comment se faire entendre, lorsque le ministre des solidarités et de la santé ne souhaite pas prendre sa place sur ce banc ?
Je rejoins ceux de mes collègues qui ont appelé à une refonte profonde et concertée de notre système de santé.
Je conclus en remerciant ceux qui nous ont accompagnés pendant de longues heures, en soulignant le travail remarquable de mes collègues sénateurs centristes, notamment au banc des commissions, qui ont permis l’adoption de nombreux amendements.
Le groupe centriste votera cette version du PLFSS amendée par le Sénat.
Puisqu’il me reste quelques secondes, je citerai les mots pleins de sagesse du Nivernais Romain Rolland : « L’équilibre est la règle souveraine des plus grands comme des plus petits. » C’est un vœu pieux !
Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains.

M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, écrire une loi de financement de la sécurité sociale conforme à la réalité dans ses équilibres financiers est une gageure, alors que nul ne sait précisément ce que le coronavirus, qui a déjà coûté la vie à 45 000 de nos compatriotes, nous réserve pour 2021.
La question n’est évidemment pas de se prononcer sur cette adéquation : ce PLFSS établira probablement un record d’imprécisions. C’est plus que jamais le sens politique du texte qui engage notre avis.
Voilà huit jours, à cette même tribune, je dressais le constat d’un rendez-vous manqué. Au sortir de son examen par notre assemblée, quelques dispositifs intéressants utiles plus tard, mais aussi après quelques reculs voulus souvent par la majorité de notre assemblée, le constat reste le même. Le rendez-vous avec l’hôpital reste inachevé, partiel et conjoncturel. Rien ne change dans la gouvernance et trop peu dans les moyens. Les urgences sont encore et toujours abordées sous le seul angle d’un dispositif de nature financière.
Les soignants de ville, eux, restent destinataires de discours inappliqués sur leur rôle essentiel. Les aides à domicile devront se contenter de bien peu. Quant à la démocratie sanitaire, tellement malmenée depuis le printemps, oubliée jusqu’à compromettre l’adhésion de la population aux mesures de lutte contre l’épidémie, elle continuera à être marginalisée. Et si l’ajout de 100 millions d’euros déconcentrés vers les ARS doit être salué, rien dans votre amendement ne nous dit si la logique de leur engagement sera encore une fois purement verticale, ou si les acteurs des territoires y seront associés.
Comme toute loi de financement de la sécurité sociale, celle-ci comporte des points positifs qui méritent d’être relevés. C’est le cas du congé paternité et de la création de maisons de naissance, par exemple.
J’ajouterai plusieurs mesures qu’a proposées, ou auxquelles a contribué, notre groupe : la lutte contre le non- recours aux aides sociales ; la pérennisation du dispositif TO-DE ; l’obligation de constitution d’un stock de quatre mois pour les médicaments majeurs, alors que tant de malades sont victimes de ces ruptures ; le renforcement de la protection des patients soumis à des mesures de contrainte en psychiatrie ; le retour de l’Agence nationale de santé publique dans le budget de l’État.
Cela ne dissipe pas notre inquiétude face à votre choix de « charger la barque » du budget social dans son exécution annuelle et dans son endettement, lequel s’accroît de ce qui devrait être à la charge du budget de l’État.
Les conditions mêmes d’examen du texte disent beaucoup. Présenté très tardivement, dépourvu d’étude d’impact sur des dispositions introduites, elles aussi, tardivement, examiné en moins de temps qu’il n’en faut pour que le travail soit suffisamment approfondi, il a de plus été modifié significativement par le Gouvernement en cours de débat.
Tout cela aurait pu être largement évité si le Gouvernement avait accédé, l’été dernier, à notre demande d’un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale.
Cette demande, nous la réitérons pour le premier semestre 2021.
Concernant la cinquième branche, dont nous approuvons la création, ses conditions d’ébauche renforcent ce sentiment : l’État fait du paritarisme un façadisme ! La conférence des financeurs est certes un outil nécessaire, mais sans la visibilité qu’offrirait une nouvelle loi relative au grand âge et à l’autonomie, que pourra-t-elle décider ?
Le temps des crises doit être celui des changements. Cette crise n’est pas un accident de l’histoire. En son lendemain, il ne suffira pas de reprendre une trajectoire de rétablissement des comptes sociaux, comme certains discours le laissent entendre. Cette crise est systémique et doit nous amener à revoir notre système de santé et à repenser le sens de notre protection sociale. Elle a d’ores et déjà révélé des défauts organisationnels majeurs de l’État et de notre gouvernance en matière de santé publique, ainsi qu’une crise de la décision.
Le texte que vous nous proposez, madame la ministre, n’apporte pas la part de réponses à cette crise qu’il aurait dû contenir. Les silos que nous connaissons bien continueront d’exister. L’État central a présenté des failles inquiétantes et la part nécessaire de décentralisation de notre politique de santé est absente de ce texte. Ce n’est d’ailleurs pas surprenant, puisque le ministre de la santé, qui ne nous fait toujours pas l’honneur d’être présent dans cet hémicycle, a exprimé son opposition à cette orientation.
L’amendement n° 201 porte un privilège rare : à lui seul, il disqualifie le texte qui nous est proposé. Son objet est notre système de retraite. Il exprime un message politique : à l’heure où la situation sociale est dramatique pour nombre de nos compatriotes, ses auteurs leur demandent de travailler plus longtemps. Ils le demandent même aux plus pauvres, pour des pensions qui seront inévitablement plus faibles, et ce alors que la majorité sénatoriale refuse avec constance – je le regrette ! – l’idée d’une contribution des plus riches à la situation exceptionnelle que nous vivons.
Applaudissements sur les travées du groupe SER, ainsi que sur des travées du groupe GEST.

C’est votre choix, que vous avez fait devant la Nation par votre vote. Mais pour nous, c’est non ! Ce budget social est un budget d’injustice sociale !
Ce n’est pas acceptable, et nous l’exprimerons par un vote négatif sur ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe SER, ainsi que sur des travées des groupes GEST et CRCE.

Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, modifié, l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.
En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 26 :
Le Sénat a adopté.
Avant de donner la parole à Mme la ministre déléguée, je souhaite remercier la présidente de la commission des affaires sociales, Mme Catherine Deroche, son rapporteur général, M. Jean-Marie Vanlerenberghe, ainsi que ses rapporteurs, pour le travail qu’ils ont accompli avant et pendant nos débats. Je veux également remercier l’ensemble de nos collègues, et vous aussi, madame la ministre déléguée, même si j’ai compris que l’absence de M. Véran suscitait des regrets : il faut dire les choses comme elles sont !
Vifs applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et SER.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je tenais à vous adresser quelques mots au terme de vos explications de vote et du vote lui-même.
Tout d’abord, je veux vous remercier pour ces échanges, pour les débats auxquels j’ai pu prendre part, avec mes collègues du Gouvernement, au cours de la semaine dernière. Vous savez que j’ai un profond respect pour le travail parlementaire, auquel j’ai pris part pendant bien des années. Si je ne pouvais, en revanche, faire valoir une telle connaissance de la Haute Assemblée, je dois dire que j’en ai reçu cette fois mon baptême !
Sourires.
Je dois dire que j’ai trouvé nos débats francs et intéressants. Il ne m’appartient évidemment pas de juger de votre vote, qui est souverain. Le travail parlementaire se poursuivra, puisque vous allez vous réunir avec vos collègues députés en commission mixte paritaire.
Sans préjuger de l’issue de celle-ci, je tiens à saluer quelques avancées majeures que vous avez introduites ou entérinées.
Dans le contexte sanitaire actuel, que chacun a rappelé, je pense en premier lieu au relèvement de 800 millions d’euros de l’Ondam, en plus des 2, 4 milliards d’euros déjà votés par l’Assemblée nationale. Ce relèvement permet de financer la stratégie de tests de la population, ainsi que les surcoûts induits par les outils de protection supplémentaire des professionnels dans les établissements sociaux et médico-sociaux.
Je salue également le soutien que vous avez apporté à l’allongement du congé de paternité, qui ouvre une démarche essentielle. Celle-ci nous permettra, d’une part, de renforcer les liens intrafamiliaux au cours d’une période précieuse dans la vie des parents et, d’autre part, de parvenir progressivement à une nécessaire égalité entre les femmes et les hommes dans les carrières et leur organisation.
Je pense aussi à la revalorisation salariale dans les Ehpad, issue du Ségur de la santé, mais surtout à l’adoption conforme du financement conjoint de la prime destinée aux travailleurs de l’aide à domicile, en récompense de leur mobilisation auprès de nos concitoyens en perte d’autonomie, y compris pendant la crise sanitaire que nous connaissons. Cette mesure relevait à mon sens d’une double gageure : elle vise à entamer le virage domiciliaire que nous appelons de nos vœux, mais aussi à accompagner les départements, qui se préparent à assumer cette compétence dans ce secteur.
Une autre mesure de ce texte vise à ce que la nouvelle branche vienne cofinancer une revalorisation des aides à domicile. Je regrette que la rédaction adoptée par votre assemblée laisse entendre que cette revalorisation salariale s’arrêtera à mi-chemin et que les départements n’y contribueront pas, alors que c’est de leur compétence et que nous y travaillons déjà ensemble. Je suis persuadée que, par le dialogue avec l’ensemble des parlementaires des deux chambres, nous parviendrons à un équilibre.
Je suis très attachée à ce dialogue et j’espère que nous pourrons le poursuivre en bonne intelligence. Les Français l’attendent. Nous serons, ensemble, à la hauteur du moment !
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi que sur des travées du groupe UC.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à quinze heures quarante, est reprise à quinze heures cinquante, sous la présidence de Mme Nathalie Delattre.

Je souhaite rectifier le vote du groupe RDPI lors du scrutin n° 24 sur l’amendement n° 26 rectifié bis, présenté par Mme Sylvie Vermeillet et plusieurs de ses collègues, tendant à insérer un article additionnel après l’article 1er du projet de loi de finances rectificative pour 2020.
L’ensemble des membres de mon groupe souhaitait voter pour cet amendement, et non pas contre.

Je souhaite, pour ma part, apporter une mise au point concernant le scrutin n° 22 sur l’article 35 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Ma collègue Muriel Jourda souhaitait voter contre cet article.

Lors du scrutin n° 23 sur l’amendement n° 201, présenté par M. René-Paul Savary au nom de la commission des affaires sociales, et tendant à insérer un article additionnel après l’article 47 quater du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, mon collègue Pierre-Antoine Levi et moi-même souhaitions nous abstenir.

Lors de ce même scrutin, je souhaitais voter contre l’amendement n° 201.

Acte est donné de ces mises au point. Elles seront publiées au Journal officiel et figureront dans l’analyse politique des scrutins concernés.

L’ordre du jour appelle le débat, organisé à la demande du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, sur le thème : « Alimentation locale et durable. »
Nous allons procéder au débat sous la forme d’une série de questions-réponses, dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents.
Je rappelle que l’auteur de la demande dispose d’un temps de parole de huit minutes ; le Gouvernement répond ensuite pour une durée équivalente.
À l’issue du débat, l’auteur de la demande dispose d’un droit de conclusion pour une durée de cinq minutes.
Dans le débat, la parole est à M. Frédéric Marchand, pour le groupe auteur de la demande.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la crise sanitaire sans précédent que nous connaissons a mis en lumière, parmi les sujets que nous pensions – funeste erreur ! – acquis ad vitam æternam, celui de l’alimentation, celui de notre alimentation.
Ce bien commun est sans conteste celui qui importera le plus dans les semaines, les mois et les années à venir, celui sur lequel il est urgent, sans transiger, de prendre des engagements forts. Les mesures du plan de relance que vous portez, monsieur le ministre, sont à cet égard significatives.
Oui, cette crise nous rappelle toute l’importance de ce que nous pouvons nommer la « sécurité alimentaire », le besoin de savoir que l’on pourra s’alimenter en quantité mais aussi en qualité suffisantes !
Cette question, la plus ancienne du monde, est celle que pose Stéphane Linou dans son ouvrage Résilience alimentaire et sécurité nationale, qui a d’ailleurs servi de base à une proposition de résolution déposée par notre ancienne collègue Françoise Laborde, que je veux ici saluer.
La question de l’alimentation durable et locale est aussi au cœur de l’excellent rapport d’information rendu au nom de la délégation sénatoriale à la prospective par notre collègue Jean-Luc Fichet et notre ancienne collègue Françoise Cartron, à qui je veux ici adresser un salut amical.
Oui, monsieur le ministre, nous sommes nombreux, sur ces travées et dans nos territoires, à penser qu’il est désormais urgent de donner à l’alimentation un véritable statut.
Il est temps d’en faire définitivement un secteur d’activité d’importance vitale, tel que défini par l’article R. 1332-2 du code de la défense, plutôt que de continuer de s’en tenir à sa seule dimension sanitaire. Alors, nous serions peut-être capables de doter notre pays, par exemple, de véritables indicateurs sur les flux d’approvisionnement alimentaire sur notre territoire, de manière à permettre une approche plus précise et préventive de la réalité alimentaire de notre pays.
Cette crise sanitaire a eu quelques vertus, si je puis me permettre cette expression : elle nous a ainsi fait redécouvrir la signification de concepts essentiels dont nous pensions parfois qu’ils n’étaient que des vœux pieux.
Concept de la solidarité, d’abord, avec nos agriculteurs, producteurs et maraîchers qui ont été, dans nos villes et nos campagnes, au moment du premier confinement, frappés de plein fouet par l’arrêt de la restauration collective et de la restauration hors foyer. Ils ont su se réinventer dans l’urgence, avec l’aide des restaurateurs et des collectivités ; depuis le début du deuxième confinement, ils sont toujours au rendez-vous.
Concept de la proximité, ensuite : certaines habitudes de consommation ont évolué, ce qui a suscité un développement sans précédent des circuits courts pour le bonheur d’un segment très large – les études le montrent – des consommateurs.
Concept de la qualité, aussi, avec une exigence renforcée au nom de principes sanitaires, mais également une plus grande appétence pour les bonnes choses produites de manière vertueuse.
Concept de la saisonnalité, enfin, avec la redécouverte de produits locaux et de saison, et une palette de productions qui permet de mélanger allégrement les goûts et les couleurs.
Ce constat posé, quelles pistes explorer pour faire en sorte que le monde d’après ne ressemble pas au monde d’avant, et pour que ce moment éphémère, dont certains producteurs nous disent qu’il n’est déjà plus qu’un vague souvenir pour des consommateurs qui ont retrouvé leurs habitudes antérieures, donne le top départ d’une résilience alimentaire partagée par toutes et tous ?
Derrière cela, c’est toute la question de notre souveraineté alimentaire qui ressurgit. Je sais, monsieur le ministre, que vous en avez fait la priorité des priorités.
« Nous ne pouvons plus déléguer notre alimentation », indiquait le 12 mars dernier le Président de la République.
La France est un grand pays agricole exportateur, mais elle est aussi un pays qui s’est inspiré du modèle américain mondialisé. Or ce modèle nous fait transférer d’énormes flux d’intrants, d’énergie ou d’azote du Brésil, pour nourrir des animaux que nous exportons ensuite vers le Moyen-Orient, le tout dans des conditions sociales difficiles et avec des coûts considérables pour la politique agricole commune (PAC).
En France, par ailleurs, nous ne produisons que 50 % des légumes que nous mangeons, et 40 % de nos besoins en fruits. Au risque d’enfoncer des portes ouvertes, il nous faut réaffirmer un principe fort : reconstituer nombre de filières qui ne peuvent être que maraîchères, ou presque, le sud de la France étant, par exemple, fort touché par le changement climatique.
Alors que nous exportons des volailles, nous importons 40 % des poulets que nous mangeons ; il convient de corriger cette inadéquation pour que la relocalisation de qualité prenne tout son sens. Pour les viandes, nous importons principalement les produits les moins chers, souvent pour la restauration collective.
Sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire, garantie d’un accès à une alimentation de qualité pour nos concitoyens, notamment pour celles et ceux qui subissent le plus la précarité, préservation de la biodiversité : voilà, monsieur le ministre, les piliers qui devraient inspirer des contrats alimentaires territoriaux passés avec les collectivités, véritables feuilles de route pour une transition agricole et alimentaire partagée par le plus grand nombre.
On m’objectera que les projets alimentaires territoriaux (PAT) sont la réponse déjà mise en place. Ils représentent à l’évidence une avancée, mais leur prisme par trop restrictif, parce qu’articulé autour de la question – certes essentielle mais non unique – de la restauration collective, leur caractère facultatif et le peu de moyens financiers et humains qui leur sont consacrés, limitent leur portée. De belles réussites sont toutefois à mettre à leur crédit, comme vous avez pu vous en rendre compte, monsieur le ministre, au début de septembre, sur le territoire de la communauté d’agglomération du Douaisis.
À cette occasion, vous avez rappelé votre ambition de développer le nombre et la qualité de ces PAT en leur octroyant des moyens supplémentaires dans le cadre du plan de relance. Nous ne pouvons que saluer un engagement qui rejoint nombre de ceux pris lors des dernières élections municipales sur ce sujet majeur de l’alimentation durable et locale.
Alors, allons plus loin et portons cette belle ambition de développer les CAT.
Pour réussir, les contrats alimentaires territoriaux doivent revêtir un caractère obligatoire et être signés à l’échelle territoriale des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui sont de véritables bassins de vie. Ils doivent être conclus dans un horizon temporel raisonnable, qui pourrait être fixé à 2022, et faire l’objet de révisions régulières.
Ils doivent affirmer le primat de l’alimentation durable et de notre sécurité alimentaire, comme outils de développement par tous et pour tous.
Ils doivent devenir l’alpha et l’oméga des documents de planifications territoriales. Leur intégration dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet) portés par les régions doit permettre de réaffirmer que les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et autres plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent être compatibles avec ces contrats.
Ils auront aussi pour vocation d’édicter des principes forts en matière de gestion du foncier agricole, ce qui me donne l’occasion de rappeler la nécessité d’ouvrir très rapidement le chantier sur le sujet, si ne voulons pas en rester au stade de l’incantation.
Ils devront intégrer de nouveaux objectifs chiffrés sanctionnables, la mise en place d’indicateurs de résilience, tels le pourcentage de l’autonomie alimentaire territoriale, le développement des circuits alimentaires de proximité, les installations ou les conversions en vente directe, sans oublier le nécessaire accompagnement des agriculteurs dans la régénération des sols.
Des moyens financiers nouveaux devront les rendre possibles, pour les redéployer, en y associant nombre d’acteurs citoyens, notamment celles et ceux qui interviennent dans le champ de la précarité alimentaire – la crise actuelle permet d’ailleurs d’en mesurer toute la prégnance – et auxquels nous ferons appel dans les semaines et les mois à venir, compte tenu des effets dévastateurs de l’épidémie sur la situation économique et sociale dans notre pays.
L’accès à une alimentation durable et de qualité est une priorité possible : c’est une question de moyens mais aussi de volonté, et je sais que vous n’en manquez pas.
Les collectivités territoriales, elles aussi, ont de la volonté à revendre. Elles ont montré, ces dernières semaines, à quel point elles étaient essentielles pour la vie quotidienne de nos concitoyens. Faire de nos EPCI des autorités organisatrices de l’alimentation durable et locale, et réunir tous les acteurs autour de la table pour prendre des décisions partagées et encouragées constitue une perspective à laquelle je vous sais très attaché. Je sais également que cette volonté, monsieur le ministre, est la vôtre, et que vous entendez consacrer énergie et moyens à la question de l’alimentation durable et locale.
N’attendons pas pour repenser notre alimentation ! Il est désormais urgent de penser des systèmes alimentaires territorialisés. Le contrat alimentaire territorial peut à ce titre s’avérer demain un outil majeur pour, ensemble, cultiver notre jardin et faire vivre notre belle exception alimentaire, laquelle est aujourd’hui plus qu’essentielle.
Cette ambition fonctionnera seulement si elle partagée par tous les acteurs qui font et qui représentent l’alimentation durable et locale. Mon ancienne collègue Nelly Tocqueville, que je salue, et moi-même avons ces derniers mois travaillé sur ce sujet. Nous remettons l’ouvrage sur le métier et formulons des propositions que, j’en suis sûr, vous partagerez.
Plusieurs choses me frappent : la qualité, l’envie et l’inventivité de tous les acteurs pour tendre vers une résilience alimentaire de qualité, mais aussi certaines incompréhensions, des méfiances entre acteurs et, parfois, le manque d’une véritable envie collective.
Permettez-moi de vous adresser une supplique. Soyez le ministre qui sera le grand ensemblier de toutes les énergies – on en trouve à foison en France ! – devant nous permettre de tendre vers cet objectif commun : faire de notre pays celui d’une alimentation durable et locale, pour toutes et tous.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à remercier le groupe RDPI d’avoir pris l’initiative de ce débat, crucial pour nos concitoyens, sur l’alimentation et l’agriculture saine et durable.
Vous l’avez évoqué, monsieur le sénateur, ce débat est inscrit de longue date à l’ordre du jour de la Haute Assemblée, et beaucoup d’entre vous ont déjà travaillé sur cette question. Il prend toutefois une résonnance particulière dans la période que nous vivons aujourd’hui : il est plus que jamais d’actualité, car la crise remet la santé au cœur de toutes les décisions, tant politiques que citoyennes.
Comme le disait Hippocrate, le premier des médicaments, c’est l’alimentation. Il est très important de le dire, l’alimentation constitue avant tout une question de santé nutritionnelle.
En tant que ministre de l’agriculture et de l’alimentation, ma conception est claire : il faut assurer la santé nutritionnelle de nos concitoyens via une alimentation de qualité, saine et durable, permise par nos agricultures partout sur le territoire. Il est capital que nous soyons clairs sur ce sujet et que nous donnions une vision à notre action. Cela suppose de partager avec vous, cet après-midi, plusieurs convictions.
Première conviction, il nous faut une agriculture forte. C’est précisément parce que nous devons assurer la santé nutritionnelle de nos concitoyens que nous devons regagner en souveraineté agroalimentaire. C’est à cette fin, vous l’avez dit monsieur le sénateur, que je me bats tous les jours.
Je crois en l’agriculture française. Beaucoup d’études montrent qu’elle est très probablement l’une des meilleures agricultures au monde, voire la meilleure, en termes de durabilité.
Il est important de le dire, nous devons être fiers de notre agriculture ! Elle a tenu pendant le premier confinement, elle continuera à tenir lors de ce nouveau confinement.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – Mme Évelyne Perrot applaudit également.
Les agriculteurs et les éleveurs français, que je qualifiais dans cet hémicycle voilà quelques jours d’« entrepreneurs du vivant qui nourrissent le peuple français », je crois aussi en eux ! Ils exercent l’un des métiers les plus nobles, à savoir assurer la santé nutritionnelle de nos concitoyens, et je pense pouvoir affirmer qu’ils en ont pleinement conscience. Cela explique sûrement la passion qui anime ces femmes et ces hommes de la grande famille agricole française.
L’agriculture française fait face depuis longtemps à d’énormes défis et se trouve en perpétuel mouvement. Depuis l’après-guerre, peu de secteurs ont autant évolué et autant répondu à la demande sociétale. L’agriculture a nourri le peuple français et continue de le faire, en prenant en compte la santé et de l’environnement. Les agriculteurs sont bien les acteurs de cette mission nourricière et protectrice, si importante pour faire société !
Gardons néanmoins en tête que, pour permettre à nos agriculteurs de trouver ces solutions et de s’y adapter chaque fois, il faut absolument que leur travail soit rémunéré à sa juste valeur. Or les agriculteurs subissent parfois les injonctions contradictoires de la société. Nous leur demandons davantage, sans être forcément prêts à y mettre le prix. De telles injonctions doivent cesser, et il faut que des actes suivent nos demandes.
Deuxième conviction, il est nécessaire de développer l’accès à des produits frais et locaux. Toutes les études le montrent, d’un point de vue nutritionnel et environnemental, ces produits sont les meilleurs pour la santé. C’est aussi vrai sur le plan économique, puisque cela permet d’augmenter le revenu des agriculteurs par une meilleure répartition de la valeur ajoutée ; par ailleurs, contrairement à certaines idées reçues, cela peut s’avérer bénéfique pour le portefeuille des consommateurs.
Il ne s’agit en aucun cas d’opposer les modes d’agriculture ! Nous avons besoin non seulement d’une agriculture qui exporte, si nous voulons qu’elle soit forte, mais aussi d’une agriculture de proximité, et le premier confinement a démontré que tel était le souhait des Français. Pour pérenniser cette demande, j’ai signé voilà quelques jours avec toutes les enseignes de grande surface une série d’engagements importants, afin de mettre en avant les produits frais locaux dans les circuits de distribution.
Troisième conviction, comme M. Marchand l’a appelé de ses vœux, il nous faut partir des territoires car c’est à partir de ceux-ci que nous pouvons le mieux possible construire les filières, et donc améliorer la distribution des produits frais et locaux.
Tel est l’objet des PAT. Vous l’avez expliqué, monsieur le sénateur, en évoquant celui du Douaisis, ces projets fonctionnent : ils permettent de structurer des filières et de créer des dynamiques.
Actuellement, environ 190 PAT sont établis sur notre territoire. La question est désormais de les démultiplier. Vous proposez des contrats ; je suggère quant à moi, de commencer par y consacrer un financement très important. C’est pourquoi j’ai obtenu que, dans le cadre du plan de relance, 80 millions d’euros soient dédiés à ces projets au cours des deux prochaines années.
Songez, mesdames, messieurs les sénateurs, que lors des quatre dernières années, l’État avait financé les PAT à hauteur de 6 millions d’euros : le financement que je propose est donc vingt-cinq fois supérieur à celui qui existait auparavant !
Il nous faut en effet dynamiser, renforcer et créer de nouveaux PAT qui fonctionnent sur les territoires ; nous avons d’ores et déjà de nombreux exemples en tête. Cela doit s’accomplir à l’échelon territorial, et nous y travaillerons en déclinant le plan de relance.
Pour avoir une agriculture forte et souveraine, il nous faut donc développer les produits frais locaux en partant des territoires et garantir que leur production soit effectuée à l’échelon local.
J’en viens à ma quatrième conviction : il convient d’appréhender avec lucidité, humilité et honnêteté la question de l’inégalité alimentaire, ce fléau qui perdure dans notre pays.
J’ai été pendant trois années ministre de la ville et du logement. Jamais je n’oublierai que, lors du premier confinement, j’ai dû édicter des bons alimentaires, ce que mon ministère n’avait jamais fait depuis l’après-guerre. L’inégalité alimentaire perdure. Il suffit pour se convaincre de cette réalité de voir les files d’attente qui s’allongent devant les associations d’aide alimentaire. Je n’entrerai pas dans le détail de toutes les mesures prises par le Gouvernement dans ce domaine…
Un point me paraît essentiel, qui va dans le sens du discours du sénateur Marchand et du débat qu’il propose : le problème des cantines, lesquelles sont le premier lieu de lutte contre les inégalités alimentaires. Nous devons aider au maximum les collectivités, quel que soit leur échelon, à faire en sorte que s’y trouvent davantage de produits frais et locaux. Cela nécessite des investissements, parfois une autre organisation, en bref, un accompagnement financier par l’État des collectivités en vue d’une meilleure qualité des aliments dans les cantines.
Alors qu’au titre du plan de relance, le Gouvernement financera les PAT à hauteur de 80 millions d’euros, nous consacrerons 50 millions d’euros au fonctionnement des cantines, afin de mettre en place des mesures très concrètes.
Pourquoi croyez-vous qu’il y ait toujours des yaourts locaux dans les cantines, et très peu de carottes ou d’oignons produits au même échelon ? La raison en est simple, les plateformes de grande distribution ou les fermes de proximité fournissent les yaourts conditionnés en palettes qu’il suffit de déballer à l’arrivée. Lorsqu’il s’agit de carottes et d’oignons, en revanche, il faut commencer la journée par en éplucher plusieurs kilos ; ce n’est pas la même chose ! C’est une véritable barrière qui empêche les cantines de s’approvisionner en produits frais locaux.
À question de terrain concrète, réponse concrète : les 50 millions d’euros permettront notamment de financer des légumeries, qui existent déjà dans plusieurs territoires.
Je crois en notre agriculture et en notre alimentation ! Les convictions que j’ai exposées manifestent la détermination qui est la mienne. Je suis absolument ravi de pouvoir débattre de ce sujet avec vous !
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et UC.

Nous allons maintenant procéder au débat interactif.
Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes au maximum pour présenter sa question, suivie d’une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente.
Dans le cas où l’auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n’ait pas été dépassé.
Dans le débat interactif, la parole est à Mme Martine Berthet.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la restauration collective sert chaque année plus de 3 milliards de repas. Elle est ainsi devenue un enjeu national, à la fois social, économique et environnemental. Elle doit permettre l’accessibilité de tous aux bons produits. Les cuisines centrales ont ainsi un rôle à jouer pour faire perdurer une alimentation durable et locale, meilleure tant pour l’environnement que pour la santé, grâce à l’apport des bons nutriments.
Toutefois, pour que les cuisines centrales puissent réaliser plus de 3 milliards annuels de repas à base de produits locaux, il devient absolument nécessaire de maîtriser la destination des terrains agricoles, lorsqu’ils sont libérés, et de pouvoir les attribuer aux cultures en déficit telles que le maraîchage ou les légumes de plein champ. L’alimentation collective nécessite en effet des cultures sur de grandes surfaces, afin de répondre aux besoins quantitatifs mais aussi parce que la massification de la production permet des prix plus bas, tout en laissant aux producteurs une marge suffisante. Or, jusqu’à présent, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) répartissent les terres agricoles disponibles entre les seules exploitations déjà existantes.
Un autre problème réside dans la vente d’exploitations pour une destination agricole autre, ne nécessitant pas toutes les terres disponibles. Il devrait être possible de réaliser des préemptions partielles pour les attribuer à d’autres fins agricoles, comme les cultures de plein champ.
Enfin, il apparaît nécessaire, sur le plan de la gouvernance, de structurer et de renforcer les filières et les interfilières afin d’améliorer les questions de logistique, en faisant en sorte que tous les acteurs concernés se parlent et s’organisent.
Sur tous ces points, les départements, détenteurs de la compétence en matière d’aménagement foncier rural et de protection des espaces agricoles naturels et périurbains, semblent être la bonne échelle pour l’organisation des discussions et des arbitrages, notamment entre Safer et établissements publics fonciers locaux (EPFL), pour la destination des terrains agricoles ainsi que sur tous les sujets logistiques.
Monsieur le ministre, quelles mesures comptez-vous mettre en œuvre pour que les conseils départementaux, au travers des PAT, soient les pilotes reconnus, légitimes et efficaces de l’organisation d’une production alimentaire locale et durable à destination des cuisines centrales ?
Votre description de la réalité du terrain, madame la sénatrice, montre bien à quel point – c’était l’objet de ma deuxième conviction – il est important de partir des territoires en matière de PAT.
Les PAT souffrent certainement de leur nom : les élus jugent souvent ces projets ou contrats territoriaux affreusement techniques. Ils font cependant font l’objet d’un consensus, tous les acteurs s’accordant à dire qu’ils fonctionnent bien. Ils permettent en effet, comme vous l’avez dit, madame la sénatrice, de structurer la filière de l’aval à l’amont. On remonte donc de la gestion des terres, que celle-ci soit qualitative ou quantitative, jusqu’aux assiettes de nos enfants à la cantine, en passant par la distribution.
Pour cette raison, je crois fondamentalement en ces PAT, et que je me suis battu pour qu’ils soient financés massivement dans le cadre du plan de relance. Je rappelle, une fois encore, que l’affectation de 80 millions d’euros sur deux ans représente une somme sans commune mesure avec les crédits consacrés à ce poste jusqu’à présent !
Votre question porte sur le rôle des départements. Mon approche sur ce sujet est simple : l’objectif est de consolider les 190 PAT déjà existants et, pour ce faire, de passer par les acteurs qui contribuent à leur mise en œuvre. Je ne souhaite en aucune façon modifier la gouvernance.
Les PAT sont d’ores et déjà développés par les territoires, cependant qu’ils bénéficient d’un très faible financement par l’État. Je propose donc que ce dernier finance bien davantage, en laissant la gouvernance telle qu’elle est.
Il existe différents échelons de développement : les EPCI – c’est le cas la plupart du temps – ; les territoires englobant plusieurs communes ; les départements. Au final, les PAT sont souvent consolidés à l’échelon des contrats de plan État-région (CPER), lesquels seront donc la porte d’entrée du dispositif, mais tout en maintenant les gouvernances locales telles qu’elles existent.
Nous continuerons à nous appuyer sur les territoires et l’intelligence territoriale, je m’y engage !

Dans mon territoire du Nord, sur la commune de Noordpeene en Flandres, un boulanger engagé montre la voie du circuit « ultracourt ». En juillet dernier, il a acheté un petit moulin autrichien pour moudre le blé d’une variété panifiable convenue avec l’agriculteur, cultivé sur la parcelle contiguë à sa boulangerie, et ainsi faire son pain.
La farine obtenue préserve les oligoéléments et le gluten du blé, grâce à un procédé plus lent que dans le circuit industriel et une température ne dépassant jamais les 40 degrés : ça, c’est du pragmatisme !
Les produits pâtissiers sont, eux aussi, fabriqués grâce au lait acheté à un laitier de la commune. Les fruits proviennent d’un maraîcher voisin respectant la saisonnalité. La qualité et la saveur des produits assurent à cet artisan de nombreux clients, certains n’hésitant pas à parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour acheter chez lui.
La période de crise que nous traversons met en lumière la nécessité de l’entraide. Le circuit « ultracourt » permet de recréer du lien et de développer une vie sociale parfois perdue dans certains de nos territoires. Ce nouveau dynamisme est un espoir pour nos communes.
Mais si l’alimentation locale est autant plébiscitée actuellement, c’est parce qu’elle est synonyme d’impact carbone moindre. L’alimentation représente le quart de l’empreinte carbone des ménages français. Or ces derniers sont de plus en plus attentifs à leur impact sur l’environnement, notamment dans leur choix de consommation alimentaire.
Votre ministère, avec le concours d’autres acteurs, a lancé au début du mois dernier un appel à candidatures pour expérimenter l’affichage environnemental des produits alimentaires. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre gaspillage et à l’économie circulaire. La Convention citoyenne pour le climat a aussi émis l’idée d’un « score carbone » sur tous les produits de consommation et les services.
Quelles sont donc, monsieur le ministre, vos pistes de réflexion sur l’affichage du poids carbone de notre alimentation ? Je pense notamment à une définition, à un mode de calcul clair, et plus particulièrement à l’encouragement de ces pionniers parmi lesquels figure mon boulanger des Flandres.
Je voudrais d’abord saluer, monsieur le sénateur, votre boulanger des Flandres et lui dire à quel point je soutiens son action !
La question que vous posez concerne la vertu des circuits courts. Comme je le disais plus tôt, je pense qu’il ne faut surtout pas opposer les systèmes agricoles en France. On a besoin d’une agriculture forte qui exporte, mais aussi d’une agriculture de proximité plus importante, dont les bénéfices sont d’ordre nutritionnel, économique, et environnemental.
Comment le consommateur doit-il être informé de l’ensemble de ces bénéfices ? Plusieurs expérimentations sont en cours : elles permettront de démontrer si un affichage environnemental est pertinent ou non. Nous travaillons sur ce sujet, et le défendrons avec détermination à l’échelon européen, dans la mesure où l’étiquetage est une compétence européenne, et parce qu’il est important au sein d’un marché commun de pouvoir comparer les produits.
Il faut cependant veiller à ce qu’un excès d’étiquetage ne tue pas l’étiquetage ! Les rayons de produits laitiers en sont « gavés »… Le consommateur doit bénéficier d’une information simple. C’est précisément pour cette raison que j’ai obtenu de la grande distribution que soit apposée, en plus de tous ces étiquetages, une bannière commune intitulée « plus près de chez vous et de vos goûts ! ». Grâce à cette formule très simple, le consommateur comprend que le produit ne vient pas de loin et que cela signifie de moindres émissions carbone. Car je crois à l’intelligence des consommateurs et de nos concitoyens en général.
À court terme, nous mettons en place cette bannière, qui sera généralisée au début de l’année prochaine ; dans le même temps, nous continuons à travailler sur les étiquetages.
Je veux délivrer un message clair à nos concitoyens : manger des produits frais et locaux, c’est ce qu’il y a de meilleur pour la santé, pour l’environnement et parfois, voire souvent, pour le portefeuille !

À propos d’alimentation saine et durable, je souhaite vous interpeller, monsieur le ministre, sur une récente enquête réalisée en partenariat avec le laboratoire de toxicologie de l’hôpital Lariboisière, qui met en lumière la présence de cadmium dans les engrais phosphatés, les pommes de terre et, en bout de chaîne, dans les urines humaines.
Le cadmium est un métal lourd, classé comme « cancérigène certain » par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Dès 2019, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) alertait sur ce risque pour la population et critiquait la décision de l’Union européenne de fixer à 60 milligrammes par kilo la teneur en cadmium dans les engrais phosphatés. D’après ses modélisations, il serait recommandé de l’abaisser dès maintenant à 20 milligrammes par kilo.
Dans la droite ligne de ce rapport, les révélations de l’enquête sont sans appel : cinq engrais phosphatés sur six, provenant en très grande majorité du Maroc ou de la Tunisie, dépassent les recommandations actuelles de l’Anses. Trois engrais de ce type sur cinq dépassent les maximales autorisées qui entreront en vigueur dans un an. On retrouve deux fois plus de cadmium dans les pommes de terre que ce qu’avait estimé l’Anses !
Enfin, 21 % des analyses d’urine font apparaître un dépassement de la concentration critique définie par l’Anses, au-delà de laquelle ont été démontrés des risques de toxicité osseuse puis, à plus haute dose, de toxicité rénale.
Les agriculteurs sont aussi concernés : si leurs sols présentent une trop forte concentration en cadmium, ils se retrouvent dans l’impossibilité de vendre leur production.
Que compte faire le Gouvernement pour préserver l’alimentation des Français de cette pollution au cadmium via les engrais phosphatés ?
Applaudissements sur des travées du groupe GEST.
Votre question concerne à la fois les problématiques de santé et d’environnement.
Le cadmium, vous le savez, est un élément très répandu dans l’environnement à l’état naturel, du fait de l’activité humaine, notamment agricole, et de l’utilisation d’engrais minéraux.
Présent à l’état naturel dans les sols, le cadmium est aussi apporté par les matières fertilisantes qui en contiennent sous forme d’impuretés, en raison de la teneur des gisements de roche phosphatée, à partir desquels sont extraits les éléments servant à la composition des engrais. Autrement dit, il ne s’agit pas d’engrais dans lesquels on intègre volontairement du cadmium, mais plutôt de produits formés naturellement à partir de roche phosphatée, laquelle contient elle-même des impuretés, dont le cadmium, que les engrais embarquent au moment de leur production.
Je partage votre diagnostic sur les risques réels induits par cet élément chimique. Il faut donc impérativement trouver des solutions. Une fois présent dans les sols, le cadmium pénètre dans les végétaux destinés à l’alimentation humaine : cette problématique sanitaire doit être prise au sérieux, compte tenu des risques d’ostéoporose et de fractures osseuses.
Nous avons tous absolument intérêt, à limiter l’exposition au cadmium : les agriculteurs, pour préserver la fertilité et la qualité de leurs sols, comme les consommateurs.
Des travaux ont été lancés dès que les études ont confirmé ces risques. Sur la base des préconisations de l’Anses, un projet de décret limitant les apports de cadmium, tous usages confondus, est en cours de concertation. Notre objectif est de le publier à l’été 2021, après les phases de consultation du public et de notification européenne.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre réponse.
D’après les données dont nous disposons, les industriels sont en mesure de dépolluer les engrais phosphatés pour un surcoût évalué à seulement 3 %. Nous attendons du Gouvernement qu’il agisse dès maintenant, en publiant un décret.
Sur le plus long terme, il est possible de mettre en place des alternatives pour se passer d’engrais minéraux, par l’utilisation de compost ou de fertilisation animale comme le fumier, entre autres. Le modèle agricole biologique peut se passer de phosphates issus des mines.
N’oublions pas que l’on importe 30 % des produits d’agriculture biologique, faute d’une production suffisante en France !
Applaudissements sur des travées du groupe GEST.

L’alimentation saine et durable est inscrite à tous les agendas. Le 20 mai dernier, la Commission européenne présentait sa stratégie « De la ferme à la fourchette ». Les recommandations alors établies traduisaient une ambition forte : bâtir une « chaîne alimentaire bénéfique pour les producteurs, les consommateurs, l’environnement et le climat », dans le cadre du pacte vert pour l’Europe.
II a notamment été proposé de porter la part de l’agriculture biologique à 25 % des terres cultivées en Europe, à l’horizon 2030. D’autres propositions doivent être faites en lien avec la lutte contre le gaspillage alimentaire, ou concernant la nécessité d’un étiquetage nutritionnel, deux problématiques abordées au Sénat au cours de la session passée.
En France, dans la continuité des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, qui a défini un objectif de 50 % de fermes en agroécologie pour 2040, le Gouvernement vient d’annoncer un plan de relance ambitieux pour l’agriculture et l’agroalimentaire. C’est d’ailleurs ce qu’ont souligné plus de cent quarante acteurs de la transition agroécologique dans une tribune parue le 9 octobre dernier, en recommandant d’« accélérer la transformation de notre modèle agricole » et d’agir « pour une agriculture du vivant ».
Se pose en même temps, et de manière accrue aujourd’hui, la question de notre indépendance protéique et de notre souveraineté, alors que la crise sanitaire a mis en exergue les effets désastreux pour les populations que pourrait avoir la rupture des circuits mondiaux.
Pour permettre cette transition, 1, 2 milliard d’euros a été dédié au volet « Transition agricole, alimentation et forêt » dans le plan de relance.
Quelle sera l’articulation de cette action politique forte, européenne et nationale, compte tenu du budget en hausse qui la soutient, avec les collectivités, en particulier pour les PAT ? Les sous-préfets de la relance interviendront-ils également sur ces sujets ?
Les élus auront besoin de pouvoir identifier précisément les aides auxquelles ils peuvent prétendre lors de la mise en œuvre de leurs propres feuilles de route.
M. François Patriat applaudit.
Madame la sénatrice, la question que vous posez est absolument essentielle.
Le plan de relance s’inscrit dans une vision assez claire : il faut bâtir une France plus forte qu’elle ne l’est aujourd’hui. Ma conviction, c’est que ce n’est pas possible sans une agriculture forte. C’est pourquoi j’ai obtenu ce montant significatif pour le volet agricole du plan de relance ; nous l’avons d’ailleurs aussi obtenu à l’échelon européen.
Comment faire en sorte que ce plan de relance irrigue nos territoires et que chaque agriculteur y ait accès ? Sont prévus 135 millions d’euros pour l’agroéquipement, et 250 millions d’euros pour les élevages ou les abattoirs – depuis combien d’années réclamez-vous que l’État accompagne les abattoirs ? Les forêts sont confrontées au drame des scolytes : l’État investit 150 millions d’euros pour réaliser ce qui constitue probablement le plus grand plan de reboisement depuis l’après-guerre, avec l’introduction de nombreux résineux dans notre pays.
Quid des collectivités territoriales ? Pour ma part, je privilégie les idées simples : aujourd’hui, de nombreux canaux existent. Ainsi, les PAT sont pris en charge par les collectivités et sont souvent définis à l’échelon du contrat de plan État-région (CPER). C’est le cas des abattoirs. La modernisation des élevages est très souvent cofinancée avec les régions au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Pour ma part, je considère que, si un canal existe déjà, on l’utilise, on le renforce et on le finance.
Par ailleurs, on tente, car il faut être innovant ! C’est pourquoi j’essaie de lancer au maximum des appels à projets sur le modèle du catalogue.
Dans certains appels à projets, on en fait vraiment beaucoup… Pourquoi ne pas plutôt créer des listes de catalogue, par exemple pour l’agroéquipement ? Cela ne dispense pas de passer par un appel à projets, mais c’est beaucoup plus simple pour nos agriculteurs.
Mon rôle consiste à simplifier en bonne intelligence avec les territoires.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.

Monsieur le ministre, dans un contexte de second confinement, avec une première période, de mars à mai, très tendue durant laquelle une grosse partie de l’économie a été paralysée, les agriculteurs nourrissent les Français. Cette crise sanitaire nous rappelle le cap à tenir, à savoir l’indépendance alimentaire, vous l’avez souligné.
La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt de 2014 avait abordé cette problématique en créant les projets alimentaires territoriaux (PAT). Les états généraux de l’alimentation ont entraîné en 2018 l’adoption de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « loi Égalim », qui contraint la restauration collective à servir 50 % de produits de qualité, dont 20 % au moins sont issus de l’agriculture biologique, d’ici au 1er janvier 2022. Au mois de décembre 2019, ma collègue Françoise Laborde a été à l’origine de l’examen d’une proposition de résolution sur la résilience alimentaire des territoires et la sécurité nationale.
Toutes ces initiatives vont dans le même sens : favoriser une alimentation durable et locale. Pourtant, ce ne sera possible qu’avec une réelle volonté politique des territoires. Les PAT ont du mal à décoller. Pourtant, leurs enjeux sont nombreux : d’ordre économique, au travers de l’aménagement du territoire, de l’emploi non délocalisable, de l’installation ; d’ordre environnemental, avec la valorisation de nouveaux modes de production agroécologique ; d’ordre social, par l’éducation alimentaire, la création de liens, la valorisation du patrimoine.
Monsieur le ministre, vous allez annoncer des moyens considérables pour les PAT. Pour autant, comment rendre plus efficient cet outil et, surtout, quels moyens forts comptez-vous déployer pour sensibiliser les élus et les inciter à s’engager ?
Monsieur le sénateur, je vous remercie d’avoir salué les travaux de votre collègue Françoise Laborde sur la question très importante de la résilience alimentaire de nos territoires.
Comment convaincre de la pertinence des PAT et comment faire pour accélérer leur mise en œuvre ?
D’abord, ce dispositif fait ses preuves dans de nombreux endroits. Frédéric Marchand a évoqué le PAT du Douaisis, qui se déploie très bien. Dans le Jura où je me suis rendu récemment, deux PAT m’ont été présentés : là aussi, cela fonctionne extrêmement bien.
Les PAT font partie de ces projets qui diffusent au fur et à mesure, car les élus qui les voient mis en œuvre dans d’autres territoires que les leurs se rendent compte que c’est utile ! Les projets alimentaires territoriaux pâtissent d’un sigle atroce – PAT ne veut pas dire grand-chose – et peut-être aussi de l’accumulation de contrats, plans et autres, ce qui peut expliquer une certaine réticence.
Ensuite, je crois à l’intelligence collective. Mon rôle consiste à accompagner et à trouver la faille. Ne nous mentons pas : en quatre ans, l’État a fait des projets alimentaires territoriaux un dispositif important, qu’il a financé à hauteur de 6 millions d’euros, soit 40 000 ou 50 000 euros sur quelques dizaines de PAT. Reste que, si l’on veut avoir les moyens de l’ambition qu’on affiche et si l’on croit à ces projets, il faut se retrousser les manches et mettre un paquet d’argent, c’est-à-dire passer de 6 millions d’euros sur quatre ans à 80 millions d’euros sur deux ans !
Enfin, derrière tout cela se trouve la grande famille agricole, que je salue, qui est composée d’individus à la fois passionnés mais aussi très bien organisés ; c’est d’ailleurs sa force. Elle nous accompagne dans la mise en œuvre de ce plan de relance. Nous travaillons énormément ensemble pour que, partout dans les territoires, les chambres d’agriculture deviennent des lieux d’accompagnement de toutes les parties prenantes – élus locaux, agriculteurs, éleveurs….
Le plan de relance, ce n’est pas celui du Gouvernement et encore moins celui du ministre de l’agriculture : c’est le plan de relance des Français, des agriculteurs et de ceux qu’ils nourrissent. Il nous faut donc absolument faire vivre toute cette famille. Les chambres d’agriculture jouent un rôle fondamental. C’est d’ailleurs pour cela que j’ai veillé à préserver leur budget dans le projet de loi de finances que vous examinerez bientôt, mesdames, messieurs les sénateurs.

Il est vrai que les PAT ont du mal à décoller. En six ans, très peu ont vu le jour.
Vous allez mettre les moyens, dites-vous, monsieur le ministre. Vous vous étiez fixé un objectif de 500 PAT pour 2020. Aujourd’hui, vous pensez en réaliser un par département. Tout le monde a bien compris ici qu’ils sont des outils indispensables pour permettre une alimentation locale et de proximité. Je suis d’accord avec vous : avec les budgets que vous prévoyez, le bouche-à-oreille sera tel que d’autres élus s’engageront.
Toutefois, monsieur le ministre, il ne faudrait pas que votre volonté et votre objectif se limitent à un PAT par département. Si plusieurs projets se font jour, il faut permettre à ceux-ci, par les moyens que vous déploierez, d’aller à leur terme. Laissez les choses se faire pour le bien de tous !
M. le ministre acquiesce.

Nous remercions le groupe RDPI d’avoir inscrit ce débat sur l’agriculture durable et locale.
Notre groupe est un défenseur acharné et un fervent promoteur de l’agriculture paysanne, biologique, respectueuse de l’humain et de la planète, et rémunératrice pour le monde paysan. Or cette agriculture durable et locale est menacée, notamment par le libre-échange, dont le gouvernement auquel vous appartenez est un grand partisan, monsieur le ministre.
En effet, le libre-échange détruit l’agriculture durable et locale en cassant nos normes. Il aggrave le réchauffement climatique en augmentant les émissions de gaz à effet de serre, avec des produits qui font parfois trois fois le tour de la planète !
Le meilleur exemple en est le CETA, ce traité de deuxième génération, ou traité mixte, signé entre l’Union européenne et le Canada, qui fait tomber les barrières tarifaires et douanières mais aussi les barrières non tarifaires, en s’attaquant aux normes sociales et environnementales ainsi qu’à nos services publics. Pire, des tribunaux d’arbitrage privés seront mis en place, qui mettront les lois des entreprises au-dessus de celles des États.
Négocié pendant dix ans, ce traité a été mis en place de façon provisoire en 2017. Il devait être ratifié au bout d’un an. L’an dernier, il a été voté par l’Assemblée nationale en catimini au cœur de l’été. Il n’est toujours pas à l’ordre du jour du Sénat. Pourquoi ? De quoi avez-vous peur, monsieur le ministre ?
Notre interrogation est simple. Quand allez-vous cesser de faire appliquer un traité dans l’illégalité ? À quelle date le CETA sera-t-il inscrit à l’ordre du jour du Sénat, pour donner la parole à la totalité du Parlement et enfin permettre un débat démocratique ?
Monsieur le sénateur, vous connaissez mon souci de toujours apporter des réponses précises.
Sourires sur les travées du groupe CRCE.
Malheureusement, je ne suis pas maître de l’inscription des textes à l’ordre du jour des travaux du Parlement, en particulier du Sénat.
Je ne saurai donc vous dire à quel moment le texte sera inscrit. Qui plus est, vous l’avez constaté comme moi, l’ordre du jour du Parlement est quelque peu chamboulé.
Il n’en reste pas moins que je tiens à répondre à la question que vous posez, car elle est fondamentale.
Aujourd’hui, pour un agriculteur qui se bat pour produire selon les plus hautes normes de qualité, il est décourageant de constater que le concombre qu’il trouve au supermarché est parfois beaucoup moins cher et produit avec des substances qui n’ont strictement rien à voir… C’est aussi vrai pour le poulet et la liste est longue !
Sur ce sujet, ma conviction est simple et je le dis très clairement : l’Europe a fait preuve de naïveté pendant trop de temps. D’ailleurs, vous le savez, l’Europe est compétente pour la négociation des accords commerciaux. C’est pourquoi, comme plusieurs ministres de l’agriculture européens, je me bats avec force. Pour la première fois, la politique agricole commune sur laquelle nous nous sommes accordés pose un socle commun de normes environnementales dans le cadre du premier pilier.
À partir du moment où, au sein du marché commun, on s’est mis d’accord sur un socle décidé dans le cadre de la politique agricole commune, il faut que celui-ci soit transcrit dans la politique commerciale. C’est à mes yeux un minima ; cette première avancée doit être finalisée par le trilogue sur ce socle commun. Je l’ai redit pas plus tard qu’hier à tous mes homologues européens : maintenant que nous nous sommes mis d’accord sur un socle commun concernant la politique agricole, celui-ci doit trouver sa traduction dans la politique commerciale.
Ainsi, pour le Mercosur, puisque la question va se poser, c’est non ! Ce traité ne respecte en rien le socle commun environnemental, en termes de déforestation ou de production de poulets. Il n’est pas question de voir arriver tous les poulets brésiliens, ce n’est pas possible !
Je ne peux pas être plus clair dans ma réponse, monsieur le sénateur.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.

Monsieur le ministre, je vous le dis, ce n’est pas entendable !
Mes chers collègues, combien de temps allons-nous laisser perdurer cette situation ? Allons-nous accepter encore longtemps qu’un traité de libre-échange qui fait débat et que vous défendez, monsieur le ministre, ne nous soit pas soumis ? Pour nous, la question est d’ordre démocratique : ce traité a été mis en place en 2017, il devait être ratifié par les deux chambres dans l’année qui suivait. Cela fait trois ans ! Avant la crise du covid, c’étaient les élections législatives au Canada… Il y a toujours une excuse !
Vous êtes dans l’incapacité de faire ratifier ce traité, parce que vous n’avez pas la majorité du peuple français pour vous soutenir. Si vous soumettez ce texte au Sénat, vous n’obtiendrez pas la majorité. L’ensemble des groupes politiques ici devraient interpeller le Gouvernement pour demander l’inscription dans l’année du CETA à l’ordre du jour de nos travaux et enfin avoir un débat démocratique sur cette question, qui est centrale pour l’avenir de notre agriculture et, au-delà, pour l’avenir du peuple français.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Monsieur le ministre, je tiens à souligner une fois de plus votre engagement aux côtés de nos agriculteurs et de notre modèle agricole, dont nous sommes si fiers. Il n’est qu’à lire l’article de The Economist, qui salue le modèle français comme étant le plus durable, et ce pour la troisième année consécutive. Il faut le répéter !
J’évoquerai moi aussi les PAT et l’enjeu de leur mise en œuvre sur les territoires.
Monsieur le ministre, envisagez-vous des PAT à périmètre concentrique ? En effet, dans la mesure où l’on ne pourra pas trouver dans un même territoire toute la gamme de produits disponibles, malgré l’engagement fort des chambres d’agriculture que l’on peut attendre, peut-on imaginer une coopération avec différents PAT ? On aurait ainsi une complémentarité qui rendrait accessible à notre restauration collective et à nos cantines, dans moins d’un an, cette large gamme de denrées.
Serons-nous capables de relever ce défi à un coût accessible ? Faut-il le redire, le coût est devenu un sujet essentiel et les impayés dans les cantines scolaires sont en train d’exploser ! Pourrons-nous apporter cette alimentation saine et durable, telle qu’elle a été définie, à un coût accessible pour nos concitoyens ?
Enfin, concernant les démarches environnementales à haute valeur environnementale (HVE), qui se développent dans nos territoires, les chiffres montrent une réelle dynamique de cette certification environnementale. Selon vous, les efforts de nos agriculteurs seront-ils suffisants pour nous permettre d’atteindre les objectifs en termes de produits, de volume, de délais et de coûts fixés par la loi Égalim ?
Madame la sénatrice, vous m’avez posé trois questions.
Premièrement, quel est le volet géographique des PAT ? Je m’adapte à ce que les territoires veulent : certains systèmes géographiques sont très concentrés, d’autres sont beaucoup plus larges. C’est aux territoires de le définir, mon rôle consiste à venir en appui.
Au regard de toutes les questions qui se posent, si le Sénat prenait un jour l’initiative d’organiser une présentation des différents PAT à l’ensemble des élus locaux, j’y participerais avec grand plaisir et je mettrais en avant ce que le plan de relance prévoit à ce sujet. Je fais cette proposition à Frédéric Marchand, à qui l’on doit le débat qui nous réunit cet après-midi ; je serai à votre disposition.
Deuxièmement, vous avez tout à fait raison, la question du coût est cruciale. Ce débat renvoie notamment à toutes les problématiques d’accompagnement, de dotation financière, etc.
Au-delà de ce débat purement financier, c’est parfois une question de faisabilité plus que de coût. Quand on demande aux enfants qui déjeunent à la cantine ce qui provient de la ferme voisine, ils citent toujours les yaourts. Le coût n’a rien à voir ! Que l’on s’approvisionne chez un grand distributeur ou à la ferme voisine, peu importe : c’est toujours une palette de yaourts qui demande la même manutention.
Si nous cherchons à créer le plus grand nombre de légumeries ou de conserveries possible, c’est pour accompagner la personne chargée de la logistique des cantines. Les carottes achetées au producteur ne sont pas plus chères que celles transformées ou déjà découpées que propose le grand distributeur. Le problème est que le chef de la cantine n’a pas le temps d’éplucher des kilos de carottes tous les matins !
Au-delà du coût, la question logistique est cruciale. C’est pourquoi l’État investit massivement pour éviter que la collectivité ne le fasse et ne répercute cet investissement sur le coût des repas.
Troisièmement, je crois beaucoup à la haute valeur environnementale. J’ai notamment accédé à une demande chère à la présidente de séance – j’imagine que c’est pour cette raison qu’elle m’autorise à dépasser mon temps de parole !
Sourires

Je remercie le groupe RDPI d’avoir organisé ce débat.
Monsieur le ministre, 43 jours d’autonomie alimentaire pour l’Union européenne, 9 mois pour la Chine. Qu’en est-il de la France ? La crise sanitaire interroge de manière urgente notre autonomie et notre souveraineté alimentaires. La mondialisation crée des dépendances vitales malgré notre capacité à produire. Face à ce constat, comment envisagez-vous la nécessaire adaptation du Programme national pour l’alimentation (PNA) à l’éclairage de la crise actuelle ? Existe-t-il un nouveau plan Protéines végétales ? Ces sujets font-ils l’objet d’une réflexion partagée à l’échelle européenne ?
Paradoxalement, vous semblez avoir abandonné le projet de loi foncière pour préserver les terres agricoles, facteur de lutte contre le changement climatique et de souveraineté alimentaire. Quelles mesures allez-vous prendre pour territorialiser nos politiques alimentaires ? Vous souhaitez renforcer les PAT, mais leurs forces et leurs faiblesses pourraient faire l’objet d’une concertation afin que leur soient donnés une nouvelle dynamique et de nouveaux moyens.
Vous allez consacrer une partie du plan de relance à ces objectifs. Les 80 millions d’euros dont vous avez parlé seront-ils également mobilisés pour accompagner la diversification des exploitations en circuit long vers les circuits courts, et pour permettre les nécessaires reconversions sociales et économiques ?
Comme les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), les PAT pourraient être des obligations pertinentes pour engager les territoires en valorisant les subsidiarités, en organisant les besoins logistiques et les circuits de valorisation. L’intégration des PAT dans les SCOT et les Sraddet contribuerait à articuler ces politiques territoriales et faciliterait leur contractualisation.
Monsieur le ministre, où en sont vos réflexions sur ces sujets particulièrement sensibles, qui méritent des réponses concrètes et factuelles ?
Monsieur le sénateur, je n’ai plus à vous le démontrer, ma conviction, ma vision du système agricole français, c’est que nous devons regagner en souveraineté. Pour répondre à votre question sur la dépendance de notre agriculture, je vous donnerai un seul exemple.
Concernant les protéines, le système est organisé depuis des décennies. Cela fait cinquante ans que les différents accords à l’échelle internationale ont conduit l’Europe, et singulièrement la France, à être dépendante d’approvisionnements de protéines d’Amérique – d’Amérique du Nord, d’abord, d’Amérique du Sud, ensuite.
À mes yeux, c’est inconcevable. C’est pourquoi je me bats avec force pour que notre pays gagne en souveraineté protéique pour les grandes cultures, d’une part, et pour nos élevages, d’autre part. Quand à cette situation s’ajoutent des épisodes de sécheresse qui font baisser les rendements de foin, on se retrouve de plus en plus dépendant de telles importations. Je le répète, ce n’est pas concevable. D’ailleurs, j’annoncerai dans les tout prochains jours le déploiement du plan Protéines végétales que nous mettons en place avec l’interprofession.
Faut-il inclure les PAT dans les SCOT ou les Sraddet, comme l’évoquait Frédéric Marchand ?
Aujourd’hui, 190 PAT existent. Pour ma part, je souhaite accélérer leur développement, mais c’est aux territoires de décider. Je connais bien les SCOT et les Sraddet, et je mesure le lien que ces documents peuvent avoir les uns avec les autres. Mais si je me présentais devant vous cet après-midi en annonçant que la solution consiste à inclure les PAT dans ces schémas, vous me répondriez sans doute qu’il y a moyen d’aller plus vite dans la période que traverse le pays.
C’est pourquoi je vous propose aujourd’hui de dégager massivement des financements pour aider d’ores et déjà les 190 PAT qui existent et qui fonctionnent. Comme le soulignait Henri Cabanel, il ne s’agit pas de mettre en place un PAT par département. Une fois cette étape terminée, si l’on réalise qu’il faut une coordination des différents documents, comme le propose Frédéric Marchand, pourquoi pas ?
À court terme, il est de ma responsabilité de booster ce qui est déjà en place, de mettre du diesel dans le tanker, comme on dit, pour faire en sorte que cela avance rapidement.

Monsieur le ministre, vous avez bien compris qu’il ne s’agissait pas de conditionner les financements à l’intégration dans les SCOT et les Sraddet. C’est une orientation qu’il faut essayer de donner. Sur ces questions, le grand problème, c’est la maîtrise foncière. Or, pour avoir une maîtrise foncière, il faut avoir une approche stratégique à l’échelon territorial.
Il faut également se demander comment créer des effets leviers en termes de contractualisation. L’intégration progressive de ces politiques dans les SCOT et les Sraddet présente l’intérêt d’améliorer la vision contractualisée et de créer des effets leviers avec l’ensemble des collectivités. En d’autres termes, c’est une orientation, pas une condition. Oui pour donner une impulsion, comme vous l’avez indiqué, monsieur le ministre, mais il faut essayer de voir à moyen et long termes !
Inscrire les PAT dans des politiques territoriales permet justement de se donner des outils, notamment pour la maîtrise foncière. Or, sur ce dernier point, vous n’avez pas répondu : vous avez abandonné le projet de loi foncière !

Mangeons local ! Mangeons français ! C’est synonyme de qualité et d’emplois. Redécouvrons les saveurs de notre terroir qui ont disparu sous les coups de la mondialisation des normes européennes !
Cela fait cinquante ans que nos agriculteurs se battent face à la concurrence déloyale et aux hauts fonctionnaires de la Commission européenne, à Bruxelles. À force, ils s’épuisent et sombrent dans le désespoir : tous les deux jours, un agriculteur français se suicide.
Nous étions autrefois l’un des plus grands pays agricoles du monde. Nous en sommes aujourd’hui réduits à consommer du bœuf aux hormones brésilien ou canadien, du poulet aux antibiotiques américain, du soja transgénique asiatique. Si nous voulons protéger nos agriculteurs et retrouver une alimentation durable, la première solution est de remettre des barrières douanières sur les produits que nos paysans produisent déjà.
Nous devons partout favoriser les produits français, imposer au moins 70 % de repas locaux dans nos cantines. L’initiative de la commune de Châteauneuf-le-Rouge dans les Bouches-du-Rhône est à ce titre un exemple à suivre.
Quid des accords que des ministres, inconnus ou disparus, ont signés et quid de l’Union européenne, me direz-vous ? Sincèrement, je me moque de ces accords ! Un accord international rédigé par des bureaucrates et signé par des énarques ne vaut pas la vie d’un seul paysan français. Même s’il a reculé sur l’accord avec l’Amérique du Sud, ce gouvernement signe à tout-va les accords de libre-échange avec le Canada ou le Vietnam.
Les paysans, ce gouvernement ne les comprendra jamais, car la paysannerie, c’est l’inverse de la Macronie : la paysannerie n’est pas en marche, elle n’est pas hors sol, elle a le corps et l’âme enracinés. On est paysan par amour et par passion, non pas pour « faire du blé », mais pour le faire pousser – nuance qui fait toute la différence ! La sachant fragile et précieuse, les paysans protègent la terre pour mieux la transmettre, en même temps qu’ils transmettent un savoir-faire et un art de vivre incomparables.
Aujourd’hui, dans nos campagnes, nous entendons non pas mugir, mais mourir des hommes et des femmes qui nous font vivre. Pour une alimentation durable et locale, faisons nôtre cette déclaration de Guy de Maupassant à la terre française : « J’aime ce pays, et j’aime y vivre parce que j’y ai mes racines, ces profondes et délicates racines, qui attachent un homme à la terre où sont nés et morts ses aïeux, qui l’attachent à ce qu’on pense et à ce qu’on mange, aux usages comme aux nourritures, aux locutions locales, aux intonations des paysans, aux odeurs du sol, des villages et de l’air lui- même. »
Monsieur le ministre, vous l’avez compris, ce n’est pas une question que je vous pose, mais c’est une déclaration d’amour dans les actes que je vous invite à faire au monde paysan, qui nous nourrit sainement et contribue à faire de la France le plus beau pays du monde.
Monsieur le sénateur, ça tombe bien : je ne suis pas énarque, je suis ingénieur agronome !
Cela devrait vous rassurer ! Pourtant, je suis macroniste et je partage cette même passion.
Les attaques contre les fonctionnaires m’étonnent toujours. D’ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, vous aviez fait le choix de la fonction publique, quand vous étiez jeune. C’est tout à l’honneur de ces femmes et ces hommes de s’engager dans la fonction publique.
Nous en avons bien besoin ! Jamais, pour ma part je ne tomberai dans le bashing de la fonction publique ; qui plus est, dans cette période, c’est très mal venu.
Un autre point nous différencie absolument. L’amour pour le monde paysan ne se décrète pas, il se montre et se prouve dans l’action. La principale valeur du monde paysan, c’est le travail. Ces femmes et ces hommes travaillent ardemment. Ce ne sont pas des discours d’estrade qui leur feront croire qu’untel ou untel est de leur famille ou empreint de l’amour que vous appelez de vos vœux, ce sont le travail et les résultats.
Monsieur le sénateur, et je crois que ce point aussi nous différencie, vous avez une vision tronquée de l’agriculture. Je le dis comme je le pense.
Vous affirmez qu’il faut faire du local. Or je n’ai pas arrêté de dire qu’il fallait inciter tous nos concitoyens à manger des produits frais et locaux. C’est ce qu’il y a de meilleur pour leur santé, pour l’environnement, pour nos agriculteurs et, souvent, pour leur portefeuille.
Toutefois, vous vous trompez, monsieur le sénateur. Vous souhaitez un pays plus fort, mais, pour ce faire, il faut avoir une agriculture plus forte, et donc une agriculture qui exporte.
Il ne faut pas opposer les uns aux autres. Si l’on veut avoir une filière qui pèse, il est important qu’elle exporte. Je l’assume : oui, je vais aider à exporter avec énormément de force et, oui, je vais aider à développer les circuits courts.
Cessez d’avoir cette vision simpliste pleine de « yakafokon » – on ne va faire que du circuit court, on va empêcher tous les autres, etc. Le monde dans lequel on vit est un monde de rapports de force. Pour peser lourd, il faut exporter. Pour que la France soit forte, il faut qu’elle ait une agriculture forte, à la fois exportatrice et de proximité.
Peut-être est-ce cela le « en même temps » macroniste, et c’est très bien ainsi.
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et UC.

Monsieur le ministre, je suis content d’avoir entendu ce que je viens d’entendre ! Si un bon gouvernement doit assurer à son peuple une alimentation durable et locale, ces termes peuvent toutefois revêtir des définitions très différentes dans la bouche des uns ou des autres.
À mes yeux, une alimentation durable passe nécessairement par l’autosuffisance alimentaire. Selon un dicton populaire dans mon pays, « pour être sûr d’en avoir assez, il faut en avoir trop » !
Sourires.

Local, pour moi, cela signifie français. Mon département produit 430 millions de litres de lait pour 230 000 habitants. Si l’on voulait limiter la distribution à quelques kilomètres seulement, il faudrait demander à tous les Altiligériens de boire du lait matin, midi et soir !
On doit être capables d’apporter du lait à Marseille, où il n’y a pas de vaches laitières, et des fruits là où le soleil n’est pas assez chaud pour les faire mûrir. Telle devrait être la réalité de notre agriculture durable et locale.
Vous dites qu’il faut favoriser l’export, monsieur le ministre. Je suis d’accord ! Encore une fois, pour en avoir assez, il faut en avoir trop.
Nouveaux sourires.

En 2010, l’excédent commercial agricole français était de l’ordre de 12 milliards d’euros. En septembre 2020, il n’est plus que de 3, 98 milliards d’euros. On ne peut pas continuer ainsi ! J’avais prédit, en 2019, que l’excédent commercial français se transformerait en déficit si nous n’y prenions pas garde. Or le risque est bien réel.
Nous avons perdu sur les céréales, nous perdons sur le vin. Plus de la moitié des fruits et légumes que nous mangeons aujourd’hui sont importés !
Vous devez avoir une politique offensive en la matière, monsieur le ministre. Vous en avez déjà parlé, mais j’espère que vous y reviendrez dans votre réponse.
Le deuxième élément…

Vous avez déjà dépassé votre temps de parole de trente secondes, mon cher collègue.

Un dernier point alors : il faut une organisation mondiale pour étudier la démographie de notre planète. Nous sommes 7, 8 milliards d’habitants aujourd’hui ; nous serons 10 milliards demain. Si nous ne faisons pas attention, si nous en restons à des débats d’enfants gâtés, nous pouvons être certains que, demain, la population d’un pays comme le Nigéria, qui dépassera le milliard d’âmes, viendra se nourrir en France !
Les deux questions posées par le sénateur Duplomb mériteraient bien plus que deux minutes pour y répondre.
Je ne reviendrai pas en détail sur le sujet de l’export, mais je crois qu’il nous faut absolument une agriculture qui puisse exporter. Il fut un temps où mon métier était précisément d’aider à réaliser ces exportations. J’ai aidé pendant plusieurs années des céréaliers français à exporter en Égypte, car ce pays a besoin de céréales avec un taux de gluten particulier et il ne peut pas les produire.
Songez tout de même, mesdames, messieurs les sénateurs, que 40 % de l’action de Business France concerne aujourd’hui le monde agroalimentaire. Mais nous avons des défis de taille à relever sur nombre de filières, notamment le vin ou certains types de viande – nous n’arrivons pas, par exemple, à ouvrir de nouveaux marchés en Italie pour les broutards.
Nous essayons d’accompagner très fortement ces exportations. J’étais il y a dix jours avec les équipes de Business France pour accompagner le lancement d’un plan de relance export grâce auquel l’État va financer une grande partie des démarches pour conquérir de nouveaux marchés.
Moi qui suis très attaché à l’agriculture française, ce qui m’énerve le plus, au-delà de la diminution de notre balance commerciale, c’est que les Allemands sont devenus meilleurs exportateurs agricoles que nous ! Comment peut-on accepter cela quand on est, comme moi, convaincu de la pertinence des produits agricoles français ?
Je prends donc l’engagement de me battre corps et âme pour favoriser l’export.
J’en viens au deuxième élément, en lien avec le premier, la question de la démographie. Dans toute science humaine, l’approche démographique me semble essentielle. Hervé Le Bras vient de publier un ouvrage absolument éclairant, Métamorphoses du monde rural, qui explique que le monde agricole est passé en trente ans d’une agriculture de territoires, de propriétaires, à une agriculture menée par des « entrepreneurs du vivant ». Cette approche me paraît extrêmement juste.
Les enjeux démographiques doivent être considérés en lien avec la nutrition. Quand on parle par exemple de gestion de l’eau à l’échelle de la planète, l’eau importée, c’est-à-dire celle incluse dans les productions végétales qui font ensuite l’objet d’échanges commerciaux, représente un sujet massif à l’échelle démographique et géopolitique. Nous devons avoir une vision claire et donner un cap.
En la matière, l’Europe a aussi un rôle à jouer. Nous finalisons actuellement la nouvelle PAC. Faut-il privilégier tel ou tel outil ? Faut-il faire plus de redistribution ou aller vers plus de convergence ? Selon moi, la seule question que l’on doit se poser, c’est la vision de notre agriculture dans sept ans. Où veut-on amener notre agriculture à cette échéance, au regard des changements à l’œuvre dans le monde ? Je conserverai cette approche, qui est à mon avis la bonne, même si elle est plus complexe.

Je conçois qu’il soit assez frustrant de répondre en deux minutes, monsieur le ministre, mais nous devons tout de même essayer de respecter les temps de parole.
La parole est à Mme Évelyne Perrot.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Madame la présidente, monsieur le ministre, la crise sanitaire et ses conséquences éclairent d’un jour nouveau le sujet de l’alimentation durable et locale. Nous sommes face à l’opportunité historique de réaliser pleinement la transition écologique de notre modèle agricole. En effet, si une telle transition est amorcée dans de nombreux domaines et dans plusieurs États membres, l’empreinte environnementale de notre alimentation reste importante.
En mai dernier, l’Union européenne s’est dotée d’une stratégie, « De la ferme à la fourchette », qui ambitionne notamment de réduire de 50 % l’utilisation de pesticides chimiques, ou encore de disposer de 25 % de la superficie agricole en agriculture biologique d’ici à 2030.
Pour atteindre ces objectifs ambitieux et nécessaires, nous devons relever ensemble plusieurs défis : la souveraineté alimentaire, la rémunération des producteurs, la capacité de nos concitoyens à acheter leurs produits et, bien entendu, le développement durable.
Dans un récent ouvrage, Hubert Védrine explique que le concept de « compétitivité écologique » va s’imposer rapidement. Nous devons aujourd’hui tracer ce chemin.
Monsieur le ministre, face à l’indispensable transition agroécologique, quelle position la France va-t-elle défendre dans le cadre des prochains grands rendez-vous européens, qu’il s’agisse de la réforme de la PAC, de l’adoption du budget européen ou encore de la stratégie « De la ferme à la fourchette » ?
Pour la mise en œuvre de cette stratégie, la Commission a prévu un calendrier réglementaire et législatif allant presque jusqu’en 2024. Ce calendrier vous paraît-il adapté ? La France souhaite-t-elle que l’examen de certains textes soit avancé ?
Madame la sénatrice, pour moi, la vision est claire. D’abord, que souhaite-t-on fondamentalement ? Où veut-on amener l’agriculture européenne dans les sept prochaines années ?
Le cadre politique sur lequel les ministres européens viennent de se mettre d’accord donne des orientations : une agriculture plus souveraine, qui développe plus de protéines et qui engage la transition agroécologique. Mais cette dernière doit bien évidemment être financée. Il ne suffit pas d’exiger cette transition des agriculteurs et de les laisser se débrouiller. Comment les accompagne-t-on ? Comment arrête-t-on de leur adresser des injonctions contradictoires ? Vous m’avez déjà entendu plus d’une fois dénoncer ces injonctions stériles, qui biaisent le débat et méconnaissent l’immense valeur ajoutée de notre agriculture et de nos agriculteurs.
Ensuite, le diable se niche toujours dans les détails, et cet adage est peut-être encore plus vrai s’agissant des politiques européennes…
Chaque État membre va à présent décliner ce cadre politique, arrêté entre les ministres et actuellement discuté avec la Commission et le Parlement, dans un plan stratégique national. Des discussions vont s’ouvrir à cette fin en France. Je ne l’ai pas encore obtenu, mais je me battrai, en profitant aussi de la présidence française de l’Union à partir du 1er janvier 2022, pour que ces fameux plans stratégiques nationaux soient considérés comme des documents politiques devant être examinés au niveau des ministres.
Nous nous sommes accordés sur la nécessité d’une convergence au sein du marché commun. Mais si cet objectif est ensuite décliné au niveau bilatéral et si l’on ne peut pas évaluer l’équivalence des chemins empruntés dans les différents États membres, ça ne peut pas marcher. Il faut, en d’autres termes, pouvoir vérifier que les règles ne sont pas beaucoup plus contraignantes d’un côté, et beaucoup moins de l’autre.
Je me bats donc pour que ces plans stratégiques nationaux soient in fine présentés au niveau des ministres. Je pourrai ainsi dire aux agriculteurs : si nous organisons la transition de cette manière, c’est parce que nos collègues européens la font aussi de cette manière, avec les mêmes ambitions.
L’ensemble forme une vision politique, et soyez assurés de mon engagement très fort sur ce point.

Monsieur le ministre, je viens de vous remettre un document que je vous demande d’examiner avec grand intérêt.
Je vis dans un secteur de grandes cultures où les paysans sont pris dans une spirale infernale. Certains se sont réunis pour travailler la terre avec respect, cultiver du bio en circuits courts à portée de tous, en respectant les nappes phréatiques, mais surtout en donnant aux agriculteurs une rémunération honnête et un regard respectueux sur leur métier.
Il s’agit d’intelligence collective, monsieur le ministre. C’est ce que vous aimez, et ce que vous venez de nous donner comme exemple.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la crise sanitaire sans précédent que nous traversons, et qui touche durement nos concitoyens, nous conduit irrémédiablement à interroger nos modes de consommation, en particulier la qualité de notre alimentation.
De fait, la question alimentaire a pris une importance grandissante et elle est devenue aujourd’hui un nouvel enjeu de développement durable pour les territoires. Les collectivités, cela a été dit, sont mobilisées et s’engagent de manière volontaire sur la question alimentaire dans l’élaboration d’initiatives locales et de PAT, qui contribuent à la construction de nouvelles politiques transversales. C’est le cas en particulier dans mon département, l’Ariège, où le PAT du pays des Pyrénées cathares a été mis en place dès le mois de mai 2018.
La problématique de l’agriculture de proximité, de la préservation du foncier et des activités agricoles est prioritaire. Vous le savez, la maîtrise foncière est l’un des principaux outils dont nous disposons pour permettre et encourager l’installation de nouveaux agriculteurs, en mobilisant du foncier ou en achetant en fonction des opportunités, en lien avec les Safer.
Pourtant, alors même que le droit de préemption des Safer a été conforté par l’acquisition de la totalité des parts d’une société, il s’avère que de nombreuses acquisitions de terres agricoles par des sociétés parfois étrangères continuent de susciter interrogations et inquiétudes.
Ainsi, les fonds de gestion, par le biais de sociétés, continuent d’acheter à des exploitants et à des prix parfois très élevés des milliers d’hectares dont les productions sont en règle générale destinées à l’exportation.
Les mécanismes de contournement de notre législation mis en œuvre par ces acheteurs, notamment la pratique des cessions partielles, démontrent clairement l’inefficacité de nos outils de régulation. Les conséquences de cette spéculation sont néfastes pour nos territoires, en particulier pour les nouveaux agriculteurs.
Monsieur le ministre, ma question est donc simple : vous aviez annoncé en 2017 la préparation d’une grande loi foncière, qui devait être programmée d’ici à la fin du quinquennat. Quand proposerez-vous au Parlement ? Comment comptez-vous agir pour mieux réguler le foncier agricole et empêcher les contournements du droit de préemption des Safer ?
Vous me posez plusieurs questions, monsieur le sénateur Michau, qui font également écho aux interrogations de plusieurs de vos collègues.
Oui, il faut profondément améliorer le foncier agricole. Les défis sont nombreux, vous l’avez dit : le statut de l’agriculteur, le fermage, la régulation. Ce sont autant de sujets sur lesquels nous avons déjà collégialement beaucoup travaillé. Le Sénat a énormément produit sur cette question et le ministère, notamment sous l’impulsion de mon prédécesseur, s’est aussi fortement engagé.
Va-t-on faire une grande loi foncière d’ici à la fin du quinquennat ? Vous connaissez ma franchise dans les réponses. De fait, le temps parlementaire a été énormément contraint par les textes liés à la situation exceptionnelle que nous vivons depuis plusieurs mois. Je ne crois pas, à titre personnel, que nous aurons la fenêtre de tir pour mener à bien cette grande loi foncière. En tout état de cause, cela ne doit pas nous empêcher de nous dire que nous la présenterons au début du prochain quinquennat, si toutefois vous le désirez, monsieur le sénateur…
Sourires.
Nous pouvons aussi avancer sur de nombreux sujets qui ne nécessitent pas l’intervention de la loi.
Prenez par exemple la question de la régulation par les Safer. Vous connaissez comme moi la gouvernance de ces sociétés, monsieur le sénateur… Franchement, on n’a pas besoin de la loi pour améliorer leur gestion ici ou là. Bien entendu, cela ne veut pas dire qu’il faut renoncer à améliorer le cadre légal.
Le portage foncier ne nécessite pas non plus de modifications législatives. On ne le sait pas suffisamment, mais le foncier agricole coûte beaucoup moins cher en France que dans les pays voisins. Comment se fait-il que nous n’en tirions aucun avantage compétitif ? Un jeune agriculteur qui s’installe, avant même de commencer, contracte systématiquement 200 000 ou 300 000 euros d’emprunt. Nous travaillons à la recherche de solutions très concrètes, sans passer par la loi.
Nous devons aussi selon moi régler la question de la retraite de nos agriculteurs, qui présente un lien direct avec le foncier. Comment expliquer cette pression foncière sur l’acquisition des terres, surtout depuis la génération qui me précède ? Tout simplement parce que, aujourd’hui, quand vous êtes agriculteur, vous financez votre retraite par le foncier !
Si l’on veut réussir à trouver de nouvelles modalités permettant aux jeunes de moins s’endetter, la première des choses à faire, c’est de régler le problème de la retraite des agriculteurs. C’est tout le travail qui est en cours, à la suite d’une proposition de loi adoptée à l’Assemblée nationale.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous alimenter de façon saine et durable est devenu un enjeu majeur et constitue une véritable attente de la part de tous nos concitoyens.
Des États généraux de l’alimentation en 2017 à la loi Égalim en 2018, l’ensemble des acteurs se sont prononcés. Ce sont autant d’enjeux sanitaires, écologiques, agricoles et économiques qui font la complexité du sujet.
Une impulsion a été donnée par l’article 24 de la loi Égalim, qui prévoit que les repas servis en restauration collective publique, d’ici au 1er janvier 2022, devront compter au moins 50 % de produits alimentaires durables de qualité, dont 20 % issus de l’agriculture biologique.
Nous souscrivons à cet objectif, mais nous sommes confrontés à des difficultés de mise en œuvre parce que nous n’avons pas les moyens sur le terrain. Nous ne comptons pas assez de producteurs, pas assez de maraîchers notamment.
Que l’on parle de souveraineté alimentaire ou d’alimentation saine et durable, les circuits courts devraient être notre objectif n° 1. C’est d’ailleurs une ambition tracée par le Green Deal européen, avec la stratégie « De la ferme à l’assiette » présentée le 20 mai dernier par la Commission européenne.
Pour atteindre l’objectif, il faut aider à l’installation de producteurs locaux et leur assurer des volumes et des prix rémunérateurs.
Prévus par la loi d’avenir pour l’agriculture en 2014, quelque 190 projets alimentaires territoriaux (PAT) ont vu le jour. Le Gouvernement en voulait 500, mais le développement est plus lent que prévu.
J’en viens à ma première question, monsieur le ministre. Quelle est votre stratégie pour accélérer l’implantation de ces PAT, afin qu’ils nous permettent de tenir nos engagements pour 2022 ?
Par ailleurs, quelles positions défendra la France, dans le cadre de la réforme de la PAC, pour concilier la transition agroécologique et la prise en compte de la situation financière critique de nos agriculteurs ?
Pour répondre à votre première question, madame la sénatrice Pluchet, je pense fondamentalement que, pour accélérer, il faut des moyens.
C’est pourquoi, dans le plan de relance, 80 millions d’euros sont consacrés à l’accompagnement des PAT. Il y a aussi un gros travail d’accompagnement à faire. J’évoquais ce point avec les chambres d’agriculture, mais je pense que la Haute Assemblée a aussi son rôle à jouer, en montrant ce qui se passe ici ou là et en convainquant d’autres de participer à cette dynamique.
Vous avez raison, tout est lié. Ici, il n’y a pas suffisamment d’agriculture biologique – la surface agricole utile en bio représente aujourd’hui environ 8, 5 % du total, ce qui est insuffisant – ; là, nous devons favoriser davantage les productions sous signe officiel de qualité (SIQO). C’est pourquoi je lance le crédit d’impôt haute valeur environnementale (HVE).
Enfin, vous l’avez souligné, il n’existe pas de définition du « produit local » : on ne sait pas s’il doit parcourir 60, 80 ou 150 kilomètres. Je suis toutefois très à l’aise avec la définition avancée par le sénateur Duplomb, et je peux même dire que je la partage. Mais c’est précisément parce que cette notion n’est pas définie, et probablement pas définissable, qu’elle n’a pas été insérée dans l’article 24 de la loi Égalim.
Les PAT constituent toutefois le bon levier pour assumer le caractère local du produit, quel qu’il soit, à une échelle compréhensible par le citoyen. Celui-ci voit bien, à son niveau, ce qu’est un produit local.
Sur la transition agroécologique, je fais partie de ceux qui disent qu’elle a un coût. Il est trop facile d’adresser aux agriculteurs des injonctions de faire sans vouloir les rémunérer pour la réalisation de cette transition.
Il ne s’agit en aucun cas d’opposer les uns aux autres – les agriculteurs sont les premiers à souhaiter la transition agroécologique –, mais de mettre en cohérence nos demandes et nos actes.
Ce n’est pas un gros mot de dire qu’il faut rémunérer l’agriculteur qui met en œuvre cette transition. Ce n’est pas être anti-écologiste, juste pragmatique, car nos agriculteurs, ces « entrepreneurs du vivant », ont besoin de vivre pour convaincre les générations futures d’entrer dans cette grande famille agricole qui peut créer de nombreux emplois, à condition qu’ils soient rémunérés.
C’est ainsi que l’on avancera, et la PAC doit nous y aider.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le travail de nos éleveurs fait notre fierté collective. Malheureusement, le confinement et les mesures de restriction appliquées à la restauration collective, aux restaurateurs ainsi qu’aux professionnels du tourisme renforcent aujourd’hui les difficultés que certaines filières animales connaissaient depuis plusieurs années.
Je voudrais attirer particulièrement votre attention sur la situation des abattoirs de proximité, qui sont nombreux à rencontrer des difficultés en milieu rural.
Ainsi, l’abattoir de Ribérac, qui emploie 21 personnes dans mon département de la Dordogne, est au bord du gouffre à la suite d’une diminution drastique du nombre de bêtes abattues : 1 200 aujourd’hui, contre 4 000 il y a quelques années.
Le retrait de la société Arcadie au printemps a réduit son activité de moitié et porté un coup fatal à cet abattoir, qui cumule 700 000 euros de dette, dont 200 000 euros de redevance due à la commune.
Le maintien de ces abattoirs locaux est pourtant nécessaire : pour limiter le temps de transport des animaux et l’impact sur l’environnement, pour favoriser les circuits courts et une économie circulaire conforme aux nouvelles attentes de nos concitoyens, pour maintenir aussi des emplois dans des territoires en difficulté.
Si rien n’est fait, leur disparition entraînera le déséquilibre de nombreuses filières. Le label « veau élevé sous la mère », qui fait la fierté du Ribéracois, est aujourd’hui menacé.
Monsieur le ministre, le volet « filières animales » du plan France relance a été doté d’une enveloppe de 250 millions d’euros, dont 130 millions d’euros spécifiquement dédiés à la modernisation des abattoirs et aux outils de première transformation.
Que comptez-vous faire pour sauver nos abattoirs ruraux ? Quels leviers comptez-vous activer pour inciter les acteurs privés à investir dans ces structures essentielles à une alimentation durable et locale ?
Je connais bien la situation en Dordogne et les conséquences des difficultés du groupe Arcadie, qui ont impliqué différentes reprises, notamment celle de l’abattoir de Ribérac par Carnivor à la suite d’une procédure douloureuse devant le tribunal de commerce de Montpellier – je parle sous votre contrôle, monsieur le sénateur.
J’irai même plus loin que vous : c’est l’identité même d’un territoire qui est parfois menacée. Si l’abattoir disparaît, l’indication géographique tombe. Ce serait le cas pour les agneaux du Quercy, par exemple.
Il est pour moi essentiel de pouvoir aider ces abattoirs de proximité. C’est pourquoi j’ai décidé d’inclure dans le plan de relance une enveloppe très importante pour les accompagner.
Les abattoirs territoriaux font parfois quelques bénéfices, mais le plus souvent ils gagnent peu ou pas d’argent, alors même que les collectivités locales les soutiennent souvent avec beaucoup de détermination.
Nous devons pouvoir leur apporter un soutien financier. Aujourd’hui, l’enveloppe est disponible ; le sujet est donc de faire remonter les projets, en lien avec les préfectures localement. Je vise plus particulièrement deux objectifs, d’une part la modernisation et la rentabilité de ces abattoirs, d’autre part la question du bien-être animal, pour diminuer le stress des animaux. Nous avons les moyens de notre ambition et je serai ravi d’en discuter avec vous, monsieur le sénateur.

Monsieur le ministre, qu’il me soit d’abord permis de dédier cette question à la mémoire de Laurent Darras, agriculteur décédé à la suite d’un accident dans son exploitation, hier, à Villers-Saint-Frambourg-Ognon, dans l’Oise.
Voilà quelques jours, le Président de la République déclarait : « Être jeune en 2020 n’est pas facile. » Être agriculteur ne l’est pas davantage. Violences à leur encontre, surenchérissement du coût du travail, surtranspositions récurrentes, complexités administratives, désertification vétérinaire, transmission des exploitations : la liste des défis auxquels ils sont confrontés est longue et en découragerait plus d’un. Vivre honnêtement et décemment de leur travail arrive en tête de ces défis.
Pour les relever, l’État n’est pas à la hauteur des attentes des agriculteurs. De perpétuels allers-retours voient chaque avancée immédiatement chassée par une nouvelle déception.
Ainsi, la loi Égalim, qui a fait naître tant d’espoirs, n’a rien résolu ! Elle laisse aujourd’hui place à la colère, tandis que sont signés des traités internationaux qui mettent en péril notre production.
C’est le cas encore lorsque vous devez assumer l’interdiction des néonicotinoïdes, tout en promettant une solution alternative qui n’arrive toujours pas. Et vous voilà obligés – le Parlement vous en sait gré – de demander une dérogation indispensable !
Résultat, l’agriculture française décroche par rapport à ses concurrents. Pourtant, elle est un atout indéniable pour notre avenir, non seulement parce qu’elle assure notre souveraineté et notre sécurité alimentaire, et qu’elle est l’ADN de nos territoires ruraux, mais aussi parce qu’elle est un formidable moteur pour l’ensemble de notre économie et la vitrine d’un savoir-faire unique, reconnu et envié dans le monde entier.
Nos agriculteurs sont les premiers écologistes. Ils respectent cette terre qu’ils ont su apprivoiser. Notre agriculture est sans doute l’une des plus durables, voire la plus durable, du monde. Elle atteint un niveau d’exigence inégalé, avec des produits de qualité dont nous pouvons être fiers.
Monsieur le ministre, à quand une campagne de sensibilisation et une politique qui revalorisent la profession et défendent nos agriculteurs ?
Monsieur Courtial, je vous remercie sincèrement pour votre question. Vous avez, ô combien, raison de ne pas tomber dans la critique facile, mais bien plutôt de valoriser ce beau métier d’agriculteur et d’éleveur !
J’en appelle à toute la jeunesse de France. Le monde agricole recrute, et il s’agit de métiers de passion. Quelle plus belle passion que celle du vivant, de la terre, de l’environnement ? Voilà ce qui anime nos agriculteurs !
L’agriculture est un métier d’innovation. Contrairement à nombre d’idées reçues, l’innovation est au cœur des métiers agricoles : machinisme, gestion raisonnée de l’ensemble des intrants, outils de transformation, autant de secteurs d’innovation dans lesquels notre pays est souvent leader mondial.
Au-delà de cette passion et de cette innovation, le métier d’agriculteur a l’une des plus importantes finalités qui soit, au service du peuple français : nourrir l’ensemble de nos concitoyens et leur donner confiance dans la santé nutritionnelle que j’évoquais, à l’instant, à cette tribune de la Haute Assemblée.
Le départ à la retraite d’un agriculteur sur deux dans les dix prochaines années constitue aujourd’hui un défi majeur. Nos lycées agricoles représentent un actif absolument considérable, ces lycées du vivant qui forment celles et ceux qui le souhaitent, tout au long de leur vie, en formation initiale comme en formation continue, aux métiers du vivant.
Ce sont des métiers de passion, d’innovation, de noblesse, des valeurs que nous devons défendre. J’ai pris cet engagement auprès des agriculteurs, celui de toujours me battre pour qu’ils puissent vivre dignement de leur métier. Je ne lâcherai rien !
Le deuxième engagement que je prends, monsieur le sénateur, est de faire en sorte que nous puissions lancer très rapidement cette campagne de communication. Dans le plan de relance, 10 millions d’euros y seront consacrés. Nous avons beaucoup travaillé à cette campagne avec les Jeunes agriculteurs (JA), car il y va de notre souveraineté : une agriculture sans agriculteurs est impossible.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le développement des circuits courts est une tendance émergente de la consommation alimentaire, largement confirmée depuis l’épidémie de la covid-19. Cette crise sanitaire a développé l’attrait des consommateurs pour les produits locaux et pour la traçabilité des aliments. Elle a également révélé le soutien et la solidarité des Français envers les producteurs de proximité. Une relation de confiance s’est construite ; il est indispensable qu’une politique de soutien économique et fiscale vienne pérenniser cette relation.
Certes, ces filières bénéficient des aides de l’État, au même titre que les entreprises des secteurs touchés par la crise sanitaire. Cependant, au-delà des mesures d’urgence, nous devons conforter leur avenir.
À ce titre, la loi Égalim n’a pas permis de mieux structurer l’offre alimentaire produite sur le sol français, comme le Sénat a pu le constater dans son bilan d’application de la loi. Elle n’a pas non plus apporté les bénéfices économiques attendus pour les agriculteurs locaux. En effet, leurs revenus restent insuffisants, alors que la demande pour leurs produits augmente et que des emplois pourraient être créés, si l’État soutenait ces filières de manière pérenne.
Monsieur le ministre, vous avez évoqué au début de ce débat la signature d’une série d’engagements avec les supermarchés, pour favoriser l’agriculture de proximité. Pourtant, permettez-moi de ne pas y voir la bonne solution.
Rendre les agriculteurs dépendants de la grande distribution, est-ce pertinent ? Les habitants ont pris de nouvelles habitudes d’achat de proximité. Nous devons garantir l’indépendance des agriculteurs, pour qu’ils puissent répondre aux attentes des clients d’aujourd’hui, lesquels participent aujourd’hui à la revitalisation des villages et villes de la France rurale, et favorisent le lien social dans nos communes rurales.
Monsieur le ministre, quelles mesures structurelles par le Gouvernement envisage-t-il de prendre pour soutenir l’ensemble de ces acteurs des filières locales ?
Cet accord et ces engagements passés avec la grande distribution n’obèrent en rien nos autres actions. Ils ne sont en rien exclusifs d’autres mesures !
Lors du premier confinement, nous avons constaté l’attrait d’un grand nombre de nos concitoyens pour ces produits frais et locaux dans les supermarchés. Il m’a semblé très important de pouvoir pérenniser cette tendance, au bénéfice de nos agriculteurs.
Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas, en même temps, structurer les filières localement. Le plan de relance prévoit 60 millions d’euros à cette fin.
Nous créons aussi les PAT, qui permettent de développer les débouchés de proximité grâce à une meilleure articulation avec l’amont de la chaîne de production. Le plan de relance y consacre 80 millions d’euros.
Enfin, 50 millions d’euros sont destinés, dans le cadre dudit plan, aux cantines scolaires. Nous nous intéressons aussi à la restauration collective, qui représente un enjeu absolument essentiel. Nous devons jouer sur tous les tableaux, et la grande distribution en fait partie.
Nous allons finaliser cet accord avec la grande distribution. Nous avons déjà commencé ce travail avec les commerçants qui, depuis toujours, valorisent les circuits locaux ; les artisans, notamment, créent la valeur ajoutée de leurs produits. Il en va de même dans le domaine de la restauration collective. Pas plus tard que la semaine dernière, en dépit des grandes difficultés que rencontre ce secteur, tous les acteurs ont souhaité participer à cette démarche.
Il me semble fondamental de développer aussi bien l’export que les circuits courts, et pour ces derniers dans toutes leurs facettes, de l’amont à l’aval, quels que soient les circuits de distribution. Pour chacun de ces circuits, je m’y emploierai avec la même détermination.

Le débat qui nous réunit aujourd’hui, monsieur le ministre, vient opportunément mettre le sujet de l’alimentation durable, et donc celui de l’agriculture, au cœur de nos discussions. Nous ne pouvons que nous en féliciter.
Bien que cette thématique ne soit pas vraiment nouvelle, elle a pris ces derniers mois, à la faveur de la pandémie, un relief particulier. En effet, chaque Français a pu constater par lui-même, au fur et à mesure que les frontières fermaient, à quel point la souveraineté alimentaire de la France était nécessaire, à quel point le circuit court pouvait répondre aux besoins d’une population, à quel point la démultiplication des circuits d’achat devait faire l’objet de toute notre attention.
À cet égard, la mise en place de maisons des producteurs au sein de plusieurs bassins de vie semble avoir apporté des réponses satisfaisantes, pour les consommateurs comme pour les agriculteurs.
Le principe de ces structures est assez simple : il s’agit de réunir des producteurs qui s’engagent à respecter une charte des bonnes pratiques garantissant la qualité de leurs produits, et de mettre à leur disposition des locaux ou du foncier pour qu’ils puissent vendre directement leurs produits de saison. Aujourd’hui, 37 départements participent à cette démarche et organisent plus de 2 500 marchés qui sont, en outre, devenus de véritables outils d’animation et de développement des territoires, tout au long de l’année.
Néanmoins, si l’objectif est simple, la mise en œuvre se heurte à deux difficultés majeures : le financement et la lisibilité.
En ce qui concerne le financement, chaque création d’une nouvelle maison des producteurs est le fruit d’un partenariat entre les producteurs, la chambre d’agriculture et les collectivités locales. Or les budgets respectifs sont contraints et l’aide de l’État s’avère nécessaire.
Pour ce qui est de la lisibilité, l’écueil semble être le même que pour le développement de sites marchands en ligne favorisant la consommation locale – voyez la campagne « Dans ma zone » en Occitanie…
Toutes les initiatives sont pertinentes, mais entre les plateformes des chambres consulaires, des associations d’élus, des collectivités, des commerces et des artisans de proximité, les professionnels et les consommateurs finissent par s’y perdre.
Au sortir de la pandémie, face à des budgets contraints, nous verrons un élan réel pour mailler le territoire avec des structures nouvelles, qui mutualisent les forces de chacun. Les agriculteurs le souhaitent, les Français y souscrivent également. Vous savez combien les Français ont toujours manifesté un attachement historique et culturel à leur alimentation.
Aussi, ma question est simple : quelle aide l’État serait-il prêt à apporter pour la création de nouveaux marchés des producteurs ou la professionnalisation des marchés existants ?
Madame la sénatrice, je crois beaucoup à ces maisons des producteurs, ainsi qu’aux marchés de gros. Nous parlons souvent de Rungis, qui est un formidable exemple de l’excellence française, mais un peu moins des autres marchés qui maillent notre territoire et ne sont pas souvent associés à certaines initiatives et politiques publiques que nous mettons en œuvre.
Je suis tout à fait d’accord pour accélérer et soutenir le développement de ces maisons des producteurs. Nous pouvons les financer au titre des PAT. Puisque ces projets visent à consolider les filières de l’amont à l’aval, en fonction des projets de territoire, ils peuvent parfaitement soutenir ces structures.
Lorsque l’État engageait entre 40 000 et 50 000 euros en faveur d’un PAT, la collectivité n’utilisait pas forcément ces sommes pour financer d’abord la maison des producteurs, tant les défis étaient déjà nombreux. En engageant des sommes vingt-cinq fois supérieures, soit 80 millions d’euros sur deux ans, versus 6 millions d’euros sur quatre ans, l’État donne des moyens à la hauteur de cette forte ambition, notamment – mesure que j’appelle de mes vœux – pour l’inclusion de ces maisons dans des PAT. Je suis prêt à travailler avec vous sur ces questions.
Madame la présidente, puisque je n’ai pas complètement épuisé mon temps de parole, je me permets de vous remercier pour la manière dont vous avez présidé ce débat et pour la mansuétude dont vous avez fait preuve à l’égard de mes réponses un peu longues.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie.
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.

En conclusion de ce débat, la parole est à M. Frédéric Marchand, pour le groupe auteur de la demande.

Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Nous sommes tous unanimes, et vous le premier, monsieur le ministre, pour dire que l’accès à une alimentation saine, durable et locale est une priorité. Il s’agit d’une question autant de justice sociale que de santé publique, vous l’avez dit et répété.
Notre débat a permis de mesurer combien les territoires sont essentiels au développement d’une alimentation de qualité et de proximité accessible à tous. Cet enjeu est au cœur du plan de relance et des mesures que vous avez pu, monsieur le ministre, tout au long de ce débat, exposer : création de circuits courts et lutte contre le gaspillage, pratiques exemplaires et filières locales. Il est évident que les territoires ont un rôle clé à jouer pour développer de véritables synergies alimentaires.
Nos territoires ont un rôle clé d’assemblier à jouer, notamment sur la question de l’accélération de la transition agroécologique au service d’une alimentation saine, sûre, durable, locale et de qualité pour tous. Y répondre nécessite une transition vers des modèles plus résilients. L’importance de notre souveraineté alimentaire, les demandes pour des produits locaux exprimées tout au long de cette crise sanitaire, tant par les citoyens que par la Convention citoyenne pour le climat, ne font que confirmer ce besoin.
Monsieur le ministre, ce grand dessein que vous incarnez, lequel est l’alpha et l’oméga de votre action quotidienne, ne peut réussir que si l’on s’appuie – vous l’avez dit – sur la dynamique territoriale partagée par tous les acteurs. Nos agriculteurs ont besoin d’un soutien toujours plus fort pour s’engager dans des modes de production vertueux, pour valoriser leur démarche et trouver des débouchés qui récompensent les efforts réalisés.
Un autre enjeu, dont nous sommes toutes et tous convaincus de l’importance, est la relocalisation de la production agricole par l’encouragement du développement de filières ancrées dans les territoires, le développement des circuits courts et la structuration de nouvelles relations sur l’ensemble de la chaîne entre producteurs et consommateurs.
Ce mois dédié à l’économie sociale et solidaire (ESS) nous donne l’occasion de marteler le message suivant : cette économie et l’alimentation durable et locale doivent, encore et toujours, développer des liaisons heureuses. Le renforcement des circuits de proximité doit être une priorité en vue, et ce n’est pas anodin, de redévelopper l’emploi dans les territoires et de réduire l’impact environnemental de notre alimentation.
Cette crise sanitaire a montré un véritable élan de nos concitoyens vers un retour à la terre. Il convient donc d’amplifier la dynamique en milieu rural et en milieu urbain. Le sujet a été au cœur de nombre de programmes municipaux. Pour ne prendre que l’exemple du département du Nord, un grand nombre de communes et d’intercommunalités ont fait de l’alimentation durable et locale un véritable objet politique. Je ne compte plus le nombre d’élus délégués à l’alimentation durable et locale ; chacun pourra s’en féliciter.
Enfin, nous devons collectivement relever l’immense défi d’une alimentation durable et locale de qualité accessible à tous – vous l’avez également répété, monsieur le ministre. L’accès de nos concitoyens les plus modestes, les plus isolés, à une alimentation locale saine, sûre, durable et de qualité est une priorité à laquelle nous devons consacrer tous les moyens financiers et toutes les énergies. Nous pouvons collectivement saluer l’effort financier que vous avez évoqué, dans le cadre des PAT.
Pour conclure, et ainsi respecter à la lettre les consignes de madame la présidente, vous me permettrez de citer Brillat-Savarin, qui, dans son traité La P hysiologie du goût, propose cette formule que je nous invite à faire nôtre collectivement, et qui est sans doute votre mantra quotidien, monsieur le ministre : « La destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent. »

Merci, mon cher collègue, vous avez été exemplaire ! Monsieur le ministre, je vous cède la parole.
Je souhaite remercier le sénateur Marchand d’avoir inscrit ce débat à l’ordre du jour.
La période actuelle nous montre qu’il convient de ne pas dissocier les sujets. L’alimentation est aussi une question de santé. La santé ne concerne pas seulement l’homme, mais l’ensemble de ses interactions avec le règne animal et le règne végétal. La politique « Une seule santé », en laquelle croient beaucoup d’entre vous, montre que cette approche holistique, globale et d’unité au sein du monde vivant est très certainement pertinente.
La complexité de la nature rend nos chemins certes difficiles à appréhender, mais passionnants à explorer.
M. Frédéric Marchand applaudit.

Nous en avons terminé avec le débat sur le thème : « Alimentation durable et locale. »
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante, est reprise à vingt-et-une heures trente, sous la présidence de M. Georges Patient.