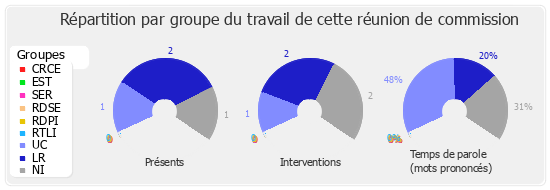Mission commune d'information Formation professionnelle
Réunion du 11 avril 2007 : 1ère réunion
Sommaire
- Audition de mm. jean-louis nembrini directeur général de l'enseignement scolaire et bernard saint-girons directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche (voir le dossier)
- Audition de m. patrick pelletier président et de m. jean-pierre michel vice-président de l'association nationale des conseillers en formation continue anacfoc (voir le dossier)
- Audition de m. xavier baux président de la chambre syndicale des organismes de formation en alternance csofa (voir le dossier)
- Audition de m. jean-claude tricoche secrétaire national de l'union nationale des syndicats autonomes unsa chargé de la formation professionnelle (voir le dossier)
La réunion
Audition de Mm. Jean-Louis Nembrini directeur général de l'enseignement scolaire et bernard saint-girons directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche
Audition de Mm. Jean-Louis Nembrini directeur général de l'enseignement scolaire et bernard saint-girons directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche
La mission d'information a d'abord procédé à l'audition de MM. Jean-Louis Nembrini, directeur général de l'enseignement scolaire, et Bernard Saint-Girons, directeur général de l'enseignement supérieur, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, accompagnés de Mme Elisabeth Arnold, sous-directrice des formations professionnelles.
a indiqué qu'à la sortie du collège, un élève sur trois s'engageait en formation professionnelle initiale, qui prépare à 213 certificats d'aptitude professionnelle (CAP), 35 brevets d'études professionnelles (BEP) et 62 baccalauréats professionnels, sous statut scolaire, par la voie de l'apprentissage, en formation continue ou par la validation des acquis de l'expérience. Ces diplômes font l'objet d'une mise à jour permanente, en partenariat avec les milieux professionnels. La grande majorité des lycées professionnels est bien équipée, grâce aux efforts engagés par les régions.
Toutefois, il a regretté que l'enseignement professionnel, qui affiche de bons taux de réussite (79 % au CAP ou BEP et 75 % au baccalauréat professionnel), reste encore trop souvent associé à la notion de voie d'échec. Il a souligné les récentes mesures prises en vue de passer d'une orientation subie à une orientation choisie : d'une part, la généralisation d'un entretien d'orientation pour les élèves de troisième et de première, y compris en première année de CAP ou BEP ; d'autre part, la mise en place, à la rentrée 2005, de l'option de découverte professionnelle, proposée à tous les élèves de troisième, afin de leur offrir un premier contact avec le monde économique.
a insisté, ensuite, sur le nombre de jeunes quittant le système de formation sans qualification, en le reliant aux 15 % d'élèves entrant au collège sans maîtriser les savoirs de base constituant le socle commun de connaissances et de compétences.
Il a avancé quelques propositions, visant à maintenir une offre de formation de niveau V adaptée, à faire en sorte que chaque BEP débouche sur un baccalauréat professionnel, à diversifier les parcours de formation afin de faciliter les réorientations, par exemple en développant le baccalauréat professionnel en trois ans, à promouvoir le modèle de lycée des métiers, permettant d'assurer une liaison entre formation initiale et continue, et à amplifier l'essor du dispositif de validation des acquis de l'expérience. Il a suggéré, enfin, de prendre appui sur le réseau de formation continue relevant de l'éducation nationale en vue de renforcer l'articulation entre formation initiale et continue, avant d'insister sur la nécessité de renouveler les emplois dans les secteurs en tension.
De son côté, rappelant que les universités avaient pris en compte l'objectif de professionnalisation dès les années soixante, avec la création des diplômes universitaires de technologie (DUT), puis avec la mise en place du diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) et des instituts universitaires professionnalisés (IUP), M. Bernard Saint-Girons a reconnu, toutefois, qu'il restait encore d'importants progrès à accomplir. Il a indiqué que la mise en place du système « Licence-Master-Doctorat » (LMD) et l'intégration dans le processus de Bologne contribueraient à améliorer la lisibilité des formations universitaires, à développer la professionnalisation, notamment dans le cadre des licences professionnelles qui sont habilitées par les universitaires et les représentants des professions, dans une perspective d'insertion. Par ailleurs, alors qu'il existe une forte césure entre les missions de formation initiale et continue, cette nouvelle architecture des formations devrait permettre de développer la formation continue, en introduisant une plus grande flexibilité des parcours.
Enfin, M. Bernard Saint-Girons a considéré que le concept de formation tout au long de la vie ne trouvait pas encore de traduction concrète. Si les outils existent, il reste encore à faire évoluer les mentalités de façon à ne plus séparer de façon hermétique le temps des études et de la formation et le temps du travail.

A l'issue de ces interventions, M. Jean-Claude Carle, président, relevant le nombre élevé de diplômes, a demandé si un effort de simplification était nécessaire, avant de s'enquérir du devenir du BEP. Il s'est interrogé sur les moyens de passer d'une orientation subie à une orientation choisie, puis s'est demandé si l'éducation nationale ne devrait pas mieux s'approprier l'apprentissage afin de le valoriser. Enfin, il a souhaité savoir si le plan régional de développement des formations professionnelles (PRDF) constitue un bon outil de programmation et d'anticipation des besoins de formation.
a reconnu que le nombre de diplômes était sans doute trop élevé et que cette spécialisation de l'enseignement professionnel ne répondait pas aux besoins actuels d'adaptation et de réorientation, supposant la maîtrise d'un socle de connaissances générales. Le BEP n'assure pas de débouchés professionnels, mais ce palier intermédiaire vers le baccalauréat sécurise les élèves les plus fragiles. Afin d'améliorer le système d'orientation, l'éducation nationale et le corps enseignant doivent être plus ouverts au monde économique. En ce sens, un stage obligatoire en entreprise a été introduit dans le nouveau cahier des charges de la formation des maîtres.
a ajouté que l'éducation nationale devait en effet davantage prendre part au développement de l'apprentissage, qui participe à l'égalité des chances. Il a indiqué qu'il avait mis en place, alors qu'il était recteur de l'académie de Créteil, un centre de formation d'apprentis (CFA) académique sans murs, destiné à apporter un appui et une expertise aux établissements en vue de finaliser leurs projets ou de consolider leurs relations avec les entreprises. Par ailleurs, des universités, comme celle de Marne-la-Vallée, proposent, à tous les niveaux, des formations en apprentissage. Le PRDF, point de convergence des politiques nationales et locales, constitue un outil essentiel.
a précisé que certains diplômes très spécialisés devaient néanmoins être préservés, car ils correspondent à des métiers rares. Une réflexion avec les milieux professionnels est en cours pour tenter de réduire le nombre de BEP, afin qu'ils ouvrent sur plusieurs baccalauréats professionnels. Par ailleurs, le ministère de l'éducation nationale travaille avec les six autres ministères certificateurs en vue d'harmoniser les différents titres et de créer des équivalences entre eux.
En réponse à M. Jean-François Humbert, qui s'inquiétait des difficultés tenant à la multiplicité des ministères certificateurs, M. Jean-Louis Nembrini a convenu que le ministère de l'éducation nationale devrait avoir la responsabilité de l'élaboration des diplômes, en liaison avec les ministères concernés, de façon à créer un guichet unique pour les certifications d'Etat.
Soulignant l'exigence que les référentiels professionnels soient définis au plus près des attentes des futurs employeurs, M. Bernard Saint-Girons a insisté sur la nécessité de ne pas opposer les formations générales et professionnelles, en développant les passerelles et les articulations entre elles.

a fait observer qu'un guichet unique des certifications devrait permettre de mieux évaluer les diplômes, alors que certains n'assurent aucun débouché professionnel aux jeunes.

a regretté que l'enseignement professionnel reste encore associé aux jeunes en difficulté, alors qu'il faudrait au contraire inciter de bons élèves de troisième à s'engager dans cette voie. Après avoir fait observer que certains BEP assuraient une bonne insertion professionnelle, elle s'est interrogée sur la place accordée par l'éducation nationale à l'enseignement professionnel et à l'alternance sous statut scolaire, s'inquiétant des baisses de moyens et des suppressions de sections les affectant, au profit des filières en apprentissage.

considérant que les enseignants n'avaient pas vocation première à s'occuper de l'orientation des jeunes, s'est inquiétée du nombre insuffisant de conseillers d'orientation-psychologues et a souhaité que l'on donne à ces derniers les moyens d'exercer leurs missions.

s'est interrogée sur le maintien de filières n'assurant plus aucun débouché, avant de citer un exemple réussi de coopération entre le monde économique et les enseignants, dans le quartier des Docklands à Londres.

a souligné le fossé général existant entre les Français et le monde économique, relevant notamment que 70 % des parents de collégiens souhaitaient que leur enfant intègre la fonction publique. Il a regretté que le stage en entreprise proposé aux élèves de troisième, partant d'un bon principe, ne produise pas les résultats escomptés, en raison d'un manque d'encadrement par les enseignants et d'un accueil hétérogène au sein des entreprises. Il a souhaité que l'option de découverte professionnelle échappe à ces difficultés. Enfin, il s'est demandé comment mieux valoriser, dans la carrière des enseignants du supérieur, les tâches autres que les publications de recherche, comme par exemple la participation aux activités de formation continue.
En réponse à ces intervenants, M. Jean-Louis Nembrini a apporté les précisions suivantes :
- le BEP constitue également une voie d'excellence pour les élèves issus des sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ; par ailleurs, l'alternance, souvent perçue comme une orientation précoce, permet de redonner à certains jeunes le goût des études générales ;
- il faut revaloriser la fonction de professeur principal et apporter une formation aux enseignants pour leur permettre de jouer un plus grand rôle en matière d'orientation ; l'idée d'introduire un stage obligatoire en entreprise dans la formation des futurs enseignants a été inspirée par des exemples étrangers ; s'il reste encore du chemin à parcourir pour rapprocher les deux mondes de la formation et de l'entreprise, les mentalités ont évolué et des organismes ont été créés pour leur permettre de travailler en commun ;
- il est difficile de supprimer un diplôme, car cela suppose de réorienter les élèves et les enseignants de ces filières.
a ajouté les éléments de réponse suivants :
- on relève, à tous les niveaux, les carences du système d'orientation et l'insuffisance de l'information donnée aux jeunes ; il ne faut pas dissocier l'acte pédagogique et l'acte d'orientation ; dans le cadre de l'orientation active mise en place à partir de cette année pour l'entrée à l'université, les professeurs de premier cycle peuvent apporter aux jeunes des conseils sur les pré-requis à maîtriser dans les filières demandées et identifier leurs chances de réussite ;
- la carte des formations doit être gérée de façon dynamique, afin de ne pas laisser perdurer des filières ne menant à aucun débouché ; l'enjeu est, en parallèle, de développer dans les académies une politique ambitieuse de gestion des ressources humaines ;
- la licence professionnelle permet de répondre aux attentes des entreprises : la durée d'insertion des diplômés constitue un indicateur majeur d'évaluation ;
- les recteurs disposent d'un quota de promotion permettant de valoriser les enseignants du supérieur s'investissant dans d'autres tâches que les publications de recherche.
Audition de M. Patrick Pelletier président et de M. Jean-Pierre Michel vice-président de l'association nationale des conseillers en formation continue anacfoc
Audition de M. Patrick Pelletier président et de M. Jean-Pierre Michel vice-président de l'association nationale des conseillers en formation continue anacfoc
La mission d'information a ensuite procédé à l'audition de M. Patrick Pelletier, président, et de M. Jean-Pierre Michel, vice-président, de l'Association nationale des conseillers en formation continue (ANACFOC).
a, d'abord, rappelé que le chiffre d'affaires des organismes de formation continue, qui s'élève à 5,4 milliards d'euros par an, est en progression continue sauf pour les prestations assurées par le secteur public [éducation nationale et les groupements d'établissements pour la formation continue (GRETA)]. Sur les 1 300 conseillers en formation continue qui exercent auprès de 280 GRETA répartis sur l'ensemble de la France métropolitaine, la moitié appartient à l'association ANACFOC. Cette association s'est fixé pour but de réfléchir au rôle du réseau de formation continue dans l'éducation nationale, et notamment sur l'évolution de la structure des GRETA.
Puis il a attiré l'attention sur le fait que l'activité des organismes de formation des adultes augmente de 9 % par an mais que, paradoxalement, celle du réseau public est en baisse malgré l'évolution du nombre de stagiaires, qui plus est parmi les publics les plus en difficulté. Son association croit en la promotion du service public de formation des adultes comme facteur d'accompagnement du développement local, y compris dans des zones où celui-ci n'est pas forcément « rentable ».
a, ensuite, estimé que la France était loin d'atteindre l'objectif européen de Lisbonne (soit 12 % de la population adulte en formation), par manque de moyens et de temps à consacrer à l'ingénierie de la formation, et ceci, malgré des réussites certaines dans ce domaine (comme les centres permanents de formation individualisée). Les formations transversales sont aussi difficiles à mener en raison du poids des branches qui créent des qualifications trop sectorielles, contraires aux impératifs de mobilité, comme le montre l'exemple des conducteurs de machines automatisées, pour lesquels il existe des certificats de qualifications professionnelles différents selon les branches.
Pour conclure, il a émis diverses propositions :
- donner les moyens au service public d'être à l'écoute des besoins locaux, sans que ces moyens soient forcément pérennes ;
- permettre à l'ensemble des organismes du service public de travailler ensemble, par exemple en faisant travailler les GRETA avec l'AFPA et en les aidant à évoluer ;
- rendre au service public un rôle régulateur afin qu'il intervienne davantage pour la recherche et l'innovation, et qu'il soit mieux subventionné, sans être pénalisé par les coûts horaires de ses formateurs ;
- permettre au service public de sortir de la logique des branches : à cet égard, il a regretté que le répertoire national des certifications professionnelles ne permette pas de resserrer davantage le nombre des certificats de qualification professionnelle.

a précisé que la notion de transférabilité devrait être appréhendée au sens large, comme un moyen d'éducation tout au long de la vie et pas simplement de formation.

a interrogé les deux intervenants sur les causes du recul de l'activité du service public de la formation, sur les solutions permettant de passer d'une logique d'offre à une logique de demande et sur les pistes de réforme concernant le statut des GRETA et celui des conseillers en formation continue.
En réponse, M. Patrick Pelletier a indiqué que :
- l'évolution de l'activité du service public de formation résultait de la réduction des demandes venant des OPCA qui portent sur des secteurs très pointus, peu ou mal appréhendés par l'éducation nationale, et du poids des branches sur ce marché. Par ailleurs, elle est liée aux coûts de production élevés des formations proposées, le réseau des GRETA étant le plus cher du marché. A cet égard, il a précisé qu'il y avait une tentation de recourir de plus en plus à du personnel précaire, avec des effets pervers tels que le déficit d'ingénierie pédagogique ;
- on peut distinguer quatre catégories d'enseignants : les titulaires de l'éducation nationale rémunérés en heures supplémentaires par le ministère de l'éducation nationale (40 % des effectifs) ; les titulaires de l'éducation nationale exerçant dans le cadre de postes « gagés » et mis à la disposition des GRETA, ces derniers prenant en charge leurs charges salariales (30 %) ; les contractuels employés par les « lycées supports » des GRETA ; les vacataires privés (30 %). Il a précisé que pour la seconde catégorie (les postes « gagés »), la situation était en train de changer à cause du transfert aux GRETA du coût des charges patronales.
S'agissant du statut des GRETA, M. Patrick Pelletier a souligné qu'actuellement ces groupements d'établissements n'ont aucune existence juridique et que c'est l'établissement public d'enseignement « support » qui en assure, sous la responsabilité de son conseil d'administration, la gestion et la comptabilité, sous la forme d'un budget annexe. Une réforme des GRETA pourrait consister à créer un établissement public local d'enseignement (EPLE) « sans murs » mais possédant un chef d'établissement et un conseil d'administration spécifique, un peu sur le modèle des unités de formation par apprentissage (UFA) pour les centres de formation d'apprentis, sachant qu'une autre solution pourrait être également leur transformation en groupements d'intérêt public (GIP).

lui a demandé de préciser le régime de tutelle et le pilotage d'un tel EPLE.

est intervenue sur la place de ce type d'établissement dans la politique d'accompagnement de la formation tout au long de la vie.

En réponse, M. Jean-Pierre Michel a insisté sur le fait que l'ANACFOC défendait avant tout des valeurs : l'ancrage dans le service public, le lien avec les établissements publics d'enseignement, l'amélioration du système des GRETA, en soulignant le risque « d'usine à gaz » qu'il y aurait peut-être, dans certaines « grosses » académies comme Créteil, à retenir le statut de GIP.
a précisé que le nouvel établissement public serait un point d'ancrage, assurant la coordination de la gestion et la valorisation des locaux dont la propriété, de toute façon, relève actuellement des conseils régionaux, dans le cadre d'une politique de conventionnement avec les différents clients (conseils régionaux, entreprises...). Il a précisé que cela impliquait un rapprochement avec l'AFPA, d'ailleurs effectivement mis en oeuvre sans difficulté sur le terrain, mais plus difficilement au plan national sans doute pour des raisons de rattachement ministériel et de financement. Sur le statut des conseillers en formation continue, sur les 1 300 conseillers, il a rappelé que 60 % sont d'anciens contractuels qui ont conservé leur statut d'origine, alors qu'il s'agit d'un métier à part entière nécessitant des relations stables et approfondies au niveau du territoire. Il a souligné la nécessité de donner un réel statut à ces conseillers, éventuellement par le biais d'une intégration dans le cadre des ingénieurs-techniciens de recherche et formation (ITRF), qui dispose d'une filière spécifique (conseillers en formation) au niveau du rectorat, sans occasionner de dépense budgétaire supplémentaire, à l'exception de quelques postes de fin de carrière.
Puis la mission d'information a procédé à l'audition de M. Xavier Baux, président de la Chambre syndicale des organismes de formation en alternance (CSOFA).
a présenté son organisation professionnelle, créée en 1994 à l'initiative de centres de formation ayant pour vocation principale la promotion de l'alternance et la mise en oeuvre des contrats de professionnalisation - dénommés contrats de qualification avant 2004. En réponse aux demandes de précisions de M. Jean-Claude Carle, président, et de Mme Muguette Dini, il a indiqué que la CSOFA ne rassemblait pas uniquement des organismes de formation impliqués dans les contrats en alternance et a cité quelques membres de la chambre syndicale, comme la Compagnie de formation qui gère le système Pigier ou l'Institut pour la formation et le conseil (IFC).
a ensuite manifesté l'inquiétude de sa chambre syndicale à l'égard de certaines conséquences de la réforme de 2004 de la formation professionnelle. Il a tout d'abord rappelé qu'antérieurement, le dispositif de contrat de qualification avait plutôt bien fonctionné : quantitativement, avec 180 000 à 200 000 contrats signés par an, mais aussi qualitativement, avec des résultats satisfaisants en termes d'insertion professionnelle et un taux d'embauche dans un emploi durable de 85 % au terme d'un contrat de qualification. Il s'est ensuite demandé si le « volet jeune » de la formation professionnelle n'avait pas été en partie délaissé par la réforme de 2004 : en effet, deux ans plus tard, il a constaté le recul de 20 000 du nombre de contrats d'alternance conclus chaque année dans notre pays et souligné que les résultats apparaissaient bien éloignés des intentions initiales, environ 92 000 contrats de professionnalisation ayant été signés en 2005 au lieu des 180 000 envisagés, en dépit d'efforts non négligeables de promotion et de communication.
Il a ensuite évoqué la question dite des « contrats orphelins », c'est-à-dire non financés par les organismes collecteurs rattachés aux branches professionnelles, en prenant l'exemple de jeunes qui, ne pouvant préparer par cette voie un BTS d'informatique de gestion, devaient se tourner vers l'ANPE ou prendre une inscription dans un premier cycle universitaire aux débouchés professionnels aléatoires.
Il a signalé qu'au moment de la réforme, des dérogations avaient toutefois été prévues pour faciliter le financement des contrats de professionnalisation diplômants et que certains responsables politiques avaient incité les branches professionnelles à assouplir leurs pratiques restrictives.

s'est interrogé sur la fongibilité des financements et sur la mixité des publics de l'apprentissage et des contrats de professionnalisation.
a relativisé l'idée selon laquelle les publics de l'apprentissage et des contrats de professionnalisation étaient différents.
Il a estimé fondamental, en outre, de maintenir des formations diplômantes qui constituent à la fois un gage de qualité et une garantie d'adaptabilité pour les jeunes. Il a ajouté que ces formations représentaient 80 % des contrats en alternance et que leur raréfaction mettait en danger la survie d'un appareil de formation qui a fait la preuve de son fonctionnement dynamique. M. Xavier Baux a également souligné la nécessité de ne pas enfermer dans des « ghettos » les formations dites qualifiantes, destinées à des publics volatiles, en veillant à préserver dans leur environnement immédiat des formations diplômantes.
Il a constaté que, jusqu'à présent, la « fongibilité » avait surtout contribué à permettre de compléter le financement d'un certain nombre de centres de formation d'apprentis (CFA) en situation de fragilité.

Acquiescant à une observation de Mme Sylvie Desmarescaux sur le maintien d'une tradition de l'apprentissage dans le secteur artisanal, M. Xavier Baux a précisé que les organismes de formation des jeunes en contrat de qualification travaillaient essentiellement avec les petites et moyennes entreprises.

En réponse à une interrogation de Mme Annie David sur la possibilité pour un jeune n'ayant pas subi de rupture scolaire de poursuivre une formation par le biais d'un contrat de professionnalisation, M. Xavier Baux a précisé qu'en pratique les jeunes sous contrat de professionnalisation peuvent compléter leur formation initiale indépendamment de leur parcours et que la différence essentielle entre le contrat de qualification et d'apprentissage résidait dans son financement.

s'est interrogé sur les obstacles éventuels au « mixage » des publics de l'apprentissage et des contrats de professionnalisation ainsi que sur la pertinence d'une éventuelle unification des deux formes de contrat.
a observé que dans certaines filières, notamment artisanales, des différences subsistaient entre l'apprentissage et l'enseignement sous contrat de professionnalisation ; il a cependant indiqué que dans certaines formations tertiaires par exemple, aucune barrière pédagogique, ni aucune différence de public ne s'oppose à l'élaboration d'un statut commun.
a alors regretté que des formations ne soient pas financées par un certain nombre d'organismes collecteurs faute de correspondre à leurs orientations, et a estimé qu'il conviendrait de remédier aux inconvénients de cette logique de branches professionnelles. Il a cité un certain nombre d'exemples de chefs d'entreprises qui déplorent l'absence de possibilités de financement de contrats de qualification et évoqué l'amertume des jeunes confrontés à de telles situations. Il a rappelé que le Gouvernement avait souhaité qu'à partir du moment où un employeur est prêt à s'associer au projet de formation d'un jeune, il convenait de garantir qu'une possibilité de financement puisse soutenir cette initiative et qu'il avait été envisagé de faire financer de telles formations par un organisme collecteur interprofessionnel.
En réponse à une demande de précision de Mme Sylvie Desmarescaux, M. Xavier Baux a indiqué que les entreprises du secteur de l'informatique avaient, par exemple, de sérieuses difficultés pour recruter au moyen des contrats de professionnalisation des jeunes susceptibles de préparer des brevets de technicien supérieur en informatique de gestion. Il a également souligné qu'il était essentiel à la survie de la profession qu'il représentait de pouvoir constituer des formations rassemblant des effectifs suffisamment nombreux.

s'est demandé s'il ne conviendrait pas d'instituer un « verrouillage » de nature à écarter tout refus de financement du contrat de professionnalisation au cas où l'entreprise s'engage à accorder au stagiaire un contrat à durée indéterminée en activant, le cas échéant, le fonds unique de péréquation (FUP).
a considéré comme un principe de base qu'un projet de formation validé par un employeur devait être prolongé par la possibilité de financer un contrat en alternance. Puis il a insisté sur la politique restrictive de certains organismes collecteurs de branches professionnelles, qui se traduit par une diminution tendancielle du nombre de contrats en alternance conclus chaque année équivalente à 20 000. Il a également signalé que l'embauche d'un jeune sous contrat n'était plus financièrement aussi attractive, depuis la suppression de la prime destinée à la prise en charge du premier salaire du jeune.
a enfin présenté un certain nombre de remarques complémentaires, en précisant qu'elles résultaient de ses observations de terrain. Il a tout d'abord indiqué que la catégorie des jeunes dits « en grande difficulté » ou sans qualification auxquels devrait être « réservée » la voie de l'alternance, apparaissait comme assez largement théorique : d'une part, a-t-il précisé, très peu de jeunes n'ont aujourd'hui aucun diplôme ou aucune formation et, d'autre part, certains jeunes, titulaires du baccalauréat, hésitant sur leur avenir professionnel, peuvent également être considérés comme « en difficulté » et seraient susceptibles de bénéficier d'une formation en alternance.
a, en outre, attiré l'attention de la mission sénatoriale sur l'accroissement du nombre de jeunes de plus de vingt-six ans qui s'adressent aux organismes de formation en alternance, indiquant que l'insertion devrait en principe être aisée pour un certain nombre d'entre eux compte tenu de leur motivation et de leur parcours, ce qui incite à réfléchir sur une prolongation du contrat de professionnalisation pour les jeunes atteignant l'âge de vingt-sept ou vingt-huit ans.
Il a conclu en évoquant l'extrême complexité et le caractère chaotique de certaines conditions d'exercice de la profession de formateur : l'élaboration d'un contrat de professionnalisation nécessite, par exemple, de remplir une quinzaine de feuillets et toute imperfection formelle est sévèrement sanctionnée, notamment par certaines directions départementales de l'emploi. Il a souhaité, dans ces conditions, et dans l'intérêt de l'emploi des jeunes, un effort de normalisation et de simplification.
Audition de M. Jean-Claude Tricoche secrétaire national de l'union nationale des syndicats autonomes unsa chargé de la formation professionnelle
Audition de M. Jean-Claude Tricoche secrétaire national de l'union nationale des syndicats autonomes unsa chargé de la formation professionnelle
La mission d'information a enfin procédé à l'audition de M. Jean-Claude Tricoche, secrétaire national de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), chargé de la formation professionnelle.
a d'abord noté que l'UNSA, n'étant pas représentative au titre de l'arrêté du 31 mars 1966, n'était pas impliquée dans la gestion paritaire de la formation continue, bien que gestionnaire de quelques organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA). Ceci lui assure une indépendance toute particulière dans l'analyse et dans l'appréciation des mécanismes du système de formation professionnelle.
L'articulation des formations initiales et continues, non acquise en France, devrait donner un sens au concept de formation tout au long de la vie. En ce qui concerne la formation initiale, la question se pose de la productivité du système : trop de jeunes sortent du système sans qualification suffisante, ce qui ne favorise pas l'insertion professionnelle, la gestion des évolutions professionnelles et la sécurisation des parcours. Il ne faut pas se satisfaire de cette situation, mais agir afin de diversifier les modes d'accès à la connaissance et au savoir, en développant les formations en alternance, en améliorant la visibilité des formations, en améliorant l'orientation, en impliquant mieux le monde économique dans la formation initiale, en gérant la situation des jeunes non qualifiés. Or la réforme de 2004 n'a pas pris en compte cette problématique. Les partenaires sociaux avaient pourtant attiré l'attention du ministère du travail sur l'opportunité de redéployer une partie des moyens de la formation initiale vers les jeunes sortis prématurément du système. L'objectif était de créer un dispositif de « formation qualifiante différée » sous la forme d'un « droit de tirage » ouvrant la possibilité d'une éducation différée. Il s'agissait, dans le souci de la véritable égalité, de donner à ceux qui n'ont pas eu en cours de formation initiale le même rythme d'acquisition des connaissances que les autres une deuxième chance intervenant après une expérience de la réalité du travail.
a estimé qu'il fallait aussi s'attaquer à l'insertion des jeunes, qui est l'objet d'un grand nombre de politiques difficiles à démêler et à évaluer. Il faudrait que les jeunes et les acteurs aient le choix entre deux ou trois dispositifs facilement identifiables. L'UNSA avait proposé, à cette fin, de créer un unique contrat en alternance, appelé « contrat de formation et insertion en alternance », et unifiant le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Avec l'évolution du contrat d'apprentissage vers l'insertion et celle du contrat de professionnalisation vers la formation différée, ces deux dispositifs ont en effet tendance à se croiser, le choix entre eux dépendant de l'existence de mesures incitatives ou de la connaissance de l'un ou l'autre dispositif par les intéressés. Un dispositif unique, destiné à accompagner la première entrée dans l'emploi et visant la qualification des jeunes, pourrait donc utilement être mis en place.
De fait, la sécurisation des parcours professionnels passe par celle de la première entrée dans l'emploi. Les études générationnelles du Centre d'études et de recherches sur les qualifications (Cereq) montrent ainsi que plus de la moitié des jeunes intégrant sans qualification le marché du travail sont encore en difficulté sept ans après.
a poursuivi son exposé en regrettant que la formation continue reste de son côté assise sur le concept obsolète d'emploi à vie dans l'entreprise. Il faudrait reconstruire partiellement la formation professionnelle à partir de l'individu, le droit à la formation étant en partie attaché à la personne, et non plus à l'emploi dans une entreprise. A cet égard, la négociation qui a précédé l'accord national interprofessionnel de 2003, repris par la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, a abouti à un compromis insatisfaisant dans certains domaines. Tels est en particulier le cas du droit individuel à la formation (DIF), les partenaires sociaux n'ayant pas pu s'entendre véritablement sur l'application de ce dispositif. Le législateur aurait pu, en fonction de cette situation, prendre l'initiative d'assurer la transférabilité du DIF.
Le système de formation doit naturellement viser l'adaptation des salariés aux évolutions internes de l'entreprise qui les emploie, l'entreprise étant alors responsable de la mise en oeuvre des dispositifs correspondants, mais il doit aussi tenir compte de la réalité contemporaine du travail, la mobilité accrue de l'emploi en particulier, et donner aux salariés la possibilité de développer les compétences susceptibles d'assurer leur employabilité tout au long de leur vie professionnelle. Cette problématique ne peut guère être prise en compte par l'employeur du moment, à qui il n'appartient pas d'assurer « l'employabilité à vie ». Aussi bien faut-il que l'individu gère de façon autonome une partie de sa formation continue. Le DIF exprime cette idée, mais il reste attaché à l'entreprise, l'initiative du salarié étant encadrée en droit, et plus encore dans les faits, l'information des salariés n'étant pas suffisante pour susciter l'« appétence » des moins qualifiés pour la formation. A cet égard, l'échec de la réorientation de la formation vers les moins qualifiés montre que le système souffre d'un grave défaut de pilotage.
Il faut donc que le DIF dépende de l'initiative de l'individu. Il faut aussi assurer à l'individu l'accompagnement susceptible de lui offrir la visibilité nécessaire sur les compétences à posséder dans l'entreprise, sur le marché du travail, dans son espace territorial, afin de lui donner la possibilité de construire efficacement ses perspectives professionnelles. Dans cette optique, les partenaires sociaux devraient mettre en oeuvre des dispositifs d'information et d'orientation à l'intention des salariés et perdre moins de temps à gérer la collecte financière de la formation professionnelle.
a précisé que le droit individuel à la formation pourrait être alimenté par les entreprises selon le principe d'un « droit de tirage » compensant une formation initiale non achevée, par les pouvoirs publics en fonction des besoins de l'économie locale ou nationale, ou encore par les partenaires sociaux en fonction des politiques de branche.
L'employabilité, a-t-il encore indiqué, est aussi liée à l'anticipation, c'est-à-dire à la capacité des entreprises et de l'ensemble des acteurs de faire des projections à court ou moyen terme sur l'évolution de l'emploi et des qualifications. Cette démarche n'est mise en oeuvre que dans des situations d'urgence, comme l'illustre le fait que les dispositifs de gestion prévisionnelle des emplois accompagnent essentiellement le lancement des plans sociaux. Les observatoires de l'emploi mis en place par les partenaires sociaux représentent certes un effort louable, mais ils devraient dépasser l'approche macro-économique et diffuser des données concernant les secteurs et les métiers dans les territoires. Ceux-ci restent en effet au centre des problématiques de la recherche d'emploi. Il est vrai cependant, l'anticipation impliquant le recueil d'informations intéressant la stratégie des entreprises, qu'elle implique l'existence d'une certaine confiance entre les partenaires sociaux, qui n'est pas acquise dans notre pays.
a évoqué ensuite le rôle des OPCA, jugeant aventureux de proposer de retirer à ceux-ci la gestion des fonds de la formation. Pour autant, l'essentiel de l'effort des OPCA est consacré à la collecte et entraîne une manière de captation des financements par les professions. A titre d'exemple, il a indiqué que dans une OPCA interbranches il y avait autant de féodalités que de branches, chacune gérant au moyen du système des sections professionnelles sa part des sommes dédiées au plan de formation. Seuls les crédits du congé individuel de formation (CIF) sont totalement mutualisés par les Fonds de gestion des congés individuels de formation (FONGECIF) et échappent à l'emprise des secteurs professionnels. La solidarité interprofessionnelle est donc très limitée. Même le transfert d'un secteur à l'autre des surplus des fonds mutualisés est difficile, sauf en ce qui concerne les montants passant par le fonds unique de péréquation (FUP). Le problème est alors de savoir si le rôle des partenaires sociaux est de collecter ou de bien dépenser.

a demandé s'il fallait regrouper les OPCA de branche afin de leur donner une « masse critique » leur permettant de développer leurs services aux entreprises et aux salariés, et quels services pourraient être développés de la sorte.
a répondu que deux OPCA interprofessionnels étaient représentés au niveau territorial, l'association de la gestion de la formation des salariés (AGEFOS) et les organismes paritaires collecteurs agréés régionaux (OPCAREG), cette situation étant explicable par l'incapacité des employeurs à s'entendre et par l'existence subséquente de deux financements du paritarisme. Il faudrait laisser subsister un seul OPCA interprofessionnel au niveau régional. Il faudrait par ailleurs que l'essentiel des fonds prélevés sur les entreprises soit connu et disponible au niveau régional. Il serait aussi normal que les FONGECIF collectent les fonds dédiés au DIF et à la professionnalisation, car la mise en oeuvre de ces dispositifs répond à une logique régionale. Les OPCA nationaux de branche pourraient continuer un certain temps à collecter certains fonds, avec un resserrement des dispositifs.
En ce qui concerne la réorientation du rôle des OPCA, il faut que ceux-ci mettent en oeuvre un service aux salariés, et même aux demandeurs d'emploi. Toutes les informations disponibles sur les évolutions, la visibilité, l'accompagnement, l'orientation, devraient être mobilisées à cette fin par les OPCA. Les prestataires de services en conseils ingénierie présents sur le marché pourraient être commandités par les OPCA.
Il appartient au législateur de prendre ses responsabilités dans ces deux domaines, pour l'intérêt de tous.

a demandé confirmation de ce que, dans le schéma exposé par l'intervenant, le FONGECIF serait l'unique collecteur des fonds dédiés à la formation continue et qu'une seule OPCA interprofessionnelle régionale subsisterait, dotée d'une mission de prestataire d'actions d'accompagnement à l'intention des salariés et d'une mission d'anticipation de l'évolution de l'emploi et des compétences. Elle a demandé comment cette dernière mission, largement dépendante des réactions des entreprises aux évolutions du marché, pourrait être mise en oeuvre.

a noté l'impossibilité pour une OPCA d'anticiper l'évolution des entreprises individuelles et a souhaité savoir comment il serait possible d'assurer la transférabilité du DIF.
a indiqué que les modalités de la gestion prévisionnelle des emplois dépendaient de la taille et du secteur de l'entreprise. Une grande entreprise peut redéployer ses effectifs de façon interne. Dans les petites entreprises, c'est à la branche qu'il appartient de mettre en oeuvre, autant que possible au niveau territorial, les outils permettant de gérer au mieux les entrées, d'anticiper sur les sorties et les recrutements nécessaires. Il faut aussi renforcer l'employabilité des salariés, en repérant et en développant les compétences susceptibles de favoriser leur retour sur le marché du travail. Cette tâche n'est pas assurée aujourd'hui.
Le DIF n'est pas transférable actuellement, car il est rattaché à l'employeur qui le finance. De fait, sauf dans quelques cas prévus par des accords de branche, le DIF doit être consommé lorsque le salarié quitte son entreprise. Par ailleurs, certaines entreprises n'autorisent le DIF que dans le cadre des formations prévues dans leur plan de formation : ainsi toute initiative du salarié disparaît-elle. Si l'on mutualisait la collecte du DIF dans une caisse comme le FONGECIF, la transférabilité, qui ne doit pas être limitée à la branche, ne poserait plus de problème.

a demandé à l'intervenant quel était son sentiment sur la négociation de branche en matière de formation professionnelle.
a indiqué que la négociation de branche était en France la principale forme de négociation sociale. Les négociations de branche portent très peu sur le DIF. En ce qui concerne la professionnalisation, les accords de branche fixent seulement quelques stipulations dérogatoires concernant les durées de contrat et les durées de formation, qui permettent aux entreprises de rapprocher le contrat de professionnalisation de l'ancien contrat de qualification, les OPCA fixant les financements. L'UNSA ne récuse pas ce niveau de négociation, mais les salariés sont de plus en plus mobiles et les parcours professionnels de plus en plus complexes. De fait, on ne peut fixer au niveau de la branche certains points intéressant la stratégie des entreprises, et notamment des groupes. Il est donc anormal que la négociation d'entreprise soit aussi faible en France, spécialement en ce qui concerne le développement de la qualification.