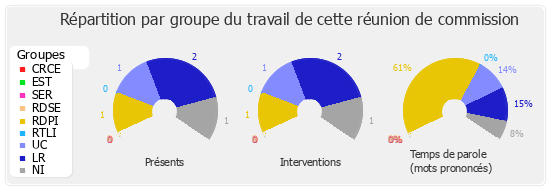Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation
Réunion du 4 octobre 2006 : 2ème réunion
Sommaire
La réunion

Au cours d'une deuxième séance tenue dans l'après-midi, la commission a procédé à l'examen du rapport pour avis de M. Philippe Marini, rapporteur général, sur le projet de loi n° 3 (2005-2006), adopté par l'Assemblée nationale, relatif au secteur de l'énergie.

a rappelé que la commission s'était saisie pour avis du projet de loi relatif au secteur de l'énergie et avait désigné M. Philippe Marini, rapporteur général, en tant que rapporteur. Il a alors invité celui-ci à présenter son rapport.

a tout d'abord souligné que la commission avait pour l'essentiel limité le champ de sa saisine à l'article 10 autorisant la privatisation de la société Gaz de France et définissant les modalités du contrôle public sur cette entreprise et ses filiales. Il a déclaré avoir eu une approche patrimoniale de ce sujet, en se plaçant du point de vue de l'Etat actionnaire.
Il a indiqué qu'il lui avait paru nécessaire, malgré tout, de compléter le présent projet de loi par des dispositions concernant la Commission de régulation de l'énergie (CRE), rappelant qu'il s'inscrivait en cela dans la continuité des travaux de la commission. En effet, lors de l'examen des projets de lois de finances rectificatives pour 2004 et pour 2005, il avait déjà présenté des amendements similaires que la commission, puis le Sénat, avaient adoptés, la commission mixte paritaire les ayant, par la suite, rejetés. En outre, il a expliqué qu'il proposerait l'adoption d'un amendement, rédigé en étroite concertation avec M. Ladislas Poniatowski, rapporteur au fond du projet de loi au nom de la commission des affaires économiques, afin de revenir sur les dispositions votées par l'Assemblée nationale quant à la composition de la CRE, et figurant à l'article 2 bis.
Procédant à l'aide d'une vidéo-projection, M. Philippe Marini, rapporteur pour avis, a ensuite évoqué la situation de Gaz de France.
En premier lieu, il a rappelé que la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières avait autorisé l'Etat à ouvrir le capital d'EDF et de Gaz de France. Il a également rappelé qu'en application de ces dispositions, Gaz de France avait été introduit en Bourse le 7 juillet 2005 au moyen, d'une part, de la cession d'actions alors existantes pour un montant de 2,5 milliards d'euros, d'autre part, de l'émission de nouvelles actions, pour un montant de 1,9 milliard d'euros. Il a relevé qu'entre son introduction et la fin du mois de septembre 2006, le cours de l'action de l'entreprise avait progressé de 34 %, augmentant la valorisation de la participation de l'Etat de 270 millions d'euros. Il a ajouté que Gaz de France avait, par ailleurs, versé à l'Etat un dividende de 536 millions d'euros au titre de l'exercice 2005, en progression de près de 50 % par rapport à l'exercice précédent.
a estimé que Gaz de France était une entreprise saine. A cet égard, il a tout d'abord insisté sur sa puissance commerciale, qui lui a permis de conserver une part de marché proche de 80 % sur les marchés ouverts à la concurrence, tout en poursuivant son développement hors du territoire national, 36 % de son chiffre d'affaires de l'exercice 2005 ayant ainsi été réalisé à l'étranger. Il a également souligné la rentabilité du groupe qui, en 2005, a réalisé un bénéfice net de 1,7 milliard d'euros, en hausse de près de 30 % par rapport à 2004, pour un chiffre d'affaires de 22,4 milliards d'euros. Il a enfin mis en exergue le faible endettement de Gaz de France.
Puis il a expliqué que, malgré ces bons fondamentaux, Gaz de France devait grandir, deux arguments justifiant selon lui la recherche d'une taille critique dans le contexte actuel :
- la nécessité de « peser » au cours des négociations commerciales avec les fournisseurs de gaz. A ce propos, il a rappelé que l'Europe dépendait de la Russie et de l'Algérie pour plus d'un tiers de ses approvisionnements gaziers, ce chiffre étant de l'ordre de 40 % pour Gaz de France, ce qui pouvait poser des problèmes géostratégiques, particulièrement après l'accord du 4 août 2006 entre les sociétés russe Gazprom et algérienne Sonatrach ;
- les fusions en cours entre distributeurs de gaz européens, de nature à créer des groupes de grande taille pouvant proposer des offres multi-énergies à leurs clients.
Il a estimé qu'au vu de ces évolutions en cours, Gaz de France ne pourrait se permettre de demeurer un acteur isolé de taille moyenne, et que tel n'était pas l'intérêt de l'Etat actionnaire.
Puis M. Philippe Marini, rapporteur pour avis, s'est interrogé quant aux alliances possibles pour Gaz de France.
Il a tout d'abord rejeté l'hypothèse d'une fusion entre cette entreprise et EDF, s'appuyant principalement sur les conclusions d'une étude juridique réalisée, en 2004, par le cabinet Bredin-Prat, à la demande de l'Agence des participations de l'Etat. Il a indiqué qu'après avoir montré qu'une telle fusion renforcerait la position dominante d'EDF et de Gaz de France sur leur marché historique, ladite étude concluait que la Commission européenne ne déclarerait ce rapprochement compatible avec le marché commun qu'au prix de très lourdes contreparties. Il a, en particulier, cité la cession d'au moins 10 à 15 % du parc nucléaire d'EDF et de 15 à 20 % des capacités de stockage de gaz de Gaz de France. De plus, il a émis de fortes réserves quant à l'opportunité de créer un tel « empire énergétique », estimant que son contrôle par l'Etat serait de facto à peu près impossible.
A l'inverse, il a jugé que le profil de Suez s'accordait mieux à celui de Gaz de France, indiquant, en premier lieu, qu'une fusion de ces deux groupes permettrait à Gaz de France de diversifier et de sécuriser ses approvisionnements en gaz, notamment en réduisant de façon significative la part de la Russie et de l'Algérie dans le portefeuille des fournisseurs. En outre, il a relevé la grande complémentarité des actifs gaziers et électriques de l'éventuel groupe fusionné. Estimant que cet atout donnerait audit groupe une forte crédibilité en matière d'offre multi-énergies, il s'est félicité que puisse ainsi apparaître un premier « concurrent sérieux d'EDF » sur le marché français. Enfin, s'appuyant sur les estimations de plusieurs analystes financiers, il a conclu qu'une fusion de Gaz de France et de Suez serait de nature à augmenter sensiblement la valeur des actions de l'entreprise, ce dont bénéficierait l'Etat actionnaire.
a ensuite décrit les modalités du contrôle public de Gaz de France prévues par le projet de loi.
A ce sujet, il a tout d'abord indiqué que, possédant plus d'un tiers du capital de l'entreprise, l'Etat disposerait de la minorité de blocage et pourrait donc s'opposer aux décisions relevant de l'assemblée générale extraordinaire, telles que les changements de statuts, d'objet social, de capital social ou de siège social. De plus, il a relevé que le « groupe de contrôle » de l'entreprise inclurait d'autres actionnaires stables, atteignant une proportion supérieure à 40 % de son capital. Il a estimé que ce facteur était de nature à dissuader une éventuelle offre publique d'achat non sollicitée.
Il a ajouté que l'article 10 du projet prévoyait la transformation d'une action de Gaz de France détenue par l'Etat en action spécifique, qui permettrait à la puissance publique de s'opposer à la cession de certains actifs au nom de l'intérêt national. Il a déclaré que la jurisprudence européenne montrait que la création d'une telle action spécifique était compatible avec le marché commun, précisant que le décret prévu par le projet de loi devrait indiquer quels actifs seraient concernés.
a relevé, de plus, que selon les termes du projet de loi, un commissaire du gouvernement participerait, avec voix consultative, à l'ensemble des réunions des organes de gouvernance de Gaz de France.
Après avoir remarqué que la privatisation de Gaz de France ne remettrait en cause ni le service public du gaz, ni le statut du personnel, fondés sur d'autres dispositions législatives, il a conclu que le dispositif prévu par l'article 10 du projet de loi offrait toutes les garanties pour que cette privatisation, qu'il a qualifiée de « condition indispensable du développement de l'entreprise », se déroule sans léser les intérêts des acteurs concernés, ni celui de l'Etat. En conséquence, il a recommandé à la commission d'adopter cet article sans modification.
a ensuite évoqué la situation des distributeurs non nationalisés.
Il a estimé qu'il serait paradoxal que le projet de loi proposant de privatiser Gaz de France maintienne en l'état l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dont les dispositions régissent les sociétés d'économie mixte de distribution de gaz détenues par des collectivités territoriales, ledit article ayant précisément été conçu comme une exception au principe de nationalisation prévu par ailleurs par ladite loi.
Il a, en outre, exprimé sa crainte que ces distributeurs, de taille modeste et qui ne peuvent se développer en dehors du territoire des collectivités présentes dans leur capital, connaissent des difficultés après l'entrée en vigueur de la libéralisation totale du marché du gaz.
Il a donc proposé à la commission d'adopter à l'article 6 un amendement autorisant les collectivités territoriales concernées à transformer ces sociétés d'économie mixte en sociétés anonymes de droit commun, ainsi qu'à privatiser lesdites sociétés, une fois transformées en sociétés anonymes de droit commun.
Enfin, M. Philippe Marini, rapporteur pour avis, a évoqué la question de la CRE.
Il a estimé qu'au vu de l'importance des décisions qu'il revenait à la CRE de prendre, il était nécessaire qu'aucun doute ne puisse subsister quant à son indépendance, et qu'elle ne devait, en particulier, être liée ni au gouvernement ni aux entreprises du secteur. Il a expliqué que, pour cette raison, il regrettait les modifications apportées par l'Assemblée nationale à la composition de la CRE, en particulier la présence de parlementaires, ès-qualités, au sein du collège. Il a souhaité que la commission revienne sur ces dispositions, en adoptant pour cela, à l'article 2 bis, un amendement, élaboré en étroite liaison avec M. Ladislas Poniatowski, rapporteur du projet de loi au nom de la commission des affaires économiques. Il a indiqué que ledit amendement rétablissait, dans les grandes lignes, l'actuelle composition de la CRE, ajoutant que ce texte définissait également les objectifs de la CRE, dont le concours au bon fonctionnement des marchés devrait, prioritairement, s'exercer au bénéfice des consommateurs finals. Il a également déclaré que cet amendement prévoyait l'instauration d'un comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions au sein de la CRE, distinct du collège des commissaires, en conformité avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Pour conclure, M. Philippe Marini, rapporteur pour avis, a proposé à la commission d'adopter, comme elle l'avait déjà fait lors de l'examen des projets de lois de finances rectificatives pour 2004 et pour 2005, deux amendements portant articles additionnels avant l'article 2 bis et qui concernent la CRE. Il a précisé que le premier de ces amendements visait à doter la CRE de la personnalité morale et à poser le principe de son autonomie financière, et que le second tendait à établir les modalités du financement de la CRE, en créant une contribution spécifique acquittée par les consommateurs de gaz et d'électricité.

a remercié M. Philippe Marini, rapporteur pour avis, pour la clarté de son exposé, et rappelé que la réalisation de la fusion entre Gaz de France et Suez dépendrait, en dernier ressort, de la décision des actionnaires des deux groupes.
Un large débat s'est alors instauré.

après avoir exprimé son souhait que l'examen du texte en séance publique fournisse l'occasion d'engager un débat de fond, et non une bataille de procédure, assurant que son groupe politique y veillerait, a regretté que « les Français ne puissent pas être juges » de la question de la privatisation de Gaz de France, le dépôt de ce projet de loi précédant de peu les élections nationales prévues en 2007.
Elle a ensuite estimé que la fusion avec Suez ne constituait pas le seul scénario possible pour l'avenir de Gaz de France, évoquant, en particulier, une fusion avec EDF, dont elle a contesté l'impossibilité, ou des participations croisées entre Gaz de France et Suez.
Puis Mme Nicole Bricq a déploré que la fusion de Gaz de France et de Suez soit envisagée pour de « mauvaises raisons », c'est-à-dire du fait du projet évoqué par d'aucuns d'acquisition de Suez par le groupe italien Enel.
En outre, elle a jugé que la fusion envisagée ne renforcerait pas la sécurité des approvisionnements de gaz de Gaz de France, estimant que celle-ci devait reposer avant tout sur l'amélioration de l'accès direct de l'entreprise aux réserves de gaz par le développement de ses activités d'exploration et de production, stratégie que Gaz de France était à même de mener seul.
a ajouté que la structure capitalistique du nouvel ensemble le rendrait vulnérable à une offre publique d'achat non sollicitée, notamment d'entreprises originaires de grands pays de production d'hydrocarbures, citant, pour appuyer son propos, l'intervention de M. Hervé Novelli, rapporteur pour avis du projet de loi au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Elle a également dénoncé « l'inanité » de l'action spécifique de Gaz de France que l'Etat devrait détenir, estimant, de plus, que le commissaire du gouvernement n'aurait aucun pouvoir réel.
Par ailleurs, elle s'est interrogée sur les conditions financières de la fusion de Gaz de France et de Suez. Remarquant que les actionnaires de Suez ne semblaient pas satisfaits de la parité envisagée entre les actions des deux entreprises, elle a jugé probable que soit l'Etat, soit en définitive Gaz de France, ait à leur acquitter une compensation financière au moment de l'opération. Elle a estimé que cela obérerait la capacité future d'endettement de Gaz de France, indiquant qu'en tout état de cause, la capacité d'endettement du groupe fusionné serait moindre que celle de la seule entreprise Gaz de France.
D'autre part, Mme Nicole Bricq s'est inquiétée du fait que les problèmes de gouvernance de la nouvelle structure ne soient pas réglés, jugeant, en outre, qu'au vu de la différence de métiers et de cultures entre les deux groupes, leur fusion risquait de se traduire par un échec. Elle a qualifié cette prise de risque « d'inconséquence grave » au moment où, a-t-elle expliqué, la plupart des Etats essayaient de reprendre le contrôle de leur approvisionnement en énergie.
Elle a enfin estimé que le Parlement devait se prononcer trop tôt sur la privatisation de Gaz de France, la Commission européenne n'ayant pas encore fait connaître les compensations qu'elle exigerait afin de déclarer la fusion de Gaz de France et de Suez conforme aux règles du droit communautaire.
En conclusion, Mme Nicole Bricq a indiqué que son groupe refuserait, dans le même esprit, la privatisation des distributeurs non nationalisés.

s'est interrogé sur l'opportunité de la saisine pour avis de la commission des finances sur le projet de loi relatif au secteur de l'énergie, ainsi que sur le degré de conviction du rapporteur pour avis au sujet de la privatisation de Gaz de France, indiquant que, pour sa part, il n'était pas convaincu que tel était l'intérêt de cet opérateur gazier. Il a conclu son propos en faisant part de son hésitation entre un vote favorable au projet de loi en séance publique et une abstention.

a fait part de son opposition à la privatisation de Gaz de France, soulignant qu'il doutait, lui aussi, de la fermeté des convictions d'un certain nombre de membres de la majorité sénatoriale. Rejoignant Mme Nicole Bricq, il a regretté que ce dossier soit traité peu avant d'importantes échéances électorales.
Il a déploré, de plus, que le projet de loi « casse le bel outil qu'est Gaz de France afin de secourir Suez », estimant, pour sa part, que la fusion de cette entreprise avec Enel aurait abouti à la constitution d'un grand groupe européen. Citant M. Hervé Novelli, rapporteur pour avis du projet de loi au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale, il a, en outre, estimé que la minorité de blocage que conserverait l'Etat au sein du capital de Gaz de France n'aurait pas d'utilité particulière. Il a également exprimé ses doutes quant au dispositif d'action spécifique envisagé par le projet de loi, relevant que la Commission européenne avait, la semaine précédente, déclaré illégales les actions spécifiques détenues par l'Etat néerlandais dans l'opérateur de télécommunications KPN et dans la société de messagerie TNT.
Enfin, M. Michel Sergent a exprimé l'inquiétude des collectivités territoriales propriétaires de leur réseau de distribution, déclarant qu'elles n'avaient pas de visibilité quant à leur avenir, du fait du projet de privatisation de Gaz de France.

a exprimé sa vive opposition à ce projet, estimant qu'il aurait mieux valu attendre les élections prévues en 2007 avant d'engager un tel débat. Elle a douté que la situation des marchés de l'énergie ait tant changé depuis la discussion du projet de loi relatif au service public de l'électricité et du gaz et des entreprises électriques et gazières, en 2004, pour qu'il soit nécessaire de revenir sur l'engagement pris alors par le gouvernement de maintenir une participation supérieure à 70 % au capital d'EDF et de Gaz de France.
Elle a jugé, par ailleurs, que l'importance de l'électricité et du gaz en faisait des produits à part, tant pour les ménages que pour les entreprises, relayant également l'inquiétude de ces dernières quant à l'évolution des prix de l'énergie.
Elle a exprimé sa préférence pour une fusion de Gaz de France avec EDF, regrettant que le refus de la « domination du marché par une entreprise publique » aboutisse à la « domination d'une entreprise privée », construite pour concurrencer EDF.
D'autre part, Mme Marie-France Beaufils a relevé que Suez intervenait également dans le domaine du traitement de l'eau et des déchets, s'inquiétant qu'à l'avenir, certaines collectivités territoriales soient contraintes de ne traiter qu'avec ce seul groupe pour l'ensemble de leurs délégations de services publics.
Elle s'est enfin interrogée sur les contreparties demandées par la Commission européenne afin de pouvoir déclarer l'éventuelle fusion de Gaz de France et de Suez conforme au marché commun.

En réponse aux différents orateurs, M. Philippe Marini, rapporteur pour avis, a tout d'abord indiqué que le débat ainsi ouvert en commission avait naturellement vocation à se poursuivre en séance publique. Il a déclaré, en outre, qu'il avait apprécié le caractère argumenté et constructif de chaque intervention des commissaires.
Puis il a tenu à affirmer son adhésion à la privatisation de Gaz de France, rappelant que, lors de la discussion du projet de loi relatif au service public de l'électricité et du gaz et des entreprises électriques et gazières, en 2004, il avait déposé, en tant que rapporteur pour avis de la commission des finances, un amendement tendant à ramener le plancher de la participation de l'Etat dans le capital de Gaz de France de 70 % à 50 %, précisément afin que cette entreprise puisse conclure des alliances avec d'autres partenaires industriels. Après avoir indiqué que sa position n'avait pas varié depuis lors, il a déclaré, de manière plus générale, assumer ses convictions en faveur de la privatisation des entreprises détenues par l'Etat.
A propos de l'éventuelle compensation financière à attribuer aux actionnaires de Suez, il a estimé que la parité proposée publiquement étant raisonnable à son sens, elle ne saurait donc varier qu'à la marge au moment de la réalisation de l'opération.
Enfin, évoquant le projet d'acquisition de Suez par Enel, il a souligné qu'au vu de l'importance des missions, notamment en termes de délégations de services publics, de ce groupe français, sa prise de contrôle par une société étrangère aurait été lourde de conséquences, en particulier pour les collectivités territoriales et les usagers. En guise de conclusion, il a indiqué sa préférence pour un schéma où les entreprises françaises travaillant dans ce type de secteurs regrouperaient leurs forces avant d'envisager des rapprochements au niveau européen.
La commission a ensuite procédé à l'examen des amendements présentés par M. Philippe Marini, rapporteur pour avis.
La commission a tout d'abord adopté un premier amendement portant article additionnel avant l'article 2 bis, tendant à doter la CRE de la personnalité morale et à poser le principe de son autonomie financière.

Puis, après une intervention de M. Philippe Adnot, qui a exprimé son opposition de principe à la création de toute nouvelle imposition, elle a adopté un second amendement portant article additionnel avant l'article 2 bis, tendant à définir les modalités de financement de la CRE, au moyen de la création d'une contribution spécifique, au sujet de laquelle M. Philippe Marini, rapporteur pour avis, a précisé qu'elle s'élèverait, en moyenne, à moins de 20 centimes d'euros par an et par foyer.
La commission a ensuite adopté, après une demande de précision de Mme Nicole Bricq, un amendement à l'article 2 bis, tendant à mieux définir les missions de la CRE, à modifier sa composition et à créer, en son sein, un comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions.
La commission a enfin adopté un amendement à l'article 6, visant à autoriser le changement de statut et la privatisation des sociétés d'économie mixte de distribution de gaz.
La commission a ensuite émis un avis favorable à l'ensemble du projet ainsi amendé.
Enfin, la commission a procédé à la suite de l'audition de M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, qui s'était initialement déroulée le mercredi 27 septembre.

Après avoir excusé M. Thierry Breton, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, retenu par son audition devant la commission des affaires économiques, M. Jean Arthuis, président, a remercié M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, de revenir devant la commission, une semaine après la présentation du projet de loi de finances pour 2007, afin d'apporter à ses membres toutes les précisions nécessaires à l'appréciation de ce budget qui présentait « les apparences de la vertu budgétaire ».

après avoir rappelé l'importance fondamentale des audits de modernisation lancés par le ministre du budget et qui portaient sur plus de 100 milliards d'euros de dépenses publiques, s'est interrogé sur les modalités d'action des parlementaires dans le cadre rénové offert par la LOLF, et notamment sur les moyens de donner, au moment de la discussion budgétaire, une traduction concrète aux propositions formulées par les rapporteurs spéciaux lors des missions de contrôle menées durant l'année en application de l'article 57 de la LOLF. Par ailleurs, il a fait état de sa préoccupation concernant le FFIPSA (fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles) qui accusait de lourds déficits qui n'étaient toujours pas comblés par le budget de l'Etat, nonobstant le versement en décembre 2005 de 2,5 milliards d'euros.

a évoqué la question de l'apport de l'Etat au budget de l'ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine), rappelant que le contrôle qu'il avait effectué avec son collègue rapporteur spécial M. Roger Karoutchi en 2006, et qui avait donné lieu à la parution d'un rapport d'information, montrait que des besoins de financement de l'ordre d'un milliard d'euros par an pourraient s'avérer nécessaires en 2008 et 2009. Il s'est interrogé sur la possibilité pour l'Etat d'augmenter sa contribution de manière significative, notant qu'elle s'élevait à 600 millions d'euros dans le projet de budget pour 2007.

s'est interrogé sur le déroulement des négociations budgétaires avec le ministère de la défense, et notamment sur le financement des opérations extérieures (OPEX), ainsi que sur le maintien en condition opérationnelle des matériels.

a évoqué la question de la réforme du FAI (fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours), rappelant que la part de l'Etat, qui s'élevait à 67 millions d'euros (à comparer au coût de 3,5 milliards d'euros pour les collectivités territoriales des services d'incendie et de secours), ne devrait donc pas être abaissée.

a évoqué l'utilisation des soultes dans le budget, estimant que ces opérations présentaient un double intérêt : budgétaire, d'une part, en améliorant le solde, de clarté, d'autre part, en rendant plus transparent le financement des retraites des entreprises publiques. Il a souhaité connaître l'état d'avancement des négociations avec la Poste et la Banque de France, rappelant qu'un arbitrage devrait être opéré, dans ce dernier cas, entre l'augmentation des dividendes versés par la Banque à l'Etat et le versement d'une soulte.

a pour sa part jugé que le traitement « maastrichien » des soultes, qui conduisait à les déduire du déficit public l'année de leur constatation, même si le versement en était différé, était inadapté. Il s'est, par ailleurs, étonné qu'une fraction des droits de mutation à titre onéreux soit, dans le projet de loi de finances pour 2007, affectée au bénéfice des monuments historiques, exprimant des doutes sur sa compatibilité, si ce n'est avec le texte, du moins avec l'esprit, de la LOLF.
En réponse à M. Jean-Jacques Jégou, M. Jean-François Copé, a estimé que le Parlement disposait avec la LOLF d'un outil de contrôle et d'évaluation qu'il lui fallait dorénavant s'approprier. Cet outil de contrôle passe par l'analyse des indicateurs fournis au sein des documents budgétaires par les projets et rapports annuels de performances (PAPs et RAPs), le respect des objectifs soumis devant la représentation nationale devant désormais devenir le critère d'évaluation de l'efficacité d'un ministre, ce qui constitue une rupture avec l'époque où son action était uniquement jugée au vu de la hausse de ses crédits. Par ailleurs, il a fait état de l'attention qu'il portait aux suites à donner aux audits de modernisation, estimant que les parlementaires se devaient de demander des comptes aux différents ministres quant à leur application des recommandations formulées dans ces rapports.

a approuvé ces propos, observant que la commission se devait, à l'issue des contrôles budgétaires qu'elle réalisait, de formuler des propositions de réformes plus précises et directement opérationnelles. Cette nécessité, qui était apparue lors des débats organisés à l'occasion de l'examen du projet de loi de règlement pour 2005, devait donc guider la commission dans ses travaux à venir.
En ce qui concerne le FFIPSA, M. Jean-François Copé, a rappelé qu'il avait été nécessaire d'abonder le fonds de 2,5 milliards d'euros l'année précédente et qu'un tel effort, eu égard à son ampleur, ne pouvait pas se prolonger indéfiniment. Il a jugé nécessaire d'engager le débat le plus large possible entre l'Etat, la sécurité sociale et les agriculteurs cotisants, estimant, si la solidarité nationale était nécessaire, qu'il était urgent de réfléchir aux moyens de trouver un équilibre dans la durée.
En réponse à M. Philippe Dallier, il a déclaré que les moyens de l'ANRU seraient réajustés à partir de 2008, soulignant l'importance de cette politique pour les quartiers sensibles.
En réponse à M. François Trucy, il a précisé que tous les ministres avaient montré leur volonté de réforme et de sincérité budgétaires. Cet effort, en ce qui concerne plus spécifiquement le budget de la défense, s'est traduit par un meilleur chiffrage des opérations extérieures.
En réponse à M. Eric Doligé, il a précisé que la réforme du FAI serait menée par le ministère de l'intérieur, et qu'il était donc de sa compétence d'apporter toutes les précisions.
a approuvé les propos de Philippe Marini, sur les soultes, souscrivant à l'idée qu'elles devaient être associées à des réformes de structure. En ce qui concerne plus spécifiquement la Poste, il a fait état de son souhait de progresser dans les négociations avec la CNAV (caisse nationale d'assurance vieillesse). Il a par ailleurs indiqué que les retraites de la Banque de France seraient financées sans amputer les dividendes et que l'on devrait arriver prochainement à l'adossement du régime.
En réponse aux interrogations de M. Jean Arthuis, président, relatives à la compatibilité au regard de « l'esprit de la LOLF » de la disposition consistant à affecter une recette aux bénéfices des monuments historiques, il a considéré que l'affectation d'une fraction des droits de mutation à titre onéreux à un établissement public, en l'occurrence le centre des monuments nationaux, lui paraissait opportune, tout en n'étant pas contraire à la LOLF. Elle présentait également des garanties d'efficacité et de pérennisation des ressources.

a abordé la question des plus-values de recettes en 2006. Il a rappelé que la loi de finances pour 2006, en application des dispositions en ce sens de la LOLF, en prévoyait l'affectation, en priorité, au désendettement de l'Etat. Il s'est interrogé sur la possibilité d'utiliser également cette somme pour le remboursement de la dette de la sécurité sociale, jugeant qu'une telle utilisation serait susceptible de mettre fin à une vision parcellaire des comptes publics.
a indiqué que cette question était tout à fait légitime mais qu'en l'état, elle présentait trois inconvénients : des difficultés juridiques de mise en oeuvre, un manque de clarté au regard des règles de gouvernance, la nécessité d'en faire un axe politique majeur, ce qui nécessitait un débat.

s'est intéressé aux conditions de mise en place du bilan d'ouverture au 1er janvier 2006, prélude à la certification des comptes de l'Etat par la Cour des comptes, en application de l'article 58-5° de la LOLF.
a indiqué qu'un travail très important était en cours dans l'ensemble de l'Etat, en relation avec la Cour des comptes. Il a indiqué qu'un projet de bilan d'ouverture pourrait être présenté à la commission des finances début novembre 2006. Il s'est dit soucieux de l'esprit dans lequel les travaux étaient conduits, et notamment du respect de la différence des fonctions de certification et de jugement.

s'est interrogé sur l'opportunité d'un changement de statut de la Cour des comptes, observant qu'il était difficile d'être à la fois certificateur et magistrat.
a confirmé que la difficulté existait, et a noté que d'autres Etats avaient trouvé des solutions, y compris en ayant recours, pour la certification, au secteur privé. Il a indiqué qu'il appartenait en tout état de cause au Parlement d'être très attentif aux conditions dans lesquelles se dérouleraient les opérations de certification et d'établissement du bilan d'ouverture.