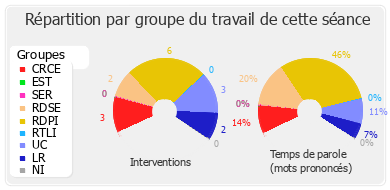Séance en hémicycle du 5 février 2008 à 10h10
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Mise au point au sujet d'un vote (voir le dossier)
- Communication relative à une commission mixte paritaire
- Questions orales (voir le dossier)
- Réalisation et financement des travaux de mise à deux fois deux voies de la rn 124 entre auch et toulouse (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à dix heures dix.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

Monsieur le président, lors du scrutin public, intervenu le 31 janvier dernier, sur le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, mon collègue Daniel Dubois figure, dans le décompte des voix, comme n'ayant pas pris part au vote, alors qu'il souhaitait voter pour.

J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

La parole est à M. Georges Mouly, auteur de la question n° 142, adressée à M. le secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme.

Monsieur le secrétaire d'État, j'avais eu l'occasion d'appeler l'attention de votre collègue Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, sur les préoccupations relatives à la libéralisation du secteur postal et aux modalités de financement du service universel assuré par La Poste.
Par courrier du 28 septembre 2007, Mme la ministre m'avait indiqué son attachement à la garantie d'un service universel de qualité sur l'ensemble du territoire et m'avait assuré que le Gouvernement veillerait à la recherche de solutions efficaces pour le financement des obligations de service universel, afin que soit garantie l'égalité de traitement de tous les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence sur le territoire.
Il s'agit bien d'un enjeu de cohésion sociale et territoriale pour notre pays ainsi que pour les élus locaux, notamment en milieu rural.
Pour ce qui concerne la présence territoriale de La Poste, les modalités de fonctionnement du Fonds postal national de péréquation territoriale, institué par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, sont enfin connues grâce à la signature de la première convention triennale de présence postale.
Cependant, alors que La Poste a estimé que le coût d'une présence postale intégrant une dimension d'aménagement du territoire s'élève à 360 millions d'euros par an, ce sont seulement 140 millions d'euros qui sont annoncés.
Or les élus locaux des zones rurales sont déjà inquiets des multiples réorganisations des activités postales, souvent engagées sans une information préalable suffisante, malgré l'existence des commissions départementales de présence postale territoriale, malgré la charte des services publics et diverses conventions de partenariat. Si, de surcroît, l'opérateur doit puiser dans sa trésorerie pour assumer ses obligations en termes d'aménagement du territoire, convenez-en, monsieur le secrétaire d'État, l'inquiétude ne pourra que grandir.
Tout en étant bien conscients de la nécessité de procéder à une réorganisation, ces mêmes maires déplorent souvent que les réaménagements opérés, au motif que n'est concerné que le fonctionnement interne, se réalisent sans concertation préalable, ni information claire, du moins suffisante, et se fassent même parfois au détriment de la qualité du service rendu en termes de compétences.
Dans mon département, par exemple, j'entretiens personnellement d'excellentes relations de travail avec la direction départementale, qui s'efforce, je dois le reconnaître, d'avoir une écoute attentive. Mais je constate des insatisfactions.
Souvent mis devant le fait accompli, avec, ici, une fermeture temporaire par manque de personnels, là, une réorganisation de l'effectif, qui laisse craindre une fermeture ou un service réduit de moindre qualité, nous pouvons nous interroger sur la juste place réservée aux décideurs locaux, alors même que les finances locales sont parfois mises à contribution pour assurer le maintien de la présence territoriale.
À ces interrogations sur le financement de la présence territoriale de La Poste s'ajoutent d'ailleurs les inquiétudes sur le maintien du réseau des trésoreries, alors que, dans mon département, un arrêté du 26 décembre 2007 portant réorganisation de postes comptables des services déconcentrés du Trésor supprime quatre trésoreries. J'entends pourtant encore les assurances données par le Gouvernement à l'occasion du projet de fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique. Signal fort de la modernisation de l'État, cette fusion doit notamment assurer un service fiscal de proximité dans les zones rurales.
Permettez-moi, mes chers collègues, de citer ici un extrait de la brochure de présentation éditée par le ministère : «La fusion ne conduit pas à remettre en cause le rôle des trésoreries implantées dans les communes rurales. Au contraire, la fusion permet de consolider leurs missions et de conforter leur place parmi les services publics de proximité. La charte des services publics en milieu rural reste par ailleurs le fondement de la politique d'implantation du réseau des services publics financiers. »
Entre un discours qui se veut rassurant et la réalité, concrète, quotidienne, vécue par les maires, la distance est assez nette, entraînant incompréhension et, surtout, donnant le sentiment à de nombreux élus d'être un « guichet » plus qu'un partenaire.
Charte des services publics en milieu rural, charte du dialogue territorial ! Même dans le cadre de l'intercommunalité, il me semble que la commune est bien l'échelon pertinent pour appréhender, dans toutes ses composantes, le service au public, dans un objectif partagé d'aménagement du territoire et dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité.
Il ne s'agit pas, monsieur le secrétaire d'État, d'occulter la nécessité d'une recherche de la meilleure efficacité économique et sociale, chacun est aujourd'hui en mesure de le comprendre. Cependant, cohésion sociale et développement équilibré du territoire sont les fondements non seulement du service postal, mais également du service public et, d'une façon plus générale, du service au public.
Quelles solutions efficaces en matière de financement des obligations de service universel le Gouvernement envisage-t-il de prendre, afin de garantir l'égalité de traitement de tous les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence sur le territoire ? Comment faire en sorte que les élus soient associés suffisamment en amont aux décisions de réorganisation ou d'aménagement, et ce même à titre purement informatif quand il s'agit de réorganisations internes ? Comment s'assurer que les discours tenus par les responsables pour rassurer les élus soient concrètement déclinés sur le terrain ?
Monsieur le sénateur, le Gouvernement est très attentif à garantir l'égalité d'accès de tous les citoyens aux services postaux, et cela quel que soit leur lieu de résidence sur le territoire, qu'ils soient situés en zone urbaine ou en zone rurale. C'est l'élu d'un département rural particulièrement sensible à la question que vous posez qui vous le dit ! Nos concitoyens ont droit à un égal accès aux services postaux.
À cet égard, des progrès notables ont été effectués avec la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, qui prévoit la mise en oeuvre de règles précises pour assurer la couverture du territoire en services postaux de proximité. « Sauf circonstances exceptionnelles, ces règles ne peuvent autoriser que plus de 10 % de la population d'un département se trouve éloignée de plus de cinq kilomètres et de plus de vingt minutes de trajet automobile, dans les conditions de circulation du territoire concerné, des plus proches points de contact de La Poste. »
Comme vous l'avez indiqué, monsieur le sénateur, Mme Christine Lagarde a conclu en complément, le 19 novembre 2007, avec le président de l'Association des maires de France et le président de La Poste, un contrat de la présence postale territoriale, qui encadre pour la période 2008 à 2010 les obligations de La Poste en matière de présence territoriale.
Ce contrat a pour objectif de répartir en toute transparence la ressource publique dont bénéficie La Poste en contrepartie de sa contribution à l'aménagement du territoire, au profit essentiellement des points de contact situés dans les zones prioritaires : zones rurales, zones de montagne, zones urbaines sensibles et départements d'outre-mer.
Aux termes de ce contrat, chaque commission départementale de présence postale territoriale sera informée, avant le 31 janvier de chaque année, du montant de la dotation départementale du fonds et recevra également de La Poste les informations permettant de proposer sa répartition.
Sur la durée du contrat, ce sont au total 420 millions d'euros qui ont vocation à être consacrés au maintien de la présence postale. En 2008, le fonds financera ainsi près de 140 millions d'euros, soit plus du tiers du coût de la mission d'aménagement du territoire, le solde étant directement pris en charge par l'entreprise.
Le mécanisme retenu pour la répartition du fonds permettra d'assurer une véritable péréquation de la ressource au profit des zones prioritaires de chaque département. La présence postale territoriale, avec ses 17 000 points de présence sur l'ensemble du territoire, sera ainsi maintenue. C'est un engagement qui avait été pris, vous vous en souvenez, par le Premier ministre de l'époque, M. Jean-Pierre Raffarin.
En prévoyant le financement d'agences postales communales en partenariat avec les mairies ou de relais poste chez les commerçants - nous connaissons de nombreux exemples dans nos départements -, ce contrat permet les nécessaires évolutions du réseau postal, tout en contribuant au maintien d'un réseau de proximité adapté aux besoins de nos citoyens.
Rappelons que la création d'un relais poste se traduit généralement par des horaires d'ouverture adaptés permettant à nos concitoyens d'effectuer, par exemple, des opérations de guichet après dix-huit heures, voire le dimanche. La création de ces nouveaux points de contact en partenariat n'est cependant encouragée que si cette évolution correspond à la volonté partagée des élus et de La Poste.
Par ailleurs, le souci de la continuité territoriale du service postal sera réaffirmé avec le contrat d'objectifs pour les années 2008 à 2012 en cours de finalisation entre l'État et La Poste. Ce contrat sera centré sur la mise en oeuvre des missions de service public assignées à l'opérateur postal, ainsi que sur les modalités de financement de ces missions.
Monsieur le sénateur, sachez que le Gouvernement est vraiment mobilisé sur ce sujet de la présence de La Poste sur le territoire, sujet important qui préoccupe l'ensemble des élus que vous êtes.

Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie des précisions que vous venez de m'apporter.
Lorsqu'une réorganisation est proposée dans le cadre des contrats et conventions que vous avez mentionnés et dont je salue l'opportunité, l'essentiel est que les élus, en particulier, soient informés, afin d'être en mesure d'examiner suffisamment en amont la décision.

La parole est à Mme Odette Terrade, auteur de la question n° 153, adressée à Mme le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

Monsieur le secrétaire d'État, c'est sur le devenir du site de l'Imprimerie nationale de Choisy-le-Roi et sur l'avenir des salariés de cette entreprise que je souhaite vous interroger.
Depuis 2003, l'État a entrepris ce qu'il a appelé « un plan de restructuration de l'Imprimerie nationale ». En fait, ce plan s'est très vite traduit par la suppression de plus de 900 emplois, la filialisation d'une partie des activités, pourtant essentielle pour la sécurisation de l'impression des documents officiels, et la délocalisation sur le site de Choisy-le-Roi. De plus, à peine l'installation faite à Choisy-le-Roi, la cession du bâtiment a été envisagée !
Ces méthodes ne sont pas sans rappeler celles qui ont été dénoncées voilà peu de temps par le Président de la République à propos de Mittal Steel. Pourtant, concernant l'Imprimerie nationale, des engagements avaient été pris par le ministre de l'économie et des finances de l'époque devenu aujourd'hui Président de la République.
En 2005, un plan de sauvegarde de l'emploi reprenant les directives du ministre a été mis en place avec les syndicats et la direction de l'Imprimerie nationale. Ce plan prévoyait que tous les employés seraient reclassés et que les ouvriers sous décret ne perdraient pas leur statut. Or, il est aujourd'hui remis en cause par le ministère et par la direction de l'Imprimerie nationale.
Oubliés, bafoués les engagements pris par le Président de la République alors qu'il était ministre ! Et ce sont les salariés qui en font les frais. L'argument avancé pour justifier la remise en cause de ces engagements est que les moyens financiers nécessaires à la mise en place de ce plan n'existeraient plus.
Que s'est-il passé ? La gestion de cette entreprise dont l'État est actionnaire à 100 % n'aurait-elle pas été bonne ? Pourtant, je veux le rappeler, il y a eu 197 millions d'euros de recapitalisation, dont 131 millions d'euros devaient couvrir les coûts sociaux dont le site de Choisy-le-Roi fait partie, plus 85 millions d'euros issus de la vente du bâtiment de la rue de la Convention et d'autres actifs encore.
Comme je l'avais demandé à Mme la ministre de l'économie dans un récent courrier, une réunion tripartite a été tenue et un médiateur nommé. Mais, d'après les représentants des salariés du site de l'Imprimerie nationale à Choisy-le-Roi que j'ai rencontrés hier, ce médiateur, malheureusement, ne disposait d'aucun moyen d'action pour assumer les engagements signés et promis aux salariés.
Les salariés, inquiets à juste titre sur l'avenir de leur emploi, veulent connaître les conditions de reprise de l'Imprimerie nationale par le seul repreneur connu aujourd'hui, qui avoue ne pas avoir les éléments nécessaires à sa décision, notamment la façon dont a été utilisée la recapitalisation ou encore le montant du chiffre d'affaires réel de l'entreprise !
Ces salariés sont d'autant plus inquiets que d'autres collègues avant eux ont été incités à partir travailler dans des filiales telles que Darling, Istra et Evry Rotatives. On leur avait promis du travail et des commandes pour ces filiales, ce qui aurait permis de garantir leurs emplois. Mais, aujourd'hui, ces filiales sont soit en dépôt de bilan, soit en redressement ou liquidation judiciaire. Convenez que cela puisse inquiéter les salariés à qui l'on assure peut-être le même sort.
Le travail promis n'a donc pas été au rendez-vous, alors que, pourtant, l'Imprimerie nationale a bien eu des commandes et les a apparemment sous-traitées, mais pas avec ses propres filiales !
Monsieur le secrétaire d'État, après l'épisode de la vente et du rachat des bâtiments de la rue de la Convention, pour laquelle mon groupe a demandé une commission d'enquête, convenez que tout cela ressemble à la casse pure et simple d'une entreprise d'État, à la manière du pire des « patrons voyous » !
Alors que votre collègue Mme Lagarde a récemment fait un grand discours sur la nécessité de préserver l'emploi dans de grandes entreprises de métallurgie françaises rachetées voilà peu de temps, alors qu'un soutien de l'État vient d'être apporté à une entreprise privée pour préserver une activité en France, le devenir du site de Choisy-le-Roi, dont l'État est l'unique actionnaire, reste très préoccupant et rien ne vient éclaircir l'épais nuage de fumée qui l'entoure.
Que comptez-vous faire pour tenir la parole de l'État, actionnaire unique, et les engagements pris en 2004 ? Qu'en est-il du repreneur potentiel ou des repreneurs potentiels ? Que vont devenir les 120 employés, en grève depuis seize jours ? Que va devenir le site de Choisy-le-Roi ? Les salariés de ce site sont attentifs à votre réponse, car c'est de leur avenir et de celui de leurs familles qu'il s'agit !
Madame le sénateur, l'État est extrêmement attentif à la situation du site de l'Imprimerie nationale à Choisy-le-Roi, qui entre aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, dans sa troisième semaine de blocage par des salariés grévistes.
La cession de ce site est prévue depuis 2005, date à laquelle l'État a obtenu de la Commission européenne l'autorisation d'apporter une aide unique de 200 millions d'euros à cette entreprise en difficulté, à condition notamment qu'elle se recentre sur son coeur de métier et cède ses autres activités, dont l'activité en forte perte de Choisy-le-Roi.
En 2007, le repreneur offrant les meilleures garanties industrielles et financières pour l'avenir du site a été sélectionné après une large recherche et a proposé de reprendre une partie des emplois. Au second semestre 2007, la direction a donc commencé un processus d'information et de négociation sur les conditions de la reprise et le plan de sauvegarde de l'emploi associé.
Par la grève qui a commencé le 21 janvier dernier, les salariés dénonçaient un manque de dialogue et de concertation sur ces deux questions et réclamaient l'organisation d'une réunion avec les représentants de l'État.
Cette réunion s'est tenue il y a une semaine, madame le sénateur, en présence des organisations syndicales, de la direction de l'entreprise, des représentants du ministère de l'économie et des finances et de la direction du travail et de l'emploi.
Elle a permis la désignation d'un médiateur, nommé par l'État, pour faciliter la reprise du dialogue social entre les représentants du personnel et la direction. Très actif, ce médiateur a déjà rencontré plusieurs fois les représentants du personnel et de la direction, en liaison avec le ministère de l'économie et des finances. Son mandat porte sur le contenu du plan social, qui devra non seulement répondre aux besoins spécifiques des employés de Choisy-le-Roi, mais aussi apporter des précisions sur les conditions de la reprise, à propos de laquelle les salariés ne s'estimaient pas suffisamment informés.
La réunion de la semaine dernière a également permis de garantir que le plan de sauvegarde de l'emploi s'accompagnerait de moyens financiers per capita équivalents à ceux qui ont été engagés à ce jour au titre du précédent plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par l'entreprise.
L'État a également confirmé, madame le sénateur, qu'il mobiliserait les dispositifs mis en place lors du précédent plan pour faciliter la recherche d'opportunités en matière de reclassement dans les fonctions publiques.
Il faut maintenant que le dialogue social, qui était bloqué avant la réunion du 28 janvier dernier, reprenne entre les salariés et la direction, avec l'assistance active du médiateur. Ayant obtenu des garanties, les salariés doivent revenir à la table des négociations, car chaque jour de blocage supplémentaire fragilise la situation économique de l'entreprise ainsi que ses chances de reprise, et risque donc de compromettre le maintien à Choisy-le-Roi de l'activité et des emplois concernés.

Monsieur le secrétaire d'État, je prends acte des paroles que vous venez de prononcer. J'espère qu'elles apaiseront les salariés, ce dont je doute malgré tout, compte tenu des informations qu'ils m'ont fournies hier.
Non seulement les syndicats n'ont pas été informés des plans de reprise que vous venez d'évoquer, mais le repreneur potentiel, qui s'était engagé, n'a visiblement pas reçu toutes les informations. Hier, les salariés ont découvert qu'il existait un autre repreneur, auquel on aurait dit qu'il était le meilleur placé, mais il semble que ce ne soit pas le cas.
Le médiateur avoue lui-même qu'il ne dispose pas de tous les moyens nécessaires. Il faut donc que l'État soit, par votre intermédiaire, très présent et très vigilant pour faire respecter la parole qui a été donnée et qu'il tienne ses engagements. On peut comprendre que les salariés n'aient plus tout à fait confiance dans leur direction, car ils ont le sentiment qu'elle s'est contentée de fermer d'anciens sites, qu'il s'agisse de Darling, société de prépresse, qui a été liquidée, d'Évry Rotatives ou d'Istra.
Il s'agit là non seulement du respect des qualifications professionnelles et des statuts de ces personnels, qui ont acquis des compétences, mais aussi de la sécurisation de nos documents officiels, qui est assurée par l'Imprimerie nationale.
Par ailleurs, où sont passés les crédits qui ont été accordés en 2005 si le plan de sauvegarde de l'emploi a été abondé ? De mon point de vue, ce ne sont pas les salariés qui bloquent la situation. Si, à un moment donné, ils ont décidé de se mettre en grève, c'est parce que c'était la seule façon, pour eux, de se faire entendre. N'attribuons pas toutes les difficultés aux salariés, alors qu'il s'agit uniquement - c'est l'impression qui domine - d'opérations immobilières !

La parole est à M. Roland Courteau, auteur de la question n° 1, adressée à M. le secrétaire d'État chargé des transports.

La presse régionale titrait, voilà quelques mois : « Le projet de ligne grande vitesse Montpellier-Perpignan avance au rythme d'un tortillard. » Tout est dit en quelques mots.
Il est vrai qu'en 1990, à l'époque de la mission Querrien, ...

... on nous disait que la ligne grande vitesse Languedoc-Roussillon serait opérationnelle dix ans plus tard. Nous sommes en 2008, soit dix-huit ans plus tard, et l'on ne sait toujours pas si les travaux commenceront dans moins de dix ans, dans vingt ans, ou dans trente ans.
C'est d'ailleurs l'objet essentiel de ma question, et, dès lors, vous comprenez mieux, madame le secrétaire d'État, notre profonde lassitude, doublée d'une certaine irritation. Cette remarque ne s'adresse évidemment pas directement à vous, mais - vous l'aurez compris - aux nombreux prédécesseurs de M. le secrétaire d'État aux transports.
Jugez plutôt les faits. En 1990, c'est la mission Querrien ; en 1995, c'est l'approbation de l'avant-projet sommaire, ou APS ; en 2001, c'est la qualification de projet d'intérêt général, ou PIG.

Entre-temps, il y eut les sommets franco-espagnols, d'Albi en 1992, de Tolède en 1993 et de Foix en 1994, avec une prévision de mise en service de la section Montpellier-Perpignan pour les années 2002-2005. Et je ne m'étendrai pas sur les innombrables réunions de travail qui ont eu lieu sur le terrain, ici même au Sénat ou au ministère des transports ! Allions-nous toucher au but ? Non !
En 2006, le secrétaire d'État chargé des transports me faisait savoir ici même qu'il convenait de lancer d'autres études, en explorant plusieurs scénarios alternatifs, pour une ligne mixte destinée au fret et aux voyageurs.
Il paraît que l'on avait oublié le fret dans les précédentes études, alors que, dès 1995, avec l'accord de Madrid, on savait déjà que la section Perpignan-Figueras, au sud, serait en ligne grande vitesse mixte, pour les voyageurs et le fret, de même que la liaison Nîmes-Montpellier, au nord, un peu plus tard. Comprenne qui pourra !
Certes, on nous explique aujourd'hui que, depuis les premières études, il y a eu un fort accroissement des échanges avec l'Espagne. Or nous le savions déjà en 1996-1997, et j'en avais fait état, en qualité de rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume d'Espagne concernant la construction et l'exploitation de la section internationale d'une ligne ferroviaire à grande vitesse entre la France et l'Espagne.
Actuellement, mes chers collègues, 8 500 poids lourds empruntent l'autoroute A9 chaque jour, soit 3 millions par an. Dans dix ans, on frisera les 6 millions par an, avec 15 000 poids lourds par jour. À quand, madame la secrétaire d'État, un véritable rééquilibrage entre le rail et la route ?
Convenons que beaucoup de temps a été perdu et qu'il y a urgence à réaliser cette section de ligne à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan, avec, j'y insiste, une gare TGV à Narbonne.

Je vous remercie, monsieur Blanc, de témoigner de votre accord sur ce point.
Je note que les pré-études fonctionnelles, c'est-à-dire les études préalables au débat public, sont d'ores et déjà engagées et qu'elles constituent une première étape de la réalisation de ce nouveau projet. Que ne les a-t-on réalisées plus tôt, d'autant qu'il est tout à fait vraisemblable qu'elles remettront en cause les orientations relatives à l'APS de 1995 ou certaines parties du fuseau de passage du PIG de 2001 ? De nouvelles études pourraient donc s'avérer nécessaires, ce qui implique encore de nouveaux délais.
C'est pourquoi, au regard des enjeux économiques et environnementaux, ainsi que des retards innombrables accumulés, desquels découlent les fortes impatiences de l'Espagne, je demande au Gouvernement de bien vouloir considérer ce projet comme étant la priorité des priorités et de noter également que, selon nous, le meilleur site d'implantation d'une gare TGV entre Montpellier et Perpignan, d'une part, et sur la ligne Narbonne-Toulouse-Bordeaux, d'autre part, ne peut être que Narbonne. Le débat public devrait sans doute le confirmer.
Ma question est donc simple : pouvez-vous, madame le secrétaire d'État, faire un point précis sur l'évolution de ce dossier et m'indiquer s'il sera bien inscrit à l'ordre du jour du prochain CIACT, le Comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires, sachant que des engagements ont déjà été pris par M. le Premier ministre, lequel a d'ailleurs évoqué sur ce projet la « culture du résultat ».
La presse régionale avait également relevé, je le rappelle, les propos de M. Borloo, qui déclarait à la sortie du tunnel du Perthus, « dans l'euphorie de son percement » : « Nous allons faire Perpignan-Montpellier à toute blinde. » Pouvez- vous me dire, madame le secrétaire d'État, quelle est l'équivalence en temps, c'est-à-dire en mois et en années, de l'expression « à toute blinde » ?
Sourires et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Monsieur le sénateur, je ne me hasarderai pas à traduire les expressions des uns et des autres ! J'essaierai néanmoins de répondre sur le fond à votre question. Vous avez bien voulu appeler sur ce sujet l'attention de Dominique Bussereau, qui m'a demandé de l'excuser pour son absence, puisqu'il effectue ce matin un déplacement avec le Président de la République pour un projet concernant le transport à grande vitesse.
Il est vrai que des inquiétudes se sont exprimées, et pas seulement au niveau local, concernant la réalisation du nouveau tronçon Montpellier-Perpignan. Vous avez fait part de votre crainte que le retard pris du côté espagnol pour la réalisation de la ligne à grande vitesse entre Figueras et Barcelone n'ait des conséquences négatives sur l'avancement des projets du côté français.
Votre inquiétude est compréhensible, mais les conclusions prises à l'issue du dernier sommet franco-espagnol du 10 janvier dernier à Paris sont de nature à vous rassurer sur la volonté de la France de maintenir le calendrier prévu pour les projets de l'arc languedocien. La programmation de ces opérations a été établie en tenant compte des perspectives d'évolution des trafics et des niveaux de saturation prévisibles des différentes sections.
Ainsi, la France engagera le contournement ferroviaire de l'axe Nîmes-Montpellier dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé, une consultation devant être lancée en 2008. Dans ces conditions, la mise en service de cette nouvelle infrastructure pourrait être envisagée à l'horizon de 2013.
Un programme d'aménagement de la ligne actuelle entre Perpignan et Montpellier sera réalisé en respectant le même calendrier, ce qui permettra d'accompagner la croissance des trafics à moyen terme. Les procédures nécessaires à la construction d'une nouvelle ligne à grande vitesse entre Perpignan et Montpellier seront réalisées parallèlement, sous réserve des conclusions du débat public qui sera lancé cette année même.
Par ailleurs, à la suite du Grenelle de l'environnement, une impulsion nouvelle au programme des lignes à grande vitesse et, d'une manière plus générale, à l'utilisation du transport ferroviaire et du transport collectif a été décidée. Ainsi, le Premier Ministre, le 19 octobre dernier, lors d'un déplacement à Nîmes, a confirmé qu'il ne doutait pas que le projet d'une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Nîmes et Perpignan constituerait l'une des priorités immédiates du Gouvernement. Vous faisiez à ce propos référence au CIACT qui se tiendra au printemps.

La parole est à Mme Michèle André, auteur de la question n° 138, adressée à M. le secrétaire d'État chargé des transports.

Madame la secrétaire d'État, ma question s'adressait à votre collègue chargé des transports, mais votre engagement lors du Grenelle de l'environnement, qui a permis de mettre en avant le rail en tant que mode de transport économe en carbone, et proche des préoccupations de développement durable, me laisse espérer une réponse attentive de votre part, à défaut, peut-être, d'une réponse positive.
Ce matin, vous venez de l'évoquer, les médias bruissent du lancement de l'AGV, l'automotrice grande vitesse, alors que, en Auvergne, on espère encore une ligne à grande vitesse qui mettrait Paris et Clermont-Ferrand, séparés de quatre cents kilomètres, à moins de trois heures. Oui, nous en sommes encore là ! Mais peut-être ce projet se réalisera-t-il en 2018 ou en 2020 !
En Auvergne, nous nous soucions des réseaux secondaires, qui subissent de multiples ralentissements et dont certains ont été fermés.
C'est le cas de la ligne Clermont-Ferrand-Montluçon.
Le résultat est le suivant : des centaines de camions sur les routes départementales, des salariés de grandes entreprises des Combrailles sans transports collectifs pour se rendre à leur travail, des familles de lycéens et de collégiens qui doivent se débrouiller autrement.
Au-delà, c'est toute une région qui se trouve délaissée, qui regarde à la télévision le progrès destiné aux autres.
Nos concitoyens, nos collectivités, nos villes - Montluçon, Clermont-Ferrand, mais aussi, sur le parcours, les Ancizes, avec le très beau viaduc des Fades -, nos départements - l'Allier, le Puy-de-Dôme -, nos régions sont révoltés.
Madame la secrétaire d'État, quel est votre point de vue sur les nécessaires investissements à faire pour maintenir ces lignes secondaires qui sont absolument nécessaires ? À un moment où la région Auvergne a beaucoup investi pour les trains express régionaux, les TER, voulez-vous soutenir cette région dans ce sens ?
Madame la sénatrice, comme vous l'avez souligné, le sujet que vous soulevez s'inscrit pleinement dans les suites du Grenelle de l'environnement.
Conformément aux conclusions de ce dernier, le Gouvernement a engagé la réflexion sur l'extension du réseau à grande vitesse, - c'est en effet d'actualité -, afin d'accroître une offre performante de transports plus respectueux de l'environnement.
Dans ce même objectif, le Grenelle de l'environnement a souligné l'enjeu que représente la mise à niveau du réseau existant, en prévoyant d'augmenter de 400 millions d'euros par an les moyens qui y seront consacrés.
Vous savez que, face au constat, à la fin de 2005, de l'état dégradé du réseau, après vingt années de sous-investissement, le Gouvernement a adopté, en 2006, un plan de rénovation 2006-2010, doté sur la période de 1 800 millions d'euros supplémentaires, pour régénérer les lignes du réseau ferré national, en priorité les plus circulées. Les régions accompagnent cet effort, dans le cadre des contrats de projets 2007-2013.
En Auvergne, comme dans les autres régions, c'est grâce aux moyens dégagés par ce plan de rénovation et par le biais des contrats de projets que les ralentissements seront supprimés et les lignes de desserte régionale modernisées. À titre d'exemple, plus de 100 millions d'euros sont inscrits au contrat de projet sur les lignes Clermont-Aurillac, Clermont-Le Puy et Montluçon-Vierzon.
Toutefois, il est évident que, dans le cas des lignes à très faible trafic, comme les lignes Lapeyrouse-Volvic, ou Montluçon-Eygurande, sur lesquelles on observe un aller-retour de train express régional par jour, une réflexion doit être engagée afin de trouver un meilleur équilibre économique.
La maintenance relativement standardisée du réseau ferré national est bien adaptée à des trafics plus importants, qui nécessitent un haut niveau de prestation. Mais elle constitue un handicap pour les lignes moins sollicitées. Par conséquent, il faut réfléchir à l'organisation des dessertes de voyageurs, par exemple en s'appuyant soit sur d'autres itinéraires, comme Montluçon-Clermont-Ferrand par Gannat, pour réduire les conséquences de ce handicap, soit sur des solutions alternatives.

Madame la secrétaire d'État, les précisions que vous avez apportées sur la liaison Montluçon-Clermont-Ferrand par Gannat ne sont pas très optimistes. Je rappelle que l'autre ligne présentait le double avantage d'être plus rapide, mais aussi plus touristique, ce qui était un atout pour notre région.
Je vous remercie néanmoins de votre réponse, même si elle est désespérante sur les perspectives de rétablissement de cette ligne.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, auteur de la question n° 143, adressée à M. le secrétaire d'État chargé des transports.

Madame la secrétaire d'État, la gare des Arcs-Draguignan, qui dessert cinquante-deux communes varoises, dont celles de la communauté d'agglomération dracénoise, comptant 85 000 habitants, et celles du golfe de Saint-Tropez, est habituée à voir passer les TGV. Les élus et les usagers de ces communes sont aussi habitués à être tenus pour quantité négligeable par la direction de la SNCF.
Par exemple, les courriers que j'ai pu adresser à cette dernière à propos de l'état et de l'accessibilité de la gare n'ont même pas fait l'objet d'un accusé de réception. Les dossiers de réaménagement du bâtiment de la gare de voyageurs et de rehaussement des quais sont toujours sur la voie de garage.
Cela n'a pas empêché la communauté d'agglomération dracénoise de procéder à l'aménagement coûteux - et sans participation financière de la SNCF - des abords de la gare, créant des voies d'accès, des parkings, et montrant ainsi l'importance qu'elle accorde au transport ferroviaire.
Les nouveaux horaires entrés en application le 9 décembre 2007, concoctés sans aucune concertation par la direction de la SNCF, sont la goutte d'eau qui fait déborder le vase !
Je citerai deux exemples. Premièrement, sur la liaison avec Lyon par TGV direct, un seul TGV sur les cinq aller et retour passe aux Arcs et encore selon un horaire ne pouvant convenir qu'aux Lyonnais, qui disposent d'un train à 9 h 07, alors que les Varois doivent attendre 16 h 38 pour bénéficier de ce privilège. Il ne leur est donc pas possible d'utiliser le train pour leurs activités professionnelles. Ils empruntent dans ce cas l'avion au départ de Nice. Le Grenelle de l'environnement propose, la SNCF dispose !
Deuxièmement, sur la liaison avec Paris, toujours par TGV direct, deux TGV circulent pour Paris, en fin de matinée et à une heure d'intervalle : 10 h 42 et 11 h 17, mais aucun l'après midi. Dans l'autre sens, on observe toujours deux TGV le matin, arrivant en gare des Arcs à 1 h 42 d'intervalle en début d'après midi. Nouveauté des nouveautés, le TGV de Paris de 13 h 50 arrivant en gare des Arcs à 18 h 09, très utilisé - quoi qu'en dise la SNCF, qui ment de façon éhontée ! - a été remplacé par un autre TGV qui, lui, ne s'arrête plus aux Arcs.
Jusque-là ce n'était pas brillant, maintenant c'est le « pot au noir » !
Je vous poserai donc trois questions simples, madame la secrétaire d'État.
Les cinquante-deux communes de l'est du Var, que j'ai évoquées, existent-elles pour le Gouvernement ?
La SNCF est-elle toujours chargée d'une mission de service public et, à ce titre, a-t-elle des comptes à rendre aux représentants de la nation et au Gouvernement ?
Les modifications horaires sont-elles le signe que le choix du tracé de la nouvelle ligne à grande vitesse en projet est déjà fait ? Si le tracé dit des « grandes métropoles » est adopté, cela signifie que Les Arcs devront se contenter de regarder passer les TGV. Autant les y préparer !
Monsieur le sénateur, la SNCF, Réseau ferré de France et les conseils régionaux des régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur travaillent, depuis plusieurs années, à la refonte du cadencement des dessertes TGV, train express régional, ou TER, et fret, afin d'accompagner la croissance du trafic.
Compte tenu notamment des trafics, cette réorganisation a nécessité de faire des choix. C'est ainsi que, sur la ligne classique, un TGV entre Marseille et Saint-Raphaël ne peut s'arrêter qu'une fois, soit à Toulon, soit aux Arcs-Draguignan.
Sachant que 100 000 voyageurs ont utilisé la ligne Les Arcs-Draguignan-Paris et 900 000 voyageurs, la ligne Toulon- Paris en 2007, le choix a été fait de privilégier l'arrêt à Toulon.
Le trafic entre Les Arcs-Draguignan et Paris est saisonnier, principalement d'avril à septembre. La SNCF a donc prévu d'améliorer la desserte TGV des Arcs-Draguignan en mettant en place, d'avril à septembre 2008, un troisième aller et retour Les Arcs-Draguignan-Paris selon les horaires suivants : départ des Arcs-Draguignan à 14 h 54, arrivée à Paris à 19h19 ; départ de Paris à 15 h 42, arrivée aux Arcs-Draguignan à 20 h 07
Les services de la SNCF suivent de très près l'évolution du trafic sur cette destination et ils étudient actuellement les éventuelles possibilités de proposer un TGV supplémentaire dans le sens Paris-Les Arcs-Draguignan pour la période d'octobre à mars.
En ce qui concerne la relation entre Les Arcs-Draguignan et Lyon, la SNCF a constaté que, sur cette ligne, le trafic était très faible et en baisse en 2007, malgré une offre qui est, quant à elle, constante.
À partir du 9 décembre 2007, les arrêts aux Arcs-Draguignan ont donc été repositionnés sur un TGV aller et retour Nice-Lyon-Lille. Cette mesure vise à mieux répondre aux flux de clientèle les plus importants en offrant une relation entre Lyon et Les Arcs le matin, avec un départ de Lyon à 9 h 07 et une arrivée aux Arcs à 12 h 22, et un retour vers Lyon l'après-midi, avec un départ des Arcs à 16 h 38 et une arrivée à Lyon à 19 h 50.
Bien entendu, la SNCF va suivre l'évolution des trafics entre Les Arcs-Draguignan et Lyon et fera un bilan en milieu d'année 2008.
En outre, les modifications horaires auxquelles je fais fait référence ne peuvent être mises en relation avec les études qui se déroulent actuellement concernant la ligne à grande vitesse Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Comme vous le savez, ces études complémentaires visent à vérifier les performances et la faisabilité des différentes solutions possibles. Elles font l'objet d'une large concertation avec l'ensemble des acteurs locaux et des collectivités concernés, associés dans le cadre d'un comité d'orientation. Ce n'est qu'une fois que seront connus les résultats de ces études, qui devraient être disponibles pour la mi-2008, et au vu des avis des collectivités concernées, que le Gouvernement sera amené à prendre une décision concernant le fuseau sur lequel seront poursuivies les études.

Je ne voudrais pas manquer de courtoisie avec Mme la secrétaire d'État, qui nous a fait le plaisir de venir dans cet hémicycle, alors que nous attendions M. Bussereau.

Il accompagne le Président de la République. Il ne peut pas être partout !

Monsieur le président, ne voyez aucun reproche dans mon propos à cet égard !
« Tout va très bien, madame la Marquise ! », m'avez-vous assuré en substance, madame la secrétaire d'État.
Vous avez précisé que la SNCF avait fait ses choix, qu'il y avait plus de monde à Toulon qu'à Draguignan. Il n'est pas besoin de faire des études très poussées pour s'en apercevoir ! Vous n'avez pas parlé des problèmes d'aménagement du territoire et vous n'avez pas répondu à la question de savoir qui exerce la tutelle dans ce domaine : est-ce la SNCF sur le Gouvernement, ou le Gouvernement sur la SNCF ?
Les horaires existants, s'ils peuvent convenir, par exemple, aux inactifs, aux retraités - c'est d'ailleurs un peu moins vrai maintenant pour ces derniers -, ne permettent pas d'utiliser le TGV des Arcs-Draguignan pour des déplacements professionnels nécessitant de partir le matin et de rentrer le soir.
Par conséquent, je suis désolé de vous le dire, madame la secrétaire d'État, la SNCF continue à se moquer de nous. J'espère que vous lui ferez savoir que nous apprécions modérément cette attitude !

La parole est à M. Aymeri de Montesquiou, auteur de la question n° 126, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Madame la secrétaire d'État, ma question porte sur la réalisation des travaux de mise à deux fois deux voies de la route nationale 124 entre Auch et Toulouse. Je citerai deux faits.
Premièrement, Auch n'est pas relié à Toulouse par une deux fois deux voies, contrairement aux autres préfectures de Midi- Pyrénées, Cahors, Albi, Montauban, Foix et Tarbes, voisines de la Haute-Garonne
Deuxièmement, le Gers ne compte que vingt kilomètres de deux fois deux voies, sans doute le réseau le plus court de France pour cette catégorie de routes. Ces vingt kilomètres de bonheur fractionné se situent entre L'Isle-Jourdain et Pujaudran, pour douze kilomètres, depuis 2000, et la déviation d'Aubiet de huit kilomètres, mise en service en 2003.
Depuis lors, nous attendons avec impatience la mise à deux fois deux voies des trente et un kilomètres restant entre Toulouse et Auch. Nous attendons avec d'autant plus d'impatience que cette route est vitale pour l'économie du Gers.
Or les retards s'ajoutent aux retards et les engagements de l'État pour la réalisation de la deux fois deux voies dans le contrat de plan État-région 2000-2006 prévoyaient une livraison en 2006. Ces engagements de l'État se trouvaient renforcés, car ils s'inscrivaient dans l'itinéraire à très grand gabarit au titre de la compensation des nuisances en découlant.
Une fois de plus, l'État n'a pas tenu ses engagements. Bien au contraire, les travaux ont pris un retard considérable faute de financements, estimés à plus de 175 millions d'euros.
Trois tronçons restent à réaliser : la liaison Auch-Aubiet, la déviation de Gimont et l'aménagement du tronçon Gimont-l'Isle-Jourdain. Ces opérations, qui sont chacune à un stade d'avancement différent, ne doivent pas seulement faire l'objet d'une inscription par l'État dans le plan de développement et de modernisation des itinéraires, le PDMI. L'État, responsable de tous les retards accumulés, doit s'engager de façon irrévocable.
Madame la secrétaire d'État, cette situation inacceptable en termes d'aménagement du territoire et d'égalité des chances ne peut se prolonger.
Je vous demande donc de me confirmer le calendrier de la réalisation des travaux, que je souhaite prochains et intensifs, ainsi que leur financement, afin que la RN 124 réponde enfin pleinement à son statut de route express, conformément aux engagements pris par l'État.
Monsieur le sénateur, sur les 76 kilomètres de la RN 124 entre Auch et Toulouse, seulement 20 kilomètres, effectivement, ont été aménagés en deux fois deux voies dans le cadre du contrat de plan État-région, et 35 kilomètres supplémentaires doivent être mis en service avant la fin de 2009.
Les travaux en cours concernent, d'une part, la section entre Toulouse et l'Isle-Jourdain, afin de disposer d'un aménagement continu à deux fois deux voies, avec en particulier la déviation de Léguevin, et, d'autre part, l'aménagement de la section Aubiet-Auch.
S'agissant des autres aménagements de la RN 124, à savoir la déviation de Gimont et les réalisations à mener entre Gimont et l'Isle-Jourdain, leur financement n'a pu trouver sa place dans le contrat de plan État-région. Il devra donc être recherché dans le cadre de la nouvelle programmation des investissements sur le réseau routier national.
Une consultation des élus et des principales collectivités concernées a été conduite par le préfet de région pour préparer cette nouvelle programmation.
Le 26 février 2007, Dominique Perben, alors ministre des transports, avait adressé un mandat aux préfets de région pour la consultation des programmes de développement et de modernisation d'itinéraires, les PDMI.
Le préfet de la région Midi-Pyrénées a consulté officiellement les élus et les parlementaires le 17 mars2007, et leurs réponses sont parvenues tout au long de l'année.
Le processus sera poursuivi et finalisé après que le Gouvernement aura entièrement tiré les conclusions, en matière de politique routière, du Grenelle de l'environnement.

Madame la secrétaire d'État, comprenez bien que la réponse que vous me communiquez ne me satisfait aucunement !
Le réseau autoroutier de la région dont vous êtes originaire est tellement dense qu'il n'est pas rare de se tromper pour passer d'un tronçon à un autre. Je rappelle que le Gers ne compte que 20 kilomètres de réseau à deux fois deux voies.
Cette situation est inacceptable en termes d'aménagement du territoire et d'égalité des chances ! Comment voulez-vous qu'un département se développe avec un réseau routier aussi peu dense ?
Je ne puis donc accepter votre réponse et je reposerai ma question, en espérant que M. Bussereau, dont je comprends parfaitement l'absence aujourd'hui, me donnera une réponse précise et prendra des engagements, engagements que l'État n'a jamais tenus.
Vous m'avez indiqué que les élus avaient été consultés par le préfet de région. Mais toutes les réponses allaient dans le même sens !
Madame la secrétaire d'État, dans votre région, on construit des murs antibruit pour préserver les riverains des nuisances sonores des autoroutes. À certains égards, je vous envie beaucoup.

La parole est à Mme Bariza Khiari, auteur de la question n° 141, transmise à M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.

Madame la secrétaire d'État, le 17 décembre dernier, lors de la cérémonie de clôture de l'année européenne de l'égalité des chances pour tous, Louis Schweitzer, le président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la HALDE, a remis au Gouvernement un rapport comportant dix-sept propositions d'action pour engager une lutte plus efficace contre les discriminations.
Parmi ces propositions, la HALDE a insisté sur la nécessité de mettre en oeuvre le CV anonyme.
Cette proposition me paraît tout à fait opportune, mais je souligne qu'elle ne devrait pas avoir lieu d'être, puisque le principe du CV anonyme pour les entreprises de plus de cinquante salariés a été adopté par le Parlement dans la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.
Mais cette disposition n'a pas été suivie d'effet depuis lors, faute de décret d'application, le gouvernement précédent et celui auquel vous appartenez n'ayant pas jugé utile d'appliquer la norme votée par la représentation nationale.
La lutte contre les discriminations dans l'emploi est difficile, en particulier dans le cas des discriminations indirectes. Elle doit passer par la création d'outils innovants, et le CV anonyme en est un. Il permet, au moins à l'étape du recrutement, de gommer les différences tant raciales que sociales, ne laissant la place qu'à des données objectives d'expérience et de formation.
Notre tradition de méritocratie républicaine impose l'anonymat aux concours et aux examens écrits. Il serait logique d'étendre ce principe au CV.
Le CV anonyme est un outil républicain, qui a une portée pédagogique évidente et qui permet de lutter contre le conformisme des recruteurs. Les études ont en effet démontré que le taux de discrimination était le plus fort au moment de la sélection des CV.
Plusieurs entreprises, grandes ou petites, ont déjà mis en oeuvre des procédures de recrutement anonymes sans rencontrer de difficultés particulières. Tel est notamment le cas des assurances AXA pour les emplois de commerciaux, et ce depuis 2005, avant même le vote du texte.
Les résultats sont probants puisque, avec le CV anonyme, le recrutement se trouve diversifié et correspond davantage à la diversité de notre société. Cette mesure est certainement bien plus efficace que toutes les politiques de quotas ou de discrimination positive, qui contribuent, elles, à stigmatiser encore davantage les populations déjà discriminées.
Madame la secrétaire d'État, quand le Gouvernement prendra-t-il les décrets d'application nécessaires à la mise en oeuvre et à la généralisation du CV anonyme ?
Madame la sénatrice, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Xavier Bertrand, qui est retenu à l'Assemblée nationale pour l'examen d'une proposition de loi.
L'article 24 de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, inséré à la suite de l'adoption d'un amendement déposé par le président Nicolas About, fait obligation aux employeurs de plus de cinquante salariés d'examiner les informations communiquées par écrit par les candidats à un emploi dans des conditions préservant leur anonymat.
C'est ce que l'on appelle communément le CV anonyme, qui permet aux candidats à un emploi de ne pas subir de discrimination dès le premier contact, discrimination qui serait attestée par certaines enquêtes réalisées sous la forme de testing.
Comme vous l'avez indiqué, madame la sénatrice, la loi renvoie les modalités d'application à un décret en Conseil d'État. Le législateur a souhaité laisser le temps à la négociation sociale d'aboutir sur cette question.
En effet, les partenaires sociaux négociaient parallèlement l'accord national interprofessionnel relatif à la diversité dans l'entreprise, qui comportait une expérimentation des dispositifs visant à préserver l'anonymat des candidatures.
Cet accord a finalement été signé le 12 octobre 2006 par quatre organisations syndicales - la CFTC, la CGT, la CGT-FO et la CFDT - et trois organisations patronales - le MEDEF, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et l'Union professionnelle artisanale - et il a été déposé auprès de la direction générale du travail le 23 mars 2007.
L'accord prévoit que chaque entreprise relevant de son champ d'application mettra en place, après information des représentants élus du personnel des entreprises qui en sont dotées, les procédures adaptées pour que les recrutements de toute nature, réalisés en interne ou en externe, soient exempts de toute forme de discrimination et visent à une diversification des sources de recrutement.
L'accord rappelle d'ailleurs que participent de cette démarche les expérimentations des dispositifs visant à préserver l'anonymat des candidatures, expérimentations dont les signataires doivent dresser un bilan à l'échéance du 31 décembre 2007.
À ce jour, les partenaires sociaux ne l'ont pas encore fait. Les organisations représentatives du personnel signataires ont toutefois demandé l'extension de l'accord national interprofessionnel, ce qui le rendrait obligatoire pour toutes les entreprises relevant des secteurs d'activité dont les organisations professionnelles signataires sont représentatives.
L'examen de l'extension de l'accord doit avoir lieu en sous-commission des conventions et des accords de la commission nationale de la négociation collective le 12 février prochain, pour une publication rapide de l'arrêté d'extension.
Xavier Bertrand rappellera à cette occasion aux partenaires sociaux que le Gouvernement attend beaucoup de l'évaluation qu'ils feront des dispositifs visant à préserver l'anonymat des candidatures.
Vous citiez les dix-sept propositions d'action formulées le 17 décembre dernier par la HALDE, qui invoque également la négociation entre les partenaires sociaux pour favoriser la mise en place de dispositifs de recrutement transparents et objectifs.
C'est la méthode que le Gouvernement continuera de privilégier.

Madame la secrétaire d'État, je vous remercie de ces précisions. Je vous interrogerai de nouveau dans quelques mois sur l'état d'avancement de cette question.
La démarche contractuelle me convient ; pour autant, je ne suis pas certaine qu'elle aboutisse dans les temps.
Je profite de la présence de Mme Boutin pour souligner l'importance de la lutte contre les discriminations, notamment à l'emploi. Il faudrait que ce sujet soit l'un des axes principaux du « plan banlieues », qui sera présenté prochainement par le Gouvernement.
Le temps perdu dans l'engagement effectif de ce combat fait planer un doute sérieux sur votre volonté réelle de lutter efficacement contre les discriminations.
J'espère que le Gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la lutte contre les discriminations soit non seulement un slogan, mais également une réalité.

La parole est à Mme Bernadette Dupont, auteur de la question n° 150, adressée à Mme la ministre du logement et de la ville.

Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention sur les difficultés de mise en oeuvre du droit au logement opposable pour les personnes handicapées dans le parc des logements sociaux.
L'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, inséré par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, impose de rendre accessibles les locaux à usage d'habitation aux personnes handicapées, quelle que soit l'origine de leur handicap.
La mise en accessibilité entraîne un surenchérissement des coûts de construction de ces logements, déjà rendus chers par la rareté du foncier disponible.
Parallèlement, l'institution par la loi du 5 mars 2007 d'un droit au logement opposable permet aux personnes handicapées de saisir les commissions de médiation pour obtenir l'attribution d'un logement social.
Or la faiblesse des ressources d'un grand nombre de ces personnes et de leurs familles, en termes d'allocations comme de compléments, lorsqu'elles ne travaillent pas, leur interdit l'accès au logement conventionnel.
Je souhaiterais donc connaître vos intentions, madame la ministre, pour mettre en cohérence les revenus des personnes handicapées et le coût du logement afin de rendre applicable le droit à un logement adapté.
Au préalable, je voudrais dire à Mme Khiari de ne pas s'inquiéter : le Gouvernement est déterminé à lutter contre la discrimination, qui est inacceptable dans une République vivante.
Madame Dupont, comme vous, je pense qu'il est indispensable que nous proposions à nos compatriotes affectés d'un handicap une offre de logements abordables dans le parc social public ou privé.
C'est une action conjointe de l'ensemble des acteurs publics qui permet de donner un toit aux plus fragiles d'entre nous.
Concernant la prise en charge par l'État du coût des travaux d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées dans le parc social existant, la loi du 11 février 2005 prévoit que la mise aux normes en matière d'accessibilité doit s'appliquer dès lors que des travaux sont entrepris dans ces immeubles.
Le coût de ces travaux est partiellement pris en charge par l'État. Les organismes HLM peuvent en effet déduire du montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties les dépenses qu'ils ont engagées pour l'accessibilité et l'adaptation de leurs logements.
Cette mesure permet donc de ne pas laisser à la seule charge des opérateurs le coût de ces travaux.
En ce qui concerne les constructions neuves, la réglementation impose désormais que les logements soient entièrement accessibles. Ainsi, l'intégration en amont de ces nouvelles normes dans les projets ne représente pas un coût d'opération supplémentaire substantiel par rapport à ce qui avait été prévu. Je ne nie pas qu'elle entraîne une augmentation du coût, mais c'est la loi et il est légitime de lutter contre les discriminations liées au handicap.
J'en viens à la question de l'adéquation entre les ressources des personnes handicapées et le coût du logement HLM.
Une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH, perçoit, au 1er janvier 2008, une aide d'un montant maximal de 628, 10 euros par mois. Celle-ci peut être complétée par une majoration pour la vie autonome de 104, 77 euros par mois lorsque cette personne occupe un logement indépendant sans exercer une activité professionnelle.
Au 31 décembre 2006, plus de 770 000 personnes étaient concernées, dont plus de 110 000 disposaient également de la majoration pour la vie autonome.
En moyenne, la dépense de logement, c'est-à-dire le loyer et les charges, s'élève à 375 euros par mois pour un logement social de deux pièces. Elle est partiellement prise en charge par une aide au logement s'élevant, pour une personne seule sans ressource imposable, à 252 euros par mois.
Ainsi, le reste à charge pour une personne handicapée occupant un logement social de deux pièces se situe entre 50 euros et 100 euros par mois, soit un taux d'effort compris entre 10 % et 12 %.
Comme vous l'avez rappelé, madame le sénateur, la loi reconnaît les personnes handicapées comme prioritaires dans les attributions des logements sociaux. Cette priorité a été renforcée par la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable.
Ce sont aussi les partenaires locaux qui nous permettront d'apporter les réponses adaptées et de développer une offre diversifiée de logement pour les personnes handicapées. À ce titre, les maisons départementales des personnes handicapées constituent le lieu « ressources » le plus approprié pour coordonner les acteurs de l'habitat sur ce thème.
Vous le savez, les personnes en situation de handicap font partie d'une des six catégories prioritaires en ce qui concerne la mise en place du droit au logement opposable.
Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, je tiens à avoir une relation de confiance avec tout le monde, en particulier avec les parlementaires. Je soutiens totalement la loi DALO - j'en suis une militante convaincue, et j'assume cette position -, mais, madame la sénatrice, à la fin de cette année, nous aurons un delta entre les demandes de ces six catégories prioritaires et les capacités de logement dont nous disposons.
C'est la raison pour laquelle je mets tout en oeuvre pour être créative. Je vous soumettrai un certain nombre de propositions dans les semaines et les mois qui viennent pour que nous puissions accueillir le maximum de ces personnes et diminuer ce delta.
Naturellement, les personnes en situation de handicap sont prioritaires et je suis convaincue qu'avec le temps, madame la sénatrice, nous mettrons un terme à ce scandale qui fait que la France ne loge pas tous ses enfants.

J'ai bien noté la volonté de Mme la ministre que les choses évoluent. Il n'en reste pas moins que, dans la pratique quotidienne, les immeubles anciens que l'on essaie de réhabiliter sont, pour la plupart, incompatibles avec les exigences d'accessibilité. Donc, le manque de logements anciens est manifeste.
Quant aux logements modernes, dans une ville comme la mienne où le foncier est très cher, les constructions réalisées sont inaccessibles aux personnes handicapées, en dépit de toutes les aides prévues en leur faveur.
Par ailleurs, si le Gouvernement aide certains organismes à mettre leurs locaux en conformité avec les normes d'accessibilité, ceux-ci ne risquent-ils pas de répercuter le coût des travaux sur le montant des loyers ?

La parole est à Mme Catherine Dumas, auteur de la question n° 148, adressée à Mme la ministre de la culture et de la communication.

Madame la ministre, je souhaite appeler votre attention sur la restauration et l'entretien du patrimoine culturel français.
En 1986, l'installation des colonnes du sculpteur Daniel Buren dans la cour d'honneur du Palais-Royal a suscité un vif émoi. Vingt et un ans plus tard, bien que cette oeuvre ait trouvé toute sa légitimité au sein de notre patrimoine culturel national et qu'elle fasse partie des circuits touristiques parisiens, la polémique réapparaît, et ce sur l'initiative de son créateur, qui voit son oeuvre initiale complètement dénaturée du fait de la privation de son écrin d'eau et de lumière initialement prévu.
La colère très médiatisée de Daniel Buren semble avoir porté ses fruits, car la rénovation de son oeuvre a été avancée par rapport au calendrier initial et devrait débuter avant l'été. Les récentes déclarations de M. Michel Clément, directeur de l'architecture et du patrimoine du ministère nous ont appris que la rénovation des colonnes de Buren s'inscrivait dans un vaste plan de restauration dans l'enceinte du Palais-Royal : 14 millions d'euros sont prévus, dont 3, 2 millions d'euros seraient dévolus à la cour d'honneur.
Si ce grand programme de rénovation et de restauration, engagé sur l'initiative du ministère de la culture, est satisfaisant et rassurant, il convient de s'interroger sur les possibilités que peuvent offrir les partenariats public-privé, si efficaces dans les pays anglo-saxons et pourtant encore trop peu utilisés en France.
L'État est propriétaire de cette oeuvre, mais il est aussi responsable juridiquement de son devenir, et cela vaut également pour toutes les autres oeuvres acquises par la commande publique, qui s'accumulent avec le temps et ont un jour besoin d'être restaurées.
Comment l'État envisage-t-il de relever ce défi de rénovation et de remise à niveau du patrimoine culturel sur l'ensemble de son territoire ?
Madame la sénatrice, l'oeuvre de Daniel Buren « les deux plateaux », communément appelée « les colonnes de Buren » et installée en 1986, est en effet une oeuvre emblématique de l'intégration de l'art contemporain dans les plus beaux lieux patrimoniaux français. Elle est d'ailleurs classée au titre des monuments historiques depuis 1994.
La fréquentation publique intense du site, qui est devenu un haut lieu touristique, a sérieusement altéré l'oeuvre de Daniel Buren, et bien qu'une rénovation en ait déjà été effectuée en 1994, une restauration lourde de l'ensemble de la cour d'honneur du Palais-Royal est désormais indispensable.
La demande de Daniel Buren de voir son oeuvre remise en état et entretenue dans les meilleures conditions est donc parfaitement légitime, et cette opération s'intègre, comme vous l'indiquez, dans un vaste plan de restauration du Palais-Royal.
Cette opération est en cours et associe chacune des institutions publiques qui occupent ces bâtiments prestigieux comme la Comédie-Française, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel.
Le ministère de la culture et de la communication, pour ce qui le concerne, a prévu de consacrer 14 millions d'euros à cette opération jusqu'en 2011. Celle-ci comprend la restauration des façades sur la rue de Rivoli, la cour d'honneur, les différentes galeries qui l'entourent et les péristyles de Joinville et de Beaujolais. Par ailleurs, la Comédie-Française aménage actuellement des salles de répétition sous la cour d'honneur.
J'ai souhaité accélérer le calendrier de rénovation de l'oeuvre de Daniel Buren, dont le démarrage était prévu en 2009 ; c'est à l'été 2008, c'est-à-dire le plus rapidement possible, que sera engagée la restauration « des deux plateaux », de façon que l'articulation avec les travaux qui vont avoir lieu pour l'étanchéité des salles de répétition de la Comédie-Française se fasse dans les meilleures conditions.
J'ai rencontré Daniel Buren le 18 janvier dernier, et je lui ai confirmé l'engagement ferme du ministère de la culture et de la communication de préserver l'intégrité « des deux plateaux ». Je lui ai également indiqué qu'il serait bien évidemment associé à la restauration, ainsi qu'à la préparation d'un protocole d'entretien de son oeuvre, qui a jusque-là fait cruellement défaut. Il s'agit d'une oeuvre majeure - même si les polémiques subsistent - à laquelle nous sommes tous profondément attachés.
Concernant le financement de ce chantier, l'État va bien sûr assumer sa responsabilité. Vous avez évoqué les partenariats public-privé, qui représentent souvent un moyen de financement tout à fait intéressant ; nous y pensons d'ailleurs pour la future philharmonie. Le processus est très long, mais nous allons tout faire pour associer les partenaires privés afin que cette opération soit un exemple de la participation des entreprises à de grands chantiers de l'État. Nous avons aujourd'hui bon espoir de trouver un partenaire privé pour la restauration des colonnes de Buren.

Je souhaite remercier Mme la ministre de sa réponse et me féliciter de la prise de conscience de l'État quant à la nécessité d'entretenir le patrimoine culturel français.

La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, auteur de la question n° 151, adressée à M. le Premier ministre.

L'aménagement des 52 hectares de terrains délaissés par Renault sur le territoire de la commune de Boulogne-Billancourt est réalisé par une société d'économie mixte « Val de Seine Aménagement », dont les actionnaires sont les villes de Boulogne-Billancourt et de Sèvres, le département des Hauts-de-Seine, la Caisse des dépôts et consignations, la Caisse d'épargne de Paris et le Groupe Dexia.
Dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté, qui couvre à la fois les terrains Renault et le quartier sensible du Pont de Sèvres, la société d'aménagement et d'économie mixte réalise à la fois des opérations d'aménagement, des équipements publics, des voieries et des logements sociaux. Une convention publique d'aménagement a été signée avec la commune de Boulogne-Billancourt en 2004. Sa réalisation fait l'objet d'une large concertation avec les riverains et les associations de la ville, du département et de la région.
À ce jour, 45 % du programme de constructions qui s'élève à 842 000 mètres carrés de surface hors oeuvres est engagé et fait l'objet de permis de construire déposés ou délivrés.
À l'intérieur de cet ensemble, trois programmes sont juxtaposés.
La réhabilitation du quartier du Pont de Sèvres fait l'objet d'un contrat avec l'ANRU, contrat qui est bloqué depuis six mois par le président du conseil général des Hauts-de-Seine.
Le deuxième programme concerne le trapèze de Billancourt et les terrains qui y sont associés. L'opération se déroule sans problème - et sans recours -, et vingt-sept cabinets d'architectes y travaillent, de Norman Foster à Franck Hammoutène, et de Jean Nouvel à Jean-Paul Viguier.
C'est le programme retenu pour l'île Seguin qui est le moins avancé. Prévoyant 175 000 mètres carrés de constructions, l'île doit recevoir des éléments scientifiques, des éléments culturels et des éléments d'accueil tournés vers l'international. À ce jour, trois programmes ont été engagés et ont fait l'objet de promesses de vente avec versements d'acomptes : un grand hôtel, une résidence pour chercheurs et artistes et l'Université américaine de Paris.
J'ajoute que l'île Seguin a été acquise par la société d'aménagement et d'économie mixte auprès de Renault pour la somme de 54 millions d'euros et que la vente des droits fonciers pour les trois programmes dont je viens de parler représente une recette de 30 millions d'euros.
Aussi est-ce avec beaucoup d'étonnement, madame la ministre, que j'ai pris connaissance, à la fin du mois de janvier, dans un grand quotidien, d'une interview du conseiller culturel du Président de la République, M. Benhamou, affirmant que le Président de la République souhaitait utiliser l'ensemble de l'île Seguin pour réaliser un grand jardin de sculptures contemporaines annulant ainsi les programmes déjà engagés. M. Benhamou ajoutait que le coût du projet serait de l'ordre de 200 millions d'euros et qu'il devrait être financé « par le conseil général, les élus locaux et les collectivités territoriales ».
Ce projet devrait se substituer à celui qu'avait proposé en son temps le Premier ministre, M. de Villepin, et le ministre de la culture et de la communication, M. Donnedieu de Vabres, qui concernait un centre européen de création contemporaine qui, au moins, prévoyait une participation de l'État à hauteur de 50 millions d'euros.
Madame la ministre, je me permets de poser trois questions.
Est-il concevable que, au mépris de l'autonomie des collectivités territoriales et des engagements pris par des élus locaux, un conseiller du Président de la République annonce un projet dont il n'a ni la maîtrise ni le financement ?
Quelle est l'intention du Gouvernement sur l'utilisation de la pointe aval de l'île Seguin, pour laquelle ni les maires concernés ni le président de la société d'aménagement et d'économie mixte n'ont été informés ou invités à donner leur avis ?
Comme je constate que le député de Boulogne-Billancourt, dans sa lettre de candidature aux élections municipales, souhaite « relancer la proposition de Nicolas Sarkozy, d'une île Seguin dédiée à la culture et à l'environnement avec un musée-jardin mondial », je souhaite savoir si le Gouvernement a progressé dans sa réflexion sur l'avenir de l'île Seguin et s'il envisage de faire part de ses propositions à la société d'aménagement et d'économie mixte ainsi qu'aux collectivités territoriales qui en assument la programmation.
Monsieur le sénateur, il a été en effet envisagé de créer sur l'île Seguin un centre européen de création contemporaine, foyer de création artistique de niveau international, à l'instar d'initiatives équivalentes dans d'autres pays européens.
Ce projet a été conçu en partenariat avec les collectivités territoriales, le conseil général des Hauts-de-Seine et la ville de Boulogne-Billancourt, et il s'inscrit dans le cadre d'un ensemble plus vaste qui tient à l'aménagement de l'île Seguin porté par les collectivités territoriales concernées.
Daniel Janicot a été chargé d'une mission à cet effet et il a remis un projet de préfiguration concernant la pointe de l'île, les emprises où devait normalement s'élever la fondation de François Pinault.
À ce stade, et compte tenu des articles de presse qui ont pu paraître, je peux dire que la réflexion sur les projets culturels se poursuit. Aucune décision formelle n'est prise et les choix à venir devront bien sûr prendre en compte ce qui existe déjà. À l'évidence, l'aménagement de l'île sera réalisé avec la mairie de Boulogne et le conseil général des Hauts-de-Seine, qui a fait connaître son intérêt pour un grand projet de « vallée de la culture », dont l'île Seguin pourrait être un élément majeur.

Je remercie Mme la ministre des trois indications qu'elle vient de me fournir.
Premièrement, on ne peut pas jeter à la rivière, s'agissant de l'île Seguin, les projets déjà engagés et financés. Ce serait un gaspillage dont nous n'avons aujourd'hui nul besoin.
Deuxièmement, la réflexion du Gouvernement progresse, et je suis tout à fait disposé à ce que la pointe aval de l'île Seguin serve d'assise à un grand projet culturel dédié à l'art contemporain. Cela me paraît tout à fait dans l'optique actuelle du rayonnement international de notre pays.
Troisièmement, enfin, j'ai noté avec intérêt que les élus locaux et les responsables de cette affaire seraient consultés sur l'évolution de la réflexion du Gouvernement. J'en prends acte avec beaucoup de satisfaction.

La parole est à M. Richard Yung, auteur de la question n° 154, adressée à M. le ministre des affaires étrangères et européennes.

Avant d'en venir à ma question, qui porte sur l'évolution du réseau consulaire, je tiens à féliciter les services du ministère des affaires étrangères, d'une part, et l'armée française, d'autre part, de la manière dont ils ont assuré la sécurité, puis l'évacuation de la communauté française de N'Djamena. Grâce à une organisation rigoureuse, ce sont près de mille personnes qui ont ainsi été évacuées ce week-end, en toute sécurité.
Tout le monde est conscient de la nécessité d'adapter notre réseau consulaire aux évolutions de la diplomatie française, des relations économiques et des intérêts fondamentaux de la France.
Nous sommes largement engagés dans un mouvement marqué vers l'Est et vers l'Asie. Depuis cinq ans, trente et un consulats ont été soit fermés, soit transformés. Ce nombre est considérable, d'autant que seuls cinq nouveaux consulats ont été ouverts. On constate donc non seulement un redéploiement, mais aussi une diminution des moyens mis à la disposition du réseau consulaire.
Cette évolution va sans aucun doute se poursuivre. Nous sommes inquiets quant à l'avenir du consulat de Haïfa, consulat historique, qui est au centre de plusieurs communautés importantes. Il semble qu'une partie de ses compétences doive être transférée à Jérusalem ou à Tel-Aviv. Pour l'heure, nous n'avons aucune certitude.
Pour une communauté française, le consulat est et reste la maison de la France. C'est à la fois la mairie, la sous-préfecture, la préfecture. C'est là que le ressortissant français est pris en charge et, en cas de besoin, que l'on assure sa sécurité.
L'évolution du réseau consulaire, certes nécessaire, se fait sans concertation, ce que déplorent les élus de l'Assemblée des Français de l'étranger et, d'une manière générale, tous ceux qui sont concernés. Nous sommes toujours placés devant le fait accompli. Bien que ces décisions soient de nature régalienne et relèvent de la responsabilité du ministère des affaires étrangères, il serait de bonne politique d'informer et de consulter les élus et les communautés françaises.
Monsieur le secrétaire d'État, comment envisagez-vous l'évolution du réseau consulaire pour les prochaines années, en particulier pour 2008 et 2009 ?
J'en viens à la question plus précise des consulats à gestion simplifiée. Au total, dix-sept consulats à gestion simplifiée ont été créés. Il s'agissait d'alléger la formule consulaire, de la « débarrasser », si je puis dire, de sa mission de gestion, sans doute afin d'économiser des moyens.
Après quatre ou cinq ans d'expérience, l'heure est au bilan. Pour notre part, nous considérons que ce bilan est négatif.
Tout d'abord, les consulats dits à gestion simplifiée ont un rôle extrêmement flou. Ils doivent assurer la présence politique diplomatique française, réaliser des analyses politiques. Mais quelles analyses politiques fait-on à Port-Gentil, à Recife ou à Porto, où la vie politique est calme, alors que l'ambassade est à quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres ?
Ensuite, ces consulats n'assurent plus aucun service aux communautés françaises. Nos ressortissants sont obligés de se déplacer à l'ambassade ou au consulat général de plein exercice le plus proche, parfois distants de 200, 300 ou 500 kilomètres.
Enfin, mais peut-être nous apporterez-vous des précisions sur ce point, monsieur le secrétaire d'État, l'économie de moyens semble limitée puisque, dans les faits, on maintient à temps plein un poste de consul général et tout ce qui va avec : personnels de service, voiture, logement.
Monsieur le secrétaire d'Etat, pourriez-vous nous indiquer comment vous envisagez l'avenir des consulats à gestion simplifiée ?
Monsieur Yung, les questions que vous abordez sont aussi celles que se pose le Gouvernement dans le cadre de la réflexion sur la révision générale des politiques publiques. Je peux en témoigner pour avoir assisté à des réunions au cours desquelles nous avons évoqué, avec lucidité, ce qui va comme nous le voulons et ce qui pourrait aller mieux.
La réforme du réseau consulaire qui a été engagée, notamment en Europe, commence à produire des effets.
Cette réforme a déjà permis le regroupement d'activités consulaires sur des pôles de compétence, notamment au travers de la centralisation des services d'état civil et de délivrance de visas dans plusieurs pays de l'Union européenne. Des pôles consulaires régionaux sont expérimentés. Ils assurent, autour d'un pôle très bien doté en moyens de traitement des dossiers, un rôle d'accueil et de réception des demandes.
La réforme a également permis le recours plus important aux nouvelles technologies en matière d'administration des Français, notamment en Europe, où les communautés françaises sont très nombreuses. Le registre mondial du réseau d'administration consulaire informatisée, intitulé RACINE, opérationnel depuis juin dernier, se révèle très utile pour faciliter les formalités à accomplir en matière d'administration des Français. Tout Français qui dispose de son numéro d'identification consulaire, le NUMIC, pourra s'inscrire au registre mondial, quel que soit son lieu de résidence à l'étranger, et consulter son dossier.
S'agissant de la mise en place de consulats généraux à gestion simplifiée, je reconnais que le dispositif est perfectible et il nous appartient de fixer les limites de l'exercice. Pour autant, monsieur le sénateur, tout n'est pas aussi négatif que vous le dites, loin s'en faut. Bien que n'ayant pas votre expérience, j'ai été parlementaire. J'ai donc pu me faire une idée de la manière dont fonctionne un consulat général à gestion simplifiée qui, déchargé de tâches consulaires regroupées dans un seul poste, continue à assumer des responsabilités, parfois spécialisées sur le plan économique, culturel ou autres.
Les consulats à gestion simplifiée, bien qu'ils n'aient plus une mission classique, ont vocation à assurer le maintien d'une présence de haut niveau et à jouer un rôle polyvalent utile. Cela passe par une rationalisation des tâches administratives et consulaires classiques soit dans les capitales, soit dans des pôles plus importants.
Ce système fonctionne bien là où le relais avec les services centraux, ou avec des consulats généraux qui gardent toutes leurs attributions, est facile, soit grâce à la mise en place de moyens nouveaux, soit parce que les distances ne compliquent pas trop la tâche de nos ressortissants. Il me paraît judicieux, dans une région où la France a une présence culturelle ou économique, de renforcer son rayonnement par la présence d'un consulat.
La situation n'est donc pas aussi tranchée que vous le dites. Les aspects positifs sont importants même si, je le reconnais bien volontiers, le dispositif n'apporte pas toujours ce que l'on peut en attendre. C'est pourquoi il faut procéder à des évaluations afin de déterminer ce qui fonctionne bien et ce qui est perfectible.
Une autre piste fructueuse réside dans la coopération consulaire entre les États européens. Certaines formes d'échanges sont devenues régulières : échanges d'informations en matière de visas et de fraudes, stages d'agents, participation réciproque aux réunions consulaires, mutualisation de moyens. Une convention sur les relations consulaires spécifique à l'Union européenne devrait nous permettre d'aller plus loin.
Il est vrai que le travail qui a été accompli depuis vingt ans et que les redéploiements auxquels il a été procédé ne se sont pas traduits par une baisse significative des services consulaires, dont le nombre est passé de 238 en 1987 à 233 en 2007. Pour autant, certains ont évolué, et nous devons là encore réaliser des évaluations.
Cela nous a néanmoins permis de renforcer les postes soumis aux plus fortes pressions : visas, nationalité, état civil en Afrique subsaharienne ou dans d'autres régions du monde. Vous avez évoqué l'inquiétude que vous inspire le consulat de Haïfa. Soyez persuadé que Bernard Kouchner et moi-même sommes très attentifs. Nous avons également renforcé les postes situés dans les pays émergents, la Chine et l'Inde, par exemple.
Dans ces zones prioritaires, des postes ont été créés, hors biométrie. Il n'y a donc pas de désengagement massif, ni en Europe ni dans le reste du monde.
La révision générale des politiques publiques nous permettra de cibler les villes dans lesquelles il est possible, tous services de l'État confondus, de rationaliser les moyens au profit de postes, ou de définition de postes. En effet, au-delà des personnes, il s'agit aussi de la définition des missions. Les consulats à gestion simplifiée pourraient nous permettre, en fonction de l'évolution de la pression, de nos intérêts, de notre rayonnement, de remédier à certains inconvénients que vous avez pointés.

Monsieur le secrétaire d'État, votre réponse n'a pas dissipé mes doutes. Je continue de penser que les consulats à gestion simplifiée ne permettent pas vraiment de réaliser des économies. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Pour l'heure, il convient effectivement de réaliser un bilan.
Pour les communautés françaises, la vraie difficulté tient à la distance. Nous allons instituer les passeports biométriques, puis les cartes d'identité biométriques. Pour renouveler son passeport, un ressortissant français habitant Stuttgart devra faire deux heures de train pour se rendre à Munich, ville distante d'environ deux cents kilomètres, une première fois pour la prise d'empreintes, une seconde fois pour retirer le document. Pour ces communautés, cela fait partie de la vie courante.
Tant que nous ne serons pas parvenus à l'utilisation optimale du guichet d'administration électronique GAEL, qui existe déjà et regroupe un certain nombre d'applications - il en sera d'ailleurs question ce soir, au Sénat même, à l'occasion d'une audition sur les systèmes informatiques du ministère -, les Français seront obligés de se déplacer plusieurs fois.
Reste enfin un point sur lequel vous n'avez pas répondu : la concertation. Les choses iraient pourtant beaucoup mieux si le ministère des affaires étrangères abordait ces questions, informait de ses intentions, voire, j'ose cette idée, consultait les Français de l'étranger.

Monsieur le secrétaire d'État, j'abonderai dans le sens de M. Yung en évoquant le cas de Haïfa, jumelée avec de nombreuses villes, dont Marseille.
La ville de Marseille, le conseil général et le conseil régional y ont construit, à l'époque, un centre franco-israélien qui porte le nom de Gaston Defferre et auquel, d'ailleurs, le Sénat avait également apporté sa participation financière.
Le ministère des affaires étrangères a envie, depuis longtemps, de fermer le consulat de France à Haïfa. Compte tenu de l'effort financier que la France a pu consentir dans cette ville, il serait tout de même surprenant que l'on mette ce projet à exécution.
Je vous serais très reconnaissant, monsieur le secrétaire d'État, de bien vouloir veiller à ce point, en complément de la demande de M. Yung.

La parole est à Mme Catherine Tasca, auteur de la question n° 145, adressée à M. le secrétaire d'État chargé de la coopération et de la francophonie.

L'idée de regrouper dans un site unique appelé « Maison de la francophonie » toutes les institutions de la francophonie ayant leur siège à Paris, aujourd'hui dispersées dans sept lieux différents, a été lancée par le Président Jacques Chirac au sommet de Beyrouth d'octobre 2002. C'est à l'évidence une nécessité si l'on veut permettre à l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, de remplir sa mission en pleine cohérence.
Pendant cinq ans, les services de l'État ont travaillé sur ce projet et ont finalement choisi un bâtiment situé avenue de Ségur et appartenant à l'État. Une convention avait même été signée avec l'OIF en 2006.
Il est très regrettable que, l'été dernier, sur l'avis de certains parlementaires amplifié par une campagne de presse, le Président de la République ait demandé au Gouvernement de retirer de l'ordre du jour de la session extraordinaire du Parlement le projet de loi autorisant l'approbation de la convention portant sur la Maison de la francophonie, dont l'examen au Sénat était prévu le 30 juillet 2007. Cette décision tardive et surprenante s'est révélée dommageable pour un projet dont l'utilité ne peut pas être mise en doute.
À la fin de 2007, aucune décision ne semblait avoir été prise. Or c'est la parole de la France et la réalité de son engagement dans la francophonie qui sont en cause. Depuis quarante ans, il n'a pas été facile de bâtir un ensemble institutionnel francophone cohérent et efficace. Les conditions de cette cohérence sont enfin réunies grâce à l'action du secrétaire général, M. Abdou Diouf.
Monsieur le secrétaire d'État, jusqu'à quand le projet de la Maison de la francophonie peut-il être différé ? La France fait-elle encore de la francophonie un axe majeur de sa politique étrangère ? Comment justifier qu'un engagement international pris il y a un an et demi soit ainsi remis en cause ?
Dans le département des Yvelines, les populations originaires des pays francophones - Algérie, Mali, Maroc, Sénégal, mais aussi Roumanie, Vietnam - sont très nombreuses et attentives aux signes que donne la France à ses partenaires. Inquiètes de la politique d'immigration, elles doutent de la solidarité proclamée mais insuffisamment concrétisée.
Le retard apporté au projet de la Maison de la francophonie est forcément vécu par nos partenaires comme un recul. C'est la confiance de la communauté francophone, c'est-à-dire 55 États membres, 13 observateurs et 10 % de la population mondiale, qui s'en trouve entamée.
Monsieur le secrétaire d'État, où en est le projet, six mois après cet épisode qui jette toujours le doute sur la volonté du Gouvernement d'aboutir à une solution rapide ? Et, si solution nouvelle il y avait, pouvez-vous nous indiquer les conditions de sa mise en oeuvre ? Je rappelle en particulier que la convention signée en 2006 prévoyait une mise à disposition à titre gratuit pour une durée de trente ans renouvelable. Pourriez-vous alors garantir au moins la reprise de ces conditions ?
Madame la sénatrice, votre question arrive vraiment à point nommé compte tenu des évolutions qu'a connues ce dossier ces derniers jours.
L'idée que vous avez développée de regrouper à Paris, dans un site unique, les diverses institutions de la francophonie est partagée par tout le monde, aussi ne la reprendrai-je pas.
Rappelez-vous, en revanche, la polémique de l'été dernier ; dès ma prise de fonction, comme secrétaire d'État chargé de la coopération et de la francophonie, j'ai été interpellé sur ce dossier par plusieurs sénateurs, en particulier par M. Gouteyron.
L'économie générale du projet initial, celui de l'avenue de Ségur, a été remise en cause à la fois par la création du nouveau ministère de l'écologie et du développement durable et par les surcoûts envisagés pour la décontamination du bâtiment, notamment en matière de désamiantage. Le Gouvernement a donc décidé, en juillet dernier, de retirer de l'ordre du jour du Parlement le projet de loi autorisant l'approbation de la convention portant sur la Maison de la francophonie.
À la même période, le 23 juillet 2007, le secrétaire général de la francophonie, le président Abdou Diouf, était reçu à l'Élysée. À cette occasion, le Président de la République lui a confirmé que l'engagement de la France relatif au regroupement à Paris des opérateurs et institutions de la francophonie dans une Maison de la francophonie serait tenu et a fait savoir qu'il confiait au Premier ministre le soin de trouver un autre lieu avant la fin de l'année 2007.
Le Premier ministre a ainsi chargé une mission conjointe de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des affaires étrangères d'étudier rapidement d'autres possibilités. Cette mission a travaillé vite et bien, ce qui lui a permis de remettre son rapport dès novembre dernier. Une réunion interministérielle a décidé le 21 décembre de prendre en compte de manière prioritaire l'une de ses propositions et de la soumettre à l'OIF pour recueillir son avis.
Il s'agit d'un ensemble immobilier sis au 19-21 avenue Bosquet, dans le VIIe arrondissement de Paris, qui, avec une surface utile brute de plus de 6 000 mètres carrés, présente l'avantage de correspondre aux besoins de la francophonie, d'être immédiatement libre et de ne nécessiter que de modestes travaux de rénovation et d'aménagement.
Le Président de la République a proposé ce projet au secrétaire général de la francophonie par courrier du 8 janvier. J'ai eu l'honneur de présenter personnellement à ce dernier les lieux, que nous avons visités ensemble le 31 janvier, c'est-à-dire la semaine dernière ; c'est pourquoi je soulignais, madame, que votre question arrivait à point nommé.
Le président Abdou Diouf a écrit le jour même au Président de la République afin de lui indiquer que cette offre répondait aux souhaits et besoins de l'OIF : « J'ai retenu de cette visite la meilleure impression en raison de l'emplacement central et prestigieux tout comme de la fonctionnalité des installations, susceptibles toutefois d'être améliorées pour répondre parfaitement aux besoins du projet. » Effectivement, nous avons vu ensemble les améliorations qu'il est possible, sans grands travaux, d'apporter à cet ensemble immobilier.
Le secrétaire général de l'OIF poursuit : « Permettez-moi, monsieur le Président de la République, de vous exprimer au nom de l'ensemble des États et des gouvernements notre très grande satisfaction pour ce choix qui illustre si bien l'engagement déterminé pour le projet francophone et votre volonté de soutenir une francophonie aussi ambitieuse qu'efficace.
« Des initiatives diligentes seront prises pour profiter pleinement des délais raccourcis et favoriser un regroupement de tous les services francophones disséminés dans la ville de Paris afin d'assurer une meilleure coordination et, par conséquent, une plus grande efficience de leurs actions ». Et le président Abdou Diouf termine sa lettre par un mot manuscrit extrêmement chaleureux.
Ainsi, le projet pourra être réalisé non seulement pour un coût très inférieur à celui de l'avenue de Ségur, mais aussi dans des délais sensiblement plus courts, c'est-à-dire avant la fin de l'année 2009 et non en 2010, monsieur Gouteyron, puisque nous avons eu un échange à ce sujet.
L'engagement de la France pourra donc être tenu et une nouvelle convention sera signée à brève échéance entre la France et l'OIF. Un projet de loi tendant à autoriser sa ratification devrait être présenté sans difficulté au Parlement au printemps.

Je salue ce happy end d'un épisode qui avait été pour le moins troublant quant aux choix du Gouvernement concernant l'installation de l'OIF à Paris. Ne l'oublions pas, c'est un privilège pour notre pays que d'accueillir l'Organisation dans sa capitale !
J'ai bien noté le gain en matière de calendrier, puisque, c'est très important, tout devrait être prêt à la fin de 2009.

Je souhaite que cela se traduise aussi dans les faits.
Vous avez été moins précis sur le coût réel de l'opération, monsieur le secrétaire d'État.

Aussi, je souhaite que le Parlement puisse en être informé dès que le programme précis des aménagements aura été établi.
Enfin, la superficie disponible dans le nouveau projet semble être sensiblement inférieure à celle qui avait été envisagée avenue de Ségur. Or le programme incluait dans la fonction du futur siège de l'OIF une dimension culturelle intéressante, grâce à un espace consacré à des conférences et des expositions.
Savez-vous déjà, monsieur le secrétaire d'État, si la configuration des locaux sur lesquels s'est porté le choix du Gouvernement permettra de maintenir ce type d'activités ? Il est très important pour les pays membres de la francophonie que le siège de l'Organisation soit non seulement une institution bureaucratique - même si les services et bureaux sont bien sûr nécessaires -, mais aussi un vrai lieu de rendez-vous, un point de rencontre pour tous ceux qui participent à la vie de l'Organisation internationale de la francophonie.
Madame la sénatrice, il sera possible très rapidement d'organiser des expositions dans une salle prévue à cet effet, après quelques aménagements auxquels fait allusion le président Abdou Diouf dans sa lettre.
Quant au financement, il sera évidemment évoqué de manière transparente avant le débat parlementaire.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, auteur de la question n° 130, adressée à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Ma question porte sur le respect du principe de l'encellulement individuel. Je souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le phénomène de surpopulation carcérale qui existe dans les 192 prisons françaises, et qui devient de plus en plus inquiétant.
Le constat est sans appel dans les maisons d'arrêt, où, contrairement aux établissements pour peine, la règle de l'encellulement individuel est généralement détournée, ce qui revient à un durcissement tant des conditions de vie des détenus que des conditions de travail du personnel.
À la Réunion, le taux de surencombrement est particulièrement alarmant. Ainsi, le taux d'occupation est de 105 % pour la prison du Port, que j'ai visitée récemment avec beaucoup d'émotion, monsieur le secrétaire d'État, car j'ai rencontré ce jour-là de très jeunes adolescents, à peine sortis de l'enfance, qui avaient pour la plupart commis des crimes graves. J'ai pu discuter avec eux, et j'ai pu aussi apprécier la compétence et les grandes qualités humaines du personnel.
Ce taux d'occupation est de 174 % pour la maison d'arrêt de Saint-Pierre et de 212 % pour la maison d'arrêt de Saint-Denis.
Il est vrai que la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 prévoit la création de 13 200 places nouvelles, ce qui devrait permettre de désengorger les établissements pénitenciers existants. De plus, l'engagement pris par le Président de la République durant la campagne présidentielle de ne mettre dans une seule place qu'un seul détenu a été clair.
Le Comité d'orientation que vous avez installé en juillet 2007 pour préparer la loi pénitentiaire a proposé le 22 octobre, entre autres mesures, une meilleure prise en compte de la préservation des liens familiaux, l'amélioration du respect des droits des détenus et, surtout, l'obligation pour les collectivités locales de créer des postes de travail d'intérêt général afin qu'il y ait des alternatives à la prison.
J'adhère totalement à ces propositions qui me semblent très importantes, mais j'aimerais savoir si, avec la surpopulation carcérale qui est constatée, les réformes à venir seront suffisantes pour garantir à coup sûr, et ce dans un délai raisonnable, le respect de la règle de l'encellulement individuel, comme le prévoit l'article 716 du code de procédure pénale ?
Madame la sénatrice, vous avez appelé l'attention de Mme la garde des sceaux sur la question de la surpopulation et de l'encellulement individuel en prison.
J'apporterai tout d'abord une précision : la surpopulation carcérale ne concerne pas l'ensemble des établissements pénitentiaires. En effet, les établissements pour peine, c'est-à-dire ceux qui accueillent les détenus condamnés, ne connaissent pas de surpopulation. Seules certaines maisons d'arrêt sont confrontées à cette difficulté.
La principale réponse que nous devons apporter est la construction de places supplémentaires engagée depuis 2002 grâce à la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice prévoyant la réalisation de 13 200 nouvelles places de détention.
En 2012, la capacité d'accueil sera de 63 000 places, contre 50 693 au 1er janvier 2008. Il faut examiner cette question avec pragmatisme.
Les évolutions constatées, notamment aux Pays-Bas et en Allemagne, laissent penser qu'il convient de réfléchir à une approche globale de la question de l'encellulement individuel. En effet, la prise en compte de l'intérêt des détenus peut conduire à écarter volontairement l'encellulement individuel. Dans le cadre de la prévention du suicide, la politique du suivi des primo-incarcérés proscrit leur encellulement individuel.
Par ailleurs, des impératifs de gestion peuvent conduire à écarter l'encellulement individuel, comme la prise en charge de complices dans une même affaire pénale ou une gestion des phénomènes de violence en détention
Il est aussi nécessaire de connaître la volonté réelle des détenus. Certains ne souhaitent pas être seuls en cellule et la mise en oeuvre d'une consultation des détenus sur leur demande en matière d'encellulement est à l'étude.
Mme la garde des sceaux présentera au Parlement, au printemps, le projet de loi pénitentiaire, qui permettra le renforcement des droits des personnes détenues et le développement des aménagements de peine.
Je souhaite enfin souligner les qualités des personnels de l'administration pénitentiaire qui exercent leurs fonctions avec professionnalisme et humanité.

Monsieur le secrétaire d'État, j'ai bien fait la différence, dans ma question, entre les établissements pour peine et les autres : j'ai dit que les premiers n'étaient pas concernés par la surpopulation.
Je vous remercie de vos réponses. En effet, trouver des alternatives à l'incarcération par la création de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, par exemple, et par les aménagements de peine est un moyen d'améliorer et d'humaniser les conditions de détention et peut-être même de donner une deuxième chance à ces personnes qui ont souvent la volonté de recommencer une nouvelle vie.

La parole est à M. Thierry Repentin, auteur de la question n° 144, adressée à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Je souhaite appeler l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réforme de la carte judiciaire en Savoie. Alors que la réforme de celle-ci prévoit la suppression des tribunaux d'instance de Saint-Jean-de-Maurienne et de Moûtiers, je tiens à souligner la spécificité géographique du ressort du tribunal de grande instance d'Albertville qui s'étale sur deux vallées, la Maurienne et la Tarentaise, un secteur de montagne regroupant deux tiers des domaines skiables de notre pays, spécificité à laquelle s'ajoute, notamment, le contentieux avec l'Italie lié au droit des étrangers au point de passage de Modane-Fourneaux.
La suppression des tribunaux d'instance va accroître considérablement les distances et les temps de trajet des justiciables, alors même que ces justiciables sont souvent parmi les plus défavorisés de nos concitoyens, réalité qu'ont exprimée les élus de ces territoires, toutes tendances politiques confondues, à l'occasion d'une manifestation qui a eu lieu le 12 janvier dernier dans le chef-lieu d'arrondissement de la Maurienne.
La création putative d'une maison de la justice et du droit à Saint-Jean-de-Maurienne ne remplacera pas le tribunal dans ses missions. Dire le contraire serait se moquer des habitants, des professionnels de la sécurité et de la justice et des élus locaux.
Par ailleurs, les élus, le barreau et les fonctionnaires du tribunal de grande instance expriment leur totale incompréhension quant à l'absence de création d'un pôle d'instruction à Albertville, dès lors que le tribunal dispose de cinq parquetiers et de deux juges d'instruction, du fait du grand nombre d'ouvertures de dossiers, d'instructions et de leur complexité, de la présence de locaux adaptés à l'accueil de ce nouveau service et de l'activité économique toujours croissante du ressort, notamment en matière industrielle et touristique. Le tribunal pourrait également être renforcé par l'installation d'un juge pour enfants.
En matière pénale, le nombre de procédures annuelles s'élève à environ 20 000, ce qui est important.
De la même manière, compte tenu de la géographie montagnarde du ressort du tribunal d'Albertville, la décision de regrouper le contentieux commercial et le registre du commerce et des sociétés d'Albertville se traduira aussi par un éloignement du service, avec les dépenses supplémentaires inhérentes aux déplacements.
S'agissant du tribunal du conseil de prud'hommes d'Aix-les Bains, des propositions ont été faites afin de maintenir cette institution à Aix-les-Bains : élargissement du périmètre de la juridiction, fusion des conseils de prud'hommes d'Aix-les Bains et de Chambéry au sein de cette cité.
Dans ces conditions, je demande à Mme la garde des sceaux, avec conviction et solennité, de reconsidérer la réforme annoncée en prenant en compte la spécificité du ressort du tribunal d'Albertville, ainsi que celle des territoires de montagne, en l'occurrence la Maurienne et la Tarentaise, avant toute décision définitive qui se traduirait par un délitement du service public de la justice et un accès rendu plus difficile à ce service pour les populations des montagnes et des territoires ruraux concernés.
Monsieur le sénateur, vous avez souhaité interroger Mme la garde des sceaux sur les conséquences de la réforme de la carte judiciaire dans le ressort du tribunal de grande instance d'Albertville et lui faire part de votre inquiétude quant aux conséquences des suppressions de juridictions pour l'accès des justiciables à la justice.
Je vous confirme que les deux tribunaux d'instance de Moûtiers et Saint-Jean-de-Maurienne seront, à compter du 1er janvier 2010, rattachés au tribunal d'instance d'Albertville.
En effet, le tribunal d'instance de Saint-Jean-de Maurienne est une juridiction de très faible activité : 255 affaires civiles nouvelles par an en moyenne sur 2004-2006, pour un niveau moyen d'activité, tous tribunaux d'instance confondus, de 615 affaires par an et par magistrat. Il compte parmi les 169 tribunaux dont l'activité ne justifie pas l'emploi d'un juge à plein temps.
Le tribunal d'instance de Moûtiers est également une juridiction de faible activité, avec 462 affaires civiles nouvelles par an en moyenne sur 2004-2006.
Dans ces conditions, la continuité du service, l'accueil du justiciable et la sécurité du tribunal ne peuvent être assurés de manière acceptable.
Par ailleurs, Mme la garde des sceaux a souhaité que les tribunaux d'instance représentent désormais une activité suffisante pour deux magistrats, afin de rompre l'isolement du juge. Il n'est en effet pas concevable que des juges d'instance, souvent nommés à la sortie de l'École nationale de la magistrature, soient seuls dans leur tribunal, sans possibilité d'échanges avec des magistrats plus expérimentés.
La réflexion qui a été menée a bien évidemment intégré les préoccupations d'aménagement du territoire. Le rattachement du ressort des tribunaux de Saint-Jean-de Maurienne et de Moûtiers au tribunal d'instance d'Albertville a tenu compte de l'accessibilité pour le justiciable. En effet, Moûtiers est distant de moins de trente kilomètres d'Albertville, soit un temps de trajet par voie express inférieur à trente minutes, et le tribunal d'instance de Saint Jean-de-Maurienne, éloigné de soixante et un kilomètres d'Albertville, est néanmoins distant de moins d'une heure de trajet par la voie express.
Dans ces conditions, l'accès à la justice dans le ressort du tribunal de grande instance d'Albertville n'est pas compromis pour le justiciable.
Par ailleurs, l'avis relatif aux modifications envisagées pour les conseils de prud'hommes, publié au Journal officiel du 22 novembre dernier, conformément aux dispositions des articles L. 511-3 et R. 511-1 du code du travail, ne fait pas état de modifications pour le département de la Savoie. Les conseils de prud'hommes d'Albertville, d'Aix-les-Bains et de Chambéry ne sont donc pas susceptibles d'être regroupés.
Par ailleurs, la compétence commerciale de vingt-trois tribunaux de grande instance sera transférée, à compter du 1er janvier 2009, aux tribunaux de commerce et le tribunal de commerce de Chambéry deviendra compétent pour le ressort du tribunal de grande instance d'Albertville.
S'agissant de l'instruction, la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, prévoit qu'à compter du 1er janvier 2010 toutes les affaires d'instruction seront confiées à un collège composé de trois juges d'instruction.
Aussi, la localisation des pôles de l'instruction a-t-elle d'emblée été faite dans la perspective de la mise en oeuvre de la collégialité à partir de 2010.
Dans le département de la Savoie, le tribunal de grande instance d'Albertville connaît, en matière d'instruction, une activité inférieure à celle de Chambéry.
En effet, le nombre d'ouvertures d'informations a été de 104 en 2004, 83 en 2005 et 113 en 2006, soit 300 au total, ce qui, à raison de soixante nouveaux dossiers par an et par juge d'instruction, représente un équivalent temps plein moyen annuel de 1, 67 juge d'instruction.
Dans ces conditions, il a été décidé de localiser le pôle de l'instruction au tribunal de grande instance de Chambéry, dont l'activité en matière d'instruction représente un équivalent temps plein moyen annuel de 1, 72 juge d'instruction.
Néanmoins, jusqu'au 1er janvier 2010, les affaires ne relevant pas de la compétence du pôle de l'instruction demeureront instruites par le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Albertville.
Par ailleurs, le tribunal correctionnel d'Albertville reste compétent pour juger les affaires qui seront instruites par le pôle de l'instruction de Chambéry.
En outre, la nécessité de créer un poste de juge des enfants à Albertville n'a pas été présentée aux services de la Chancellerie par les responsables de juridictions.
Enfin, une commission présidée par le secrétaire général du ministère de la justice et l'inspecteur général des services judiciaires est chargée de faire des propositions quant à l'évolution des maisons de justice et du droit.
C'est dans ce cadre que vos préoccupations en matière d'organisation judiciaire pour le ressort d'Albertville semblent devoir désormais s'inscrire.

Sur la forme, je tiens à dire une nouvelle fois ma complète déception s'agissant de l'attitude de Mme la garde des sceaux, qui devait venir nous annoncer ses décisions dans le département. Elle s'est arrêtée en cours de route à Lyon, considérant sans doute que délivrer son message à deux heures de Chambéry était une forme de courtoisie à l'égard des membres du barreau et des élus qui l'attendaient sur place, à Chambéry.
Elle n'est pas là ce matin ! Je ne peux que constater qu'elle est plus disponible pour des rendez-vous mondains ou des manifestations organisées par M. John Galliano que pour la représentation parlementaire.
Sur le fond, hélas ! les réponses que vous êtes chargé de m'annoncer, monsieur le secrétaire d'État, lui permettent de « botter en touche », si vous me permettez l'expression, mais le ballon revient toujours sur le terrain.
Là, nous sommes sur le terrain de la justice, et je ne comprends pas pourquoi à partir de 2010, date à laquelle cette réforme sera mise en place, dans notre pays, pour se rendre au tribunal, il faudra deux stations de métro dans certains départements, et deux heures de trajet dans d'autres. Les élus de ces derniers départements ne peuvent accepter cet état de fait !

La parole est à M. Adrien Gouteyron, auteur de la question n° 121, adressée à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

C'est aujourd'hui la journée nationale pour la prévention du suicide et ma question va traiter de ce grave et très douloureux sujet.
Mme Bachelot-Narquin participe ce matin même à un colloque sur ce problème et je comprends donc tout à fait qu'elle ne soit pas là. Mais vous avez qualité pour la remplacer, monsieur le secrétaire d'État, et vos responsabilités peuvent vous permettre, me semble-t-il, de me fournir quelques réponses.
Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes de quinze à vingt-cinq ans : tous les ans - les chiffres sont dramatiques -, 40 000 adolescents attentent à leurs jours, soit 800 à 900 décès par an.
L'augmentation des tentatives de suicide authentifiées comme telles est très inquiétante. Selon une psychologue, sur une période de six à sept ans, chaque adolescent connaîtra un copain de son âge qui aura fait une tentative de suicide et parfois, hélas ! cette tentative aura abouti.
Près de 15 % des onze à dix-huit ans sont dans une situation de grande souffrance psychique, souffrance qui se manifeste par des addictions, des troubles du sommeil, l'absentéisme en milieu scolaire, la montée de la violence sur soi. Et pourtant, trop souvent, l'adolescent demeure « le grand oublié des politiques publiques ».
Le jeune entre deux âges est, en effet, trop rarement le destinataire de récents programmes spécifiques de prévention. Le dispositif psychiatrique et médico-social est souvent saturé et n'est pas en état de répondre à la demande.
Combien de parents sont habités par l'idée effroyable que leur enfant adolescent ou jeune adulte peut décider de mettre fin à ses jours ? Nous ne pouvons les laisser seuls avec leurs interrogations ou leur angoisse et dans le cas, hélas ! où l'irréparable a été accompli, avec leur terrible sentiment de culpabilité.
Face à ce fléau, quelles réponses donner à ces parents ? Quelles réponses peut apporter notre société au désarroi de ces jeunes ?
Trop souvent, le suicide ou les tentatives de suicide sont des sujets tabous ; ce fait est souvent dénoncé par les spécialistes.
En 2000, et pour cinq ans, la France s'est dotée d'un programme national de prévention du suicide mobilisant les centres hospitaliers et les associations. Les actions visent un dépistage des facteurs de risque et une meilleure connaissance des facteurs précurseurs de la crise suicidaire et de ses facteurs déclenchant. Pouvez-vous dresser un bilan de leur effet ?
Il est évidemment très important de renforcer la prise en charge des jeunes suicidaires ou en désarroi. On le sait, un jeune qui a tenté de se suicider répète parfois son geste, et cela aboutit trop souvent.
Pour ma part, j'ai eu l'occasion de connaître le désarroi de certains parents. Leur douleur est indescriptible. C'est ce qui m'a poussé à poser cette question, monsieur le secrétaire d'État. J'espère que la réponse sera à la hauteur de la gravité du sujet.
Monsieur le sénateur, vous avez bien voulu appeler l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la douloureuse question du suicide chez les jeunes. Elle m'a chargé de vous répondre.
À un âge où la mortalité pour des raisons de maladie est très faible, le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes de quinze à vingt-quatre ans, après les accidents de la circulation.
Selon les dernières évaluations publiées par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, en 2005, 567 jeunes sont morts par suicide. Ces chiffres sont à mettre en relation avec ceux de l'année 1993, au cours de laquelle 1 030 jeunes s'étaient suicidés.
Pour autant, on ne le redira jamais assez, le suicide des jeunes est inacceptable. De plus, le grand nombre de tentatives de suicide, notamment chez les jeunes filles, reste très préoccupant.
Le suicide est une cause de décès évitable.
Depuis 1998, les pouvoirs publics ont mis en place une politique de prévention du suicide. Plusieurs axes forts sont privilégiés.
Favoriser le dépistage de la crise suicidaire au travers d'action d'informations et de formation des professionnels en contact avec les jeunes, en particulier les enseignants.
Diminuer l'accès aux moyens létaux.
Améliorer la prise en charge des suicidants en développant des protocoles de prise en charge dans les établissements de santé.
Approfondir la connaissance épidémiologique du phénomène.
S'agissant plus particulièrement des jeunes, la stratégie nationale d'actions face au suicide a permis de développer des lieux d'accueil et d'écoute et de former différents intervenants auprès des jeunes, en particulier en milieu scolaire, pour le repérage et la prise en charge de la crise suicidaire.
Le ministère chargé de la santé a consacré près de 1, 5 million d'euros au financement de cette stratégie entre 2000 et 2005, tandis que près de 20 millions d'euros ont été dépensés en région sur la période 2000-2004.
Par ailleurs, le plan psychiatrie et santé mentale 2005-2008 prévoit la création de lits d'hospitalisation à temps complet en psychiatrie infanto-juvénile. Les efforts en la matière seront poursuivis cette année. Ainsi, 21 millions d'euros seront affectés à l'amélioration des structures hospitalières et 46 millions d'euros de crédits supplémentaires seront destinés à la création de postes, en particulier en pédopsychiatrie.
Ils permettront notamment de développer des structures spécialisées dans la prise en charge des enfants et des adolescents.
Un nouveau plan national d'action face au suicide 2008-2012 sera présenté en 2008. Dans les prochaines semaines, Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports installera un comité de pilotage présidé par une personnalité reconnue, et ce afin d'élaborer, dans un cadre pluridisciplinaire, des axes et des mesures prioritaires sur le repérage, la prise en charge et la prévention du suicide, en particulier en faveur des jeunes.
Le rôle des maisons des adolescents est également important dans les dispositifs destinés aux jeunes les plus en difficulté. De telles structures permettent d'apporter des réponses adaptées à la situation de ces publics en mettant en place un espace qui leur est dédié, pour leur accueil, pour leur écoute et pour leur apporter des réponses de santé diversifiées et adaptées à leurs besoins et attentes. C'est pourquoi l'objectif d'au moins une maison des adolescents par département doit être mené à son terme.
Roselyne Bachelot-Narquin a pris connaissance avec beaucoup d'intérêt du rapport de la défenseure des enfants. Ses recommandations, notamment s'agissant de développement des maisons des adolescents et de la place des parents, sont examinées avec toute l'attention nécessaire à l'action publique en matière de santé des jeunes.

J'ai noté avec satisfaction la volonté affirmée par le Gouvernement de lutter contre ce fléau. Je souhaite simplement que les crédits annoncés soient effectivement mobilisés et que les mesures envisagées soient réellement mises en oeuvre.
Je profite de l'occasion pour rendre hommage à l'action des élus locaux, en particulier des conseils généraux et des municipalités, qui prennent souvent en charge un tel problème en instituant des lieux d'écoute, car les jeunes ont besoin d'être écoutés. Je salue également le rôle important joué par les associations.
Pour que l'action publique soit réellement efficace, il est nécessaire que ces différents acteurs travaillent de manière coordonnée.
Le sujet est d'importance et il est normal que le Parlement en débatte de temps en temps.

La parole est à M. Dominique Mortemousque, auteur de la question n° 139, adressée à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Selon le rapport sécurité sociale 2007 de la Cour des comptes, « la France souffre moins d'un manque de médecins que de leur répartition inadaptée [...] entre spécialités [...] et entre secteurs ». Le milieu rural connaît une inquiétante pénurie de médecins. Nombre de praticiens ne trouvent pas de successeurs et ferment leur cabinet à leur départ à la retraite.
Ce manque de médecins crée une véritable psychose dans nos campagnes et un grand nombre de personnes âgées sont angoissées par crainte de ne pas pouvoir être soignées.
Quelles mesures le Gouvernement entend-il prendre pour pallier ce déséquilibre de l'offre de soins et pour améliorer les conditions d'exercice des professionnels de santé en milieu rural ?
Monsieur le sénateur, vous avez bien voulu interroger Roselyne Bachelot-Narquin sur la répartition des médecins sur notre territoire. L'égalité d'accès aux soins représente en effet un enjeu majeur.
L'accès aux soins de premier recours, et en particulier au médecin généraliste, est un droit pour tous. Il n'est pas admissible que certains de nos concitoyens en soient exclus.
Ainsi que vous le rappelez, « la France souffre moins d'un manque de médecins que de leur répartition inadaptée sur le territoire » entre spécialités et entre secteurs, puisque la répartition sur le territoire est trop variable, et ce malgré un nombre important de professionnels de santé.
Effectivement, ce sont les zones rurales, mais également les zones périurbaines, qui souffrent le plus de cette situation. Elles doivent bénéficier de tous nos efforts pour améliorer l'accès à une offre de soins que Mme la ministre souhaite rénovée.
En effet, les mutations socioculturelles de notre société doivent trouver un écho dans une nouvelle organisation professionnelle respectueuse des fondements de notre système de santé et adaptée aux besoins de nos concitoyens.
C'est la raison pour laquelle Roselyne Bachelot-Narquin a demandé la mise en place des États généraux de l'organisation de la santé. Une première synthèse des travaux sera rendue le 8 février à Paris. Un certain nombre d'entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, ont d'ailleurs participé à leur préparation. Je sais que Mme la ministre tient beaucoup à l'expression de vos avis au sein de ce débat.
En outre, et afin de prendre en compte la diminution de la démographie médicale dans les prochaines années, le numerus clausus des études médicales a été augmenté de 200 dès cette année, pour porter à 7 300 le nombre d'étudiants reçus en deuxième année de médecine.
Un rééquilibrage est notamment effectué en faveur des universités situées dans des régions sous dotées, comme le nord-ouest, le nord-est, l'ouest et les départements d'outre-mer. Dans les régions plus dotées comme le sud-est et l'Île-de-France, le numerus clausus n'augmente pas.
Par ailleurs, comme vous le savez, la proposition de loi relative aux personnels enseignants de médecine générale vient d'être adoptée par le Parlement, sur l'initiative du sénateur Francis Giraud. En permettant de consolider la structuration de la filière universitaire de médecine générale, ce dispositif contribue à la valorisation du métier de médecin généraliste.
Ces éléments seront complétés par les conclusions des États généraux de l'organisation de la santé et de la mission conduite par Gérard Larcher, que Mme la ministre attend pour la fin du mois de mars. En effet, les questions d'accès aux soins ne pourront trouver de réponses efficaces que par une meilleure complémentarité entre la ville et l'hôpital.

Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie de votre réponse.
À l'occasion de l'examen de textes législatifs relatifs à l'aménagement du territoire, nous avons travaillé sur les possibilités de rendre fiscalement intéressante l'installation de médecins dans certaines zones moins attractives. Les résultats ne sont pas au rendez-vous !
J'espère que des solutions seront annoncées pour remédier à cet état de fait le 8 février prochain, car le problème est particulièrement préoccupant dans certains de nos territoires.

La parole est à Mme Patricia Schillinger, auteur de la question n° 149, adressée à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Je souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur l'utilisation par le grand public des défibrillateurs entièrement automatisés. Alors que seuls les professionnels de santé étaient habilités à s'en servir, le décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 autorise désormais « toute personne, même non-médecin » à les utiliser.
En France, 40 000 à 60 000 personnes décèdent chaque année à la suite d'un arrêt cardio-respiratoire, soit près de 200 morts par jour.
L'installation des défibrillateurs est un projet ambitieux, car il permettra de sauver de nombreuses vies.
En effet, en France, le taux de survie est estimé entre 2 % et 4 % seulement, contre 20 % à 50 % aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, où les défibrillateurs sont à la disposition du grand public. Cette expérience a pu démontrer l'efficacité de tels appareils et, par conséquent, la pertinence de les installer également en France.
Une mise en place encore timide de ces défibrillateurs cardiaques est en cours dans nos villes et nos villages, dans les lieux accueillant du public, notamment les centres-villes et les équipements publics, par exemple les salles de sport ou de spectacle.
Présentés sous la forme d'appareils portables, les défibrillateurs sont extrêmement sûrs et ne se déclenchent qu'en cas de nécessité. Par ailleurs, ils n'entraînent aucune nouvelle complication.
De plus, l'appareil « parle » pour informer les utilisateurs, puis délivre un choc électrique dit « défibrillation ». Ce système doit être utilisé très rapidement pour être efficace.
Selon la Croix-Rouge, la défibrillation doit être réalisée dans les cinq premières minutes suivant l'accident, alors que le délai d'intervention des urgences est en moyenne de sept à neuf minutes. Sachant qu'une seule minute de perdue représente 10 % de chance de survie en moins, on comprend l'urgence d'installer de tels appareils à des endroits visibles et accessibles.
S'agissant du choix des lieux d'installation des appareils dans les communes, compte tenu de leur expérience en la matière, le SAMU et les pompiers sont les interlocuteurs les plus qualifiés pour désigner aux collectivités locales les endroits les plus appropriés.
Cette mesure, qui concerne le grand public, doit obligatoirement s'accompagner de l'apprentissage des gestes de premiers secours. Il est impératif de prévoir cette formation dans les écoles, les collèges, les lycées et les centres de formation, afin de sensibiliser les jeunes aux gestes adaptés pour porter secours.
Dans ce cadre, qu'en est-il de la formation aux gestes de premiers secours et à l'enseignement des règles générales de sécurité ? Pour que ces appareils soient véritablement efficaces, est-il envisagé d'imposer cette formation en l'intégrant dans le programme scolaire de l'année 2008-2009 ?
Aujourd'hui, il est opportun d'anticiper la question de la responsabilité du maire.
En cas de décès brutal par arrêt cardiaque, la famille du défunt pourrait-elle présenter un recours contre le maire de la commune si elle estime n'avoir pas eu toutes les informations relatives aux lieux d'installation du matériel et aux gestes de secours à effectuer ?
Cette interrogation implique une question plus générale. Le maire peut-il juridiquement être tenu à une obligation de moyens ? En d'autres termes, peut-il être poursuivi si sa commune n'a pas investi dans l'achat de ce type d'appareil ?
Vu le coût non négligeable de ces appareils, les possibles actes de vandalisme et malgré les opérations de lobbying effectuées auprès des collectivités locales, il semble tout à fait illusoire d'imaginer qu'il y aura, au moins dans les cinq prochaines années, des défibrillateurs dans les communes les plus retirées et les plus pauvres.
Enfin, peut-on imaginer que, dans les zones les plus touristiques, l'utilisateur qui ne comprend pas la langue des ordres dictés par l'appareil pourra poursuivre l'élu de la commune et le tenir pour responsable ?
Monsieur le secrétaire d'État, face à une société de plus en plus procédurière et pour éviter toute action judiciaire abusive à l'encontre des maires, pouvez-vous préciser le cadre juridique relatif à la responsabilité de l'élu dans l'installation généralisée des défibrillateurs dans les communes ?
Madame la sénatrice, l'accident cardio-circulatoire entraîne chaque année en France le décès d'environ 50 000 personnes.
Parmi les accidents qui interviennent en dehors d'un établissement de santé, 10 % à 30 % surviennent sur la voie publique et 1 % à 2 % se produisent au travail ou sur des lieux sportifs. Le nombre de décès de jeunes sportifs dans ces circonstances est de 300 à 400 par an. L'usage, dans les premiers instants de l'arrêt cardiaque, des défibrillateurs bénéficie aux arrêts cardiovasculaires dus à une fibrillation ventriculaire, ce qui représente 40 % de ces arrêts.
Jusqu'à présent, seuls les professionnels de santé étaient habilités à utiliser un défibrillateur externe. Un décret publié au mois de mai dernier autorise toute personne, même non-médecin, à utiliser les défibrillateurs automatiques ou semi-automatiques.
Il est nécessaire de rappeler que l'utilisation d'un défibrillateur externe ne doit en aucun cas retarder l'utilisation du massage cardiaque externe, de même que l'appel au centre 15 et l'intervention des équipes médicalisées de secours.
Cette mesure a été engagée par le ministère chargé de la santé, en concertation avec les professionnels de l'urgence et avec les collectivités locales qui ont la charge de mettre à disposition du public ces matériels.
Il est conseillé que ces matériels soient disposés dans les lieux publics de grand passage, notamment les gares, les galeries marchandes, les rues commerciales, les stades sportifs accueillant un grand nombre de spectateurs. Les communes doivent cependant pouvoir choisir les lieux d'installation les plus adaptés aux configurations locales en lien avec les équipes de secours habituées à traiter ces accidents, afin d'optimiser l'utilisation de ces appareils.
Il est également prévu une remontée d'informations sur les conditions et les modalités d'utilisation des défibrillateurs externes à partir d'une fiche de saisine qui devrait être commune à toutes les équipes de secours. Ces données devraient permettre de disposer de données fiables sur l'utilisation de ces appareils, l'intervention des secours ainsi que le devenir des patients. Cette remontée d'informations devrait également permettre d'adapter et de compléter, si nécessaire, les mesures déjà adoptées et les actions entreprises.
Outre l'engagement fort du ministère dans cette action de santé publique, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a décidé d'aider les clubs sportifs à acquérir ce matériel en participant à leur financement à hauteur de 50 %. Mme Bachelot-Narquin a également décidé d'acheter 50 défibrillateurs pour l'équipement des principales administrations, pour un coût total de plus de 2 millions d'euros.
Les services du ministère de la santé sont en outre en train de travailler sur certains aspects juridiques de la mise en place de ces défibrillateurs. Cependant, l'acquisition d'un défibrillateur, bien que très fortement recommandée, n'étant pas une obligation légale, un maire ne saurait être poursuivi pour défaut d'équipement en cas d'absence de défibrillateur dans sa commune.
Parallèlement à l'extension de l'implantation des défibrillateurs, une action de formation a été mise en place dans les écoles, les collèges et les lycées, en lien avec le ministère de l'éducation nationale, la sécurité civile et les centres d'enseignement des soins d'urgence. Cette formation se met progressivement en place dans les programmes scolaires, depuis 2006.
L'ensemble de ces mesures devrait, à termes, porter ses fruits et rehausser la France au niveau des pays anglo-saxons, en avance sur ce point.

M. le secrétaire d'État a répondu à quelques-unes de mes questions, mais je voudrais surtout souligner l'urgence de la mise en oeuvre du dispositif, compte tenu du retard que nous avons pris.
Je me permets donc d'interpeller M. le Président de la République, afin que ce projet devienne européen. Il importe vraiment que chaque commune, en Europe, dispose d'un lieu - la mairie, le centre de secours, les pompiers - où ce matériel est disponible. Dans un souci d'efficacité, chaque citoyen doit savoir, quand il déménage, qu'un appareil est accessible.
Certaines petites communes touristiques, qui comptent, par exemple, des fermes auberges, doivent aussi pouvoir offrir la possibilité d'être secouru. L'égalité entre les communes doit se retrouver à tous les niveaux, en termes financiers, de territoire et de formation, en particulier dans les écoles.
Cela fait des années que nous parlons de secourisme : là, nous pouvons vraiment nous en donner les moyens !

La parole est à M. Pierre Martin, auteur de la question n° 146, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale.

Ma question concerne la mise en place du service minimum d'accueil, le SMA, à l'école primaire en cas de grève des enseignants.
Le SMA me paraît une bonne mesure, plébiscitée par l'opinion puisqu'elle suscite l'adhésion de 83 % des parents. Elle devait se concrétiser le 24 janvier dernier, journée au cours de laquelle il y a eu un peu plus de 34 % de grévistes.
À cette occasion, il était question non pas, bien évidemment, de remettre en cause le droit de grève, mais de mieux prendre en compte le droit au travail des parents. En cas de grève, en effet, les enfants reviennent à la maison et la liberté de travail des parents est mise en cause.
Concernant les jours de grève, monsieur le ministre, je sais que l'accueil est obligatoire au lycée et au collège, mais je n'en ai pas eu la confirmation pour l'école primaire. Je souhaiterais que vous puissiez nous le préciser, car il me semblait que l'accueil des enfants devait également y être prévu.
Par ailleurs, les journées de grève ont des conséquences indirectes sur les transports scolaires. À quoi servent-ils si les enfants restent chez eux ? Il faut savoir que, dans le département de la Somme, une journée de transport coûte 100 000 euros. Vous imaginez ce que cela représente à l'échelon de la France !
Concernant l'accueil dans les écoles primaires, il va de soi que les parents doivent être informés en cas de grève. Il arrive que l'information ne circule pas et que les parents ne sachent même pas si les enfants doivent ou non se rendre à l'école. Dans ce cas-là, ils appliquent en quelque sorte le principe de précaution et gardent les enfants. Comment gérer cette information ?
Les mairies ne sont pas informées de la participation des maîtres à une journée de grève. Comment, dans ces conditions, peuvent-elles organiser le SMA ?
Je voudrais en outre souligner que les possibilités d'accueil sont très différentes d'un endroit à l'autre. C'est la raison pour laquelle seules 10 % des communes ont expérimenté le système ; elles s'interrogeaient et elles s'inquiétaient.
Les situations sont très diverses : dans un groupe scolaire, tous les maîtres peuvent faire grève, une partie seulement, ou bien aucun...
Il y a surtout une disparité entre les milieux rural et urbain. Dans les villes, il existe des organisations qui accueillent les enfants le soir, pendant les vacances. Celles-ci disposent donc de locaux pour les CLSH, les centres de loisirs sans hébergement, c'est-à-dire pour les activités périscolaires. Il y a aussi des garderies, dont les communes rurales sont parfois dépourvues. Alors, comment faire ?
Faute de locaux pour accueillir les enfants, on ne peut se reporter que sur les locaux existants, c'est-à-dire les classes. Or ce n'est pas sans semer une certaine zizanie, puisque certains maîtres sont très opposés à la venue de quelqu'un d'autre dans leur classe, où tout est soigneusement rangé. Là aussi, c'est un véritable problème.
Concernant les regroupements pédagogiques intercommunaux, les RPI, et les regroupements pédagogiques concentrés, les RPC, il va de soi qu'il faut prévoir le repas de midi. Comment faire pour que les enfants soient accueillis au mieux si les fonctionnaires de la cantine font grève ?
Enfin, je voudrais aborder la question du transfert de compétences aux communautés de communes. Ce transfert peut être total, ou concerner uniquement le fonctionnement. Dans le cas d'un transfert partiel, il peut se produire un conflit entre la communauté de communes et la commune au sujet de l'utilisation des locaux de l'école dans le cadre du SMA.
Vous le voyez, monsieur le ministre, la mise en oeuvre du service minimum d'accueil pose un tas de problèmes ; j'espère que vous leur apportez une réponse.
Le dernier point que je souhaitais aborder, c'est la responsabilité des maires. Nombre d'entre eux se sont posé la question. En effet, il suffit qu'un but soit mal arrimé et, en cas d'accident, c'est le maire qui est responsable. On peut imaginer que, ces jours-là, se produisent des incidents ou des accidents : quelle sera alors la responsabilité du maire ?
Monsieur Martin, vous êtes parfaitement habilité à nous interroger sur les écoles, puisque vous fûtes vous-même un brillant directeur d'école.
C'est l'occasion de rappeler l'intention du Gouvernement sur le service minimum d'accueil, mais aussi de répondre aux problèmes réels que vous avez posés, qui pourraient faire l'objet de contentieux si l'on n'y prenait pas garde.
D'abord, rappelons ce qu'est le service minimum d'accueil : c'est une nouvelle liberté que l'on donne aux familles, un nouveau droit, au fond, pour que, pendant l'exercice du droit de grève, que nous ne discutons pas, les usagers du service public ne soient pas pénalisés.
Le test qui a été effectué le 24 janvier dernier a surtout bénéficié aux familles les plus modestes : les familles monoparentales ou celles qui ne peuvent pas payer une nounou pour garder leurs enfants. Le service minimum d'accueil a donc bien un caractère de justice sociale.
Le dispositif a été expérimenté par 2 067 communes, ce qui représente près de 9 millions d'habitants, soit 30 % des villes de plus de 100 000 habitants. Dans votre département de la Somme, monsieur le sénateur, 49 communes l'ont mis en place.
Vous posez la question de l'obligation faite aux directeurs d'école d'accueillir les enfants en cas de grève. Cette obligation résultait d'une circulaire du 26 mars 1981. Je pourrais dire qu'il s'agit d'une « disposition martyre », puisque, en juin 1981, quelques mois après sa parution - vous vous souvenez sans doute qu'il s'est passé quelque chose à cette période
Sourires
Vous me demandez comment le maire pourrait être certain de la qualité des personnels qu'il emploie pour l'accueil des enfants. Je vous réponds : de la même manière qu'il s'assure de la qualité des animateurs de centre de loisirs ou des surveillants d'études que certaines communes embauchent pour s'occuper des enfants.
Le financement apporté par l'État, qui s'élève à 15 euros de l'heure pour un groupe de 10 à 15 élèves, permet à la commune de faire appel à du personnel compétent, puisqu'il sera bien rémunéré, soit à du personnel municipal, si elle le souhaite, soit à des agents spécialement recrutés à cette fin sous sa propre responsabilité.
Vous soulevez la question classique, mais pas toujours évidente, de la responsabilité des maires durant les heures d'accueil des enfants. Cette question se pose et se résout dans les mêmes termes que pour les locaux que les enfants fréquentent avant ou après la classe lorsque la commune organise un accueil hors temps scolaire. Il n'y a donc pas de différence, sauf que, en l'occurrence, la durée d'accueil est plus longue et qu'elle concerne plus de monde.
Enfin, vous souhaitez savoir, ce qui montre là aussi le spécialiste, qui de la communauté de communes ou de la commune responsable des locaux, surtout lorsqu'il y a des regroupements pédagogiques intercommunaux, est responsable en cas de divergence sur l'opportunité d'appliquer le service minimum d'accueil. Je vous répondrai que, lorsque les maires sont décidés à appliquer le SMA, ils sont autorisés à organiser cet accueil dans tout autre bâtiment de leur commune, donc dans des bâtiments qui ne dépendent pas de la communauté de communes ou d'un regroupement intercommunal quelconque.
Je crois avoir répondu aux quelques points litigieux que vous avez soulevés. Je le répète, le service minimum d'accueil a reçu une réponse très favorable de l'opinion : 72 % des électeurs souhaitent que leur maire le mette en place. Il est important de le rappeler, surtout en cette période ...
Sourires
Je pense que ce dispositif entrera dans les moeurs et aura vocation à se généraliser, mais il nous faudra rester vigilants et prendre les précautions que vous avez rappelées.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de vos réponses aux différents points que j'ai abordés. Je reste néanmoins sceptique en ce qui concerne la qualification des personnels.
Lorsqu'une commune organise des CLSH, c'est pendant les vacances. Le personnel est donc généralement composé d'étudiants, qui ne sont donc pas disponibles les jours de grève.
Si pour garder des enfants trois heures le matin et trois heures l'après-midi, le personnel n'a pas une certaine qualification, que deviendra cette garderie ? Car il ne s'agit pas de laisser tout simplement les enfants jouer dehors pendant cette journée !
C'est pourquoi, vous avez raison, il y a lieu de se pencher sur le sujet. De votre côté comme du nôtre, la réflexion conduira certainement à trouver les bonnes solutions afin que cet accueil permette la liberté de travail des parents.

Monsieur le président, lors du scrutin public à la tribune sur le projet de loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution intervenu hier à Versailles, à la suite d'une erreur matérielle, deux de nos collègues, MM. Henri Revol et Henri de Richemont, ont été portés comme n'ayant pas pris part au vote, alors qu'ils désiraient voter pour.

Acte vous est donné de cette mise au point, monsieur Martin.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à seize heures, sous la présidence de Mme Michèle André.