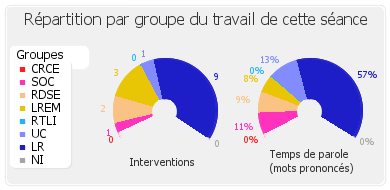Séance en hémicycle du 26 mars 2013 à 21h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Bariza Khiari.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle le débat sur les enjeux et les perspectives de la politique spatiale européenne, organisé à la demande de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
La parole est à M. Bruno Sido, président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, corapporteur.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous avons le plaisir de vous présenter aujourd’hui, avec Catherine Procaccia, le rapport que nous a confié l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, saisi par la commission des affaires économiques du Sénat, sur les enjeux et perspectives de la politique spatiale européenne.
En tant que président de l’Office parlementaire, je suis particulièrement heureux que ce débat puisse avoir lieu.
Tout d’abord, parce que ce débat est l’occasion de mieux faire connaître les travaux approfondis menés par l’Office et les suites qui y sont données. Vous le savez, l’Office est la seule délégation commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Les sujets que nous traitons sont parfois ardus, mais ils occupent une place croissante dans le débat public. Les questions technologiques sont en effet au cœur de nombreuses préoccupations de nos concitoyens. On le constate dans des domaines comme l’énergie ou la bioéthique, qui sont l’objet de nombreux travaux de l’Office parlementaire.
Ensuite, je suis particulièrement heureux de ce débat sur la politique spatiale parce qu’il nous semble, avec Catherine Procaccia, que l’espace n’a peut-être pas – justement – la place qu’il mérite dans le débat public et parlementaire.
Comme on a pu le voir récemment avec les images du satellite Planck de l’Agence spatiale européenne, qui dévoilent les débuts de l’univers, la recherche française et européenne a conduit à des résultats remarquables. Mais ceux-ci demeurent trop méconnus. Qui sait, par exemple, parmi nos concitoyens, que le robot Curiosity, que la NASA a fait atterrir d’une manière remarquable sur Mars au cours de l’été dernier, est en réalité issu d’une coopération franco-américaine ?
Nous souhaitons instamment que la politique spatiale ait, à l’avenir, une place accrue dans les travaux parlementaires. C’est déjà le cas aujourd’hui grâce à ce débat, qui se déroule peu après l’audition par la commission des affaires économiques, cet après-midi, du candidat pressenti à la présidence du Centre national d’études spatiales, le CNES – l’agence française de l’espace –, et dont je salue la présence dans nos tribunes. §
J’en viens à la présentation de nos conclusions, en remerciant Mme la ministre – ancienne membre de l’Office parlementaire – d’être présente pour répondre à nos interrogations.
Je présenterai nos recommandations concernant la gouvernance de la politique spatiale et la préservation de notre autonomie d’accès à l’espace. Puis, Catherine Procaccia présentera nos conclusions concernant les objectifs et la durabilité de notre politique spatiale.
Nous avons intitulé notre rapport « Europe spatiale : l’heure des choix », car il a été élaboré dans la perspective de la réunion des ministres en charge de l’espace des pays membres de l’Agence spatiale européenne, l’ESA, qui s’est déroulée les 20 et 21 novembre dernier, à Naples.
Cette réunion de l’ESA a constitué un tournant, avec des décisions importantes prises dans un contexte économique et financier ne permettant pas d’envisager un subventionnement massif du secteur spatial, alors même que l’Europe dépense déjà six fois moins que les États-Unis pour l’espace.
L’Europe est dotée aujourd’hui d’au moins deux politiques spatiales : celle de l’Union européenne, que le traité de Lisbonne a doté d’une compétence spatiale depuis 2009 ; celle de l’ESA, première institution à avoir incarné l’Europe de l’espace, à sa création en 1975.
Par ailleurs, les États membres, notamment la France, demeurent très actifs, car la politique spatiale comporte trop d’enjeux de souveraineté nationale pour ne pas reposer, en dernier ressort, sur leur volonté.
L’industrie spatiale a également un rôle à jouer, puisqu’elle est seule garante in fine de l’autonomie de l’Europe.
Cette énumération des principaux acteurs de la politique spatiale européenne laisse déjà entrevoir les difficultés de gouvernance susceptibles d’en résulter. Ce « mille-feuille » spatial européen peut être source de confusion dans les objectifs et de dispersion des moyens.
Dans ce contexte, nous proposons de clarifier la gouvernance de la politique spatiale.
En France, il nous semble qu’il faudrait réintroduire l’espace dans l’intitulé d’un ministère chargé d’en valoriser l’utilité auprès du grand public : en effet, l’ambition spatiale est trop peu portée aux niveaux politiques et administratifs ; en conséquence, elle est peu partagée par l’ensemble des Français.
Toujours en France, et comme je l’évoquais précédemment, il serait souhaitable d’associer davantage le Parlement à la programmation spatiale. Nous avons été frappés, lors de notre déplacement aux États-Unis, par la place que le Congrès occupe dans l’élaboration de la politique spatiale. La NASA est en effet en constante négociation avec les deux chambres du parlement pour la définition des objectifs et des budgets de sa politique. Le secteur spatial n’est certes qu’une illustration parmi d’autres des différences d’approches entre les parlements français et américain. Il nous paraîtrait néanmoins légitime qu’en France le Parlement puisse être saisi à intervalles réguliers de la politique spatiale française et de la vision défendue sur le plan européen par notre pays.
Par ailleurs, lors de nos auditions, les industriels ont exprimé le sentiment de ne pas être associés comme ils le souhaiteraient à la définition de la politique spatiale. Il nous semble qu’un dialogue pérenne doit être organisé, grâce à la création d’une structure de concertation État-industrie, présidée par une personnalité indépendante.
Quant à l’ESA, elle doit faire évoluer sa règle de « retour géographique », selon laquelle plus un État contribue à un programme, plus son industrie reçoit de contrats pour la réalisation de ce programme. Suivant une logique inverse, une règle de « juste contribution » de chaque État, en fonction de l’implication de son industrie dans les projets, paraîtrait préférable.
S’agissant enfin de la politique spatiale de l’Union européenne, c’est un processus en devenir dont les objectifs et le cadre de gouvernance demeurent pour le moins flous. Le budget de l’Union finance le programme de navigation-localisation-synchronisation Galileo, qui doit aboutir d’ici à 2015, ainsi que le lancement du programme de surveillance pour l’environnement et la sécurité, le GMES, dont le financement, demeuré longtemps incertain, semble aujourd’hui garanti, mais a minima.
Si elle veut exercer pleinement la compétence que lui a confiée le traité de Lisbonne, l’Union devra élaborer un véritable programme spatial plus exhaustif dans ses ambitions.
Elle devra également élaborer un cadre juridique pour la gouvernance de cette politique spatiale, en faisant de l’ESA son agence spatiale, sans que cela remette en cause par ailleurs le fonctionnement intergouvernemental de l’Agence.
L’Union doit aussi pouvoir faire appel aux compétences des agences nationales et privilégier, plus généralement, le recours aux organisations existantes, plutôt que de créer ses propres structures de gestion opérationnelle des programmes spatiaux, redondantes par rapport aux compétences existant déjà sur le territoire européen.
Enfin, l’Union doit reconnaître comme prioritaire l’application d’un principe de préférence européenne. Ce principe doit entraîner l’obligation de recourir à ses propres lanceurs. Ce n’est pas le cas actuellement, comme l’illustre le recours à un lanceur russe – au demeurant excellent – pour la mise en orbite de certains satellites du programme GMES.
Ce constat me permet d’en venir à la question, cruciale, de la préservation de notre autonomie d’accès à l’espace.
D’abord, je le rappelle, c’est par l’intermédiaire d’Arianespace, créée en 1980, que l’Europe accède aujourd’hui de façon indépendante à l’espace.
Arianespace exploite à ce jour trois lanceurs depuis le centre spatial guyanais.
Tout d’abord, Ariane 5 – à tout seigneur tout honneur, allais-je dire –, dont la capacité d’emport, dans sa version ECA, est de 10 tonnes vers l’orbite géostationnaire, et qui se caractérise par des lancements doubles. Ariane 5 est le n° 1 des lancements en orbite géostationnaire, avec près de 50 % de parts de marché et, à ce jour, il faut le souligner, 54 succès d’affilée.
Le deuxième lanceur d’Arianespace est Soyouz, exploité depuis Baïkonour, par l’intermédiaire de la filiale d’Arianespace, Starsem, créée en 1996. Depuis 2011, Soyouz est aussi lancé depuis la Guyane, avec une capacité d’emport de 3, 2 tonnes vers l’orbite de transfert géostationnaire, en application d’un accord intergouvernemental franco-russe, signé en 2003.
Enfin, le dernier-né des lanceurs européens est Vega – lanceur italien riche de promesses – dont la capacité d’emport est de 1, 5 tonne en orbite basse, mais qui a vocation à monter en puissance.
Cette gamme devra, à l’avenir, répondre à l’évolution prévisible des marchés. Il faut d’abord répondre à la demande institutionnelle.
À l’heure actuelle, le lanceur Ariane 5 est surdimensionné pour ce marché. L’Europe a donc recours à Soyouz, ce qui n’est pas complètement satisfaisant, car il ne s’agit pas d’un lanceur développé par l’Europe, et parce que la coopération avec la Russie n’est assurée que jusqu’en 2020. La qualification du lanceur Vega devrait résoudre une partie du problème, en permettant à tout le moins d’éviter le recours aux lanceurs russes dérivés, il faut le souligner, d’anciens missiles intercontinentaux. Il n’en reste pas moins qu’Ariane, conçu pour des objectifs de souveraineté, est en réalité peu utilisé pour le lancement de nos satellites gouvernementaux.
Il faudra aussi, à l’avenir, répondre à une demande commerciale, dont l’Europe dépend pour ces lanceurs, en raison de la faiblesse de son marché institutionnel. Or de nouveaux acteurs émergent. Ainsi, l’Américain Space X a récemment remporté plusieurs contrats de lancement de satellites de télécommunications. Cette entreprise est directement héritière du tournant pris par la politique spatiale sous la présidence de Barack Obama, consistant à recentrer la NASA sur sa mission de recherche et développement en vue de l’exploration lointaine, et à octroyer des subventions à des entreprises privées pour la reconquête de l’orbite basse, c’est-à-dire la desserte habitée de la Station spatiale.
Nous avons visité Space X dans le cadre de nos travaux. Cette entreprise est fondée sur un principe tiré, a contrario, des leçons de la navette spatiale : de la simplicité découlent à la fois la fiabilité et la modicité des coûts ; son lanceur est fondé sur un système modulable et sur une simplification de l’organisation productive.
Par ailleurs, la Chine, l’Inde, le Brésil et la Russie développent d’autres lanceurs potentiellement concurrents des nôtres. Or cette concurrence croissante intervient sur un marché où la demande est appelée à demeurer stable, autour de 20 à 25 satellites de télécommunications par an.
Dans ce contexte, deux projets de lanceur, conçus à l’origine comme complémentaires, sont devenus progressivement concurrents.
Démarré après la conférence ministérielle de l’ESA de 2008, Ariane 5 ME, ou Midlife Evolution – pardonnez-moi cet anglicisme –, est une évolution du lanceur actuel vers un lanceur plus performant – douze tonnes – et plus « versatile », c’est-à-dire doté d’un étage supérieur réallumable grâce au moteur Vinci, développé par notre entreprise Safran.
Ariane 6 est un lanceur de nouvelle génération, doté du même moteur réallumable pour son étage supérieur, mais plus modulable – de deux à huit tonnes – et surtout susceptible de procéder à des lancements simples, c’est-à-dire monosatellites.
Le lancement double est en effet devenu très problématique pour Arianespace, car il implique l’appairage des satellites, susceptible, vous l’avez bien compris, de faire perdre du temps et donc de l’argent aux opérateurs.
Notre rapport fait état de tous les arguments avancés au cours de nos auditions, en faveur de l’un ou l’autre de ces deux projets.
Il nous a semblé in fine qu’Ariane 6 apportait une réponse plus tardive qu’Ariane 5 ME, mais plus durable, aux évolutions en cours.
Procédant à des lancements « simples », Ariane 6 doit permettre d’accroître la cadence de production, afin de ne pas passer sous le seuil de cinq lanceurs par an, en deçà duquel il est unanimement reconnu que la fiabilité et la viabilité financière d’Ariane seraient remises en cause.
Dans sa version dite PPH, ou poudre-poudre-hydrogène – veuillez m’excuser pour ces termes un peu techniques –, le lanceur de nouvelle génération serait complémentaire de Vega, et privilégierait la poudre, technologie très fiable – je dirai même qu’aucun lancement ayant échoué n’est dû à l’étage poudre – et peu coûteuse. Cette configuration permettrait de bénéficier d’effets de standardisation.
D’un coût de production moindre, ce lanceur est sans doute plus susceptible qu’Ariane 5 ME de réduire la subvention publique actuellement versée pour garantir l’équilibre de l’exploitation d’Ariane 5, c’est-à-dire 120 millions d’euros par an.
C’est pourquoi nous avons préconisé de développer aussi rapidement que possible ce lanceur de nouvelle génération en mettant la priorité sur la réduction des coûts.
En novembre dernier, la Ministérielle de l’ESA a ouvert la voie au développement, en synergie, des deux lanceurs Ariane 5 ME et Ariane 6. L’idée est de développer un étage supérieur commun aux deux lanceurs, dont les caractéristiques doivent être définies au cours des prochains mois. La décision définitive de développement d’Ariane 6 doit être prise lors d’une nouvelle Ministérielle en 2014.
L’objectif est de développer en sept ans un lanceur dont le coût unitaire devrait être d’environ 70 millions d’euros, à condition de réorganiser la production industrielle du lanceur, actuellement trop éparpillée.
À ce sujet, je souhaiterais, madame la ministre, que vous puissiez nous informer des conditions industrielles et financières de développement de ces deux lanceurs. Comment l’Europe, qui traverse actuellement l’une des plus graves crises de son histoire, va-t-elle développer parallèlement deux projets d’une telle envergure ? N’aurait-il pas fallu – mais je sais que c’est compliqué – passer directement à l’étape « Ariane 6 » ?
Mme Sophie Primas s’exclame.

Je laisse maintenant la parole à Catherine Procaccia pour développer les autres aspects de notre rapport. §

La parole est à Mme Catherine Procaccia, corapporteur pour l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, j’évoquerai pour ma part les objectifs et la durabilité des activités spatiales de l’Europe.
Dans le contexte d’une concurrence croissante, déjà évoqué par Bruno Sido, il est tout d’abord indispensable d’aider l’industrie européenne à demeurer compétitive.
Nous avons préconisé, dans notre rapport, de poursuivre le soutien à la filière européenne de satellites de télécommunications par de grands programmes structurants, par exemple en suscitant le développement d’une filière européenne de satellites à propulsion tout électrique – nous en avons parlé cet après-midi –, afin de répondre à l’avance prise par Boeing dans ce domaine, cette entreprise bénéficiant d’une technologie développée pour les satellites de télécommunications militaires.
Il faut également agir pour réduire la dépendance technologique de l’Europe, notamment dans le domaine des composants microélectroniques durcis.
Cette dépendance est en effet préjudiciable dans le contexte des règles d’exportation américaines ITAR – International Traffic in Arms Regulations –, qui interdisent aux industriels européens d’exporter sans autorisation des produits qui comporteraient des composants ou technologies développés aux États-Unis. Mais la question de la dépendance de l’Europe à l’égard de technologies importées ne se réduit pas à celle des règles ITAR. C’est une question de compétitivité, car la dépendance entraîne des difficultés d’accès aux technologies de dernière génération, ainsi qu’une limitation de l’accès à la documentation, engendrant des difficultés à gérer, par exemple, des anomalies. L’existence d’une source d’approvisionnement unique est en soi un facteur de risques.
Le concept de non-dépendance implique donc une maîtrise des technologies et l’existence d’une double source, dont l’une au moins située en Europe. Mais il implique aussi une maîtrise des coûts. Le maintien à tout prix en Europe de filières beaucoup plus coûteuses qu’aux États-Unis n’est pas viable. Il faut par conséquent veiller à la rentabilité économique des filières développées et concentrer les moyens disponibles sur quelques priorités.
S’agissant des autres objectifs de la politique spatiale, il nous semble que ceux-ci doivent être orientés, en priorité, vers les services aux citoyens et privilégier les retombées concrètes. Notre rapport évoque en particulier l’observation, en vue de la compréhension des mécanismes du fonctionnement terrestre, qui est aujourd’hui devenue un enjeu scientifique et économique majeur.
L’Europe doit se donner pour priorité de demeurer précurseur dans ce domaine. Elle dispose d’une compétence reconnue dans ce que l’ESA nomme « les Explorateurs de la Terre », c’est-à-dire les satellites d’observation dédiés à l’étude de domaines précis tels que l’océanographie, l’étude des sols, de l’eau, de la glace, de l’atmosphère ou du champ magnétique.
L’observation spatiale présente l’avantage d’offrir une vision globale et continue dans le temps, qui permet des progrès considérables de la recherche sur l’environnement et le climat. Elle sera un instrument essentiel à l’évaluation du changement global et de l’impact des activités humaines sur le fonctionnement du système terrestre. Pour l’avenir, la surveillance des émissions de gaz à effet de serre deviendra un enjeu international majeur, et les moyens de mesure seront un atout important pour ceux qui les maîtriseront.
Mais pour que l’observation spatiale soit efficace, encore faut-il qu’elle soit continue et produise des données homogènes. Or le mode de fonctionnement des agences, dont la vocation est d’innover, et non d’assurer la continuité de l’existant, n’est pas forcément propice à la poursuite de missions en vue non pas d’innover mais de prolonger en optimisant les coûts. Il faudrait, pour cette raison, garantir la continuité des missions dès leur conception.
Nous préconisons également de poursuivre activement la mise en place des infrastructures du programme GMES de surveillance globale pour l’environnement et la sécurité, en mettant en œuvre le financement et le pilotage nécessaires à l’entrée en phase opérationnelle des services de ce programme. Lors de notre unique déplacement à Bruxelles, nos interlocuteurs de la Commission nous ont en effet confié être « très en amont » de la réflexion sur ce sujet...
Notre rapport examine aussi la question de l’exploration spatiale. Nous avons préconisé de continuer à participer à la Station spatiale internationale jusqu’en 2020.
Mais l’Europe doit apporter une contribution de nature technologique, comme elle le fait actuellement en fournissant le véhicule automatique de ravitaillement de la Station, l’ATV.
Cette contribution pourrait d’ailleurs participer plus tard au démantèlement de l’ISS, c’est-à-dire à sa désorbitation. Ce démantèlement doit d’ores et déjà être envisagé. Ses modalités ne sont pas encore fixées. Son coût est évalué à 2 milliards de dollars, ce qui ne représente finalement que 2 % du coût exorbitant de cette Station.
Pour l’avenir, l’Europe doit par ailleurs privilégier les missions robotiques remplissant des objectifs d’innovation scientifique, à coûts maîtrisés et autant que possible dans le cadre de coopérations internationales. Bruno Sido a parlé de Curiosity, mais c’est aussi le cas du projet ExoMars : lancé dans un premier temps par l’ESA en partenariat avec la NASA, il est aujourd’hui envisagé avec l’agence russe Roskosmos, à la suite de la défection de la NASA.
Si l’exploration de Mars est prioritaire, ce n’est pas par goût de l’aventure, mais parce que l’on estime que cette planète a pu abriter la vie et qu’une meilleure connaissance de son histoire pourrait être utile à la compréhension de l’évolution de notre propre planète.
Quant à l’exploration habitée de Mars, elle nécessiterait des ruptures technologiques importantes et la fixation d’objectifs intermédiaires. Elle requerrait, surtout, un investissement massif, puisque son coût est estimé à 600 milliards d’euros, voire 800 milliards d’euros, soit de l’ordre de cent fois plus qu’une grosse mission robotisée.
Par le passé, l’exploration habitée a toujours répondu à des objectifs d’abord politiques, plutôt que scientifiques. Les conditions ne nous paraissant pas réunies pour le moment, et les montants financiers en jeu étant exorbitants, nous n’avons pas souhaité formuler de préconisations sur la question du vol habité, au-delà de l’orbite basse, même si, depuis quelques semaines, a beaucoup été évoqué le projet Mars One, 8 000 personnes acceptant d’aller sur Mars sans espoir de retour
Sourires.

Dans l’immédiat, nous remarquons que le plus gros programme souscrit lors de la récente Ministérielle de l’ESA concerne la Station spatiale internationale. La France s’est engagée à financer 20 % de la contribution européenne à la Station. Après 2017, cette contribution consistera à produire un module de service pour la capsule habitée de la NASA, Orion, destinée à voler au-delà de l’orbite basse.
À ce sujet, nous souhaiterions vous interroger plus particulièrement, madame la ministre. Sait-on quels seront les objectifs de ces missions de la NASA auxquelles l’Europe s’est donc engagée à contribuer ? Quel en sera le retour technologique et industriel pour notre continent ?
J’achèverai cette intervention en mettant l’accent sur un enjeu trop méconnu, et qu’il nous a paru urgent de mettre en lumière : celui de la durabilité des activités spatiales, aujourd’hui menacée par la multiplication des déchets.
Le nombre d’objets de plus de dix centimètres en orbite autour de la Terre est estimé à 20 000. Leur quantité s’accroît naturellement en conséquence de réactions en chaîne, ce que les scientifiques désignent sous le nom de syndrome de Kessler.
Le risque de collision n’est pas purement théorique. La première collision répertoriée a eu lieu en 1996. Un satellite militaire français avait alors été affecté. Plus récemment, en 2007, les Chinois ont détruit à l’aide d’un missile l’un de leurs satellites météorologiques, ce qui a engendré environ 2 500 débris de taille supérieure à dix centimètres. Enfin, en 2009, la collision entre un satellite Iridium et un satellite inactif Kosmos a été à l’origine d’environ 2 000 gros débris.
À cet égard, l’ISS procède environ une fois par an à des réajustements de sa trajectoire pour éviter des collisions.
Par ailleurs, il existe un risque de dommages au sol lors des rentrées atmosphériques. Sur ce sujet, notre rapport comprend un intéressant cliché. On estime à une tonne les retombées quotidiennes de débris qui s’évaporent ou non dans l’atmosphère. Le danger est certes minoré par le fait que 70 % de la surface de la Terre est océanique, mais le risque de dommages voire de victimes au sol n’est pas négligeable.
Notre rapport identifie trois types d’actions pour faire face à ces risques.
Premièrement, il convient de promouvoir des règles de conduite renforcées. Des règles sont en vigueur au niveau international, ainsi qu’en France, depuis la loi de 2008 relative aux opérations spatiales. Il existe également une proposition de code de conduite émise par l’Union européenne, et actuellement en cours de négociation à l’échelle internationale.
Des désaccords subsistent entre pays sur la forme – contraignante ou non – que devrait revêtir ce code de bonne conduite. Il serait regrettable d’attendre qu’un accident majeur se produise pour accélérer les négociations.
Pour l’Europe, l’arrivée d’un lanceur à étage supérieur réallumable, point qui a été évoqué par Bruno Sido, constituera une avancée, car cela permettra de désorbiter l’étage supérieur après accomplissement de la mission. Rappelons-le, Ariane 5 est actuellement le seul lanceur commercial qui ne le permet pas.
Deuxièmement, il est indispensable de mettre en place un système européen complet de surveillance de l’espace, fédérant les moyens existants.
À l’heure actuelle, l’Europe dépend des États-Unis, qui possèdent le réseau de surveillance le plus vaste et le mieux distribué au monde. La coopération avec ce pays permet d’éviter un certain nombre de collisions, en déplaçant, comme je l’ai indiqué il y a quelques instants, le véhicule concerné par une alerte, du moins lorsque c’est possible, c’est-à-dire lorsqu’il est encore actif. Toutefois, cette coopération ne garantit pas l’indépendance de l’Europe.
Pour assurer cette autonomie, il faut renouveler le radar Graves et mettre en place des capteurs supplémentaires, afin d’améliorer l’identification de la nature des objets et de leur trajectoire.
L’ESA a lancé un programme de surveillance dit SSA, Space situational awareness, qui, pour l’heure, n’est pas réellement mis en œuvre.
Par ailleurs, notre rapport évoque la surveillance de l’espace lointain. La chute d’une météorite en Russie le 15 février dernier a montré que nous n’avions pas parlé et traité de science-fiction. Il s’agit non seulement de surveiller les objets géocroiseurs, mais aussi de prévoir les variations d’activité du soleil, qui représentent une menace pour l’intégrité de nos satellites et de nos réseaux terrestres.
Troisièmement, et enfin, il faut développer des solutions technologiques innovantes pour le nettoyage des débris. D’après les modèles existants, il suffirait de retirer chaque année de l’ordre de cinq à dix gros débris pour stabiliser le nombre de déchets actuellement en orbite basse. Nous avons même suggéré une solution quelque peu originale : instaurer un prélèvement sur les mises en orbite, afin de financer ces futures opérations de nettoyage.
Il nous est apparu que l’effort accompli dans le domaine de la surveillance de l’espace demeurait insuffisant, les pays membres de l’ESA ayant quelque peu délaissé le programme qu’ils avaient lancé en 2008.
Madame la ministre, c’est la raison pour laquelle nous vous interrogeons sur ce volet de la politique spatiale, qui est la condition sine qua non de tous les autres : quelles sont les actions menées par la France pour promouvoir la durabilité comme un axe majeur de la coopération internationale dans le secteur spatial ?
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l’Europe a récemment accompli un tournant majeur en décidant de développer le lanceur Ariane 6, qui nous paraît le seul garant à long terme de notre autonomie d’accès à l’espace.
Cependant, de nombreux motifs de vigilance demeurent, dans un contexte financier qui impose de faire des choix en application d’une stratégie claire.
Nous sommes heureux que le Sénat puisse aujourd’hui débattre de cette stratégie, et ainsi contribuer à la réflexion sur ce sujet majeur pour notre industrie, notre économie et, au-delà, pour notre rayonnement international. À cet égard, je remercie les sénatrices et sénateurs ici présents, qui ont préféré assister à ce débat plutôt qu’à la diffusion télévisée d’un match de football ! §

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, avant tout, je tiens à féliciter les deux corapporteurs pour leur excellent rapport, qu’ils ont voulu le plus exhaustif possible. En tant que Toulousain, je connais quelque peu les problèmes de l’aérospatiale, et je souligne qu’il s’agit là d’un travail remarquable.

Comme la plupart des grandes aventures humaines, les progrès de l’industrie spatiale ont été permis par la compétition et la coopération.
Si le contexte international ne s’est pas figé au temps de la guerre froide, la politique spatiale conserve un schéma marqué par des grands blocs, États-Unis, Russie et, désormais, Union européenne.
Avec l’entrée en scène de grandes puissances émergentes, comme le Brésil ou l’Inde, aspirant, à juste titre, à leur propre autonomie d’accès à l’espace, la compétition s’est intensifiée. Parallèlement, les trois puissances spatiales historiques se maintiennent dans un contexte budgétaire et financier très différent de celui qui a permis les grandes avancées opérées des années 1950 aux années 1970, et même un peu au-delà.
La politique spatiale s’est rapidement fondée sur la coopération. Elle a permis de favoriser la mutualisation des moyens et de réaliser des projets plus ambitieux, notamment en matière de défense ou de surveillance de l’espace, indispensables à la sécurité de tous.
En France, le programme spatial lancé en 1961 sur l’initiative du général de Gaulle, alors Président de la République, est allé de pair avec la naissance de l’Europe spatiale. Celle-ci a traduit la volonté de s’associer et de développer ensemble des projets de grande envergure plutôt que de travailler de manière isolée. Du reste, on le constate clairement aujourd’hui : nous ne serions pas dans la compétition si nous avions choisi une autre voie que celle-ci !
À la course vers l’accès à l’espace se substitue en grande partie la maîtrise des nouvelles technologies répondant à de nouveaux besoins et à de nombreuses activités civiles dans divers secteurs de l’économie, mais aussi dans des domaines comme la sécurité, les sciences, le climat, la gestion des catastrophes naturelles ou les transports.
Par ailleurs, la politique spatiale participe également à la diffusion de l’information et de la culture, avec le développement du numérique qui permet la démocratisation du savoir et l’accès de tous à ces contenus.
Les technologies spatiales représentent donc un instrument vital de l’aménagement du territoire via l’amélioration de l’accès de tous aux services publics à travers les télé-services, le télétravail ou l’éducation à distance.
Nos sociétés sont partant dépendantes de ces extraordinaires outils qui irriguent les activités de notre vie quotidienne : en conséquence, il convient de conserver une réelle indépendance dans l’accès à l’espace.
Aux nombreuses démonstrations de puissance se substitue progressivement une stratégie économique et scientifique.
Pour illustration, l’homme a marché sur la Lune en 1969. Toutefois, le président des États-Unis, Barack Obama, a pris la décision d’abandonner le programme « Constellation » mis en place par son prédécesseur à la Maison Blanche et qui prévoyait notre retour sur la Lune pour 2020.
De toute évidence, les missions d’exploration de l’espace ne seront pas prioritaires au cours des prochaines années, même si la Chine et l’Inde ont exprimé des prétentions en la matière. On se contentera de l’accord conclu entre les États-Unis et l’Union européenne visant à réaliser un vol non habité autour de la Lune. Cette opération est prévue pour 2017.
Néanmoins, les missions vers Mars – planète dont les récentes découvertes ont confirmé que l’ancien environnement était propice à la vie – se poursuivront grâce à la robotique, et peut-être grâce à ces 8 000 volontaires dont Mme Procaccia nous a rappelé l’existence ! §
Si ces missions ne sont pas prioritaires par rapport aux activités économiques, la course aux technologies spatiales reste effrénée.
Dans ce cadre, l’Europe doit réaffirmer sa position et conserver ses compétences dans une activité à très forte valeur ajoutée, et au titre de laquelle il serait risqué de sous-investir. Cinquante ans après les grandes conquêtes technologiques, l’Europe spatiale a encore devant elle un avenir très long, pour ne pas dire infini.
Seule la coopération permettra à l’Europe de relever ce défi et de conserver sa place au sein du club des grandes puissances spatiales auprès des États-Unis, de la Russie, du Japon et de la Chine.
Des projets tels que le système de navigation Galileo ou le GMES, pour l’observation de la Terre, illustrent les avantages de cette coopération. Galileo nous permettra notamment de nous affranchir du GPS américain et de renforcer notre indépendance. Comme M. Sido l’a souligné il y a quelques instants, cette opération a véritablement été réalisée a minima. Toujours est-il qu’elle se poursuit. §Ce constat n’a pas toujours été dressé avec autant de clarté, et je vous en remercie, monsieur le corapporteur.
De plus, l’engagement de l’Europe autour du lanceur de nouvelle génération Ariane 6 est incontournable face à la concurrence, comme l’a pertinemment rappelé le rapport de l’OPECST.
Cependant, le dernier conseil ministériel de l’Agence spatiale européenne, qui s’est tenu le 22 novembre dernier à Naples, n’a pas clairement tranché entre les deux projets à la fois concurrents et complémentaires, Ariane 6 et Ariane 5 ME.
Il s’agit là d’un enjeu primordial. Arianespace rassemble 60 % des commandes dans le marché du lancement de satellites, prenant de l’avance sur le russe Proton et sur l’américain Space X. Les cinquante-trois lancements consécutifs, accomplis avec succès en 2012 pour Ariane 5, démontrant sa forte fiabilité, ont largement contribué à ce succès. Pourtant, les subventions dont Arianespace bénéficie diminuent avec le temps. Elles se sont réduites de 250 millions d’euros à 100 millions euros en une dizaine d’années. Ces atouts doivent donc faire l’objet de tout le soutien des États membres.
Au sein de l’Union européenne, la France joue un rôle essentiel en raison de ses compétences et de son savoir-faire acquis au long de toutes ces années grâce à l’excellent travail du Centre national d’études spatiales, le CNES, que je tiens à saluer.
Cet organisme emploie 2 400 salariés, dont environ 1 700 à Toulouse, ce qui est incontestablement un atout pour la région Midi-Pyrénées. Celle-ci concentre à elle seule le quart des effectifs européens dans ce domaine. En 2012, le conseil régional a contribué à hauteur de 33, 8 millions d’euros en matière de recherche et d’innovation.
En France, la filière spatiale représente environ 13 000 emplois directs – soit deux fois plus qu’en Allemagne – sur lesquels nous ne pouvons pas faire l’impasse. De surcroît, d’après l’Agence spatiale européenne, ils représentent un nombre d’emplois indirects dix fois plus élevé, d’où l’importance de préserver la compétitivité de cette filière industrielle stratégique et garante de notre souveraineté.
De nombreux projets titanesques continuent à être lancés, malgré le manque de financements. Cette aventure en vaut-elle la chandelle ? Je l’ignore. Néanmoins, au regard des avantages que l’on peut tirer de l’espace, il est incontestable que cette nouvelle dimension nous offre un potentiel économique non négligeable.
L’industrie spatiale européenne est alimentée par un budget annuel de 6, 5 milliards d’euros, soit 10 euros par an pour chaque citoyen européen. Comme le rappelle l’Agence spatiale européenne sur son site internet, le coût de cette politique représente le prix d’un ticket de cinéma par habitant de l’Union européenne et par an. En ramenant à cette échelle les sommes colossales qui sont régulièrement évoquées, on observe que l’effort peut être poursuivi !
À ce prix-là, bien dérisoire au regard des enjeux, le groupe du RDSE, profondément attaché aux progrès de la recherche et de l’innovation, ne peut qu’inviter la France, qui contribue déjà activement dans ce domaine, et l’Europe tout entière à relever pleinement ces défis : en la matière, le retour sur investissement bénéficie immédiatement à l’ensemble de nos concitoyens et, plus encore, aux générations futures. §

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je dois tout d’abord avouer que le sujet qui nous occupe ce soir n’est pas des plus familiers aux écologistes. Nous ne comptons pratiquement, hélas ! aucun spécialiste du domaine spatial. Voilà sans doute pourquoi c’est à moi, membre de la commission des affaires européennes et passionné d’espace depuis ma plus tendre enfance, que revient l’honneur et le plaisir d’intervenir devant vous.

Pourtant, à bien y réfléchir, il s’agit d’un élément essentiel pour nous qui nous fixons comme ligne de conduite de penser global et d’agir local.
L’espace est en effet le lieu le plus absolu de cette pensée à l’échelle globale – et, ajouterais-je, inscrite dans le temps long – que nous appelons de nos vœux.
Nous nous efforçons d’agir en cohérence avec notre souci de préserver la planète, ses ressources, son équilibre et ses dynamiques.
De ce point de vue, l’espace nous donne à voir un spectacle singulier : celui d’un globe fini, fragile, isolé… et finalement pas tant que cela.
L’espace nous fait prendre conscience de notre propre finitude et en même temps, par la fascination qu’il exerce, nous fait rêver et nous aide à comprendre que ces limites ne demandent qu’à être surmontées.
En disant cela, je pense notamment à un article publié en une du journal Le Monde le 21 mars dernier. On y voyait un ovale coloré de multiples taches aux tons bleus et ocrés. Il s’agissait d’une image représentant l’univers à son stade le plus jeune jamais observé, soit 380 000 ans. C’était il y a 13, 8 milliards d’années.
Ce cliché offre aux chercheurs du monde entier une gigantesque mine d’informations à analyser. Il a été rendu possible grâce à la politique spatiale européenne ; ce sont en effet des scientifiques travaillant pour l’ESA, l’Agence spatiale européenne, qui l’ont réalisé à partir des données transmises par le satellite Planck. Il pourrait justifier à lui seul, je crois, l’existence de cette politique.
Elle connaît pourtant actuellement une période difficile, en raison, d’abord, du contexte économique et, ensuite, du contexte institutionnel.
Sur le plan économique, elle risque de pâtir, comme toutes les autres politiques, des restrictions budgétaires engagées dans toute l’Europe. Quand les Américains consacrent 48 milliards de dollars à l’espace, les Européens n’en consacrent que 6.5 milliards.
Et si cette politique ne représente « que » 35 000 emplois à travers l’Europe, ses retombées sont difficilement quantifiables. Elles vont des satellites météorologiques à l’aide à la navigation, en passant par les études qu’une telle politique rend possibles en matière d’environnement ou de changement climatique.
La concurrence est vive, en provenance des États-Unis mais aussi de la Russie, de la Chine ou de l’Inde, pays qui cherchent à engager ou à renouveler une politique de prestige et de puissance peu commune.
Sur le plan institutionnel, nous sommes face à une redéfinition, au moins partielle, de la politique spatiale européenne et de son organisation.
Depuis 1975, l’ESA, qui fonctionne sur un mode intergouvernemental, est l’organe européen de cette politique, soutenue pour l’essentiel par deux États membres, la France et l’Allemagne.
Mais depuis le traité de Lisbonne et l’article 189 du traité sur le fonctionnement de l’Union, cette politique est devenue un domaine de compétences partagé entre l’Union et les États membres. Ce n’est pas un problème en soi, car des programmes comme Galileo ou GMES, Global Monitoring for Environment and Security, ont besoin de nouveaux financements, d’une impulsion permanente et d’une collaboration toujours plus forte.
Cependant, des ajustements sont nécessaires, ne serait-ce que pour éviter que les industries des deux pays que je citais à l’instant ne soient dépossédées de leurs outils, sans que de nouvelles dynamiques se mettent en place par ailleurs.
Parmi ces outils, ces richesses, ces moyens dont disposent la France et l’Europe, je pense en particulier au centre spatial guyanais. C’est un dispositif essentiel de cette politique en raison de sa localisation géographique, au niveau de l’équateur. De nulle part ailleurs aujourd’hui la mise en orbite de satellites géostationnaires n’est aussi fiable que depuis Kourou, quels que soient le type de lanceurs ou l’altitude visée, ce qui explique la très forte compétitivité du site.
Les écologistes soutiennent l’existence d’une politique spatiale européenne ambitieuse.

Mais il ne faudrait pas que son développement ignore certains principes.
Le premier de ces principes, c’est l’équité entre les diverses politiques, sciences ou disciplines dans l’accès aux financements publics. Aujourd’hui, le Parlement européen semble encore déterminé à faire amender le projet de budget présenté par les États membres. Des programmes comme GMES, devenu aujourd’hui Copernicus et dont certaines composantes nous plaisent plus que d’autres, ne doivent pas être les seuls à être préservés dans le programme de recherche et d’innovation de l’Union européenne à l’horizon 2020. Bien d’autres domaines, tout aussi fondamentaux, méritent également d’être sanctuarisés ou développés. On ne comprendrait pas que la France oublie cela en cherchant à favoriser sa propre industrie.
Le deuxième principe, c’est la « soutenabilité ». L’espace est une réalité durable. On peut en tout cas souhaiter qu’il le reste ! Mais la politique spatiale ne peut être durable sans, par exemple, une réflexion sur la gestion des satellites qui ont cessé d’être opérationnels. On compte environ 20 000 objets de plus d’une dizaine de centimètres placés en orbite autour de la Terre. Cela pose des questions évidentes en termes de sécurité et de pollution de l’espace. Une politique de surveillance de l’espace et des objets spatiaux est aujourd’hui nécessaire. La France et l’Allemagne l’appellent de leurs vœux et la Commission européenne vient de faire une proposition sur ce sujet, que je rapporterai prochainement devant la commission des affaires européennes.
Par ailleurs, le centre spatial de Kourou dont je rappelais l’importance stratégique pose lui-même des problèmes environnementaux en Guyane. Pour être durable, la politique spatiale européenne doit prendre pleinement en compte ces problématiques.
Enfin, et en guise de conclusion, le dernier principe renvoie à l’utilité citoyenne et pacifique de cette politique. La politique spatiale peut être d’une immense utilité pour la communauté. Mais elle peut aussi se révéler particulièrement dangereuse, si les grands acteurs de cette planète se mettent à militariser l’espace, voire à le transformer en arsenal. L’usage de satellites dans des buts sécuritaires ou militaires est évidemment déjà courant – je rappelle que le GPS que nous utilisons tous est un système de géolocalisation militaire américain –, mais nous avons su jusqu’à présent nous prémunir de toute dérive d’usage en la matière.
Veillons donc à ne pas courir le risque de voir de telles dérives se développer à l’avenir ! §

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite en premier lieu et à mon tour remercier les rapporteurs Mme Catherine Procaccia et M. Bruno Sido pour la qualité et la clarté de ce rapport de l’OPECST, au moment où notre industrie spatiale européenne doit faire des choix stratégiques majeurs. Ce rapport est tout à fait éclairant.
Alors que la France et l’ensemble de l’Union européenne sont à la recherche d’un nouveau souffle de croissance, et en particulier de croissance industrielle, l’industrie spatiale française et européenne démontre chaque jour son excellence, sa productivité et l’étendue des compétences technologiques de nos ingénieurs.
C’est un sujet de fierté, en particulier pour notre pays. J’en veux pour simple témoignage l’attention et quasiment l’émerveillement de lycéens des Yvelines, venus visiter le site Astrium des Mureaux la semaine dernière, dans le cadre de la semaine de l’industrie. C’est également un message fort sur l’Europe et ses capacités.
Mais l’industrie spatiale n’en est qu’à ses débuts, et les perspectives de croissance liées aux applications et aux services satellitaires en particulier laissent entrevoir des sources de développement économique considérables, à très forte valeur ajoutée pour les États qui s’en empareront. La France doit en être.
La France et l’Europe occupent l’un des premiers rangs mondiaux dans l’industrie spatiale grâce à la clairvoyance et à la pertinence de la vision stratégique de nos prédécesseurs, grâce à la maîtrise de l’ensemble des compétences et à une industrie redoutablement performante. L’industrie française compte 12 000 employés, soit un tiers des effectifs européens, et réalise 50 % du chiffre d’affaires de l’industrie européenne. Notre industrie spatiale française est précieuse.
Les groupes tels que Thales, Astrium, Safran sont des fleurons industriels qui ont créé de véritables filières de production, en collaboration avec des fournisseurs performants de haute technologie et qui sont désormais accompagnés par des filières entières d’activités, particulièrement dynamiques. Autant d’opportunités pour le développement d’entreprises françaises, y compris de PME.
Aujourd’hui, l’observation de la Terre, le renseignement, la météorologie, la géolocalisation et, bien sûr, les télécommunications sont les principaux champs de recherche et d’exploitation commerciale. Ils sont d’ores et déjà créateurs d’emplois, de gains de productivité, d’efficacité civile, mais aussi militaire, naturellement, pour les États qui les maîtrisent. Le champ des applications est très vaste et, je le pense, n’a été qu’à peine effleuré.
La géolocalisation, par exemple, presque familière désormais à tous les conducteurs ou tous les propriétaires de smartphones, est à l’aube de son exploitation. Son utilisation en marketing mobile, par exemple, ouvre d’immenses perspectives. Ainsi, le chiffre d’affaires estimé dans un rapport à 58 milliards d’euros en 2010 devrait atteindre 165 milliards d’euros en 2020, soit un triplement !
L’observation de la Terre offre, quant à elle, des champs d’application infinis en termes d’optimisation de nos modes de vie. Ainsi, le rapport de l’OCDE intitulé « L’espace à l’horizon 2030 » indique-t-il, par exemple, qu’une amélioration des prévisions météorologiques d’un seul degré Fahrenheit permettrait aux producteurs d’énergie d’économiser un milliard de dollars par an !
Que dire, également, de l’utilisation satellitaire pour l’agriculture, si chère à mon cœur ! Une pratique raisonnée, assistée par une observation satellitaire fine de chaque parcelle agricole réduit de façon considérable l’utilisation d’eau, l’apport d’engrais, le recours à des fongicides, des herbicides ou des insecticides, ce qui devrait faire plaisir à nos amis écologistes.
Au-delà de l’enjeu des seules perspectives de croissance économique qu’offrent toutes ces applications commerciales satellitaires, l’espace représente d’abord et avant tout un enjeu de souveraineté.
L’indépendance d’accès aux informations satellitaires est aussi stratégique que notre autonomie énergétique ou alimentaire. Nous devons bénéficier d’un accès souverain aux informations militaires, d’observations et d’analyse. Cela semble évident, mais il est nécessaire de le réaffirmer en cette période budgétaire difficile. Je ne reviens pas sur le caractère décisif de ces capacités au cours des opérations extérieures de la France, y compris dans l’actualité récente.
Au-delà du domaine militaire, ces informations nourrissent la puissance de notre pays, son influence géopolitique et son rayonnement, au travers également d’utilisations culturelles ou humanitaires.
En matière culturelle, par exemple, la promotion de notre langue, la diffusion de la culture européenne, la coopération universitaire, auxquels vous devez être sensible, madame la ministre, ainsi que la diffusion des médias et de l’information sont des enjeux qui vont au-delà de la seule croissance économique.
Même la tradition humaniste de notre pays peut s’exprimer grâce à l’exploitation de l’espace. Je pense bien sûr à la charte « espace et catastrophes majeures », créée voici presque quinze ans par l’ESA et le CNES, et qui permet de coordonner les secours de façon efficace en cas de catastrophes sismiques, météorologiques, ou environnementales. Votre rapport le souligne d’ailleurs fort bien, et fait état de plus de trois cents applications opérationnelles de cette charte dans le monde en dix ans. Le secours aux sinistrés d’Haïti a probablement été une opération emblématique en la matière.
Compte tenu de ces potentiels de croissance presque infinis, compte tenu, également, de l’enjeu géopolitique des applications satellitaires dans tous les domaines, stratégiques, industriels, militaires et commerciaux, la France a le devoir impératif de maintenir sa souveraineté au cœur de l’Europe et avec elle.
Mais cette souveraineté nationale a bien sûr un corollaire : notre souveraineté d’accès à l’espace.
Cette souveraineté commence par notre autonomie à disposer de lanceurs performants, fiables, évolutifs et dont l’économie globale est supportable par les États européens, y compris en ces périodes de crise.
Aussi, reconnaître le maintien de l’autonomie d’accès à l’espace comme un objectif européen prioritaire, en recourant à nos propres lanceurs européens, est absolument essentiel. Nous devons partager cet objectif avec tous les pays membres et contributeurs, y compris avec nos amis allemands.
Bien sûr, la France et l’Europe occupent aujourd’hui une place unique dans l’univers des lanceurs, et je veux dire notre fierté à chaque lancement, d’Ariane en particulier, vous me pardonnerez ce chauvinisme.
Cependant, la concurrence mondiale s’active de façon spectaculaire, engageant des moyens bien supérieurs aux nôtres, comme l’a indiqué mon collègue Bruno Sido il y a quelques instants. Aux États-Unis, avec des acteurs soutenus par la NASA – je pense bien entendu à SpaceX –, mais aussi en Russie, au Japon, en Chine et demain en Inde, sans oublier le Brésil. Tout cela est parfaitement décrit dans votre rapport.
Leader des lanceurs commerciaux, nous devons consolider nos positions, les protéger et pour cela optimiser chaque euro investi, sans aucune déperdition. En ce sens, chacune des recommandations de ce rapport est essentielle.
Réorganiser notre gouvernance européenne spatiale, clarifier les objectifs de notre politique – c’est essentiel –, soutenir une exploration spatiale à coûts limités, créer des filières, surveiller les débris spatiaux : ce sont là des recommandations fortes et tout à fait pertinentes.
Nous devons, en France en particulier, veiller à ce que le partenariat entre la maîtrise d’œuvre des projets de développement portés par le CNES et la maîtrise d’œuvre industrielle portée par Astrium puisse continuer à se renforcer, dans l’intérêt général. Comme cela a été souligné précédemment, l’industrie doit être directement intégrée aux décisions stratégiques.
Nous devons également prendre conscience des conséquences industrielles locales des choix stratégiques retenus par l’Europe et défendus pour la France par le CNES.
Le choix, par exemple, d’un lanceur Ariane 6 à propergols solides, ou PPH, a des conséquences en matière d’organisation industrielle sur les sites historiques d’Astrium ; je pense naturellement au site d’intégration des Mureaux. Il nous faut anticiper les conséquences de ces choix, afin d’opérer une transformation des sites industriels pour y maintenir activité, emplois et compétences.
Les pouvoirs publics ont aussi une responsabilité majeure en ce domaine pour toujours préférer la pérennité d’une excellence industrielle au redressement économique.
Enfin, considérant l’ensemble des recommandations de ce rapport d’information, je souhaite apporter tout mon soutien à celle qui est relative à la nécessité de maintenir les budgets spatiaux malgré la crise.
En effet, ces budgets, publics et militaires, sont à la fois les ferments de la croissance et le gage de notre indépendance sur la scène internationale. La dépense spatiale publique est, je le répète, cruciale pour l’avenir de notre économie, notamment eu égard à son puissant effet multiplicateur : « 1 euro investi dans l’industrie spatiale crée 20 euros de richesse. »
Les crédits du programme « Recherche spatiale » prévus dans la loi de finances pour 2013 s’élèvent à 1, 143 milliard d’euros, soit une progression de 1 % par rapport à la loi de finances pour 2012. Nous pouvons nous réjouir de cette légère évolution, tout en remarquant que cette stabilité globale ne traduit peut-être pas encore assez le caractère prioritaire de la recherche spatiale.
Par ailleurs, je veux évoquer ici l’impact significatif du programme d’investissements d’avenir mis en place par le gouvernement précédent. Ce programme, au travers des dépenses ciblées destinées à améliorer la compétitivité de notre industrie, a ainsi alloué 600 millions d’euros à la recherche dans le domaine spatial.
De notre vision volontariste, partagée sur les différentes travées de cet hémicycle, à soutenir les efforts du secteur spatial dépendront nos capacités à créer de la valeur ajoutée industrielle, technologique et de la créativité technique et commerciale pour les prochaines générations.
Je salue en ce sens les résultats obtenus lors du conseil interministériel de l’ESA à Naples : concernant les lanceurs, le développement d’Ariane 5 ME et la décision de lancer les études pour Ariane 6 ont été obtenus au travers d’une mutualisation des dépenses. Cela permet aux industriels de s’organiser pour préparer la rupture technologique souhaitée et, en même temps, de préserver les compétences en matière de haute technologie présentes à ce jour sur les sites de recherche.
Madame la ministre, le maintien de ces compétences constitue un véritable enjeu, car leur déperdition serait malheureusement irrémédiable. Aussi avons-nous le devoir de soutenir avec force le ministère de la défense pour le maintien des budgets militaires consacrés à la recherche spatiale.
À ce sujet, il convient de préciser que le retard pris par le Livre blanc a des conséquences immédiates sur le maintien des moyens accordés dès 2013 à des sites mixtes, civils et militaires, sur lesquels les forces intellectuelles sont mutualisées. L’activité militaire peut représenter, dans certains sites industriels, deux tiers de l’activité – le site des Mureaux n’est pas le seul à être concerné. Le ralentissement de cette activité aurait des effets immédiats sur les capacités de développement de la partie civile.
Enfin, la dispersion des budgets entre les ministères et sur des lignes non agrégées est probablement un frein qui nuit, ainsi que l’a souligné tout à l'heure l’un de nos collègues, à une véritable vision globale de la politique spatiale, laquelle est trop peu souvent soumise à l’examen du Parlement.
Bien sûr, le maintien de ces budgets est difficile à expliquer aux Français et difficile à obtenir, je l’imagine, en cette période de crise économique, qui touche non seulement la France, mais aussi toute l’Europe. Aussi, l’idée de réintroduire l’espace dans l’intitulé d’un ministère est loin d’être anecdotique.
(Très bien ! sur le banc des commissions.) Cela constituerait en effet un sacré choc !
Sourires.

Valoriser l’utilité de l’espace auprès du grand public et expliquer la nécessité de protéger notre souveraineté, voilà qui est fondamental pour que les Français comprennent la nécessité de réaliser des efforts budgétaires. Peut-être devrions-nous envisager – je le dis sous forme de boutade ! – de créer un choc des consciences, en organisant un événement national ou européen, qui pourrait s’intituler : « Une heure sans l’espace », une heure pendant laquelle nous couperions toutes les applications satellitaires utiles dans la vie quotidienne ! §
Pour conclure, je veux, une nouvelle fois, saluer le travail réalisé par les coauteurs de ce rapport d’information, en m’associant pleinement aux recommandations qui y sont formulées, ainsi que l’action menée parallèlement par le groupe des parlementaires pour l’espace, que préside notre collègue sénateur de Haute-Garonne Bertrand Auban. Ces travaux conduiront, de toute évidence, le Gouvernement et le Parlement à la clairvoyance et à la sagesse dont ont fait preuve nos aînés.
Applaudissements.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens d’emblée à saluer le travail très approfondi que nos collègues corapporteurs ont réalisé.
Dans le contexte actuel de crise économique, certains peuvent parfois s’interroger sur l’opportunité de continuer à investir dans l’activité spatiale. En effet, la complexité du domaine spatial peut donner l’impression que des budgets très lourds sont en jeu, pour des retours sur investissement peu connus du grand public.
Pourtant, non seulement l’activité spatiale résiste bien à la crise, tirée qu’elle est par les demandes croissantes de nos concitoyens, notamment en matière de télécommunications, mais en outre notre industrie européenne prend toute sa part dans cette dynamique, qui crée de nombreux emplois : 16 000 emplois en France dans le domaine spatial, dont 12 000 dans l’industrie.
L’espace constitue un véritable moteur de compétitivité et de croissance : les activités spatiales ont, dans l’économie, un effet multiplicateur important de l’investissement initial, sans compter les retours, plus difficiles à quantifier et à forte valeur ajoutée sociétale, tels que l’attrait des jeunes pour les études scientifiques, par exemple. J’ai d’ailleurs appris cet après-midi que Jean-Yves Le Gall, avait obtenu, au cours de ses études, une bourse du Centre national d’études spatiales !
Cette compétitivité de l’activité spatiale européenne trouve ses sources dans l’engagement résolu de l’Europe depuis plus de quarante ans à développer une stratégie cohérente et volontariste. Cette politique, qui s’est construite par étapes successives, permet aujourd’hui à l’Europe d’être en excellente position mondiale.
Dès 1975, l’Europe a su fédérer ses forces au travers de l’Agence spatiale européenne pour conquérir et garantir notre accès à l’espace. Elle a su mettre en place un programme scientifique permettant de maîtriser les technologies spatiales et d’explorer des applications innovantes, au service de nos concitoyens.
Quand certaines de ces applications se sont révélées pertinentes, l’Europe a su s’organiser pour les mettre en œuvre : on pourrait citer EUMETSAT, dans le domaine de la météorologie, ou encore EUTELSAT, dans le domaine des télécommunications, qui contribue à la couverture numérique du territoire en très haut débit.
Ce processus se poursuit aujourd’hui au sein de l’Union Européenne, en complémentarité avec l’Agence spatiale européenne et les États membres.
À cet égard, on peut citer le programme Galileo, système de positionnement des satellites, qui garantira l’autonomie de l’Union européenne, notamment par rapport au système GPS américain. On peut aussi évoquer le programme GMES, qui va doter l’Europe d’une capacité d’observation de la Terre, notamment dans le domaine environnemental.
Ainsi, l’Europe se positionne comme un acteur majeur dans le monde.
Si l’Europe spatiale est une réussite incontestable, elle doit toutefois aujourd’hui faire face à une concurrence croissante, avec l’émergence de nouveaux acteurs privés, mais aussi publics, en particulier l’Inde et la Chine, qui ont rejoint les États-Unis et la Russie au rang des acteurs incontournables dans le domaine de l’activité spatiale.
Face à ces nouveaux défis, et parce qu’une politique spatiale se pilote nécessairement sur le long terme, il est indispensable d’anticiper et de créer dès à présent les conditions nécessaires au maintien de la position européenne dans le monde.
Si vous me permettez de développer ce point, on peut identifier quatre conditions majeures.
La première de ces conditions tient évidemment aux moyens et à la part du budget que nous consacrons, au niveau européen comme au niveau national, à la politique spatiale.
Dans un contexte budgétaire extrêmement difficile, nous pouvons nous féliciter des orientations prises par le Gouvernement, et singulièrement le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, dans le cadre du budget pour 2013. Cela s’est traduit notamment par une augmentation de 3, 7 % de la contribution française à l’Agence spatiale européenne, soit 29 millions d’euros supplémentaires sur une participation française de 799 millions d’euros, le budget global de l’ESA s’établissant à environ 4 milliards d’euros.
Cette contribution permet ainsi de garantir les engagements souscrits par la France et de participer à l’apurement de la dette de l’Agence spatiale européenne, conformément aux engagements pris par la France en 2008.
La deuxième des conditions est de faire évoluer nos lanceurs pour les adapter aux évolutions du marché commercial et institutionnel ainsi que pérenniser notre autonomie en matière d’accès à l’espace.
À cet égard, nous pouvons nous féliciter de la décision du conseil interministériel de l’Agence spatiale européenne, en novembre dernier, à Naples, qui marque l’acte de naissance d’Ariane 6.
Madame la ministre, vous avez réussi à convaincre certains autres États membres, ce dont nous pouvons nous réjouir. Cette nouvelle génération de lanceurs va, par ailleurs, permettre d’optimiser les coûts d’exploitation, tout en préservant les emplois, et garantir notre autonomie en matière d’accès à l’espace.
La troisième condition, à laquelle souscrit l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques - n’étant pas membre de la commission des affaires économiques, c’est de mon bureau que j’ai suivi cet après-midi ses travaux -, est la nécessité d’améliorer notre gouvernance en matière de politique spatiale.
Forts de notre histoire européenne, de nombreux acteurs interviennent dans la politique spatiale européenne.
Ce sont tout d’abord les États membres, au premier rang desquels la France. Premier pays à avoir développé une politique spatiale et à s’être doté d’une agence, le Centre national d’études spatiales, créé en 1961, la France consacre 2 milliards d’euros à cette politique - soit 31 euros par habitant et par an -, dont 799 millions d’euros pour l’Agence spatiale européenne. Le CNES est aussi le premier actionnaire d’Arianespace.
Il faut citer ensuite l’Agence spatiale européenne, créée en 1975, et l’Union européenne, qui dispose d’une compétence propre en la matière depuis 2009.
Il semble aujourd’hui nécessaire de réinterroger cette organisation, afin d’éviter autant que possible que le grand nombre d’acteurs n’entraîne une dispersion des forces et, au final, des moyens.
Concernant la question de la gouvernance, il semble aussi tout à fait essentiel d’associer davantage le monde industriel, en vue d’établir un programme spatial européen pleinement partagé par tous.
Ce dernier point me semble rejoindre la quatrième des conditions, puisqu’il s’agit d’aider l’industrie européenne et française à rester compétitive. Cela doit notamment passer, me semble-t-il, par les investissements d’avenir, qui permettent des financements ciblés répondant à des objectifs stratégiques partagés. D’ailleurs, même si nous devons conserver une politique spatiale française, car elle constitue l’élément moteur de la politique spatiale européenne, ces investissements devraient sans doute à terme être davantage portés par le budget de l’Union européenne.
La filière spatiale parvient bien souvent à réunir ce que l’on a trop tendance à séparer : les grands groupes industriels, les PME, les entreprises de taille intermédiaire et les laboratoires publics. En somme, elle réussit à réunir la recherche fondamentale et l’innovation appliquée à des besoins industriels. Vous êtes, je le sais, madame la ministre, aussi particulièrement sensible et attentive à de telles initiatives, que vous avez accompagnées sur le territoire grenoblois en particulier et dans l’Isère en général, comme je peux en témoigner pour être élu dans ce département.
C’est d’ailleurs en cette qualité que je me permets de citer l’exemple de l’entreprise Air Liquide, mondialement connue et dont le site isérois situé dans l’agglomération grenobloise est né, dans les années soixante, d’une collaboration avec le CNRS de Grenoble.
Par la conception d’oxygène et d’hydrogène liquides, Air Liquide a fourni, dès 1967, le ministère de la défense, puis le CNES. Depuis 1973, le site Air Liquide, en Isère, est étroitement lié à Ariane, puisque l’entreprise assure la propulsion des différents lanceurs.
Les technologies liées à l’hydrogène développées par Air Liquide, qui ont trouvé leurs origines dans la filière spatiale, permettent aujourd’hui des innovations remarquables. Ainsi, l’entreprise développe des véhicules électriques à l’hydrogène et a pour ambition de déployer une filière de l’hydro-énergie en Europe, s’affirmant ainsi comme un acteur clé de la transition énergétique.
Cet exemple est une nouvelle preuve que l’activité spatiale sait essaimer et contribuer au dynamisme de notre activité économique par la recherche et l’innovation qu’elle développe. Il montre aussi que c’est la collaboration entre le public et le privé qui crée l’innovation ; au bout du compte, c’est cette collaboration qui contribue et contribuera au redressement économique de notre pays. Tel est bien, madame le ministre, l’esprit du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi présenté par le Gouvernement, qui prévoit notamment le développement de trois CEA Tech en région.
Dans le spatial comme dans l’aéronautique, l’Europe a su se montrer exemplaire : en se fédérant autour d’objectifs partagés, elle est devenue compétitive et s’est affirmée comme un acteur incontournable dans le monde. Nos deux collègues Jean-Jacques Mirassou et Jean-Pierre Plancade, élus en Midi-Pyrénées, en savent quelque chose.
À l’heure où l’Europe est souvent sinon décriée, tout au moins critiquée, à l’heure où les États membres doivent faire face à un contexte économique et social difficile, la politique spatiale européenne nous montre combien il est indispensable de rester solidaires et d’aller encore plus loin dans le processus d’intégration européenne.
Applaudissements.

Madame la présidente, madame la ministre, madame, monsieur les corapporteurs, mes chers collègues, ce débat sur les enjeux et les perspectives de la politique spatiale européenne tombe à point nommé, à la suite de la réunion des ministres chargés de l’espace des États membres de l’Agence spatiale européenne. Lors de cette réunion qui s’est tenue à Naples au mois de novembre dernier, les États engagés dans la réalisation de la politique spatiale européenne ont tenté de définir les axes et les contours de cette politique pour la décennie qui vient. Ils ont pris un certain nombre de décisions attendues tant par les acteurs de l’industrie spatiale que par les usagers, qu’ils soient institutionnels ou commerciaux.
En tant que parlementaires qui se préoccupent de la défense des intérêts nationaux, nous nous devons d’être attentifs à la politique menée par notre pays dans ce secteur crucial pour l’avenir de la planète tout entière. À cet égard, les enjeux de la réunion de Naples ont été très bien exposés dans l’excellent rapport que nos collègues Catherine Procaccia et Bruno Sido ont publié au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Dans ce rapport, qui justifie notre présent débat, nos collègues ont également fait d’utiles recommandations sur les perspectives du secteur spatial, dont la réunion de Naples a montré qu’il était à la croisée des chemins face aux nouveaux défis qu’il devrait relever au cours des dix prochaines années.
En effet, la situation a considérablement changé depuis la création de l’ESA, il y a maintenant près de quarante ans. De nouveaux acteurs, publics et privés, sont apparus et, avec eux, une concurrence qui s’exacerbe d’année en année. Ce sont aussi les modes de fonctionnement de l’Europe spatiale qui ont grandement évolué, en particulier depuis que le traité de Lisbonne, en 2009, a attribué à l’Union européenne une compétence dans ce domaine.
Ces données sont bien connues des spécialistes de la question, dont je ne suis pas, mais je les rappelle pour situer le contexte dans lequel évolue désormais l’Europe spatiale ; c’est notamment en fonction de ces données que doivent être prises les décisions lors des sommets européens consacrés à la politique spatiale.
Toutefois, d’autres facteurs entrent aussi en ligne de compte. Car si la politique spatiale européenne est aujourd’hui à la croisée des chemins, c’est que, fondamentalement, elle n’a pas trouvé l’équilibre entre la nécessaire réponse aux besoins humains, économiques et industriels et la recherche d’une rentabilité financière fondée sur la seule réduction des coûts de production.
Le conseil interministériel de l’ESA a tenté de définir les besoins de l’Europe en matière de lanceurs sur une décennie. De fait, l’Europe est confrontée à un questionnement qui doit déboucher sur des options décisives pour l’avenir : il lui faut soit se plier à une logique purement commerciale de marchandisation des lancements, soit considérer les moyens de lancement comme une dimension stratégique de sa politique spatiale. Aujourd’hui, on doit malheureusement constater que la recherche d’une rentabilité financière rapide prime la réponse aux besoins humains. À cet égard, la réunion de Naples a été tout à fait significative de l’état d’esprit actuel des responsables européens.
Pourtant, il faut bien que des décisions fortes soient prises au niveau européen pour préserver la capacité de l’Europe à assurer son accès à l’espace. Dans cette perspective, la question des lanceurs est déterminante. C’est la raison pour laquelle la conférence interministérielle de l’ESA s’était fixé comme objectif de définir les grands axes des architectures de lanceurs, notamment sous l’angle de la propulsion, et de réduire les coûts de lancement d’environ 20 % en diminuant de façon drastique les financements publics, ce qui conduit à se plier à une logique commerciale dans le cadre d’une concurrence exacerbée. Les choix technologiques sont alors opérés en fonction de cette seule logique.
Je relève avec satisfaction que, dans leur rapport, nos collègues Catherine Procaccia et Bruno Sido ont fait l’intéressante proposition d’instaurer dans le domaine spatial un principe de réciprocité avec nos partenaires non européens, afin de lutter contre la fermeture par certains d’entre eux de leur marché. Reste que la logique purement commerciale choisie par les responsables européens ne permettra pas d’inverser la tendance : il faudrait admettre qu’il est décisif pour l’Europe d’avoir recours à ses propres lanceurs pour assurer le maintien de son autonomie d’accès à l’espace.
Certes, en décidant le lancement du programme Ariane 6, l’ESA a fait le choix judicieux de remplacer les vieux Soyouz par une solution européenne. Toutefois, on peut estimer qu’elle n’a pas fait preuve de beaucoup de détermination, puisqu’elle a timidement limité à deux ans le développement d’Ariane 5 ME avec ses moteurs Vinci et Vulcain. Souhaitons que, lors de sa prochaine conférence interministérielle, prévue en 2014, l’ESA décide enfin de donner une suite positive à Ariane 6 et à Ariane 5 ME !
À l’arrière-plan de ces aspects économiques et technologiques se pose une question fondamentale : la nécessaire clarification de la gouvernance de la politique spatiale européenne. À ce sujet, le groupe CRC souscrit à la plupart des recommandations formulées dans le rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. En particulier, il soutient la proposition d’établir un véritable programme spatial de l’Union européenne à l’horizon de dix ans, dans le cadre duquel l’ESA et les agences spatiales nationales seraient les interlocuteurs privilégiés de la Commission de Bruxelles.
Pour notre part, nous considérons qu’il est nécessaire, afin que l’Union européenne puisse retrouver une politique spatiale ambitieuse, que les agences reprennent la main sur les industriels privés et se dotent de règles de solidarité. Il faut également favoriser les rapprochements entre l’ESA et les agences nationales, afin d’améliorer leur coopération ; nous pourrons ainsi, conformément aux préconisations du rapport, éviter les doublons et mieux utiliser les compétences réparties sur l’ensemble du territoire européen.
Chez nous, il faut que le CNES retrouve son rôle de maître d’œuvre des programmes spatiaux et qu’il coopère plus étroitement avec l’ESA, dont le fonctionnement et les processus de prise de décision doivent être plus transparents ; il faudrait en particulier en rationaliser les règles de fonctionnement et établir une répartition plus équitable des retombées économiques pour chaque pays.
Pour ma part, j’estime qu’afin de pallier la diminution des investissements publics, il faut exiger des industriels du secteur une participation accrue des capitaux privés à la relance de la politique spatiale européenne. C’est une question primordiale pour assurer l’avenir commun de nos sociétés. C’est aussi une exigence de justice et d’intérêt général pour des entreprises qui ont largement fait profiter leurs actionnaires d’activités très rentables. Si les entreprises concernées n’acceptaient pas cette responsabilisation sociale, l’État devrait envisager d’entrer dans leur capital ; après tout, c’est bien ce qui s’est produit dans le secteur bancaire de certains pays qui ne sont pas forcément les moins libéraux !
S’agissant enfin de quelques questions plus précises, j’estime, compte tenu de la position que je viens de présenter, qu’il faut maintenir la part de l’État français dans le capital d’EADS, nous opposer fermement à l’acquisition de l’entreprise Avio par l’américain General Electric et favoriser sans ambiguïté l’engagement européen sur une gamme pérenne de lanceurs fondée sur Vega, Ariane 6 et Ariane 5 ME.
Telles sont, madame la ministre, mes chers collègues, les observations que je souhaitais présenter, au nom du groupe CRC, sur la politique spatiale européenne.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC, du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens à féliciter les deux corapporteurs pour la qualité de leur travail.
Madame la ministre, je ne suis pas un grand spécialiste du domaine spatial, mais je me souviens qu’à l’automne 2009, lors d’un débat préalable à un Conseil européen, j’avais exhorté l’un de vos prédécesseurs à faire preuve d’une plus grande audace en matière de recherche spatiale. C’est avec beaucoup de regret que je me vois contraint, plus de trois ans plus tard, à renouveler mes encouragements dans le sens d’un accroissement massif de nos efforts en la matière.
Une chose a changé depuis octobre 2009 : la crise a consommé toutes nos marges de manœuvre budgétaires, atteint nos rêves spatiaux et ralenti nos perspectives de reprise économique. Dans ce contexte, nous voyons apparaître un réflexe somme toute bien naturel : la recherche spatiale serait une dépense somptuaire, un luxe ou une frivolité, l’apanage d’une puissance qui se veut encore grande, du moins plus grande que le bœuf. D’un coup, la recherche spatiale n’est plus une priorité ; bien au contraire, en période de tension budgétaire, c’est un poste qu’il faudrait rogner, redéployer ou pudiquement « stabiliser » en attendant des jours meilleurs.
C’est ainsi que l’administration Obama a décidé, en 2011, le gel du budget de la NASA pour cinq ans. De même, l’Espagne et la Grèce ont suspendu leur participation au financement de l’ESA jusqu’à nouvel ordre. Pour autant, les conséquences opérationnelles et stratégiques d’un gel budgétaire sont différentes lorsqu’il est question de plus de 17 milliards de dollars, budget annuel de la NASA, et de 4 milliards d’euros, budget annuel de l’ESA.
J’observe qu’on tient le même type de raisonnement en matière de défense : à quoi bon nous défendre, à quoi bon entretenir nos forces de dissuasion si nous sommes en paix ? Pourquoi consacrer tant de milliards d’euros chaque année à des politiques qui passent, au café du commerce, pour des dépenses d’un autre temps ? Pourquoi ne pas consacrer ces sommes à l’éducation, qui est fondamentale, ou à l’investissement productif, dépenses sans doute plus utiles en temps de crise ?
Ces raisonnements sont le voile de notre ignorance. La vérité, madame la ministre, c’est que nous n’avons plus foi dans le progrès ni dans l’avenir. Aussi le moindre denier versé à la recherche spatiale fait-il immédiatement figure de dépense de science-fiction pour scientifiques et universitaires.
Mes chers collègues, je vais vous raconter une histoire qui devrait vous inciter à méditer sur la recherche spatiale. Il s’agit d’un vieux conte persan intitulé Les trois princes de Serendip. Ces princes, partis à la recherche d’un chameau, étant accusés du vol de l’animal, parviennent à force de sagacité à conserver la vie et à devenir riches en repartant chargés de trésors. Nous connaissons tous cette histoire, pour l’avoir nous-mêmes vécue : combien de fois n’avons-nous pas fait une découverte inattendue en poursuivant un autre but ?
L’homme de lettres anglais Horace Walpole a appelé ce phénomène la « sérendipité ». La sérendipité, qu’il définit comme « la découverte de quelque chose par accident et sagacité alors que l’on est à la recherche de quelque chose d’autre », est à l’origine de découvertes majeures dans tous les domaines, comme le vaccin contre la vache folle.
Au XXe siècle, les deux secteurs de la recherche fondamentale les plus fertiles en innovations ont été la recherche militaire et la recherche spatiale. Dans l’histoire, la recherche spatiale a démontré à quel point la sérendipité de ses personnels était féconde. Que l’on songe aux nombreuses innovations dont nous jouissons au quotidien et qui ont été produites par la recherche spatiale : les ordinateurs à circuits intégrés et les téléphones portables, mais aussi l’imagerie IRM, les airbags de sécurité et jusqu’au revêtement des poêles !
Le produit de la recherche spatiale se déverse dans toute l’économie et a bouleversé nos modes de consommation en nous permettant une incroyable série de bonds technologiques depuis plus d’un demi-siècle. Or, à l’heure actuelle, le budget de l’Agence spatiale européenne est de 4, 2 milliards d’euros, alors qu’il était encore de 4, 5 milliards d’euros en 2009. Autrement dit, nous avons perdu plus d’un milliard d’euros de financements sur cinq années à peine. Cette évolution est préoccupante et je ne peux que regretter que le fameux pacte européen pour la croissance et l’emploi négocié par le Président de la République en juin dernier ne contienne aucune stipulation relative à la recherche spatiale. Où est l’ambition pour cette filière ? Où est le soutien dont elle a besoin ?
Le dernier conseil ministériel de l’ESA, qui s’est tenu à Naples, en novembre dernier, et auquel, madame la ministre, vous avez participé, puis la conférence spatiale européenne de janvier dernier ont confirmé une stabilisation du financement de la recherche spatiale à son niveau actuel. Je sais, madame la ministre, que vous êtes pour beaucoup dans ce résultat. Reste qu’il s’agit d’une stabilisation alors que de nouvelles contributions vont être versées par la Pologne et la Roumanie.
Certes, nous avons pu nous satisfaire de la préservation du site de Kourou, en Guyane, dont le financement est assuré pour les cinq années à venir. Toutefois, est-ce suffisant pour placer la recherche européenne au niveau des enjeux ? Faut-il le rappeler, Kourou est le plus important site de lancement au monde et l’un des plus compétitifs, puisqu’il a attiré jusqu’au lancement des satellites Soyouz, même si les Russes deviennent de plus en plus indépendants. Une stabilisation de l’enveloppe est-elle à la hauteur de la promesse faite dans le Traité de Lisbonne de doter l’Europe d’une véritable politique spatiale internationale ?
Mes chers collègues, on ne mesure pas à quel point la recherche spatiale est devenue déterminante dans la compétition économique qui anime un monde globalisé. En particulier, les satellites sont devenus indispensables à notre mode de vie, à notre soif permanente d’informations et de communication.
Si nous ne nous donnons pas les moyens de préserver nos savoir-faire et de préparer l’avenir, notamment via le renouvellement des sites et des installations, ainsi que la formation de scientifiques de très haut niveau, ce sont nos concurrents qui prendront les décisions à notre place et nous imposeront, avec tous les risques stratégiques que cela suppose, leurs équipements.
Imagine-t-on l’Europe couverte par des satellites non européens, alors que de nombreux pays – je ne les citerai pas - animent une guerre permanente en matière d’intelligence économique et de déstabilisation des systèmes d’information ?
Par exemple, du point de vue des Chinois, la recherche spatiale est non seulement un enjeu économique, mais aussi une question de sauvegarde de la souveraineté nationale, ce depuis le Livre blanc qu’ils ont publié en 2002.
Joan Johnson-Freese, professeur à l’Académie navale de guerre des États-Unis, estimait déjà en 2005 que la Chine consacrait annuellement plus de 2, 2 milliards de dollars américains à l’espace. Or, depuis le premier vol habité chinois en 2003, la Chine, c’est patent, ne cesse d’évoluer dans ce domaine.
On se rassure en évoquant les retards technologique et budgétaire du programme chinois. Ils doivent cependant être relativisés par rapport aux nôtres, puisque nous ne disposons pas de données fiables en la matière. La Chine s’est ainsi imposée comme une puissance majeure, y compris pour ce qui concerne le lancement et la mise sur orbite de satellites, en échange d’approvisionnements énergétiques. Je pense notamment au Venezuela et au Nigeria, qui rétribuent les lancements par des livraisons de barils de pétrole ou le contrôle de sources d’énergie.
Les pays européens, bien que soutenus par de puissantes économies, sont toutefois contraints par des pressions budgétaires, alors que les pays émergents disposent de masses financières beaucoup plus importantes. Sur les dix, quinze ou vingt prochaines années, cela fera peut-être la différence !
La multiplication des acteurs internationaux en matière de recherche spatiale pose d’importantes questions relatives au droit de propriété intellectuelle, principalement au regard de la coopération internationale qui anime la Station spatiale internationale. Un problème se pose déjà sur le statut des innovations qui pourraient avoir lieu au sein de l’ISS. Une découverte faite dans l’espace peut-elle être brevetée sur Terre et, si oui, dans quel pays ?
La question se pose plus particulièrement dans le cadre européen. Elle est d’autant plus problématique au regard de la faiblesse des garanties accordées par le droit chinois en matière de protection de la propriété intellectuelle. C’est la raison pour laquelle les spécialistes se penchent désormais sur ces problèmes cruciaux, les réponses apportées en la matière devant permettre de préserver la saine émulation qui anime nos équipes de recherches, ici, en Europe.
Comme vous pouvez le constater, madame la ministre, mes chers collègues, la situation de la recherche spatiale européenne est prise dans l’étreinte d’un étau à trois branches.
Nous faisons face à une contrainte budgétaire inédite qui ne fait qu’accentuer la concurrence et la montée en puissance des programmes spatiaux chinois et hindous, le fossé technologique qui nous sépare des États-Unis ne cessant de se creuser. Le programme européen n’a pas de satellite Hubble à mettre à son actif, et nous n’avons pas lancé le programme robotique Curiosity, mis en œuvre récemment sur Mars. L’Europe a de grands astrophysiciens, mais notre ambition et nos rêves ne sont pas relayés par des investissements privés ou émanant de la puissance publique.
Car il s’agit bien de cela, madame la ministre ! La recherche spatiale n’est pas une dépense somptuaire. C’est un investissement, éventuellement rentable pour des décennies. Ma collègue Sophie Primas le disait tout à l’heure, avec un euro d’investissement on obtient en retour vingt euros.
On parle beaucoup de la manière de rétablir, à moyen terme, la croissance économique en Europe par des réformes structurelles. Peut-être la recherche spatiale nous ouvre-t-elle la voie d’une prospérité industrielle de très long terme.
Mes chers collègues, vous l’aurez compris et certains d’entre vous, qui sont spécialistes de la matière, le savent mieux que moi, la recherche spatiale est une entreprise de longue haleine. C’est un sentier escarpé où l’échec est toujours possible, mais où les récompenses sont sans commune mesure. Soyons hardis, soyons audacieux en matière de recherche et faisons confiance à nos chercheurs et à nos entrepreneurs.
Je me permettrai ainsi de formuler une proposition. Nous savons que, dans le cadre national, le Centre national d’études spatiales remplit globalement cinq missions. Parmi celles-ci, la recherche fondamentale, notamment l’astrophysique et les sciences de l’univers en général, ne peut être assumée que par l’État. En revanche, d’autres missions, telles que l’accès à l’espace, la gestion des déchets stellaires ou encore certaines opérations de lancement de satellites, pourraient donner lieu à un renforcement de la présence des entreprises françaises, européennes ou étrangères, ce qui améliorerait le délai de transmission de la recherche fondamentale à la recherche appliquée.
Renforçons donc les partenariats avec le privé ! Quitte à faire des choix budgétaires courageux, ouvrons les vannes du financement privé. Tout le monde y gagnera !
N’ayons pas peur d’injecter, s’il le faut, des sommes folles – j’exagère peut-être, mais je ne suis pas loin de la réalité –, pour que notre programme spatial soit comparable, en termes de moyens, à celui des États-Unis. L’Europe en a la capacité. Le préalable à une recherche spatiale européenne digne de ce nom, c’est une ambition européenne robuste. Nous avons les talents nécessaires en Europe, donnons-nous les moyens de les exploiter !
Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, cette journée aura été marquée par les questions spatiales. Cet après-midi, la commission des affaires économiques a procédé à l’audition du candidat pressenti pour la présidence du Centre national d’études spatiales, et nous nous retrouvons ce soir – hasard du calendrier ! –, pour un débat sur l’avenir de l’Europe spatiale, largement initié par l’excellent travail fourni dans le cadre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, pour lequel j’assure leurs auteurs de mes compliments.
Aujourd’hui, nous nous rendons compte que notre pays est le vrai moteur de la politique spatiale européenne. Sans la France, on peut le dire sans crainte d’être détrompé, il n’y aurait pas de politique spatiale en Europe.
D’abord, depuis 1961, nous affichons une ambition dont nous nous donnons les moyens, à travers la création, par le général de Gaulle, du Centre national d’études spatiales.
Des ressources importantes ont été allouées, il faut le souligner. Alors que les États-Unis consacrent des sommes considérables à l’espace - à hauteur de 49 euros par habitant pour ce qui est du spatial civil -, la France y affecte 31 euros par habitant, ce qui est loin d’être négligeable, alors que l’Allemagne – mais il ne s’agit pas ici de classer par ordre de mérite les pays concourant à la politique spatiale européenne – n’y consacre, toujours par habitant, que 17 euros et le Royaume-Uni, 6 euros.
La France supporte, aux deux sens du terme, presque la moitié du budget consacré à l’Europe spatiale. En retour, bien entendu, elle dispose d’un leadership, qui se manifeste d’abord par la localisation à Paris du siège de l’Agence spatiale européenne, ensuite par la place qu’occupent ses industriels, la science en général, dans cette politique spatiale, et enfin par le rôle majeur joué par la base spatiale de Kourou.
Ce n’est pas être cocardier – même si, de temps en temps, on peut l’être, surtout lorsqu’on vient de perdre un match important au Stade de France
Sourires.

Cette politique européenne dispose d’un certain nombre d’atouts. Quand on regarde ce qui a été réalisé depuis une cinquantaine d’années, on se rend compte que le premier de ces atouts réside dans la volonté politique.
Madame la ministre, dans le sillage des ministres qui vous ont précédée, vous avez affiché une vraie volonté dans ce domaine, et ce que vous avez obtenu à la conférence de Naples illustre qu’une telle volonté permet de surmonter bien des difficultés. Cela n’était pas facile. Lorsqu’on connaît un peu la position des pays qui s’intéressent à l’espace, on s’aperçoit que beaucoup traînent les pieds, ou sont plus que réservés.
J’ai eu la chance d’exercer, par le plus grand des hasards, que j’ai assumé avec bonheur, la présidence du groupe des parlementaires pour l’espace, dans une autre assemblée et dans une autre vie. À l’époque, j’avais pris l’initiative d’organiser un certain nombre de rencontres avec nos collègues des principaux pays de l’Union européenne. À chaque fois, j’avais été surpris de constater leur réticence, leurs réserves, leur capacité à imaginer toutes sortes de difficultés, tout simplement pour retarder les décisions, et ce alors que les contraintes budgétaires n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui.
En France, nous avons cette volonté politique et j’ai été frappé de constater, dans un hémicycle abondamment garni ce soir
Sourires.
Nouveaux sourires.

… le large consensus qui s’est manifesté, la presque unanimité, qui a fait que la plupart des orateurs – modestement, je ne veux pas anticiper le sort qui sera réservé à mon intervention – ont été chaleureusement applaudis par ceux qui les avaient écoutés.
Mais je vois un deuxième atout : la communauté scientifique française. Les meilleurs, et ce n’est pas pour le coup être cocardier de le dire, sont français. Les scientifiques, qui travaillent depuis longtemps sur ces questions, ont besoin non seulement du soutien de nos gouvernements et du Parlement, mais aussi, vous le savez, madame la ministre, de moyens très importants en termes de formation.
L’un de mes collègues l’a dit à la tribune, nous avons été particulièrement frappés, cet après-midi, d’entendre le futur président du CNES expliquer dans quelles conditions il avait mis les pieds dans l’espace, si je puis dire : une bourse lui avait été octroyée, alors que la carrière qui lui était destinée ne l’aurait pas forcément conduit dans les étoiles. Cet effort de formation doit évidemment être amplifié, pour que cette communauté scientifique continue d’être la meilleure.
Enfin, nous avons un troisième atout : les industriels. Notamment sur le sol français, un certain nombre d’entre eux contribuent à faire en sorte que l’Europe spatiale se manifeste concrètement par des tirs réussis et l’envoi dans l’espace de satellites utiles.
Pour autant, nous sommes exposés à une concurrence sévère. Il y a encore une vingtaine ou une trentaine d’années, le leadership des États-Unis était incontesté, l’Union soviétique occupait une place importante et l’Europe essayait de se frayer un chemin, malgré des débuts un peu difficiles, notamment pour les lancements. Aujourd’hui, nous occupons une place déterminante, la moitié des satellites civils étant lancés par l’Europe. Toutefois, nous sommes assez surpris de voir qu’un certain nombre de pays sont devenus nos concurrents, grâce, évidemment, aux politiques de bas salaires qui sont les leurs, alors que nous pensions détenir le meilleur, pour ce qui est à la fois de la science, des technologies et du savoir-faire industriel.
Mais il ne faut pas se résigner, car l’exercice qui consiste à envoyer des satellites dans l’espace à des prix extrêmement élevés est difficile. Je parle non seulement des lanceurs, mais aussi des satellites eux-mêmes. Il faut savoir coordonner et organiser la coopération. Tout seuls, nous ne pouvons évidemment pas assumer une telle responsabilité.
Pour ma part, je suis convaincu que la coopération avec la Russie s’impose, car nous partageons avec ce pays une même plaque continentale. Tout d’abord, le savoir-faire des Russes est incontestable. On est encore émerveillés de voir, aujourd’hui, le nombre de vols réalisés grâce à Soyouz, dont, finalement, la géométrie n’a pas tellement varié au cours des années. Nous nous émerveillons également du nombre de satellites envoyés dans l’espace, d’abord par l’Union soviétique, ensuite par les régimes qui ont suivi, je pense notamment à Mir. Au final, on s’aperçoit - sans ironie - que la seule vraie révolution qu’ait réussie la Russie, c’est bien celle de ses satellites autour de la Terre.
Sourires.

Aujourd’hui, nous avons besoin de cette coopération, qui se manifeste à Kourou par la place maintenant réservée à la base de Soyouz. Je pense que, dans les années qui viennent, nous aurons besoin de la concrétiser de façon encore plus forte, car les contraintes budgétaires sont énormes et on ne voit pas que l’on puisse dilapider nos deniers publics dans des options qui seraient hasardeuses ou inutiles.
Je sais qu’il est extrêmement délicat d’aborder la question de l’utilité de certaines initiatives. Est-il utile d’aller creuser, à des prix extraordinaires, le sol de Mars, comme certains le voudraient, alors que nous avons besoin de mobiliser nos moyens surtout pour rendre l’Europe spatiale utile pour les citoyens ?
On a largement décrit les applications, notamment dans la vie quotidienne, issues de la recherche spatiale. À cet égard, madame la ministre, Galileo constitue évidemment l’un des objectifs essentiels, qui sera d’ailleurs atteint dans un an et demi ou deux ans et permettra aux Français d’être complètement autonomes. Aujourd’hui, en effet, la politique spatiale, c’est aussi le renforcement de l’indépendance de notre pays et de l’Europe.
Madame la ministre, la politique spatiale a besoin du soutien de l’opinion. Celle-ci doit être partie prenante et ne doit à aucun moment pouvoir estimer que les crédits dégagés sont autant d’argent jeté par les fenêtres. Il faut donc assurer ce lien entre l’opinion et la politique spatiale et faire en sorte que les Français connaissent mieux l’espace.
L’espace, on ne le découvre souvent que lorsque le ciel est dégagé et que l’on admire les étoiles. Car on aime regarder les étoiles, mais on ignore souvent tout de l’univers qui nous entoure comme des finalités très concrètes que son exploration nous offre.
Je ne saurais trop redire le rôle important que peut jouer le CNES, notamment grâce aux initiatives qu’il prend sur le terrain et qui sont régulièrement saluées. Les merveilleuses expositions qui sont organisées pour en rendre compte témoignent du génie français et de l’excellence du travail de nos scientifiques.
Applaudissements.

Madame la présidente, madame la ministre, madame, monsieur les corapporteurs, mes chers collègues, il y a moins d’une semaine, le satellite Planck de l’Agence spatiale européenne a révélé une image de la formation de l’univers d’une qualité exceptionnelle, dix fois plus précise que celle qu’avait proposée la NASA en 2003.
Ce soir, le débat proposé par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques nous projette non pas 13, 8 milliards d’années en arrière, mais dans la vingtaine d’années à venir.
En nous faisant naviguer dans le temps, l’Observatoire spatial européen, qui a secoué le monde des astrophysiciens, révèle le paradoxe de l’image d’une politique spatiale européenne nébuleuse dans au moins trois de ses composantes : son pilotage, sa finalité, sa portée.
Le pilotage de la politique spatiale, c’est-à-dire sa composante institutionnelle, est qualifié de « millefeuille » dans le rapport de l’OPESCT. L’image d’un agrégat friable semble tout aussi juste.
Le projet Planck, qui a retenu notre attention, est développé par l’Agence spatiale européenne, mais il a pour origine la fusion de deux projets, l’un français, l’autre italien, et a demandé la collaboration des Américains. Il est ainsi à l’image de la multiplicité européenne des institutions privées et publiques ayant une compétence générale ou particulière dans le domaine spatial.
Alors que chaque État possède ainsi son agence spatiale dont l’action est coordonnée par l’Agence spatiale européenne, le Traité de Lisbonne dote l’Union européenne de compétences pour élaborer son propre programme spatial.
Les vingt-sept États membres de l’Union européenne ne sont pas tous membres de l’ESA. En effet, l’Agence spatiale européenne compte vingt membres, dont la Norvège et la Suisse, qui ne font pas partie de l’Europe politique. En France, le Centre national d’études spatiales fait figure d’agence spatiale nationale. Toutefois, il faut distinguer, quasiment en son sein, des acteurs opérationnels et institutionnels majeurs, puis ajouter l’ensemble de l’industrie spatiale.
Est-il possible de mener à bien des projets technologiques et industriels avec ces différentes structures ? Les réalisations passées de l’Agence spatiale européenne sont le gage de futures réussites, mais le pilotage de l’Union européenne reste pour le moment problématique.
Le projet Galileo de navigation par satellite est cité en exemple de cette réussite, mais les retards et les difficultés de financement du programme attestent que les montages institutionnels rendent une opération de cette envergure aussi compliquée que complexe, entraînant des difficultés pour imposer le système face à un GPS modernisé.
Le programme européen de surveillance de la Terre, le GMES, est encore plus symptomatique des difficultés du millefeuille institutionnel, la Commission européenne tentant, contre la position des États membres, de se retirer du financement et de faire peser sur les États le coût du projet, estimé à près de 6 milliards d’euros.
Enfin, le programme MUSIS, initialement européen puisqu’il associait huit États membres et l’Agence européenne de défense, marque encore la faiblesse de l’intégration d’une politique spatiale à l’échelle de l’Union européenne.
Dans cette Europe « à la carte », c’est finalement le couple franco-italien qui prend la main pour monter un programme spatial de renseignement, alors que les Britanniques s’en sont déjà remis à un opérateur privé pour leurs télécommunications militaires.
La difficulté d’engager des projets est-elle liée à cette stratification institutionnelle ?
L’importance moindre du budget spatial européen, même si l’on additionne les moyens des différents acteurs, comparée aux budgets américain, russe ou chinois, témoigne de ce manque de direction politique européenne, la contrainte économique étant ressentie partout.
La finalité de la politique spatiale est encore à définir.
L’accès à l’espace est un enjeu : il reçoit des applications dans les domaines économique – télécommunication, localisation, météorologie, aménagement du territoire –, scientifique – surveillance de la planète, réchauffement climatique, exploration spatiale, origine de l’univers – et militaire avec le renseignement, la communication sécurisée et le commandement des opérations.
Deux directions apparaissent alors possibles pour mobiliser face à ces enjeux : la souveraineté et le marché. Est-ce à la souveraineté, entendue comme l’indépendance et l’autonomie, ou au marché, entendu comme la recherche du service à moindre coût, de fonder le ressort d’une politique européenne d’accès et d’utilisation de l’espace ?
La politique de l’Agence spatiale européenne et celle de l’Union européenne contrastent singulièrement sur la direction empruntée.
Alors que l’ESA connaît un principe de retour géographique visant à une participation des États au programme spatial correspondant à leur participation financière, les règles du marché européen ignorent cette volonté des États de voir le fruit de leur effort budgétaire consacré à leur économie nationale.
De même que la sécurité de la double source industrielle pour l’approvisionnement en satellites du projet Galileo est abandonnée par l’Union européenne en raison de son coût, les deux prochains satellites destinés au projet GMES seront lancés par des vecteurs russes, moins onéreux.
Certes, la préservation des ressources publiques doit faire l’objet d’une mobilisation importante de tous les acteurs et la compétitivité de l’industrie spatiale demeurer un objectif important, puisque leur absence conduirait à l’échec certain de toute politique spatiale. Toutefois, l’autonomie et l’indépendance de l’accès à l’espace sont des enjeux de souveraineté que les États de l’Union européenne ne peuvent abandonner aux géants américains, russes, chinois, japonais et bientôt brésiliens et indiens.
En effet, l’enjeu pour ces États est avant tout militaire, et l’Europe ignore complètement cette utilisation de l’espace. C’est encore une juxtaposition de programmes nationaux, bilatéraux ou trilatéraux, qui constitue la politique spatiale militaire en Europe, ce qui entraîne des écarts de 1 à 20 entre la somme de ces budgets et les dépenses américaines.
L’image qui en ressort, celle d’une Union européenne absente du domaine spatial, joue au renfort de la souveraineté des États mais au détriment de la cohésion et de l’intégration européennes ; on en ressent de plein fouet les effets.
Cette absence de l’Europe du domaine spatial se retrouve encore sur le terrain symbolique.
Être une puissance spatiale est un vecteur d’engouement et de fierté, une affaire de prestige et d’affichage politique. La concurrence entre Russes et Américains pour la conquête spatiale, la capacité d’envoyer des taïkonautes chinois dans l’espace, la douloureuse dépendance des Américains pour l’accès à la Station spatiale internationale sont autant d’indicateurs de la puissance symbolique inscrite dans l’accès à l’espace. Mais alors qu’Ariane domine le secteur du lancement des satellites, que l’Europe est capable d’approvisionner la station spatiale, la portée symbolique de la politique spatiale européenne est encore invisible.
La Guyane peut servir de champ d’analyse à ce décalage entre les prouesses technologiques, industrielles et économiques du secteur spatial et leur réception par nos concitoyens.
Malgré une contribution économique non négligeable à l’économie guyanaise ou à l’effort pédagogique du Centre spatial guyanais, les blessures de l’expropriation, le décalage entre la puissance des moyens techniques et sécuritaires mis en œuvre pour le lancement d’une fusée et les conditions de vie des habitants provoquent quelquefois chez les Guyanais, tout au moins une partie d’entre eux, un sentiment d’indifférence à l’égard de l’activité spatiale.
Plus généralement, le rapport qui nous est présenté témoigne de l’inquiétude des membres de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques quant au manque de valorisation du spatial. Je soutiens pleinement la préconisation qui y figure d’indiquer le terme « espace » dans l’intitulé du ministère et de prévoir la saisine régulière du Parlement sur le programme spatial et la stratégie qu’il traduit.
Hélas ! je crains que l’intérêt du spatial ne progresse que fort peu quand je note la différence de tonalité de l’OPESCT entre le rapport de 2007 et celui de 2012.
Dès son titre, Politique spatiale : l’audace ou le déclin », le premier rapport annonçait un thème fort et ne laissait guère de doute quant à la place première qui devait revenir à la politique spatiale européenne dans le monde. Ainsi, le secteur spatial militaire devait se faire, avec ou sans l’Europe ; la maîtrise technologique était nécessaire et « l’exploration et les vols habités, inséparables et inconcevables sans l’Europe ». La question du lanceur était autant d’accompagner les mutations du marché des satellites que de permettre les vols habités.
Aujourd’hui, une même politique volontariste et ambitieuse est soutenue, mais elle est tempérée, peut-être par la crise économique.
Ainsi, la conquête spatiale et les vols habités sont des domaines que la politique spatiale européenne a abandonnés pour elle-même et les secteurs autres que les satellites commerciaux semblent trop peu mobiliser l’intérêt européen.
Sans direction unique, écartelée entre la volonté de souveraineté des États et les contraintes du marché, ignorant la portée symbolique de la conquête spatiale, la politique européenne en la matière offre, on l’espère, un reflet déformé et temporaire de l’intégration politique, industrielle et spatiale de l’Union européenne. Le succès français, italien et allemand que constitue la décision prise à l’issue de la conférence interministérielle des 20 et 21 novembre dernier de lancer le programme d’Ariane 6 ne demande qu’à être partagé avec l’ensemble des partenaires européens.
Applaudissements.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je remercie Bruno Sido, président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et Catherine Procaccia, corapporteur, dont le rapport sur les enjeux et les perspectives de notre politique spatiale nationale et européenne est tout à fait remarquable, je tiens à le souligner à mon tour.
Je me réjouis que la Haute Assemblée ait inscrit ce débat à l’ordre du jour de ses travaux en séance publique. Je sais que la commission de l'économie, dont je salue le président ici présent, a également consacré une partie de ses travaux aujourd'hui à ce sujet.
Je salue également Jean-Yves Le Gall, président-directeur général d’Arianespace, qui assiste à ce débat. Il est manifestement appelé à occuper prochainement d’autres fonctions, mais je ne souhaite pas plus anticiper sur une nomination à venir même si plusieurs d’entre vous l’ont évoquée.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez tous abordé le conseil ministériel 2012 de l’ESA et ses suites. J’en rappellerai brièvement les résultats et évoquerai les perspectives que nous en attendons.
Naples a été un succès pour l’Europe spatiale. Je souhaite dissiper la morosité ambiante et apporter cette touche d’optimisme, car notre enthousiasme peut aussi provoquer des rebonds et il ne faut pas de priver d’une occasion de le manifester.
Les ministres des vingt États membres de cette organisation et du Canada ont décidé d’allouer un budget de 10 milliards d’euros aux activités et programmes spatiaux de l’ESA pour les années à venir. Dans le contexte que nous connaissons, c’est un engagement important et tout à fait structurant. Les ministres ont concentré leurs investissements sur les domaines ayant un fort potentiel de croissance ou un impact direct et immédiat sur l’économie, mais également sur les grands programmes scientifiques. Évidemment, dans ce domaine comme dans d’autres, on voudrait toujours investir davantage, et c’est bien normal.
Ce conseil ministériel de l’ESA a été l’occasion tout à la fois de dresser un constat - les objectifs français sont parfaitement atteints –, de conforter le programme Ariane et de garantir un accès autonome à l’espace pour l’Europe.
Je tiens à lever le doute qui m’a semblé subsister : l’évolution vers Ariane 6 a été actée, avec l’objectif d’un lanceur plus robuste et mieux adapté à l’évolution des besoins internationaux, tout en optimisant la transition, pour garantir les emplois et pérenniser les compétences industrielles, sans rupture de charge. Voilà ce à quoi nous nous sommes engagés.
Le leadership d’Ariane 5 durant cette période sera donc conforté, avec un programme d’évolution adapté et détaillé.
Je voudrais rendre hommage à Arianespace et à l’ensemble des scientifiques, en particulier ceux du Centre national d’études spatiales. Tous ont contribué au succès de ce lanceur. Réussir 54 lancers consécutifs, c’est une grande première à l’échelle internationale, et je salue également cette forme d’élégance qui a consisté à réussir tous les lancers depuis que je suis ministre, …
Mme Geneviève Fioraso, ministre. … consciente que tous mes prédécesseurs n’ont pas eu cette chance…
Sourires.
Nous avons également validé une nouvelle approche, fondée sur la recherche d’une synergie maximale entre la future Ariane 6 et les évolutions d’Ariane 5 pour optimiser les développements et les coûts, tout en minimisant les risques. J’espère que cette trajectoire sera confirmée lors du conseil ministériel de 2014, à l’issue d’études plus approfondies.
Nous avons voté un programme de deux ans, qui représente 300 millions d’euros pour la France, sur un total de 619 millions d’euros.
Nous confirmons notre engagement pour mener toutes les études intermédiaires qui nous permettront d’aboutir à la confirmation de la trajectoire décidée.
La France est également co-leader avec l’Allemagne, sur Metop-SG, le programme européen de météorologie opérationnelle, avec une contribution de 27 %.
L’industrie européenne des satellites de télécommunications s’est essentiellement fédérée autour du projet NEOSAT, programme de plateforme innovante à propulsion électrique ou mixte.
La quote-part de la France dans le financement de l’exploitation de la Station spatiale internationale, l’ISS, diminue de manière significative, passant de 27 % à 20 %, à la suite d’un compromis avec l’Allemagne et d’un engagement récent du Royaume-Uni. La France va contribuer au développement du module de service du futur véhicule de desserte de l’ISS, que Mme Procaccia et M. Sido appellent de leurs vœux dans leur rapport.
Enfin, au-delà de l’ISS, tous les programmes scientifiques dont les résultats contribuent au rayonnement de la science spatiale française et européenne dans de nombreux domaines – univers, sciences de la Terre, etc. – ont été maintenus et amplifiés. Prises depuis le satellite Planck, les magnifiques images nous ont tous fait rêver, d’autant plus que ce formidable outil concentre beaucoup de science, de technologie et d’industrie française, notamment, et vous me permettrez un instant de régionalisme, le groupe Air Liquide et certains laboratoires du CEA.
La recherche scientifique a ainsi vu renforcer ses instruments spatiaux lors de ce conseil, avec une nouvelle période quinquennale du programme scientifique obligatoire.
La base spatiale de Kourou, vous avez été nombreux à le dire, a également été confirmée, et son financement assuré pour les cinq années à venir.
En cette période de difficultés économiques et financières, chacun est conscient du fait que l’effort budgétaire important des pays européens, notamment de la France, doit trouver sa contrepartie dans une maximisation des retours économiques, opérationnels, scientifiques et technologiques.
Dans cet esprit, les enjeux de cette nouvelle phase de mise en œuvre sont nombreux.
Je citerai tout d’abord la nécessaire collaboration entre l’industrie, le CNES et l’ESA, sur les travaux industriels d’Ariane 6 entre 2013 et 2014, la configuration technique et le schéma industriel devant tendre vers l’objectif primordial qu’est la minimisation du coût de production de ce nouveau lanceur, tout en préservant les filières technologiques et industrielles essentielles des différents contributeurs. C’est, je ne vous le cache pas, l’enjeu majeur de la période finalement très courte qui nous sépare du prochain conseil ministériel de l’ESA en 2014.
Je citerai ensuite le lancement d’un processus rigoureux de mise en concurrence sur Metop-SG, l’aboutissement de NEOSAT sur les technologies du futur dans les meilleures conditions économiques et industrielles, afin que l’exploitation de ces travaux débouche sur une ligne de produits compétitifs au niveau mondial, ainsi qu’une maîtrise des dépenses d’exploitation de l’ISS.
Pour ce qui concerne plus spécifiquement le positionnement de notre industrie dans la suite d’Ariane, la meilleure garantie reste l’engagement financier important de la France, puisque l’ESA applique le principe opportun du « retour géographique ». La France a contribué à hauteur de la moitié du programme correspondant. Ariane 6 aura une configuration technique différente de celle d’Ariane 5 : c’est même en cela qu’elle constituera un progrès déterminant. Mais son entrée en service opérationnel complet n’aura lieu qu’au milieu de la prochaine décennie, ce qui laisse à l’industrie le temps de se reconfigurer progressivement.
À mon arrivée au ministère, j’ai beaucoup consulté – croyez-moi, mesdames, messieurs les sénateurs, c’était indispensable, je n’en dis pas plus, les spécialistes me comprendront… –, et je suis parvenue à la conclusion que cet équilibre était nécessaire.
Naples a été un succès pour l’Europe spatiale, avec un budget de 10 milliards d’euros destinés aux activités et programmes spatiaux de l’ESA pour les années à venir. Je vous laisse apprécier ce montant, tout sauf négligeable dans le contexte actuel !
Pour la France, ce sont plus de 2, 3 milliards d’euros d’investissements, comme en 2008, tandis que l’Allemagne a consenti un effort à hauteur de 2, 5 milliards d’euros. Il s’agit du plus gros investissement commun entre la France et l’Allemagne, et du plus gros projet commun, aussi. Je l’ai fait remarquer, car cela avait échappé à certains, à l’occasion du conseil ministériel organisé dans le cadre du sommet franco-allemand de Berlin, en présence du Président de la République, François Hollande, et de la Chancelière allemande, Angela Merkel, à qui naturellement cela n’avait pas échappé !
Naples, ce furent aussi des négociations difficiles que nous ne sommes parvenus à conclure qu’au petit matin, après deux jours et deux nuits de discussions compliquées. Nous n’avons pas beaucoup vu Naples, le président du CNES et nos collaborateurs respectifs peuvent en témoigner !
Sourires.
Si nous avons pu faire prévaloir notre vision auprès de nos interlocuteurs allemands, et cela n’a pas été facile, c’est que nous avons respecté quelques conditions préalables qu’il me paraît indispensable de conforter à l’avenir.
Je vois une première condition dans l’expertise d’une filière complète, depuis la recherche fondamentale jusqu’à la valorisation et au transfert vers l’industrie, dans toute sa diversité, qu’il s’agisse des grands groupes comme Safran, Astrium, TAS, Air Liquide, ou des ETI, PMI et PME, sans opposer les uns aux autres.
Je vois une deuxième condition dans la solidarité d’une « équipe France » qui, in fine, a joué groupée, et dont les membres ont su renoncer à faire valoir leurs intérêts spécifiques pour s’accorder sur un projet commun et cohérent.
C’est cette intelligence collective qui a prévalu à Naples, et je tiens à saluer tous les artisans de ce succès - publics et privés -, au premier rang desquels le CNES – je rends hommage à Yannick d’Escatha, qui a depuis pris sa retraite -, mais aussi Arianespace et l’ESA, à travers notamment son directeur général, Jean-Jacques Dordain.
Rien n’était acquis d’avance, et tous ont largement contribué à cette issue heureuse.
Il s’agit, troisième condition, d’anticiper, en jouant toujours un coup d’avance, car nous sommes dans un monde où les mutations sont rapides, avec un marché très évolutif. Les pays émergents investissent beaucoup dans la recherche-développement. Ils ont davantage de facilité pour le faire que les pays européens.
Il s’agit, quatrième condition, de préserver et de développer l’emploi et l’expertise industrielle, avec la recherche de solutions évitant les ruptures de charges et la fragilisation des emplois. C’est une priorité pour le Gouvernement.
Enfin, cinquième condition, au-delà de nos frontières, il s’agit de construire un projet fédérateur pour la France et pour l’Europe, en nous appuyant sur des alliances avec l’Italie, la Suisse, le Luxembourg qui ont très bien fonctionné à Naples, et qui ont facilité l’accord final avec notre partenaire allemand.
Le spatial est un exemple dont de grands secteurs industriels pourraient utilement s’inspirer. Il contribue, grâce à la diffusion de technologies de pointe dans de nombreux secteurs industriels, au redressement du pays par l’innovation et la compétitivité-qualité, la seule durable.
Vous avez également été nombreux, au cours du débat, à évoquer la question des relations entre l’Union européenne et l’Agence spatiale européenne.
Nous abordons ici un sujet qui, je crois, est d’une très grande importance pour le présent, au travers des programmes Galileo et GMES, ou en cours de développement, mais aussi pour le futur de l’activité spatiale en Europe. Le Traité de Lisbonne ayant conféré à l’Union européenne une compétence spatiale parallèlement à celle qui est exercée par ses États membres, il convient maintenant d’en clarifier les contours, au plan tant du contenu que des modalités d’application, pour former une politique spatiale ambitieuse, à la hauteur des enjeux qui se présentent au continent européen.
C’est une formidable occasion qui nous est offerte. Rendons-nous compte : entre Galileo – 6, 3 milliards d’euros –, GMES – 3, 8 milliards d’euros – ou le grand programme-cadre européen Horizon 2020 – 1, 2 milliard d’euros pour le secteur, ce ne sont pas moins de 11, 3 milliards d’euros qui seront consacrés au spatial par l’Union européenne durant la période 2014-2020, soit un budget annuel de 1, 6 milliard d’euros, supérieur à la moitié du budget annuel de l’Agence spatiale européenne !
C’est considérable, et cette montée en puissance s’est faite dans une période relativement courte, sur une décennie. Le chemin parcouru est vraiment très impressionnant.
S’il s’agit incontestablement d’un grand succès, il convient néanmoins de clarifier la gouvernance du spatial en Europe. Le sujet a été évoqué sans tabou à Naples, et plus récemment à Bruxelles.
Il s’agit, pour l’essentiel, d’organiser les relations entre l’ESA et l’Union européenne. Rien ne serait pire que l’Union européenne mettant en place une agence doublon de l’ESA. La réactivité de l’ESA est appréciée de tous les pays membres et je crois qu’il faut la préserver. Je l’ai dit récemment à Bruxelles, lors d’un débat présidé par le Commissaire européen à l'industrie et à l'entreprenariat, Antonio Tajani, également vice-président de la Commission européenne.
Ce sujet était déjà sur la table lors du conseil ministériel de l’ESA à Naples. Les ministres ont adopté, à l’unanimité, une déclaration politique sur l’avenir de l’Agence. Cette déclaration prévoit que les travaux devront être menés en collaboration avec la Commission européenne et faire l’objet de propositions lors la prochaine conférence ministérielle de l’ESA, en 2014.
Du côté Union européenne, une communication de la Commission européenne, intitulée « Instaurer des relations adéquates entre l’Union européenne et l’Agence spatiale européenne », a été publiée le 14 novembre 2012. Le conseil Compétitivité, qui s’est tenu à Bruxelles le 12 décembre dernier, j’y ai fait allusion à l’instant, a été l’occasion d’un échange de vues extrêmement riche et direct sur ce sujet.
Toutes les options pour un rapprochement de l’ESA vers l’Union européenne seront étudiées, notamment la solution qui nous apparaît aujourd’hui comme la plus prometteuse et qui consisterait à placer l’ESA sous l’autorité de l’Union européenne, en lui conservant son caractère d’agence intergouvernementale, ce qui lui permettrait de continuer à mener des programmes non communautaires pour le compte de ses États membres.
Nous veillerons à ce que les évolutions de l’ESA soient bénéfiques à l’ensemble de la communauté spatiale, notamment aux communautés utilisatrices. Je pense, en particulier, à celles qui sont regroupées au sein d’EUMETSAT pour l’exploitation des satellites météorologiques.
Pour ce qui est du SSA, ou Space Situational Awareness, la France est en pointe, grâce notamment à l’engagement de la défense.
Le caractère dual de la plupart des recherches est extrêmement important ; il faut le préserver. C’est ce qui a poussé l’excellence de la recherche française et de ses applications. La France a ainsi développé une coopération avec l’Allemagne : après un premier programme ESA, nous sommes en train de mettre sur pied une initiative dans le cadre d’Horizon 2020, preuve, là encore, d’une belle complémentarité.
La politique industrielle spatiale européenne constitue le deuxième thème de discussions au sein du conseil Compétitivité, dont la prochaine réunion, le 30 mai, devrait être l’occasion de donner des orientations sur un sujet qui a fait l’objet d’une communication de l’Union européenne le 28 février dernier.
Nous soutenons les cinq objectifs énumérés dans ce document : premièrement, mettre en place un cadre réglementaire cohérent et stable – c’est fondamental –; deuxièmement, continuer à développer une base industrielle compétitive, solide, efficace et équilibrée en Europe et soutenir la participation des PME en accompagnant leur croissance, afin qu’elles deviennent des entreprises de taille intermédiaire solides au plan national et international ; troisièmement, soutenir la compétitivité mondiale de l’industrie européenne, en encourageant le secteur à devenir plus rentable tout au long de la chaîne de valeur ; quatrièmement, développer les marchés pour les applications spatiales et les services ; enfin, cinquièmement, assurer la non-dépendance technologique et l’accès indépendant à l’espace. L’importance de ce dernier enjeu a été soulignée à juste titre par nombre d’entre vous.
Nous sommes particulièrement sensibles aux propositions de l’Union européenne en vue de l’élaboration d’une politique européenne pour assurer un accès indépendant à l’espace. Il s’agit à nos yeux d’un élément de crédibilité pour l’Europe, car il ne peut y avoir de politique spatiale sans politique d’accès à l’espace.
Nous soutenons également les efforts déployés par l’Union pour encourager la participation des PME qui contribuent à la compétitivité de l’industrie européenne, notamment par le développement des applications aval, ainsi que ses efforts en matière de financement de la recherche-développement au travers du programme Horizon 2020.
Les enjeux économiques et sociétaux du secteur spatial ont fait l’objet de nombreux développements de votre part, tous très pertinents.
Je voudrais à mon tour dire à quel point l’espace représente un objectif stratégique pour la France et pour l’Europe, du fait des enjeux de défense et de sécurité qu’il recouvre et de la diversité de ses applications. Ces dernières concernent de nombreux secteurs de la vie du pays, qu’il s’agisse de l’observation de la Terre et de l’environnement, des télécommunications ou encore du triptyque « localisation, navigation, datation par satellite ».
Au-delà des 16 000 emplois directs qu’il représente en France, ainsi que du retour sur investissement de vingt euros pour un euro investi – il me semble reconnaître là une petite musique chère au président du CNES §, le secteur spatial est source de développement technologique et d’innovations qui irriguent l’ensemble du tissu industriel. Les infrastructures spatiales constituent souvent de véritables clés de voûte pour des applications et des services bien plus vastes.
L’espace est ainsi à la fois un outil de développement économique et une composante essentielle de l’autonomie de décision et d’action de la France et de l’Europe.
Il constitue également un formidable champ d’étude, tant pour les sciences de l’univers que pour celles de la Terre ou de la physique fondamentale.
La politique spatiale française doit pouvoir s’appuyer sur des capacités industrielles nationales techniquement performantes et compétitives. Le modèle économique de notre industrie repose notamment sur une présence importante du secteur commercial, ce qui conditionne les emplois.
La concurrence croissante de l’industrie américaine en particulier – nous constatons son retour en force aussi bien dans le domaine des télécommunications que dans celui des lancements associés – mais aussi, à terme plus ou moins rapproché, des pays émergents que vous avez tous cités, constitue un véritable défi.
Pour le relever, j’ai décidé, en plein accord avec mon collègue ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian, d’instituer un comité de concertation État-industrie, le COSPACE, à l’image de celui qui existe dans le domaine de la recherche aéronautique civile, le CORAC. Ce comité aura pour objectif principal d’élaborer des feuilles de routes technologiques permettant la convergence des efforts de l’ensemble des acteurs nationaux.
Mme Geneviève Fioraso, ministre. J’ai profité de l’unanimité qui régnait, non pas à mon arrivée au ministère, je ne vous le cache pas, mais à la suite de la conférence de Naples, pour créer ce nouveau comité. Il faut toujours savoir profiter d’un bon état d’esprit pour lancer des initiatives convergentes !
Sourires.
Le secteur spatial, en sus de son impact sur la formation et l’emploi des jeunes, a le mérite de rendre attractives les carrières scientifiques. Or stimuler l’attrait des plus jeunes pour ces carrières est justement l’une des priorités de mon ministère.
S’il est vrai que l’intitulé de ce dernier ne comprend pas l’espace, je peux vous rassurer : le décret de nomination indique que ce secteur fait bel et bien partie de mon périmètre de compétence. Je crois me souvenir d’ailleurs que le ministre de la recherche qui, le premier, a vu son titre complété par le terme « espace » fut Hubert Curien. Je veux lui rendre hommage ce soir : lui qui a en quelque sorte propulsé Ariane 5 restera comme une belle étoile dans le firmament de notre recherche et de notre technologie spatiales dont il a grandement contribué au rayonnement.
Vous l’avez dit, les découvertes et les explorations scientifiques font rêver le grand public, tout particulièrement les jeunes.
L’ampleur de la couverture médiatique suscitée par les images provenant des engins posés sur Mars est frappante. Le dernier en date de ces robots, Curiosity, embarque des instruments français de très haute technologie. Il constitue un témoin de l’excellence de la science française, de l’expertise du CNRS, du CEA et de l’université Paul-Sabatier de Toulouse.
Au sein de notre société baignée par le numérique, ces images, au-delà de tout témoignage, nous donnent à tous l’impression d’être réellement sur Mars. Et je dois avouer que je me sens plus à l’aise avec cette translation virtuelle qu’avec le voyage auquel vous nous invitiez, madame la sénatrice, et pour lequel je ne serai pas encore candidate.
Sourires.
Au-delà de l’émerveillement, l’espace est également un formidable champ de problématiques scientifiques et technologiques intellectuellement stimulantes : notre jeunesse y est particulièrement sensible. Le rêve et l’excitation intellectuelle se côtoient.
Avec l’arrivée des nano-satellites, nos établissements d’enseignement supérieur peuvent utiliser le secteur spatial comme un vecteur d’apprentissage couvrant une large gamme de spécialités et permettant de confronter nos étudiants à des réalisations à la fois concrètes, opérationnelles et relativement complexes pour un coût raisonnable.
Au total, le secteur spatial constitue un formidable facteur d’attraction vers les filières scientifiques.
Il y a quelques années, afin de convaincre des collégiens – et des collégiennes, car nous manquons encore plus de jeunes filles dans les carrières scientifiques – de s’orienter vers ces filières, nous avions demandé à un astronaute du Corps européen des astronautes de venir en tenue dans les classes. Cela peut paraître un peu folklorique, mais je peux vous assurer que nous avons réussi à déclencher de véritables vocations grâce au rêve devenu tangible en un instant.
Pour illustrer très concrètement ce sujet, deux cas de réussites exemplaires me viennent à l’esprit : je pense tout d’abord aux étudiants de l’université de Montpellier II qui, sous la conduite de leur professeur et après avoir satisfait aux obligations de la loi spatiale, ont lancé leur premier nano-satellite, Robusta, sur le premier vol du petit lanceur Vega ; je pense ensuite à la jeune et dynamique entreprise lyonnaise NovaNano, start-up créée par deux jeunes ingénieurs de l’INSA de Lyon, qui propose sa propre gamme de nano-satellites et de services complets « clefs en main » à des clients, institutionnels ou privés, désireux de conduire des expériences en orbite. Il s’agit là aussi d’une translation virtuelle, mais extrêmement efficace.
En résumé, sur la base d’un socle franco-allemand à consolider, sur lequel il faut être très vigilant mais aussi confiant, d’un travail commun à optimiser vers Ariane 6 pour les lanceurs, de programmes scientifiques à développer dans le cadre de l’Union européenne comme de l’ESA, sans doublons mais en complémentarité et en partenariats européens et supra-européens, le développement de cette politique spatiale est tout à fait crucial.
La constance des investissements, le partenariat entre recherche publique et recherche privée, les transferts technologiques vers l’industrie, l’attractivité de la filière pour susciter des vocations scientifiques, nous en sommes tous d’accord, constituent les axes forts de cette politique.
Votre rapport, monsieur Sido, madame Procaccia, y contribue largement, ainsi que l’organisation de débats et de journées dédiées.
Cet enjeu est porté par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, soyez-en convaincus, avec enthousiasme et volontarisme. Soyez assurés aussi du soutien plein et entier de mon ministère et de celui de la défense dans cette action duale et doublement stratégique.
Félicitons-nous de la convergence, vécue ce soir, au service de l’emploi, de la science et du progrès.
Félicitons-nous également de la productivité de nos investissements : si l’Europe investit moins que les États-Unis, notre productivité est meilleure. Sachons voir le verre à moitié plein. En cette période, je crois que c’est important !
En conclusion, je tiens à vous remercier tous de votre engagement, de votre passion. L’espace, vous le savez, suscite immédiatement la passion, et cette passion, il nous faut la partager davantage pour pouvoir l’amplifier, et amplifier à son tour notre excellence, nationale et européenne, pour la faire rayonner encore davantage à l’international. Merci d’y contribuer avec nous !
Vifs applaudissements.

Nous en avons terminé avec le débat sur les enjeux et les perspectives de la politique spatiale européenne.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 27 mars 2013 :
De quatorze heures trente à dix-huit heures trente :
1. Proposition de loi relative au versement des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire au service d’aide à l’enfance lorsque l’enfant a été confié à ce service par décision du juge (n° 640, 2011-2012) ;
Rapport de Mme Catherine Deroche, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 430, 2012 2013) ;
Texte de la commission (n° 431, 2012-2013).
À vingt et une heures :
2. Débat sur le droit de semer et la propriété intellectuelle
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq.