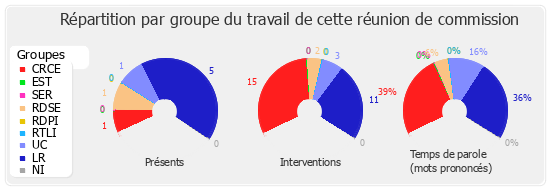Commission d'enquête sur le rôle des banques et acteurs financiers dans l'évasion des ressources financières en ses conséquences fiscales et sur les équilibres économiques ainsi que sur l'efficacité du dispositif législatif, juridique et administratif destiné à la combattre
Réunion du 22 mai 2013 : 1ère réunion
Sommaire
- Audition de mme mathilde dupré chargée de plaidoyer au comité catholique contre la faim et pour le développement ccfd-terre solidaire coordinatrice de la plate-forme paradis fiscaux et judiciaires ; de mm. gérard gourguechon membre du conseil scientifique de l'association attac et jean merckaert membre du conseil d'administration de l'association sherpa (voir le dossier)
- Audition de m. bernard esambert ancien président-directeur général de la compagnie financière edmond de rothschild ancien membre du collègue de l'autorité des marchés financiers (voir le dossier)
- Audition de m. françois d'aubert président du groupe de revue par les pairs au sein du forum mondial sur la transparence et l'échange d'informations en matière fiscale ancien ministre
- Audition de madame jézabel coupey-soubeyran maître de conférences en économie à l'université paris-i panthéon-sorbonne conseillère scientifique auprès du conseil d'analyse économique et de m. gabriel zucman doctorant à l'école d'économie de paris (voir le dossier)
- Audition de mm. jean-françois gayraud criminologue et noël pons ancien inspecteur des impôts (voir le dossier)
La réunion
Audition de Mme Mathilde duPré chargée de plaidoyer au comité catholique contre la faim et pour le développement ccfd-terre solidaire coordinatrice de la plate-forme paradis fiscaux et judiciaires ; de Mm. Gérard Gourguechon membre du conseil scientifique de l'association attac et jean merckaert membre du conseil d'administration de l'association sherpa
Audition de Mme Mathilde duPré chargée de plaidoyer au comité catholique contre la faim et pour le développement ccfd-terre solidaire coordinatrice de la plate-forme paradis fiscaux et judiciaires ; de Mm. Gérard Gourguechon membre du conseil scientifique de l'association attac et jean merckaert membre du conseil d'administration de l'association sherpa

Nous allons procéder aux premières auditions de cette première commission d'enquête, autant légitime par son sujet que par l'actualité qui la sous-tend. Toute personne entendue par une commission d'enquête doit prêter serment, lequel n'est pas uniquement formel puisque le Code de Procédure pénale et le Code Pénal prévoient des sanctions lorsqu'il apparaît que les informations délivrées sous serment sont fausses.
Madame Mathilde Dupré, prêtez-vous serment de dire toute la vérité, et rien que la vérité ? Levez la main droite et dites « je le jure ».
AUDITION DE MME MATHILDE DUPRÉ, CHARGÉE DE PLAIDOYER AU COMITÉ CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE DÉVELOPPEMENT, (CCFD)-TERRE SOLIDAIRE, COORDINATRICE DE LA PLATE-FORME PARADIS FISCAUX ET JUDICIAIRES ; DE MM. GÉRARD GOURGUECHON, MEMBRE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L'ASSOCIATION ATTAC ET JEAN MERCKAERT, MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION SHERPA
Chargée de plaidoyer au Comité catholique contre la faim et pour le développement, (CCFD)-Terre solidaire, coordinatrice de la Plate-forme Paradis fiscaux et judiciaires. - Je le jure.

Monsieur Gérard Gourguechon, prêtez-vous serment de dire toute la vérité, et rien que la vérité ? Levez la main droite et dites « je le jure ».
Je le jure.

Monsieur Jean Merckaert, prêtez-vous serment de dire toute la vérité, et rien que la vérité ? Levez la main droite et dites « je le jure ».
Je le jure.
Chargée de plaidoyer au Comité catholique contre la faim et pour le développement, (CCFD)-Terre solidaire, coordinatrice de la Plate-forme Paradis fiscaux et judiciaires. - La plate-forme Paradis fiscaux et judiciaires est une organisation de la société civile créée il y a bientôt 10 ans. Elle regroupe 18 organisations qui s'intéressent aux questions des paradis fiscaux, judiciaires et réglementaires, ainsi qu'à l'opacité financière, l'évasion fiscale et la corruption. Nous rassemblons des ONG de développement, des organisations environnementales ou de lutte contre la corruption, mais également des mouvements citoyens et des syndicats, tous acteurs de la société civile qui travaillent sur ces sujets depuis longtemps ; ils ont décidé de joindre leurs efforts pour partager l'expertise, comprendre ces phénomènes assez complexes, et surtout essayer de dégager ensemble des propositions puis les faire connaître auprès des parlementaires et des décideurs. L'impact des flux financiers illicites sur les pays en développement équivaut dix fois ce qu'ils reçoivent en aide publique au développement de la part des pays riches. C'est sur la base de ce constat que nous avons commencé à travailler sur les paradis fiscaux.
Toutes les recommandations que nous avons formulées et portées depuis dix ans sont actuellement largement reprises à la faveur de différentes révélations dévoilées aujourd'hui. Notre souci est de savoir comment les pays en voie de développement pourront récupérer les recettes fiscales qui leur font cruellement défaut pour financer leur politique publique de développement en santé, éducation, etc.
C'est aussi un vrai sujet, pour rétablir les comptes publics en France et dans tous les pays européens qui connaissent une crise de la dette.
C'est un véritable honneur d'être une nouvelle fois invité en tant que représentant de la société civile. L'enquête que le Sénat a menée l'année dernière, notamment, a permis l'élaboration d'un rapport très impressionnant de plus de 1 000 pages. Un projet de loi sera par ailleurs bientôt à l'étude à l'Assemblée nationale. Notre espoir est que des recommandations soient faites, grâce auxquelles la France pourra avancer sans nécessairement attendre un consensus de l'ensemble de ses partenaires au niveau international.
Beaucoup de nos concitoyens ont été très surpris, en ouvrant leur journal cette semaine, d'apprendre que des millions de données tombées dans les mains de journalistes avaient échappé jusqu'à présent aux radars des autorités de contrôle. Pour notre part, nous ne disposions pas de ces données, tout simplement parce que le secret est devenu une industrie, avec ses places fortes. Les montants des fortunes détenues offshore sont difficiles à estimer et sont évalués entre 5 900 milliards de dollars et 32 000 milliards de dollars. La Suisse représenterait environ 28 % de ce marché, suivie de l'Angleterre ainsi que ses satellites et l'Irlande - un quart du marché - puis des Caraïbes et Panama, avec 13 % du marché. Hong Kong et Singapour représenteraient également 13 % de ce marché. Les Etats-Unis et le Luxembourg complètent le tableau.
Selon une étude de Tax Justice Network, réseau international auquel nous appartenons, une poignée de banques - UBS, Crédit Suisse, City Group, SSB, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Bank of America, Merrill Lynch, JP Morgan Chase, BNP Paribas, HSBC, Pictet & cie, Goldman Sax, ABN AMRO, Barclays, Crédit Agricole, Julius Baer, Société Générale, Lombard Odier - gérerait entre 62 et 74 % de la fortune privée détenue offshore.
Depuis 25 ans maintenant, la communauté internationale montre du doigt un certain nombre d'Etats récalcitrants ; elle doit continuer à le faire. On ne peut pas tolérer qu'Encore aujourd'hui encore, au sommet européen, des petits Etats parviennent à bloquer des négociations à 27. Mais cela ne suffit pas. Nous considérons dès lors indispensable de s'attaquer aux leaders de cette industrie. Il existe notamment des paradis fiscaux qui bien souvent ne constituent que les terrains d'atterrissage d'une activité menée ailleurs et qui les dépasse largement. Il suffit de voir la densité des banques par paradis fiscal. Ainsi, pour 10 000 habitants, on compte en France 0,1 banque, 2,5 au Luxembourg 13 à Monaco, mais et 45 aux Iles Caïman. ! Cette activité est donc exercée dans certains Etats de façon largement fictive.
Cette industrie du secret est dommageable à la fois pour nos finances publiques, pour celles des pays en voie de développement et pour la cohésion sociale. Nous recommandons donc de la démanteler parce qu'elle est nocive pour la société. En témoigne
Un rapport d'un think tank britannique (A Bit Rich, 2009), la New Economics Foundation qui a essayé de mesurer l'utilité sociale de quelques professions. Il apparaît que pour chaque euro reçu en guise de rémunération, un employé de crèche crée 9 euros de valeur sociale, quand un banquier de la City en détruit 7 et un comptable fiscaliste 47.
Nous avons donc affaire à des professionnels qui se sont structurés, enrichis par la recherche d'évitement de l'impôt et par le contournement des règles qui s'appliquent chez nous. Nous connaissons bien les grands leaders de cette industrie, ils ont pignon sur rue en France et dans les grands pays voisins. Aujourd'hui, nos deux grandes attentes portent sur la transparence et sur la répression de la fraude.
Chargée de plaidoyer au Comité catholique contre la faim et pour le développement, (CCFD)-Terre solidaire, coordinatrice de la Plate-forme Paradis fiscaux et judiciaires. - L'année dernière, nous vous avions présenté des chiffres sur la concentration des filiales des entreprises multinationales dans les paradis fiscaux. Ce rapport, publié en 2010 par le CCFD-Terres solidaires, traitait des 50 premières entreprises multinationales européennes. Il démontrait qu'une filiale sur cinq était présente dans les territoires opaques, c'est-à-dire une moyenne de 100 filiales pour chaque entreprise. La concentration était par ailleurs supérieure pour le secteur bancaire, puisqu'un quart des filiales des institutions financières européennes étaient localisées dans les paradis fiscaux.
Nous avons réédité l'exercice en mai-juin 2012 et avons publié un rapport en juillet 2012 : à notre grande surprise, non seulement cette concentration n'avait pas diminué, mais le nombre absolu de filiales dans certains territoires avait même un peu augmenté, malgré les déclarations de la Fédération française bancaire et des dirigeants des principales banques françaises qui avaient pris l'engagement dès 2009 de se retirer des paradis fiscaux. La législation française avait d'ailleurs été un peu durcie sur la base de la liste des paradis fiscaux établis par la France, par des surtaxes sur certaines activités en provenance et en direction de ces territoires. En juillet 2012, nous avions ainsi montré que pour BNP Paribas, 360 filiales sur 1 409 étaient situées dans les territoires opaques, dont 61 au Luxembourg, 22 aux Iles Caïmans, 7 aux Bermudes, 2 à Chypre, 8 à Singapour, 10 en Suisse. Pour le Crédit Agricole, le nombre était de 104 filiales sur 5258, pour la Société Générale, 49 sur 276 filiales. La concentration des banques sur ces territoires est donc forte.
Nous ne sommes pas les seuls à avoir procédé à ce type d'enquête. En effet, le Conseil des prélèvements obligatoires a également rédigé un rapport publié en janvier 2013 sur la fiscalité des entreprises dues secteurs financiers. Deux chercheurs du CEPII ont notamment mis à jour des informations sur les filiales jusqu'au 10e rang (filiales de filiales). La concentration y apparaît encore plus forte que ce que l'on pouvait observer à partir des documents publics, puisqu'elle atteint 330 % de filiales de plus au Luxembourg, 300 % en Irlande et à Singapour, 240 % en plus à Hong Kong, 460 % de plus en Suisse. Les enquêteurs montrent en outre que la taxation des banques françaises a été divisée par trois en presque 20 ans, et que le taux d'imposition implicite moyen dans le secteur bancaire français est bien plus faible que dans les autres pays. Ainsi pour les grandes banques commerciales françaises, le taux s'élève à 8 % d'imposition en moyenne entre 2002 et 2009 alors qu'il se situait à 37 % entre 1988 et 1994. A l'étranger, le taux effectif pour les établissements financiers allemands entre 2002 et 2009 s'élevait à 50 %, à plus de 30 % pour les Américains et les Anglais et à 25 % pour les Danois et les Italiens.
Je suis membre d'ATTAC depuis 1998. Auparavant, j'étais au syndicat des impôts « Solidaires finances publiques ». Compte tenu de mon âge, j'ai déjà entendu beaucoup de commissions d'enquête à l'Assemblée nationale et au Sénat portant sur ces questions de première importance. Toutefois, même si les travaux parlementaires aboutissent à des résultats intéressants, ils sont souvent négligés par la suite. Nous souhaitons cette fois-ci qu'ils débouchent sur des résultats tangibles. Toutes les banques importantes au niveau mondial et notamment les banques françaises sont fortement implantées dans les paradis fiscaux, compte tenu d'une part de l'importance de la finance qui y transite, d'autre part de la concurrence entre les banques. C'est donc tout le système qu'il faut modifier.
Pour autant, récemment, lorsque le gouvernement français a essayé de réguler le système par le biais de la loi, le lobby bancaire a fait pression arguant de la concurrence avec les banques étrangères. Ainsi, chaque gouvernement, pour défendre sa place financière, répond aux sollicitations plus ou moins pressantes et prégnantes du lobby bancaire. Les paradis fiscaux qui permettent une évasion fiscale énorme expliquent quant à eux, en partie, les déficits publics et le fait que les pouvoirs publics soient dépendants des prêteurs et des marchés financiers.
Les banques françaises ne sont plus imposées que de 8 %.L'impôt sur les sociétés, qui s'élevait à 50 % il y a 15 ou 20 ans n'est plus que de 33 % aujourd'hui - 25 à 27 % pour les PME, d'où une concurrence déloyale entre les entreprises. En outre, la plupart des paradis fiscaux sont dépendants des places financières importantes. La City rayonne ainsi sur 50 % des paradis fiscaux - en tout cas de ceux que l'on recense, pas forcément ceux qui sont indiqués dans les listes noires ou grises. C'est pour cela qu'elle demeure une place financière prépondérante au niveau mondial, alors que la Grande-Bretagne n'est plus un pays dominant au niveau économique et financier.
Les législations financières, fiscales, sociales, judiciaires, policières et environnementales des paradis fiscaux sont souvent faites sur mesure par des experts, des avocats d'affaires, des hommes d'affaires. Une partie de la législation de la Barbade a notamment été rédigée par des Canadiens, pour la place financière de Toronto. Démanteler ce système implique donc de lutter à la fois sur les territoires et consécutivement sur les places financières, mais également sur les principaux clients - multinationales et riches particuliers - et les intermédiaires plus ou moins complices du système, tels que les banques et avocats d'affaires.

L'aboutissement des commissions d'enquête est un sujet qui nous préoccupe. Nous y porterons une attention particulière, notamment lors des prochaines auditions.
Terre solidaire, coordinatrice de la Plate-forme Paradis fiscaux et judiciaires. - Nous souhaitons proposer à nouveau une mesure déjà évoquée l'année dernière, et sur laquelle des progrès ont été accomplis. Nous estimons en effet que la transparence comptable exercée pays par pays permettra de définir précisément les motifs de concentration des filiales dans les paradis fiscaux. L'objectif est de déterminer si les niveaux d'activité, de chiffre d'affaires, de bénéfices déclarés et d'impôts versés paraissent cohérents par rapport à la répartition géographique des activités.
Nous espérons pour notre part que la réforme introduite dans la loi bancaire française passera lors de sa deuxième lecture. Quoi qu'il en soit, elle a été dupliquée immédiatement au niveau européen. Ainsi, un accord a été trouvé entre le Conseil et le Parlement européen dans le cadre de la directive CRD 4 qui transpose les règles de Bâle 3 en matière de ratio de fonds propres par rapport à ce que les banques peuvent prêter. La règle doit maintenant être appliquée afin que nous puissions nous servir des données et que ces dernières soient rendues publiques en annexe des rapports des banques.
Cette séquence a permis de montrer qu'en dépit des difficultés, un pays comme la France est capable d'enclencher une dynamique au niveau européen et d'engager des réformes européennes pourtant dont on nous avait souvent dit qu'elles étaient vouées à l'échec. C'est une belle leçon pour l'action politique ; elle affirme le poids que peut avoir notre pays dans des décisions européennes en matière de régulation financière.
Une deuxième mesure évoquée l'année dernière mais sur laquelle il reste des progrès à faire concerne la transparence et l'échange automatique de la part des banques. La loi FATCA, votée en 2010 par les Etats-Unis de façon unilatérale, a notamment une portée extraterritoriale importante. Elle prévoit ainsi que les institutions financières du monde entier présentes sur les marchés financiers américains sont obligées de donner au fisc américain des informations sur les détenteurs américains de comptes bancaires, qu'ils soient entreprises ou particuliers. La sanction prévue en cas de non-respect de cette mesure est d'un montant exorbitant et de nature à exclure les établissements financiers des marchés financiers américains. Elle se traduirait par une retenue de 30 % à la source pour tous les revenus issus des marchés financiers américains, que ce soit pour compte propre de la banque ou pour le compte de ses clients. La loi FATCA est donc une mesure forte pensée par l'administration américaine; elle lui permettra de récupérer les noms et les données des comptes bancaires des Américains partout dans le monde.
Dans la foulée de cette mesure, les USA se sont lancés dans des négociations d'accords bilatéraux sur l'échange automatique d'informations. En effet, un certain nombre de pays dont la France, l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Espagne ont demandé à l'OCDE de réfléchir à un modèle d'échange bilatéral automatique d'informations. L'objectif était d'encadrer la transmission d'informations relatives aux institutions financières en passant par leurs administrations fiscales et non plus que les données soient adressées directement au fisc américain.
Ces accords sont en cours de signature dans une cinquantaine d'Etats. La réciprocité est effective dans certains pays mais ne l'est pas en Suisse ou au Japon qui ne sont pas intéressés par une information sur leurs propres résidents. Mais le FATCA va continuer de s'appliquer aussi aux pour les banques situées dans les Etats qui n'auront pas signé d'accord bilatéral d'échange d'informations avec les USA. Toutes les institutions financières de ces pays seront ainsi tenues de transmettre leurs informations au fisc américain sous peine de retenues à la source très importantes.
Aujourd'hui, une règle Fatca à l'européenne est évoquée mais son objectif diffère en réalité. En effet, les pays qui signeront ces accords avec les Etats-Unis prévoient d'échanger entre eux les informations recueillies. Nous sommes cependant encore loin d'une règle qui stipulerait que toutes les institutions financières du monde entier doivent rapporter de façon automatique au fisc de tous les pays européens les informations relatives aux comptes bancaires basés à Singapour ou aux Iles Caïmans. Nous pensons que pour aller plus loin, et pour construire à terme un standard d'échange automatique d'informations entre tous les pays, il est fondamental que l'Union européenne - et au premier chef la France - annonce son intention de mettre en place une règle de type Fatca, avec obligation pour les banques de déclarer les informations dont elles disposent. Une proposition de loi allant dans ce sens et nous paraissant intéressante a notamment été présentée par le Groupe Europe écologie les verts à l'Assemblée nationale ; elle nous paraît de nature à déclencher des négociations prometteuses au niveau européen sur ce sujet. Les Etats-Unis ont réalisé la partie la plus difficile de ce programme ; nous devons maintenant réclamer les mêmes mesures pour nos propres résidents.
Les moyens permettant l'échange automatique d'informations ne suffiront pas néanmoins ; il convient en également de déterminer comment collecter efficacement les informations échangées, tant en France qu'à l'étranger. Nous avons effectué une étude sur les différents registres des comptes bancaires existants. A ce titre, le FICOBA - registre des comptes bancaires français - est réputé être un très bon outil. Pourtant, comparer les mécanismes similaires existant dans d'autres pays a permis de faire apparaître une incertitude relative aux détenteurs réels des comptes bancaires puisqu'il n'existe pas d'obligation explicite de chercher le bénéficiaire ultime du compte. A l'inverse, cette contrainte est spécifiée au Danemark par exemple.
M. Eric Bocquet, sénateur. - Le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur l'évasion fiscale internationale a été voté à l'unanimité mais, de l'avis général, une suite doit lui être donnée. Notre très grande détermination nous amène notamment à lancer cette deuxième commission d'enquête sur le rôle plus particulier des banques et des acteurs financiers d'une part, sur la régulation d'autre part.
Le contexte est toutefois un peu différent par rapport à l'année dernière. Votre audition a en effet beaucoup marqué nos travaux et avait fait référence, tant par son contenu que par votre dynamisme dont vous témoignez encore aujourd'hui. Le chantier est immense et nous le savions. Il faudra y mettre beaucoup d'énergie, du temps, de la volonté et beaucoup de détermination, ce dont nous ne manquons pas.
Nous sommes d'accord sur le constat. Vous parliez de la présence des banques françaises dans les paradis fiscaux, dont le nombre est au mieux stabilisé, au pire en progression. J'ai en tête également une audition de Monsieur Saint Amans à la commission des finances il y a quelques semaines, qui faisait état de l'augmentation du nombre de schémas d'optimisation, estimé à 350 il y a un an et à 400 cette année. Le phénomène n'est donc pas du tout à l'arrêt, d'autant que dans le même temps, l'opinion publique a été sensibilisée et que le sujet est à l'ordre du jour des travaux menés à l'Assemblée nationale.
Pour ma part, je souhaite quelques précisions.
Tout d'abord, vous avez indiqué qu'une filiale sur quatre des banques dont vous avez examiné la structure était implantée dans un paradis fiscal. Pensez-vous à certaines banques en particulier ? Selon vous, quel est l'intérêt de cette présence dans les paradis fiscaux ?
Il existe par ailleurs dans les banques des moyens de contrôle et d'audit interne. Ces services jouent-ils leur rôle ou se rendent-ils complices de l'évasion fiscale ? Si oui, de quelle manière ?
Egalement, avez-vous pu identifier le rôle des banques et autres opérateurs financiers dans la diversion des ressources financières ? Je pense notamment aux holdings financiers et aux trusts, qui sont aussi des outils de l'opacité.
Enfin, dans vos recherches, quelles ont été les principales résistances et obstacles à l'avancée vers la transparence que vous et nous avons appelée de nos voeux ?
Nous serons assez modestes dans nos réponses ; en effet, aucun de nous n'est banquier de profession.
Que font les banques dans les paradis fiscaux ? Elles seules pourraient fournir une réponse précise. Plusieurs motifs clairs apparaissent toutefois. Ainsi, dans certains territoires que nous considérons comme des paradis fiscaux, peut exister une activité de crédit classique et une véritable clientèle de banque. Ensuite, il existe potentiellement des activités pour compte propre de contournement des législations prudentielles. Jean Pierre Jouyet, que j'ai interviewé pour la Revue Projet sur la question de la lutte contre les paradis fiscaux lorsqu'il était à la tête de l'AMF, avait notamment reconnu le manque patent d'avancée sur le sujet. Enfin, il existe aussi, à en croire les banques, un certain nombre d'activités ou de schémas financiers que seuls les paradis fiscaux permettent. Par exemple, les Iles Caïman sont spécialisées dans le leasing et dans les montages financiers pour le secteur aérien - c'est l'une des justifications de BNP-Paribas sur sa présence sur ce territoire. Nous savons également que le Luxembourg permet des montages financiers spécifiques, parfois pour des activités d'intérêt général comme le financement des micro-crédits.
Les moyens de contrôle s'améliorent toutefois de manière importante depuis plus de dix ans, afin de lutter contre le blanchiment de l'argent. Depuis l'affaire du Sentier et après que Monsieur Bouton ait été menacé de se retrouver derrière les barreaux, les équipes dédiées à ces contrôles ont été renforcées ; elles font preuve d'une vigilance accrue quant à la provenance des fonds. Est-ce pour autant satisfaisant ?
Dans les statistiques de Tracfin, qui recueille les déclarations de soupçons, les banques apparaissent comme les bons élèves. En effet, sur 19 000 déclarations de soupçons reçues en 2010 par Tracfin, 13 000 proviennent des banques. Pour autant, depuis la troisième directive anti-blanchiment, les établissements financiers doivent théoriquement effectuer une déclaration lorsqu'elles soupçonnent certains fonds d'être le fruit de la fraude fiscale. Or, les déclarations de soupçons reçues par Tracfin n'ont un motif fiscal que dans 8,6 % des cas (chiffres de 2010), un taux estimé comme faible.
Quels sont les contrôles effectués dans les banques sur l'effectivité des contrôles anti-blanchiment ? Il serait intéressant de poser la question à la Banque de France. Je souhaite par ailleurs revenir sur un exemple sur lequel a travaillé SHERPA ces dernières semaines. Il apparaît notamment que selon un rapport interne à la BNP, la filiale monégasque de BNP-Paribas a reçu entre 2008 et 2011, en provenance de plusieurs pays d'Afrique ainsi que de Madagascar, des milliers de chèques libellés en euros, détournés de leur raison économique à l'insu des autorités de contrôle des changes. Nous pouvons donc imaginer qu'il existe à la base une fraude fiscale. Les personnes qui ont intérêt à rapatrier des fonds sans que les autorités le sachent cherchent peut-être à cacher les bénéfices de leur entreprise. Pour autant, à aucun moment, BNP Paribas-Monaco n'a fait de déclaration de soupçon à Sicfin, équivalent monégasque de Tracfin. Nous voyons bien ici qu'il y a encore des progrès à faire en matière de vigilance sur la provenance des fonds. J'ajouterais que dans cette affaire, la justice monégasque que nous avons alertée dès la mi-avril 2013, n'a pas jugé bon, à ce jour, d'ouvrir une information judiciaire.
Terre solidaire, coordinatrice de la Plate-forme Paradis fiscaux et judiciaires. - Pour compléter ce propos, une enquête avait été menée par l'autorité des services financiers britanniques en 2011, montrant que dans 70 % des banques, les contrôles internes étaient insuffisants, y compris dans les plus grandes banques britanniques. Nous pensons qu'il faudrait contrôler non seulement la qualité des procédures, mais aussi effectuer des contrôles aléatoires sur des dossiers clients pour vérifier que les procédures affichées et mises en avant sont réellement mises en oeuvre.
A travers une série d'articles parus dans la presse et les médias sur l'utilisation des paradis fiscaux - principalement concernant la BNP - nous pouvons toutefois constater différentes finalités. Parfois, l'objectif est de réduire la facture fiscale de la banque elle-même, c'est le cas par exemple la filiale monégasque de BNP-Paribas. Dans d'autres cas, il s'agit de montages pour leurs clients. Nous avons essayé d'interroger la BNP à plusieurs reprises sur les documents révélés par Libération le 22 mai 2012 mais nous n'avons jamais obtenu de réponse. J'imagine que vous aurez plus de moyens que nous le faire. Par ailleurs, les dernières révélations d'Offshore Leaks dans Le Monde sont très claires sur l'utilisation de filiales notamment asiatiques par la BNP et le Crédit Agricole pour créer des sociétés « écrans » pour le compte de clients.
Le recours à des sociétés écrans dans les paradis fiscaux peut permettre notamment de dissimuler l'identité réelle des clients et pour, d'une part, aux banques d'échapper aux règles de prudence financière, d'autre part, aux clients d'échapper au fisc ou aux autorités judiciaires et/ou aux banques de réduire leur facture d'impôt ou de contourner les règles de prudence financière.
Lorsqu'elles sont interrogées, les banques affirment néanmoins avoir mis fin à ces pratiques.
Toutefois, le code de conduite fiscale développé par la Société générale en 2010 montre que les engagements pris pourraient être contrôlés et renforcés. Par exemple, cette banque s'engage à « ne pas faciliter ou soutenir des opérations avec les clients dont l'efficacité repose sur la non-transmission d'informations aux autorités fiscales », à « ne pas mettre en place ou proposer des opérations à but exclusivement fiscal ». Autant d'engagements difficiles à mesurer. Nous pouvons dès lors nous interroger sur ce qu'il advient du « partiellement » fiscal ?
Longtemps, les banques n'ont pas eu à rendre compte de leurs activités et de leur code de conduite dans ce domaine. Aujourd'hui, elles commencent à le faire. L'activité de conseil qu'elles exercent pour leurs clients reste néanmoins une question délicate. Officiellement, elles affirment ne pas vouloir l'exercer ; elles déclarent même parfois qu'elles ne facturent pas ce service mais qu'elles l'offrent à leurs clients, ou encore qu'il n'est pas accessible à leurs clients français mais uniquement aux clients étrangers.
Si les banques ne sont pas présentes dans les paradis fiscaux, elles ne peuvent être reconnues au niveau mondial ni bénéficier de l'importante masse financière offshore. Ainsi, les fonds russes qui échappent au fisc russe reviennent en partie par Chypre, les banques y étant installées participant à ce blanchiment de l'argent. Chypre est l'un des premiers investisseurs en Russie, à l'instar de l'Ile Maurice en Inde, ou du Luxembourg en France.
Par ailleurs, des montages financiers s'effectueraient parfois dans les bureaux des banques à Paris, le client entrant dans une pièce spécifique pratiquement extraterritoriale afin d'être mis en relation avec une filiale basée à Hong Kong ou à Singapour.
Depuis une vingtaine d'années, en France et dans beaucoup d'autres pays, nous constatons une tendance lourde, consistant à laisser les entreprises s'autoréguler et s'autocontrôler dans beaucoup de secteurs d'activité. Ce processus, qui existe autant en matière de sécurité, de santé, et dans le domaine bancaire, permet de supprimer quelques emplois de fonctionnaires et d'augmenter la liberté des entreprises. Ainsi, le système politique aujourd'hui accorde plus ou moins sa confiance aux entreprises ; il revient ensuite aux organismes publics, neutres et indépendants, de s'assurer simplement de l'existence de ce contrôle interne.

Concernant la rémunération des personnes en charge du contrôle interne des banques, pensez-vous d'une part qu'elle est nettement supérieure à celle des agents du fisc, d'autre part qu'elle leur permet de garantir leur indépendance ?
Je connais la rémunération des agents du fisc, mais pas celle des personnes en charge du contrôle interne des banques. Il y a 15 ou 20 ans, les jeunes inspecteurs élèves passaient par l'Ecole des impôts, restaient quelques années dans l'Administration fiscale, puis étaient sollicités pour être embauchés dans le privé. Le critère financier intervenait de manière importante dans ce choix individuel. Le problème de l'indépendance des contrôleurs se pose pour le système bancaire, comme dans d'autres domaines.
Au Royaume-Uni, depuis 2004, la une loi (dite DOTAS) oblige les intermédiaires juridiques et financiers à déclarer aux autorités fiscales l'ensemble des montages qu'ils commercialisent pour éviter l'impôt. D'après un ancien inspecteur du fisc britannique, cette seule mesure aurait apporté à l'administration fiscale 12,5 milliards de livres sterling en quelques années. C'est une mesure qui est aussi appliquée au Canada, aux Etats-Unis, en Australie, en Irlande. En France, une mesure semblable fut envisagée par le Premier Ministre en septembre 2005, mais n'a jamais abouti.

Il me semble que cette procédure existe aussi en France, mais de façon embryonnaire, avec la possibilité de soumettre à l'administration fiscale un montage financier pour qu'il évite l'abus de droit.
Deux autres pistes existent en la matière. L'une d'entre elles a été suivie par les Etats Unis au moment de l'affaire UBS. À l'issue d'un bras de fer avec la Suisse, les États-Unis on tobtenu 4 450 noms d'UBS. Ils ont ensuite menacé les fraudeurs et leur ont demandé de venir non seulement se dénoncer eux-mêmes, mais aussi expliquer au fisc les montages qui leur avaient été vendus. Résultat, près de 15 000 personnes sont venues se dénoncer et les États-Unis disposent aujourd'hui d'une cartographie très fine des schémas d'optimisation ou d'évasion fiscale.
Une loi va par ailleurs être débattue à l'Assemblée nationale ces prochains jours. Elle prévoit de créer le délit de fraude fiscale en bande organisée, lequel peut être mis en parallèle avec le délit de vol en bande organisée qui existe déjà. Ainsi, selon l'article 330 311-9-1 du code pénal, toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée est exemptée de peine si, ayant averti l'autorité administrative et judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction. En outre, lorsque l'infraction est en cours, le complice qui la dénonce et qui permet de stopper la réalisation de l'infraction, peut voir sa peine divisée par deux. Nous pourrions ainsi nous inspirer de ces mesures dans le cadre de cette nouvelle loi sur la fraude fiscale en bande organisée.
Chargée de plaidoyer au Comité catholique contre la faim et pour le développement, (CCFD)-Terre solidaire, coordinatrice de la Plate-forme Paradis fiscaux et judiciaires. - Aujourd'hui, les sanctions et les amendes financières à l'encontre des banques mises en cause au niveau international pour des défaillances sérieuses ou systémiques dans leur système de contrôle interne sont souvent très faibles. Dans le cas par exemple d'une filiale de la Royal Bank of Scotland, la sanction s'était élevée seulement à 2 % des profits avant impôts. Dans ce contexte, il reste très rentable de ne pas être trop regardant sur l'origine des fonds et sur l'application du droit. Il faut donc absolument proportionner des sanctions financières aux gains retirés de ce type d'activité.

Monsieur le Président, je partage votre sentiment, comme celui de notre rapporteur, sur le fait que cette commission et le rapport qui suivra ne resteront pas lettre morte. C'est la moindre des choses dans le cadre d'une telle démarche.
Hasard du calendrier, nous débutons notre enquête le jour d'un sommet dont on nous dit qu'il est prometteur. J'ai toutefois bien compris que certains Etats étaient prêts à faire des concessions, à condition que d'autres suivent, ce qui peut nous condamner à l'immobilisme.
Je remercie nos interlocuteurs de la qualité de leurs réponses, et de la continuité dans les efforts qu'ils mènent au sein de leurs organismes respectifs. J'ai pour ma part trois questions à leur poser.
Tout d'abord, il existe des études montrant que l'aide publique au développement est dépourvue d'efficacité, en raison d'un détournement de cette aide. Avez-vous examiné cette hypothèse ?
Considérez-vous ensuite que la France et l'Europe sont assez vigilantes sur cette question, ou qu'il faudrait prendre davantage de garanties, et si oui, lesquelles ?
Enfin, avez-vous examiné les conditions concrètes du fonctionnement du système bancaire en Afrique ?

Vous êtes intervenus devant notre commission en 2012. Vous aviez effectué des interventions très complètes auxquelles votre audition d'aujourd'hui apporte peu d'éléments nouveaux. Dès lors, elle paraît moins complète. Vous manifestez notamment des attentes et vous nous questionnez par rapport à notre volonté d'action dans la lutte contre l'évasion fiscale. Nous avons quand même obtenu de haute lutte la mise en place de quelques dispositions législatives. Le Président, le Rapporteur et les membres, à chaque fois qu'il a été possible de le faire, ont rappelé les travaux de la commission d'enquête. Je ne crois pas que cette maison ait montré sur bon nombre de sujets plus de ténacité dans un délai aussi court. Ainsi, si nous prenons l'exemple de la sécurité du médicament, après le Viox et le Mediator, la loi sur le médicament est loin d'avoir apporté toutes ses solutions.
J'ai, quant à moi, également quelques questions à vous poser. Pourriez-vous tout d'abord effectuer un point sur les améliorations que vous avez constatées cette année ? Ensuite, en tant qu'associations très actives - vous êtes un peu les « justiciers » de la fiscalité - avez-vous effectué des saisines du parquet ou déclenché des déclarations de soupçons ? Par ailleurs, avez-vous une action directe sur les acteurs que vous dénoncez justement ? Enfin, comment êtes-vous financés ?
Chargée de plaidoyer au Comité catholique contre la faim et pour le développement, (CCFD)-Terre solidaire, coordinatrice de la Plate-forme Paradis fiscaux et judiciaires. - Il existe plusieurs canaux par lesquels l'aide publique au développement peut être détournée. Aujourd'hui, nous constatons qu'une grande partie de celle accordée par la France passe par le soutien au secteur privé pour encourager la croissance et le dynamisme économique ; dès lors, les règles déterminant les conditions d'accès à des subventions de l'Agence française de développement ou de sa filiale PROPARCO doivent encore être renforcées dans le domaine de la responsabilité fiscale. L'Agence Française de Développement vient tout juste de se doter à ce sujet d'une règle interne stipulant que l'aide ne doit plus transiter par les paradis fiscaux. Aujourd'hui plus de la moitié de l'intervention de PROPARCO passe par des intermédiaires financiers (banques ou fonds d'investissements) localisés notamment dans des centres financiers offshore. La France vient donc d'établir une liste de territoires des centres désormais interdits, à partir d'une compilation de plusieurs listes (celle de l'OCDE utilisée par la Banque centrale, et la liste ETNC française, etc.). Ce texte de mesure a été annoncé hier par le ministre du Développement.
Nous pourrions aussi demander plus de transparence fiscale aux entreprises bénéficiant de ces soutiens et de ces financements publics, afin de s'assurer qu'elles paient effectivement des impôts à la hauteur de leur activité et de la richesse qu'elles créent dans les pays en développement. Nous avons porté cette proposition pendant la campagne présidentielle et législative, mais nous avons du mal à la faire passer. Les liens entre fiscalité et développement constituent des sujets traités par les Nations Unies, l'UE ou l'OCDE sur lesquels la France a été en pointe.
Je n'ai, par ailleurs, pas particulièrement travaillé sur le thème du fonctionnement bancaire en Afrique, je ne me hasarderai donc pas à vous répondre sur ce point.
En termes de points d'amélioration, nombre d'événements sont notables depuis l'année dernière. En quelques mois, les déclarations se sont considérablement accélérées. Parmi les avancées, nous retenons évidemment le reporting par pays qui représente l'aboutissement de dix ans de mobilisation de la société civile. Nous avons entendu les annonces du Président de la République et du Premier ministre sur l'importance de l'étendre à d'autres secteurs d'activité et nous serons bien sûr vigilants sur ces sujets.
Notons également que l'OCDE a ouvert un processus BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), relatif aux érosions des assiettes fiscales et aux transferts de profits. Pour la première fois, l'OCDE reconnaît qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème spécifique aux pays en développement, en raison de leur administration fiscale qui serait corrompue, mal formée ou mal payée. Un pré-rapport publié en février 2013 détecte en effet un véritable problème avec la fiscalité des entreprises multinationales au niveau mondial, pensée dans les années 1920 et qui n'est plus adaptée à notre époque. Ainsi, aujourd'hui, le contournement de l'impôt est devenu la règle. Les accords qui permettent d'éviter la double imposition aboutissent à ce que les entreprises ne paient plus d'impôt nulle part. En conséquence, tout le monde est perdant, sauf les paradis fiscaux qui attirent des activités artificielles pour enregistrer des profits en réalité générés ailleurs. Sur ces questions, nous commençons à rencontrer un écho favorable. Reste à savoir quelles seront les mesures concrètes retenues.
Nous sommes toutefois un peu inquiets. En effet, au niveau français, à travers les discussions menées avec Bercy, nous sentons une volonté d'agir sur le secteur du numérique, mais pas forcément sur l'ensemble des secteurs d'activité. Je pense pourtant que les mêmes dispositifs prévalent pour Google et les grandes multinationales françaises lorsqu'elles tentent de contourner l'impôt.
En dernière avancée, il apparaît clairement que tout le monde partage désormais ce sentiment qu'il faut développer les échanges automatiques d'informations. Cette contrainte pourrait constituer un nouveau critère d'évaluation des pays dans le Forum fiscal mondial. La liste française des paradis fiscaux pourrait aussi reprendre ce critère-là.
Enfin, concernant le financement du CCFD, il est assuré à hauteur de 9180 % environ par des dons privés individuels, et en partie par un financement public, notamment pour soutenir l'activité de nos partenaires dans des pays africains, asiatiques, et d'Amérique Latine. Nous ne menons pas d'action directe en justice, parce que ce n'est pas notre mandat.

En tant que doyen, j'avais félicité le président et le rapporteur pour le premier rapport qui avait été établi et que nous souhaitons, comme les autres, voir aboutir à des actions concrètes. Nous devons dès lors bénéficier des éléments sur lesquels nous appuyer pour proposer des orientations ou des amendements.
Avez-vous eu ainsi la possibilité de conduire des investigations en profondeur ? De même, avez-vous obtenu des éléments vous permettant de bien connaître le fonctionnement et les objectifs des personnes ou des organismes bancaires qui interviennent dans les paradis fiscaux ?
Vous nous avez par ailleurs confié n'avoir pas obtenu de réponse à certaines questions que vous aviez posées au système bancaire. La différence, dans le cadre d'une audition au Sénat, c'est que les intervenants devront prêter serment. Ils prennent donc le risque de sanctions s'ils nous fournissent des informations erronées ou s'ils ne répondent pas aux questions posées alors même qu'ils disposeraient d'éléments de réponse. Dès lors, avez-vous des questions qui vous paraissent importantes et que nous pourrions poser nous-mêmes, avec plus de garantie quant à leur réponse ?
Je rappelle que j'ai été secrétaire général du syndicat des impôts. Il y a une vingtaine d'années, vous disposiez chaque année d'informations détenues par l'administration fiscale sur le nombre et les résultats des contrôles fiscaux de l'année précédente, profession par profession. Vous pouviez par exemple connaître le nombre de bouchers charcutiers inscrits en France, ainsi que le nombre de contrôles fiscaux dans cette profession et leurs résultats. Ces informations permettaient de faire apparaître que les cultivateurs étaient contrôlés en moyenne tous les 102 ans, et les multinationales l'étaient tous les 18 ans, souvent de façon très partielle. Par exemple, la totalité des factures d'achat sur une année pour un groupe comme Total représentait trois camions ; or nous ne disposions que de quelques semaines pour tout vérifier.
Vous n'avez plus accès à ces informations, et nous souhaiterions qu'elles vous soient communiquées à nouveau. Elles sont importantes en termes de transparence et permettraient de déceler que la fraude fiscale, dont la fourchette haute est actuellement estimée à 80 milliards d'euros, est en réalité beaucoup plus importante. Le contrôle fiscal rapporte aujourd'hui environ 10 à 15 milliards, respectivement 10 milliards pour le contrôle fiscal externe, 5 milliards pour le contrôle fiscal du bureau. En contrôlant les entreprises tous les 50 ans, nous pourrions ainsi récupérer 15 ou 20 % de la fraude.
Concernant les améliorations apportées, le Conseil des Ministres du 10 avril a fait des annonces intéressantes, notamment quelques créations d'emplois d'inspecteurs vérificateurs, et un renforcement des sanctions pénales. Cependant, il ne s'agissait que d'annonces. Si elles se transforment en textes mis en application, elles participeront aux résultats positifs engrangés depuis 12 mois.
Je terminerai sur le fonctionnement d'ATTAC. Nous sommes une petite association de 12 000 à 15 000 membres financée par des cotisations, et bénévoles.
Portons-nous plainte sur ces affaires fiscales ? Aujourd'hui, seule la commission fiscale de Bercy a le monopole de la transmission des dossiers fiscaux au Parquet, ce qui pose une vraie question. En matière de corruption le problème était similaire. Il existait notamment un monopole de l'action publique, réservée à l'Etat, jusqu'à ce qu'un arrêt de la Cour de Cassation du 9 novembre 2010 (dans l'affaire dite des biens mal acquis) estime que des associations anti-corruption pouvaient engager l'action publique.
Il est important, concernant ces affaires de fraude fiscale, de ne pas compter uniquement sur l'administration fiscale pour déclencher l'action judiciaire. Aujourd'hui, il existe environ un millier de condamnations pénales dans des dossiers fiscaux. Pour autant, une soixantaine seulement aboutit à des peines de prison. Je m'interroge quant à moi sur le nombre d'intermédiaires condamnés chaque année.
Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Nous entendons le Premier ministre britannique déclarer qu'il n'est plus acceptable d'avoir une structure juridique au monde dont on ne connaisse pas le propriétaire. Sans doute y a-t-il une part d'hypocrisie importante dans ce propos sachant la prospérité que le Royaume-Uni doit au trust mais faisons-lui confianceprenons-le au mot ! Si le Luxembourg, la Suisse et l'Autriche, pour leur part, résistent à céder sur l'échange automatique d'information, c'est qu'ils ont peur que le marché parte au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis. Ce serait une grande hypocrisie si le G8 ne s'achevait pas avec l'engagement de chacun des Etats à disposer d'un registre public des trusts. Les banques jouent un rôle important dans ce contrat à trois que constitue le trust.
Concernant les moyens d'investigation, nous sommes une petite équipe ; nous n'avons pas mené d'investigation approfondie au sein des banques. En revanche, j'ai trouvé très intéressante l'annonce de l'autorité allemande des marchés financiers (la BaFin) relative à la mise en place d'inspections au sein des banques sur leurs activités dans les paradis fiscaux, notamment l'activité de gestion de patrimoine. Si les autorités allemandes le font, rien n'empêchera le les autorités françaises de les `imiter !
Quant aux moyens de l'administration fiscale, depuis des années, nous constatons une réduction assez sévère des postes de vérificateurs. Pourtant, selon les chiffres du syndicat des impôts, chaque vérificateur rapporterait environ 2,3 millions d'euros. Même si on peut penser que ce syndicat est un peu juge et partie, le renforcement des équipes pourrait s'avérer très rentable.
Dernier point, que peut-on faire au niveau français ? Depuis le début de l'Offshore Leaks, et avec l'affaire Cahuzac, le gouvernement semble renvoyer le problème au niveau européen. Je n'ai entendu aucun argument qui justifierait de ne pas mettre en place la loi Fatca en France. Les Etats-Unis l'ont fait, pourquoi la France ne pourrait-elle pas le faire également ? L'échanges d'informations au niveau international est intéressant, mais un échange franco-français semble également une piste intéressante. Par exemple, si l'on en croit les déclarations d'Antoine Peillon sur l'affaire UBS, la DCRI elle-même non seulement n'aurait pas transmis les informations à l'administration fiscale mais les aurait détruites pour ne pas qu'elles lui parviennent.
Concernant le financement de SHERPA, nous sommes une petite équipe et nous recevons des fonds de la part de fondations allemandes, françaises, américaines ou africaines. Moi-même je suis bénévole.

Nous disposons quand même d'un rapport de la division des enquêtes fiscales nationales et internationales qui me semble assez complet sur le nombre de contrôles et leurs résultats. Notamment, pour la division internationale, plusieurs chapitres traitent de la difficulté des agents à cerner le prix des produits et du fait qu'ils ne sont pas en capacité de contrôler des données dont ils ne maîtrisent pas techniquement la teneur.
M. Yvon Collin, sénateur. - Vous paraît-il pertinent que la commission auditionne Proparco et l'AFD pour avoir leur avis ?
Chargée de plaidoyer au Comité catholique contre la faim et pour le développement, (CCFD)-Terre solidaire, coordinatrice de la Plate-forme Paradis fiscaux et judiciaires. - J'ai rencontré le directeur de la direction des risques à l'AFD, qui m'a présenté les nouvelles procédures de contrôle interne en vigueur dans l'Agence. En effet, l'AFD ayant le statut de banque, elle est également soumise aux mêmes règles en matière de blanchiment de l'argent. Je pense donc que cela peut être intéressant de l'interroger - d'autant plus que l'AFD est habilitée a à agir en tant qu'intermédiaire financier pour distribuer l'aide européenne.
A l'heure de penser notre contribution au développement, nous nous pensons souvent en tant que contribuables français : nous regardons souvent les flux qui sortent de France, et nous souhaitons savoir si ces fonds servent effectivement au développement des pays. Du point de vue des pays en question, la principale question n'est pas seulement l'évaporation des flux d'aides mais plus généralement celle des ressources du pays liées à la fraude fiscale. Le ministre de la Coopération a raison d'insister sur le fait que l'on aide ces pays encore plus en s'attaquant aux flux illicites sortants. Afin de parvenir à les réduire, il faut que l'échange automatique d'informations ne s'établisse pas seulement entre pays européen mais que nous en fassions bénéficier les pays du sud.

Nous sommes demandeurs des réponses écrites aux questions que je vous ai adressées et que nous n'avons pas eu le temps d'évoquer ici. En matière de liste des paradis fiscaux, vous évoquez de votre côté 60 territoires ou pays. Il existe également la liste de la France pour laquelle, à la date d'aujourd'hui et à ma connaissance, l'arrêté n'a pas été pris alors que ce processus emporte des conséquences juridiques. Nous connaissons aussi la liste des Etats-Unis et celle de l'OCDE. Autant de listes différentes représentent un vrai problème puisque nous n'avons pas de base commune. Ne faudrait-il pas retenir votre propre liste pour aboutir à une base fiable ?
Chargée de plaidoyer au Comité catholique contre la faim et pour le développement, (CCFD)-Terre solidaire, coordinatrice de la Plate-forme Paradis fiscaux et judiciaires. - Le Président de la République et le Premier ministre ont fait des déclarations concernant la mise à jour de la liste cette année et le fait qu'un certain nombre de pays qui n'auraient pas été efficaces dans la transmission et l'échange d'informations puisse y figurer. Nous avons progressé puisque nous disposons maintenant du rapport du gouvernement qui fournit le nombre de requêtes et le nombre d'informations transmises. Il sera malgré tout difficile d'établir une liste correcte, d'autant que la France s'interdit, de même que l'ensemble des pays de l'Union européenne, de désigner des pays de l'Union comme paradis fiscal. Nous savons également que le Forum fiscal mondial sur l'échange d'informations et la transparence publiera d'ici la fin de l'année une nouvelle liste sur la base des rapports d'évaluation produits depuis maintenant trois ans. Les critères existent. Le problème est d'une part la volonté politique d'avancer, d'autre part la capacité de nommer ses propres paradis fiscaux et ses dépendances politiques. Les Britanniques ont commencé cette démarche avec la lettre de Monsieur Cameron envoyée à toutes les dépendances de la Couronne et dans les territoires d'Outre-mer. A nous de faire de même avec Monaco, Andorre, et certains territoires d'Outre-mer.
Nous vous enverrons par écrit la liste des mesures qui peuvent être mises en oeuvre dès maintenant au niveau de la France, telles que la loi Fatca, la transmission des schémas d'optimisation fiscale par les intermédiaires, les registres des comptes bancaires, les registres des trusts, la proportionnalité des sanctions, l'effectivité des contrôles anti-blanchiment, etc.

Au nom de notre Commission, je vous remercie vivement de vos témoignages, de votre expertise et de votre enthousiasme.
Audition de M. Bernard Esambert ancien président-directeur général de la compagnie financière edmond de rothschild ancien membre du collègue de l'autorité des marchés financiers
Audition de M. Bernard Esambert ancien président-directeur général de la compagnie financière edmond de rothschild ancien membre du collègue de l'autorité des marchés financiers

Monsieur Bernard Esambert, conformément à l'article 6 de l'ordonnance mai du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, votre audition doit se tenir sous serment ; tout faux témoignage est passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du code pénal. Je vous demanderai donc de prêter serment en levant la main droite et en disant : « Je le jure ».

Vous avez la parole pour un exposé liminaire sur le sujet qui nous occupe...
C'est la première fois que je participe à une réunion de cette nature, et suis très heureux d'être présent.
S'agissant de la déontologie des marchés financiers, j'utiliserai l'image du verre à moitié plein et du verre à moitié vide.
Du côté du verre à moitié plein, notamment concernant les paradis fiscaux, les places offshore, ou tout autre moyen d'échapper à la fiscalité et à la vigilance financière des Etats, un certain nombre de progrès ont été réalisés depuis un G 20 remontant à quelques années, et qui avait confié à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) la mission de mettre fin à un certain nombre de ces places offshore. Plus récemment, des mesures ont également été envisagées à Bruxelles par la Commission.
Ceci a conduit à une forte réduction du nombre de ces places offshore qui, selon certains commentateurs, ne sont plus qu'au nombre d'une dizaine. La liste noire de l'OCDE aurait disparu, et la liste grise s'est réduite.
Du point de vue des Etats mis en cause, des progrès certains ont été accomplis depuis quelques années. Les textes en préparation, les directives ou les mesures envisagées par le G 8, le G 20 et l'OCDE, vont encore accroître la pression, notamment en Europe, sur des pays comme l'Autriche et le Luxembourg...
C'est là un point positif, qui résulte de la conjonction d'une unité de vue des grands Etats de l'OCDE -États-Unis, Grande-Bretagne, France - sur ce thème. On n'aurait pas imaginé cette conjonction il y a un certain nombre d'années...
Sur d'autres plans, comme l'élaboration de fonds de gestion alternatifs par les banques ou, plus généralement, par le système financier -hedge funds- des progrès ont également été accomplis. Ces hedge funds sont mieux régulés que par le passé en termes de possibilités d'emprunts ou de liquidités.
Dans un autre domaine, celui des délits d'initiés -que je connais un peu moins mal que les autres, l'Autorité des marchés financiers (AMF) m'ayant confié une mission et demandé des propositions pour réduire ces délits - un certain nombre de mesures ont été prises il y a sept ou huit ans. Le délit d'initié est maintenant mieux codifié, et l'on peut donc plus facilement poursuivre ceux qui profitent de connaissances que n'a pas le grand public.
Pour ce qui est du verre à moitié vide, les paradis fiscaux renaissent à mesure que d'autres disparaissent. Le Botswana va ainsi créer un paradis fiscal. C'est aussi le cas du Panama, de Dubaï, et d'un autre Etat d'Afrique, dont le nom m'échappe. Il existe par ailleurs encore des Etats ou des îles non régulés. On a braqué les projecteurs sur un certain nombre d'îles proches des côtes européennes, mais on a négligé des îles plus lointaines. Le Vanuatu continue ainsi à profiter de la liberté qu'il s'est arrogé en ce domaine.
La chasse aux paradis fiscaux n'est donc pas terminée, et la pression sur les banques, qui en font profiter leurs clients, est à peine amorcée. Il existe bien des projets de loi dans ce domaine, mais ils demeurent dans les limbes.
Quant aux hedge funds, ils continuent à se développer et à utiliser les ventes à découvert, moyen diabolique pour faire perdre des quantités d'argent cataclysmiques dans certains cas...
Concernant les délits d'initiés, même si les choses ont été codifiées, les sanctions étaient, lorsque j'ai quitté l'AMF, il y a un certain nombre d'années, relativement faibles. J'avais préconisé de les renforcer sensiblement, en multipliant par dix le plafond des sanctions pécuniaires et par deux ou presque le nombre d'années d'emprisonnement. Je ne sais si mon rapport a été suivi d'effets.
Nous avons, en France, un problème général : nous appliquons des sanctions nettement plus faibles que dans les grands pays développés, notamment les Etats-Unis ou dans les pays anglo-saxons. Je n'en connais pas les raisons, même si je les devine...
En second lieu, l'application de ces sanctions n'a pas, en France, le même niveau que dans d'autres pays. Aux États-Unis, les sanctions pécuniaires sont très élevées. C'est un moyen de négociation pour les autorités américaines, afin de permettre à ceux qui ont enfreint la réglementation de ne pas être poursuivis pénalement. Ces sanctions sont donc sans commune mesure avec celles que nous connaissons en France.
J'ai fait partie de la commission des sanctions de la Commission des opérations de bourse (COB), avant la création de l'AMF. Ces sanctions étaient fort limitées, voire ridicules dans certains cas, par rapport à celles que permet le système anglo-saxon ! Cette sorte de tradition française est à revoir. Je crois d'ailleurs qu'il existe un texte de loi en préparation qui va en ce sens.
Les sanctions sont appliquées chez nous de façon très timide, sauf par la Commission de la concurrence, qui profite de façon spectaculaire des plafonds qui lui sont autorisés. Les autres organismes n'en profitent pas ou peu. C'est notamment le cas de l'AMF, maintenant dotée d'une commission des sanctions distincte de son collège.
Nous avons donc encore des progrès à faire. Je ne suis pas un adepte de la sanction, mais je ne pense pas que l'on puisse poursuivre sévèrement, dans des domaines mineurs, ceux qui ont volé une pomme à l'étalage si on n'applique pas aux financiers, qui ont volé l'équivalent de millions de pommes des sanctions adaptées et puissantes !
Plus généralement, au-delà des mesures qui sont enfin prises, au travers d'une sorte de consensus des grandes nations, il existe un problème de déontologie du libéralisme et du système du marché dans lequel nous vivons, sans foi ni loi, qui a conduit, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, à un enrichissement moyen général de la planète énorme, laissant toutefois subsister des poches importantes de pauvreté, et permettant des enrichissements insolents, à l'autre extrémité du spectre.
Il y a, dans ce libéralisme formidablement efficace, un manque d'éthique et de déontologie. Le libéralisme est devenu, depuis la mort du communisme, une sorte de religion qui oriente tous nos comportements économiques. Ceci conduit les exclus de l'enrichissement que j'évoquais à aller vers les sectes ou l'extrémisme islamique, le libéralisme n'offrant pas à leurs yeux cet idéal qu'ils poursuivent, dans les voies que l'on sait et avec les conséquences que l'on sait.
Mon idée est probablement simpliste, mais j'essaye de la mettre en oeuvre et de faire créer ce code éthique du libéralisme par une structure apolitique, que l'on peut imaginer composée de représentants de toutes les grandes spiritualités, parmi lesquelles je place, en priorité, l'agnosticisme, les droits de l'homme, et autres modes de pensée...
Ce groupe pourrait être composé de représentants de ces spiritualités, de présidents d'ONG, de prix Nobel de la paix, et de quelques prix Nobel scientifiques. Je n'ose y inclure des prix Nobel de l'économie, généralement farouches défenseurs d'une économie de marché dans toute sa rigueur, mais sans ses vertus -sauf certains, comme Amartya Sen ou quelques autres...
J'essaye de mettre en place, sous l'égide de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), une sorte de concile d'une trentaine ou d'une quarantaine d'hommes et de femmes de cette nature. Réunis, ils établiraient ensemble les tables de la loi du libéralisme, supprimeraient définitivement le travail des enfants jusqu'à ce qu'ils soient autonomes, instaureraient l'égalité entre les hommes et les femmes, banniraient les enrichissements insolents et sans cause, etc.
Trente à quarante personnes, chargées de l'écriture d'un tel message, très bref, seraient choisies de telle sorte que chacun des sept milliards d'habitants de cette planète se sente représenté par l'un d'entre eux. L'élaboration d'un tel concile n'est donc pas forcément une tâche facile...
Je vous livre ces idées quelque peu fantasques pour attirer votre attention sur le fait que le thème de l'éthique dépasse à mes yeux celui des marchés financiers, qui reste cependant un signal fort qui, si on arrivait à la régler, permettrait au libéralisme d'être un peu moins mal perçu par tous ceux qui en sont exclus !

Ces propos liminaires sont pleins d'espoir !
La parole est au rapporteur...

Votre propos fait le lien avec les ONG que nous avons auditionnées avant vous.
Vous présentez, à votre façon, avec votre vision du monde -que je respecte par ailleurs - un monde solidaire. C'est un peu ce qui sous-tend votre propos, et qui le rend intéressant.
Vous avez été l'un de nos banquiers d'affaires et avez travaillé en tant que régulateur pour l'AMF. Ceci vous a permis d'évoluer au coeur du système bancaire et financier, objet même de notre commission d'enquête, qui commence ses travaux aujourd'hui.
Notre souci est d'en comprendre les mécanismes, les ressorts et, en particulier, ce qui sous-tend les pratiques les moins avouables, que vous avez vous-mêmes décrites, légales ou illégales. Vous avez émis des critiques sur ce système dérégulé, déréglementé, sans foi ni loi, pour reprendre vos propres termes.
Dans d'autres lieux, vous avez eu l'occasion de mettre à l'index les salaires indécents, la corruption, l'absence de morale. On voit bien votre philosophie générale... Vous militez pour une forme de moralisation du système en place.
Selon votre expérience, quelles failles intrinsèques du système conduisent-elles à l'absence de morale de ce système ? Que doit-on entendre par l'idée de « moraliser le libéralisme » ? Quels sont les chantiers à entreprendre, les solutions éventuelles pour ce faire ?
On entend parler d'amnistie fiscale pour les auteurs de ces méfaits. Quelle appréciation portez-vous sur cette technique ?
Par ailleurs, la crise financière que nous vivons est aussi une crise économique, politique, démocratique. Vous dites qu'elle est née en 2007-2008, avec la crise des subprimes, aux États-Unis. Comment aurait-on pu l'éviter ?
A-t-il été répondu de manière satisfaisante aux problèmes identifiés, avec un recul de cinq années ? Dans le cas contraire, que convient-il de faire ?
Avez-vous été amené, en tant que banquier d'affaires à contribuer au montage de système offshore dont il est beaucoup questions ces temps-ci ? Si tel est le cas, de quel type de montages s'agissait-il, et pour quel type de clients ?
Vous avez évolué dans ce monde, il y a quelques décennies de cela. Y a-t-il eu, selon vous, une évolution nette des comportements du monde de la finance depuis les années 1970, date à laquelle vous avez pris la tête de la banque Rothschild ? En trente ou quarante, durant la période de dérégulation que l'on a vécue, où les choses se sont accélérées, automatisées, quels changements de comportements avez-vous pu analyser ?
Enfin, l'AMF est-elle allée assez loin en matière de reprise en main du contrôle des acteurs financiers ? Que devrait-elle faire de plus, au regard de l'actualité récente et de la situation dans laquelle nous nous trouvons ?
Pourquoi en est-on arrivé là en matière d'application du libéralisme ? C'est la nature humaine qui est ici en cause ! Elle est ainsi faite qu'elle est très imaginative. C'est pourquoi j'évoquais l'idée de forte régulation, d'une part, et l'usage de la coercition d'autre part. Je ne suis pas partisan du bâton mais, dans le domaine financier, je ne vois pas pourquoi on ne l'emploierait pas à l'échelle des profits indus suscités par des comportements immoraux. C'est pourquoi je ne suis pas de ceux qui condamnent la création d'un parquet financier, s'il permet d'éviter la répétition de fraudes que l'on constate tous les jours !
Il n'y a pas un mois, dans le monde, où il n'y ait pas une affaire Enron, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Chase, ou Libor ! C'est donc qu'il existe un problème de comportements de ceux qui travaillent dans le secteur financier. Il faut que ceux-ci aient la même morale que ceux qui ne s'y trouvent pas.
Les solutions sont celles que les Etats mettent en oeuvre en régulant, après avoir dérégulé, là où il le faut. Il ne s'agit pas de réguler partout, bien au contraire, mais de savoir réguler avec efficacité, là où c'est vraiment nécessaire, en appliquant des peines sévères, en recourant peut-être un jour au code éthique du libéralisme que je souhaite voir mis en oeuvre.
J'avais écrit, en exergue de mon rapport sur le délit d'initié, que plus on s'élève dans la hiérarchie des hommes, plus on doit être exemplaire. Ceux qui profitent du délit d'initié doivent l'être en conséquence, occupant le plus souvent un échelon élevé de la hiérarchie. Malheureusement, on n'apprend plus la morale à l'école, comme c'était le cas dans mon enfance. J'ai appris sur les bancs de l'école que, plus on s'élève, plus on doit être insoupçonnable et irréprochable. Le code éthique peut ranimer cette morale, comme je le souhaite ardemment.
Pour ce qui est de l'amnistie fiscale, je suis favorable au fait que ceux qui ont fait sortir des capitaux les fassent revenir et travailler en France, afin de stimuler l'investissement mais, si amnistie il doit y avoir, je plaide plutôt pour une amnistie pénale. Je verrais bien un système -qui, je crois, est d'ailleurs en préparation - où les pénalités seraient fortement accrues, la rentrée de ces capitaux permettant en même temps à ceux qui y recourent de ne pas être poursuivis pénalement. Le tout, bien sûr, devrait être fait dans la plus grande transparence, en laissant aux seuls fonctionnaires le soin d'appliquer les nouveaux textes.
Pour ce qui est de la crise financière, et pour être bref, le départ, vous le savez tous, réside dans la fameuse crise immobilière américaine des subprimes et dans le fait que les banques américaines, pour faire davantage de crédits hypothécaires, ont titrisé leurs crédits et libéré le ventre de leurs banques. Elles se sont mises à créer une sorte de bulle gigantesque, bien au-delà de leurs ratios. Tout ce qui était dans le ventre des banques, au travers des crédits consentis, a été sorti et vendu à des financiers qui, eux-mêmes, l'ont revendu partout à travers le monde, les incorporant dans différents produits.
Je le sais d'autant mieux que, m'occupant de nombreuses fondations et associations charitables ou médicales, dont je gère la trésorerie, j'ai failli incorporer ces produits financiers venant des États-Unis. Cela n'aurait pas obéré complètement le maigre pactole des fondations dont je m'occupe, mais aurait néanmoins réduit une partie des dons que je reçois chaque année, ce qui aurait été fâcheux !
La suspicion entre banques a commencé ; celles-ci ne se sont plus prêté d'argent. Les banques centrales ont dû faire l'appoint, puis on s'est aperçu que les Etats étaient très endettés, à la fois en pourcentage de leur PIB et en matière de dette extérieure. La crise immobilière a dégénéré en crise mondiale de l'endettement pour un certain nombre d'Etats.
Comment l'empêcher ? Aurait-on pu l'éviter ? Oui, si on n'avait pas créé cette bulle immobilière aux États-Unis, qui a consisté à financer des achats de maisons sans apport des souscripteurs, lesquels étaient généralement endettés à 120 %.
L'excès a atteint son comble en permettant d'emprunter à ceux qui, de toute évidence, n'aurait jamais les moyens de rembourser. Les banques pensaient détenir un gage dans les valeurs immobilières, qui leur paraissaient devoir continuer à monter, alors qu'elles se sont au contraire effondrées. Il aurait fallu faire en sorte de ne pas créer cette bulle à l'origine de tous nos problèmes.
On ne va certes pas titriser à nouveau des créances immobilières, mais la prochaine bulle est en train de se constituer quelque part. Il y en a eu une tous les sept ans, depuis quarante ans, en moyenne, la première remontant à la crise pétrolière de 1973. Cette bulle éclatera ; si elle est modérée, les conséquences en seront très limitées. Si elle met en lumière l'endettement d'un certain nombre de nations, comme la crise de 2009, on risque d'avoir à nouveau des problèmes.
L'un d'eux est d'ailleurs devant nous, et ce depuis trente ou quarante ans : il s'agit de l'endettement des États-Unis, dont il faudra un jour se préoccuper. C'est le plus élevé de tous les pays développés mais, les États-Unis battant monnaie, avec un dollar qui tient le haut du pavé, cela n'a pour le moment pas de conséquences. Il faudra bien un jour que les nations développées disent leur vérité aux États-Unis et fassent en sorte que ceux-ci prennent eux-mêmes à leur tour les mesures que nous nous imposons tous en Europe, avec la sévérité, les excès et les problèmes auxquels cela conduit. Cela peut arriver dans dix, quinze, vingt ans -voire même plus tôt.
Comment empêcher la montée de la bulle ? Je n'ai pas de solution miracle ! En revanche, il faut dès maintenant faire pression sur les Etats-Unis pour les amener à quitter leur statut d'observateur en Europe, et prendre les mesures qui conviennent chez eux, afin de réduire leur endettement et faire en sorte que, le jour où la bulle éclatera, elle ne se traduise pas par un cataclysme américain !
Ai-je réalisé des montages offshore lorsque j'étais banquier ? Non. A l'époque, il y en avait très peu. J'ai fait mes classes au Crédit lyonnais de 1973 à 1977, puis j'ai été banquier, de 1977 à 1993. Il y avait probablement des montages offshore dans d'autres banques, mais j'avais ma conception de la banque.
J'ai été le conseiller industriel et scientifique de Georges Pompidou. J'étais vraiment un industrialiste saint-simonien, au sens fort du terme. Je suis arrivé dans la banque en considérant qu'elles devaient appuyer l'industrie. J'ai fait en sorte que la Compagnie financière aide les industriels à se développer, à s'implanter à l'étranger, à exporter davantage. Je l'ai fait de différentes façons, en particulier en améliorant leur trésorerie. J'avais développé un produit de trésorerie, copié par les Américains et les autres banques françaises. J'ai également développé des produits à l'exportation. Je considérais que les banques devaient jouer le rôle de pompes qui aspiraient les dépôts des particuliers pour les prêter aux entreprises, notamment industrielles. Ce faisant, elles aidaient au développement de leur pays, ce qu'elles faisaient d'ailleurs pour l'essentiel à l'époque.
Il existait d'autres façons de les aider. J'ai passé plusieurs semaines à observer ce qui se déroulait dans la Silicon Valley. J'avais créé un observatoire des valeurs de haute technologie, ce qui était nouveau en 1979. Je rapportais aux cinq premiers groupes français -Aérospatiale, Renault, Alcatel, EDF et un cinquième dont le nom m'échappe- toutes les affaires qui se créaient dans leur domaine, de façon à ce qu'ils puissent éventuellement les racheter et avoir une avance technologique dans leur secteur.
Je n'ai, en quoi que ce soit, utilisé de montages offshore, n'en ayant pas eu l'occasion. L'aurais-je fait si j'en avais eu la possibilité ? Je ne sais... A priori, je pense que non -mais on n'est jamais à l'abri de la tentation !

Dans le cadre de vos activités à l'AMF -époque bien plus récente, durant laquelle les montages offshore étaient largement en vigueur - avez-vous identifié des montages de ce genre ? Pourriez-vous nous les décrire ? Pour quel type de clients ? Qui en étaient bénéficiaires ?
Non, ce n'était pas le rôle de l'AMF de vérifier les montages offshore. Le législateur n'en avait pas décidé ainsi.
Faut-il lui confier cette tâche ? Les montages offshore sont le fait des structures financière et des banques. Je verrai donc plutôt ce rôle dévolu à la Commission bancaire -mais on peut aussi le confier à l'AMF. Je ne pense pas que ce soit encore le cas aujourd'hui...
L'AMF a pour objet de vérifier le bon fonctionnement des marchés intra-muros, les opérateurs devant respecter les régulations en cours mais ceci ne va pas jusqu'au montage des opérations offshore.

J'ai le sentiment que vous êtes une exception puisque vous avez exercé dans le privé, puis à l'AMF. En France, c'est souvent la haute administration qui fournit les banques d'affaires en grands dirigeants. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous une d'idée des critères de recrutement ?
On nous explique souvent que les grands mécanos que les banques d'affaires organisent - prises de contrôle, fusions acquisitions - sont fait pour créer des richesses. Ces richesses correspondent-elles à l'économie réelle ?
Par ailleurs, pouvez-vous détailler ce que vous avez dû contrôler et vérifier lorsque vous exerciez à l'AMF ?
D'autre part, beaucoup de ministères, dans des opérations de restructurations, choisissent des banques d'affaires pour les conseiller. Trouvez-vous cette démarche utile ou discutable ?
Enfin, le Japon a décidé de laisser filer sa dette. Ne pensez-vous pas que les Etats-Unis, banquiers du monde, s'ils étaient mis au pied du mur, pourraient bien faire la même chose ?

Cette audition offre une image pacifiée, qui tranche sur la précédente, qui était plutôt dans le mouvement, l'agitation et la revendication. Cette alternance de n'est pas désagréable...
En tant qu'avocate, j'ai assisté à la création du Marché des options négociables de Paris (MONEP), auquel votre remarque sur les ventes à découvert m'a fait penser...
Je suis par ailleurs une grande adepte du film « Inside Job », documentaire que j'ai vu une bonne demi-douzaine de fois. Je suggère d'ailleurs d'organiser une projection pour la commission d'enquête. Cette autopsie de la crise des subprimes permet de mieux comprendre comment fonctionne tout le système, y compris en matière de conflits d'intérêts...
Au vu de votre expérience, pouvez-vous nous indiquer quels sont les conflits d'intérêts les plus importants dans le domaine bancaire et financier ?
D'autre part, en matière de gouvernance de la zone euro, la crise de Chypre -qui sera sûrement suivie de beaucoup d'autres- nous montre toutes les limites des dispositifs bancaires, que l'on pourrait soit améliorer, soit éviter les difficultés.
On est ici dans l'imprécation, mais aussi dans la réflexion, le conflit d'intérêts étant à mon sens un problème majeur. Que recommanderiez vous, au niveau européen, pour réguler une crise qui risque d'avoir un effet « domino » ?

Quel est l'intérêt, pour les banques, d'être présentes dans les paradis fiscaux ? Je pense que vous ne nous l'avez pas vraiment dit...
Est-ce pour pouvoir y ouvrir une structure juridique intéressante ? S'agit il d'avoir de meilleures conditions d'exercice de l'activité bancaire ? A-t-on davantage accès à des fonds dans un paradis fiscal ? Peut-on prêter davantage et différemment ? Est-on hors fiscalité -je le crois. Les banques agissent-elles pour elles ou pour leurs clients ? Les techniques de titrisation sont-elles plus faciles à mettre en oeuvre dans un paradis fiscal ?
Il est très important pour les membres de cette commission d'enquête de comprendre l'intérêt des banques en la matière...
S'agissant du pantouflage, je l'ai écrit dans l'un de mes récents ouvrages, je suis contre, sous toutes ses formes, ou bien pour des pantouflages modestes, avec des hauts fonctionnaires -j'en ai fait partie - qui fassent leurs classes dans le groupe dans lequel ils envisagent de faire carrière, à un niveau très subalterne, à l'étranger, autant que faire se peut, afin de ne pas bénéficier de l'environnement de leur corps. On les jugera sur la façon dont ils auront su gérer une filiale, à 10 000 kilomètres du siège parisien où sévissent leurs petits camarades ! Ils pourront gravir, ce faisant, la hiérarchie de leur entreprise et accéder au poste suprême, s'ils font preuve des qualités nécessaires.
Je suis violemment contre les pantouflage des inspecteurs des finances, des ingénieurs du corps des mines, du corps des Ponts, de la Cour des comptes, qui arrivent immédiatement à la tête d'une entreprise qu'ils ne connaissent pas, dont ils n'ont pas le professionnalisme, ne connaissent pas les produits, la sensibilité de ceux-ci sur le marché mondial, puisqu'il faut maintenant raisonner mondialement !
Ce phénomène, sous sa forme actuelle, ne concerne d'ailleurs que la France...
Vous pensez là à des pantouflages dans des structures qui auraient pu être liées à l'activité antérieure. Je considère qu'en général, les commissions en question font preuve d'un laxisme excessif. Dans beaucoup de cas, elles ne devraient pas accepter ce qu'elles ont accepté !
S'agissant des opérations de fusion acquisition, les banquiers ont deux motivations. La première est de toucher des commissions importantes -elles sont proportionnelles aux opérations. La deuxième réside dans la gloire qui s'attache à avoir fusionné deux grands groupes, et à apparaître comme le banquier qui a eu l'idée de la fusion, ou qui l'a organisée au mieux.
Quand on étudie le bilan de toutes les opérations de fusion acquisition des grands groupes qui ont eu lieu depuis quarante ans en France, on s'aperçoit qu'environ une sur deux s'est traduite par un échec. Elle a été bien menée sur le plan du montage qui a conduit à la fusion et s'est ensuite avérée être un échec, les deux entreprises ne devant pas se marier, n'ayant pas en commun ce qui aurait permis à ce mariage d'être fructueux.
C'est un reproche que l'on peut faire aux banquiers d'affaires. Il faudra que vous leur posiez la question : ont-ils prêté suffisamment d'attention à l'avenir des groupes fusionnés lorsqu'ils ont organisé l'opération de rapprochement ? Un échec sur deux c'est un nombre important.
L'échec peut être partiel, mais seule une opération sur deux, en moyenne, donne lieu à la création d'un champion important, qui porte haut ses couleurs dans la compétition mondiale.
Quant aux manipulations de cours, je n'ai pas souvenir d'en avoir vu passer devant l'AMF. Il y en a bien eu quelques-unes, mais il s'agissait de manipulations mineures. Elles ne sont pas nombreuses. Toutes les opérations de salles de marché étant enregistrées, on peut ensuite retrouver ce qui s'est dit. Cela permet, en cas de manipulation, d'en poursuivre les auteurs. Je n'en ai pas vécu beaucoup, mais les plus sournoises, les plus importantes, sont les opérations comme celles qui ont eu lieu sur le Libor. Quasiment invisibles, elles portent sur des masses gigantesques, représentant des montants énormes.
Par ailleurs, l'Etat, quand il organise une privatisation ou une nationalisation, fait toujours appel aux banquiers d'affaires. L'un se trouve du côté du groupe, l'autre du côté de l'Etat.
L'Etat fait concourir les banquiers. J'ai concouru plusieurs fois, comparaissant devant une équipe de hauts fonctionnaires, qui m'ont torturé pour savoir si ma banque aurait les compétences nécessaires pour conseiller l'Etat. J'ai été choisi dans deux ou trois cas. J'ai gagné un concours sur sept ou huit. Je n'ai rien à dire sur la façon dont ce choix s'effectue. Les gens en face de moi étaient des gens que je ne connaissais pratiquement pas. Il n'y avait pas de conflit d'intérêts. Les questions posées étaient en général assez judicieuses. J'espère n'avoir pas été trop mauvais.
S'agissant des banques japonaises, le Japon vit depuis dix ans dans une crise provoquée par son système bancaire. Auparavant avait eu lieu la crise de certains autres pays d'Asie du Sud-Est -Corée du Sud, Malaisie, Indonésie. Il faut surveiller les banques comme le lait sur le feu. La vigilance de la commission bancaire et des nouveaux organismes qui se sont créés depuis doit être totale. C'est absolument essentiel, la crise bancaire étant vraiment la mère de crises capitales de toute nature. Les Japonais, dont l'économie stagne pour ces raisons, en savent quelque chose !
Un mot de l'euro. Abaisser de moins de 10 % le taux de notre monnaie ferait gagner plus d'un point de croissance à toutes les économies de la zone, ce qui prouve bien que l'euro joue un rôle énorme dans la solution de nos problèmes actuels. Nous avons plusieurs problèmes. Le premier est celui de la situation de la zone euro, à laquelle nous appartenons, face au reste du monde, d'où l'intérêt de faire baisser notre monnaie. Le second problème est celui de pouvoir cohabiter avec l'Allemagne et de nous confronter économiquement à elle.
Nous sommes actuellement dans la zone mark, telle que les Allemands l'imaginent et peuvent la supporter, compte tenu de leur économie. Nous n'avons plus la possibilité d'avoir une monnaie qui s'adapte à l'état de notre économie. Un ouvrage collectif, auquel j'avais participé avant la création de l'euro, conseillait, en substance, de vérifier que la convergence économique des nations soit suffisante pour que celles-ci n'aient pas à souffrir un jour de l'euro, au travers d'évolutions divergentes. Cet ouvrage estimait alors que ce jour-là, il serait trop tard, sauf à sortir de l'euro. Nous n'en sommes pas là, et je ne pense d'ailleurs pas que nous sortirons. Quelques-uns de mes amis le pensent, mais je ne le crois pas. Toutefois, si l'euro baissait de 10 %, 1,5 point de croissance en plus serait le bienvenu !
Cependant, on ne baisse pas l'euro ainsi. Le cours des monnaies relève, à chaque instant, de la loi de l'offre et de la demande. Or, sur le marché où s'échangent ces monnaies, la loi de l'offre et de la demande est liée à des phénomènes comme le taux à court terme. Pour lors, comme le disait le général de Gaulle : « On peut sauter sur sa chaise comme un cabri en criant : « L'Europe ! L'Europe ! L'Europe ! », mais cela ne mène à rien ». Seuls les taux d'intérêt de l'euro, comparés aux taux d'intérêt des autres monnaies fortes -dollar essentiellement - peuvent y parvenir !
Si notre taux d'intérêt est beaucoup plus faible que celui du dollar, l'euro peut baisser ; si notre taux d'intérêt est plus attractif, les gens achèteront de l'euro et le feront monter. Tout le reste n'est qu'incantation, mais sans résultat.
Les conflits d'intérêts sont par ailleurs un domaine essentiel. Goldman Sachs nous l'a prouvé de façon aveuglante ! C'est un sujet sur lequel les régulateurs doivent veiller. Il faut interdire tout transfert d'informations d'un département bancaire à un autre. Cela conduit à évoquer le problème de la séparation entre les activités de banque d'affaires et de banques de dépôt...
Je n'ai pas souvenir de cas importants. Nous n'avons condamné que des cas mineurs.
Par ailleurs, le Glass-Steagall Act, en 1933, aux États-Unis, a séparé les activités de banque d'affaires des activités de banque de dépôt, que l'on souhaite réintroduire régulièrement. Une loi est actuellement en débat devant le Parlement sur la filialisation des activités des banques d'affaires. Je pense personnellement que l'on ne va pas assez loin pour séparer les deux types d'activité. En fait, les activités de banque d'affaires sont déjà séparées dans les banques et filialisées. Ce n'est donc pas une novation. Ce qui est nouveau, c'est la rigueur avec laquelle on va étudier les ratios de la filiale traitant de ces activités d'opérations pour comptes propres. Ces derniers, qui sont très dangereuses, amènent la banque à prendre des risques importants, qu'elle peut faire supporter à ses déposants au-delà de 100 000 euros.

Vous estimez donc que la banque doit pouvoir effectuer des opérations pour ses clients, quels que soient les marchés, mais vous pensez que le fait qu'elle engage ses fonds propres est critiquable...
En effet. Que les banques aient des salles de marché pour rendre service à leurs clients - achats de devises ou prises de garanties de change à terme - est normal : ces produits dérivés sont le service à rendre aux entreprises, notamment exportatrices. En revanche, acheter pour son compte propre ou souscrire des emprunts d'Etat, comme l'ont fait les grandes banques françaises, qui détenaient toutes de l'emprunt grec, chypriote ou autres, était destiné à gagner des marges sur des taux d'intérêt élevés. Enrichir la banque en cash-flow est normal ; ce qui ne l'est pas, c'est de prendre des risques aussi importants sans que le déposant le sache !
On peut parfaitement conserver l'activité de banque d'investissement pour compte propre et l'activité de banque de dépôt à condition de prévenir le déposant. Il faut que la clarté règne. Je suis favorable à une séparation plus nette, mais si l'on ne veut pas aller jusque-là, je plaide au moins pour la transparence vis-à-vis du client !

Pourquoi une banque a-t-elle des filiales dans un paradis fiscal ? Quel en est l'intérêt ?
Cela lui procure des revenus très importants. Prenez l'exemple de la Société générale. Tout le monde savait il y a quelques années que celle-ci était observée attentivement par la BNP, qui voulait l'absorber par une offre publique d'achat (OPA).
Le réflexe de l'équipe dirigeante -on ne peut le lui reprocher - a été d'augmenter la capitalisation boursière de la banque, afin que sa valeur devienne telle qu'elle ne puisse plus faire l'objet d'une OPA de la BNP. Il a fallu pour cela qu'elle double ou triple instantanément ses résultats. Comment y parvenir en deux ans ? Ce n'est pas en ouvrant des comptes de dépôt qu'on peut y parvenir ! C'est coûteux et ce n'est pas d'un rapport financier extraordinaire... La seule façon de gagner beaucoup d'argent en deux ou trois ans, c'est de se lancer sur les marchés financiers. C'est ce qu'a fait la Société générale. Elle a en effet doublé son résultat, mais elle en a subi les conséquences. Dans de tels cas, une affaire Kerviel intervient de temps en temps. Elle n'a toutefois consommé qu'une année de résultats, sans mettre complètement à mort la Société générale.
Pour en revenir à la séparation complète des activités pour compte propre des activités pour compte de tiers, je suggère que l'on surveille de très près les filiales en faisant en sorte qu'une perte importante ne condamne pas le résultat de la maison mère, et que tous les clients soient informés des risques que la banque envisage de prendre ou a déjà pris. Ceci devrait être communiqué sous forme de plaquette, à chaque ouverture de compte.

Quel est le statut de la Compagnie financière Edmond de Rothschild ? Avait-elle des filiales dans les paradis fiscaux ?
La Compagnie financière Edmond de Rothschild est une banque de dépôt, ayant comme activité la gestion de patrimoine et la gestion de trésorerie pour le compte des entreprises. J'avais inventé un produit consistant à permettre aux trésoriers de connaître le « float » des chèques émis mais non encore perçus, et de gérer ainsi leurs trésoreries avec une très grande finesse. C'est grâce à ce produit que nous avons ouvert les comptes de toutes les grandes entreprises françaises. Nous ne leur faisions pas crédit, n'en ayant pas les moyens, mais nous leur offrions ce service, que nous étions les seuls à proposer. Seule une banque américaine faisait de même. Trois ans plus tard, les banques françaises ont bien évidemment mis le même produit en place.
La Compagnie financière Edmond de Rothschild accompagnait également ses clients en leur offrant des crédits export. Nous avons ainsi réalisé tout le montage des deux premières centrales nucléaires de Daya Bay, en Chine, vendues par Framatome, en réussissant à passer entre les mailles du filet du client chinois et du fournisseur français.
Nous avions par ailleurs créé un produit d'observation des hautes technologies américaines pour le compte de grandes sociétés françaises.
Tous ces produits accompagnaient la vie de l'entreprise dans sa mondialisation, à l'exportation, pour l'implantation à l'étranger, dans le rachat de sociétés un peu partout dans le monde, mais nous ne faisions pas de comptes offshores. Je n'en ai jamais ouvert un. Je ne savais pas ce que c'était...

Daya Bay a été financée par une joint-venture, la moitié de l'électricité allant à Hong Kong, l'autre à Canton...
Il y avait également des banques de Hong Kong dans l'affaire, mais la directrice des opérations chinoises de la Compagnie financière Edmond de Rothschild était la descendante du directeur de cabinet de Sun Yat-sen. Même sous le régime communiste, elle avait droit au tapis rouge quand elle allait en Chine ! Grâce à elle, nous avons bénéficié d'informations. Nous avons fait notre métier vis-à-vis des Chinois, et c'est ainsi que Framatome a emporté ce marché.

A l'époque, l'Assemblée nationale a dû envoyer un représentant de chaque parti à Hong Kong signer la joint venture, à la demande des Chinois, qui ne comprenaient rien à notre démocratie ! J'ai fait partie de cette aventure...
Je rentre de Chine, où plusieurs groupes, ainsi que les autorités chinoises, m'ont demandé de venir haranguer deux mille cadres pour leur expliquer la politique industrielle gaullo-pompidolienne, notamment en souvenir de l'opération de Daya Bay !

Vous avez évoqué les pertes importantes des banques ayant acheté des produits grecs. N'existait-il pas un moyen de l'éviter, en donnant la possibilité à la Grèce -ou à l'Espagne- d'étaler leur dette d'Etat sur quarante ou cinquante ans, sans obliger une banque comme le Crédit agricole ou autres à subir une perte sèche ?
N'est-on pas allé trop vite -ou trop loin ? On étrangle la population grecque et on est en train de s'étrangler nous-mêmes ! Quel est votre sentiment ?
Je ne puis répondre avec précision, ne connaissant pas les modalités de l'endettement grec, ni sa durée. Je crois que celle-ci était déjà très longue. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles on n'a pu aller plus loin... Je pense qu'il fallait, pour aider la Grèce, en venir à un système par lequel une partie de la dette était abandonnée. Allonger le remboursement aurait donné un peu d'oxygène, mais en annuler un bon tiers a donné à ce pays un ballon d'oxygène bien plus important.

Les États-Unis mettent en avant leur rôle majeur dans la lutte contre l'évasion fiscale. Or, il existe des Etats comme le Delaware et le Wisconsin... Par ailleurs, la crise des subprimes a pris naissance dans l'ingénierie de la puissance financière américaine, et les États-Unis ne taxent pas les plus-values réalisées dans certains paradis fiscaux, les favorisant ainsi indirectement. Comment analysez-vous l'action financière des États-Unis ? Quelles sont les ambitions réelles de ce pays donneur de leçons ?
Je suis embarrassé pour vous répondre... Les Américains, comme toujours, font à la fois preuve de réalisme et d'idéalisme. Leur politique est gouvernée par un mélange des deux -peut-être encore davantage sous la présidence de M. Obama qu'auparavant, où le réalisme dominait j'imagine davantage...
En ce moment, leur politique est claire : elle vise à faire rentrer fiscalement un certain nombre de montants importants, dont les États-Unis connaissent le chiffre, ayant des moyens d'investigation supérieurs aux nôtres en ce domaine. Cela leur fait miroiter des horizons budgétaires glorieux. Dans ces cas-là, on sait que, lorsque l'Amérique déclenche un mouvement, elle le fait avec grande vigueur !
Cela permet une conjonction extraordinairement favorable pour moraliser quelque peu le paysage de l'offshore, au moins trois grands pays -États-Unis, Grande-Bretagne et France - étant d'accord pour aller de l'avant et faire pression sur la Suisse et autres pays. Je me réjouis de l'attitude américaine, mais je suis plus étonné de celle des Britanniques. M. Cameron agit dans le même sens, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout ! Je n'ai pas d'explications à la nouvelle tendance vertueuse des gouvernants britanniques. Tant mieux ! Ils y trouvent sûrement leur intérêt, ayant certainement des problèmes de déficits budgétaires importants !
Audition de M. François d'auBert président du groupe de revue par les pairs au sein du forum mondial sur la transparence et l'échange d'informations en matière fiscale ancien ministre
Audition de M. François d'auBert président du groupe de revue par les pairs au sein du forum mondial sur la transparence et l'échange d'informations en matière fiscale ancien ministre
(mercredi 22 mai)
L'audition s'est tenue à huis clos.
Audition de madame jézabel coupey-soubeyran maître de conférences en économie à l'université paris-i panthéon-sorbonne conseillère scientifique auprès du conseil d'analyse économique et de M. Gabriel Zucman doctorant à l'école d'économie de paris
Audition de madame jézabel coupey-soubeyran maître de conférences en économie à l'université paris-i panthéon-sorbonne conseillère scientifique auprès du conseil d'analyse économique et de M. Gabriel Zucman doctorant à l'école d'économie de paris
(mercredi 29 mai)

Dans le cadre de cette commission d'enquête sur le rôle des banques et acteurs financiers dans l'évasion des ressources financières, nous allons commencer par l'audition de Jézabel Couppey-Soubeyran, suivie de celle de Gabriel Zucman.
La commission d'enquête a ses usages ainsi que ses obligations juridiques, dont la première, et la plus importante, est de faire prêter serment à ceux qu'elle auditionne. Madame Jézabel Couppey-Soubeyran, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ».
Je le jure.

M Gabriel Zucman, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ».

Nous allons vous donner quelques minutes afin que vous vous présentiez, puis je donnerai la parole au rapporteur Eric Bocquet. Ensuite, le débat sera nourri par les questions de mes collègues. Le dernier mot ira au rapporteur, et je vous laisserai un temps à la fin de votre audition pour d'éventuelles précisions.
Lors de l'élaboration du rapport réalisé en collaboration avec mon collègue Gunther Capelle-Blancard pour le Conseil des Prélèvements Obligatoires, j'ai été amenée à étudier les implantations des banques européennes et françaises à l'étranger et plus précisément dans les centres offshores. Nous souhaitions trouver des explications à la faiblesse relative des banques françaises face au prélèvement obligatoire.
Afin d'examiner la présence des banques françaises à l'étranger, nous avons pu nous appuyer sur une base de donnée commerciale appelée Bankscope, mais pas sur celles de l'ACP ou de la Banque de France. Bankscope, nous a permis de dénombrer des filiales de grandes banques européennes à l'étranger et plus spécifiquement dans les centres offshores. Pour notre sélection de banques européennes, nous nous sommes limités aux filiales de premier rang (filiales détenues à au moins 25 %). De la sorte, nous avons considérablement restreint le champ d'étude. Les filiales de ces grands groupes se comptent par centaines ou milliers. Le pourcentage de filiales étrangères implantées dans les paradis fiscaux est de l'ordre de 20 %, voire 30 % pour certains groupes.
Nous sommes allés au-delà des filiales de premier rang pour trois groupes bancaires français. Ainsi, nous avons pu dénombrer 256 à 331 filiales pour la BNP selon la liste des paradis fiscaux que l'on retient, 104 à 150 filiales pour le Crédit Agricole et entre 75 et 91 filiales pour la Société Générale.
Les études qui abordent ces questions sont rares car les données manquent. Aux Etats-Unis, le Government Accountability Office de décembre 2008, ou encore l'ONG Action Aid en Grande-Bretagne ont notamment recensé les filiales dans les paradis fiscaux des 100 plus grandes entreprises américaines cotées. Les résultats de leurs rapports sont annexés au rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires.
Deux problèmes compliquent le recensement de ces données. Le premier porte sur l'exigence de reporting à laquelle les banques doivent se plier. Elles ne communiquent en effet que les données pour lesquelles elles sont contraintes. Cependant, les exigences de reporting vont croissant, y compris sur l'activité des banques dans les paradis fiscaux. Ce premier problème donc est en voie de résolution.
La deuxième source de problème, très importante et insuffisamment mentionnée, porte sur la rétention de données par les autorités bancaires et financières. Ni la Banque de France ni l'ACP en effet n'ont donné suite aux demandes que nous leur avions adressées dans le cadre du rapport pour le Conseil des Prélèvements Obligatoires. Nous souhaitions obtenir des éléments relatifs à l'implantation des banques françaises à l'étranger, ainsi que sur les comptes de bilan. Ces données sont tout à fait publiques, et nous aurions pu les collecter une par une dans les rapports annuels bancaires. Cependant, cette méthode n'est pas propice aux travaux de recherches. Nous avons donc dû nous contenter, pour la base de données à l'étranger, de Bankscope, un outil très utilisé par les universitaires mais qui ne bénéficie pas du sceau du régulateur. Par ailleurs, nous avons utilisé des comptes de bilan agrégés publiés par l'OCDE.
Le cas de la France en matière d'accès aux données bancaires est très préoccupant. Hier, j'ai participé à un jury de thèse. Le candidat avait travaillé sur le secteur bancaire de la Corée du Sud. Un de ses rapporteurs lui a fait remarquer que les données en provenance de la Banque centrale de Corée du Sud n'auraient pu être transmises par la Banque de France.
M. Eric Bocquet, rapporteur. - Comment l'expliquez-vous ?
La Banque de France ou de l'ACP font de la rétention. La production des données est un premier problème, qui peut toutefois se résoudre avec le temps. Leur accessibilité en est un second. Il me semble qu'un chercheur français s'intéressant au sujet d'aujourd'hui doit n'avoir aucune stratégie de publication, ou bien faire preuve d'une grande ingéniosité.
Quoi qu'il en soit, l'internationalisation des groupes bancaires et leur présence massive dans les paradis fiscaux nous apparaissent faire partie des facteurs expliquant pourquoi les banques françaises contribuent relativement peu aux recettes fiscales, ou, en tout cas, n'y contribuent pas à la hauteur du dynamisme de leur activité.
Je suis en train de finir ma thèse de doctorat consacrée aux paradis fiscaux. En effet, je m'intéresse notamment aux inégalités de patrimoine. J'estime ainsi que s'il est impossible de taxer le capital et le patrimoine, les fortunes risquent de se concentrer de manière importante. Aujourd'hui, les paradis fiscaux permettent aux entreprises et aux particuliers d'éviter ou de frauder les différents impôts qui existent sur le capital. J'ai donc voulu comprendre quelles actions permettraient de s'y opposer. Existe-t-il ainsi des politiques pour faire en sorte que la fraude à l'impôt sur le patrimoine soit plus difficile ? Au préalable, j'ai souhaité essayer de mesurer la fraude.
Nous manquons terriblement de littérature au sujet de la fraude, et ce manque devient caricatural en ce qui concerne les paradis fiscaux. Il est lié au manque de données, et, plus fondamentalement, au manque d'intérêt des économistes académiques pour les questions appliquées. Cet état d'esprit est toutefois en train de changer au sein de la profession.
J'ai voulu tout d'abord connaître le montant des fortunes détenues par les particuliers dans les paradis fiscaux, lesquelles sont méconnues. Des rapports existent toutefois, mentionnant des ordres de grandeur allant de 5 000 milliards de dollars à 35 000 milliards de dollars. Ensuite, je me suis demandé si les politiques utilisées actuellement pour lutter contre la fraude fiscale offshore fonctionnent.
Après recherche, j'estime qu'au niveau mondial, 8 % du patrimoine financier des ménages est détenu dans les paradis du monde entier, soit à peu près 6 000 milliards d'euros. Je parle ici d'argent détenu par des ménages fortunés, directement ou par le biais de sociétés-écrans. Un gros quart de cet argent serait en Suisse, soit 2 000 milliards d'euros. Ce chiffre est officiel et provient de la Banque Nationale Suisse. 4 000 milliards d'euros sont logés dans d'autres paradis fiscaux tels que Singapour, le Luxembourg, Hongkong, les îles Caïmans, et les Bermudes.
Les politiques mises en place actuellement pour lutter contre la fraude sont inefficaces. Pour l'instant, l'essentiel de la lutte contre la fraude se fait par l'intermédiaire de traités sur l'échange d'informations bancaires à la demande. Pendant de nombreuses années, l'OCDE a promu ce standard, et le G20 l'a repris à son compte en 2009 lors du Sommet de Londres. En 2009, les paradis fiscaux ont signé de nombreux traités sur l'échange d'informations à la demande avec les pays de l'OCDE. Quatre ans après, ces traités semblent n'avoir quasiment servi à rien. En effet, au total les sommes dans les comptes offshores des paradis fiscaux n'ont pas bougé. Des fortunes offshores ont quitté les paradis fiscaux ayant signé de nombreux traités d'échange d'informations et se sont dirigées vers des juridictions en ayant signé peu. Mais au niveau mondial, ce jeu est à somme nulle.
Que faudrait-il faire ? Il est important de comprendre que ce problème a une solution simple qui s'appelle l'échange automatique d'informations bancaires. Aujourd'hui, les banques françaises ont l'obligation de communiquer au fisc les listes de leurs clients, et les revenus perçus par ces derniers. Ces revenus apparaissant directement sur les feuilles d'impôts, de telle sorte qu'aucune fraude n'est possible. Cette mesure doit être étendue aux banques domiciliées dans les paradis fiscaux. Techniquement, cette mesure est très simple. L'échange automatique d'information fonctionne déjà à l'intérieur des grands pays. Etendu aux paradis fiscaux, il mettrait un terme à la fraude puisque les montants apparaîtraient directement dans les feuilles d'impôts pré-remplie.

Monsieur Zucman, j'ai lu un document que vous avez produit en février 2011 où vous faisiez état de chiffres légèrement différents de ceux que je viens d'entendre. Vous évoquiez ainsi 73 000 milliards de dollars, parmi lesquels 31 000 milliards de dollars seraient gérés en offshore. De plus, 42,5 % de cette somme seraient détenus par 0,1 % de la population. 5 800 milliards de dollars seraient également gérés offshore dont les quelque 2 000 milliards de dollars que vous venez de citer. Confirmez-vous ces chiffres ?
73 000 milliards de dollars correspondent au total du patrimoine financier des particuliers à l'échelle mondiale. 50 à 60 % de cette somme appartiennent à 1 % des ménages les plus fortunés. Une fraction des 73 000 milliards de dollars est placée offshore - environ 5 8000 milliards de dollars à l'époque de l'étude que vous citez, environ 6 000 milliards d'euros aujourd'hui. Tous ces chiffres sont parfaitement cohérents.

Je vous remercie. Madame Couppey-Soubeyran, la Commission des finances du Sénat vous avait entendue en début d'année concernant l'élaboration de la réforme bancaire, sur laquelle je vous demanderai un avis en fin d'entretien. Quelles sont selon vous les motivations de la présence des filiales de banques françaises dans les paradis fiscaux ?
Il ne s'agit évidemment pas de diaboliser l'internationalisation des banques, pas plus que la présence de filiales étrangères. L'implantation importante dans les paradis fiscaux facilite l'optimisation fiscale des banques. Ces dernières souhaitent ainsi bénéficier de réglementations et de dispositions fiscales avantageuses. C'est sans doute un motif parmi d'autres. De même, les banques justifient leur présence dans les paradis fiscaux par des motifs commerciaux et les pressions concurrentielles qu'elles subissent. Il ne s'agit pas de considérer que l'internationalisation des banques ne répond qu'à une recherche d'optimisation fiscale. Elle a en effet largement reposé sur une volonté politique qui consistait à promouvoir des champions nationaux capables de résister à la concurrence internationale. Même s'il est impossible de déterminer avec précision la part des filiales implantées à l'étranger pour des motifs fiscaux, nous pouvons légitimement considérer qu'elles en facilitent l'optimisation.

Quelle analyse avez-vous faite des écarts entre vos données et celles publiées par l'ACP ?
Il est difficile de répondre à votre question. Nous nous sommes uniquement appuyés sur les données de la base Bankscope puisque nous n'avons pu accéder à celles de l'ACP, pourtant peut-être plus précises.

Comment comprendre qu'il soit difficile d'obtenir de l'information de la part de l'ACP, un organisme censé assurer la supervision ? Quelles conclusions en tirez-vous ?
Je pense que nous sommes face, effectivement, à un problème d'accès aux données bancaires, et particulièrement aux données bancaires détaillées à haute fréquence. Nous ne disposons ainsi d'aucune donnée trimestrielle sur l'activité des banques, leur implantation à l'étranger, la part de l'activité réalisée dans tel ou tel pays, et les rémunérations versées. Toutes ces données sont conservées par les institutions qui les produisent.

Estimez-vous que des lacunes existent dans les postes de supervision ou qu'il s'agit d'une rétention délibérée de l'information ?
Exiger plus d'information de la banque et du régulateur ne suffit pas. Ces éléments devraient être transmis à la communauté citoyenne et scientifique dans un format adapté. Il ne s'agit pas uniquement de produire un rapport dans un format PDF mais de ²faire en sorte que ces fichiers de données soient exploitables par les chercheurs qui veulent réaliser des travaux sur ces questions.

Considérant les difficultés évoquées, quelle méthode avez-vous utilisée afin de rassembler les chiffres de votre étude ?
Deux grandes sources de données m'ont permis d'aboutir au taux de 8 % du patrimoine des ménages détenu dans les paradis fiscaux, et tout d'abord, les statistiques de la Banque Nationale Suisse sur les fortunes offshore détenues en Suisse.
Elles ont des défauts mais sont exhaustives et fiables. Je ne pense pas que les banques suisses communiquent de fausses informations. Ce type de données n'avait pas été utilisé jusqu'à présent, notamment parce qu'elles sont difficiles à interpréter. En effet, la Suisse est le seul pays à publier ce genre d'informations sur les fortunes offshores. Par ailleurs, la plupart des comptes en Suisse sont détenus par des sociétés écrans, à hauteur de 60 %. Ceux-ci se reflètent dans les statistiques par des montants considérables d'actifs enregistrés au Panama, aux Iles Caïmans, ou aux Iles Vierges Britanniques.
J'ai ensuite utilisé des anomalies dans les statistiques d'investissements internationaux des pays, consécutives à la détention par des particuliers de comptes offshores. Cela crée des problèmes dans les statistiques. Prenez un particulier français qui a un compte en Suisse. Il y investit cet argent en achetant des actions. Imaginez que ce Français achète des actions américaines depuis son compte en Suisse. Les Etats-Unis enregistrent un passif, car ils savent qu'un investisseur étranger détient des actions américaines. Les statistiques suisses n'enregistrent rien car ces actions n'appartiennent pas à la Suisse. Quant aux statisticiens français, ils n'enregistrent rien, car ils n'ont pas moyen de savoir que ce ménage français détient un portefeuille d'actions américaines en Suisse. Au niveau mondial, vous allez avoir plus de passifs que d'actifs enregistrés. C'est pour cette raison que les portefeuilles d'actions, d'obligations et de parts de fonds d'investissement qui sont détenus dans des comptes offshores par des particuliers ne sont nulle part enregistrés comme actifs. La différence entre les actifs et les passifs est très importante au niveau mondial. J'utilise cette anomalie pour avoir un ordre de grandeur du total des fortunes offshore détenues par des particuliers. Toutes les sources disponibles sur les investissements internationaux sont utilisées.

Madame Couppey-Soubeyran, vous avez cité pour les trois premiers groupes français des fourchettes de nombre de filiales. Si je prends la BNP, comment vous arrêtez-vous au nombre de 256 ou 358, soit une différence de 100 ?
La différence provient de la liste des paradis fiscaux que l'on utilise. Nous utilisons deux types de listes, l'une établie par le FMI et une autre plus restrictive.

Vous avez dit que les banques ont un nombre de filiales extrêmement important. Je voudrais essayer de comprendre. Que ces banques s'installent dans des paradis fiscaux, à l'étranger, afin de faire de l'optimisation fiscale, on peut le comprendre. Pourquoi le font-elles ainsi, par un nombre si important de filiales ? Quel est l'avantage procuré d'être non seulement présent mais également d'avoir de nombreuses filiales, lesquelles ne sont pas seulement des sociétés-écrans ? Je pense que le mécanisme juridique nous échappe en plus du mécanisme financier.
Vous pointez un problème important. Les filiales créent une complexité organisationnelle au travers d'une structure capitalistique très complexe, qui rend le groupe difficile à superviser.

Vous voulez dire que cette organisation crée volontairement une opacité ?
Je crois qu'elle rend la supervision des grands groupes bancaires plus difficile, en particulier lorsque l'organisation des dispositifs de supervision est telle que des autorités nationales doivent encore superviser des groupes présents à une très large échelle. Cela montre que l'organisation de la supervision n'a pas évolué suffisamment vite.

On peut se demander s'il ne faut pas limiter cette possibilité de création de filiales. Certains doutent de l'utilité de cette mesure et je peux comprendre, mais en matière bancaire, des règles pourraient s'imposer. Ainsi, la liberté totale pour une banque de créer 200 ou 300 filiales pour une banque est-elle normale ?
Je crois que les dispositions relatives aux mécanismes de résolution, qui vont être décidés dans le cadre de l'Union bancaire ou de la Loi bancaire française, sont de nature à réduire les complexités organisationnelles. Demander aux établissements bancaires de fournir un plan préventif les obligera à simplifier cette organisation. Les plans préventifs auront donc un impact.

Vous indiquez que vos études ont commencé par le constat de la sous-fiscalisation de l'ensemble des banques françaises. Par rapport à d'autres pays comparables, peut-on avoir une idée de cette sous-fiscalisation ? Pour autant, nous avons reçu, voici quelques mois, l'OCDE, dont l'appréciation était optimiste sur l'échange d'informations fiscales entre les pays, y compris les paradis fiscaux bien connus. Je voudrais que vous m'expliquiez la différence entre le système OCDE et le vôtre.
La rétention de données nous étonne beaucoup et nous allons agir auprès de la Banque de France avec le rapporteur. La Loi de finance a par ailleurs essayé de séparer les activités de marché et de dépôt des banques. 1 à 2 % du chiffre d'affaires serait concerné, ce qui est relativement modeste. Pensez-vous que ces chiffres correspondent à la réalité ou sont-ils sous-évalués ?
Les banques, quant à elles, nous ont dit qu'il leur était vital d'être présentes dans les paradis fiscaux, qui sont des carrefours financiers. Pensez-vous que les banques sont dans ces paradis fiscaux exclusivement pour des clients ou pour elles-mêmes ? Pensez-vous qu'en dehors de la fiscalité, les banques ont un autre intérêt d'être dans les paradis fiscaux ?
Concernant les impôts payés par les banques, nous avons essayé de mettre en avant un décalage important entre l'évolution des impôts payés par les banques et celle de leur activité mesurée, notamment par les profits réalisés. Les impôts payés par les banques ont augmenté mais beaucoup moins vite que leurs profits. Pour les banques françaises, sur la période qui court du milieu des années 1990 à la veille de la crise, les impôts ont été multipliés par 1,5 et les profits par 10. Nous nous sommes efforcés de calculer des taux d'imposition implicites.
Ces calculs ne sont pas évidents à établir car les profits et les impôts payés varient beaucoup d'une année sur l'autre. Lorsque l'on s'applique à rapporter les impôts aux profits, on est obligé de travailler sous-période par sous-période, ainsi que de lisser les données. Les résultats obtenus sont très sensibles au choix de la sous-période ou du cumul effectué. Plutôt que le chiffre en valeur absolue, il convient donc de s'intéresser à la tendance. Ce taux d'imposition implicite fait apparaître, tant pour les banques françaises que celles de la zone OCDE, une nette tendance à la baisse, beaucoup plus marquée pour les banques commerciales que pour les mutualistes. Que l'on effectue le cumul dans le temps ou dans l'espace, cette baisse du taux d'imposition implicite ressort très fortement.
Je ne vais pas reprendre le chiffre car je ne souhaite pas attirer votre attention sur les valeurs absolues. En partant de ce constat, nous avons cherché des facteurs explicatifs. La présence dans les paradis fiscaux semble être un facteur important, mais il n'est pas le seul que nous mettons en évidence. Nous avons également fait ressortir le fait que les banques ont recours à l'emprunt et bénéficient de la déductibilité des intérêts d'emprunts. Or cette disposition est dangereuse pour la stabilité financière puisqu'elle induit une incohérence entre fiscalité et régulation. La Loi de finance 2013 est revenue sur ce point en plafonnant la déductibilité des emprunts, mais, dans le cas des banques, il faudrait aller plus loin. La variabilité des profits et les résultats des banques leur permettent en effet de tirer avantage des mécanismes de reports comptables et des bénéfices. Cette donnée est davantage à la portée des comptables que des économistes. Elle participe quoi qu'il en soit à l'optimisation fiscale que les banques sont capables de réaliser.

La non-déductibilité pose des problèmes différents pour les banques et pour les PME/PMI.
Il convient de distinguer les banques des entreprises non financières. Il est notamment indispensable de limiter le levier d'endettement des banques. Le régulateur exige qu'elles aient davantage de fonds propres. Or la fiscalité leur permettant d'augmenter la dette contredit cette exigence.

Avez-vous des exemples de report de déficits d'une année sur l'autre des banques ?
Il existe des reports de bénéfices, bien entendu.

Je voudrais partir d'un exemple simple. Monsieur X a un patrimoine qu'il souhaite optimiser et donc sortir de son pays pour aller dans un pays L. La banque crée forcément des filiales pour optimiser ce portefeuille. L'optimisation fiscale ne sera en effet possible que si la banque suit son client.
Je reviens sur le nombre de personnes que les banques ont dans ces paradis. Il faut des gens pour gérer ces patrimoines dans le pays L. Plus les banques auront des clients dans le pays L, plus il lui faudra des gens pour y gérer ce patrimoine. Cela signifie que les banques accompagnent le client dans son optimisation, afin de le fidéliser. Comment le client qui optimise peut-il utiliser ce patrimoine optimisé en France ? Quels schémas peuvent-ils être créés ? J'essaye de comprendre comment ces capitaux reviennent.
Gabriel Zucman. - C'est une question importante et intéressante. Je pense qu'il n'y a aucune raison pour qu'un patrimoine détenu par l'intermédiaire d'une banque suisse soit moins taxé que s'il était détenu par l'intermédiaire d'une banque française. Les gens ont peut-être le droit d'avoir des comptes où ils veulent, mais ces comptes doivent être déclarés. En pratique une fraction (inconnue) des comptes offshore n'et pas déclarée. Les banques françaises présentes dans les paradis fiscaux spécialisés dans la gestion de fortune (Suisse, Singapour) ont donc en particulier des clients qui ne respectent pas la législation fiscale.
Concernant l'échange d'information, l'OCDE s'occupe de ces questions depuis 1998. Les proclamations de succès ont été permanentes mais, de mon point de vue, ce succès n'est pas du tout avéré. En effet, des dizaines de milliers de particuliers français détiennent des comptes étrangers non déclarés. Pour autant, Bercy ne reçoit que quelques dizaines d'informations sur ces comptes chaque année, et souvent par le fait du hasard. Dans ce contexte, les progrès réalisés depuis quinze ans, voire trois ans ou même au cours des derniers mois, sont loin de me paraître considérables. Les personnes qui ont des comptes en Suisse, à Singapour ou à Hongkong n'ont ainsi aucun risque d'être détectées. Cela peut changer s'il y a une forme d'échange d'informations beaucoup plus contraignante qu'actuellement.
Aujourd'hui, Bercy ne peut obtenir des informations que si elle a des soupçons préalables qu'un contribuable français fraude par le biais d'une banque précise. Dès lors, il est impératif de remplacer le système d'échange d'informations à la demande par un système d'échange automatique. Par ce procédé, les banques suisses ou singapouriennes enverraient automatiquement annuellement la liste complète de leurs clients français avec le montant des patrimoines, et les revenus perçus par ces ressortissants A l'heure actuelle, ce système n'existe pas. Aucun paradis fiscal spécialisé dans la gestion de fortune n'a clairement indiqué vouloir mettre en place ce système. Je m'inscris donc en porte-à-faux avec les déclarations de victoire de l'OCDE.

Comment peut-on contraindre ces pays à l'échange automatique d'informations ? Madame Couppey-Soubeyran, vous parliez, quant à vous, des banques dont les taux d'intérêt devraient être plafonnés afin qu'elles ne puissent les déduire indéfiniment. Pour ma part, j'estime ce processus assez dangereux. Les banques sont en effet là pour réaliser des bénéfices et le font également pour nous. C'est grâce à ces mêmes banques que l'on finance les PME. Elles sont d'ailleurs différentes des banques d'affaires anglo-saxonnes. Si nous appauvrissons trop ce secteur - je ne suis pas un défenseur des banques, je me suis battu toute ma vie contre elles -, nous ne pourrons plus financer notre économie. Je parle ici des règles normales de fonctionnement, je ne parle pas des comptes offshores. Une banque doit en effet optimiser afin d'avoir des bénéfices. Ces derniers lui permettront de disposer de capitaux propres suffisants afin de se refinancer mais également de financer nos entreprises et industries. Enfin, vous dites que la Banque de France fait de la rétention. Je ne veux surtout pas que vous en preniez ombrage, mais de quel droit pouvez-vous obtenir de la Banque de France des informations concernant des clients ?

Une tentative a-t-elle été faite pour discerner le profil des filiales dans les paradis fiscaux ? S'agit-il de filiales de sociétés bancaires ou de sociétés pour le compte de clients ? Ces filiales bancaires ont-elles une activité bancaire ou les banques sont-elles simplement l'outil de clients qui désirent avoir des sociétés pour faire des transactions internationales ? J'ai du mal à croire qu'il y ait 350 filiales dans des activités bancaires. Je suis persuadé que certaines pratiquent l'activité bancaire, mais que d'autres ne sont là que pour telle ou telle grande société. Lorsque le Crédit Lyonnais a fait des transactions pour une marque de sport, il utilisait des sociétés comme celles-là. Dans ce cas, s'agissait-il de comptes pour la banque ou pour la marque de sport ?
En tant que parlementaire français et citoyen européen, je souhaite savoir si nos activités bancaires internationales présentent des anomalies par rapport à nos voisins. Les grands Groupes français ont-ils beaucoup plus, en proportion, ou beaucoup moins d'antennes que nos voisins allemands, espagnols, italiens, néerlandais, ou sont-ils dans la norme ? Cette information serait importante pour les parlementaires nationaux que nous sommes.
L'utilité des banques pour le financement de l'économie va de soi, et il ne s'agit pas de porter préjudice à l'activité bancaire. L'enjeu des régulateurs est de reconnecter le secteur bancaire à l'économie réelle et à la croissance économique. Il y a de bonnes raisons de croire que la croissance du secteur bancaire et financier a été excessive ces dernières années. Il convient d'opérer un rétrécissement du secteur bancaire, afin de reconnecter ce dernier à l'économie réelle. Une réglementation plus restrictive et une taxation pouvant réduire les rentes accumulées par le secteur bancaire sont donc nécessaires.
Ces rentes transparaissent à travers la dynamique des profits des banques, dont l'évolution a été plus rapide que dans le secteur non financier. L'enjeu aujourd'hui est de disposer de banques saines, stables, connectées à l'économie réelle, qui contribuent à la croissance économique. Collectivement, l'enjeu n'est pas la profitabilité des banques. Vous vous étonniez des exigences d'information que nous pourrions faire valoir, simplement en tant que citoyens. Cette transparence participe à la régulation du secteur bancaire. La transmission doit aller dans un premier lieu des banques vers le régulateur, mais il faut également se préoccuper de la transmission de ces informations des régulateurs vers la communauté citoyenne et scientifique. Ces échanges me semblent importants pour nourrir les travaux académiques et formuler des recommandations de politique économique en la matière.
Les filiales dénombrées sont bien financières. Ont-elles été mises en place pour servir les intérêts de sociétés non financières ? Je ne peux absolument pas vous répondre tant le manque de données est important.
En revanche, je ne crois pas à l'anomalie de l'implantation des banques françaises à l'étranger. Le nombre de filiales des banques françaises est important et son pourcentage dans les paradis fiscaux est relativement fort, mais il reste très en deçà des banques britanniques. La tendance générale correspond à l'internationalisation du secteur bancaire.

Monsieur Zucman, avez-vous une idée précise de la répartition par nationalité des comptes offshores (Allemagne, France, Etats-Unis) ? Parmi ce palmarès, où se situe la France ?
Il m'est difficile de répondre à cette question car nombre de comptes sont enregistrés dans la statistique internationale comme appartenant à des sociétés-écrans enregistrées au Panama, ou aux Iles Vierges Britanniques. Néanmoins, il me semble assez clair d'après mes estimations que pour la Suisse - qui gère un tiers de la fortune offshore mondiale - au moins 50 % des comptes offshores appartiennent à des européens.
Dans le cadre de la « directive- épargne », votée en 2005, les comptes offshores suisses sont soumis à un impôt européen. Cette directive est mal rédigée et ne frappe pas les comptes détenus par l'intermédiaire de sociétés-écrans. En 2005 notamment, une très grande proportion de comptes européens a basculé vers des sociétés-écrans. La statistique officielle suisse montre que la quantité d'argent des français et des allemands diminue soudain très fortement, à l'inverse de celle du Panama, des Iles Caïmans, etc. Au moment de l'adoption de la directive épargne, les banquiers suisses et leurs clients ont en effet usé de sociétés écrans pour ne pas payer l'impôt. Par le biais de ce type de changement législatif, on peut estimer ainsi qu'au moins 50 % des comptes suisses appartiennent à des européens.
Sur le cas de la France, 8 % du patrimoine des ménages mondial est détenu dans les paradis fiscaux. Si l'on part de l'hypothèse que la France est dans la moyenne mondiale, les ménages français disposeraient ainsi d'au moins 200 milliards d'euros dans les paradis fiscaux. Je pense que cette estimation est très inférieure à la réalité des choses. En effet, le chiffre de 8 % à l'échelle mondiale est très conservateur, et, lorsque l'on regarde les chiffres suisses, on s'aperçoit que les Français ont plus tendance à utiliser les paradis fiscaux que les résidents d'autres pays.
Sur l'imposition de l'échange automatique d'information, il faut dire haut et fort qu'aucun pays n'a le droit de siphonner la base fiscale de ses voisins, ce que permet pourtant le secret bancaire.

Pensez-vous que le système de transmission automatique d'informations est préférable à l'accord RUBIK proposé par la Suisse à certains pays partenaires ?
J'en suis convaincu. La retenue à la source est appliquée et prévue par la directive épargne. Les banquiers suisses en ont pourtant complètement détourné l'esprit, en faisant en sorte que leurs clients n'y soient pas soumis. J'estime dès lors cocasse que les banquiers suisses proposent désormais une nouvelle retenue à la source par le biais d'accords RUBIK.
La France doit exiger de la Suisse, du Luxembourg et des autres paradis fiscaux qu'ils pratiquent l'échange automatique d'information. Elle doit pour cela menacer de sanctions diplomatiques, commerciales et douanières, de retirer les licences bancaires des banques suisses et des autres paradis fiscaux, jusqu'à ce que ces pays admettent qu'ils n'ont pas le droit de siphonner la base fiscale de leurs voisins. De la sorte, ils se plieront au standard international des échanges automatiques. Aucun paradis fiscal ne peut se mettre contre la volonté de l'Union Européenne et des Etats-Unis, pour lesquels le rapport de force est éminemment favorable. Il suffirait que les deux parlent d'une seule voix pour que le problème soit résolu.

Cette volonté, si elle se concrétise un jour, permettra de répondre à une proposition de la précédente commission d'enquête qui appelait à une gouvernance mondiale dans ce domaine. Tant qu'elle n'existe pas, elle reste au stade de voeu pieux.

Qui s'oppose à ce que l'Europe parle d'une seule voix et qu'elle pèse de tout son poids ?
Le Luxembourg et l'Autriche freinent des quatre fers, donc je ne pense pas que l'Union Européenne soit le bon cadre pour mener ce rapport de force diplomatique. Il suffit qu'une coalition de pays au sein de l'Union Européenne manifeste sa volonté de supprimer le secret bancaire pour qu'elle soit imposée à la Suisse, à Singapour, etc. Je pense que la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni doivent se mettre d'accord sur l'échange automatique d'informations bancaires, et déclarer qu'ils prendront des mesures importantes face à l'ampleur des pertes subies par leurs finances publiques. A ce moment-là, l'échange automatique d'information entrera en vigueur. En tout cas, j'ai du mal à voir comment il pourrait en être autrement.

Les Etats-Unis pratiquent déjà le rapport de force, avec l'UBS et le retrait de licences.

J'ai des questions complémentaires à poser à Madame Couppey-Soubeyran. Du point de vue du management, existe-t-il un avantage financier de la banque à être présente dans les paradis fiscaux ? Les données que la Banque de France refuse de nous transmettre pourraient-elles nous être adressées en tant que commission d'enquête ? Nous pourrions d'ailleurs reprendre à notre compte ces questions et les adresser à la Banque de France.
Afin d'approfondir l'étude, nous nous intéressons au rôle des opérateurs financiers. Pensez-vous utile d'investiguer ce domaine ? La question des holdings et du leasing pourrait être un prolongement. Enfin, j'ai une question sur la maîtrise de l'ingénierie financière et de ses produits ; ainsi, pensez-vous que l'évasion des capitaux passe par des systèmes virtuels, tels que les dérivés ? Quelle est votre appréciation des produits financiers proposés sur les marchés ?
Les avantages financiers de l'implantation dans les centres offshores s'appuient sur des avantages fiscaux, voire réglementaires. En revanche, je ne peux vous proposer d'évaluation chiffrée de leur montant.

Avez-vous des informations relatives aux rémunérations des cadres et dirigeants de ces filiales ?
Nous buttons sur le même problème. Il est extrêmement difficile d'avoir accès aux rémunérations des cadres bancaires à l'étranger. Nous avons une idée du pourcentage de l'effectif localisé à l'étranger, mais aucune information précise n'existe sur la répartition des cadres à l'étranger et des rémunérations qui leur sont versées.
Les informations demandées à l'ACP et à la Banque de France étaient auparavant très accessibles. La Commission bancaire, en son temps, publiait les comptes de bilan et de résultats des banques de manière très détaillée. Elle donnait également des informations sur l'implantation des banques françaises à l'étranger. Le problème de l'accessibilité aux données bancaires est aujourd'hui une réelle difficulté. Le CNIS s'y intéresse de très près, en faisant passer un questionnaire aux universitaires français utilisateurs de données.

Comment expliquez-vous cette évolution entre le comportement de la Commission bancaire en son temps et aujourd'hui avec la Banque de France et l'ACP ?
Je ne vais pas spéculer sur ces raisons. En tant que chercheurs intéressés par les problèmes bancaires, nous faisons souvent face à des difficultés d'accès aux données bancaires.
Il nous faudrait disposer de données assez précises. Une enquête de l'INSEE sur les liaisons financières entre les entreprises, mais à laquelle je n'ai pas participé, traite notamment de ce sujet. J'ignore comment on peut se la procurer pour examiner ensuite les liaisons financières entre les groupes financiers et non-financiers. Les travaux sur ces questions sont rares du fait d'une difficulté d'accès aux données.

Que pensez-vous de la virtualisation et de la dérivation des produits financiers ?
Si votre question porte exclusivement sur le développement de la monnaie virtuelle, je n'ai pas d'avis sur la question. En revanche, plus largement, sur la complexité croissante des produits financiers, il convient d'observer plus attentivement l'innovation financière. L'AMF est chargée d'observer les nouveaux produits, mais cette observation pourrait être effectuée par une autorité à part entière. Cette dernière pourrait s'interroger sur l'utilité sociale des nouveaux produits et techniques, ce que nous n'avons pas fait jusqu'à présent, considérant que ces nouveautés allaient forcément dans le sens de l'efficacité des systèmes financiers.

Monsieur Zucman, avez-vous un avis sur ces sujets ? Quelle est votre appréciation à tous les deux sur le projet de la loi bancaire ?
Je suis loin d'être spécialiste de questions sur l'économie bancaire, donc je n'ai pas d'avis sur les questions extrêmement compliquées qui ont été soulevées. Toutefois, je considère également que le manque d'accès aux données - incluant la répartition des fortunes - est problématique. Notre appareil statistique ne nous permet pas en effet de mesurer qui possède quoi. Si l'on veut taxer le patrimoine, si l'on est attaché à un minimum de progressivité de l'impôt, je pense que nous devons pointer du doigt ce problème fondamental, qui peut être résolu par la coopération des banques.

Existe-t-il des époques privilégiées pour le départ des fortunes vers les paradis fiscaux ? Sont-elles figées ou évoluent-elles ? Le flux de constitution de patrimoine est-il identique ou le capital présent dans les paradis fiscaux s'est-il constitué à une époque ?
Il s'agit de deux questions très importantes auxquelles je n'ai pas de réponse précise.

Le contrôle des changes a été mis en place car certaines fortunes disparaissaient.
L'observation de l'évolution des fortunes en Suisse indique qu'avant la Première Guerre mondiale, il y avait un peu d'argent mais pas énormément. Les premiers afflux massifs datent de l'entre-deux-guerres. Sur la dynamique actuelle, je ne peux pas vraiment vous dire. Au niveau global, sur les douze dernières années, le montant des fortunes offshores, en proportion du patrimoine mondial des ménages, a l'air assez stable, avec toutes les incertitudes qui demeurent et qui restent très importantes.

Vous avez évoqué l'imposition des banques. Selon le document que vous avez fourni, le CPO ne cautionnerait pas les chiffres indiqués. Les aurait-il finalement validés ou existe-t-il deux visions sur les chiffres que vous avez évoqués en matière d'imposition ?
La mention à laquelle vous faites référence indique que l'étude n'est pas assumée par le CPO et en tout cas ne l'engage pas. Des débats importants ont d'ailleurs eu lieu au sein du conseil sur ce sujet. Je pense pour ma part qu'il y a tout lieu d'indiquer les précautions méthodologiques qui s'imposent par rapport à ces chiffres. Mais il me semble que le calcul du taux d'imposition implicite était ainsi nécessaire car il délivre une tendance riche d'enseignements. Il ne faut pas retenir les valeurs absolues.
Elles ont existé dans la mesure où nous avons été obligés de collecter plusieurs types de données. Si nous avions disposé des données de la Banque de France ou de l'ACP, nous aurions pu avoir une base d'informations plus homogène, qui nous aurait dispensé de collecter des données micro et macroéconomiques, et de travailler sur des périodes différentes. Nous avons été le plus rigoureux possible. Les débats portaient sur le fond. Ce rapport a été réalisé dans la période de gestation de la loi bancaire, et peut-être qu'il ne fallait pas trop de court-circuit entre les messages à délivrer.
Les conclusions du rapport général sont très éloignées de celles que nous défendions dans deux rapports particuliers. Nous étions ainsi assez mécontents des conclusions générales reprises et portées dans la presse. Nous avons souhaité faire valoir nos propres conclusions. Le CPO en a pris ombrage et nous a rappelés à notre devoir de confidentialité.
Je crois qu'il existe de bonnes raisons de penser que la fiscalité des banques n'a pas évolué proportionnellement à la dynamique de leurs activités.
Le contrôle interne participe à la régulation d'ensemble du secteur bancaire. Le régulateur a des exigences tout à fait justifiées en la matière. Le scandale Kerviel par exemple n'était pas à mon sens l'affaire Kerviel mais l'affaire Société Générale. C'était l'affaire d'un dysfonctionnement du contrôle interne au sein de cette banque. Ce contrôle interne doit impérativement être renforcé, et les métiers de la banque réorientés vers le contrôle des risques.

Monsieur Zucman, avez-vous un avis sur le contrôle interne des banques ?
Je n'ai pas d'avis mais je souhaite rappeler que les banques sont tenues de connaître les bénéficiaires ultimes des fonds qu'elles gèrent. Cette information devrait être utilisée pour générer des statistiques ayant un sens. Notamment, les banques installées dans les paradis fiscaux devraient utiliser leurs connaissances pour identifier qui se trouve derrière les sociétés-écrans. J'aimerais, par exemple, que la Banque Nationale Suisse puisse nous dire que tant de pourcentages des comptes appartiennent à des Français, des Allemands, etc., au lieu d'affirmer que 60 % des comptes appartiennent aux Iles Caïmans, au Panama, etc. Ces listes peuvent être établies car il existe un contrôle interne et un règlement anti-blanchiment appliqué au sein des banques.

Je vous remercie pour toutes ces informations. Si vous souhaitez nous donner des informations complémentaires ou nous alerter sur certains points, n'hésitez pas.

Avant d'obtenir sur le plan international un accord avec toutes les banques, avez-vous envisagé de proposer aux détenteurs de comptes offshores de rapatrier leur fortune, en contrepartie de quoi ils paieraient X % à l'Etat français sans poursuite judiciaire ?
Non, je pense que la loi doit s'appliquer à tous de la même façon, que l'on soit ou pas riche et puissant. Les personnes qui sont dans l'illégalité peuvent rapatrier leur fortune mais la loi doit s'appliquer. Une solution simplifiée peut toutefois être envisagée qui permettrait à l'Etat d'abandonner les poursuites pénales mais prendrait 100 % des fortunes non déclarées.
Nous n'avons pas répondu à votre question sur la loi bancaire. Le Titre I a mobilisé beaucoup d'énergie mais le Titre II portant sur les mécanismes de résolution est le plus important, car il participera à la simplification des structures capitalistiques. Ce sont de bons éléments sur lesquels la Commission Européenne peut s'appuyer pour accélérer le mouvement sur le volet II de l'Union bancaire.

Je vous remercie. Je vous informe que le Ministre du Budget a demandé, pour des raisons d'agenda, à reporter son audition, qui devrait avoir lieu avant la fin de juin. Nous avons accepté la demande.