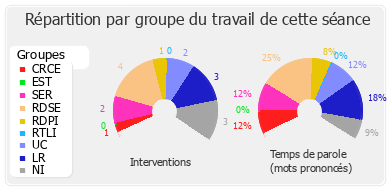Séance en hémicycle du 1er février 2017 à 21h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Thierry Foucaud.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle le débat, organisé à la demande du groupe du RDSE, sur le thème : faut-il supprimer l’École nationale d’administration ?
La parole est à M. Jacques Mézard, orateur du groupe auteur de la demande.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le débat dont nous avons demandé l’inscription à l’ordre du jour du Sénat pourrait être considéré comme un « marronnier », comme on dit dans le jargon journalistique. Je pense pour ma part qu’il est de ces débats particulièrement utiles, même si nous ne sommes pas très nombreux ce soir. La qualité pallie la quantité !
En 1936, un projet de loi défendu par Jean Zay prévoyait la création d’une nouvelle école nationale d’administration, …

Mon cher collègue, si un radical ne le faisait pas, ce serait à désespérer !

Il s’agissait pour lui de mettre fin à une situation obligeant l’État « à recruter ses principaux serviteurs dans une classe privilégiée restreinte dont les intérêts et les sentiments peuvent ne pas coïncider avec ceux de l’ensemble de la nation ».
La question du recrutement d’une élite administrative est légitime. Elle intéresse le Parlement autant que le Gouvernement, compte tenu de la part importante que représente le recrutement dans les dépenses publiques et surtout de l’influence de ses modalités sur la conduite de la politique de la Nation.
Cette question n’a d’ailleurs cessé de jalonner les débats parlementaires, y compris sous la IIIe République. Dès le début du XXe siècle, alors que le recrutement par concours s’impose progressivement, on s’interroge sur la possibilité d’en finir une bonne fois pour toutes avec l’impression de cooptation que donnaient certaines pratiques de recrutement opaques. Il s’agit de doter la République d’un système de recrutement sur concours, sanctionnant uniquement le mérite du candidat, en rupture avec les réseaux de recrutement hérités des précédents régimes et du Second Empire.
À la Libération, l’ENA est créée sous l’impulsion de Michel Debré. Elle a depuis formé nombre de personnalités éminentes de la République, dont trois Présidents de la République et de nombreux ministres.

Bien évidemment !
Aujourd’hui, plus de soixante-dix ans après sa création, il est assez déstabilisant de remarquer que plusieurs des critiques de l’ancien régime de recrutement des hauts fonctionnaires demeurent malheureusement d’actualité.
Les critiques ont surgi très tôt puisque, dès 1967, Jacques Mandrin – alias Jean-Pierre Chevènement, Didier Motchane et Alain Gomez –, dans un ouvrage intitulé L’Énarchie ou les mandarins de la société bourgeoise, écrivaient : « L’activité inlassable et gourmée de tant d’anciens bons élèves munis d’autorité commence cependant d’effrayer. Le pays avait eu, il y a trente ans, le cauchemar de la Synarchie, mais elle n’existait pas. Il découvre l’Énarchie, elle existe bel et bien. Il en ressent l’effroi d’un honnête homme qui se réveille ficelé par des brigands. » Nous reconnaissons là le tempérament de notre ancien collègue Jean-Pierre Chevènement…
Mes chers collègues, vous le savez, il ne s’agit pas de faire un procès aux grandes écoles françaises, qui sont pour la plupart aussi prestigieuses que performantes dans la production de nos élites – je pense à l’École polytechnique ou à l’École normale supérieure, pour ne citer qu’elles. Il faut en effet se souvenir que la guerre de 1914-1918 a été gagnée par des généraux polytechniciens…
L’absence de diversité dans le recrutement de l’ENA ne fait plus de doutes, même s’il y a bien sûr d’heureuses exceptions. Elle pose un sérieux problème de légitimité et d’acceptation de la décision produite par notre administration. L’ENA jouit d’un quasi-monopole pour la formation des cadres supérieurs de la fonction publique étatique, mais ses élèves ne sont pas assez représentatifs de l’ensemble de la Nation. On estime ainsi que près de 28 % des membres des grands corps de l’État auraient au moins un parent énarque. Cela fait tout de même beaucoup ! Comme en attestent les rapports annuels consacrés aux concours de recrutement de l’école, les grandes écoles parisiennes y sont surreprésentées, au premier rang desquelles Sciences Po Paris. La reproduction sociale fonctionne ici à plein régime…
Il semble au contraire demeurer une défiance envers le monde universitaire, qui s’étend du recrutement de la catégorie A+ à celui de la catégorie A. La possibilité d’offrir aux titulaires d’un doctorat une voie d’accès au concours interne sur titre a finalement été abandonnée en mars 2013 sous l’effet d’un certain nombre de pressions.
Il existe donc une lente éviction sociale et territoriale qui commence de plus en plus tôt, puisque les formations préparatoires plébiscitées par le jury de l’ENA recrutent majoritairement dans le bassin parisien, pour ne pas dire dans quelques arrondissements parisiens bien précis. Certains parents choisissent même leur logement en fonction de la proximité des lycées les plus prestigieux, Saint-Louis ou Henri-IV.
La formation dispensée à l’ENA pose également un certain nombre de problèmes : elle fabrique trop de hauts fonctionnaires stéréotypés, sur la forme et sur le fond. Lors de leur arrivée sur le terrain, ces derniers éprouvent souvent, à tort ou à raison, un sentiment de distorsion et d’inadaptation de leur formation à la réalité de leurs tâches quotidiennes. Le pire, c’est quand eux-mêmes ne se rendent pas compte de cette distorsion.
Les critiques énumérées par les anciens élèves de l’École rappellent évidemment celles qui ont été rapportées par l’historien et résistant Marc Bloch dans L’Étrange défaite : « Par deux fois, dans deux campagnes différentes, à plus de vingt ans d’intervalle, j’ai entendu des officiers brevetés dire de l’enseignement qu’ils avaient reçu : “L’École de Guerre nous a trompés.” »
La trop forte porosité entre la sphère publique et les sphères économique et financière est également problématique : c’est la question du « pantouflage ». Cette porosité est encouragée par les dispositions normatives actuelles, destinées à permettre une meilleure « respiration » de la haute fonction publique, dont les membres peuvent se mettre en disponibilité. Plusieurs enquêtes de la direction générale de l’administration et de la fonction publique, la DGAFP, font état de la grande mobilité des fonctionnaires de la catégorie A+, qui est plus importante que celle des autres fonctionnaires.
Quant aux anciens élèves de l’école qui se lancent dans des carrières politiques, ils devraient eux aussi être soumis à l’obligation de rembourser leurs frais de scolarité. Un délai de carence devrait leur être imposé avant de pouvoir se présenter à des élections. Les anciens élèves entrés en politique partagent d’ailleurs une méfiance héréditaire envers le parlementarisme. On remarque en effet qu’ils sont souvent les plus prompts à proposer de restreindre drastiquement les pouvoirs du Parlement et, en particulier, à faire le procès du bicamérisme.
Il est regrettable que des dispositions néfastes à la démocratie représentative soient souvent instillées par la haute administration. Les hauts fonctionnaires veulent souvent diminuer le nombre de parlementaires, mais rarement les effectifs des directions ministérielles ! Actuellement, les règles concernant le contenu de l’engagement décennal et le remboursement éventuel des frais de scolarité font défaut. Qui en assure le contrôle ?
L’engagement décennal doit-il être considéré comme ayant été respecté lorsqu’un énarque est engagé prématurément dans un cabinet ministériel, par une administration européenne ou internationale, ou s’il se réoriente vers une carrière universitaire ? Puisque de nombreux énarques sont également d’anciens élèves de l’École normale supérieure, l’ENS, ou de l’École polytechnique, comment est calculée, madame la ministre, la durée totale d’engagement attendue ? Enfin, dans quels délais ces remboursements sont-ils effectués ?
La haute fonction publique devrait se recentrer sur sa raison d’être : exécuter les décisions des élus de la Nation. Or on observe de plus en plus l’inverse !
Enfin, le poids des grands corps, en particulier du Conseil d’État, a des conséquences plus indirectes sur la vie de notre nation, comme j’ai eu l’occasion de le constater en ma qualité de rapporteur de la commission d’enquête sur le bilan et le contrôle de la création, de l’organisation, de l’activité et de la gestion des autorités administratives indépendantes. J’ai été frappé par le mépris affiché par certains présidents, certes, minoritaires, vis-à-vis de la représentation parlementaire.
L’inflation constante des directions centrales des ministères, la multiplication des autorités, agences et hauts conseils est une autre conséquence du poids des membres de ces grands corps, pour lesquels il faut parfois inventer des distinctions afin d’assurer leur avancement.
Enfin, et surtout, il en résulte une véritable « diarrhée réglementaire », au point qu’on a parfois le sentiment que la machine administrative a inventé le mouvement perpétuel.
Il est clair que, plus que pour toute autre, la pérennité de cette école repose sur sa capacité à intégrer ces critiques et à se réformer. Nous considérons qu’une telle réforme doit porter à la fois sur le recrutement, la formation et le cursus professionnel du haut fonctionnaire énarque.
Plusieurs pistes peuvent être explorées. En matière de recrutement, la possibilité d’aménager des passerelles avec le milieu universitaire pourrait être étudiée, car elle pourrait apporter un peu de diversité. La refondation des épreuves pourrait être approfondie en veillant à évaluer la capacité des candidats à répondre à une commande politique et en accordant moins de poids à l’épreuve de culture générale.
J’ai souvenance de questions ayant été posées à un certain nombre de mes amis de l’Université : « Quelle est la hauteur de la Seine à Paris ? » La réponse attendue est : « Sous quel pont ? » Ou encore : « Madame, pouvez-vous nous expliquer la différence entre pudeur, pudibonderie et pruderie ? » Ce moyen de sélection a atteint ses limites. Il engendre le plus de réponses stéréotypées et avantage très nettement les candidats « bien nés » disposant d’un fort capital culturel.
Pour conclure, madame la ministre, il faut rendre obligatoire le remboursement des frais de scolarité de ceux qui ne respectent pas leur engagement décennal, clarifier les règles de remboursement et fixer des délais précis. Il s’agit de s’assurer que la devise de l’École demeure « Servir sans s’asservir » – et non « se servir ». Le diplôme de l’ENA ne doit plus être considéré par quelques jeunes étudiants aussi brillants qu’ambitieux comme un ticket d’entrée dans une carrière politique accélérée, ou encore comme un moyen de parvenir au sommet de la direction d’une grande entreprise du CAC 40.
Faire l’ENA, c’est d’abord être animé par le sens de l’État, c’est vouloir servir son pays en assistant le pouvoir politique, le seul qui bénéficie de la légitimité démocratique de l’élection, celle-là même qui lui permet de décider et d’assumer en responsabilité.
Il s’agit donc, madame la ministre, non de supprimer l’ENA, mais de la réformer.
Applaudissements sur les travées du RDSE et du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à remercier mes collègues du groupe du RDSE et leur président, M. Jacques Mézard, d’avoir demandé l’inscription de ce débat à l’ordre du jour du Sénat.
Le thème de ce débat – « Faut-il supprimer l’École nationale d’administration ? » – pose en fait deux questions distinctes.
La première porte sur la pertinence d’un cadre commun de formation de nos hauts fonctionnaires. Pour répondre à cette question, il faut en revenir aux origines de l’ENA et à ses fondateurs, Michel Debré, mais aussi Maurice Thorez.
À la source de la réflexion de ces deux hommes se trouvent les projets non aboutis d’Hippolyte Carnot et de Jean Zay qui, pour harmoniser et unifier les procédures de recrutement des différentes administrations, d’une part, et pour lutter contre le corporatisme inhérent à des cercles fermés, d’autre part, avaient eu l’idée de créer une procédure de recrutement et de formation unique. La démission pour l’un, le rejet du Sénat pour l’autre ont conduit au maintien d’un système dans lequel chaque corps s’organisait librement.
Outre ces enjeux, se posait la question de la démocratisation de la haute fonction publique, sur la base d’une méritocratie républicaine et d’une égalité de fait entre classes dominantes et classes populaires. Au fond, c’était l’article VI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qu’il s’agissait de mettre en œuvre.
Par ailleurs, il faut aussi se rappeler le contexte de la création de l’ENA : notre pays était alors ravagé tant matériellement que moralement, notre administration avait failli à sa tâche et renoncé à ses valeurs supposées en détournant sciemment le principe de neutralité de la fonction publique pour se dédouaner des actes inhumains commis par le régime de Vichy et les forces d’occupation.
La création de l’ENA devait clairement permettre de faire émerger une nouvelle génération de hauts fonctionnaires, issus de tous les horizons, et pour qui les valeurs républicaines n’étaient pas juste un prétexte pour se dédouaner. Cette mission, c’est Thorez et Debré qui l’acteront, mais c’est tout le Conseil national de la Résistance qui l’initiera.
La seconde question qui est posée est celle de l’accomplissement de cette mission par l’ENA aujourd’hui. À cette question, la réponse est forcément négative, et ce pour plusieurs raisons.
Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, dès les années soixante, avaient constaté que le projet émancipateur de l’ENA avait été biaisé et ne servait finalement qu’à la perpétuation des élites. Plus qu’une catégorie ou une classe, le monde de l’énarchie est devenu une caste se perpétuant de génération en génération. Ainsi, les « camarades de classe à l’école » deviennent « copains de promo à l’ENA » pour reprendre les termes des sociologues Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot. Cette reproduction sociale repose sur deux éléments.
Le projet de Thorez et Debré devait, pour fonctionner, s’appuyer sur une école républicaine égalitaire, l’institution scolaire devant gommer les inégalités de capitaux au lieu de les creuser. Or, comme le rappelait le Conseil national d’évaluation du système scolaire en septembre dernier, la France reste la championne des inégalités à l’école parmi les pays de l’OCDE. De fait, la mise à mal de l’égalité républicaine dans le domaine scolaire, couplée au concours particulièrement ardu de l’ENA, permet à la seule élite d’y accéder, car elle y est mieux préparée depuis la maternelle. Pour ma part, j’ai essayé, mais j’ai échoué…
Par ailleurs, et c’est le second élément, le vivier de recrutement de l’ENA se limite peu ou prou à deux écoles elles-mêmes particulièrement élitistes, Polytechnique et Sciences Po. Même si cette dernière a, par le biais des conventions d’éducation prioritaire, tenté d’ouvrir plus largement ses portes, il n’en demeure pas moins que le nombre de boursiers du 27 rue Saint-Guillaume n’atteint pas le tiers des élèves et que 65 % des étudiants sont issus des catégories socioprofessionnelles les plus élevées. Ces derniers représentent 82 % des nouvelles entrées à l’ENA…
La situation s’est aggravée du fait de la suppression, en 1990, de la troisième voie, ouverte aux dirigeants associatifs et syndicaux, créée par Anicet Le Pors en 1983. Il s’agissait pour ce dernier de créer ce qu’il appelle « l’élitisme de masse ». La troisième voie devait permettre le strict respect du principe d’égale admission aux emplois publics de tous les citoyens. La pleine signification du projet d’Anicet Le Pors était la promotion aux plus hauts niveaux de l’administration de citoyennes et de citoyens de qualité, ayant fait la preuve de leur attachement au service public dans des activités qualifiées antérieures, issus pour la plupart des couches populaires. Croyez-moi, j’en connais qui ont réussi l’ENA grâce à cette troisième voie.
La situation de l’ENA aujourd’hui, mélange d’homogénéité et de reproduction sociale, a des conséquences qui, en définitive, rejaillissent sur l’ensemble de l’administration et sur l’État.
Tout d’abord, comme le montre Luc Rouban dans son étude sur les profils et trajectoires des énarques, les lignes entre le politique et l’administratif se sont brouillées depuis le début des années quatre-vingt. Il y a plusieurs raisons à cela, plutôt logiques d’ailleurs.
D’une part, il ne faut pas oublier qu’une partie des énarques se sont lancés en parallèle en politique. De fait, leur pouvoir de nomination leur a permis de s’appuyer sur des gens de confiance pour mener leur action. Et qui d’autre que les fameux « copains de promo » pour le faire ?
D’autre part, la technocratisation progressive de la politique a permis dans bon nombre de cas le renforcement de liens sur des fondements techniques et non idéologiques. Cette logique pouvait s’entendre lorsque les sphères politiques et administratives étaient étanches. Or il y a bien longtemps que la haute administration fait de la politique. Qui peut dire aujourd’hui que les rapports d’éminents technocrates ne sont pas politiques ?
Il est d’ailleurs à noter que les nouveaux énarques semblent souffrir des mêmes maux, comme le relevaient les membres du jury d’admission à l’ENA en 2015 : « absence de sens critique », « incapacité de prise de hauteur » et « conformisme idéologique ». Et le profil des élèves admis à l’ENA, qui ont plutôt fait des écoles de commerce que des études de droit, ne peut qu’aggraver le problème. On se retrouve bien souvent avec des hauts fonctionnaires ayant un profil de gestionnaires privés bien plus que de cadres attachés au service public.
Enfin, j’aborderai la question du pantouflage.
Il est regrettable que le Conseil constitutionnel, composé pour moitié d’énarques, ait censuré le transfert à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du contrôle des départs vers le secteur privé des très hauts fonctionnaires et membres de cabinet. C’est en effet aujourd’hui une constante : les dix ans d’engagement au service de l’État et de l’intérêt général exigés des énarques en contrepartie de la gratuité de la formation ne sont que rarement accomplis. À titre d’exemple, Bruno Bézard, mais il est loin d’être le seul, a quitté la direction générale du Trésor pour rejoindre un fonds d’investissement franco-chinois, Cathay Capital.
Il s’agit là d’une bataille démocratique d’importance dans laquelle le groupe CRC est profondément engagé, comme en attestent nos multiples interventions lors de l’examen de la loi Sapin II, ainsi que les amendements que nous avons déposés sur ce texte.
Reproduction des élites et homogénéité idéologique ont donc conduit à l’appauvrissement de la haute fonction publique, et donc des serviteurs de l’intérêt général, d’une part, et à des pratiques particulièrement douteuses de copinage entre les membres de cette caste, d’autre part.
Certes, il est indispensable d’avoir une école pour former les hauts fonctionnaires, mais il est essentiel de revenir aux fondements de l’ENA et de mener une réforme particulièrement profonde pour permettre sa démocratisation. Il s’agit de faire de cette école un outil d’émancipation et de formation des plus hauts serviteurs de l’État, et donc des services publics.
Applaudissements sur les travées du RDSE et du groupe écologiste.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme l’écrivait Marc Bloch, dont la loyauté à la République est indiscutable : « À une monarchie, il faut du personnel monarchique. Une démocratie tombe en faiblesse, pour le plus grand mal des intérêts communs, si les hauts fonctionnaires formés à la mépriser […] ne la servent qu’à contrecœur ».
Le sens de l’État est la première qualité du fonctionnaire. Dans une démocratie, le président Mézard l’évoquait, le sens de l’État implique de respecter le principe démocratique et de se mettre au service du pouvoir élu. Malheureusement, cette qualité est l’une des plus difficiles à déceler au moment d’un concours. Elle ne se révèle en réalité qu’au cours d’une carrière, au travers des choix individuels du fonctionnaire, et se mesure à l’aune de sa propension à faire primer le bon fonctionnement de son service et de l’administration sur son destin personnel.
On peut toutefois considérer que le fonctionnement actuel de l’ENA et le statut spécifique de la catégorie A+ présentent des défauts susceptibles d’affaiblir le sens de l’État de certains anciens élèves de cette école, comme celui des fonctionnaires d’autres catégories.
Dans la continuité des constatations faites par Jacques Mézard, j’évoquerai la question des modalités d’affectation des énarques dans les différents corps, puis les difficultés managériales liées à l’imperméabilité de ces corps.
En premier lieu, l’opacité qui entoure l’affectation de sortie des énarques dans les différents corps de l’administration est un facteur initial de frustration. Actuellement, tous les candidats d’une même voie – interne, externe, troisième voie – sont soumis aux mêmes épreuves, ce qui permet de recruter de bons généralistes. Chaque élève reçoit la même formation, malgré la différence des postes accessibles à la sortie de l’école : conseiller de tribunal administratif, administrateur civil au ministère de l’agriculture, conseiller des affaires étrangères ou inspecteur général de l’administration…
La cérémonie de l’« amphi-garnison » qui clôture la scolarité à l’école, au cours de laquelle les élèves choisissent leur affectation successivement en fonction de leur rang de sortie, ne permet pas d’aiguiller les élèves vers les carrières les plus adaptées à leurs compétences. Un individu ayant une formation d’économiste pourra ainsi être nommé au Conseil d’État.
Surtout, la performance de l’élève au cours de ses deux années d’école et son classement final auront un impact très fort sur le déroulement de toute sa carrière. Cela explique pourquoi le classement est très contesté : il repose sur l’attribution d’une seule note, établie à partir des évaluations des maîtres de stage et des résultats aux épreuves de management subies lors du cursus.
Jusqu’à présent, la réforme de ce système de classement, qui ne fonctionne pas toujours très bien, n’a jamais abouti. On pourrait pourtant imaginer différentes solutions : les candidats pourraient choisir une épreuve majeure en fonction du corps qu’ils souhaitent intégrer lors du concours d’entrée ou l’affectation par classement pourrait se faire dès l’entrée à l’École, sur la base des notes obtenues au concours. La formation des élèves pourrait ainsi être calibrée en fonction de leur future affectation.
Saluons néanmoins l’ouverture accrue de l’École aux entreprises. Cela étant dit, peut-être ne serait-il pas inutile que les futurs administrateurs civils et magistrats puissent effectuer un stage au sein du Parlement ?
En second lieu, l’existence d’une catégorie A+ implicite et rigide cause de nombreuses difficultés managériales.
Tout d’abord, cette catégorie s’est imposée hors de tout cadre législatif, puisque la loi du 11 janvier 1984 ne prévoit que trois catégories distinctes : A, B et C. Elle a seulement été définie dans le rapport annuel 2009-2010 de la DGAFP.
Il s’agit d’un frein considérable à la promotion de la performance au sein de la fonction publique, puisque, à travail égal ou supérieur, un cadre de catégorie A ne pourra jamais parvenir à un niveau d’intéressement égal à celui d’un cadre de catégorie A+, sauf à repasser des concours internes.
Pourtant, en raison du maintien de concours d’accès parallèles pour des fonctions nécessitant une certaine spécialisation, on constate l’existence de différences de traitement substantielles entre un énarque et un autre fonctionnaire à des postes similaires. C’est notamment le cas au ministère des affaires étrangères, dans les tribunaux administratifs et les chambres régionales des comptes. Un alignement des grilles de traitement doit être envisagé, dans un souci d’équité.
De façon plus ambitieuse enfin, la différenciation de la catégorie A et de la catégorie A+ pourrait être repensée. Il faudrait dynamiser les outils de promotion interne qui doivent être fondés non seulement sur l’expérience, mais aussi sur la performance. Il faut approfondir le travail accompli dans ce sens depuis la remise du rapport Diefenbacher.
Ainsi, l’existence même de l’accès direct aux grands corps pourrait être remise en cause en s’inspirant du fonctionnement de l’ordre judiciaire. Il serait peut-être bon de réserver en partie l’accès au Conseil d’État, à la Cour des comptes et à l’Inspection générale des finances aux fonctionnaires ayant fait preuve de leurs mérites dans le long terme, et non pas seulement lors du concours initial.
En conclusion, cette refondation doit être conçue en parallèle d’une réflexion sur la lutte contre le pantouflage. La création de commissions de déontologie ne semble pas suffisante.
Vous l’aurez compris, il s’agit dans tous les cas de valoriser la carrière des hauts fonctionnaires démontrant sur le long terme leur sens de l’État, la première et la plus indispensable des qualités que le jury devrait s’employer à rechercher en priorité chez tous les candidats admissibles à l’ENA.
Applaudissements sur les travées du RDSE et du groupe écologiste, ainsi que sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le thème de notre débat – « Faut-il supprimer l’École nationale d’administration ? » –donne l’occasion à la représentation nationale de se pencher sur une école dont tout le monde a entendu parler, et dont beaucoup de parents, souvent issus eux-mêmes de la fonction publique, rêvent pour leurs enfants, parce qu’elle est dans leur esprit synonyme de réussite.
Il suffit, en effet, de se pencher sur le parcours de certains des responsables politiques ou cadres supérieurs de diverses entreprises en vue pour constater que l’ENA fait partie des écoles dont sont issus, depuis la fin de la guerre, un certain nombre de dirigeants de notre pays.
À l’inverse - et c’est sans doute la contrepartie des rêves que l’ENA a pu susciter dans certaines familles ou certains milieux -, l’ENA est aussi l’une des écoles, voire l’école qui suscite le plus de regrets ou de déceptions : déception de ne pas avoir réussi le concours, regret de ne pas être sorti avec un classement permettant d’accéder directement à un grand corps, sentiment que les candidats issus de certains milieux socioprofessionnels ont plus de chances que d’autres d’y accéder, etc. Il y a toujours une bonne excuse à faire valoir.
Comme disait ma grand-mère : « il vaut mieux faire envie que pitié ». Il est donc tout à fait naturel que cette école, dont beaucoup de parents rêvent pour leurs enfants, fasse l’objet d’autant de critiques que de louanges.
Faut-il pour autant supprimer l’ENA ?
Si oui, par quoi la remplacer ? Plusieurs des orateurs précédents ont soulevé la question en ne souhaitant pas le retour au système antérieur.
Si non, comment l’améliorer et gommer les reproches qui lui sont adressés, avec lesquels je suis parfaitement d’accord ?
Quels sont donc les reproches que l’on entend le plus souvent ?
D’abord, celui de ne plus jouer le même rôle de démocratisation de l’accès à la haute fonction publique qu’à ses débuts. Alors qu’avant 1945 chaque filière de la fonction publique organisait son propre recrutement et avait naturellement tendance à puiser dans le même milieu socioprofessionnel de génération en génération, force est de constater que la création d’une école unique d’accès aux diverses responsabilités de la « haute fonction publique » a constitué un vrai rempart au népotisme qui prévalait parfois, et une vraie prime au travail et aux qualités personnelles des candidats par rapport à leur origine sociale ou politique.
Il n’y a pas que des fils de préfets ou de conseillers d’État qui entrent à l’ENA, et je crois pouvoir dire que j’en suis un des nombreux exemples, moi qui suis le fils d’un couple de petits agriculteurs n’ayant chacun que leur certificat d’études. J’étais d’ailleurs le seul fils d’agriculteur dans ma promotion. Peut-être était-ce un alibi pour l’ENA ? Je n’en sais rien.
Alors oui, si la création de l’ENA a constitué une sorte de rempart au népotisme et, de manière générale, à la politisation de l’administration publique qui existait à l’époque, force est cependant de constater un paradoxe, celui de la faible diversification de son recrutement.
Si l’on se réfère à une étude menée par deux chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales sur les années 1985 à 2009, on constate que les enfants de cadres représentent de l’ordre de 72 % des élèves de chaque promotion de l’ENA, suivis par 12 % d’élèves issus de la catégorie des professions intermédiaires, 9 % de familles d’agriculteurs ou artisans, et seulement 6 % de familles d’employés et d’ouvriers.
Il faut aussi constater que l’on observe peu ou prou les mêmes répartitions d’origines socioprofessionnelles à Sciences Po, à l’École normale supérieure ou à l’École polytechnique. Sans doute n’est-ce pas tout à fait ce que l’on attend de l’accession par concours à une école, quelle qu’elle soit. Cependant, le système du concours pour accéder à une formation ou à un poste reste, me semble-t-il, quelles que soient ses limites, le moins mauvais que l’on ait trouvé, …

… d’autant plus que le nombre de postes ouverts au concours interne s’est rapproché de celui du concours externe, ce qui n’était pas du tout le cas à l’époque où j’ai passé le concours externe.
Alors, quelle solution face à cette sorte de « reproduction des élites » ? J’avoue ne pas avoir la réponse.
Un autre reproche est souvent adressé aux énarques, celui de peupler les cabinets ministériels et d’avoir une forte – certains diraient trop forte – influence sur les politiques qui sont menées par les divers gouvernements dans certains domaines, quelle que soit leur couleur politique.
Il est vrai que l’on fait parfois le même reproche à certains professionnels de l’éducation nationale s’agissant de la politique scolaire. Nul n’ignore que le ministère de l’éducation nationale est truffé d’enseignants et que, s’il est une branche dans la fonction publique où les syndicats, qui ne sont sans doute pas composés d’énarques, font la pluie et le beau temps ou presque, c’est bien l’éducation. Nous le savons tous, du moins tant que nous avons encore les pieds sur le terrain, ce qui sera sans doute moins le cas lorsque nous ne serons plus que sénateurs.
On touche là directement, je crois, à la responsabilité du politique. Suffit-il de remplacer un énarque par un autre dans un cabinet ou de remplacer un énarque par un non-énarque pour mieux régler ou régler différemment un problème ? Ce serait tellement simple si cela suffisait ! Et cela se saurait…
En tout état de cause, s’il est clair qu’un membre du Gouvernement est d’abord un politique, il est non moins clair qu’il a besoin de travailler avec des collaborateurs connaissant les rouages de l’administration. Et force est de reconnaître que, dans certains ministères, ce sont souvent des énarques qui occupent des postes à responsabilités parce que, précisément, les administrateurs issus de cette école sont ceux qui connaissent le mieux le fonctionnement interne et les moyens dont dispose l’État.
Dans certains ministères, les postes à responsabilités sont tenus par des magistrats ou des membres de l’éducation nationale, pour ne citer que ces deux exemples. Même problème, même solution ! Ces ministères sont-ils mieux gérés que ceux qui sont peuplés d’énarques et les politiques qu’ils mènent sont-elles plus efficaces ? Je ne me permettrai pas de répondre ni de dire ce que j’en pense.
Alors, quelles solutions, si l’on considère que l’ENA pose problème pour notre pays ? Supprimer cette école n’arrangerait rien. Nous avons besoin d’une haute fonction publique formée et préparée aux responsabilités. On peut toutefois penser à des améliorations, comme le fait de rendre plus professionnel et moins théorique l’accès au concours de l’ENA à partir d’un certain niveau de responsabilités et de donner peut-être une plus grande part, dans le choix de certains responsables, aux qualités managériales.
Peut-être convient-il également de renforcer les aspects pratiques de la formation à l’ENA, même si des avancées ont été faites, avec plus de missions concrètes et de séjours dans diverses entités déconcentrées ou décentralisées, dans des entreprises, des collectivités ou autres structures, dont les élèves seront éventuellement appelés ultérieurement à réglementer ou à superviser les activités ?
Peut-être aussi faut-il que les politiques fassent preuve d’une plus grande implication dans la préparation et la mise en œuvre des décisions relevant de leurs ministères et dont ils sont à l’origine ? Là, on rejoint le service après-vente – ou après vote, mais c’est la même chose –, expression que l’on entend parfois ici. Faisons-nous bien notre travail si nous votons, dans une loi, une décision de principe et si nous ne regardons pas la manière dont les administrations centrales la mettent en œuvre ? Là aussi, il y a quelque chose à faire sans qu’il soit nécessairement besoin de taper sur l’ENA.
Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire, sans doute trop longuement, à propos de l’ENA, en osant, pour conclure, parce que le problème n’est pas simple à régler, paraphraser Churchill : l’ENA est pour l’administration publique la pire des formations, à l’exception de toutes les autres.
Applaudissements sur les travées de l’UDI-UC et du RDSE, ainsi que sur certaines travées du groupe Les Républicains et du groupe socialiste et républicain.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, une scolarité déconnectée de la réalité, l’inadaptation du contenu des enseignements aux nouveaux enjeux du monde contemporain, l’obsession du classement, la responsabilité des élites dans la défiance envers les institutions politiques et administratives, les griefs formulés ici même à l’encontre de l’École nationale d’administration sont nombreux et nous interrogent. Je remercie donc très vivement le groupe du RDSE et son président, Jacques Mézard, d’avoir fait inscrire à notre ordre du jour ce débat sur la nécessité de supprimer ou non l’ENA.
Si la manière dont sont recrutés et formés les hauts fonctionnaires, et plus généralement même l’existence des grands corps de l’État, ne nous donne pas satisfaction, ces questions doivent être réglées.
Le recrutement des énarques pose la question de savoir qui sont nos élites. Le constat est édifiant, cela a été dit par tous les orateurs : ces dernières sont majoritairement masculines, alors que les filles réussissent plutôt mieux à l’école, issues des mêmes milieux sociaux et des mêmes écoles. Cette absence totale de diversité n’est absolument pas en adéquation avec les besoins de notre société : nous avons besoin de hauts fonctionnaires qui doutent, à même d’innover, de préparer l’avenir. Le fait de réussir brillamment un concours très difficile à l’âge de 21 ans ne prédispose pas forcément au doute ni à l’innovation.
Le système actuel comprend tout de même des moyens de diversifier la haute fonction publique, avec le troisième concours s’adressant aux actifs du secteur privé, aux élus et aux responsables associatifs. Il faudrait développer cette troisième voie et mettre en place un réel statut de l’élu. Ainsi, l’ENA pourrait être une voie permettant de diminuer le nombre de mandats et la durée de vie en politique ; elle serait ainsi plus vertueuse.
Un autre levier pourrait être trouvé en privilégiant davantage le concours interne, destiné aux fonctionnaires. Il faudrait recruter plus de fonctionnaires expérimentés, avec une plus grande diversité. En plus de diversifier le profil des lauréats, même si cela ne répond pas à la question de l’hypermasculinité de l’école, cela permettrait de favoriser les retours d’expérience et les échanges.
Développer la diversification, cela passe aussi par l’éducation pour lutter contre l’autocensure, évoquée par la présidente Assassi, qui explique aussi que les jeunes issus de milieux modestes ou les femmes tentent moins d’entrer à l’ENA. La promotion qui a effectué sa rentrée au mois de janvier 2016 illustre cette absence de diversité. Parmi les lauréats, on ne compte qu’un quart de femmes, ce qui est un défi intellectuel, celles-ci réussissant beaucoup mieux que les hommes dans toutes les filières du supérieur, …

… et 70 % des admis du concours externe sont issus de Sciences Po Paris.
L’évolution de notre haute fonction publique passe également par la formation initiale et continue des énarques. Le mouvement enclenché en 2016 est encourageant : il était temps ! Des changements importants ont été engagés depuis cinq ans, afin d’axer davantage la scolarité sur les relations humaines, d’offrir plus de stages dans des milieux variés.
Demain, les hauts fonctionnaires auront vocation à exercer des missions extrêmement difficiles, à répondre à des questions essentielles, et il est nécessaire de développer plus encore la prévention des conflits d’intérêts, la formation à la gestion des conflits dans une société toujours plus conflictuelle, mais aussi l’intelligence émotionnelle, qui n’est pas enseignée à l’ENA, ce qui explique sans doute une partie des problèmes rencontrés. Autrement dit, il faudrait apprendre à nos énarques à mieux connaître leurs émotions et celles des autres, afin d’améliorer leurs capacités relationnelles.
Surtout, il nous paraît primordial d’ancrer l’École nationale d’administration à l’université.

Nous défendons l’idée selon laquelle les énarques doivent s’initier à la recherche, être formés à l’université avec les élites scientifiques. Nous sommes le seul pays au monde à compter si peu de docteurs parmi nos élites, ce qui est incompréhensible aujourd’hui. Les énarques sont brillants, mais ils doivent aussi se confronter aux sciences dures et à la recherche. Face aux évolutions technologiques de notre société, il n’est plus possible que nos élites s’affranchissent de la formation par la recherche et à la recherche.
Pour illustrer mon propos, j’évoquerai la question de l’open data, qui fut très bien comprise, lors de la préparation de la loi Lemaire, par quelques jeunes énarques issus de la génération geek. L’exercice s’est avéré un véritable calvaire pour les autres et, du coup, pour les rédacteurs de la loi, faute de partager le même langage, malgré la bonne volonté de tous.
Bien évidemment, ce nouveau rôle de l’université dans la formation des énarques ne devrait pas se faire au détriment des moyens alloués à l’université. Les énarques, principalement issus de milieux privilégiés, pourraient percevoir un traitement légèrement minoré, les crédits correspondants étant attribués à l’université. Par ailleurs, l’université de Strasbourg, proche de l’Allemagne, formerait plus de bilingues ; tout cela irait dans le bon sens.
Nous ne proposons donc pas de supprimer l’ENA, dont les travers ont été signalés. Celle-ci forme des têtes bien faites, des personnes à haut potentiel qu’il convient d’intégrer à l’université, de confronter à la recherche et de mélanger aux élites scientifiques de notre pays.
Enfin se pose la question du pantouflage. Il faut que les énarques connaissent l’entreprise privée, son fonctionnement, ce qu’est la compétitivité. Pour autant, des abus ont été constatés depuis dix ans, choquant nos concitoyens, en dépit de toutes les commissions qui s’efforcent d’être vertueuses.
Vous l’aurez compris, plus qu’une suppression pure et simple, qui n’aurait pas vraiment de sens, un pays ayant besoin d’élites, nous proposons une réforme d’envergure : l’ENA à l’université, avec l’université. Que tout le monde essaie de parler l’allemand, regarde ce qui se passe en Allemagne et cela n’ira pas plus mal !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC, du groupe socialiste et républicain et du RDSE.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je voudrais d’abord rendre hommage aux très nombreux anciens élèves de l’École nationale d’administration que j’ai pu rencontrer dans des préfectures, des ministères, des établissements publics et qui m’ont souvent frappé par leur haut sens de l’intérêt public et du service public. Il y a tellement de « marronniers », comme l’a dit Jacques Mézard, consistant à imputer à cette école quelques-uns des maux de la société qu’il faut aussi rendre hommage à ceux qui ont créé cette école, inspirée de la Résistance et du gaullisme social, afin de donner à notre pays les cadres de la fonction publique qui lui étaient nécessaires.
Je ne voudrais pas que l’on fasse finalement une erreur de raisonnement, qui serait sanctionnée dans beaucoup de concours, consistant à créer des rapports de causes à effets sans jamais les prouver. Par exemple, notre excellent collègue Jacques Mézard nous dit que les énarques sont vraiment méprisants à l’égard du Parlement…

… et n’aiment pas le bicamérisme. Je me demande ce qui autorise une telle affirmation. Est-elle fondée sur une étude statistique, une enquête ? Certes, il existe un antiparlementarisme dans notre pays, mais je ne crois pas qu’on puisse l’imputer aux énarques plus qu’à d’autres. D’ailleurs, au sein du Parlement, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, un certain nombre d’énarques contribuent utilement à notre travail.
Il faut faire attention à ces corrélations. Par exemple, beaucoup de choses qui ont été dites ici à juste titre de l’ENA valent pour toutes les grandes écoles. Tout comme Yves Détraigne, je n’étais pas prédestiné : j’ai appris l’existence des classes préparatoires par un collègue moniteur de colonie de vacances. J’ai posé ma candidature et beaucoup travaillé pour intégrer une grande école. Cela fait aussi partie d’un itinéraire relevant de la méritocratie républicaine ; il ne faut pas le dénigrer.
La vérité, c’est que la démocratisation de l’enseignement est sans doute, dans certains de ses aspects, en régression. Les chiffres que l’on donne quant à l’origine sociale des élèves valent pour l’ENA aussi bien que pour l’École polytechnique, HEC et beaucoup de grandes écoles de ce pays.
Je vois la source de ce problème dans la manière dont on traite l’enseignement élémentaire. Je sais que beaucoup de choses ont été faites, mais, si l’on veut régler cette question, il faut beaucoup de temps scolaire, se concentrer sur les savoirs fondamentaux dès l’école, être très exigeant et n’accepter jamais qu’un élève arrive en sixième sans savoir lire, écrire. Or nous en sommes très loin.
Notre école est à refonder autour de l’idée d’une école de l’exigence. Cela a été réalisé dans l’histoire, à une époque où beaucoup moins de jeunes faisaient des études jusqu’au baccalauréat. Cependant, je crois que la source du problème est beaucoup plus profonde, elle se trouve dans l’ensemble de notre conception de l’enseignement dès le départ.
De même, je partage les constats de Corinne Bouchoux sur la singularité française que sont les grandes écoles. Celles-ci sont certainement très remarquables, mais je crois qu’il est nécessaire de les intégrer aux universités, en tout cas de créer des liens beaucoup plus forts qu’ils ne le sont aujourd’hui. Il est étrange, en effet, que les professeurs des classes préparatoires aux grandes écoles n’aient aucune obligation de recherche, contrairement aux enseignants de l’université, dont j’ai fait partie, lesquels ne manquent pas d’être heureux de voir leurs enfants être admis dans des classes préparatoires aux grandes écoles où exercent d’excellents enseignants qui ne sont pas tenus à des activités de recherche…
J’en viens à la question de la formation dispensée à l’ENA, qui serait critiquée pour être trop générale. Pour ma part, je suis un adepte de la formation générale : apprendre à raisonner, à penser, à s’exprimer, à analyser est primordial, et je ne suis pas forcément convaincu par les discours qui, à l’école élémentaire comme à l’ENA, vantent une grande dispersion des séquences de formation. On veut ouvrir l’école sur tout : c’est très bien, mais il faut d’abord assurer le fondamental.
Je dirai la même chose pour l’École nationale d’administration. Les stages, que ce soit dans une administration ou une collectivité locale, dans une ambassade à l’étranger ou dans une entreprise, sont très précieux et bénéfiques, mais il faut aussi que le reste de la formation soit substantiel.
Une ancienne élève de l’ENA, magistrate de la Cour des comptes, a écrit, dans un article publié par le quotidien Le Monde : « Ce qui manque est connu depuis des décennies : c’est un programme, une pédagogie, un corps enseignant ».
Savez-vous qu’il n’existe pas de corps enseignant à l’ENA ? Cela a de bons côtés, puisque d’éminents administrateurs de nombreux ministères, et même du Sénat ou de l’Assemblée nationale, ne manquent pas de faire des cours à l’ENA, et ils le font très bien. Mais ne faudrait-il pas réfléchir à une structure permanente plus forte, avec une pédagogie et des programmes mieux définis ? Le fait de disposer de programmes mieux définis n’est pas antinomique du fait de donner à l’enseignement le caractère général qui me paraît nécessaire, étant entendu, bien sûr, qu’un enseignement général qui n’a pas d’ouverture sur les réalités professionnelles est un enseignement à la généralité duquel il manque quelque chose.
Enfin, je voudrais aborder la question de l’affectation des étudiants issus de l’ENA. Voilà quelques années, on avait tenté d’en finir avec le classement de sortie, qui est en effet problématique, car il induit une hiérarchie des ministères absolument contraire à l’esprit républicain.
Une ancienne ministre avec qui j’ai eu l’occasion de travailler, qui est actuellement maire d’une ville importante du département du Nord, capitale de la région des Hauts-de-France, a choisi, en sortant de l’ENA, de rejoindre le ministère du travail. Ce choix est apparu incongru à certains. Si vous êtes dans les premiers du classement, vous choisissez en principe le Conseil d’État, l’Inspection des finances, la Cour des comptes, puis le Quai d’Orsay… Le ministère des affaires sociales et le ministère du travail arrivent en dernier, comme s’il existait une sorte de hiérarchie et qu’il était plus noble d’être affecté à Bercy qu’au ministère des affaires sociales. Or nous avons besoin de grands administrateurs pour gérer le ministère du travail et la sécurité sociale, tout autant qu’à Bercy !
On me reprochera peut-être ma franchise, mais, entre les moyens de certaines directions de Bercy et ceux de la direction de l’administration pénitentiaire au ministère de la justice, il y a plus que des nuances, je vous l’assure. L’idée même d’une telle hiérarchie me paraît devoir être contestée.
Par ailleurs, pour mettre fin à la pratique de l’« amphi-garnison » qui voit les quinze premiers choisir les grands corps et les autres prendre ce qui reste, un énarque issu d’une promotion dont on a quelque peu parlé, Jean-Pierre Jouyet, avait imaginé un système qui, par un processus itératif jalonné de moult commissions et entretiens, cherchait à faire correspondre les souhaits des élèves et les besoins des administrations.
Avec notre collègue Catherine Tasca – je me souviens encore de nos entretiens à ce propos au ministère chargé de la fonction publique –, je me suis opposé à ce système. Certes, le système actuel doit être amélioré, mais si c’est pour le remplacer par un processus qui risque de remettre au goût du jour les connivences en mettant fin à tout anonymat, ce serait incontestablement une régression.
Je souhaite que des réformes interviennent, notamment dans la formation interne et les affectations, mais à condition que l’on sache concilier le nécessaire esprit de réforme avec le souci rigoureux de l’égalité et de la justice. Je préfère le concours anonyme aux passe-droits, parce que c’est précisément contre le système des connivences qu’a été créée l’ENA, selon un acte profondément républicain.
Pour conclure, comme l’a excellemment dit Jacques Mézard, il ne faut pas supprimer l’ENA ; il faut la réformer !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du RDSE et du groupe CRC.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, dans les prochains mois, trois élections majeures se succéderont : deux élections parlementaires et une élection présidentielle.
Comme à chaque grand renouvellement, nous assisterons à la valse des cabinets ministériels, qui verra des énarques, directeurs de cabinet ou conseillers, être remplacés par d’autres, avec le même profil. Dans le reste du système, des directeurs d’administration centrale changeront, des préfets, des ambassadeurs. Tous, ou presque, seront remplacés par le même modèle.
Corps de direction des administrations, corps préfectoral, corps diplomatique, corps des magistrats, corps d’inspection générale… et combien de ministres et de parlementaires : tous sont passés sur les bancs de l’École nationale d’administration.
C’est vrai, les énarques sont partout, car ils sont formés pour le service de l’État au plus haut niveau. Leur concours est difficile, leur formation rigoureuse. L’école demeure prestigieuse en France et constitue toujours un modèle à l’étranger – du moins, nous l’espérons !
Tout semble normal, voire excellent. Pourtant, la défiance vis-à-vis de l’ENA et des hauts fonctionnaires qu’elle forme ne fait qu’augmenter.
De tous les bords politiques, les « modernistes », en tout cas ceux qui se revendiquent comme tels, proposent de réformer, voire de supprimer l’ENA. La plupart du temps, ils en sont eux-mêmes issus et ne l’ont critiquée qu’après avoir tiré profit du statut de haut fonctionnaire et du réseau des anciens élèves. Un ancien ministre du redressement productif tirait encore récemment à boulets rouges sur l’école, avant que la presse ne lui rappelle l’influence qu’il avait laissée aux énarques de son cabinet, lui qui avait raté le concours…
Supprimer l’ENA ? La réponse la plus tentante serait de répondre par l’affirmative, car cette école n’a pas toujours bonne presse dans l’opinion publique. Mais est-ce vraiment elle qui exaspère ou l’attitude de certains de ceux qui en sortent ? Est-ce le statut protecteur de la fonction publique, le pantouflage ou le poids excessif des grands corps qui irrite ? Sans doute les causes du désamour sont-elles multiples.
Il est vrai que, de cadre de formation des grands serviteurs de l’État, l’ENA est devenue l’antichambre du pouvoir. Pour ce qui me concerne, je ne suis pas favorable à la confusion des genres, et c’est pourquoi une claire séparation entre élus et hauts fonctionnaires me semble nécessaire. Les énarques devraient démissionner de leurs fonctions pour faire de la politique. La politique, c’est une vocation et un risque, et non pas une ligne à ajouter à son CV !
Mes chers collègues, avec la fin du cumul des mandats cette année, il existe bien un danger de voir les élus de terrain progressivement remplacés par des apparatchiks ou des hauts fonctionnaires, catégories moins exposées que les autres.
De plus, la vocation du service public n’est plus ce qu’elle était. Ainsi, en cinquante ans, on est passé du cadre supérieur au service de l’État, finissant chef de service, au dirigeant « multicarte » migrant d’un service à un cabinet, puis à un établissement public, pour aller en entreprise et revenir, avant de repartir pour finir comme président d’une banque d’affaires.
Par ailleurs, je regrette le manque relatif de culture européenne des élèves, bien que leur établissement fût symboliquement déplacé à Strasbourg et leurs cours sur l’Union renforcés. J’aimerais ainsi que davantage de ces jeunes gens, avec leur niveau d’études, se présentent prioritairement aux concours de la fonction publique européenne afin d’y occuper des postes à responsabilité. Selon un récent rapport parlementaire, les résultats obtenus par nos compatriotes dans ces concours sont très décevants et c’est « principalement la faiblesse du nombre de candidats qui explique les mauvais résultats de la France à ces concours ».
Enfin, l’ENA est souvent perçue comme un creuset de reproduction sociale des élites. Comme le confirmait une étude du CEVIPOF en 2015, « le recrutement ne s’est pas démocratisé durant soixante-dix ans et l’ENA n’a pas réalisé le brassage social espéré par Michel Debré en 1945 ». Il reste donc beaucoup à faire.
On peut regretter également l’excès de conformisme des candidats et des anciens élèves, qui pèse beaucoup sur la capacité d’initiative, mais je ne veux pas accabler la seule ENA dans la mesure où les élèves arrivent déjà bien formatés par la préparation.
Par conséquent, je ne pense pas qu’il faille fermer l’ENA. Il faut au contraire l’ouvrir encore plus !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du RDSE.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le débat qui nous rassemble ce soir n’est pas nouveau.
Faut-il supprimer l’ENA, une école jugée trop élitiste, conformiste, coupée des réalités ? C’est une question récurrente, qui réapparaît sur le devant de la scène politique et médiatique assez régulièrement. Cette récurrence traduit d’ailleurs le questionnement légitime de bon nombre de nos concitoyens sur la place et l’efficacité de cette école qui forme des fonctionnaires. Ce débat est souvent considéré, à tort, comme accessoire ou secondaire. L’ENA alimente pourtant de trop nombreux fantasmes.
Si la défiance vis-à-vis des élites trouve une résonance dans ce débat, il est de notre devoir, en tant que parlementaires, de nous en saisir tout en le dépassionnant.
Avant toute chose, il convient de revenir à la genèse de l’ENA, à ses fondements, à la volonté initiale de deux hommes, Michel Debré et le général de Gaulle, de créer cette grande école de l’administration française.
L’unité de l’État, son indivisibilité : voilà peut-être la première motivation du général de Gaulle quand il accepte la proposition de son conseiller, Michel Debré, de créer une grande école permettant de doter les ministères de fonctionnaires formés à l’exercice pragmatique du pouvoir. Tous deux ont en mémoire la récente débâcle de 1940 et l’effondrement de l’appareil de l’État. Tous deux pensent que l’unité d’une nation passe par une certaine homogénéité intellectuelle de ceux qui la servent.
En 1945, la création de l’ENA s’inscrira donc pleinement dans la grande réforme administrative du général de Gaulle, qui doit jeter les bases de l’État nouveau. Pourquoi, en près de quatre-vingts ans, l’ENA est-elle passée de ce statut d’école dépositaire de l’unité de la République à celui d’une école perçue comme endogame et totalement étanche au monde qui l’entoure ?
Il apparaît assez évident que l’ENA souffre, au minimum, d’un problème d’image. Elle est perçue par une partie de la population comme une machine à reproduire des élites, présidents de la République et ministres de préférence.
Critiquer les élites est facile, voire populiste. En revanche, s’interroger sur leur sélection et leur formation est utile.
L’ENA concentre le rejet d’une certaine caste, celle des gens qui savent, qui dirigent, qui servent tout en se servant. Cette rhétorique anti-élite, de plus en plus puissante, et entretenue parfois maladroitement, trouve dans l’ENA un catalyseur de premier choix.
Ce n’est pas la suppression de l’ENA qui estompera le décalage entre les politiques et la population. Pis encore, avec la suppression de l’ENA, nous pourrions imaginer une distribution de postes de la haute fonction publique en fonction des réseaux et du copinage. Finalement, parlons vrai : dans un pays comme la France, l’ENA est le seul moyen pour que les préfets, les ambassadeurs et les directeurs d’administration centrale soient désignés par le mérite intellectuel, et non par le piston ou les think tank s des partis politiques récompensant les plus fidèles soldats.
Supprimer l’ENA, ce serait détruire l’un des piliers de la République, ce serait affaiblir l’État !
Balayer d’un revers de main le débat que suscite cette école n’est pas la bonne réponse à cette défiance. Il semble néanmoins assez légitime que nos concitoyens se posent la question de savoir comment sont sélectionnés et formés ceux qui ont vocation, tôt ou tard, à diriger le pays.
Ne pas la supprimer ne veut pas dire, en revanche, ne pas la réformer.
Depuis plusieurs années, consciente de son image à redorer, l’ENA a entrepris d’ouvrir ses portes à des profils plus diversifiés, aux origines sociales différentes.
Par son concours interne, elle s’est ouverte aux fonctionnaires déjà en poste, qui peuvent désormais tenter leur chance. C’est, là aussi, un gage de diversité. Au-delà du débat médiatique sur la suppression ou non de l’ENA, je crois que la solution se trouve dans sa refonte profonde.
Cette ouverture souhaitée par différents gouvernements aux sensibilités politiques parfois éloignées a répondu, en partie, à l’exigence de plus en plus profonde de nos concitoyens d’avoir une classe dirigeante qui leur ressemble, moins fermée, plus en phase avec une certaine réalité quotidienne qui donne le sentiment d’être parfois méconnue.
Je crois cependant qu’un dernier blocage important n’a toujours pas été levé : « la botte » du classement de sortie de l’ENA, qui dirige, pour une vie entière, les meilleurs vers les grands corps de l’État. Elle est extrêmement mal perçue par la population comme par les élèves eux-mêmes. C’est une affectation à vie qui véhicule cette image de caste déconnectée de la réalité, bien au chaud sous les ors de la République.
L’ENA est une richesse française ; la question de sa suppression revient à poser un faux problème, ou plutôt à éviter d’en poser un vrai, celui de la fonction publique de demain, de son rôle et de son périmètre. L’ENA a su évoluer, incontestablement.
Pour conclure, mes chers collègues, je crois en l’ENA, je crois, à l’instar de Michel Debré et du général de Gaulle, en la nécessité impérieuse pour un pays de former correctement ses hauts fonctionnaires dans l’unité et l’amour du service de l’État.
Je ne crois pas en la suppression de l’ENA, qui ne ferait que déplacer le problème. Je crois en sa réforme, en son ouverture sur le monde et la société civile.
Je crois, surtout, à l’unité de notre nation, difficile équilibre qu’il convient de préserver en conservant un État fort et compétent, compris et accepté dans son fonctionnement et sa composition par nos concitoyens.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l’UDI-UC.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, faut-il supprimer l’ENA ? La question est incongrue. Nous sommes-nous déjà demandé s’il fallait supprimer Polytechnique, créée en 1794, HEC, créée en 1881, ou Normale Sup, créée en 1826 ? Dès lors, pourquoi poser de façon récurrente la question de la suppression d’une école beaucoup plus récente, créée en 1945 par Michel Debré, dont l’objet était de doter la France de hauts fonctionnaires serviteurs de l’État – peut-être ces derniers sont-ils d’ailleurs trop serviteurs, et pas assez managers ?
Citoyens, politiques, ministres, et même anciens énarques s’accordent parfois pour demander sa suppression. Est-ce par opportunisme politique, par populisme ou par souhait de faire plaisir aux Français éloignés des élites et qui sont parfois en opposition avec l’establishment ? Est-ce parce que nos concitoyens jugent ceux qui les gouvernent responsables de leurs malheurs, et que les énarques font partie du paysage ?
Le terme occidental de mandarin était déjà employé pour désigner, dans la Chine antique, un haut fonctionnaire qui avait réussi ses examens impériaux. Nos énarques seraient-ils des mandarins intouchables, qui ne répondraient de leurs actes qu’à leurs pairs et ne seraient sensibles qu’à leur classement et à leur rang, une sorte de noblesse d’État identifiée par Bourdieu ? Je n’ose y croire.
En faisant un léger détour en Europe, on observe que certains pays tels que la Bulgarie, l’Estonie, la Grèce, l’Islande, les Pays-Bas, la Slovénie ou encore la Roumanie ont simplement un comité ad hoc de recrutement de leurs hauts fonctionnaires. La France, à l’instar de la Pologne, de l’Italie et de l’Espagne, a confié à une école le soin de les recruter, cherchant même à dupliquer ce modèle en Asie centrale.
On peut s’interroger sur le recrutement dès lors que, sur les 40 lauréats d’un concours récent, 33 provenaient de Sciences Po Paris, aucun d’un autre institut d'études politiques et quelques-uns de prestigieuses écoles de commerce comme HEC.
Chez nos voisins anglais, le fast stream permet à des docteurs en mathématiques ou en sciences sociales d’accéder aux postes de la haute fonction publique d’État ; en Allemagne, le recrutement des hauts fonctionnaires s’effectue à partir de l’université. Les résultats économiques de ces pays et de leurs hauts fonctionnaires n’ont pourtant rien à envier à ceux de la France.
Je ne peux passer sous silence l’ouvrage d’Adeline Baldacchino, La F erme des énarques, qui dresse un tableau sombre de son ancienne école, en soulignant son inadaptation aux enjeux du monde contemporain. Elle souligne combien les énarques sont en décalage avec le monde qui est le nôtre. Leur formatage les rendrait-il incapables d’inventer l’avenir de notre pays ? Les énarques manqueraient-ils de courage, prompts à glisser sous le tapis tout ce qui implique une prise de risques ? Où se trouve la réflexion critique de ces candidats à l’ENA, nécessaire pour accompagner un changement politique favorable pour nos concitoyens ? Car leur fonction future est bien de servir la France, et non de gérer leur quotidien et leur avenir.
I have a dream, celui d’une école où la consanguinité et la cooptation n’existeraient plus, d’une école où le classement de la botte, système archaïque, serait supprimé afin de ne plus permettre à un lauréat d’orienter toute sa vie professionnelle à partir de son rang de sortie, d’une école dont les élèves auraient plus de facilité à se reconvertir dans le privé – on leur préfère en effet souvent des candidats issus d’autres formations, plus stratèges, plus créatifs, plus managers –, d’une école où la culture d’équipe existerait, où les risques et les résultats primeraient les compétences, d’une école qui favoriserait l’optimisme de ses étudiants, leur foi en l’avenir et les préparerait à la réalité contemporaine, d’une école, enfin, qui répartirait mieux ses lauréats. En effet, sur les 4 300 énarques en activité, plus de 3 500 exercent dans les ministères, les inspections, les collectivités locales ou les organismes internationaux.
En résumé, faut-il supprimer l’ENA ? Non ! Faut-il la transformer ? Certainement !
En bon énarque que je ne suis pas, j’organiserai ma conclusion en trois points : il faut, premièrement, améliorer les conditions d’accès à cette école en diversifiant les profils, deuxièmement, revoir la formation pour la rendre plus professionnelle, plus opérationnelle, plus culturelle et moins déconnectée du terrain, troisièmement, éviter l’omniprésence de ses diplômés dans les cercles de pouvoir en les orientant différemment.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l’UDI-UC.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, faut-il supprimer l’École nationale d’administration ? Voilà une question qui revient régulièrement dans le débat public et qui transcende les clivages politiques.
Depuis sa création en 1945 par le général de Gaulle, cette grande école créée pour former les hauts cadres chargés de reconstruire la France au lendemain de la guerre n’a cessé d’être contestée.
L’École nationale d’administration a connu une trentaine de réformes, mais les plus audacieuses ont toujours été abandonnées, au nom de l’intérêt de l’État. Encore récemment, Bruno Le Maire proposait de la faire disparaître. Délocalisée à Strasbourg, l’ENA a résisté à tous les assauts ; elle est toujours là.
Dans un sondage paru dans Le Figaro le 1er septembre dernier, 82 % des 47 753 personnes interrogées se disaient favorables à sa disparition.
À ce jour, les énarques sont à 70 % dans les grandes administrations d’État, 23 % dans les collectivités territoriales, 7 % dans les grandes entreprises privées. Cette élite de la fonction publique, recrutée dès l’âge de 25 ans, et classée à la sortie de l’école entre « super-élite » et « élite », accède au statut « à vie » de haut fonctionnaire.
La « super élite » intègre les grands corps de l’État grâce à des procédures de recrutement spécifiques vers des postes clés qui sont systématiquement occupés par des personnes issues de la même filière.
Leurs compétences sont-elles remises en cause ? Certainement pas, mais la question de l’absence d’expérience et de la diversité des profils se pose, même si l’ENA se revendique aujourd’hui comme une école d’application. L’État ne devrait-il pas être exemplaire dans le recrutement de ses hauts fonctionnaires ?
On peut se demander si cette école n’est pas, en fait, un bouc émissaire facile. En effet, l’ENA a permis à des personnes issues de milieux divers de s’élever au sein de la fonction publique, à force de travail. Qu’en est-il aujourd’hui ? L’école favorise-t-elle la mixité sociale ? À en croire les chiffres, tel n’est pas le cas.
Par exemple, la proportion de femmes est largement inférieure à celle des hommes. En 2012, la nomination de Nathalie Loiseau à la tête de l’ENA avait pourtant suscité l’espoir d’une ère nouvelle, plus favorable aux candidates. La nouvelle directrice avait clairement exprimé son souhait de « corriger » au concours ce qui relève « implicitement d’une discrimination positive en faveur des hommes ». Statistiques à l’appui, il est prouvé que les femmes obtiennent de bons résultats aux écrits du concours, mais qu’elles sont plus souvent éliminées que les hommes aux épreuves orales.
De nombreuses propositions de loi visant à supprimer l’ENA ont été déposées. Faut-il y voir de la part de nos collègues une défiance à l’égard de la haute fonction publique française ? Je ne le crois pas.
Chacun s’accorde à reconnaître les grandes qualités professionnelles et le dévouement au service de la Nation de ces hauts fonctionnaires, mais le mode de formation et de recrutement des élites administratives, de même que la place dominante qu’elles détiennent dans les rouages administratifs et politiques, ne compteraient-ils pas parmi les principaux obstacles à la modernisation de notre pays ? Le système « énarchique », la structuration en grands corps ont-ils toujours leur utilité à l’heure de la mondialisation ?
Les énarques détiennent tous les leviers de commande de la haute administration et ont, peu à peu, investi la vie politique. Notre pays détient le record absolu du nombre de fonctionnaires passés de l’administration à des fonctions électives ou gouvernementales. On peut donc légitimement s’interroger sur la capacité d’un haut fonctionnaire devenu ministre à réformer son administration d’origine.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l’UDI-UC. – M. Jacques Mézard et Mme Corinne Bouchoux applaudissent également.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi, tout d’abord, de remercier le groupe du RDSE, qui a inscrit ce débat à l’ordre du jour de votre Haute Assemblée. Je remercie également le président Jacques Mézard et les orateurs des différents groupes pour leur participation à cette discussion passionnante.
À la question : faut-il supprimer l’ENA ?, j’ai déjà répondu non, et je persiste, sans fébrilité ni tergiversations.
Depuis sa création, cette école est en butte aux critiques. C’est un grand classique, surtout à l’approche des échéances électorales… Il est vrai que le modèle sur lequel elle s’est fondée et développée a fait son temps et je crois qu’il faut aujourd’hui réformer l’ENA.
Votre débat n’a pas tant porté sur l’ENA que sur la haute fonction publique dans son ensemble. Il concerne en effet les anciens élèves de l’ENA, mais aussi ceux de Polytechnique et de ses écoles d’application. En définitive, l’une des dimensions centrales de la discussion est la relation, parfois trop étroite, entre l’administration et le politique.
Ma réponse portera donc sur ces deux dimensions. Elle s’appuiera sur mon action depuis un an en tant que ministre de la fonction publique et sur celle du Gouvernement depuis 2012, mais aussi sur mes convictions de femme politique.
Je veux d’abord dire que les débats autour de la fonction publique, majeurs et importants pour nos choix de société, ne sauraient se résumer à l’ENA.
Pendant ces quelques mois au sein du Gouvernement, je me suis attachée à promouvoir une fonction publique plus diverse dans ses recrutements, qui fasse une place plus grande aux jeunes et qui soit exemplaire en ce qui concerne le traitement des valeurs, en premier lieu de la laïcité.
À cet égard, l’ENA a répondu à notre appel.
C’est le cas en ce qui concerne la diversité, puisque, depuis 2014, la majorité des élèves – 47 sur 90 – est issue du concours interne et du troisième concours.
C’est aussi le cas en ce qui concerne la jeunesse. L’ENA est souvent critiquée, car elle donnerait trop tôt des responsabilités à de jeunes gens, qui n’ont pour seul mérite que d’avoir réussi un concours et une scolarité difficiles. Mais il faut rappeler que, dans une époque marquée par la transformation numérique et un rythme effréné des innovations, cette jeunesse représente aussi pour notre administration une chance de disposer de cadres bien formés et prêts à innover et s’impliquer.
Dans le cadre du cycle de consultations « Ma fonction publique se réinvente », que j’ai lancé en septembre 2016, j’ai pu rencontrer de nombreux jeunes. Ils sont l’avenir de notre service public ; leur enthousiasme, autant que leur engagement, fait plaisir à voir et est rassurant si l’on pense aux défis que nous devons relever en ce début de XXIe siècle. À Strasbourg, j’ai aussi dialogué avec les élèves de l’ENA et de l’Institut national des études territoriales, l’INET, qui se tenaient côte à côte, rassemblés par le même engagement au service des Français.
J’en reviens au cœur de mon propos. Nous avons besoin de l’ENA, parce que la haute fonction publique doit être formée et que l’école qui exerce cette mission doit être un outil d’excellence. Je rappelle qu’elle est une école d’application, c’est-à-dire qu’elle ne délivre pas de diplôme, mais forme les futurs hauts fonctionnaires.
Plus que jamais, nous avons besoin de hauts fonctionnaires qui sachent s’adapter aux défis de demain. La gestion publique requiert des savoir-faire, mais aussi des savoir-être spécifiques. Cette école d’application permet aux élèves externes de faire des stages au plus près des réalités de la vie professionnelle et de celle des Français, que ce soit derrière le guichet d’accueil d’une préfecture ou au sein d’une PME ou d’une association.
Rappelons que la haute fonction publique française est reconnue, voire enviée, à l’étranger. Je l’ai moi-même observé en tant que secrétaire d’État chargée du développement et de la francophonie : j’ai pu voir combien la fonction publique française et l’ENA sont admirées.
L’ENA a d’ailleurs tissé des partenariats avec plusieurs écoles ou universités étrangères. Elle accueille chaque année des élèves d’autres pays ; ils sont autant de relais d’influence dans le monde entier. L’école a récemment accueilli dans ses murs la communauté des ambassadeurs étrangers en poste à Paris, parmi lesquels plusieurs de ses anciens élèves – leurs pays d’origine allaient du Japon à l’Afghanistan ! Cela participe du rayonnement de la France dans le monde.
Contrairement à ce que l’on dit souvent, l’ENA se réforme, mais il est vrai qu’elle est encore trop élitiste. Il faut donc poursuivre et amplifier ces réformes.
En matière de recrutement, un reproche est souvent formulé à l’encontre de la haute fonction publique, et de l’ENA en particulier, celui de la reproduction des élites et du recrutement en fonction de profils bien déterminés : plutôt parisiens, issus des classes aisées, enfants de hauts fonctionnaires…
S’ajoute à cette critique la nature même de la formation, qui est perçue comme un moule bien établi, dans lequel seuls certains peuvent se fondre.
Ces deux critiques relèvent de la même tonalité : l’ENA favoriserait « l’entre soi » et l’endogamie. Luc Rouban, directeur de recherche au CNRS, le souligne : « Si les élèves recrutés via le concours externe, très sélectif, sont incontestablement brillants, leur profil social est très homogène ».
Une partie de cette situation reflète l’inégalité des chances d’accès à l’enseignement supérieur et les difficultés de notre système scolaire à assurer l’égalité des chances. Je tiens d’ailleurs à saluer le travail de recherche précis que mène l’école, année après année, sur des cohortes d’élèves. Il a permis à la mission confiée à Olivier Rousselle de dégager une vision très précise de la situation ; de ce fait, son rapport, qui nous sera prochainement remis, comprendra un certain nombre de recommandations utiles.
Toutefois, il faut effectivement prendre garde à ce que l’excellence d’une formation, qui permet de disposer des meilleures compétences, ne débouche pas sur une réduction, voire un assèchement, des profils recherchés.
Plusieurs réformes ont été conduites ces dernières années. Je voudrais en remercier Nathalie Loiseau, qui n’a pas ménagé ses efforts depuis sa nomination à la tête de l’école en 2012. Permettez-moi de rappeler que cette nomination était un symbole d’ouverture et de modernisation, puisqu’il s’agit d’une femme – la deuxième à diriger l’ENA –, non-énarque, diplomate – elle a été directeur des ressources humaines de son ministère – et très engagée sur les questions d’égalité entre les femmes et les hommes.
Parmi les réformes conduites, je citerai tout d’abord le concours d’entrée, qui a été modifié et qui ne s’appuie plus seulement sur la vérification des connaissances, mais aussi sur l’évaluation du parcours, de la motivation et du potentiel des candidats.
Une reconnaissance des acquis de l’expérience a été introduite durant l’entretien avec le jury et une épreuve orale collective permet de mesurer les capacités d’interaction des candidats. Je vous informe à cet égard que l’arrêté permettant de reconnaître le doctorat dans les acquis de l’expérience est en cours de finalisation.
Mais il faut aller plus loin. Pour cela, il est important de promouvoir, comme nous l’avons fait, les classes préparatoires intégrées, les CPI, notamment celles qui permettent de préparer le concours d’entrée à l’ENA. Ce dispositif est soumis à condition de ressources et permet aux candidats de bénéficier d’une allocation ; ceux-ci peuvent ainsi préparer des concours qui, autrement, leur seraient fermés. Sur l’initiative du Président de la République, nous avons doublé le nombre de places en CPI pour qu’il atteigne 1 000 et je tiens à saluer l’engagement de l’ENA, qui a devancé l’appel en augmentant, dès 2015, le nombre des places en CP’ENA, sa classe préparatoire visant à favoriser l’égalité des chances.
Il faut aussi permettre la formation par l’école de personnes en situation de handicap et leur intégration dans les corps recrutant à la sortie de l’ENA. Ce sera chose faite avec la publication du décret dans quelques jours.
De manière générale et comme je l’ai mentionné à l’instant, nous examinerons avec une grande attention les recommandations formulées par Olivier Rousselle dans son rapport. Sa prochaine présentation permettra d’ouvrir un débat sur l’ensemble de ces questions.
Par ailleurs, il nous faut certainement aménager le concours externe, en valorisant davantage l’expérience des candidats en fonction de leur engagement dans la société civile. Nous pourrions, par exemple, évaluer l’idée d’inclure, comme critère d’entrée, l’expérience que représente une année de service civique ou de volontariat international ; cette idée a déjà été mise en œuvre dans plusieurs pays.
Nous devons également – c’est le sens de la mesure adoptée par le Parlement dans la loi Égalité et citoyenneté – renforcer le troisième concours, qui est ouvert aux personnes disposant d’une expérience professionnelle.
Je souhaite maintenant évoquer la scolarité qui, comme le concours, a été récemment revue.
L’enseignement a été réformé ces dernières années. Au-delà du cursus, qui fait la part belle à la gestion publique dans ses composantes budgétaires et financières, au management, à l’éthique et à la déontologie, à la négociation ou encore au dialogue social, le programme permet également aux élèves de travailler sur l’innovation publique : le rôle et la place du numérique ou les nouvelles méthodes de conception, de mise en œuvre et d’évaluation de l’action publique. La dimension européenne et internationale des enseignements a également été renforcée.
Là aussi, allons plus loin ! En particulier, il faut rapprocher l’ENA du monde universitaire. Ces dernières années, ils ont déjà approfondi leurs liens, l’école délivrant par exemple des masters en coopération avec des universités partenaires. L’école doit continuer de s’inscrire pleinement dans le paysage de l’enseignement supérieur, qui est en profonde mutation. Le contrat d’objectifs et de performance signé par l’ENA et sa tutelle offre de nouvelles perspectives pour approfondir ces partenariats, par exemple avec la création de chaires associant des établissements de recherche. Je dois dire que le premier projet de chaire – il porte sur l’innovation publique et associe l’ENA à l’École nationale supérieure de création industrielle, l’ENSCI, qui est une école de design – est très prometteur.
Le contrat prévoit également d’engager une réflexion sur le changement de statut de l’école pour adopter celui d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Cela autoriserait l’ENA à délivrer seule des diplômes, tant pour ses formations continues qu’initiales, et il pourrait être de nature à faciliter la mise en place d’une fondation. L’école, la DGAFP et les services de mon collègue Thierry Mandon, secrétaire d’État chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui partage pleinement cette orientation, travailleront sur ce changement de statut.
En outre, il faut probablement resserrer la scolarité, davantage encore, sur les disciplines les plus professionnalisantes, en écartant les cours académiques.
Pour éviter « l’entre soi », il faut certainement changer la composition du conseil d’administration de l’ENA, presque exclusivement composé, aujourd’hui, d’anciens énarques.
Il faut aussi rapprocher davantage l’ENA, l’INET et l’École des hautes études en santé publique, ces deux dernières écoles formant les hauts fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Nous pourrions réfléchir à la mise en place d’un grand établissement.
Un autre sujet évoqué ce soir concerne le parcours des anciens élèves. La critique de l’ENA est en fait, vous l’avez dit, celle d’une haute fonction publique coupée de la réalité, en connivence avec le monde économique et ayant infiltré le monde politique… Il s’agit bien sûr d’une caricature, à laquelle vous avez échappé.
Selon une étude confiée à deux chercheurs, seuls 5 % d’énarques s’engagent en politique et 8 % des fonctionnaires issus de l’ENA pantouflent. Il faut rappeler ces chiffres pour éviter les stéréotypes. Pour autant, j’ai souhaité m’emparer du sujet du pantouflage dans le privé, car je l’estime beaucoup trop rapide. C’est pour moi une question de principe.
À plus long terme, il nous faudra réfléchir aux parcours dans les grands corps de l’État : Inspection générale des finances, Conseil d’État, Cour des comptes, corps des Mines ou des Ponts…
Aujourd’hui, l’engagement de servir à l’issue de la scolarité n’est pas suffisamment exigeant. L’ENA n’est pas une école de commerce, pas plus que Polytechnique. Aujourd’hui, les anciens élèves ne doivent rembourser la « pantoufle » qu’après une disponibilité de dix ans, s’ils quittent définitivement la fonction publique.
C’est tout à fait insuffisant : un énarque ou un ancien élève de l’École des mines représente un investissement important pour la collectivité. Or, il ne remboursera sa « pantoufle » que quatorze ans après avoir quitté l’école et en n’ayant éventuellement servi que quatre ans. La Nation leur a payé une formation d’excellence, qui a un coût. Aujourd’hui, le coût annuel est de 83 000 euros pour un élève de l’ENA, il est même supérieur pour un ingénieur des Mines ou des Ponts.
C’est pourquoi je propose un principe simple : un ancien élève devra consacrer les dix premières années de sa vie professionnelle au service des Français. Un fonctionnaire qui choisirait de partir avant cette date devra démissionner et rembourser les frais supportés par l’État pour assurer sa formation. J’ai saisi le Président de la République et le Premier ministre de cette question et je leur ai soumis un projet de décret. J’espère que cette mesure sera adoptée rapidement.
Autre question qui doit être examinée, celle des grands corps.
Souvent, les élèves qui en sont issus se retrouvent très rapidement à la tête des grandes administrations de ce pays, alors qu’ils ne disposent pas d’une véritable expérience de terrain, pourtant indispensable aux managers. Par exemple, la DGAFP a eu pendant très longtemps un conseiller d’État pour patron. C’était une tradition, une place acquise. Ce n’est plus le cas depuis quinze ans, car il a été jugé indispensable de nommer à ce poste des personnes qui ont un parcours de manager et connaissent bien les questions liées à la gestion des ressources humaines.
Par ailleurs, les comités d’audition, créés en mai dernier, concourent à la diversification des recrutements et à la professionnalisation. La sélection des cadres supérieurs de l’État va donc progressivement changer. Dès 2012, nous avons aussi mis en place ce qu’on peut appeler un vivier de cadres dirigeants pour ouvrir l’accès à la haute fonction publique et la diversifier. Je crois que ce vivier, qui intègre encore peu de fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers, doit rassembler les trois versants de la fonction publique.
La sortie de l’ENA dans les grands corps constitue aussi une question récurrente.
En 2015, Marylise Lebranchu a confié une mission sur ce sujet à cinq personnalités, dont les conclusions ont été rendues à l’automne de la même année. Cette mission n’a pas recommandé de supprimer la sortie directe dans les grands corps. Elle s’était plutôt orientée vers la fusion des corps. J’ai jugé que ce dossier n’était pas mûr, d’autant que de telles fusions auraient exigé, pour le Conseil d’État et la Cour des comptes, un vecteur législatif, alors même que nous ne disposions plus, dans ce quinquennat, du temps nécessaire.
Toutefois, je suis convaincue, comme beaucoup d’entre vous, qu’il faudra réformer ce système. Il me paraîtrait sain que le pouvoir politique, grâce à une mission parlementaire par exemple, se penche sur cette question et fasse des propositions de réforme, à la fois innovantes et susceptibles de se traduire ensuite dans la loi.
En réalité, s’interroger sur la réforme de l’ENA, c’est s’interroger sur la modernisation de l’État, car l’ENA – je l’ai dit en commençant ce propos – n’est qu’une partie d’un tout. Cette école forme des hauts fonctionnaires qui seront amenés à diriger des administrations.
Moderniser l’ENA, c’est donc s’inscrire dans le cadre plus général de la modernisation de l’État, qui est un processus nécessaire et continu. Il s’agit d’adapter nos administrations à l’évolution des techniques et aux attentes des usagers, mais aussi à celles des fonctionnaires. C’est aussi, plus largement, nous interroger sur notre conception de l’action publique, qui doit être à même de relever les défis du monde de demain, qu’ils soient économiques, numériques, démographiques ou liés aux questions de sécurité. Il nous faut engager un grand débat démocratique autour de ces thèmes. Cela nous permettra de mieux appréhender les évolutions et les changements profonds que notre pays doit affronter.
En conclusion, je crois que la question plus large de nos institutions est posée et doit être au cœur de nos prochains débats. Nous devons avoir la capacité de nous projeter vers l’avenir et de relever l’ensemble des défis auxquels nous sommes confrontés. Pour cela, nous devons être prêts à changer le système dont nous sommes issus.
Applaudissements.

Nous en avons terminé avec le débat, organisé à la demande du groupe du RDSE, sur le thème : faut-il supprimer l’École nationale d’administration ?

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, jeudi 2 février 2017, à dix heures trente :
Débat sur le thème : violences sexuelles, aider les victimes à parler.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures quinze.