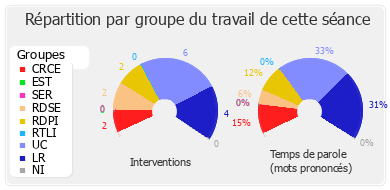Séance en hémicycle du 8 mars 2005 à 10h00
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à dix heures.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

M. le président a reçu de M. le Premier ministre une lettre en date du 7 mars 2005 par laquelle il a fait part au Sénat de sa décision de placer en mission temporaire auprès de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, M. Alain Lambert, sénateur de l'Orne.
Acte est donné de cette communication.

La parole est à M. Bernard Murat, auteur de la question n° 663, adressée à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce matin, je vais ouvrir le feu des questions, si je puis m'exprimer ainsi, en évoquant un sujet brûlant.
Il faut savoir que, depuis la circulaire de 1951, les maires, en particulier les maires ruraux, et ce dans tous les départements, sont de plus en plus préoccupés par la défense incendie, notamment par son organisation, en particulier dans les communes rurales.
En effet, depuis ce fameux texte, les moyens consacrés à la défense incendie se sont développés et l'état des routes s'est amélioré, si bien que les services d'incendie se trouvent désormais plus proches du lieu de l'incendie. Cependant, l'Etat souhaite, à juste titre, qu'il y ait la même qualité de défense incendie sur l'ensemble du territoire national, qu'il s'agisse de zones rurales ou de zones non rurales.
Il n'en reste pas moins vrai qu'aujourd'hui les maires sont confrontés de plus en plus au problème de la défense incendie, en particulier lorsque des entreprises veulent venir s'installer sur le territoire de leur commune - vous savez, madame la ministre, combien c'est important pour le développement et la revitalisation du tissu rural - car les chefs d'entreprise doivent alors assumer des coûts très importants en ce qui concerne la défense incendie.
Bien évidemment, ils se retournent vers les maires, qui, eux, n'ont pas les moyens financiers de répondre à leurs demandes. Ainsi, le cas où, malheureusement, des entreprises ne veulent pas, ou ne peuvent pas, s'installer dans ces zones-là parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers de faire face à cette réglementation, se rencontre de plus en plus fréquemment.
Madame la ministre, aujourd'hui, vous allez répondre à des milliers de maires inquiets, qui ne savent pas comment faire. Certes, chacun est de bonne foi dans cette affaire, mais il va falloir que nous nous réunissions afin que cesse cette partie de ping-pong. Les maires sont désabusés par les réponses des SDIS, les services départementaux d'incendie et de secours, qui, composés de techniciens, remplissent leur mission en voulant la meilleure défense incendie possible sur l'ensemble du territoire.
Comment sortir de cette impasse ?
Monsieur le sénateur, la question que vous posez est importante, parce qu'elle met en jeu deux principes essentiels de l'action du Gouvernement.
En premier lieu, je citerai la sécurité. Les exigences en matière de réseaux d'eau trouvent leur origine dans la nécessité, pour nos sapeurs-pompiers, de disposer, partout en France, notamment en zones rurales, de quantités d'eau suffisantes pour lutter contre les incendies dans les bâtiments d'habitation.
C'est donc, comme vous l'indiquez, la sécurité de nos concitoyens qui est aujourd'hui en jeu.
En second lieu, le Gouvernement doit veiller à ne pas freiner le développement des territoires ruraux par des règles mal adaptées à la situation vécue localement par les élus qui cherchent à faire vivre leurs communes et, plus largement, leur territoire. C'est tout l'enjeu de la circulaire de 1951, qui fixe les obligations en matière de réseaux d'eau et qui, parfois, entrave la construction en zone rurale.
Le Gouvernement en est conscient. C'est pourquoi je puis vous annoncer, ce matin, que le texte va être revu. Il s'agit, non pas de faire baisser notre niveau d'exigence en matière de sécurité, mais d'atteindre ce même niveau avec des moyens plus diversifiés et plus adaptés aux contraintes du monde rural.
Un groupe de travail technique a commencé à travailler sous la conduite du directeur de la défense et de la sécurité civiles. Il associe les professionnels du secours et les sapeurs-pompiers. Je souhaite que cette démarche technique indispensable soit placée sous le regard des élus, notamment des élus ruraux. Aussi M. Dominique de Villepin va-t-il créer un comité de pilotage pour qu'à chaque étape de la réflexion les maires et les conseillers généraux, mais aussi les parlementaires, soient associés à ce travail. Ce comité de pilotage sera installé et devra examiner les premiers résultats de cette démarche avant l'été.
Il va de soi, monsieur le sénateur, que le Gouvernement n'engagera pas une réforme aussi importante pour le monde rural sans donner aux élus l'occasion de faire valoir leur point de vue. Il est indispensable que nous arrivions ensemble à concilier la sécurité, que chacun souhaite voir assurée, et le développement rural, voulu également par tous. Soyez assuré que nous y veillerons.

Madame la ministre, vous avez apporté la réponse que tous les maires attendaient. Le remaniement du texte de la circulaire de 1951 sera déjà une première étape positive. Pendant trop longtemps, en effet, il nous a été objecté que ce texte était intangible.
Par ailleurs, la mise en place de ce comité de pilotage est la bienvenue. Ainsi, les élus pourront apporter leur expérience. Quant à moi, je pose dès à présent ma candidature, si cela est possible, pour faire partie de ce comité de pilotage.

La parole est à M. Claude Biwer, auteur de la question n° 628, adressée à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, chacun, ici, se souvient que la canicule de l'été 2003 a eu des conséquences très graves, non seulement sur le taux de mortalité des personnes âgées, mais également pour un très grand nombre de bâtiments d'habitation situés sur l'ensemble du territoire national.
C'est ainsi que plusieurs dizaines de milliers de nos compatriotes ont eu à subir des désordres liés à la sécheresse et ont, fort logiquement, saisi les maires de leurs préoccupations, lesquels ont aussitôt adressé en préfecture des dossiers visant à reconnaître l'état de catastrophe naturelle pour leurs communes.
Après de longues tergiversations, le Gouvernement a finalement décidé, par un arrêté du 26 août 2004, soit un an après les faits, de déclarer sinistrées 1 365 communes sur un total de 6 973 demandes, soit moins de 20 % des communes concernées. Dans mon département, la Meuse, deux tiers des communes touchées par la sécheresse n'ont pas été concernées par cet arrêté et, dans d'autres départements, il est arrivé qu'aucune commune ne soit déclarée sinistrée.
La conséquence pratique de cet arrêté a minima consiste à laisser à la charge de plusieurs dizaines de milliers de propriétaires les frais de remise en état de leur habitation.
Dans la mesure où nous avons eu le sentiment que le nouveau dispositif sur lequel s'est appuyé le Gouvernement avait, en réalité, pour objet de réduire, autant que faire se peut, le nombre de communes éligibles, j'ai, avec plusieurs de mes collègues, déposé une proposition de loi visant à faire en sorte que, désormais, les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols constituent bien des effets d'une catastrophe naturelle et ce quelle qu'en soit l'intensité.
Cette initiative a suscité un très grand écho : dans de nombreux départements, des maires nous ont fait part de leur intérêt et de leur appui.
Le groupement des entreprises mutuelles d'assurances vient également de réclamer une loi contenant les définitions précises des incidents susceptibles d'être indemnisés, s'inquiétant « des décisions parfois arbitraires prises en la matière par le Gouvernement ».
Devant l'avalanche de protestations suscitée par l'arrêté du 24 août 2004, un second arrêté a été signé, le 1er février dernier, permettant à 873 nouvelles communes de se voir reconnaître l'état de catastrophe naturelle. Je regrette qu'aucune commune meusienne ne soit concernée par cet arrêté, alors que dix-huit d'entre elles attendent toujours ce classement.
Madame la ministre, il reste encore, au plan national, 4 735 communes dont les habitants ne seront toujours pas indemnisés.
Or, je rappelle que les désordres dont les biens sont atteints sont parfaitement visibles et vérifiables et que les propriétaires bénéficient d'une garantie d'assurance au titre des catastrophes naturelles pour laquelle ils payent une surprime : ils se demandent, quelquefois, à quoi peut bien servir cette garantie si elle ne peut être mise en jeu.
Cette affaire est d'autant plus incompréhensible que, par le passé, la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle n'a pratiquement jamais posé de problème.
Je souhaiterais donc, madame la ministre, que soit édictée une procédure simple, claire et précise afin que toutes les personnes dont les biens ont subi des dommages puissent enfin être indemnisées.
Monsieur le sénateur, je veux d'abord saluer l'intérêt que vous portez depuis le début à ce dossier et votre investissement personnel au service des habitants des communes de votre département touchées par la sécheresse de l'été 2003.
Cette situation mobilise non seulement un grand nombre de parlementaires et d'élus locaux, mais également, sachez-le, le Gouvernement. Je suis, comme vous, très sensible à la situation de nombreuses personnes dont les habitations ont été endommagées, parfois très sérieusement, par la sécheresse de l'été 2003.
En juin 2004, vous aviez déjà interrogé mon prédécesseur, qui, en application des orientations fixées par Dominique de Villepin, vous avait annoncé l'assouplissement des critères établis en 2000. Sans cet assouplissement, monsieur le sénateur, aucune reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle n'aurait été possible. Je voudrais aujourd'hui compléter cette réponse.
Les nouveaux critères annoncés à l'époque ont permis la reconnaissance de 2 248 communes, par les arrêtés interministériels que vous avez évoqués du 26 août 2004 et du 1er février 2005, ce qui porte le taux de reconnaissance à 31, 5 %. L'instruction des dossiers en cours devrait permettre de porter le nombre des communes reconnues à près de 3 000 et le taux de reconnaissance à plus de 40 %.
Mais, comme Dominique de Villepin et moi-même avons déjà eu l'occasion de le dire ici même, cela est à nos yeux encore insuffisant.
La logique des critères retenus jusqu'à présent n'a pas permis de reconnaissance dans certaines parties du territoire, pourtant parfois sévèrement affectées par la sécheresse de l'été 2003. Dans le département de la Meuse, par exemple, une seule commune a pu être reconnue alors que trente-quatre ont présenté une demande.
C'est pourquoi, avec l'accord du Premier ministre, le ministre de l'intérieur a retenu une nouvelle démarche. II souhaite que tous les dossiers puissent être réexaminés sur le fondement d'un examen individualisé de chaque situation.
Pour cela, un nouveau chantier a été engagé : le Premier ministre a confié à quatre grands corps d'inspection de l'Etat la mission d'expertiser les conclusions des travaux rendus par l'un d'entre eux, le 15 février dernier, au ministre de l'intérieur. Nous analysons actuellement ces conclusions, qui nous permettront de définir une méthode totalement nouvelle de mesure de la gravité des dommages subis par les habitations et de leurs liens précis avec la sécheresse de l'été 2003.
Ce travail est aujourd'hui près d'aboutir.
Dès que nous aurons arrêté cette nouvelle méthode, nous adresserons aux préfets des instructions qui leur permettront de lancer sans délai la procédure de réexamen. Nous serons alors, monsieur le sénateur, en mesure d'apporter une réponse définitive à tous ceux qui ont été les victimes de cette sécheresse exceptionnelle de l'été 2003.
Le Gouvernement a pris connaissance avec beaucoup d'attention de la proposition de loi que vous avez déposée le 12 août 2004, monsieur le sénateur, avec plusieurs de vos collègues. Cette proposition tend à reconnaître l'ensemble des phénomènes de sécheresse, quelle que soit leur intensité.
Nul ne peut méconnaître le caractère généreux de votre démarche, fondée sur le souci de venir en aide, à l'avenir, aux victimes de phénomènes semblables à celui de l'été 2003.
Toutefois, l'adoption de ce texte remettrait en cause toute l'architecture de notre système d'indemnisation des catastrophes naturelles.
Tout d'abord, en effet, en permettant la reconnaissance systématique de tout phénomène de sécheresse, votre proposition de loi risquerait de favoriser les effets d'aubaine et de permettre l'indemnisation de dommages qui n'ont pas de rapport direct avec le phénomène naturel en cause.
Ensuite, ce texte constituerait une inflexion importante de l'esprit de la loi du 13 juillet 1982. Le régime qu'elle prévoit repose en effet sur le caractère anormal d'un agent naturel et exclut par conséquent toute reconnaissance systématique. Une telle évolution pourrait se traduire par un relâchement de l'effort que chacun doit accomplir en matière de prévention pour faire face aux catastrophes naturelles.
L'approche proposée par Dominique de Villepin permettra donc bien d'apporter une réponse adaptée aux situations douloureuses vécues par certains de nos concitoyens, et ce sans dénaturer l'esprit de ce régime qui, depuis 1982, a permis de faire face aux catastrophes naturelles ayant touché notre pays.

Madame la ministre, je constate que nous faisons cause commune. Vous m'avez habilement laissé entendre que j'étais allé un peu loin dans ma proposition de loi. En vous écoutant, j'avais déjà l'impression d'en débattre et d'accepter un amendement. Cela viendra peut-être !
Du fait de la présence de mines, notre région, peut-être plus que d'autres, est sensibilisée au problème des bâtiments d'habitation qui se lézardent ou qui s'effondrent.
Lorsqu'un deuxième phénomène survient, comme la sécheresse, les conséquences sont d'autant plus fortes et les préoccupations des habitants d'autant plus intensives.
Je me réjouis qu'il soit possible de définir une nouvelle méthode d'indemnisation qui ne provoque pas, comme vous le disiez à l'instant, d'effets d'aubaine. Tel n'est pas, en effet, l'objectif. J'espère, madame la ministre, que vous trouverez la solution appropriée.

La parole est à M. Yves Détraigne, auteur de la question n° 657, adressée à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Madame la ministre, je souhaite rappeler que l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, introduit par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, précise : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. »
Dans son interprétation littérale, cette disposition signifie que seuls les conseillers minoritaires ont la possibilité de s'exprimer dans les bulletins d'information générale, ce qui ne semble pas correspondre à l'esprit qui animait le législateur quand il a voté cette disposition.
En effet, il ressort des débats qui ont eu lieu tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat lors de l'examen de cette loi - je l'ai vérifié récemment - que le Parlement souhaitait au contraire que toutes les composantes de l'assemblée municipale puissent s'exprimer.
Dans la mesure où, en s'appuyant sur le texte de l'article L. 2121-27-1, des élus de l'opposition de certaines communes- je l'ai constaté dans deux ou trois communes de mon département -, contestent aux élus de la majorité le droit à un espace de libre expression dans les bulletins municipaux, je souhaiterais que vous me précisiez, madame la ministre, si seuls les conseillers minoritaires ont droit à un espace réservé à leur expression ou si toutes les tendances du conseil municipal peuvent en bénéficier.
Monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur l'interprétation à donner de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, qui accorde en effet aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale le droit de disposer d'un espace d'expression dans les bulletins d'information générale diffusés par les communes de 3 500 habitants et plus.
Ce droit, qui résulte de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, vient s'ajouter à ceux qui ont déjà été reconnus aux élus minoritaires par la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République pour faciliter l'exercice de leur mandat électif, comme leur représentation dans les différentes commissions municipales et la mise à disposition d'un local administratif.
S'agissant du droit d'expression des élus minoritaires dans les bulletins municipaux, il a été reconnu et généralisé pour l'ensemble des communes de 3 500 habitants et plus, alors que, avant 2002, il dépendait du maire et de sa majorité.
Pour autant, cette mesure, qui garantit le caractère pluraliste des opinions émises dans ces supports d'information, n'a ni pour objet ni pour effet de priver les élus majoritaires de leur droit d'expression sur les affaires communales dont le bulletin se fait l'écho.
En tout état de cause, les bulletins municipaux rendent compte des événements de la vie communale et des actions menées dans la commune, sous l'égide du maire, par sa majorité. Ils ont donc, par définition, vocation à permettre à la majorité municipale d'exercer son droit d'expression.
Cependant, si le législateur n'a pas jugé nécessaire de consacrer ce droit d'expression pour tous les conseillers municipaux, rien, monsieur le sénateur, ne s'oppose à ce que les bulletins diffusés par les communes comportent un espace pour les élus de la majorité. Ainsi, le tribunal administratif de Dijon a considéré, dans un jugement du 27 juin 2003, que les dispositions législatives, si elles prévoient un espace réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité, ne font pas obstacle à ce que les pages des publications municipales créées à cet effet soient également ouvertes aux conseillers de la majorité municipale.
L'opposition d'une commune de plus de 3 500 habitants n'est donc pas donc pas fondée à contester ce droit à la majorité.

Je vous remercie, madame la ministre, de la clarté de votre réponse.
Curieusement, cet article, qui avait effectivement vocation à permettre l'expression pluraliste dans les bulletins municipaux, était interprété, dans certaines communes, heureusement pas dans la majorité d'entre elles, d'une manière tout à fait restrictive.
Votre précision, madame la ministre, lèvera, je le pense, toutes les ambiguïtés.

La parole est à M. André Rouvière, auteur de la question n° 655, adressée à M. le ministre délégué au logement et à la ville.

Monsieur le secrétaire d'Etat, j'appelle une nouvelle fois votre attention, comme je l'ai déjà fait dans une question écrite au mois de novembre l'année dernière, sur les conséquences particulièrement injustes de l'arrêté du 30 avril 2004 fixant à 24 euros par mois le seuil en dessous duquel l'aide personnalisée au logement, l'APL, n'est plus versée.
De nombreux ménages figurant parmi les plus modestes sont ainsi frappés par cette mesure qui, sur douze mois, les prive d'une ressource non négligeable au regard de leur situation matérielle et financière.
Le Gouvernement pourrait pourtant facilement décider, par exemple par arrêté, que les versements mensuels inférieurs à 24 euros soient réglés par trimestre ou par semestre.
Cet arrêté du 30 avril 2004 soulève, à mon sens, au moins deux interrogations.
Tout d'abord, monsieur le secrétaire d'Etat, cet arrêté est-il légal ? Un arrêté peut-il limiter la portée d'une loi ? C'est en effet bien de cela qu'il s'agit : cet arrêté prive les plus démunis d'une partie de l'aide prévue par la loi.
Ensuite, ma deuxième interrogation est d'ordre moral. Il est en effet choquant, voire révoltant, que le Gouvernement réduise les impôts des moins démunis et, dans le même temps, supprime l'APL des plus défavorisés. Monsieur le secrétaire d'Etat, comment pouvez-vous accepter une telle injustice ?
J'ai sous les yeux une lettre du Médiateur de la République, qui, sans que je l'aie sollicité, m'a spontanément fait connaître son opinion après avoir lu la question écrite que j'avais déposée. Vous connaissez le contenu de cette lettre, car vous l'avez reçue, monsieur le secrétaire d'Etat, mais j'en lirai seulement deux paragraphes.
Le Médiateur de la République écrivait : « Cette réglementation, qui paraît poursuivre un objectif louable de bonne gestion administrative, est vécue par les personnes concernées comme un déni de droit. Elle entraîne, en effet, à leur encontre, des conséquences inéquitables en privant des personnes ou des familles, qui disposent de revenus modestes, d'une prestation d'un montant non négligeable, puisqu'il peut atteindre 288 euros par an. »
Il poursuivait : « Afin de rétablir l'équité, le Médiateur de la République demande que soit étudiée la possibilité de mettre fin à la règle de non-octroi des allocations de logement inférieures à un certain niveau. »
Monsieur le secrétaire d'Etat, je me permets de vous renouveler cette question en espérant que votre réponse sera différente de la réponse écrite que vous m'avez déjà adressée.
Monsieur le sénateur, je vous prie d'excuser M. Marc-Philippe Daubresse, qui est absent pour raison de santé.
Je tiens tout d'abord à vous rappeler la volonté du Gouvernement de manière générale de réévaluer en fonction de l'inflation l'ensemble des aides publiques ainsi que les barèmes d'impôt. Cela implique que soient revalorisés non seulement les montants mais aussi les seuils de non-paiement, tant pour les impôts que pour les allocations. C'est ce qui a été fait pour l'APL.
La difficulté, que Marc-Philippe Daubresse mesure bien et que le Médiateur de la République décrit dans son courrier, que le Gouvernement a également reçu, est que la revalorisation portait sur les années 1988 à 2004 et qu'il a fallu rattraper plus de quinze ans sans actualisation. Je pense que vous le savez. En cela, l'arrêté est conforme au principe législatif. Cela ne signifie pas pour autant que cette question ne doive pas être étudiée d'un point de vue législatif.
C'est la raison pour laquelle M. Marc-Philippe Daubresse a mis en place, en lien avec la caisse d'allocations familiales, très concernée par ces questions d'aide à la personne en matière de logement, un groupe de travail qui, avant l'été, doit examiner la question de la réorganisation et de la revalorisation de l'APL.
Dans son esprit, il va de soi que cette question du seuil de non-paiement même si, éventuellement, l'on décide de modifier le cadre législatif du principe d'un tel seuil, puisse être examinée.
Je veux maintenant vous apporter deux précisions d'ordre général.
Tout d'abord, ce sont bien les aides les plus faibles qui ne sont pas versées. Or, généralement, plus le ménage perçoit des revenus modestes, plus le montant de l'aide est élevé. Par conséquent, ce ne sont pas les ménages les plus modestes qui sont pénalisés par ce mécanisme. Je livre cette réflexion mathématique à votre sagacité, que je ne mésestime pas.
Ensuite, il n'y a aucun recul des moyens engagés par l'Etat. A peu près 6 100 000 ménages bénéficient de l'APL depuis l'arrêté du 30 avril 2004, pour un montant de 5 milliards d'euros.
Mais ces remarques ne retirent rien à la justesse de votre propos sur l'éventualité d'un réajustement. M. Marc-Philippe Daubresse consulte d'ailleurs actuellement la CAF et l'ensemble des partenaires sur ce sujet.
Une réponse sera donc apportée d'ici à l'été de manière générale sur la revalorisation de l'APL.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne veux pas polémiquer. Vous dites que les bénéficiaires de l'APL ne sont pas forcément les plus défavorisés. C'est peut-être exact, mais je ne pense pas qu'ils soient les plus favorisés, sinon ils ne percevraient pas l'APL.
Votre réponse marque néanmoins un léger progrès par rapport à la première que vous m'aviez apportée.
Qui que nous soyons, nous nous grandissons en reconnaissant nos erreurs. Je souhaite que le Gouvernement répare la sienne qui plus qu'une erreur est une grave injustice.
Alors que la loi accorde une aide à des personnes qui, si elles ne sont pas les plus défavorisées, figurent parmi les plus défavorisées, je suis choqué sur le plan moral qu'un arrêté puisse limiter cette aide.
Je m'interroge aussi d'un point de vue légal. Un arrêté peut-il limiter la portée d'une loi ? Je ne suis pas convaincu que vous ayez raison.
Je souhaite que ce petit pas ne soit que le premier parmi d'autres et que, dans quelque temps, je puisse spontanément vous remercier d'avoir revu votre position.

La parole est à M. Roger Karoutchi, auteur de la question n° 661, transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

Madame la secrétaire d'Etat, la découverte récente d'explosifs au sein de la maison d'arrêt de La Santé lors de fouilles relance l'idée que la sécurité dans les prisons est incertaine, difficile à assurer. Les détenus utilisent tous les moyens pour faire entrer en prison des explosifs, des lames de scies, des armes. On a trouvé de nombreux objets lors des contrôles, qui sont devenus assez réguliers depuis quelques mois.
Le contrôle est devenu de ce fait beaucoup plus difficile pour le personnel assurant la sécurité de ces établissements.
Les lacunes résultent tout aussi bien du manque relatif du personnel de surveillance que de la difficulté de mise en oeuvre des moyens techniques existants.
En effet, si les prisons sont équipées de portiques de détection d'objets métalliques, rien ne permet, en revanche, d'identifier la présence d'explosifs.
Cette situation est à la fois dangereuse pour la population vivant à proximité de ces établissements pénitentiaires, qui n'est pas à l'abri d'une évasion des détenus ou d'incidents, et pour les surveillants de prison.
Le rapport remis le 20 juillet 2001 par le directeur régional des services pénitentiaires de Paris, à la suite des graves événements qui étaient survenus à la prison de Fresnes, préconisait des réponses efficaces et réalistes s'appuyant sur deux axes, la sécurité active et la sécurité passive.
L'ensemble des réflexions issues du groupe de travail prenait également appui sur un certain nombre d'observations résultant de voyages d'études effectués dans divers pays européens, tels l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni.
Madame la secrétaire d'Etat, après ce rapport, un certain nombre de mesures avaient été prises.
Pouvez-vous d'ores et déjà préciser à la Haute Assemblée ce qu'il est advenu de ce rapport et si ces préconisations ont été suivies d'effet ? Et, si oui, comment se fait-il que, quelques années plus tard, nous soyons de nouveau confrontés au même problème ? Pouvez-vous apporter des réponses à la fois pour le personnel de surveillance des établissements pénitentiaires et pour tous les Français qui résident à proximité de tels établissements ?
Monsieur le sénateur, Dominique Perben, retenu par des obligations, m'a chargée de vous présenter ses excuses et de vous apporter les éléments de réponse suivants.
Dès sa nomination en qualité de garde des sceaux, il a souhaité donner à l'administration pénitentiaire les moyens de remplir sa mission de sécurité publique dans les meilleures conditions.
La mission première de l'administration pénitentiaire consiste en effet à protéger nos concitoyens et à maintenir la sécurité publique dans le respect des règles d'un Etat de droit.
La mise en oeuvre d'une politique ambitieuse dans le domaine de la sécurité pénitentiaire passe non seulement par l'obtention de moyens supplémentaires, prévus dans la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, mais aussi par une politique volontariste.
En premier lieu, dans le cadre de la loi précitée, d'importants moyens nouveaux ont été mis en oeuvre pour renforcer la sécurité dans les prisons.
La sécurité périmétrique a été valorisée par l'amélioration des infrastructures.
Ainsi, la politique de mise aux normes des miradors est poursuivie. Un effort considérable est en cours de réalisation en faveur des maisons centrales et des maisons d'arrêt les plus importantes. Des glacis sont progressivement mis en place à l'extérieur des établissements afin de sécuriser les abords.
Par ailleurs, la sécurité électronique s'est développée au cours de l'année écoulée.
Ainsi, les établissements sont progressivement équipés d'appareils de radiocommunication couplés avec un système d'alarme.
Des tunnels d'inspections à rayons X sont installés chaque année avec l'objectif de doter tous les sites en 2007 et neuf établissements ont été équipés en 2004.
Le brouillage des téléphones portables constitue une priorité. Les quartiers disciplinaires et d'isolement des structures les plus sensibles ont été équipés depuis 2003. Au total, trente sites ont ainsi été dotés.
Progressivement, tous les établissements seront pourvus d'un système de contrôle biométrique des détenus à l'occasion des parloirs, afin de lutter contre les évasions par substitution. A titre d'exemple, les grands établissements de la région parisienne sont d'ores et déjà tous équipés.
D'autres orientations de la loi d'orientation et de programmation pour la justice concourent au renforcement de la sécurité. Il s'agit de programmes de construction, de créations d'emploi de personnels à l'administration pénitentiaire et du recours à la visioconférence.
En second lieu, la sécurité des établissements a été renforcée grâce à une politique volontariste sur le terrain et par de nouveaux outils.
Il s'agit, tout d'abord, de la pérennisation des opérations de fouille générale, dont le ministre de la justice a annoncé le principe au mois de mars 2003.
Dorénavant, tous les établissements sont concernés selon un plan annuel comprenant une quarantaine de sites. A ce jour, quatre-vingts fouilles ont été organisées dans les établissements pénitentiaires.
Il s'agit, ensuite, des équipes régionales d'intervention et de sécurité, les ERIS, créées par circulaire du 27 février 2003. Elles interviennent pour prévenir des mouvements collectifs ou individuels et pour sécuriser certains transferts de détenus dangereux.
Les ERIS ont réalisé près de six cents opérations d'envergure, essentielles pour le maintien de la sécurité des personnes et de l'ordre.
Il s'agit également de la création d'une sous-direction de l'état-major de sécurité visant à regrouper tous les services de l'administration centrale ayant à connaître des questions de sécurité pénitentiaire. Sa mise en place vise à augmenter la capacité de réaction et d'anticipation de la Direction de l'administration pénitentiaire.
Placée sous l'autorité directe du directeur de l'administration pénitentiaire, elle est organisée en trois bureaux à vocation très opérationnelle, le bureau de la gestion de la détention, le bureau de la sécurité pénitentiaire et le bureau du renseignement pénitentiaire
Il s'agit, enfin, de la réalisation, au sein de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, d'un bâtiment exclusivement consacré à la formation aux gestes professionnels, afin de mieux former les personnels à l'exercice quotidien de leurs missions.
Cette politique ambitieuse, que Dominique Perben mène depuis plus de deux ans et demi, a d'ores et déjà porté ses fruits. Le nombre d'évasions sous garde pénitentiaire, par bris de prison, violence, ruse ou lors d'une consultation médicale, a diminué ces dernières années. Il s'élevait à 31 en 2001, à 18 en 2003 et à 17 en 2004. Cet effort sera poursuivi.
Certaines mesures correspondent à la mise en oeuvre de celles qui sont préconisées dans le rapport auquel vous faites allusion, monsieur le sénateur, mais les actions entreprises par le ministère de la justice vont bien au-delà.

Madame la secrétaire d'Etat, toutes ces dispositions vont dans le bon sens. J'ai été confronté à des difficultés semblables dans la ville où je suis élu. Le fait de construire une maison d'arrêt, une maison centrale, pose beaucoup de problèmes à la population.
Si nous voulons construire plus facilement des établissements pénitentiaires sans réaction de la population, il faut à la fois poursuivre l'humanisation à l'intérieur des prisons et développer la sécurité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ces deux éléments sont indispensables.
Madame la secrétaire d'Etat, vous avez cependant bien fait de nous rappeler les principaux éléments de la politique du Gouvernement en la matière.

La parole est à M. Claude Biwer, en remplacement de M. Jean Boyer, auteur de la question n° 665, adressée à M. le ministre délégué à l'industrie.

Je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de notre collègue Jean Boyer, qui m'a demandé de le représenter ce matin. Je le fais d'autant plus volontiers que j'aurais pu moi-même poser cette question orale, tant les difficultés que connaît son département, la Haute-Loire, ressemblent à celles auxquelles je suis confronté dans mon département, la Meuse. En matière de téléphonie mobile et d'Internet à haut débit, ce sont souvent les départements ruraux qui sont les moins adaptés à ce jour. Tel est bien le cas de ceux que nous représentons l'un et l'autre.
S'agissant de la téléphonie mobile, des avancées significatives, en partenariat avec les collectivités territoriales et les différents opérateurs, ont été engagées d'une manière exceptionnelle, multipliant ainsi les projets destinés à la mise en place de relais de transmission dans les zones dites « blanches ».
Sans l'initiative gouvernementale, que je tiens à saluer, sans la définition d'un accord entre les trois opérateurs présents sur le marché mais également avec le concours, souvent décisif, des collectivités territoriales - des départements en particulier mais aussi, très souvent, des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale -, le désenclavement autour de la téléphonie mobile n'aurait pu voir le jour.
Cependant, madame la secrétaire d'Etat, l'inquiétude va grandissant concernant les zones dites « grises », c'est-à-dire les zones où, pour l'instant, un seul opérateur téléphonique intervient, car, ces zones n'étant de ce fait plus considérées comme prioritaires, elles pourraient devenir demain de véritables zones d'ombre sur la carte de France, ce qui limiterait considérablement leur accessibilité.
Or, à l'image du haut débit, la téléphonie mobile avec ses innovations technologiques sans cesse renouvelées participe non seulement au développement économique mais également à l'attractivité des territoires, quels qu'ils soient. Inutile de préciser que, si ces technologies sont absentes ou défaillantes, les entreprises qui ne peuvent en bénéficier auront tôt fait de s'implanter ailleurs, sous des cieux plus cléments !
Sans une bonne couverture par tous les opérateurs, des pans entiers de nos espaces les plus fragiles, en particulier les zones de montagne, auxquelles j'ajouterai certaines zones de plaine très éloignées des centres urbains, seront pénalisés et risquent une nouvelle fois de subir les conséquences cumulatives de nombreux handicaps.
Pour toutes ces raisons, je vous serais reconnaissant, madame la secrétaire d'Etat, de bien vouloir préciser quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour que les zones dites « grises » puissent bénéficier de la couverture de tous les opérateurs présents sur le marché à partir d'un seul pylône, évitant ainsi une démultiplication des équipements et favorisant l'accessibilité de tous les usagers à cette nouvelle technologie.
Par ailleurs, pourriez-vous nous indiquer quelles sont les mesures rationnelles et efficaces que le Gouvernement compte adopter afin qu'il n'y ait pas une démultiplication d'initiatives isolées ?
Madame la secrétaire d'Etat, dans ce domaine de la téléphonie mobile mais aussi de l'Internet à haut débit, il ne faudrait pas que les zones « grises » d'aujourd'hui deviennent demain des zones totalement « blanches ».
Monsieur le sénateur, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser M. Devedjian, qui est retenu par des obligations.
Comme vous l'avez très bien rappelé, un plan de couverture des zones « blanches », c'est-à-dire des zones dans lesquelles il n'y a aucun opérateur, a été engagé sur l'initiative du Gouvernement.
Une convention nationale pour la couverture en téléphonie mobile des zones « blanches » a ainsi été signée le 15 juillet 2003 entre l'Autorité de régulation des télécommunications, l'Assemblée des départements de France et l'Association des maires de France, les trois opérateurs et le Gouvernement.
Cette convention nationale prévoit l'équipement, en deux phases, d'environ 2 000 sites permettant de couvrir 3 000 communes.
Ce plan commence à porter ses fruits. Au 1er février 2005, 673 sites de la phase I avaient fait l'objet d'un accord entre opérateurs et collectivités territoriales sur leur lieu d'implantation ; 53 protocoles départementaux étaient signés, 50 infrastructures étaient mises à disposition d'opérateurs par les collectivités et 32 sites étaient ouverts commercialement.
Le problème des zones « grises » se pose de façon très différente de celui des zones « blanches », puisque, par définition, les zones « grises » sont déjà couvertes par un opérateur qui a pris le risque d'y investir.
Le plan de couverture des zones « blanches » constitue une première incitation pour les opérateurs à investir dans les zones « grises » afin d'assurer la continuité de leur service sur le territoire.
En outre, les nouvelles obligations de couverture retenues par le Gouvernement dans le cadre du renouvellement des licences de Orange et de SFR obligeront les opérateurs à assurer une couverture de 99 % de la population métropolitaine en 2006, contre 90 % actuellement, ainsi que la couverture des axes routiers principaux de chaque département. La mise en oeuvre de ces obligations diminuera donc de fait l'ensemble des zones « grises » sur le territoire.
Enfin, l'utilisation par plusieurs opérateurs des mêmes pylônes est tout à fait envisageable pour les zones « grises ». Il s'agit d'ailleurs d'une pratique largement développée chez les opérateurs afin d'éviter la démultiplication des équipements.

Madame la secrétaire d'Etat, je vous remercie des précisions que vous avez apportées.
J'ai relevé que vous annonciez une couverture de 99 % de la population. On parle souvent d'une couverture de 80 %, 85 % ou 90 % - peu importe le chiffre - du territoire, en oubliant le terme de « population ». Or, population ou territoire, ce n'est pas pareil.
Nous plaidons aujourd'hui la cause du territoire. Il est bien évident que toutes les villes sont équipées - même si, pour y circuler, nous savons que, même à Paris, il y a parfois des ruptures de réseau -, alors que les territoires ruraux sont souvent laissés de côté.
Je me réjouis que l'accompagnement gouvernemental se poursuive. C'est une incitation à relancer le débat afin que l'on puisse bientôt communiquer de manière plus moderne sur l'ensemble du territoire !

La parole est à Mme Michelle Demessine, auteur de la question n° 658, adressée à M. le ministre délégué à l'industrie.

Madame la secrétaire d'Etat, je souhaite interroger le Gouvernement au sujet de la sécurité des ouvrages gaz, sécurité qui est sous la responsabilité de notre entreprise nationale Gaz de France.
Gaz de France a su faire face par le passé à des défis technologiques et financiers importants, mais il faut bien constater que cette entreprise nationale fonde depuis plusieurs années sa gestion sur le seul critère de rentabilité, cela afin de se présenter comme une entreprise attractive pour les capitaux privés, mais aux dépens de ses missions de service public.
Et, de fait, l'explosion qui, le 26 décembre dernier, a fait dix-sept morts à Mulhouse résulte selon toute vraisemblance de la cassure d'une canalisation en fonte. Cet accident, après ceux de Dijon, en décembre 1999, de Toulouse, en novembre 2002, et de Beaurain, en décembre 2003, sans compter un nombre important de cassures et d'explosions, met en exergue l'urgente nécessité d'éliminer les fontes cassantes du réseau de Gaz de France.
Dès 1970, ce type de canalisation n'était plus autorisé, et les techniciens de GDF mettaient en évidence la nécessité d'éliminer les anciennes fontes cassantes, en commençant par les plus dangereuses pour les personnes et pour les biens.
Ce problème bien connu de la direction, à la suite des interpellations des représentants du personnel au début des années quatre-vingt-dix, a fait l'objet d'un engagement par le conseil d'administration de GDF d'éliminer totalement ces fontes à l'horizon 2000. Ainsi, 1 600 kilomètres ont été renouvelés en 1992 et 1 700 kilomètres en 1993.
Puis, sur décision interne, la longueur renouvelée a chuté. Pis, le conseil d'administration décide en 1996 de ne renouveler que sur risque calculé ! Les longueurs renouvelées passent de 900 kilomètres en 1997 à 650 kilomètres seulement en 1999. Malheureusement, nous connaissons le résultat : on compte aujourd'hui les morts.
Cette attitude, qui fait fi de la sécurité des citoyens, conduit GDF à consacrer 2 milliards d'euros au financement d'activités internationales en 2002, mais à n'affecter la même année que 136 millions d'euros au renouvellement des fontes alors que 600 millions d'euros suffisaient pour éliminer les 6 200 kilomètres subsistant en 1999.
La situation est d'autant plus grave que, lors du conseil d'administration du 26 janvier dernier, les représentants de la direction GDF et la représentante du ministère de l'industrie ont refusé toute accélération du programme de renouvellement, en rejetant la responsabilité sur les villes au prétexte qu'elles n'acceptent pas l'ouverture des chantiers.
Bien que le Gouvernement ait abandonné aux lois du marché un bien de la nation en le convertissant en société anonyme, l'Etat reste l'actionnaire unique de Gaz de France, madame la secrétaire d'Etat.
Par ailleurs, nous vous rappelons que l'Etat est le garant de la sécurité publique.
En conséquence, nous demandons au Gouvernement d'intervenir auprès de GDF afin d'éliminer le plus vite possible de ses réseaux la totalité des fontes cassantes, ainsi que toutes les canalisations dangereuses.
Le second problème, et ce n'est pas le moindre, tient à ce qu'une très grande partie des accidents dus au gaz relèvent des installations dans les logements.
Le contrôle de ces installations dépend depuis 1992 d'un organisme de droit privé. Il en résulte que le contrôle n'est obligatoire que pour les seules installations neuves, que ce contrôle est payant pour l'usager et les installations anciennes, et que les changements d'occupants se faisant en « libre service » y échappent.
Or il est devenu indispensable de rendre ce contrôle obligatoire et systématique tous les dix ans. Son intégration dans le contrat de GDF garantirait la périodicité des contrôles et la sécurité des biens et des personnes sur le territoire national. Ce ne sont pas les élus de cette assemblée qui me contrediront, en particulier ceux qui ont la responsabilité d'une collectivité territoriale.
Ces situations particulièrement préoccupantes nous conduisent à nous interroger sur le niveau de qualité de la maintenance pratiquée sur l'ensemble des ouvrages de ce service public, maintenance prévue, je le rappelle, dans le cahier des charges de distribution publique auprès des autorités concédantes que sont les collectivités locales.
A cet égard, différentes informations sont également inquiétantes.
Ainsi, on constate un important accroissement des agressions subies par les ouvrages enterrés, du fait de la suppression des surveillants de chantiers et d'une cartographie de plus en plus défaillante.
On assiste également à une diminution des effectifs à travers de multiples réformes de structures qui éloignent de plus en plus les techniciens des ouvrages concernés.
Les formations techniques sont de moins en moins fréquentes : alors que seules les écoles de métiers de GDF dispensaient les connaissances nécessaires, elles ont été supprimées.
Le suivi des ouvrages impose des visites périodiques, mais celles-ci sont de plus en plus espacées. Or cet espacement ne permet plus une connaissance réelle de l'évolution des ouvrages.
Enfin, l'accroissement de la sous-traitance conduit à une diminution de la qualité des réalisations, à l'augmentation des coûts et, simultanément, à une perte de compétence au sein de l'entreprise.
Cette dégradation progressive de l'ensemble de la politique de maintenance des ouvrages de la distribution du gaz résulte d'une adaptation systématique de la politique aux moyens que l'on décide d'accorder et non d'une définition des besoins en partant des missions de service public.
C'est la conception même de la sécurité qui doit être remise en cause. L'entreprise Gaz de France avait d'ailleurs été critiquée par la commission d'enquête sur la sûreté des installations industrielles et des centres de recherche et sur la protection des personnes et de l'environnement en cas d'accident industriel majeur, qui, dans son rapport paru en 2002, « considère que l'un des premiers objectifs à atteindre, pour évoluer vers des situations de risques socialement acceptables, est de faire reculer la culture du secret si fortement implantée dans l'entreprise, vis-à-vis tant des salariés que des populations extérieures ».
Il ne semble pas que GDF ait tenu compte des observations des parlementaires, bien au contraire, et le cas des fontes cassantes n'est malheureusement que la partie apparente de l'iceberg.
En conséquence, madame la secrétaire d'Etat, je vous demande de bien vouloir m'éclairer sur les dispositions que compte prendre votre gouvernement pour que Gaz de France respecte intégralement ses missions de maintenance, afin de préserver le devenir des ouvrages et de tout mettre en oeuvre pour garantir la sécurité de notre réseau et pour que les accidents que nous avons connus ne puissent plus se reproduire.
Madame la sénatrice, je vous demande de nouveau de bien vouloir excuser M. Devedjian, qui est retenu par un impératif.
Vous interrogez le ministre délégué à l'industrie sur le respect par Gaz de France de ses missions de maintenance et de surveillance de son réseau de distribution du gaz par canalisations en fonte cassante.
M. Devedjian me charge de vous dire à quel point il est comme vous extrêmement soucieux de toutes les questions de sécurité que vous évoquez.
A la suite du tragique accident de Mulhouse du 26 décembre dernier, Gaz de France s'est engagé à prendre d'urgence un certain nombre de mesures, en fixant pour objectif une résorption totale des fontes grises - soit 2 040 kilomètres répertoriés à la fin 2004 - pour la fin de l'année 2006 lorsqu'elles sont situées en zone sensible et pour la fin de l'année 2007 pour les autres.
Ces mesures seront inscrites dans le prochain contrat de service public entre l'Etat et Gaz de France.
Les autres distributeurs de gaz devront également accélérer leur programme de résorption.
Sur le terrain, les DRIRE, les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, suivront, en relation avec les responsables régionaux de Gaz de France, l'évolution de la résorption de ces canalisations.
Gaz de France s'est également engagé à faire surveiller ces canalisations trois fois par an au lieu d'une fois par an jusqu'à présent.
J'insiste sur le fait qu'il n'est pas possible de tout résorber en même temps sur la seule initiative de Gaz de France du fait de contraintes de voiries et de disponibilité des entreprises de BTP. Il revient donc aussi aux communes de faire des choix.
En ce qui concerne la sécurité des installations intérieures de gaz, les installations neuves, modifiées ou complétées doivent faire l'objet d'un contrôle par un organisme agréé par les pouvoirs publics.
Pour ce qui est des installations anciennes de gaz, un diagnostic portant sur leur sécurité sera bientôt imposé lors d'un changement de propriétaire. Cette disposition sera reprise par le ministre délégué au logement dans le cadre plus général de l'obligation d'établir un diagnostic immobilier ; les projets d'ordonnance et de décret sont en cours.
En outre, diverses actions sont actuellement menées par Gaz de France pour améliorer la sécurité des installations intérieures, notamment la réalisation de diagnostics portant sur leur sécurité, dans un cadre contractuel.
Enfin, plusieurs accidents récents ont été causés par le fonctionnement défectueux d'appareils à gaz, en particulier des appareils de cuisson. Nous avons proposé à la Commission européenne que la directive européenne applicable soit révisée à cet effet, notamment pour rendre obligatoire des systèmes automatiques de coupure en cas d'extinction de flamme.

La parole est à M. Ambroise Dupont, auteur de la question n° 649, adressée à M. le ministre de l'écologie et du développement durable.

Ma question porte sur la coexistence de deux types de zones classées au titre de la prévention du risque d'inondation et sur les conséquences de ces deux classements sur la responsabilité des élus.
II existe deux types de classification des zones inondables. Le premier est intitulé « plan de prévention des risques d'inondation », mieux connu sous le nom de PPRI. Aux termes de la loi du 2 février 1995, ces PPRI doivent être mis en place à l'issue d'une concertation - trop souvent symbolique - entre les services de la direction départementale de l'équipement, la DDE, et les collectivités locales.
Cette classification interdit clairement aux maires et aux services d'urbanisme d'accorder un permis de construire ou tout autre certificat d'urbanisme au sein de ces zones, sauf à les assortir des conditions particulières prévues à l'article R. 421-38-14 du code de l'urbanisme.
La délivrance d'un permis de construire en méconnaissance des PPRI est de nature à entraîner la responsabilité pénale des élus, notamment sur le fondement de l'article 121-3, alinéa 3, et de l'article 223-1 du code pénal, qui sanctionnent les manquements à une obligation de sécurité mettant en danger la sécurité d'autrui.
Tout cela est clair, mais peu de ces PPRI sont aujourd'hui en place.
Le second type de zones soumises à un risque d'inondation est classifié au sein des atlas des zones inondables.
Ces atlas des zones inondables sont établis par les directions régionales de l'environnement, les DIREN, dans le cadre des obligations de l'Etat en matière de prévention des risques naturels majeurs prévues par le décret du 11 octobre 1990.
Ces documents portent à la connaissance des collectivités locales et du public les informations disponibles sur les risques d'inondation sous forme de textes et de cartes. Ils sont établis à partir des relevés des évènements historiques connus et d'études de modélisation. Ne faisant l'objet d'aucune concertation avec les élus locaux, ils font parfois l'objet de modifications importantes sans qu'aucun événement nouveau ne soit intervenu pour justifier l'extension des périmètres concernés et l'aggravation de l'aléa du risque envisagé. Ainsi, dans le Calvados, l'atlas des zones inondables, mis à jour en 2003, vient de connaître une nouvelle mise à jour en novembre 2004, qui étend les zones inondables bien au-delà du périmètre des plus hautes eaux et remplace, pour de nombreux secteurs, le classement zone alluviale à risque mal identifié par un classement zone inondable.
Les atlas des zones inondables recouvrent donc des zones très larges dans lesquelles les risques d'inondation ne sont souvent pas avérés, voire sont tout à fait improbables. Il est dès lors très difficile pour les maires d'en tenir compte, notamment pour refuser un permis de construire, sans entraîner un fort mécontentement général.
De plus, cette double classification crée une instabilité dans les informations portées à la connaissance des élus locaux et du public qui risque de décrédibiliser la politique générale en matière de prévention des risques majeurs.
Surtout, il semble qu'aux termes du décret du 11 octobre 1990 les seules obligations des maires découlant de ces atlas des zones inondables consistent en une information du public sur les risques encourus ; il n'incombe nullement aux maires de les prendre en compte lors de la délivrance des documents d'urbanisme.
Monsieur le ministre, je vous remercie de m'indiquer si les élus locaux et les maires qui ne tiennent pas compte des atlas des zones inondables, notamment lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et de la délivrance des permis de construire, engagent leur responsabilité administrative, civile et surtout pénale de la même manière qu'en cas de méconnaissance des PPRI.
Monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur les responsabilités des autorités locales compétentes en matière d'urbanisme qui ne tiendraient pas compte, lors de l'élaboration des documents d'urbanisme ou de la délivrance de permis de construire, des informations sur les risques d'inondation contenues dans les atlas des zones inondables.
Vous faites, à bon droit, la distinction entre deux types de documents qui n'ont ni la même valeur juridique ni, par conséquent, les mêmes implications en termes de responsabilités : d'une part, les plans de prévention des risques naturels prévisibles, servitudes d'utilité publique annexées aux plans locaux d'urbanisme et directement opposables aux tiers et, d'autre part, les atlas des zones inondables, documents purement informatifs qui comportent notamment une cartographie des phénomènes historiques recensés.
Cependant, comme le rappelle la circulaire ministérielle du 4 novembre 2003 relative à la politique de l'Etat en matière d'établissement d'atlas des zones inondables, ces derniers constituent des documents de référence pour la connaissance des phénomènes d'inondation. Il est d'ailleurs de la responsabilité de l'Etat de les porter à la connaissance des autorités locales pour que celles-ci les prennent en compte, en tant que de besoin, dans leurs décisions en matière d'urbanisme.
Par conséquent, bien que dépourvus de valeur réglementaire et ayant vocation à être actualisés ou enrichis avec le temps, ces atlas représentent, au moment de leur transmission, un certain état des connaissances sur les risques d'inondation. Ils doivent, à ce titre, contribuer à orienter la réflexion des collectivités territoriales sur le développement et l'aménagement de leur territoire au travers des documents d'urbanisme. Ils doivent également inciter ces mêmes collectivités à apprécier les conditions de délivrance des autorisations en droit des sols au regard des impératifs de sécurité publique, en application notamment de l'article R. 111- 2 du code de l'urbanisme.
Les responsabilités encourues par les autorités compétentes en matière d'urbanisme sont largement reconnues sur le plan administratif dans le cas où un permis de construire a été délivré sans tenir compte des risques connus.
En matière pénale, ne pas tirer de conclusion directe, dans le domaine de l'urbanisme, d'un atlas des zones inondables n'est pas en soi constitutif d'un manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement au sens de l'article 223-1 ou de l'article 121-3 du code pénal, comme le serait en revanche la violation d'une règle édictée par un plan de prévention des risques, un PPR.
En revanche, et j'insiste sur ce point, en application du même article 121-3 du code pénal, le juge pénal pourrait qualifier de faute caractérisée ayant exposé la vie d'autrui à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignorée la délivrance d'un permis de construire dans une zone identifiée comme soumise à un risque d'inondation important.

Je vous remercie, monsieur le ministre, des précisions que vous avez apportées sur la classification et la hiérarchie des documents. Toutefois, il ne m'apparaît pas clairement que la vie des maires en sera simplifiée.
Aujourd'hui, les services de l'Etat, notamment la DDE, service instructeur en matière de documents d'urbanisme et de permis de construire, émettent purement et simplement un avis défavorable à toute construction qui se trouve ressortir de l'atlas des zones inondables.
On nous dit, année après année, que la carte évolue en fonction des travaux destinés à rendre constructibles des terrains aujourd'hui situés en zone dite inondable. Vous reportez ainsi un risque, puisque les travaux qui aboutissent à des remblaiements, dont on ne mesure pas toujours les effets, conduisent à créer de nouvelles zones inondables, lesquelles n'auront pas été signalées dans le précédent atlas ayant permis la délivrance du permis de construire.
Nous allons au devant de grandes difficultés et, s'il n'y a pas une lecture commune des services de l'Etat des divers documents établis dans ce domaine, les maires ne pourront pas facilement assumer la responsabilité qui leur est confiée.
Monsieur le ministre, les zones inondables figurent en rouge dans les PPRI. Il ne faudrait pas que ces atlas des zones inondables « rougissent » à la vitesse grand V, sous peine de bloquer tout développement.

La parole est à M. Roland Courteau, auteur de la question n° 656, adressée à M. le ministre de l'écologie et du développement durable.

Depuis le 26 décembre 2004 et le raz-de-marée qui a dévasté les rives de l'Asie du Sud, les populations qui résident à proximité des côtes s'interrogent sur l'existence d'un risque et sur le degré de protection dont elles sont susceptibles de bénéficier. Le problème se pose peut-être plus particulièrement pour la Méditerranée puisque la tectonique des plaques fait de cette mer une zone à forts risques sismiques. Par le passé, des séismes particulièrement meurtriers, suivis de tsunamis, ont bien eu lieu sur cette mer.
Certes, chacun sait que le risque est moins important que dans l'océan Indien ou dans l'Océan Pacifique et qu'il est relativement éloigné dans le temps. Il n'empêche que ce risque existe et qu'en raison de la sensibilisation toute particulière à ce problème depuis le 26 décembre dernier les populations éprouvent une certaine angoisse, qu'il ne faut toutefois pas exagérer. Le fait que nous ne disposions d'aucun système d'alerte en Méditerranée n'y est pas étranger.
Je ne sous-estime pas, monsieur le ministre, la complexité de la question. Tout d'abord, la mise en place d'un tel système ne concerne pas, j'imagine, un seul pays. Elle exige donc une concertation et une collaboration de l'ensemble des pays du pourtour de la Méditerranée, notamment de la Méditerranée occidentale.
Ensuite, l'étroitesse de cette mer peut constituer un facteur aggravant, puisqu'un raz-de-marée consécutif, par exemple, à un séisme au large du Maghreb atteindrait nos côtes très rapidement : j'ai entendu parler de soixante minutes environ, ce qui implique un dispositif d'alerte très réactif.
Je ne voudrais pas que mes propos soient considérés comme alarmistes, mais nous ne devons rien négliger, car de tels phénomènes sont imprévisibles.
Face à de tels risques majeurs, il est normal que les populations souhaitent être informées sur le degré de protection existant, notamment en Languedoc-Roussillon - mais cela concerne également la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, monsieur le président - où les côtes sont par endroit tellement basses qu'elles subiraient, y compris dans le cas d'un raz-de-marée de faible amplitude, des dégâts considérables.
S'il est vrai, monsieur le ministre, que les séismes sont imprévisibles, les raz-de-marée qui les suivent sont, eux, prévisibles. Or il existe en France un centre sismologique qui assure l'alerte sismique pour l'ensemble de la Méditerranée.
Les scientifiques considèrent aujourd'hui que nous disposons du savoir nécessaire et que les compétences sont réunies pour mettre en place un système d'alerte au tsunami, fonctionnant, dans des délais très brefs, par liaison de stations sismiques à des centres de collecte de données transmises par satellite. Il reste à savoir qui coordonnerait l'ensemble et, surtout, à s'assurer que les financements seront bien au rendez-vous.
Il reste également à savoir comment préparer, sensibiliser les populations, et les rendre aptes à recevoir les informations pour organiser leur autoprotection. Il convient, en outre, d'évaluer la capacité des institutions à réagir dans des temps très brefs sans que les populations soient, pour autant, maintenues dans un état de « suralerte » qui serait, à bien des égards, préjudiciable.
J'admets que la question est compliquée. Si je me devais, monsieur le ministre, de cibler ce dossier sur la Méditerranée occidentale, la question se pose également pour la façade atlantique et pour l'outre-mer. En ce qui concerne l'ensemble de ces zones, le président du groupe socialiste, M. Jean-Pierre Bel, a d'ailleurs fait part au bureau du Sénat de l'opportunité de saisir l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, lequel pourrait utilement nous éclairer. J'aimerais, monsieur le ministre, connaître votre sentiment sur ce point.
Pour conclure, je souhaite simplement que vous puissiez faire le point aujourd'hui sur l'état d'avancement du dossier relatif à la Méditerranée.
Vous m'interrogez, monsieur le sénateur, sur les mesures que j'entends prendre en matière de prévention et d'alerte au tsunami en Méditerranée. C'est là une question qui a fait l'objet d'un colloque auquel j'ai participé, il y a quelques jours, et qui s'est déroulé à Nice, sous la présidence de M. Christian Estrosi, président du conseil général.
En termes de probabilité, d'occurrence et d'importance des dégâts, le risque direct lié aux séismes est bien plus important que celui qui résulte d'un tsunami.
Aussi, j'ai présenté, le 8 décembre dernier, les grandes orientations d'un programme national de prévention du risque sismique. Le détail opérationnel de ce plan sera rendu public dans les prochaines semaines. Ce programme comprendra des mesures en matière de prévention et d'alerte au tsunami en Méditerranée, qui seront engagées dès 2005.
La première de ces mesures vise à pouvoir alerter les autorités et la population. Il s'agit de mettre en place et de coordonner, sous l'égide de l'UNESCO, un système d'alerte en Méditerranée. Il devra être adapté aux spécificités locales, notamment à la faible étendue de cette mer. Je rappelle qu'un système, également placé sous l'égide de l'UNESCO, existe déjà dans le Pacifique.
La deuxième mesure consiste à évaluer et à cartographier les risques Il s'agira de définir, sur le pourtour méditerranéen, les zones présentant un risque maximum vis-à-vis des effets d'un tsunami, à partir de la connaissance des tsunamis historiques, du contexte tectonique et sismique. Il semble bien qu'il y ait, selon les situations géographiques en Méditerranée, des différences de risques qui demandent naturellement à être évaluées.
La troisième mesure tend à renforcer l'éducation. Le comportement des enfants ayant souvent une influence importante sur celui des parents, il est en particulier essentiel de les sensibiliser aux risques naturels et notamment au risque de tsunami : un comportement adapté du citoyen peut éviter des pertes humaines importantes. A cet égard, j'ai eu l'occasion de constater que, dans le système scolaire français, des initiatives avaient déjà été prises, en particulier autour de la Méditerranée, et j'en félicite leurs auteurs. Il conviendra de systématiser cette sensibilisation.
La quatrième mesure a pour objet de sensibiliser les populations exposées. La culture du risque est en effet souvent faible et, plus le temps passe, plus le risque est oublié.
C'est la raison pour laquelle des campagnes de sensibilisation seront conduites auprès des différentes catégories de populations exposées telles que les habitants, les touristes et les professionnels du tourisme.

Je remercie M. le ministre de sa réponse, mais il n'a pas évoqué la question du financement.

La parole est à M. Christian Cambon, auteur de la question n° 667, adressée à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Depuis 2002, et à la demande du Président de la République, le Gouvernement a placé la lutte contre l'insécurité routière au centre de ses priorités. Des résultats encourageants ont déjà été obtenus : les accidents de la route ont baissé de 20 % entre 2002 et 2003 et le nombre de victimes a diminué de 9 % en 2004. Ce sont là les meilleurs chiffres enregistrés depuis vingt ans puisque, durant cette période, les baisses avaient rarement dépassé les 6 %.
Allumage des feux de jour, radars automatiques, limitation de vitesse, permis probatoires : autant de mesures dont les résultats sont indiscutables.
Hélas, derrière ces pourcentages, certains chiffres font encore frémir. Ainsi, le 24 janvier dernier, le comité interministériel de sécurité routière dressait le bilan de l'année 2004 : 84 331 accidents, 5 217 tués et 107 219 blessés.
Chaque victime est une victime de trop ! Des progrès doivent donc encore être réalisés et les efforts doivent se poursuivre. Tel est le cas en Val-de-Marne, département traversé par trois des plus importantes routes nationales de notre pays : la RN 6, la RN 7 et la RN 19.
Permettez-moi, monsieur le secrétaire d'Etat, d'appeler votre attention sur le point noir du Val-de-Marne, en termes de sécurité routière : la RN 19, dans sa section située entre la RN 406, c'est-à-dire Boissy-Saint-Léger, et la limite du département.
Cette voie, classée route à grande circulation, est l'une des radiales les plus importantes de la région parisienne : sur le plan départemental, elle dessert le plateau briard ; sur le plan régional, elle permet des liaisons entre l'autoroute A 86 et la francilienne, à l'entrée de Brie-Comte-Robert ; sur le plan national, elle relie Paris à Troyes et à la Suisse.
En moyenne, 28 000 véhicules empruntent quotidiennement cette route nationale, dont près de 10 % de poids lourds.
Entre 1997 et 2004, sur seulement huit kilomètres, 368 accidents ont été enregistrés, avec un taux de gravité particulièrement élevé : 542 victimes dont 17 tués. Mais, encore une fois, derrière les chiffres et les pourcentages, il y a, nous le savons tous, des vies brisées, des familles endeuillées. Permettez-moi, sans m'appesantir sur l'aspect macabre de la question, de citer quelques exemples de la triste actualité de cette voie au cours des derniers mois.
Le 7 mars 2004, un piéton est renversé rue du Général Leclerc : grièvement blessé, il est dans le coma et restera handicapé à vie.
En août 2004, un autre piéton, circulant sur un trottoir, est heurté par une camionnette : âgé de 38 ans, et père de deux enfants, il meurt sur le coup.
Le 19 octobre, deux véhicules entrent en collision frontale. Deux des victimes les plus grièvement touchées sont évacuées dans le coma : elles n'en sont toujours pas sorties. La violence de cet accident a paralysé la totalité du sud du département pendant plus de six heures.
En janvier dernier, une personne âgée est écrasée ; elle décédera des suites de l'accident.
Le 4 février, à la hauteur de Santeny, deux véhicules se heurtent, encore une fois, de plein fouet à grande vitesse. Il aura fallu plus d'une heure aux sapeurs-pompiers pour extraire de la carcasse de sa voiture l'une des victimes, âgées de 25 ans. Elle se trouve encore aujourd'hui dans le coma, entre la vie et la mort.
Et comme si l'inscription de cette question demandait encore à être illustrée par l'actualité, au cours de ce week-end, au petit matin, à la hauteur de Marolles-en-Brie, la collision de deux véhicules a fait six blessés, dont cinq jeunes gens âgés d'une vingtaine d'années.
Je pense que cette description suffit en elle-même à vous indiquer le sens de ma question, monsieur le secrétaire d'Etat. C'est en effet dans cette section de la RN 19 située en zone périurbaine, c'est-à-dire au moment où l'on quitte les communes pour entrer sur le plateau briard, quand les automobilistes se croient délivrés des contraintes de prudence à observer dans les milieux urbanisés, là où la route n'est bordée d'aucun habitat, que les enjeux de sécurité routière sont les plus sérieux.
Face à ce bilan terrible, face à ces dix morts survenues en cinq ans, entre Marolles-en-Brie et Santeny, sur moins de six kilomètres, l'Etat a naturellement réagi. Ainsi, la direction départementale de l'équipement a proposé plus de dix projets de travaux de mise en sécurité. Hélas ! le très faible niveau des crédits du plan régional d'aménagement de sécurité, le PRAS, n'a pas permis, jusqu'à présent, de dégager les financements nécessaires. Aujourd'hui, en attendant une décision, la série noire continue. Combien de morts faudra-t-il encore déplorer ?
Sachant que les contrôles radars ne suffisent malheureusement pas à remédier à cette situation, ne serait-il pas possible, monsieur le secrétaire d'Etat, de prendre, dès cette année, les mesures qui s'imposent ?
En juillet dernier, lors d'une réunion des élus des communes concernées, le préfet du Val-de-Marne et la DDE ont trouvé une solution permettant de réduire la circulation à deux fois une voie, avec une glissière de sécurité, tout en protégeant les arbres. Cette dernière variante est estimée à 1 300 000 euros, coût sensiblement inférieur à celui des projets précédents.
Aussi, au nom de tous les élus et des populations concernées, je vous demande instamment, monsieur le secrétaire d'Etat, de prendre enfin la décision de lancer ces financements de mise en sécurité pour que cesse cette hécatombe et que cette route sorte, enfin, de la rubrique quasi quotidienne des faits divers.
Le Président de la République a courageusement choisi de faire de la sécurité routière l'une des priorités de son mandat. Faites en sorte, monsieur le secrétaire d'Etat, que cette priorité se concrétise aussi sur le terrain.
Monsieur le sénateur, cette accumulation de drames ne saurait laisser personne indifférent. Vous avez raison de dire qu'il nous faut agir sur un plan général et je ne peux que souscrire à vos propos concernant la sécurité routière : elle reste une priorité absolue. Nous devons donc encore accomplir des progrès, notamment sur cette section particulièrement dangereuse de la RN 19.
Des travaux s'imposent effectivement, qui répondent à des projets anciens : ils concernent la déviation de Boissy-Saint-Léger et la mise en sécurité de la RN 19. Il s'agit de travaux très coûteux puisque le seul montant de la déviation est estimé à 230 millions d'euros et que celui d'une première tranche entre la RN 406 et l'échangeur dit du « RER », inscrite au contrat de plan, est chiffré à 114 millions d'euros.
L'Etat apporte, comme il est d'usage en région d'Ile-de-France, 30 % du financement et, grâce à la relance des crédits, décidée par le Premier ministre le 5 novembre 2004, nous allons pouvoir entamer des travaux cette année. En effet, une dotation de 20, 5 millions d'euros, dont 6, 2 millions d'euros à la charge de l'Etat, est inscrite à la programmation 2005 pour la déviation de Boissy-Saint-Léger. Cette enveloppe permettra de financer les deux ouvrages situés sous la ligne du RER, marquant une étape significative dans la réalisation de cette opération.
Dans les toutes prochaines semaines, la construction du passage supérieur n °5 sera lancée.
Ce sont des investissements qui ont un impact certain en termes de sécurité routière. Je puis vous donner l'assurance que le ministre Gilles de Robien veillera à traiter en priorité cette opération en 2006, afin de la mener à un rythme aussi soutenu que possible.
Il faudra prévoir des financements complémentaires, d'un montant à peu près équivalent, dans le prochain contrat de plan.
Toutefois, cette opération lourde d'amélioration de l'équipement routier n'est pas en elle-même suffisante. C'est particulièrement vrai s'agissant de la section de la RN 19 située entre Grosbois et la Francilienne, dont la configuration rectiligne favorise des vitesses élevées. Certes, les contrôles radars ne sont pas la panacée, mais ils sont dissuasifs. Nous allons donc demander qu'ils soient renforcés.
Parallèlement, vous avez mentionné un certain nombre de diagnostics de sécurité, conduits aujourd'hui par la DDE. Nous sommes en train d'en étudier les résultats, afin de prendre des mesures susceptibles de réduire les vitesses excessives et de préserver les vies humaines ; un trop grand nombre de morts a été enregistré sur ce tronçon routier spécialement dangereux. Nous sommes, comme vous-même, monsieur le sénateur, particulièrement sensibles à ces drames de la route et à la recherche de solutions qui permettront de les éviter.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez très clairement dissocié les problèmes, ce qui est réconfortant.
La déviation en cours de Boissy-Saint-Léger, qui représente une enveloppe considérable, constitue certainement l'un des plus grands programmes de travaux entrepris par l'Etat dans le Val-de-Marne. S'agissant de l'aménagement de la section qui s'étend de Boissy-Saint-Léger jusqu'à la Francilienne, point sensible de ma question, je vous remercie des ouvertures que vous avez faites.
L'initiative conjointe du préfet et du directeur départemental de l'équipement me paraît aller dans le bon sens. Il importe que la volonté politique suive et que les travaux puissent débuter dès 2005, sachant que les études préalables sont maintenant achevées.
Je me félicite des engagements que vous avez pris, monsieur le secrétaire d'Etat. J'en ferai part personnellement aux élus, qui sont exaspérés, et à la population, qui est particulièrement en colère.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, auteur de la question n° 639, adressée à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Le calendrier est bien fait : je suis heureuse de poser cette question ce 8 mars, Journée internationale des femmes. C'est une journée non pas de commémoration, mais de lutte des femmes partout dans le monde, y compris en France.
La compagnie Air France impose aux hôtesses de l'air en mission en Iran le port du foulard et d'un vêtement ample à la sortie de l'avion.
La direction de la compagnie justifie cette contrainte et les sanctions pour non-respect de la règle de la manière suivante : « La tolérance et le respect des cultures et des coutumes de ces pays sont pour nous, depuis tous temps, des valeurs fondamentales et nous nous attachons à ce que la pratique du métier de personnel navigant s'inscrive dans ce cadre contextuel et contractuel. Comme tous les visiteurs étrangers, nos équipages sont tenus de respecter les lois du pays où ils se trouvent. »
Je ne conteste pas la nécessité de respecter les lois des autres pays. Je sais aussi que l'obligation de dissimuler leurs cheveux et leur corps est, hélas ! imposée à toutes les femmes en République islamique d'Iran et que celles qui luttent contre cette réalité de l'obscurantisme le font au péril de leur vie.
De quoi s'agit-il ? De la charia et de ses terribles régressions pour les femmes iraniennes ! Comment qualifier ces contraintes de « coutumes » ? Comment évoquer la « tolérance » ou les « valeurs fondamentales » ?
Les règles de la charia, c'est précisément l'intolérance, un recul dangereux des valeurs fondamentales que les peuples du monde se sont données.
En ce 8 mars, il serait juste et opportun de soutenir les citoyennes françaises qui refusent de porter le symbole de la soumission, de soutenir les hôtesses de l'air qui défendent ainsi leur dignité et, au-delà, celle de toutes les femmes.
J'ajoute que, cette année, notre pays célèbre le centenaire de la laïcité et réaffirme celle-ci comme l'une des valeurs de la République. La compagnie Air France s'honorerait de porter ces valeurs partout dans le monde.
A l'évidence, un autre aspect est très préoccupant : les hôtesses de l'air sont non pas des touristes, mais des salariées. Et la compagnie n'offre aux hôtesses refusant de porter le voile qu'une seule alternative : subir une retenue sur salaire ou être affectées sur des moyens courriers. Comment exiger un tel sacrifice de femmes, souvent jeunes et - ce que vous ne savez peut-être pas - mal rémunérées ? Comment leur demander de mettre ainsi en cause leur carrière ?
Il faut sortir de cette alternative ! C'est possible en mettant en oeuvre le principe du volontariat sur les lignes France-Iran. Ce principe a déjà été appliqué, par exemple lors de la guerre du Golfe. De même, sur les vols vers La Mecque, le personnel navigant est exclusivement masculin.
Une telle solution, proposée par le syndicat des cadres et techniciens de la confédération générale du travail, préserverait les intérêts de la compagnie et respecterait la dignité des hôtesses.
Madame la sénatrice, vous posez une question qui ne peut manquer de nous toucher tous, car il s'agit de réalités qui sont particulièrement difficiles à vivre pour les femmes concernées.
Je trouve, comme vous, que le texte d'Air France que vous avez cité est pour le moins maladroit, et j'ai bien l'intention de le faire observer au président de cette compagnie. Cela étant, il n'est pas exact de dire qu'Air France impose un certain nombre de règles à ses collaboratrices. Afin de tenir compte des réalités locales, Air France demande à son personnel féminin, lorsqu'il effectue un transit entre l'aéroport et l'hôtel, de se couvrir les cheveux avec un foulard et de porter des vêtements « amples » pour circuler en ville.
L'Etat iranien est un Etat souverain : il adopte les lois qu'il veut ! Celles-ci ne seraient évidemment pas de mise dans une démocratie comme la nôtre, mais elles sont une réalité en Iran. La législation iranienne ne fait aucune différence entre les ressortissantes iraniennes et les étrangères ; elle ne fait pas de différence non plus selon que l'on se trouve dans un cadre professionnel ou dans un cadre touristique.
La desserte de Téhéran par Air France, qui est souhaitable à d'autres points de vue, ne peut avoir lieu qu'à ce prix. Les autres compagnies européennes, qui desservent l'Iran depuis plus longtemps que nous, car elles n'ont pas interrompu leur liaison avec ce pays - Air France n'a repris ses vols vers Téhéran que depuis quelques mois -, respectent ces obligations locales, que je me garde bien de confondre avec des coutumes.
La direction d'Air France informe ses collaborateurs qu'ils sont soumis à des contraintes particulières quand ils sont affectés sur les vols desservant l'Iran. Et l'entreprise offre aux agents qui n'accepteraient pas ces règles locales - c'est leur droit le plus strict - des possibilités d'affectation non pas sur des moyens courriers, comme vous l'avez dit, madame la sénatrice, mais sur d'autres zones géographiques.
Le dispositif adopté par Air France me paraît convenable et protecteur des droits des salariés. Mais, je le répète, j'ai été, comme vous, madame la sénatrice, défavorablement impressionné, pour ne pas dire plus, par la rédaction adoptée par la compagnie.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie d'avoir dit que la justification avancée par la compagnie Air France n'était pas des plus habiles. Cela étant, il me paraît nécessaire de poser sérieusement la question du volontariat. En effet, à l'heure actuelle, les collaboratrices d'Air France qui refusent ces contraintes sont sanctionnées financièrement.
J'ajoute, afin de compléter votre information, monsieur le secrétaire d'Etat, que l'obligation et la sanction qui touchent les personnels que nous évoquons sont contraires à l'esprit du décret de 11 juillet 1991 : « Tout membre d'équipage doit s'abstenir d'exercer ses fonctions dès lors qu'il ressent une déficience quelconque de nature à lui faire croire qu'il ne remplira pas les conditions d'aptitude nécessaires à l'exercice de ses fonctions ».
Je veux également vous rappeler les mesures figurant dans le code du travail : toute disposition qui n'est pas intégrée dans le règlement intérieur doit faire l'objet d'une procédure de négociation préalable pour être éventuellement imposée. En l'occurrence, cette disposition relative aux salariés doit s'appliquer, puisqu'il ne s'agit pas de touristes qui sont libres de se rendre en Iran et de porter ou non le voile.
La moindre des choses serait que les salariées d'Air France aient une possibilité de choix. Il importe, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous évoquiez avec la compagnie le cas de celles qui n'acceptent pas les contraintes que nous évoquons, afin qu'elles soient affectées sur d'autres lignes et qu'elles ne subissent aucune sanction, financière ou autres.

La parole est à M. Serge Lagauche, auteur de la question n° 666, adressée à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Ma question concerne les conditions de transport aérien desservant l'outre-mer.
Entre 1998 et 2003, le prix du billet a augmenté de 28 % pour les Antilles et de 25% pour la Réunion, comme l'atteste le rapport d'information de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire de l'Assemblée nationale sur la desserte aérienne de l'outre-mer.
La crise du tourisme a conduit les tours-opérateurs à proposer des « packages » hôtel et vol à des prix très bas comparativement aux prix des vols secs, suscitant ainsi le mécontentement légitime des Domiens. D'autant que les transporteurs aériens s'appuient, en période de vacances scolaires, sur cette clientèle dite « captive » pour compenser la baisse du trafic touristique en basse saison. Le billet peut être trois fois plus cher en haute saison.
En outre, le transport aérien desservant l'outre-mer subit, de façon répétée, de graves incidents dus à l'âge et à la vétusté des appareils. La grande majorité des compagnies aériennes serait touchée par ce phénomène préoccupant.
Il faut dire qu'une grande partie des appareils utilisés sur ces lignes a plus de vingt ans, alors que l'âge moyen de la flotte hors outre-mer d'une compagnie comme Air France est de sept ans.
La compagnie Corsair est particulièrement concernée : en décembre 2004, pas moins de sept incidents y ont été répertoriés, dont deux le même jour, dus, pour l'essentiel, à des pannes moteur.
Quant à la compagnie Air Austral chargée des liaisons Paris-Saint-Denis, elle a eu à déplorer, elle aussi, des pannes de moteur sur deux de ses Boeing 777-200, à une semaine d'intervalle.
La compagnie Air France n'est pas pour autant dédouanée, mais il est particulièrement difficile d'obtenir des informations à son sujet.
Ces incidents graves et répétés laissent à penser aux usagers que leur sécurité est directement compromise par l'âge et la surexploitation des avions.
Or un remplacement par des appareils d'occasion plus ou moins âgés dans les années à venir n'est pas une solution satisfaisante pour sortir de cette situation particulièrement préoccupante.
Ces conditions de desserte de l'outre-mer constituant une atteinte au principe de continuité territoriale et à la libre circulation des Domiens, ma question sera très simple, monsieur le secrétaire d'Etat : quelles sont les mesures mises en oeuvre ou à venir pour remédier à cette situation dans les meilleurs délais ?
Monsieur le sénateur, le Gouvernement est, comme vous-même, très attentif aux conditions, notamment tarifaires, de la desserte aérienne des départements d'outre-mer. Cette déserte est vitale pour l'ensemble de nos compatriotes résidant dans ces départements et pour le développement économique de l'outre-mer.
Il est vrai que les tarifs ont récemment augmenté, mais cette augmentation résulte essentiellement de l'accroissement du prix du carburant, qui renchérit les coûts d'exploitation. Le Gouvernement ne demeure toutefois pas inactif face à cette situation, dont il ne peut se satisfaire.
Tout d'abord, grâce à la dotation de continuité territoriale de l'Etat, instituée par la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003, les collectivités d'outre-mer ont mis progressivement en place, sous leur responsabilité, des aides au passage aérien des résidents. La dotation prévue à cet effet s'élève, en 2005, pour l'ensemble de l'outre-mer, à 31 millions d'euros - dont 21 millions d'euros pour les départements d'outre-mer -, contre 30 millions d'euros en 2004.
Les régions ont décidé d'utiliser cette dotation pour faire bénéficier leurs résidents aux revenus modestes d'une réduction tarifaire significative : elle représente environ 30% du prix du billet.
Ces dispositifs de continuité territoriale porteront pleinement leurs fruits dans les prochains mois. Ils font d'ailleurs l'objet d'une réflexion constante visant à les améliorer de façon à répondre à la demande spécifique de certaines catégories de la population : je pense aux jeunes, mais aussi à ceux de nos compatriotes qui doivent envisager un retour dans leur département d'origine lorsqu'ils sont frappés par des drames familiaux.
S'agissant des Antilles et de la Réunion - ce n'est malheureusement pas le cas de la Guyane -, la concurrence entre trois opérateurs exerce une pression sur les prix, certes insuffisante, mais réelle. Le nombre de sièges offerts sur ces destinations a augmenté, ce qui est une bonne chose, en particulier pour l'économie locale.
Vous avez relevé, monsieur Lagauche, des incidents techniques. Tout d'abord, ces incidents ont affecté tant des avions récents que des avions plus anciens. Ce n'est donc pas l'âge des appareils qui est en cause. Ensuite, je tiens à vous le dire solennellement, à aucun moment la sécurité des passagers n'a été mise en danger.
Tous les avions exploités en transport public aérien dans notre pays sont soumis à des règlements très exigeants pour garantir la sécurité. Ainsi, tous les incidents évoqués ont fait l'objet d'analyses par les compagnies aériennes concernées. La Direction générale de l'aviation civile s'est assurée que, conformément aux procédures en vigueur, des mesures correctrices ont été prises.
Deux des compagnies desservant nos départements d'outre-mer ont prévu, à brève échéance, de rajeunir leur flotte en achetant des avions non pas d'occasion, mais neufs. On peut donc prévoir une amélioration dans les tout prochains mois. Vous le savez, la France est un pays qui ne transige jamais avec la sécurité aérienne.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le secrétaire d'Etat. J'espère que les Domiens apprécieront les efforts consentis en la matière.

La parole est à M. Daniel Goulet, auteur de la question n° 668, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

A l'heure où s'engage la réforme de l'éducation nationale et alors qu'un grand journal du soir a publié de multiples articles et titré l'un d'eux L'échec scolaire, le défi de l'éducation, je tiens à vous dire ma perplexité devant le foisonnement des entreprises privées qui dispensent des cours de soutien ou de rattrapage.
Je parle ici non pas des établissements qui, traditionnellement, préparent aux concours d'entrée des grandes écoles, mais d'entreprises qui s'adressent aux élèves du primaire et du secondaire.
La société Acadomia compte 65 agences et 78 000 élèves, les cours Legendre 18 000, et je pourrais également citer les entreprises KeepSchool ou Top Profs. Le réseau compte plus de 22 000 professeurs.
Le coût d'inscription est de 70 euros environ, alors que l'heure de cours est facturée entre 22 euros et 42 euros.
Si je n'ai pas de remarques à faire sur le développement des entreprises privées, l'ancien directeur d'école que je suis s'interroge surtout sur le bien-fondé des mesures d'accompagnement fiscales qui encouragent les parents à utiliser les services de ces entreprises.

En effet, les parents peuvent déduire de leurs impôts sur le revenu 50 % des sommes engagées, soit 6 000 euros, auxquels s'ajoutent 750 euros par enfant à charge, dans la limite de 7 500 euros.
De telles dispositions ne sont-elles pas de nature à encourager les parents à user des services parascolaires et à marquer une certaine défiance à l'égard du ministère chargé de l'éducation nationale et de ses enseignants ?
Par ailleurs, alors que l'école constitue le creuset de l'égalité républicaine et de l'intégration - le récent débat sur la laïcité a été l'occasion de le rappeler avec force -, ne pensez-vous pas que de telles dispositions sont de nature à rompre les valeurs de gratuité auxquelles nous tenons et d'égalité d'enseignement entre les élèves ?
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Monsieur le sénateur, tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de François Fillon, qui est retenu. Il m'a demandé de vous communiquer les éléments de sa réponse.
Les prestations marchandes de soutien scolaire bénéficient du principe de la liberté du commerce, fondé sur les lois, fort anciennes, des 2 et 17 mars 1791.
Lorsqu'elles sont effectuées à domicile, ces prestations bénéficient effectivement, sans discrimination aucune, comme toute activité de service aux personnes exercée au domicile des particuliers, du chèque-emploi service. C'est la loi ! Il est à noter que ce dispositif, qui relève du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, n'est pas nouveau : il existe depuis 1991 s'agissant des services émanant d'un particulier ou d'une association, et depuis 1996 pour ce qui est des services émanant d'une société.
Loin de se défausser sur les entreprises privées, l'institution scolaire n'est pas restée inactive en matière de soutien scolaire. Plusieurs dispositifs ont été mis en place au sein de l'école, afin d'aider tous les élèves qui rencontrent des difficultés et de les préparer à poursuivre leur scolarité dans les meilleures conditions possibles.
Ces mesures seront renforcées grâce à l'instauration d'un programme personnalisé de réussite scolaire ; c'est l'un des chapitres essentiels du projet de loi d'orientation pour l'avenir de l'école que le Sénat s'apprête à examiner. Le dispositif proposé permettra aux élèves des écoles et des collèges ayant des difficultés à maîtriser ce que l'on appelle le socle des connaissances indispensables d'obtenir un accompagnement de trois heures de soutien par semaine.
Monsieur le sénateur, que l'initiative privée propose une offre de soutien ou de rattrapage aux élèves en difficulté, c'est un fait et c'est une liberté. Mais parce qu'il revient à l'Etat républicain d'affirmer haut et fort le principe d'égalité des chances, l'école a le devoir de garantir à ces mêmes élèves les mesures d'accompagnement adéquates. C'est aujourd'hui une réalité, mais ce sera encore plus le cas demain !

Monsieur le secrétaire d'Etat, votre réponse ne saurait me satisfaire. Comme je l'ai précisé, je ne suis pas contre les textes de loi qui autorisent certaines entreprises à concevoir des formules d'enseignement de rattrapage ou de soutien. Ma question visait à attirer l'attention du Gouvernement sur le fait que ces sociétés bénéficient de mesures fiscales, car je ne peux pas comprendre cet état de fait.
Comme vous pouvez l'imaginer, monsieur le secrétaire d'Etat, je donnerai une suite à cette question.

En outre, si le Gouvernement doit maintenir sa volonté de consentir des déductions fiscales, je compléterai mon intervention en vous indiquant ce qu'ont imaginé nos amis canadiens en la matière : ils ont octroyé des déductions fiscales pour encourager les séjours linguistiques. C'est une voie qui mérite d'être explorée.

La parole est à Mme Bariza Khiari, auteur de la question n° 654, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Ma question concerne les conséquences de la délocalisation du Centre national de documentation pédagogique, le CNDP, à Chasseneuil-du-Poitou.
Manifestement, le choix du nouveau site ne s'inscrit pas dans une réflexion cohérente d'aménagement du territoire. Cette décision non concertée a entraîné une perte d'emplois importante en Ile-de-France et a abouti à un démantèlement des missions de service public confiées au réseau du CNDP.
Depuis deux ans, les élus parisiens et les représentants syndicaux n'ont cessé d'alerter le ministre de l'éducation nationale sur les dysfonctionnements dus à la première vague de délocalisations : les services sont écartelés entre des sites distants de 350 kilomètres, les équipes sont dispersées et, plus grave, les services aux usagers sont interrompus. Par ailleurs, des agents devant être reclassés en raison du transfert de leur poste n'ont pas eu droit à un traitement digne et équitable.
Alors que le nouveau projet d'établissement pour le CNDP et les centres régionaux est encore en cours d'élaboration et qu'aucune localisation future des actuels services parisiens n'est décidée, un nombre croissant de postes est transféré à Chasseneuil-du-Poitou, émiettant ces services et perturbant ainsi gravement le fonctionnement de l'établissement.
La crise était telle qu'au printemps dernier le ministre a chargé M. Pierre Dasté d'une mission de médiation afin de trouver une issue au blocage.
Le Médiateur a, dans un premier temps, pu apaiser le climat social en obtenant que soit différé d'un an le transfert, prévu le 1er septembre 2004, d'une cinquantaine de postes occupés notamment par des personnels contractuels et des enseignants mis à disposition. Mais, depuis plusieurs mois, les facteurs de tension se multiplient de nouveau à l'extrême.
De plus, à défaut de voir ses préconisations suivies par la direction du CNDP, le Médiateur a abandonné sa mission.
Récemment, les représentants du personnel du CNDP regroupés en intersyndicale ont proposé un projet alternatif au projet de la direction actuelle du CNDP.
Je sais que M. le ministre de l'éducation nationale est très occupé aujourd'hui, mais je souhaite qu'il précise les dispositions qu'il entend prendre, d'une part, pour apaiser le climat social qui règne au sein du CNDP, et, d'autre part, pour intégrer les propositions du projet alternatif présenté par le personnel, projet visant à sauvegarder les emplois des contractuels franciliens et, surtout, à permettre au réseau du CNDP de mener sa mission essentielle auprès des communautés éducatives. Car les enseignants ont plus que jamais besoin de disposer d'outils fiables et accessibles pour mener une mission réellement émancipatrice, qui va au-delà de l'instruction.
Madame la sénatrice, je vous remercie d'avoir bien voulu excuser par avance l'absence de François Fillon. Je vous communique sa réponse.
La décision de transférer le CNDP à Chasseneuil-du-Poitou, choix retenu par le Comité interministériel pour l'aménagement et le développement du territoire du 13 décembre 2002, s'inscrit dans la continuité des politiques de délocalisation des établissements publics menées depuis plus de dix ans, tous gouvernements confondus.
La présence sur le site du Futuroscope de l'Ecole supérieure de l'éducation nationale et du Centre national d'enseignement à distance constitue un atout pour une action concertée entre ces trois établissements.
L'arrêté de transfert a été pris le 26 juin 2003. Le transfert progressif des services est en cours depuis le mois de septembre 2003.
Contrairement à ce que vous avez dit, madame la sénatrice, ce transfert n'a pas été décidé froidement dans je ne sais quel bureau parisien. Il s'est accompagné d'une concertation permanente non seulement au sein des instances réglementaires, telles que le comité technique paritaire ou le conseil d'administration de l'établissement, ce qui est tout à fait normal, mais également avec les organisations syndicales, qui ont été régulièrement invitées à s'exprimer.
En outre, la mission du Médiateur a été renouvelée et recentrée sur l'accompagnement et le reclassement des personnels concernés.
Un travail approfondi est mené par le Médiateur, en liaison avec la direction et les services administratifs du CNDP, afin que les personnels qui souhaitent rejoindre la Vienne puissent y être accueillis dans les meilleures conditions possibles. Des mesures concrètes sont prises à cet effet. De même, s'agissant des agents qui ne souhaitent pas suivre le CNDP, le Médiateur est chargé de chercher le meilleur reclassement possible en tenant compte de l'expérience et des compétences acquises.
Enfin, le dialogue est maintenu avec les organisations représentatives du personnel. Celles-ci ont été invitées à faire part de leurs remarques et de leurs propositions sur le document de travail qui doit servir de base au projet de l'établissement, afin que ce dernier continue - c'est notre souhait à tous ! - d'assurer ses différentes et importantes missions tout en tenant compte de sa nouvelle implantation.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le secrétaire d'Etat, mais vos propos ne sont pas satisfaisants dans la mesure où le CNDP est en ébullition. Je me suis rendue sur place et j'ai pu constater, en discutant avec le personnel et avec l'intersyndicale, que les choses ne vont pas aussi bien que vous le dites.
Si la mission du Médiateur a été recentrée, c'est à la suite de sa démission, je tenais à le préciser.
En l'état actuel des choses, je me permets de vous suggérer quelques éléments de sorties de crise, puisque crise il y a au CNDP, que vous pourrez utilement transmettre à M. le ministre de l'éducation.
Tout d'abord, le dossier doit être repris par le ministère de tutelle, celui de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ensuite, la restauration de l'autorité du Médiateur doit être effective. Par ailleurs, il convient que le projet concernant le personnel du CNDP soit pris en compte, puisqu'un projet alternatif a été déposé par l'intersyndicale. Enfin, en attendant un audit social, culturel et financier, rien d'irréversible ne doit être décidé ni exécuté.

M. le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, pour les délocalisations, Marseille peut concourir avec Chasseneuil-du-Poitou.
Sourires

La parole est à M. Gérard Delfau, auteur de la question n° 664, adressée à Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées.

Ma question concerne l'élargissement de l'usage des places bleues de stationnement réservées aux personnes handicapées. En effet, ces places sont largement sous-utilisées, alors que de très nombreuses personnes handicapées ou à mobilité réduite ne peuvent y accéder.
Ce constat conduit quelques associations à demander un élargissement du droit d'accès au-dessous du taux d'invalidité de 80 %. D'autres associations font valoir le risque de banalisation de ces places que comporterait une telle mesure. Elles s'inquiètent, en outre, des manquements répétés à cette signalisation par des personnes valides. Elles s'étonnent, par ailleurs, que les infractions soient trop souvent non sanctionnées. Elles estiment, enfin, que la situation de grand handicap n'est pas suffisamment reconnue et traitée par des mesures spécifiques dans notre société. C'est d'ailleurs l'objet de la loi qui vient d'être votée par le Parlement.
Il m'a semblé utile, madame la secrétaire d'Etat, de soumettre à votre réflexion ces deux positions et de vous demander si vous n'envisagez pas de revoir, maintenant que la loi est votée, la réglementation concernant le stationnement sur ces places dites « bleues ». Cette question suscite, en effet, de nombreuses interrogations. En tout cas, il est nécessaire que la position des pouvoirs publics soit réaffirmée.
Monsieur Delfau, en l'état actuel de la réglementation, la carte européenne de stationnement, qui a remplacé, depuis le 1er janvier 2000, le macaron GIC, grand invalide civil, peut être attribuée par le préfet, sur leur demande, aux personnes qui sont titulaires de la carte d'invalidité et dont le taux d'invalidité est au moins égal à 80 %, après examen de leur situation. Les personnes titulaires de la carte « station debout pénible » ne peuvent donc y prétendre.
Aux termes de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, en ce qui concerne le droit de stationnement réservé aux personnes handicapées, les maires avaient reçu la possibilité d'accorder aux personnes titulaires de la carte « station debout pénible » une autorisation de stationner, dans leur commune, sur les emplacements réservés aux personnes handicapées.
Il est apparu, dans le cadre de la réflexion conduite sur la simplification des démarches administratives, que ces nouvelles dispositions pouvaient se révéler d'application complexe pour les maires, les services chargés de les mettre en oeuvre et les usagers, dans la mesure où l'autorisation de stationnement n'était valable que pour une seule et même commune.
Le Gouvernement a donc proposé au Parlement, dans le cadre de la discussion du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d'adopter un nouveau système permettant d'autoriser la délivrance d'une carte de stationnement à une personne handicapée, de manière générale, lorsque son état de santé le nécessite.
C'est ainsi que la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, que le Parlement vient d'adopter, modifie, en son article 65, un article du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne [...] atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. »
Le même article prévoit également que les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir une telle carte.
Monsieur le sénateur, les conditions d'application de ces dispositions, qui répondent, me semble-t-il, non seulement à vos attentes de simplification et de clarification, mais également à votre souhait de faire valoir le droit des usagers et de le voir respecter, seront très prochainement fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ainsi, nous entrerons, si je puis dire, dans une nouvelle ère d'application de ce type de réglementation.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Madame la secrétaire d'Etat, je souhaitais, d'abord, que vous rappeliez très précisément ces dispositions, ensuite, que vous preniez l'engagement - ce que vous venez de faire, m'a-t-il semblé - que le décret soit pris prochainement. Il nous faudra tester ensemble cette nouvelle étape, car l'application des mesures qui ont été adoptées ne sera pas simple.
Il ne faudrait pas que les personnes en situation de grand handicap soient, en fin de compte, victimes de la nécessaire expérimentation de l'élargissement de ce droit.

La parole est à M. Louis Souvet, auteur de la question n° 652, adressée à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Même s'il est coutume d'évoquer - on vient de l'entendre à de nombreuses reprises, lors de cette séance des questions orales - des problèmes locaux d'infrastructures en tout genre, je n'abuserai pas de cette tribune pour polémiquer sur le site médian du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard ; cela n'aurait pas un très grand intérêt pour mes collègues ici présents. Sachez toutefois que les parlementaires du pays de Montbéliard feront preuve d'une extrême vigilance.
De vigilance, il doit en être question pour le dossier que j'aborderai aujourd'hui : la situation des chirurgiens dans les hôpitaux publics. Pourquoi, pourriez-vous m'objecter, opposer deux composantes d'un système de santé ? Je n'ai pas l'habitude d'aborder ainsi les problèmes, mais les contraintes auxquelles sont confrontés les chirurgiens des centres hospitaliers, la spécificité de leur situation, méritent amplement que je fasse une exception à cette règle de conduite.
Un tel état de fait non seulement affecte les conditions de travail au sein des blocs opératoires, mais réduit également le nombre d'opérations. Ce fonctionnement au ralenti engendre des délais d'attente pour les patients. S'ajoutent des distorsions relatives à la répartition territoriale des chirurgiens, donc à l'offre de soins au niveau national.
Reconnaître les astreintes du métier de chirurgien des hôpitaux, c'est se donner les moyens de traiter, à la base, ce dossier. Cette reconnaissance doit s'insérer dans une large palette de mesures : elles vont de la réorganisation de la formation chirurgicale de troisième cycle, en passant par les conditions de participation à la permanence chirurgicale. La mise en place de la réduction du temps de travail a en effet pesé particulièrement sur les services chirurgicaux compte tenu des spécificités temporelles et techniques.
Il suffit de reprendre les statistiques pour constater objectivement que l'activité chirurgicale d'urgence est, en très grande majorité, assurée dans les centres hospitaliers, avec les contraintes en matière de garde que cela suppose en termes à la fois de présence et de responsabilités.
Tout d'abord, les responsabilités sont multiples du fait non seulement de la non-délégation des actes chirurgicaux, mais également du suivi quotidien des suites chirurgicales et des opérations ultérieures qui se révéleraient nécessaires.
Ensuite, les responsabilités, au sein de l'équipe chirurgicale, se concentrent, compte tenu de la nécessaire personnalisation de l'acte, sur le chirurgien.
Enfin, les responsabilités sont accrues du fait de la pénurie, car pénurie il y a dans les blocs opératoires, les effectifs n'étant pratiquement jamais complets en raison de l'application de la réduction du temps de travail.
Les hôpitaux doivent gérer une pénurie chronique d'infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat. Je citerai juste un chiffre pour illustrer l'ampleur du phénomène : à un concours d'entrée en école d'IBODE, le nombre de candidats s'élevait à 74 unités pour 105 places.
On peut dès lors comprendre les conditions de travail particulièrement pénibles des infirmières ou infirmiers et des chirurgiens confrontés à ces sous-effectifs. A l'exigence propre de leur spécialité s'ajoutent des contraintes supplémentaires. Le résultat est logique. Les chiffres le prouvent : 40 % des chirurgiens ayant débuté à l'hôpital n'y exercent plus au bout de dix ans. Dans un métier où l'expérience constitue un facteur déterminant, ce turn-over n'est pas à prendre à la légère. Il se conjugue malheureusement avec le non-remplacement des chirurgiens partant à la retraite.
Ces multiples problèmes affectant la chirurgie dans le secteur public hospitalier, il convient de les envisager et de les traiter le plus en amont possible, c'est-à-dire au niveau du recrutement, en rendant son attractivité à une filière valorisée et valorisante au sein du cursus médical.
Devra être augmenté, de façon significative, le nombre des internes en chirurgie, avec la capacité, en dernière année, de participer à la permanence des soins chirurgicaux ; il est nécessaire de reconstituer des équipes opératoires complètes.
Dans un excellent article intitulé Lettre à un de mes anciens élèves, le professeur Bernard Debré le rappelle : les chirurgiens ne recherchent ni des remerciements ni même la gloire, si mince soit-elle ! Pour autant, nous nous devons de leur permettre d'exercer leurs responsabilités dans les conditions les plus satisfaisantes possibles. Ils doivent également pouvoir se concentrer sur leur pratique, qui nécessite une formation et une remise à niveau permanentes. Je me mets à la place d'un étudiant en médecine : à l'heure actuelle, compte tenu de toutes les contingences matérielles que je viens d'évoquer, il ne s'interrogera même pas sur la durée de sa carrière de chirurgien au sein d'un centre hospitalier. Il ne choisira tout simplement pas cette voie !
Je n'attends pas de solutions miracles : je suis réaliste ! Mais je souhaite savoir si une réforme prenant en compte la globalité d'une telle problématique permettra de mettre fin à ce qui s'apparente à une crise de la vocation s'agissant de la chirurgie.
Je pourrais poursuivre cette énumération, mais je ne me situe pas dans une quelconque logique de défense d'un pré carré corporatiste : je dresse seulement le constat d'une situation alarmante tant pour les praticiens que pour les patients actuels et à venir.
Monsieur le sénateur, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille a déjà rappelé, à plusieurs reprises, son attachement à soutenir et à accompagner la chirurgie hospitalière française. Cette volonté s'est traduite, en janvier dernier, par un accord avec les représentants du collectif Chirurgie hôpital France, dont je rappellerai les cinq mesures majeures.
La première mesure concerne la démographie des chirurgiens. Une « commission opérationnelle », demandée par les chirurgiens et créée au sein du ministère des solidarités, de la santé et de la famille, est chargée, d'ici à la fin de l'année et en liaison avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur, de formuler des propositions sur la formation des internes et sur les modalités d'évaluation de cette dernière. Par ailleurs, le nombre de postes d'internes en chirurgie progressera de manière significative dès la rentrée 2005 : l'objectif est fixé à 550 postes, contre 450 à la rentrée 2004.
La deuxième mesure porte sur la réorganisation des plateaux techniques. Une cellule « haute technologie », placée sous l'égide du ministre des solidarités, de la santé et de la famille, a également été créée. Associant la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, la DHOS, la mission d'appui à l'investissement national hospitalier, la MAINH, et le Conseil national de la chirurgie, elle proposera au ministre un véritable plan de modernisation des blocs opératoires, pour en favoriser l'équipement en matière de haute technologie et en optimiser l'organisation territoriale.
La troisième mesure a trait au statut des praticiens hospitaliers. Les négociations avec les quatre organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers se poursuivent sur la base de trois objectifs : la revalorisation des astreintes, l'instauration d'une part variable de rémunération dépendant, notamment, de la pénibilité des exercices, et l'adaptation du statut. Le protocole d'accord, qui est en cours de négociation, mettra prioritairement l'accent sur la chirurgie et la psychiatrie, et ce dès cette année.
La quatrième mesure concerne les équipes opératoires. Pour mieux prendre en compte les conditions de travail dans les blocs opératoires - organisation, coordination des activités et exercice des différents métiers -, la DHOS réunira, d'ici à la fin du mois, deux groupes de travail : l'un associera des représentants des équipes chirurgicales, c'est-à-dire les chirurgiens, les infirmières de bloc opératoire et les internes, et l'autre les équipes d'anesthésie, à savoir les anesthésistes réanimateurs, les infirmières anesthésistes et les internes. Après intégration des travaux en cours du Conseil national de la chirurgie, ces groupes auront pour mission de soumettre au ministre des propositions d'amélioration du fonctionnement des blocs opératoires d'ici à la fin du mois de mai prochain.
La cinquième et dernière mesure porte sur les dispositifs médicaux. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la tarification à l'activité, le ministre chargé de la santé a décidé de financer en dehors des tarifs d'hospitalisation certains dispositifs médicaux, notamment les prothèses orthopédiques. Cet acquis important pour les hôpitaux doit soutenir l'activité de chirurgie à l'hôpital public et dans les hôpitaux participant au service public hospitalier. Une évaluation sera réalisée cette année avec les professionnels concernés.
Vous le voyez, monsieur le sénateur, les pouvoirs publics ont pris la mesure des difficultés de la chirurgie, et ils s'attachent, par des mesures concrètes, datées et donc mesurables, à mettre en oeuvre les décisions qui s'imposent.

Madame la secrétaire d'Etat, je vous remercie de votre réponse. J'espère que les cinq mesures majeures que vous venez de décrire largement produiront leurs effets. Actuellement, notre pays souffre d'une pénurie de chirurgiens, préjudiciable à la fois à l'organisation du travail au sein de l'hôpital, à ceux qui y travaillent et, bien sûr, aux malades eux-mêmes.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, auteur de la question n° 662, adressée à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Je souhaite attirer l'attention du ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la reconnaissance du statut d'ostéopathe prévue par l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Cet article avait suscité de très longs débats dans cet hémicycle et les décrets d'application sont attendus avec impatience. Afin d'en préparer la rédaction, un groupe de réflexion sur les conditions d'exercice et de formation de cette profession, comprenant les organisations représentatives d'ostéopathes, s'est réuni à plusieurs reprises entre septembre 2003 et février 2004.
La concertation s'est interrompue et, depuis, aucune information officielle sur les orientations du ministère chargé de la santé n'est parue. Il semble que cette suspension soit liée à des désaccords entre les principales directions concernées par le sujet de l'ostéopathie. En effet, si la DHOS est consciente de la nécessité de maintenir l'accès direct des usagers aux ostéopathes, la direction générale de la santé y serait, pour sa part, opposée.
Cette divergence de vue place les patients des ostéopathes dans une situation de plus en plus délicate, à un moment où l'article 75 a entraîné une explosion du nombre d'installations de praticiens dont la formation et le type d'exercice ne sont pas toujours identifiables. Par ailleurs, l'inflation du nombre de centres de formation en ostéopathie ne présentant pas de garanties qualitatives est considérable et place de nombreux étudiants dans une situation potentiellement précaire.
Les organisations représentatives d'ostéopathes se sont fortement impliquées dans un processus de réglementation de leur profession, nécessaire au regard des droits des malades et de la qualité du système de santé. Elles se sont, de ce point de vue, montrées légitimistes et détentrices du savoir-faire dans le domaine de l'ostéopathie. Elles ne comprendraient pas de ne pas être entendues sur le modèle réglementaire qu'elles préconisent.
C'est pourquoi je souhaite connaître la position du Gouvernement sur l'accès direct des patients à l'ostéopathie, sur le modèle de formation qui sera mis en place et, surtout, sur l'état d'avancement des textes d'application d'une loi qui, je le rappelle, a fêté son troisième anniversaire vendredi dernier.
Monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur les décrets d'application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002, qui a reconnu le titre d'ostéopathe et a prévu de définir les conditions de formation de ces professionnels et leurs conditions d'exercice.
Il s'agit, pour l'Etat, de garantir aux personnes qui ont recours aux ostéopathes une sécurité et une qualité des pratiques, en s'assurant que ces professionnels ont reçu une formation adéquate.
La loi du 4 mars 2002 a été promulguée voilà plus de trois ans et il n'est pas bon, en effet, que ses principaux textes d'application n'aient pas été publiés. La reconnaissance du titre d'ostéopathe, sans les décrets qui doivent en préciser le contenu en termes de formation, laisse un vide juridique propice à un usage abusif de ce titre et à la création d'écoles sans contenu pédagogique validé.
Tant la durée souhaitable de la formation des ostéopathes - aujourd'hui, elle est souvent de six ans - que l'articulation de cette formation avec celle des masseurs-kinésithérapeutes, notamment, continuent à faire débat. Le ministère a entrepris, depuis maintenant deux mois, des consultations avec l'ensemble des organisations des professionnels concernés, afin de dégager sur ces sujets des options claires, qui garantiront la qualité de la prise en charge.
Cette phase de consultations se termine. Le Gouvernement entend, en tout état de cause, prendre les décrets d'application permettant de mettre en oeuvre cet article 75 dans un délai de six mois. C'est la date que je peux, à ce jour, officiellement vous communiquer, monsieur le sénateur.

Je vous remercie, madame la secrétaire d'Etat, de ces précisions. Ce terme de six mois semble un délai maximum, car, au bout de trois ans, il est nécessaire que soient publiés les décrets d'application de la loi.

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à seize heures.