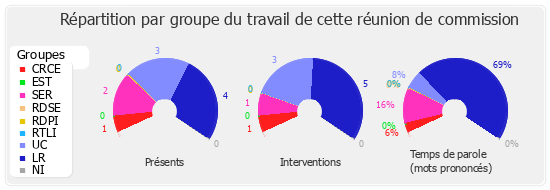Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation
Réunion du 19 mai 2021 à 10h05
Sommaire
- Coûts et avantages de la syndication
- « finance durable »
- Audition de m. thierry déau président de finance for tomorrow mme anuschka hilke directrice du programme « institutions financières » de l'institute for climate economics i4ce m. anthony requin directeur général de l'agence france trésor et mme laurence scialom professeure d'économie de l'université paris nanterre (voir le dossier)
La réunion

Nous commençons notre ordre du jour par une communication de notre collègue Jérôme Bascher, rapporteur spécial de la mission « Engagements financiers de l'État » sur les coûts et les avantages de la syndication.

C'est un sujet technique que je vous propose ce matin avec la syndication, une technique d'émission de la dette publique. L'Agence France Trésor (AFT), chargée de la gestion de la dette de l'État, est animée par un double objectif : que les titres de la dette française trouvent preneur - afin de couvrir nos besoins de trésorerie et de financement - et à moindre coût, dans les conditions les plus favorables possibles pour le contribuable - afin que la charge de la dette soit la moins élevée possible.
Avant de vous présenter les caractéristiques de la syndication, qui diffèrent de celles de la méthode classique d'émission par adjudication, un rappel sur la spécificité des titres de dette publique. Imaginons un particulier qui souhaite faire un prêt, il emprunte une somme donnée sur 20 ans à un coût de 2 % et il connait très exactement le coût de son produit. Pour la dette publique, c'est différent. Prenons là-aussi un exemple théorique, l'État va émettre 100 avec un coupon (un intérêt) de 0,5 %. Le prix payé par les souscripteurs pourrait très bien ne pas être de 100, mais être de 99 ou 101 selon le contexte de taux. C'est important parce qu'il faut bien se rappeler que les obligations assimilables du Trésor (OAT), les titres à moyen et long terme de la dette française, s'inscrivent dans un marché financier, il y a une offre et une demande.
Quand l'État émet des titres par adjudication, ce sont les spécialistes en valeur du Trésor (SVT), les 15 banques sélectionnées pour être les partenaires privilégiées de l'AFT, qui vont venir acheter les titres, sur ce marché primaire. Ils les portent donc dans leur bilan, avant de les revendre aux investisseurs intéressés sur le marché secondaire, là où ces titres s'échangent. Les détenteurs de dette peuvent être des assureurs, des gestionnaires d'actifs ou encore des hedge funds, des résidents français comme des non-résidents. Dans une opération d'adjudication, la Banque de France apporte un soutien technique et les SVT ne sont pas rémunérés. J'ai eu l'opportunité d'assister en direct à une adjudication et c'est très impressionnant : en moins d'une heure, plus de 10 milliards d'euros sont émis et répartis entre les souscripteurs. Les offres dont les prix sont les plus élevés sont servies en premier, chaque SVT payant donc des prix différents, correspondant aux prix demandés, pour les quantités demandées. Le prix moyen pondéré n'est donc connu qu'à la fin de l'opération.
En syndication, le déroulement de l'opération et les rôles de chacun sont différents. Commençons par les SVT, dont je rappelle ici qu'ils sont sélectionnés pour trois ans, le prochain renouvellement ayant lieu à l'automne prochain, pour la période 2022-2024. Ces SVT se rassemblent dans un syndicat bancaire, avec un rôle particulier pour les cinq établissements désignés « chefs de file ». Dans une syndication, les SVT ne sont plus acheteurs directs des titres mais garants. Ils vont servir d'intermédiaire entre l'émetteur (l'AFT) et les investisseurs finaux, à qui ils doivent faire souscrire une part de la dette, en développant aussi des stratégies de vente pour ces produits, comme ce fut le cas pour le lancement de la première OAT verte par exemple. Si jamais l'un des investisseurs venait à faire défaut, le SVT concerné prendre le papier à son compte. Il y a par ailleurs des échanges en amont de l'opération entre l'AFT et les SVT pour juger de l'appétence du marché pour le produit émis par syndication et à quel prix. Les titres sont en effet acquis par les souscripteurs au prix défini avec l'émetteur, contrairement à une adjudication. Il y a donc une négociation. Dernière spécificité, dans une syndication, les SVT sont rémunérés par l'AFT, avec le versement de commissions. Si la grille de rémunération est confidentielle, le montant total des commissions et frais encourus au titre de la gestion de la dette est connu : 27,5 millions d'euros en 2020, pour trois syndications.
Je vous l'ai indiqué, la France n'émet qu'une part minoritaire de ses titres par syndication, tout comme l'Allemagne, qui, avant 2020, n'avait plus eu recours à cette technique d'émission depuis 2015. A contrario, des plus petits émetteurs, comme la Slovénie ou le Portugal, ont au contraire couvert respectivement 100 % et 48 % de leur programme de financement net par des syndications. Passer par une syndication est un moyen plus sûr pour les pays plus petits ou plus fragiles de pouvoir placer les montants souhaités.
La France, comme les plus grands émetteurs souverains, réserve la syndication à l'émission de titres pour lesquels la demande et, surtout, le prix sont moins connus. Il s'agit notamment des produits innovants, tels la création d'une OAT verte, ou encore les titres de maturité très élevée, de 30 à 50 ans. En l'absence de référence, il est préférable de passer par cet échange direct entre l'émetteur et les investisseurs finaux. Pour les titres plus « classiques », de deux à vingt ans pour les OAT nominales, les prix sont bien connus et les adjudications se déroulent selon un calendrier précis et prédéterminé. Il n'y a pour ces produits que peu d'incertitudes sur le prix et la demande, qui plus est au regard des montants émis par la France, qui fait partie des plus gros émetteurs de dette en volume.
Les syndications conduites par la France en 2020 et en ce début d'année se sont déroulées dans de très bonnes conditions, avec des taux de rendement à des niveaux historiquement bas et surtout des taux de couverture extrêmement élevés. Ainsi, les montants inscrits sur le livre d'ordres, qui retrace la demande des investisseurs finaux, étaient près de 10 fois plus élevés que le montant émis lors du lancement de la nouvelle OAT à 50 ans. Les investisseurs demandaient 75 milliards d'euros, l'AFT en a servi sept. Dans ces conditions, certains estiment que la France devrait profiter de ce contexte pour allonger très fortement la maturité de sa dette en émettant de manière beaucoup plus fréquente des titres de maturité très élevée. Je veux tout de suite clarifier les choses : ce n'est pas la bonne solution et cela pourrait même être très dangereux pour la qualité de la dette française.
Cette proposition s'appuie en effet sur une lecture déformée du livre d'ordres, du fait du phénomène de surenchère (overbidding) de la part des investisseurs. Ce phénomène s'observe dans plusieurs pays et traduit la tendance des investisseurs, notamment les plus opportunistes d'entre eux, à demander des montants très élevés lors des syndications en anticipation de la dilution de leurs ordres lors de l'allocation finale par l'émetteur. Le but de ces investisseurs c'est de revendre rapidement les titres acquis pour réaliser un bénéfice ; ce ne sont donc pas les investisseurs les plus privilégiés lors des syndications. En effet si, dans une adjudication, les investisseurs finaux ne sont pas connus, dans une syndication, l'AFT peut optimiser l'allocation des titres en fonction de la nature des investisseurs. Ce n'est toutefois bien qu'une image à un instant donné, les titres pouvant être immédiatement revendus après l'allocation.
Ce sujet sur les syndications m'a donc conduit à m'interroger d'une part sur l'allongement de la maturité de la dette et d'autre part sur l'émission de nouvelles obligations thématiques pour traiter de la hausse de l'endettement public. J'ai répondu sur l'allongement de la maturité, une impasse. La maturité de la dette française est par ailleurs supérieure à la moyenne OCDE, dans la fourchette haute, à 8,2 ans. Loin devant se situe le Royaume-Uni, à plus de 15 ans, mais pour des raisons très spécifiques, liées au poids des fonds de pension, du fait de la gestion du système de retraite britannique. Ces acteurs demandent des titres de maturité élevée et concentrent par ailleurs leurs investissements sur le segment obligataire.
Pour conclure, il me semble qu'il me faut plutôt conserver les modalités actuelles d'émissions de la dette, avec une prédominance des adjudications, en réservant les syndications pour les produits « rares » que sont par exemple les produits innovants ou de très longue maturité. Ces opérations coûtent plus chères et il ne serait pas dans notre intérêt de bouleverser notre modèle.

Je remercie le rapporteur pour la synthèse qu'il a offerte sur une question complexe. Les éclaircissements qu'il vient d'apporter permettront de mieux appréhender les thématiques de la table ronde qui va suivre, qui concerne les obligations vertes.

Ma première remarque vise à rappeler qu'à la différence du Royaume-Uni, où l'agence d'émission de la dette publique est située dans la City, l'Agence France Trésor est localisée au sein même de Bercy. Je me suis intéressé à la composition du comité stratégique de l'AFT, qui ne compte pas de représentant de l'administration ou du Gouvernement mais essentiellement des banquiers et des profils financiers. Comment expliquez-vous cette composition ?
Par ailleurs, alors que la demande des titres de dette français sur le marché secondaire est très forte, les spécialistes en valeur Trésor, qui achètent les titres sur le marché primaire, les revendent très rapidement. Cependant, qu'advient-il des titres une fois ces derniers revendus sur le marché secondaire ? On nous dit en effet qu'il n'est pas possible de connaître précisément les détenteurs de notre dette. N'y a-t-il pas là un danger ?
Enfin, quels sont les critères permettant de sélectionner les spécialistes en valeur Trésor ? Vous avez évoqué la rémunération des SVT en 2020 en indiquant que le détail de celle-ci était confidentiel. Le montant total est-il public ?

Pouvez-vous nous préciser la différence entre la prime d'émission et le taux applicable aux obligations ?

Je souhaite compléter la question de notre collègue Éric Bocquet en interrogeant le rapporteur sur le profil et l'origine des principaux spécialistes en valeur du Trésor. Quels sont les principaux SVT et existe-t-il un noyau dominant ?

Je vais d'abord clarifier mon propos pour répondre à Arnaud Bazin : il y a bien un lien entre le prix et le taux, les deux évoluant à l'inverse l'un de l'autre. Cela me permet de rappeler qu'en 2020, le taux moyen à l'émission des SVT était de - 0,13 %, un niveau inédit.
Le comité stratégique de l'AFT est composé de connaisseurs du marché, ce qui est logique puisqu'il est chargé d'assister l'AFT dans sa gestion de la dette de l'État, de la conseiller sur les grands axes de la politique d'émission de l'État. L'AFT dispose d'ailleurs à Bercy d'une véritable salle de marché.
Parmi les SVT, on trouve d'abord des grands établissements, français comme étrangers, à l'image de BNP Paribas, de HSBC, du Crédit agricole, de JP Morgan ou encore de la Société générale, pour reprendre les cinq premiers du classement des SVT publié chaque année par l'AFT. En cas de non-respect de la charte des SVT, leur statut peut être suspendu, ce qui a été le cas pour Morgan Stanley pendant trois mois. À cette suspension s'ajoute également une sanction réputationnelle pour les SVT qui ne respecteraient pas les règles déontologiques qui leur sont applicables.
Par ailleurs, si les SVT se plaignent souvent des coûts que représente pour eux cette activité et en particulier les adjudications, ce statut ne va pas sans bénéfices. Ils peuvent par exemple être choisis par d'autres émetteurs pour les accompagner dans leurs propres opérations. En France, les agences publiques ou les banques publiques de développement procèdent ainsi par syndication, à l'instar de la SFIL, filiale de la Caisse des dépôts, dont j'ai entendu le directeur dans le cadre de ce contrôle.

Une dernière question : avez-vous constaté un effet du Brexit sur la gestion de la dette ?
La commission autorise la publication de la communication de M. Jérôme Bascher, rapporteur spécial, sous la forme d'un rapport d'information.
« finance durable »
Audition de M. Thierry Déau président de finance for tomorrow Mme Anuschka Hilke directrice du programme « institutions financières » de l'institute for climate economics i4ce M. Anthony Requin directeur général de l'agence france trésor et Mme Laurence Scialom professeure d'économie de l'université paris nanterre

S'il fallait trouver un mérite à la crise sanitaire que nous traversons depuis maintenant plus d'un an, ce serait sans doute de nous faire prendre conscience de la grande fragilité de nos systèmes économiques et sociaux. De ce point de vue, alors que 2020 aura été l'année la plus chaude enregistrée depuis les premiers relevés en 1850, la crise écologique représente une menace plus grande encore, qui nous impose de transformer en profondeur nos modes de production et de vie.
Le secteur financier constitue naturellement un élément décisif des mutations à venir, compte tenu du rôle majeur qu'il joue pour orienter les financements. Pour ne donner qu'un chiffre, la Commission européenne estime que 260 milliards d'investissements « verts » supplémentaires sont nécessaires chaque année pour que l'Union européenne atteigne ses objectifs climatiques en 2030.
Dans ce contexte, la France a jusqu'à présent joué un rôle moteur en matière de finance durable. Le 24 janvier 2017, notre pays a ainsi été le premier État souverain au monde à émettre, pour une taille significative, des obligations vertes, conformément à l'engagement pris par le Président François Hollande en avril 2016 lors de la quatrième conférence environnementale. En cumulant les flux publics et privés, la France s'est classée en 2020 à la troisième place mondiale des plus grands émetteurs d'obligations vertes, derrière les États-Unis et l'Allemagne.
Notre commission avait d'ailleurs consacré dès le mois de février 2018, il y a maintenant un peu plus de trois ans, une audition commune sur la politique d'émission de dette par l'État et le développement du marché des obligations vertes. Il est désormais temps de faire le point sur l'avancée de ce sujet et de mesurer la réalité des engagements pris.
Dans un secteur aussi internationalisé, l'enjeu se situe également et logiquement à l'échelle européenne, avec la mise en place du plan d'action de l'Union européenne pour la finance durable annoncé en 2018 et les réflexions engagées par la Banque centrale européenne pour « verdir » sa politique monétaire.
Afin d'aborder ces sujets, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin quatre intervenants, que je remercie pour leur participation : M. Thierry Déau, président de Finance for Tomorrow ; Mme Anuschka Hilke, directrice du programme « institutions financières » de l'Institute for climate economics (I4CE) ; M. Anthony Requin, directeur général de l'Agence France Trésor, qui était déjà présent lors de la table ronde en 2018 ; Mme Laurence Scialom, professeure d'économie de l'Université Paris Nanterre.
Sans plus tarder, je cède la parole à Anthony Requin, pour un bref propos liminaire sur la place grandissante prise par les obligations vertes dans la politique d'émission des États.
Je vais vous présenter quelques diapositives pour introduire ce débat, en abordant le développement du marché des obligations vertes, au travers de notre expérience d'émetteur. Le marché des obligations vertes était initialement un marché de niche, défriché par quelques émetteurs supranationaux. Je rappellerais le rôle moteur joué par la Banque européenne d'investissement en 2006 et par la Banque mondiale en 2009. Les grandes entreprises du secteur de l'énergie et quelques collectivités locales ont pris le relais de ces institutions supranationales. Les États n'arrivent donc que tardivement sur ce marché. Il faut donc reconnaitre qu'il s'agit d'un marché de niche, avec une audience assez confidentielle. Au regard de l'ensemble des flux obligataires actuels, on estime que l'encours des obligations vertes, sociales et durables est à peu près de 1 000 milliards de dollars à la fin de l'année 2020, soit 0,86 % du total de l'encours du marché obligataire. Même avec le développement que nous avons connu ces dernières années, en termes de stock, l'encours des OAT vertes reste faible. Mais en 2016, l'encours n'était que de 100 milliards de dollars : le marché a donc été multiplié par 10 en termes d'encours en quelques années.
Comme vous l'avez rappelé, il y a eu un changement d'échelle en 2017 avec l'émission par la France d'une OAT souveraine qui a eu deux conséquences : d'abord, celle de consolider la place de premier plan de la France sur ce marché. Nous avons un écosystème remarquable, constitué d'agences et d'établissements publics, de grandes entreprises qui ont très tôt saisi le potentiel de ce marché, des banques qui ont des capacités de placement, et des agences de notation. Avec cette première émission, l'État a consolidé cet écosystème. En deuxième lieu, cette émission a eu un effet d'entraînement sur d'autres émetteurs européens.
La deuxième diapositive montre, à partir des données du Climate Bonds Initiative, que la France occupe ces dernières années une troisième place dans les flux d'émissions d'OAT vertes dans le monde, souvent aux côtés des États-Unis et de la Chine. L'Allemagne est arrivée en troisième position en 2020 : nouvel émetteur souverain en 2020 sur ce marché, l'Allemagne est en effet remontée dans le classement. Vous avez rappelé que c'est à l'issue de la COP 2021, en 2016, que la France a décidé de démontrer la maturité des marchés financiers pour accompagner la transition énergétique dans laquelle doivent s'engager les États signataires et de montrer l'exemple en étant le premier État souverain à émettre une obligation verte pour une taille de référence : c'est l'OAT 2039 émise en janvier 2017, pour 7 milliards d'euros. La troisième diapositive montre le changement d'échelle du marché français à compter de 2017 : le marché triple en l'espace d'une année et les OAT vertes ont représenté près de 50 % des émissions totales en 2017 et 2018, puis le marché poursuit sa lancée en 2019 et en 2020. Les émissions de l'État ont donc joué un rôle de premier plan dans la dynamique de ce marché.
La quatrième diapositive illustre le rôle pionnier de la France parmi les émetteurs souverains européens. Après avoir fait la preuve de la viabilité de ce marché, à travers une structuration adéquate qui n'a pas mis à bas les principes d'efficience qui guident les agences d'émission, d'autres pays emboîtent le pas de la France : dans l'ordre, il s'agit de la Belgique, de l'Irlande, des Pays-Bas, de l'Allemagne, et plus récemment de l'Italie. L'Espagne et le Royaume-Uni sont attendus pour cette année. Comme le montre le graphique, un mois sépare les opérations de la Pologne et de la France : la Pologne a effectué en décembre 2016 une opération de 750 millions d'euros d'émission à 5 ans. L'émission française, c'est 7 milliards d'euros, pour un titre à 22 ans de maturité. En termes de risque absorbé par le marché, nous sommes donc sur un facteur de 1 à 40 entre la Pologne et la France. Le changement d'échelle s'est véritablement produit avec l'émission française. Nous pouvons revendiquer d'avoir changé les dynamiques dans ce marché.
Les diapositives suivantes rappellent ce que sont les OAT vertes : il s'agit d'une obligation dont le produit de l'émission sert à financer les dépenses budgétaires qualifiées de « vertes ». La cinquième diapositive illustre les types de dépenses qui ont été financées sur la période de 2017 à 2020 en cumulé. Par souci de simplicité et d'illustration, nous avons sélectionné les 8 principales, d'un montant cumulé supérieur au milliard d'euros et couvrant 80 % du global, mais au total nous avons 32 lignes budgétaires concernées, relevant de 13 programmes budgétaires, auxquels il faut ajouter les 3 programmes d'investissements d'avenir. Si vous souhaitez des informations exhaustives à ce sujet, je vous renvoie au rapport annuel d'allocation des fonds de l'OAT verte, publié sur le site internet de l'Agence France Trésor. Ces dépenses vertes sont sélectionnées après un processus interministériel rigoureux. Elles doivent répondre à un cahier des charges précis, et doivent contribuer à l'atteinte d'objectifs environnementaux rappelés dans la sixième diapositive. Les quatre objectifs environnementaux sont l'atténuation du changement climatique, la protection de la biodiversité, la réduction de la pollution et l'adaptation au changement climatique. Ces dépenses interviennent dans six différents secteurs : le bâtiment, le transport, l'énergie, les ressources vivantes, l'adaptation et la pollution et l'éco-efficacité. Ces dépenses doivent faire l'objet d'un rapportage annuel quant à l'allocation des fonds, et de rapport d'impacts environnementaux dans la mesure du possible. C'est ce à quoi la France s'est attelée avec la constitution du conseil d'évaluation de l'OAT verte. La septième diapositive montre sur la gauche quelques exemples de rapports et d'études ayant été menés par le conseil. Je voudrais insister sur le rôle essentiel de ce conseil d'un point de vue institutionnel car il est garant de la qualité de notre démarche. Il est composé de neuf personnalités qualifiées, ayant une expérience internationale, spécialisées dans le champ de l'environnement, de la finance verte ou dans l'évaluation des politiques publiques : de grandes institutions sont représentées comme l'OCDE, la Banque mondiale, le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Ce conseil est présidé par un ancien ministre de l'environnement du Pérou, qui avait présidé la COP 20.
Une dernière observation importante : rien de tout cela ne se fait en contradiction avec les principes budgétaires, notamment la règle de l'universalité, qui interdit l'utilisation d'une recette déterminée pour le financement d'une dépense déterminée. Il n'y a pas d'affectation prédéterminée, pas de compte ségrégé. Le produit des émissions d'OAT vertes est géré comme les autres produits d'émissions obligataires et les autres ressources au sein du compte unique du Trésor.
Cependant, nous sommes engagés à tenir un reporting auprès des investisseurs sur les montants qui sont effectivement décaissés sur les programmes budgétaires pré-identifiés, en assurant que chaque année, nous n'émettions pas plus d'OAT vertes que nous décaissions envers ces programmes : il s'agit de l'équivalence notionnelle, vérifiée par un auditeur externe qui certifie l'intégrité de notre approche.
Après quatre années d'expérience, le modèle d'émission conçu par la France connait un succès à trois titres. D'abord, l'émission d'OAT vertes s'est faite sans surcoût pour le contribuable, ce qui est la mission première de l'AFT - financer l'État dans les meilleures conditions de coût et de sécurité - car nous avons été en mesure d'entretenir la liquidité de notre souche d'OAT selon les mêmes principes que nous utilisons pour les émissions de nos OAT conventionnelles, en étant à l'écoute du marché et en apportant aux investisseurs le produit qu'ils recherchent au moment où il le souhaitent. Avec le temps, nous avons progressivement augmenté notre encours d'OAT vertes : la neuvième diapositive montre que l'encours atteint un niveau équivalent à celui des autres OAT, ce qui assure un niveau de liquidité équivalent. Nos émissions se sont réalisées avec un coût sans doute un peu moindre pour l'OAT verte que pour les autres OAT : le contribuable en a donc bénéficié. Nous tirons parti d'un déséquilibre persistant dans ce marché entre la demande de titres verts qui vient de la communauté des investisseurs et l'offre de titres, en dépit de la multiplication du nombre d'émetteurs, notamment souverains. L'encours atteint par l'OAT verte est actuellement de 30 milliards d'euros, ce qui nous a conduits en mars dernier à émettre une nouvelle souche, l'OAT 2044, dans d'excellentes conditions de demande et de taux d'intérêt : 0,526 % à l'émission. Pour la première fois à l'occasion d'une opération syndiquée, le fameux greenium s'est matérialisé : il s'agit de la prime à l'émission d'une OAT verte. On estime que cette OAT a été émise avec 1 point de base sous sa valeur théorique. Le greenium, par référence à l'OAT 2039 et aux conditions qui prévalaient sur le marché secondaire au moment où a été émise l'OAT 2044, peut être estimé entre 2 et 3 points de base. À l'occasion de cette opération, nous avons en quelque sorte partagé le greenium entre l'émetteur et les investisseurs. C'est donc la preuve que le marché gagne en maturité, ce premium permettant de couvrir sans difficulté les charges administratives spécifiques aux OAT vertes et la gouvernance associée à ce titre obligataire.
J'en viens au deuxième succès : l'OAT verte s'est installée comme un produit d'émission régulier de l'AFT, aux côtés des OAT conventionnelles, des titres indexés sur l'inflation, et des titres de court terme. Nous avons à peu près 5 % des programmes d'émissions sous forme d'OAT vertes contre 10 % de programmes d'émissions réalisé sous la forme de titre indexés sur l'inflation française et européenne. Nous nous adaptons en fonction de l'intensité de la demande.
Enfin, le troisième succès : beaucoup d'autres États nous ont emboité le pas, selon une structuration voisine de la nôtre, y compris des émetteurs souverains qui au départ étaient très sceptiques après notre opération en 2017. On assiste donc à des conversions bienvenues. L'arrivée de ces nouveaux émetteurs n'a pas détérioré nos conditions préférentielles d'émissions. Nous avons contribué à renforcer cette classe d'actifs, avec un cercle vertueux où l'offre génère un supplément de demande. J'ai l'intime conviction que l'émergence d'actifs souverains verts permet le développement croissant d'une gestion d'actifs purement verte, qui devrait permettre le financement d'investissements de la part d'entreprises ou de pays émergents par exemple, qui n'auraient pas pu voir le jour sans la structuration progressive du marché.
En conclusion, je voudrais évoquer les défis à venir. Ce n'est pas l'émission d'un nouveau titre vert, puisque ce défi a déjà été relevé avec succès. À court terme, le défi est de voir dans quelle mesure l'équilibre de marché actuel sera modifié ou pas par l'arrivée de la Commission européenne en tant qu'émetteur. La Commission européenne a en effet un programme d'émission de titres verts considérable, de 250 milliards d'euros potentiellement au cours des prochaines années, ce qui en fera rapidement le premier émetteur d'obligations vertes au monde. Le deuxième défi est la question de l'alignement de notre cadre d'émissions avec la taxonomie européenne en cours d'élaboration, qui n'est pas encore complète. Il s'agira de nous assurer que ce que nous faisons et les dépenses que nous finançons sont bien alignés avec cette taxonomie. Je vous remercie.

Je vous remercie. Je cède maintenant la parole à M. Thierry Déau, qui reviendra sans doute sur l'engagement de la place de Paris en faveur de la finance durable et les évolutions en cours à l'échelle européenne.
Je vous remercie pour cette invitation. Finance for Tomorrow constitue la branche de Paris Europlace qui s'occupe de la finance durable. Nous représentons quatre-vingt institutions - des émetteurs aux entreprises en passant par les institutions financières - et les pouvoirs publics sont représentés au sein de notre gouvernance. C'est un lieu de dialogue et de coopération du marché et des pouvoirs publics, avec un objectif de transformation des pratiques du secteur de la finance pour atteindre nos objectifs de développement durable. Nous cherchons par ailleurs à faire de la place de Paris un centre financier de référence en la matière, dans une logique d'attractivité.
Dans le contexte de la pandémie et de la crise économique que nous connaissons, les enjeux de la finance durable consistent à mettre en place les moyens de notre résilience économique sur le long terme.
La finance durable, c'est d'abord un plan d'investissement public et privé à l'échelle mondiale pour permettre une transition juste - car il ne faut pas oublier les aspects sociaux de l'Accord de Paris. Pour donner quelques chiffres, l'Organisation des Nations Unies estime à 5 000 milliards de dollars les besoins d'investissement annuels à l'échelle mondiale pour respecter nos objectifs de développement durable. Au niveau européen, le Green Deal cherche à déployer plus de 1 000 milliards d'euros d'investissements publics et privés. En France, l'institut I4CE estime entre 13 et 17 milliards d'euros le déficit d'investissement annuel pour respecter la stratégie nationale bas carbone. Il s'agit donc bien de transformer les pratiques de la finance pour flécher les capitaux vers ces usages.
Dans cette perspective, permettez-moi de commencer par rappeler le rôle déterminant de la réglementation. La France est assez avant-gardiste sur ce sujet, avec par exemple l'obligation de proposer des produits labellisés dans les assurances vie. Néanmoins, les autres acteurs mondiaux se mobilisent fortement. La Commission européenne a avancé son plan d'action sur la finance durable, avec de premiers règlements qui ciblent la transparence des acteurs en matière de durabilité sur le plan climatique et social. Tout cela est assez positif mais pour garder le leadership par rapport aux États-Unis, il nous paraît nécessaire d'accélérer la coopération entre le public et le privé et de créer des incitations efficaces, en allant au-delà de l'approche par les risques. Il y a deux sujets majeurs de ce point de vue. D'abord, le prix du carbone à long terme, qui joue un rôle de signal essentiel. Ensuite, il faut aligner les priorités en matière d'investissements et de subventions publics sur les objectifs de l'Accord de Paris.
Le deuxième enjeu est celui de la donnée extra-financière. Il y a là un véritable sujet de souveraineté pour la France et l'Europe. Il est indispensable de pouvoir comparer les données afin de les rendre plus lisibles. Elles doivent être accessibles à un coût raisonnable. Il faut également en protéger l'hébergement et l'utilisation, afin de rester un marché compétitif. La mise en place de bases de données publiques s'organise à l'échelle européenne. Pour donner un exemple de ce qui se fait, nous avons mis en place un observatoire de la finance durable, avec comme première thématique la sortie du charbon. Il permet de présenter de façon claire les engagements des acteurs et de proposer des données sectorielles comparables pour mesurer les progrès et les avancées.
Mon dernier point concerne la finance à impact. Il faut passer de la responsabilité à l'impact, qui cherche à créer des effets positifs dans l'économie réelle et la société. La finance dite « à impact » reste un marché de niche, centré autour de l'économie sociale et solidaire. Elle doit permettre de transformer la finance dans son ensemble. Pour répondre aux aspirations des citoyens, il faut du concret. L'objectif, c'est la transition juste. Dans ce cadre, nous avons lancé la construction de la « maison de l'impact » au sein de la place de Paris, en collaboration avec Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. L'ambition est de fédérer tous les acteurs de la place autour de cet enjeu et de porter cette voix singulière à l'échelle européenne et internationale. Plusieurs groupes de travail ont été mis en place pour s'entendre sur les définitions, la méthodologie et produire des recommandations visant à développer l'activité.
Je suis ravie d'être parmi vous. Je représente l'Institut de l'économie pour le climat, que vous connaissez peut être en raison de ses travaux relatifs à la construction d'un budget vert. Notre institut est un « think tank » qui mène des réflexions sur la façon de mettre l'économie au service du climat, ainsi que sur l'intégration des questions climatiques dans l'activité des institutions financières, et également dans le cadre fixé par la réglementation financière.
Les interventions précédentes ont souligné des expériences intéressantes, telles que les émissions d'obligations vertes souveraines, mais ces sujets restent des sujets de niches. Or, cette approche n'est pas suffisante face aux grands défis posés par le changement climatique. Comment pouvons-nous élargir le champ de cette analyse ? À mon sens, le budget vert peut fournir un exemple pour transformer l'ensemble du secteur financier face aux défis du changement climatique. Dans cette perspective, il ne suffit pas de regarder uniquement les activités dites « vertes », mais l'ensemble des activités du secteur financier, les catégoriser et les rendre compatibles avec les défis auxquels nous faisons face. Cette approche est valable pour le climat, mais elle peut être étendue aux défis plus globaux du développement durable. En somme, la question climatique ne représente qu'une partie de la problématique qui nous occupe.
Un rapport récent de notre institut, publié par Julie Evain et Michel Cardona, a analysé en détails les principaux obstacles au financement de la transition énergétique et les marges de manoeuvre de la réglementation financière afin de donner au secteur financier des incitations nécessaires pour l'aider à se transformer. En effet, ce secteur d'activité comprend des mécanismes désincitatifs, en particulier en matière de gestion des risques, qui visent à répliquer l'économie actuelle plutôt qu'à la transformer. Le rapport rappelle que les enjeux varient selon les entreprises, leur positionnement sur la question de la transition énergétique, leur taille, le secteur d'activité et la localisation. S'il n'y a pas de solution miracle, trois grands leviers d'actions peuvent être évoqués. Premièrement, la compréhension du financement de la transition énergétique avec les acteurs financiers reste limitée. L'expertise en la matière n'est pas assez généralisée. Deuxièmement, l'investissement dans une perspective de long terme doit être davantage encouragé. Enfin, il faut inciter les acteurs financiers à s'intéresser à des projets qui ne sont pas considérés comme étant suffisamment rentables. Le rapport comprend une liste de recommandations des approches qu'on pourrait mettre en oeuvre pour que la France se positionne comme pionnière en la matière.
Certes, sur certains sujets, la France ne peut pas agir seule car ils relèvent des compétences de l'Union européenne. En revanche, il est possible de progresser seuls sur la question de la formation des acteurs financiers. Plusieurs initiatives ont été mises en place, notamment le programme « finance climat », mis en oeuvre par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), et financé par la Commission européenne.
Sur la question du court-termisme des acteurs financiers, au détriment des investissements de long-terme, les travaux menés suggèrent que la politique de rémunération pourrait être un levier d'action pour modifier ce biais.
La question de la mobilisation de l'épargne des particuliers, sujet qui intéresse votre commission, est également importante. Au-delà des solutions de facilité, telles que la labellisation de fonds, la question est celle de la prise de risque : est-ce à l'épargnant de l'assumer ? Selon moi, ce n'est pas à lui de prendre ce risque, car la transition énergétique est nécessairement risquée par nature. À l'échelle de chaque épargnant, ce risque serait très élevé. Le rôle de l'État doit être interrogé pour répartir équitablement cette prise de risque entre l'ensemble des acteurs.
Nous ne parviendrons pas à revenir à une trajectoire de réchauffement climatique liée à 2 degrés sans une transformation profonde de la finance. Il ne faut pas seulement investir dans l'économie verte, mais aussi et surtout désinvestir de l'économie brune et carbonée. Or la finance climatique n'est pas actuellement alignée sur une trajectoire 2 degrés et une politique de simple amélioration n'est pas raisonnable. Il faudra un engagement volontariste des États et des banques centrales, qui peuvent contribuer à la réallocation de flux financiers.
En premier lieu, la finance est incapable à elle seule d'aligner les flux financiers sur une trajectoire soutenable. La plupart des efforts ont porté jusqu'à présent sur l'amélioration de l'information relative à l'exposition des entreprises aux secteurs carbonés ou peu soutenables. Il faut certes réunir des informations pour mesurer les risques financiers d'origine climatique et la taxonomie verte d'origine européenne est une avancée, mais ce n'est pas suffisant. En effet, l'allocation des flux, en finance, se fait en fonction du rendement et du risque anticipés, mais seul le rendement du point de vue de l'investisseur est pris en compte : la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui bénéficie à tous, n'est pas tarifée par le marché. À l'inverse, les investissements dans l'économie brune nuisent à tous sans que cela pèse sur la rentabilité financière. Ainsi les plus grandes banques mondiales ont-elles, depuis les accords de Paris, accordé près de 4 000 milliards de dollars à l'industrie fossile, dont près de 300 milliards de dollars pour les banques françaises. Cette défaillance du marché justifie une intervention publique.
En outre, les risques financiers d'origine climatique sont sous-estimés parce qu'ils sont nouveaux, les modèles existants étant basés sur les risques passés, et ils ne sont pas véritablement quantifiables, ce qui constitue une entrave à l'action.
La finance durable doit porter surtout sur le désinvestissement dans les secteurs les plus nocifs, comme l'a recommandé hier un rapport de l'Agence internationale de l'énergie. Les investissements publics doivent donc être massifs et, afin d'entraîner la finance privée, des règlementations doivent pénaliser l'investissement dans l'économie brune.
Il faut, en application du principe de double matérialité, qui est désormais reconnu dans la législation européenne, reconnaître les conséquences du réchauffement climatique sur la finance mais aussi, à l'inverse, celles des choix économiques et financiers sur l'aggravation du réchauffement climatique. Contrairement aux intermédiaires financiers, les banques centrales peuvent prendre en compte ce principe parce qu'elles n'ont pas d'objectif de maximisation des profits et qu'elles représentent les intérêts de la communauté. De même que, en situation de crise financière, les banques centrales agissent en prêteurs de dernier ressort lorsque les acteurs privés ne le font pas, il faut reconnaître une urgence à agir pour la lutte contre le réchauffement climatique, dont on ne se relève pas comme d'une crise financière : les banques centrales devraient donc, du fait de leur position hiérarchiquement supérieure, intégrer dans leur doctrine le principe de double matérialité, en dépit de la difficulté à tarifer les risques climatiques. Le prix de l'inaction, lui, est connu : elle entraînerait des catastrophes climatiques irréversibles. Les travaux du GIEC l'ont montré, certaines régions pourraient devenir invivables d'ici à la fin du siècle. Les banques centrales ont donc un rôle majeur à jouer, selon des critères différents de leurs actions habituelles.

La Banque centrale européenne est engagée dans cette réflexion et nous aurons des résultats d'ici quelques mois. Il faudra prendre en compte la transition vers un nouveau système et les financiers doivent concilier ces impératifs avec leurs missions, y compris pour le financement des systèmes sociaux.

S'agissant des épargnants et du label « Investissement socialement responsable » (ISR), je suis préoccupé par les conclusions sévères de l'Inspection générale des finances, qui l'estime condamné à une perte inéluctable de crédibilité et de pertinence parce que ses exigences de sélectivité ne sauraient garantir la responsabilité ou la durabilité des investissements. Comment corriger ces défauts afin que les promesses faites aux épargnants soient respectées ?
La loi « Pacte » a imposé aux assureurs-vie de proposer au moins une unité de compte ayant obtenu un label reconnu par l'État dans l'un des trois domaines d'investissement suivants : responsable, vert ou solidaire, puis dans chaque de ces trois domaines à partir du 1er janvier 2022. Quel est l'état du marché aujourd'hui ?
Enfin, dans une note publiée en mai 2019, l'Institute for Climate Economics (I4CE) s'interrogeait sur la compatibilité de la réglementation financière française avec les accords de Paris. Les récentes évolutions législatives et réglementaires vous paraissent-elles aller dans le sens d'une mobilisation des nouveaux flux financiers en direction des actifs de transition ? Comment les acteurs financiers peuvent-ils mieux tenir compte des risques financiers que fait peser le changement climatique sur l'économie ? Qu'en est-il pour les acteurs de la supervision ?
Les modalités de la transition seront essentielles : pensons à l'écotaxe qui a débouché sur le mouvement des bonnets rouges, et à la trajectoire de la taxe carbone qui s'est heurtée à celui des gilets jaunes.

S'il y a eu un glissement dans les interventions et les propositions, le débat reste le même, sous un angle différent : il faudrait pricer les risques, en donnant par un exemple un prix au carbone pour rééquilibrer les choses.

Sur les marchés financiers, on a besoin d'un actif de référence. Est-ce que les obligations vertes de l'État jouent aujourd'hui ce rôle pour pricer le reste des actifs ? Est-ce que leur volume est suffisant pour assurer cette fonction ?
Thierry Déau nous a rappelé que la finance durable, ce n'est pas seulement le verdissement de l'économie. Existe-t-il d'autres mécanismes, d'autres produits qui donneraient une vision plus complète, en couvrant à la fois la partie verte et la partie sociale ? Quelles sont les innovations envisagées dans ce domaine ?
Sur les marchés « classiques », l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR) sont là pour vérifier que les choses se passent bien. En matière de finance durable, qui doit contrôler, qui doit poser les normes et comment ?

Récemment, OFI Asset Management, un gestionnaire d'actifs engagé dans la finance responsable, s'est publiquement déclaré contre la stratégie climat de Total, en se disant particulièrement inquiet de noter les projections à la hausse du groupe dans le secteur gazier. Le 28 mai prochain, Total présentera en effet pour la première fois une résolution sur le climat à ses actionnaires. Une partie de ces derniers s'élèverait contre cette stratégie, qu'ils ne trouveraient pas suffisamment ambitieuse puisqu'elle laisse une part prépondérante aux énergies fossiles, gaz et pétrole. Il y a eu un embryon de réponse par le marché financier, à travers la réaction publique d'OFI Asset Management, mais c'est une démarche assez solitaire.
Pour ma part, il me semble que le marché ne peut pas tout. En matière de biodiversité, l'idéologie de marché croit résoudre le problème en donnant un prix à la nature, pour la préserver. Seulement, ce n'est pas en affectant un prix à des biens non marchands qu'on pourra lutter contre les effets destructeurs de l'exploitation d'un site de gisement, comme on le voit avec la destruction des forêts primaires au Canada ou au Brésil par exemple.
Par ailleurs, la mise en place des marchés de compensation (offset markets), comme cela existe aux États-Unis, est prévue par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages d'août 2016 et le plan biodiversité de 2018. Avec ce dispositif, il est donné la possibilité de détruire la biodiversité par des opérations d'aménagement à condition de la compenser par la création de zones nouvelles où la biodiversité sera préservée, donnant lieu à des droits pouvant être achetés et revendus sur un marché de compensation. Alors même que nous faisons face à des menaces sérieuses en matière d'environnement, nous nous contentons d'implorer le marché. Pensez-vous que la finance telle qu'elle existe aujourd'hui peut venir palier les troubles qu'elle contribue à créer ?
Ma deuxième question porte sur la distribution des dividendes. En pleine pandémie, les groupes du CAC 40, tout en bénéficiant d'aides publiques massives, s'apprêtent à verser plus de 51 milliards d'euros à leurs actionnaires, soit une hausse de 22% par rapport à l'année précédente et alors même que le résultat net du CAC s'est effondré de plus de 55 %. Globalement, le CAC 40 a réalisé des bénéfices cumulés de 37 milliards d'euros en 2020. Rapportés aux dividendes versés, cela signifie que les grands groupes ont versé à leurs actionnaires l'équivalent de 140 % de leurs profits annuels. Autrement dit, ils auraient versé 100 % de leur profit aux actionnaires et puisé dans leur trésorerie pour verser le reste. Les prêts garantis par l'État ont de manière détournée servi à financer une partie de ces dividendes. Un récent sondage montrait que 85 % des personnes interrogées souhaitaient taxer davantage les actionnaires les plus fortunés. Pensez-vous qu'une taxe sur les transactions financières pourrait être une solution pour financer la transition écologique de manière plus juste et équitable ?

La Commission européenne a publié sa taxonomie sur la finance verte afin d'identifier les secteurs les plus vertueux en matière de développement durable. Certains pensent qu'il faudrait la compléter d'une taxonomie brune qui identifierait les activités nuisibles à l'environnement, sachant que certains économistes considèrent dans le même temps qu'une telle taxonomie pourrait déstabiliser l'économie dans son ensemble.
Par ailleurs, si l'AMF et l'ACPR ont mis en place des travaux de suivi des engagements pris par les acteurs financiers en matière de climat, elles soulignent la difficulté à mesurer l'impact et l'utilité réelle de ces investissements. Quelles sont les pistes d'amélioration en la matière pour s'assurer de la réalité et de l'efficacité de ces investissements durables ?

Laurence Scialom a évoqué la nécessité d'accompagner le verdissement de l'économie et, à l'inverse, de pénaliser tout ce qui n'y contribue pas. Dans quelle catégorie placez-vous l'énergie nucléaire ? Est-elle décarbonée ou est-ce une énergie d'un autre temps ?

Thierry Déau a évoqué les travaux menés avec Olivia Grégoire, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Quelles sont vos réflexions et les pistes envisagées pour réorienter une partie des moyens financiers disponibles pour les grands marchés vers l'économie de proximité non délocalisable et solidaire ? Quels instruments mettre en oeuvre pour financer cette forme d'économie dans nos territoires ?

La finance durable et, plus généralement, le verdissement de l'économie et la transition écologique, font partie de ces sujets qui n'ont de sens qu'au niveau mondial. Sans réponse globale, on ne voit pas réellement comment on peut résoudre les problèmes auxquels nous faisons face, même s'il faut bien commencer par pousser des initiatives au niveau national avant qu'elles ne soient reprises au niveau international. Concernant la finance, cela se double d'une autre difficulté : une compétition exacerbée, à la « microseconde ». On est dans un système de compétition entre financiers qui se gère par des systèmes automatiques d'achat et de revente sur des temps extrêmement brefs et sans vision « humaine ». Comment peut-on arriver, dans ce contexte, à intégrer, autrement que par une vision globalisée en termes de normes et en termes de règles, une vision européenne ou française ? Est-ce que cela a du sens ?
Sur le nucléaire, c'est une énergie de transition, dont nous allons encore avoir besoin pour assurer une transition vers les renouvelables, jusqu'à ce que nous disposions de capacités de stockage suffisantes pour éviter l'intermittence.
Il a été plusieurs fois question de la manière dont on pouvait financer l'économie sociale et solidaire et disposer de critères qui ne sont pas uniquement climatiques, mais également sociaux. Pour ma part, je milite beaucoup pour deux choses. La première, ce sont des circuits courts de la finance : on pourrait imaginer de nouveaux produits à l'échelle locale. Les épargnants locaux sauraient alors que l'argent qu'ils épargnent ne sert qu'à financer localement une entreprise de proximité, d'agriculture biologique, de rénovation thermique, etc. Le Crédit Coopératif a de lui-même mis en place ce type de produits mais on pourrait très bien imaginer des règlementations pour stimuler l'émergence de ces produits et les circuits courts. La transition écologique se fait en effet à tous les niveaux. Il y a les gros acteurs, comme les banques centrales, les banques publiques d'investissement ou la Banque européenne d'investissement qui peuvent agir, donner une impulsion, mais c'est également au niveau des territoires que cela se joue. C'est bien à ce niveau qu'on observe une demande de plus en plus forte pour que l'épargne ait un sens, mais il n'y a pas d'offre en face.
Le deuxième élément que je défends, c'est de permettre la création et l'installation de banques éthiques et alternatives. Ces dernières sont fédérées au niveau mondial dans la Global Alliance for Banking on Values (GABV) et la plus grande d'entre elles est Triodos. Triodos n'a pourtant pas pu s'installer en France, à cause du lobbying des grandes banques. Les banques éthiques et alternatives, qui sont généralement des banques mutualistes et coopératives, rejettent l'hybridation avec le marché et sont gouvernées par le principe des trois P : profit - il faut d'abord faire des profits pour être capable d'assurer son rôle d'intermédiaire financier - planet et people - ce qui signifie qu'elles font leurs choix d'investissement à partir de l'avantage social que peuvent procurer ces investissements et qu'elles financent donc en priorité l'économie sociale et solidaire, la culture mais également tout ce qui relève de la transition écologique. Des études ont montré qu'elles sont plus profitables que nos grandes banques : elles dégagent une rentabilité supérieure alors même qu'elles ne sont pas systémiques et ne mettent donc pas en péril la stabilité financière. Leur petite taille leur permet d'assurer un circuit court de la finance. Pour autant, on est dans un cadre dans lequel les réglementations sont faites pour les grands acteurs et dans lequel la co-construction de ces règlementations empêche ces petits acteurs d'émerger. Si c'est plus facile dans certains pays, en France, il y a très clairement un lobbying intense qui empêche ces acteurs alternatifs d'émerger et de se développer.
Sur le trading algorithmique, je considère qu'il y a là un renoncement politique : cela devrait être interdit, et d'autant plus que cette interdiction est facile à mettre en oeuvre. Il suffit d'augmenter le « pas » en passant par exemple de la nanoseconde à la milliseconde.
La finance telle qu'elle fonctionne aujourrd'hui a des pratiques qui sont antinomiques avec la transition écologique, que ce soit le trading à haute fréquence ou la gestion passive. L'essentiel de la gestion d'actifs est de la gestion passive : pour limiter les coûts, on reproduit les indices, mais ces indices, c'est l'économie telle qu'elle est et non telle qu'elle devrait être. La gestion passive ne permet pas de réallouer les fonds, c'est bien au contraire une entrave à la réallocation des fonds. De la même manière, la Banque centrale européenne (BCE) dit qu'elle doit respecter la neutralité de marché dans ses interventions et ne pas distordre les prix relatifs, empêchant donc toute évolution. Il y a donc un problème de volontarisme dans la manière dont les choses sont faites.
Il me paraît évident qu'il nous faut nous doter d'une taxonomie brune, qui serait l'équivalent de la taxonomie verte. La France n'est pas très allante dans ce domaine mais le Network for Greening the Financial System (NGFS), qui regroupe des banques centrales et des superviseurs au niveau mondial, plaide en faveur de cette taxonomie. Si on veut améliorer la transparence de l'information et sa standardisation, il ne faut pas le faire que pour le vert, il faut également le faire pour les activités dans lesquelles on doit désinvestir.
L'activisme actionnarial est une piste de transformation et d'incitation des grands groupes à agir pour la transition écologique. L'activisme actionnarial avait jusqu'ici mauvaise presse, on considérait que son objectif était seulement d'augmenter la profitabilité des entreprises (le return on equity, ROE), avec l'adoption de résolutions qui ont conduit à des plans de licenciement. Cependant, on peut également avoir un activisme actionnarial climatique, des associations d'intérêt des investisseurs qui prendraient volontairement des parts substantielles dans certaines sociétés pour faire bouger les choses.
Pour ce qui est des leviers sur lesquels il faut agir - taxe sur les transactions financières, réglementations et régulations - l'urgence est telle qu'il faut agir sur tous les leviers, qui sont complémentaires. Quand je parle d'urgence à agir, il faut bien comprendre qu'on a entre 10 et 15 ans avant d'avoir épuisé ce qu'on appelle « le budget carbone », que l'on est tout à fait capable de mesurer. Le budget carbone, c'est combien de gaz à effet de serre on peut encore émettre pour rester sous la trajectoire des 2°C d'ici 2100. Actuellement, si on brûle toutes les réserves fossiles qui sont déjà valorisées au bilan des entreprises, on est sur une trajectoire de 4°C à 6°C. Cela veut donc dire qu'il faut complètement arrêter les nouvelles prospections. C'est bien pour cette raison que l'on propose, avec Finance Watch et Thierry Philipponnat, son directeur, que toute nouvelle prospection soit financée à 100 % par du capital et non par de la dette, puisque c'est trop risqué, même dans une logique financière. Il ne faut plus prospecter puisqu'il ne faut même plus brûler ce que l'on a déjà valorisé si l'on veut que notre planète demeure vivable pour les générations futures.
À travers son étude « Finance fit for Paris », I4CE avait fait un état des lieux de l'environnement réglementaire en France. La question est de savoir si la situation s'était améliorée depuis. Nous n'avons pas actualisé cet exercice. Nous pouvons néanmoins considérer qu'il y a probablement eu certaines avancées notables. On peut citer notamment le premier exercice pilote de stress test climat de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Il y a eu des avancées mais nous sommes toujours loin d'avoir une vision globale. L'exercice pilote de stress test était très intéressant quand bien même il n'avait pas d'impact direct sur les besoins en capitaux des banques. C'était un véritable exercice pédagogique pour pousser les réflexions relatives au climat au-delà des seules directions consacrées à la responsabilité sociale des entreprises (RSE) ou à la communication.
Il faut désormais utiliser la réglementation prudentielle pour obliger les institutions financières à avoir des stratégies compatibles avec les objectifs climatiques. Il faut un objectif climat contraignant. Si une stratégie d'alignement avec les objectifs climatiques ne va pas régler la question des risques financiers à court terme, elle sera utile, à plus long terme, pour éviter d'accroître les risques futurs. La réglementation prudentielle bancaire pourrait donc être utilisée en ce sens plutôt que le second pilier.
Il y a beaucoup de réflexions autour du premier pilier. L'idée d'une taxonomie brune est notamment discutée dans ce cadre. Nous ne sommes pas très favorables à ce type d'instruments car il pourrait avoir des effets négatifs sur la résilience des institutions bancaires. Nous préférons réfléchir, dans le cadre du second pilier, à intégrer directement ces questions dans les systèmes de gestion du risque des institutions financières. Par ailleurs, si elle pourrait tout de même présenter quelques avantages, une taxonomie brune serait beaucoup plus difficile à négocier qu'une taxonomie verte car les intérêts sont forts et les ajustements nécessaires qui en résulteraient pourraient se révéler brutaux. Ce qui nous paraît plus important et plus facile à mettre en place, c'est une taxonomie de transition au niveau de l'entreprise et non pas au niveau de l'activité. Nous avons besoin de transformer l'entreprise dans sa globalité et pas seulement telle ou telle activité. Il est nécessaire que la stratégie de l'entreprise dans son ensemble soit réellement compatible avec les objectifs climatiques.
Je ne suis pas du tout convaincue que les produits d'épargne durables soient aujourd'hui suffisants. Il y a un déficit de lisibilité pour les épargnants qui ne comprennent pas les stratégies utilisées derrière ces produits. Par exemple ils ne comprennent pas pourquoi ces produits contribuent à financer l'entreprise Total alors que ce sont des instruments durables. Il est nécessaire de concevoir des produits plus lisibles pour les épargnants et potentiellement plus risqués. La question se pose alors de savoir qui assume ce surcoût de risque ? Une partie du risque devrait peut-être être assumée par l'État pour permettre de lever davantage de fonds pour de véritables produits de transition.
Je ne suis pas un dogmatique sur ces sujets et je considère qu'il faut revenir à des cas concrets car la finance durable ne peut exister qu'à la condition que l'on ait une économie durable et des décisionnaires publics qui la conçoivent. Je ne crois pas à la main invisible de la finance. Elle ne peut pas faire les choses toutes seules.
Je vais prendre l'exemple du nucléaire. La fermeture de la centrale de Fessenheim a beaucoup mobilisé l'opinion mais il n'en va pas de même sur la fermeture des centrales à charbon. Pourtant le nucléaire n'émet pas de CO2, même s'il existe des externalités négatives en termes de déchets qu'il ne faut pas négliger. Il n'empêche que les décisions politiques depuis 15 ans s'acharnent davantage à fermer les centrales nucléaires que les centrales à charbon qui sont pourtant fortement émettrices de gaz à effet de serre.
La finance durable ne va pas remplacer la décision et les politiques publiques. On peut parler de désinvestissement dans les énergies qui contribuent aux émissions de gaz à effets de serre mais ça ne règle pas le problème si les États ne prennent pas la décision de fermer les centrales. Dans ce cas, désinvestir cela signifie qu'un financier rapace prendra le relais en anticipant des gains financiers. L'action publique est essentielle pour guider, non seulement la finance, mais plus largement l'économie et l'ensemble des acteurs économiques sur ces sujets.
Un autre exemple intéressant est celui des transports. Combien de collectivités locales ont pris des décisions fermes de renouvellement de leurs flottes de bus diesel, même Euro 6, par des motorisations électriques, hydrogène ou autres solutions alternatives ? Est-ce qu'une décision politique centrale, comme en Californie, doit l'imposer ? Les Californiens ont décidé qu'en 2030, leurs transports afficheraient des émissions nettes nulles. Sans une telle décision, la finance ne peut pas, d'elle-même, faire bouger les choses. La question n'est pas est-ce que l'on peut faire évoluer la finance ? Il faut que la finance soit toujours en lien avec l'activité économique réelle et les objectifs de développement durable clairs et précis traduits par les États dans leur action et leurs décisions politiques. Il ne peut en être autrement.
Tous les systèmes de contrôle ont bien évolué et les régulateurs y travaillent activement. Le contrôle prudentiel est nécessaire car il y a un élément de risque évident. Je pense que les efforts de la commission européenne et de la Banque de France sont énormes et vont finir par aboutir. Les exigences de transparence obligent à mieux quantifier le risque et, in fine, elles conduisent à pénaliser, dans une logique prudentielle, ceux qui détiennent les actifs à terme.
Les obligations sociales à impact existent déjà. Nous finançons des hôpitaux en Turquie avec des obligations à la fois sociales et vertes. Nous essayons d'identifier les bonnes pratiques économiques vertueuses car c'est bien la base. Pour avoir un hôpital « vert » il faut construire un bâtiment zéro émissions nettes avec des exigences d'accessibilité. C'est d'abord l'acteur économique qui doit être responsable. La finance doit l'inciter en lui proposant des solutions pour faciliter sa transformation. Prenons l'exemple du tanneur qui fournit les sacs d'Hermès. Si ses effluents ne sont pas contrôlés par une réglementation stricte et qu'il ne dispose pas des moyens pour transformer son outil industriel, la finance durable est impuissante.
Il faut rester sur du concret, partir de la situation concrète des citoyens, des entreprises et des acteurs économiques. Il y a une responsabilité forte de l'État et du Parlement dans la définition de ces objectifs. L'économie ne va pas opérer seule une transformation aussi profonde dans un délai aussi rapide sans des décisions très claires quant aux objectifs. IL ne s'agit pas de donner de leçons, de contrôler ou de taxer systématiquement, mais de se montrer clair sur ces objectifs. Par exemple, si l'on veut protéger la biodiversité, on n'autorise pas forcément les compensations. S'il s'agit en effet d'une pratique ancienne, la question de son évolution ou de son interdiction est posée, et la réponse qu'il convient d'apporter doit reposer sur une base scientifique. La protection de la biodiversité étant un objectif de développement durable, il faut que les politiques publiques se déploient en déterminant ce qui est souhaitable ou non, la finance ne peut pas le décider à leur place.
En résumé, nous devons « rester sur terre » : c'est à l'économie de devenir durable, la finance n'est qu'à son service. Je ne nie pas qu'il ne faut pas « taper » sur la finance pour qu'elle le fasse à coups d'incitations, de réglementations et de pénalités. Il faut se monter réalistes : le fait d'attirer les flux vers l'économie durable nécessite de surmonter d'autres obstacles en amont. Il est compliqué d'expliquer à l'élu d'un territoire où une centrale à charbon génère un millier d'emplois que celle-ci doit fermer. Il faut parvenir à une transition durable, mais juste. Je suis par exemple favorable à une taxonomie de transition : certaines opérations ne sont aujourd'hui pas considérées comme relevant de la taxonomie « verte », mais pourraient le devenir. La Banque européenne d'investissement applique par exemple une taxonomie impliquant toute une série d'investissements interdits. Reste posée la question de savoir comment aider les petites entreprises dont l'activité pollue à mener leur transition grâce à une finance bien orientée et des politiques publiques adéquates.
Sur l'économie sociale et solidaire, je dirais que nous avons la chance, en France, d'être de très gros épargnants. Or, la finance ne peut être efficace que si elle atteint des volumes suffisants. Il faut que la finance globale se rende compte qu'il y existe un vrai bénéfice à investir dans l'ESS. C'est la raison pour laquelle l'initiative de l'Impact est très importante pour la place de Paris et, je l'espère, pour l'Europe.
La matière que nous traitons aujourd'hui est extraordinairement complexe. Je n'ai pas d'a priori sur le caractère bénéfique ou maléfique de la finance. La finance est un outil d'allocation des capitaux, qui permet notamment de financer notre déficit et donc nos politiques publiques, et qui réagit à des signaux et à des incitations. Si l'on estime que ceux-ci sont insuffisants, on peut encore les compléter avec de la réglementation, qui permet d'interdire ou d'autoriser lorsque les signaux de prix ne permettent pas d'atteindre suffisamment rapidement les objectifs fixés. Ainsi, je ne baisserais pas les bras en disant qu'il n'est pas possible d'orienter les capitaux pour atteindre certains objectifs sociaux.
Les signaux de prix sont essentiels : on peut réduire les problèmes d'externalités, notamment par la fiscalité en tenant compte des contraintes sociales et politiques qui ont été évoquées par le rapporteur général. On peut également intervenir par la réglementation quand ces signaux sont insuffisants.
La plupart des sujets que nous traitons requièrent une coopération internationale. On ne peut pas résoudre les problèmes évoqués dans le seul cadre national voire européen. C'est essentiellement aux États-Unis et en Chine que se trouvent les principaux enjeux en matière de transition énergétique. Il ne faudrait pas faire preuve de trop d'impatience en édictant trop rapidement des règles nationales, qui seraient sans efficacité dans la mesure où elles pourraient entraîner des fuites d'activités à l'étranger Il faut donc élever le niveau de conscience collective à l'échelle internationale. Quand ce n'est pas possible, il existe parfois des instruments de régulation à notre portée, comme en témoigne le mécanisme d'ajustement des prix aux frontières auquel réfléchit l'Union européenne. Une limite réside dans le temps qui est nécessaire pour parvenir à cette coopération internationale.