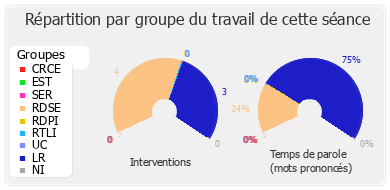Séance en hémicycle du 21 octobre 2009 à 21h45
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.

La séance est reprise.

Je vais vous donner lecture des conclusions de la conférence des présidents, qui s’est réunie aujourd’hui :
Jeudi 22 octobre 2009
À 9 heures 30 :
1°) Question orale avec débat n° 47 de Mme Nathalie Goulet à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur le contrôle parlementaire de l’action du Fonds stratégique d’investissement (demande du groupe Union centriste) ;
La conférence des présidents a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; le délai limite pour les inscriptions de parole est expiré.

À 15 heures :
2°) Questions d’actualité au Gouvernement ;
3°) Débat européen de suivi des positions européennes du Sénat (demandes de la commission des affaires européennes et de la commission de l’économie) :
- brevets européen et communautaire ;
- droits des consommateurs ;
- transposition insuffisante d’une directive ferroviaire (mise en demeure de la France) ;
- coopération judiciaire et policière : situation en Bulgarie et Roumanie ;
4°) Débat sur les prélèvements obligatoires (demandes de la commission des finances et de la commission des affaires sociales) ;
La conférence des présidents :

Semaine d’initiative sénatoriale
Mardi 27 octobre 2009
À 9 heures 30 :
1°) Dix-huit questions orales :
Ordre d’appel des questions fixé par le Gouvernement.
- n° 607 de Mme Nicole Bonnefoy à M. le secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme ;
- n° 642 de Mme Alima Boumediene-Thiery à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
- n° 635 de Mme Virginie Klès à Mme la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;
- n° 632 de Mme Christiane Demontès à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;
- n° 641 de M. Yves Daudigny à Mme la secrétaire d’État chargée des aînés ;
- n° 631 de Mme Nicole Bricq à M. le secrétaire d’État à l’intérieur et aux collectivités territoriales ;
- n° 646 de Mme Éliane Assassi à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
- n° 597 de Mme Anne-Marie Payet à Mme la ministre de la santé et des sports ;
- n° 633 de Mme Anne-Marie Escoffier à M. le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement ;
- n° 636 de Mme Catherine Troendle à M. le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement ;
- n° 643 de Mme Gélita Hoarau à M. le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement ;
- n° 634 de M. Jean-Pierre Demerliat à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ;
- n° 638 de M. Robert Navarro à M. le ministre chargé de l’industrie ;
- n° 625 de M. Yannick Bodin à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État ;
- n° 619 de M. Jacques Mézard à M. le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche ;
- n° 628 de M. René-Pierre Signé à M. le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche ;
- n° 630 de M. Francis Grignon à M. le ministre de la culture et de la communication ;
- n° 649 de M. Richard Yung à M. le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire ;
À 14 heures 30 :
2°) Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, préalable au Conseil européen des 29 et 30 octobre 2009 ;
De 17 heures à 17 heures 45 :
3°) Questions cribles thématiques sur l’immigration ;
À 17 heures 45 et, éventuellement, le soir :
4°) Proposition de loi relative au service civique, présentée par M. Yvon Collin et les membres du groupe du RDSE (texte de la commission, n° 37, 2009-2010) ;
La conférence des présidents a fixé :

mercredi 28 octobre 2009
Ordre du jour réservé au groupe UMP :
À 14 heures 30 :
- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, présentée par M. Philippe Marini (texte de la commission, n° 534 rectifié, 2008-2009) ;
La conférence des présidents a fixé :

Jeudi 29 octobre 2009
Ordre du jour réservé aux groupes de l’opposition et aux groupes minoritaires :
À 9 heures :
Ordre du jour réservé au groupe socialiste :
1°) Proposition de résolution européenne, présentée en application de l’article 73 quinquies du règlement, portant sur la proposition de directive du 13 juillet 2009 relative aux exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération (E 4632), présentée par M. Simon Sutour, Mme Nicole Bricq, MM. Richard Yung, François Marc, Bernard Angels et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés (n° 629, 2008-2009) ;
La conférence des présidents a fixé :

2°) Proposition de loi portant diverses dispositions relatives au financement des régimes d’assurance vieillesse des fonctions publiques hospitalière et territoriale, présentée par M. Claude Domeizel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés (texte de la commission, n° 33, 2009-2010) ;
À 15 heures :
Ordre du jour réservé au groupe Union centriste :
3°) Question orale avec débat n° 49 de Mme Catherine Morin-Desailly à M. le ministre de la culture et de la communication sur la décentralisation des enseignements artistiques ;
La conférence des présidents a fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mercredi 28 octobre 2009 ;

4°) Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative aux recherches sur la personne (texte de la commission, n° 35, 2009-2010) ;
La conférence des présidents a fixé :

Semaines réservées par priorité au Gouvernement
Lundi 2 novembre 2009
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 16 heures et le soir :
1°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports ;
2°) Projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales (Procédure accélérée) (texte de la commission, n° 51, 2009-2010) ;
La conférence des présidents a fixé :

Mardi 3 novembre 2009
À 9 heures 30 :
1°) Dix-huit questions orales :
L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.
- n° 610 de Mme Anne-Marie Payet transmise à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
- n° 616 de Mme Anne-Marie Escoffier à M. le secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation ;
- n° 640 de M. Jean-Pierre Chauveau à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;
- n° 644 de M. Dominique Braye à M. le secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme ;
- n° 647 de M. Pierre-Yves Collombat à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
- n° 648 de M. Alain Fouché à M. le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche ;
- n° 650 de M. Serge Lagauche à M. le ministre de la culture et de la communication ;
- n° 652 de Mme Maryvonne Blondin transmise à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;
- n° 654 de M. Claude Bérit-Débat à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ;
- n° 655 de Mme Monique Cerisier-BEN Guiga à M. le ministre des affaires étrangères et européennes ;
- n° 656 de M. Marcel Rainaud à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ;
- n° 657 de M. René Vestri à M. le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche ;
- n° 659 de M. Philippe Madrelle à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
- n° 661 de M. François Patriat à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;
- n° 664 de Mme Bariza Khiari à M. le ministre de la défense ;
- n° 668 de M. Alain Gournac à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;
- n° 670 rect. de M. Jacky Le Menn à Mme la ministre de la santé et des sports ;
- n° 678 de M. Bernard Vera à M. le ministre chargé de l’industrie ;
À 14 heures 30 et le soir :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
2°) Suite du projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales.
Mercredi 4 novembre 2009
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :
- Suite du projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales.
Jeudi 5 novembre 2009
À 9 heures 30 :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
1°) Suite du projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales ;
À 15 heures et le soir :
2°) Questions d’actualité au Gouvernement ;
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
3°) Suite du projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales.
Éventuellement, vendredi 6 novembre 2009
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 9 heures 30, à 15 heures et le soir :
- Suite du projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales.
Lundi 9 novembre 2009
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 11 heures, à 15 heures et le soir :
- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (A.N., n° 1976) ;
La commission des affaires sociales se réunira pour le rapport le mercredi 4 novembre 2009.

Mardi 10 novembre 2009
À 9 heures 30 :
1°) Dix-huit questions orales :
L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.
- n° 604 de M. Claude Biwer à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
- n° 618 de Mme Anne-Marie Escoffier transmise à M. le secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation ;
- n° 637 de Mme Catherine Dumas à Mme la ministre de la santé et des sports ;
- n° 651 de Mme Brigitte Gonthier-Maurin à M. le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement ;
- n° 653 de M. Michel Billout à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
- n° 658 de M. Jean-Léonce Dupont à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;
- n° 660 de M. Michel Teston à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;
- n° 662 de Mme Anne-Marie Payet à Mme la ministre de la santé et des sports ;
- n° 665 de M. Yannick Bodin à M. le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement ;
- n° 667 de M. Jean Besson à Mme la secrétaire d’État chargée de la prospective et du développement de l’économie numérique ;
- n° 669 de Mme Marie-France Beaufils à M. le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche ;
- n° 671 de Mme Maryvonne Blondin à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;
- n° 673 de Mme Claudine Lepage à Mme la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;
- n° 675 de M. Thierry Repentin à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ;
- n° 676 de M. Bernard Piras à M. le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement ;
- n° 679 de M. Didier Guillaume à Mme la secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité ;
- n° 681 de M. Jean-Pierre Vial à M. le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement ;
- n° 685 de M. Jacques Berthou à M. le secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme ;
À 14 heures 30 et le soir :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
2°) Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 ;
La conférence des présidents a décidé d’organiser un débat thématique sur le thème : « Pénibilité, emploi des seniors, âge de la retraite : quelle réforme en 2010 ? », avant le début de la troisième partie du projet de loi relative aux recettes pour 2010 ;

Jeudi 12 novembre 2009
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 9 heures 30, à 15 heures et le soir :
- Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.
Vendredi 13 novembre 2009
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 9 heures 30, à 15 heures et le soir :
- Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.
Éventuellement, samedi 14 novembre 2009
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 9 heures 30 à 15 heures et le soir :
- Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.
Semaine sénatoriale
Lundi 16 novembre 2009
Ordre du jour fixé par le Sénat :
À 15 heures :
1°) Question orale avec débat de M. Jack Ralite sur la numérisation des bibliothèques (demande du groupe CRC-SPG) ;
La conférence des présidents a fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le vendredi 13 novembre 2009 ;

2°) Proposition de loi organique modifiant le livre III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales relatif à Saint-Martin, présentée par MM. Louis-Constant Fleming, Jean-Paul Virapoullé et Mme Lucette Michaux-Chevry (texte de la commission, n° 57, 2009-2010) ;
3°) Proposition de loi organique tendant à permettre à Saint-Barthélemy d’imposer les revenus de source locale des personnes établies depuis moins de cinq ans, présentée par M. Michel Magras (texte de la commission, n° 56, 2009-2010) ;
La conférence des présidents a décidé que ces deux propositions de loi feraient l’objet d’une discussion générale commune ;

Mardi 17 novembre 2009
À 14 heures 30 :
Ordre du jour réservé au groupe socialiste :
1°) Proposition de loi relative à la lutte contre le logement vacant et à la solidarité nationale pour le logement, présentée par MM. François Rebsamen, Thierry Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés (n° 631, 2008 2009) ;
2°) Proposition de loi visant à réguler la concentration dans le secteur des médias, présentée par M. David Assouline et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés (n° 590, 2008 2009) ;
De 17 heures à 17 heures 45 :
3°) Questions cribles thématiques sur les collectivités territoriales ;
À 17 heures 45 :
Suite de l’ordre du jour réservé au groupe socialiste :
4°) Suite de l’ordre du jour du début d’après-midi.
Mercredi 18 novembre 2009
À 14 heures 30 :
Ordre du jour réservé au groupe RDSE :
1°) Proposition de loi tendant à interdire ou à réglementer le cumul des fonctions et des rémunérations de dirigeant d’une entreprise du secteur public et d’une entreprise du secteur privé, présentée par M. Yvon Collin et plusieurs de ses collègues du groupe du Rassemblement démocratique et social européen (n° 8, 2009-2010) ;
À 18 heures 30 et le soir :
Ordre du jour réservé au groupe UMP :
2°) Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public (n° 506, 2008-2009) ;
Du jeudi 19 novembre au mardi 8 décembre 2009
- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2010 (A.N., n° 1946) ;
Le calendrier et les règles de la discussion budgétaire seront établis ultérieurement.

Monsieur le président du Sénat prononcera l’éloge funèbre de M. André Lejeune le mercredi 24 novembre, à quatorze heures trente.
Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances et à l’ordre du jour autre que celui résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement ?...
Ces propositions sont adoptées.

Par lettre en date du 7 octobre 2009, Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales, a fait part à M. le président du Sénat de son souhait de constituer une mission d’information sur le mal-être au travail.
La conférence des présidents a décidé de soumettre au Sénat cette demande, sous la réserve de la prochaine réunion du bureau qui aura à débattre de cette question, conformément au règlement.
Comme M. le président du Sénat l’a souhaité, je donne la parole à Mme Muguette Dini.

Monsieur le président, mes chers collègues, la question du mal-être au travail est un sujet qui préoccupe notre commission depuis longtemps, avant même que les événements douloureux survenus au sein du personnel de France Télécom lui donnent une actualité dramatique.
En janvier 2009, nous avons donc inscrit à notre programme de travail de l’année l’objectif d’une réflexion à conduire dans le cadre d’un groupe de travail. L’énergie et le temps que nous avons dû mobiliser pour mener à bien la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, ne nous en ont pas laissé l’occasion.
C’est la raison pour laquelle, après avoir auditionné le président Didier Lombard, notre commission sollicite désormais l’autorisation de constituer, en son sein, une mission d’information.
Conformément à l’article 21 de notre règlement, cette demande a été adressée au bureau du Sénat, qui se réunira fin novembre, mais nous souhaitions pouvoir procéder rapidement à sa constitution.
La conférence des présidents qui s’est tenue ce soir a bien voulu donner son accord de principe, avant confirmation officielle, à sa mise en œuvre.
Cette mission comportera dix-neuf membres désignés, comme c’est la règle, à la proportionnelle des groupes.
Je demanderai dès demain aux différents présidents de nous faire connaître leurs candidats, afin d’organiser au plus vite sa formation, la nomination de son bureau et l’élaboration d’un programme de travail, avec l’ambition de pouvoir commencer à travailler dès la mi-novembre.

Je consulte le Sénat sur cette demande.
Il n’y a pas d’opposition ?...
Je constate que le Sénat autorise la création de cette mission.

L’ordre du jour appelle le débat sur les pôles d’excellence rurale.
La parole est à M. Rémy Pointereau, auteur du rapport d’information fait au nom de la commission de l’économie : Les pôles d’excellence rurale : un accélérateur des projets issus des territoires.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 23 juin dernier, nous avons déjà effectué un point d’étape sur les pôles d’excellence rurale, ou PER, dans cet hémicycle, sur une initiative de notre collègue Jean Boyer. Nous avons alors évoqué les actions que ceux-ci ont cristallisées sur le plan local et l’effet d’entraînement qu’ils ont eu sur les territoires. À cette occasion, j’ai pu vous dire tout le bien que je pensais de cette politique rurale.
Le jour même de ce débat, le Gouvernement s’est enrichi, pour la première fois, d’un ministère dédié spécifiquement à l’espace rural et à l’aménagement du territoire, et dont le titulaire était issu du Sénat, puisqu’il s’agissait de vous-même, monsieur le ministre.
Au-delà de la coïncidence, c’est le signe de l’actualité des questions rurales. Réjouissons-nous de leur inscription à l’ordre du jour du Gouvernement. Je trouve d’ailleurs dommage que ce débat important pour la ruralité intervienne à cette heure tardive, avec en outre la concurrence déloyale d’un match de football important, Bordeaux contre le Bayern de Munich.
Sourires
Moins important que celui d’hier !

Je crois savoir qu’à cet instant Bordeaux mène au score.
Réjouissons-nous également, monsieur le ministre, de votre initiative d’organiser les assises des territoires ruraux afin d’établir un plan d’action permettant d’apporter des réponses concrètes pour favoriser l’attractivité des territoires ruraux sur les plans économique et social, en partenariat, et pour répondre aux besoins et attentes des habitants, notamment en termes d’accès aux services et aux commerces. Les pôles d’excellence rurale y contribuent en partie.
La ruralité est aujourd’hui multiple.
C’est bien sûr le monde agricole, fondement de l’économie rurale et gardien des paysages, qui donne à la France rurale son attrait, unique en Europe, me semble-t-il. Le monde agricole souffre, pris en tenailles entre la chute des cours et la hausse des charges, ne l’oublions pas.
Mais les espaces ruraux, c’est aussi une multitude de PME et de PMI, de commerces de proximité. Ce sont de nouvelles populations aux besoins différents – les néo-ruraux veulent disposer des mêmes services qu’en ville – en termes d’infrastructures, d’offres de services publics et au public, de commerces de proximité.
L’animation de ces territoires demande aujourd’hui un esprit « projet » et une réactivité particulière de la part des élus et de tous les acteurs locaux. C’est pourquoi nous avons pris note, avec la plus grande satisfaction, de l’annonce officielle faite par le Premier ministre, le mois dernier, du lancement d’un nouvel appel à projets de pôles d’excellence rurale. Elle rejoint en effet les conclusions auxquelles la commission de l’économie est parvenue à l’issue des travaux du groupe de travail sur les pôles d’excellence rurale, que j’ai eu l’honneur de présider pendant six mois.
Permettez-moi d’indiquer que notre groupe de travail a été constitué au mois de février dernier, sur l’initiative du président de la commission de l’économie, M. Jean-Paul Emorine. Nous avons reçu M. Hubert Falco, puis vous-même, monsieur le ministre. Je vous remercie tout particulièrement de la pleine coopération que vous avez apportée à nos travaux.
Nous avons également accueilli le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires, M. Pierre Dartout, mais il faut à nouveau l'appeler le Datar, puisque vous avez décidé, monsieur le ministre, de redonner à la délégation son nom historique, et je m’en félicite.
Nous avons écouté les principales organisations concernées au niveau national par la politique des pôles d’excellence rurale : l’Association des communautés de communes de France, l’Association de promotion et de fédération des pays, l’Agence de services et de paiements, qui a remplacé le Centre national pour l’aménagement des structures et des exploitations agricoles. Enfin, nous avons sollicité l’avis de M. Jean Boyer, sénateur émérite.
Sur le plan local, nous nous sommes rendus dans mon département du Cher avec nos collègues François Pillet et Gérard Cornu, vice-président de la commission de l’économie, ainsi que dans celui du Gers avec Gérard César, où M. Raymond Vall nous a excellemment reçus. Partout, nous avons pu constater l’engagement important des élus et des entrepreneurs comme des représentants de l’État autour de ces projets.
Les résultats de ces travaux ont été présentés dans le cadre d’un rapport, voté et adopté à l’unanimité le 16 septembre dernier par la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Tout d’abord, qu’est-ce qu’un pôle d’excellence rurale ? Rappelons que le Gouvernement a lancé le 15 décembre 2005 un appel à projets incitant les territoires ruraux à proposer des projets innovants sur quatre thématiques adaptées à la réalité des territoires ruraux d’aujourd’hui : promotion des richesses naturelles, culturelles et touristiques ; valorisation et gestion des bio-ressources ; offre de services et accueil de nouvelles populations ; enfin, productions industrielles, artisanales et de services localisées.
Le Gouvernement comptait labelliser 300 pôles : l’extraordinaire réactivité des territoires s’est traduite par le dépôt de près de 800 projets, parmi lesquels 379 ont finalement reçu le label de « pôle d’excellence rurale ». Conçus dans des délais très contraints, ils ont pourtant réussi à se développer et à prospérer : une vingtaine d’entre eux seulement ont été abandonnés par la suite.
La plupart des pôles devraient atteindre leur terme cette année ou dans le courant de l’année prochaine, moyennant une certaine souplesse dans les délais à laquelle le Gouvernement s’est engagé devant notre groupe de travail.
Avant de nous tourner vers l’avenir, je voudrais d’abord constater que les PER ont été un formidable accélérateur de projets pour les territoires, pour reprendre la formule que j’ai choisie comme titre du rapport.
D’une part, les territoires se sont mobilisés très rapidement pour mettre en place des projets sur les thématiques définies par l’appel à projets.
D’autre part, les PER ont insufflé un esprit « projet », dans un objectif de partenariat public-privé. Le PER, c’est en effet une vision d’ensemble du développement local, portée bien souvent par un élu local « porteur » du projet au niveau d’une communauté de communes, d’un département ou d’un pays.
Cette vision se traduit par des projets concrets, mis en œuvre à la fois par des collectivités et par des entreprises, dans un esprit « public-privé » inspiré des pôles de compétitivité.
L’État n’est pas absent, loin de là : il est à l’origine de l’appel à projets, et la labellisation s’est accompagnée d’une aide au financement qui, en pratique, a représenté 20 % en moyenne du coût des projets.
L’État a toutefois laissé l’initiative aux acteurs locaux. L’aménagement du territoire ne se réalise plus, désormais, du haut vers le bas : il est pris en main par les collectivités locales elles-mêmes, au plus près du terrain, car celles-ci savent déceler les possibilités de croissance et les blocages qui gênent le développement des projets.
Les PER ont ainsi permis de faire aboutir des idées en germe, qui peinaient à démarrer, parce qu’il leur manquait le « coup de pouce » indispensable.
Voilà ce que nous avons constaté au cours de nos travaux et auprès des personnes que nous avons rencontrées.
Il a ainsi paru naturel, à l’issue de la première génération de pôles, de poursuivre par une deuxième génération. Nos travaux ne se sont donc pas limités à un bilan : ils se sont tournés résolument vers l’avenir.
Je ne reprendrai pas l’ensemble des vingt propositions que nous avons faites et qui ont été approuvées par la commission de l’économie. Je sais, monsieur le ministre, que votre réflexion a bien progressé, et je souhaiterais mettre l’accent sur certains points : le calendrier de l’appel à projets, les thèmes abordés, enfin la gouvernance et le financement des pôles.
S’agissant du calendrier, certains ont critiqué la brièveté du délai laissé en 2005-2006 pour le dépôt des dossiers, notamment pour ceux qui ont fait partie de la « première vague ». Pouvez-vous nous rappeler le calendrier qui est aujourd’hui envisagé par le Gouvernement ? Il me semble important de ne pas allonger excessivement les délais, afin que le programme des PER conserve cet effet d’entraînement et de réactivité qui l’a caractérisé.
Je note d’ailleurs que, cette fois-ci, on ne va pas dans l’inconnu : la procédure est mieux connue, certains projets sont déjà en préparation. En un mot, l’« esprit PER » commence à faire partie de la culture des territoires ruraux.
Au sujet des thèmes abordés, vous avez d’ores et déjà mis l’accent sur les socles de services publics et au public. C’est un enjeu essentiel d’attractivité des territoires pour les entreprises et les nouvelles populations, mais aussi, tout simplement, la sauvegarde de la qualité de la vie : l’accès au haut ou au très haut débit peut être la condition de l’implantation d’une entreprise, tandis que l’animation d’un territoire passe aujourd’hui par la création de maisons de service public, de maisons médicales de santé, ainsi que par l’accueil de la petite enfance et des personnes âgées ou à mobilité réduite.
L’attachement de nos concitoyens à la permanence d’un réseau de services publics de proximité s’illustre particulièrement s’agissant de La Poste. L’une des voies à explorer pour renforcer les services au public est celle de leur mutualisation.
Pour autant, il ne faut pas oublier les autres sources de croissance des territoires ruraux ; je pense au développement durable, aux énergies renouvelables, mais aussi à certaines filières existantes – agricoles, bois, élevage –, ancrées sur un savoir-faire local. L’« esprit PER », c’est de savoir trouver dans chaque territoire les projets qui peuvent le revitaliser.
Il faut évoquer, enfin, la vie des projets : leur gouvernance et leur financement.
L’une des principales difficultés rencontrées par les porteurs de projet a été le manque de crédits d’ingénierie : le montage du dossier, la définition de la stratégie, la mise au point du plan de financement sont des tâches complexes pour lesquelles les petites collectivités n’avaient pas toujours les moyens nécessaires.
Il faut sauvegarder et améliorer encore la coopération entre les responsables de PER et l’administration déconcentrée.
Les préfets et les sous-préfets sont de bons connaisseurs des problèmes rencontrés localement. Dès la phase de candidature, ils sont à même, avec leur administration, d’aider les acteurs locaux à mettre en forme leur idée et à préparer un plan de financement. Ils doivent ensuite rester à leur côté pendant la vie du projet.
Cette relation de confiance entre l’État et les collectivités, qui passe par la contractualisation, est source d’efficacité et améliore d’ailleurs l’image de l’État dans les territoires.
Cette confiance doit se traduire également dans les modalités de financement.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer quels moyens le Gouvernement compte consacrer à la nouvelle génération de PER ? Mais au-delà du montant, il est nécessaire de clarifier les règles. Actuellement, les ressources d’État passent par une dizaine de ministères et une demi-douzaine de fonds différents, selon des règles variées qui compliquent sans nécessité la vie des porteurs de projet.
Dans un but de simplification et de transparence, il faudrait rassembler tous ces financements, ou la plus grande partie possible, sur une ligne budgétaire unique avec des fonds dédiés aux PER.
Par ailleurs, pourquoi limiter l’enveloppe de financement à 1 million d’euros par pôle ? La diversité des projets peut justifier un éventail plus large des financements, fondé sur la prise en compte des spécificités locales et non sur une limitation fixée a priori.
Ces difficultés ont été sensibles lors de la première génération de pôles d’excellence rurale. Elles pourraient être résolues, afin de donner au dispositif une efficacité plus grande encore. Un éventail de 500 000 euros à 1, 5 million d’euros me paraîtrait intéressant.
Je voudrais conclure sur un souhait : les PER doivent être considérés non pas comme un dispositif de plus, mais comme un outil au service d’une vision intégrée du développement des territoires. Il ne faut pas opposer les territoires urbains aux territoires ruraux : les habitants qui viennent résider à la campagne, les entreprises qui vont s’y installer ne se reconnaissent pas dans cette séparation.
Il ne faut pas non plus mettre en concurrence les pôles d’excellence rurale et les pôles de compétitivité : ils ont vocation à participer tous ensemble au développement d’un territoire, et même à mieux collaborer et à mieux communiquer ensemble.
Les PER ont montré que les espaces ruraux sont, eux aussi, des réservoirs de croissance. Il n’y a pas de territoire condamné d’avance par les départs d’activités ou de population.
Là où il y a la volonté des hommes et des femmes, la volonté d’élus ou d’entrepreneurs, les territoires se développent. Le nouvel appel à projets, que nous appelons de nos vœux, pourra contribuer à cette autre ambition pour nos territoires ruraux.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je suis ravi d’intervenir pour la seconde fois, en l’espace de quatre mois, sur ce thème des pôles d’excellence rurale, fait suffisamment rare pour être signalé. Nous aurons d’ailleurs cette fois-ci le plaisir d’entendre notre ancien collègue, Michel Mercier, devenu depuis ministre de l’espace rural et de l’aménagement du territoire.
Ce deuxième débat traduit sans doute l’importance des pôles d’excellence rurale dans la politique d’aménagement du territoire et de développement des zones rurales conduite par le Gouvernement et la majorité sénatoriale, ce qui ne signifie pas, je l’espère, que cette politique nationale se résume aux seuls PER.
Cette fois-ci, nous avons une base sérieuse de travail, puisque la commission de l’économie vient d’adopter le rapport d’information de M. Pointereau. Je tiens d’ailleurs à saluer la qualité des travaux qui ont été menés et l’objectivité des conclusions du groupe de travail, qui ne se limite pas à donner un satisfecit général ; il dresse aussi quelques constats moins unanimes, et peut-être moins faciles à entendre, sur les faiblesses du dispositif.
Ce sont ces constats que je souhaite commenter ce soir, non par volonté d’opposition systématique, mais par souci d’améliorer notre politique, chaque fois que l’occasion nous en est donnée. Nous avons d’ailleurs appris récemment qu’une deuxième génération de PER serait lancée l’année prochaine.
J’aimerais toutefois rappeler de façon liminaire que les pôles d’excellence rurale sont le pendant, dans les zones rurales, des pôles de compétitivité qui ont été mis en place dans les zones urbaines et qui ont bénéficié de la réorientation des fonds structurels européens vers un nouvel objectif de compétitivité et d’emploi.
C’est en 2005, et surtout en 2006, que la nouvelle programmation de la politique européenne de cohésion et celle de la politique agricole commune ont été élaborées pour la période 2007-2013. Et c’est à cette date qu’il a été décidé que la politique européenne de développement rural serait complètement rattachée à la PAC et que son fondement serait non plus territorial, mais sectoriel, et que, de son côté, la politique régionale serait concentrée sur les zones urbaines et les zones en reconversion économique.
Il est vrai que le cadre financier européen est désormais contraint et qu’il s’agissait d’adapter les politiques européennes à une Union élargie comptant dix membres de plus.
Ce rappel du contexte européen ne vise pas à dédouaner la France de sa responsabilité, car c’est avec son soutien qu’une telle évolution a eu lieu, soutien d’autant plus fort que cette réorientation des fonds structurels permettait de financer les pôles de compétitivité lancés en 2004.
Cette réforme n’aurait pas été si grave si, de son côté, le deuxième pilier de la PAC s’était concentré sur le développement rural non agricole. Malheureusement, celui-ci est resté principalement orienté sur la modernisation des structures agricoles et n’a pas permis de mettre en place une vraie politique de développement rural entendue comme une politique de soutien destinée au développement économique et social des zones rurales, à l’amélioration de la qualité de la vie et à la protection de l’environnement et des ressources naturelles.
C’est dans ce cadre très contraint et avec des aides européennes limitées que les pôles d’excellence rurale ont vu le jour en France, le Gouvernement se rendant sans doute compte qu’une politique d’aménagement du territoire axée seulement sur la compétitivité risquait d’accentuer les disparités entre zones urbaines et zones rurales.
Toutefois, comme le souligne le rapport d’information de la commission de l’économie, plusieurs obstacles ont empêché les pôles d’excellence rurale de réaliser tout leur potentiel.
L’un de ces obstacles, c’est que nous n’ayons pu aboutir, et j’en suis désolé, à dresser un véritable bilan des résultats de la première génération de PER en termes d’activités durables, notamment en matière d’emplois pérennes, avant de lancer la deuxième génération.
Il est indispensable, monsieur le ministre, que l’ensemble des pôles de première génération soient évalués lorsqu’ils seront tous effectivement en fonctionnement. Nous devons connaître exactement le nombre d’emplois nets créés et d’emplois induits dans l’économie locale. Cela nous paraît très important : quand nous menons une politique, nous devons avoir le souci de l’évaluer systématiquement.
Je formulerai deux remarques.
Tout d’abord, celles et ceux qui connaissent un tant soit peu les exigences des élus savent que, aux yeux de ces derniers, chaque investissement de l’État et des collectivités territoriales doit être assorti de contreparties et de résultats en termes de maintien ou de création d’emplois durables.
Ensuite, je reste persuadé que le défaut d’ingénierie dans les territoires ruraux est un obstacle majeur à une plus grande réussite des PER. C’est réellement par ce biais que nous arriverons à travailler au développement des zones rurales.
Le groupe de travail de la commission a proposé plusieurs initiatives visant à lever cet obstacle, telle l’amélioration de l’accès aux services de la Caisse des dépôts et consignations. Je pense que l’objectif ne sera pas atteint tant que le PER ne financera pas aussi, au moins en partie et sous des formes appropriées, des dépenses de fonctionnement, notamment des dépenses en ingénierie.
Je suis enfin quelque peu resté sur ma faim quant à l’existence d’un véritable label PER, qui supposerait une réelle volonté de considérer ceux-ci, également, comme des expérimentations ayant vocation à être pérennisées et adaptées à d’autres territoires. Ma collègue Odette Herviaux avait souligné ce point en commission, et je le crois fondamental. Nous sommes tous d’accord pour insister sur la spécificité des pôles en fonction du contexte local, mais une trop grande originalité dans le montage empêcherait de le reproduire ailleurs.
Je propose qu’une partie du fonds PER qui, je l’espère, devrait naître de nos réflexions puisse servir directement à aider au montage d’autres projets, parfois quasiment similaires, dans d’autres territoires. Il faut instaurer un échange des bonnes pratiques et une diffusion des modèles qui auront rencontré un succès.
Il faudra aussi accentuer les liens entre pôles de compétitivité et pôles d’excellence rurale, entre urbain et rural, ce qui me paraît garantir une meilleure cohésion territoriale.
L’excellence, ne l’oublions pas, a valeur d’exemple et d’expérience. Au moment où nous nous apprêtons à accueillir la deuxième génération de PER, je reste doublement inquiet pour la pérennité des premiers projets labellisés, notamment de ceux qui entrent en fonctionnement maintenant seulement et qui auront encore besoin d’un accompagnement financier.
Monsieur le ministre, le décalage entre les sommes engagées et les sommes payées est encore trop important. La première étape est loin d’être achevée, et il est envisagé de repousser l’échéance de décembre 2009 à décembre 2010.
Par ailleurs, il n’aura échappé à personne que les PER constituent aussi une mutualisation financière, puisque l’État contribue à chaque projet au maximum à hauteur de 33 %, mais qu’en réalité sa participation, rapportée à l’ensemble des PER, est en moyenne de 20 %. La crise économique affecte directement les investisseurs, publics et privés, qui sont tentés, et on le comprend parfois, de concentrer leurs actions sur des activités jugées immédiatement rentables ou indispensables.
À cette incertitude provoquée par la conjoncture économique, il faut ajouter une incertitude politique tout aussi importante, parfois même plus déterminante : celle que le Gouvernement crée et entretient, notamment en proposant une réforme des collectivités territoriales qui peut se révéler inadaptée. On sait très bien que, souvent, le conseil général est l’un des principaux financeurs des pôles d’excellence rurale : s’il perdait, par exemple, sa compétence générale, il serait inévitablement amené à se mettre aux « abonnés absents » et ne pourrait plus se permettre de soutenir des initiatives aussi importantes.
Le rapport du groupe de travail montre très justement la nécessité de créer un fonds PER pour que l’action de l’État soit plus lisible. Je rejoins complètement mon collègue sur cette question et je souscris à la proposition d’inscrire une ligne budgétaire spécifique dans le projet de loi de finances. Mais l’État ira-t-il jusqu’à cette lisibilité ? Car, inévitablement, celle-ci fera apparaître que, sans les collectivités, en particulier sans l’ingénierie qu’elles mettent à disposition, bon nombre de projets ne verraient pas le jour !
Je sais gré à M. le rapporteur d’avoir proposé que les collectivités locales, qui assument le poids financier de ces pôles, soient considérées non pas uniquement comme de simples tiroirs-caisses, mais aussi comme des décideurs dignes de contribuer, en amont, à l’élaboration des appels à projets.
Dans le même temps, qui peut dire si, avec la disparition programmée de la taxe professionnelle, mais aussi avec le projet de modification de la compétence générale que j’évoquais tout à l’heure, voire avec la réforme territoriale dans son ensemble, les collectivités, les groupements de communes, les pays pourront continuer à financer ces pôles ? Véritable incertitude ! Les collectivités n’ont pas suffisamment d’assurances sur leur propre avenir pour intervenir durablement dans des projets qui, somme toute, ne relèvent pas de leur champ d’intervention premier.
Les collectivités locales étaient jusqu’ici contraintes à limiter leur participation financière du fait des décisions de l’État. Monsieur le ministre, prévoyez-vous d’augmenter votre contribution pour assurer la survie des projets ? Envisagez-vous de flécher plus de fonds européens sur les pôles d’excellence rurale ?
Je suis enfin plus circonspect, et ce sera là le dernier point de mon intervention, sur les thèmes d’appels d’offres que vous semblez retenir dans la prochaine génération de PER : développement durable, services publics, soutien aux filières traditionnelles existantes, telles sont les trois orientations que vous avez données.
Comme M. Pointereau l’a indiqué dès le préambule de son rapport, les pôles d’excellence rurale ne sauraient se substituer à une vraie politique d’aménagement du territoire et de développement rural. Ils constituent des valeurs ajoutées et doivent être considérés comme tels. L’État ne doit en rien s’exonérer de ses responsabilités propres en matière de transports, de lutte contre les déserts médicaux ou de services publics. Les 379 pôles labellisés ne doivent en aucun cas masquer la réalité des 36 000 communes, pour qui la survie territoriale est souvent la norme.
Lors d’une récente conférence de presse, monsieur le ministre, vous avez souhaité être le ministre du concret : ce soir, nous allons essayer d’être des sénateurs du concret.
Souhaitez-vous vraiment que la nouvelle génération de pôles d’excellence rurale permette, dès 2010, de financer des projets de services publics ?
J’aimerais également que vous nous apportiez quelques garanties sur les dossiers qui seront privilégiés.
Comme tous mes collègues ici présents, je serai, monsieur le ministre, très attentif à ce que les nouvelles générations de PER ne soient pas une fois de plus un prétexte pour faire financer par d’autres des services publics d’État, un moyen de maquiller, sous couvert d’excellence pour quelques-uns, le délitement des services publics prévus pour le plus grand nombre et d’organiser, comme c’est le cas dans certaines zones, des déménagements du territoire.
Si tel était le cas, je vous le dis tout net, monsieur le ministre, nous ne serions pas d’accord, et je sollicite du président du groupe de travail, ainsi que du président de la commission de l’économie la plus grande vigilance sur cette question. Directions départementales de l’agriculture, directions départementales de l’équipement, aujourd’hui l’Office national des forêts, parfois les gendarmeries, les tribunaux : la ruralité connaît un départ impressionnant de services publics. Ce processus doit être stoppé. La révision générale des politiques publiques a fait des ravages dans nos territoires.
Le groupe socialiste, qu’avec Yves Chastan je représente ici, soutient le principe de nouvelles générations de PER, afin d’accélérer le financement de projets de développement local. Il n’empêche que nos réserves sont bien réelles quant à la philosophie générale dans laquelle ce renouvellement s’inscrit. En d’autres termes : oui à un label PER qui permette de dynamiser les énergies locales, non à une vitrine PER qui masquerait les difficultés actuelles des territoires ruraux, notamment en termes de maintien des services publics, difficultés que nous vivons au quotidien dans nos circonscriptions et que nous continuons à dénoncer.
Comme nombre d’élus ruraux, monsieur le ministre, j’attends avec impatience vos réponses à ces questions.

M. Raymond Vall. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, prendre la parole après le rapporteur du groupe de travail sur les PER et après mon collègue Martial Bourquin me permettra d’adopter une position radicale.
Sourires

Il est clair que la décision de lancer un nouvel appel à projets de PER a suscité très rapidement un grand espoir dans les territoires, en particulier dans les territoires ruraux. Le premier appel à projets a largement répondu à l’espérance du Gouvernement et, globalement, les projets qui en sont issus sont une réussite.
J’irai directement aux vingt préconisations – qui, je le rappelle, ont été adoptées à l’unanimité par les membres de la commission de l’économie – et je les classerai en deux catégories.
Appartiennent à la première catégorie les propositions qui visent à dresser un bilan des PER de la première génération et à en améliorer le dispositif.
C’est vrai, il est nécessaire de revoir les modalités de soutien à l’ingénierie de conception des projets ; il faut mobiliser les services des préfectures, parfois insuffisamment impliqués ; il faut fixer pour la préparation des candidatures un délai incitatif, mais sans trop laisser traîner les choses afin que les projets soient de bons projets ; il faut mieux coordonner les PER avec les politiques conduites par les régions et par les départements, notamment dans les domaines de compétences de ces collectivités qui, en général, sont ensuite intégrées dans les contrats de projet État-régions et dans les documents de planification ; enfin, il faut favoriser la coopération entre les PER et les pôles de compétitivité. Je crois que nous sommes tous d’accord sur ces divers points.
Les propositions appartenant à la seconde catégorie tentent de répondre à un grand nombre des inquiétudes qui ont été exprimées, monsieur le ministre, et pourront probablement apaiser, au moins partiellement, les craintes de l’orateur qui m’a précédé.
Ainsi, je veux souligner l’importance de la proposition 9, qui vise à ce que la labellisation par le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire, au nom du Gouvernement, d’un projet reconnu comme étant en mesure de développer un territoire s’accompagne de l’engagement ferme de l’État de maintenir, sur le territoire concerné, les services publics indispensables à la vie locale. Nous attendons de M. le ministre qu’il nous indique sa position ; cela pourrait contribuer à répondre, au moins en partie, au point qui a été évoqué.
Nombre de ces propositions comportent des innovations.
Aux termes de la proposition 19, lorsque sont labellisés des PER susceptibles d’être reproduits ailleurs et qui revêtent un caractère d’intérêt général, il faut favoriser les échanges de bonnes pratiques entre les porteurs de projets des deux générations de PER. L’instauration de tels échanges pourrait représenter une première réponse à la préoccupation qu’exprimait mon collègue, et qui me paraissait justifiée.
Par ailleurs, le fait d’avoir souhaité et permis le regroupement de communes ou de communautés de communes pour atteindre une taille correspondant à un bassin de vie ou à un bassin d’emploi constitue une avancée qui permettra à cet ensemble, qui peut aujourd’hui porter le nom de pays, mais qui pourra demain, par convention, porter le nom d’un groupement de communes, de réaliser des investissements.
Enfin, ces nouvelles propositions ont mis l’accent sur l’idée de pouvoir garder et accueillir des populations qui ont besoin de services publics et de services au public. L’énumération qui figure dans la proposition 11 est très précise et correspond aux préoccupations qui ont été évoquées précédemment.
Tout cela me paraît extrêmement positif et, en ce qui nous concerne, nous serons évidemment attentifs aux réponses qui seront apportées aux propositions du Sénat, propositions qui me semblent répondre à l’attente de ces territoires ruraux.
Malheureusement, monsieur le ministre, je suis obligé de dire que l’espoir suscité par ce nouvel appel d’offres – et je vous remercie d’en avoir été un ardent défenseur – peut aujourd’hui être mis à mal par l’annonce de la volonté de supprimer les pays.
Notre territoire comporte 370 pays, qui ont porté 30 % des projets PER. Ces pays comptent en moyenne 60 000 habitants et ils répondent, par conséquent, à la notion que l’on a voulu introduire dans ce texte, celle de bassin de vie et bassin d’emploi, qui me semble indispensable pour les aides de l’État.
Sur les 211 enveloppes affectées à l’État français dans le cadre de la politique européenne de développement rural, 160 enveloppes ont été attribuées à des pays sur le programme leader +. D’ailleurs, ces enveloppes répondent à l’une des préoccupations soulevées par nos collègues, à savoir la difficulté de disposer de l’ingénierie nécessaire. Au travers des programmes leader +, on peut se doter d’un certain nombre de projets et il faut éviter de perdre une telle possibilité.
Ces pays – ils ne sont pas les seuls – ont engagé la déclinaison de la politique gouvernementale d’aménagement du territoire via les SCOT, les plans climat territoriaux, les agendas 21 et les premières décisions du Grenelle de l’environnement. Ils sont devenus des espaces à la fois d’échanges entre le secteur public et le secteur privé et de démocratie participative ; au moment où l’on constate une fracture importante entre le politique et les citoyens, il me paraît dommage de les supprimer.
Par ailleurs, grâce à cette mutualisation des compétences, aujourd’hui, les pays disposent en moyenne de trois à quatre emplois. Si nous supprimons les pays, nous allons sacrifier entre 800 et 1 000 jeunes techniciens compétents, qui sont au service de tout un tissu de communes, parce qu’on ne peut pas transférer toutes les compétences aux communautés de communes. Cela signifie qu’une commune de 200 habitants, par exemple, ne pourra jamais avoir accès à ces fonds et n’aura pas la possibilité de financer ces emplois de jeunes techniciens. Par conséquent, on créera une fracture s’agissant des compétences générales qui n’ont pas été transférées à l’intercommunalité, alors que des projets existent.

Pourquoi un tel acharnement sur ces structures qui sont issues d’un volontarisme local et d’une démarche pragmatique ?
Les pays ont aujourd'hui la possibilité de résoudre un problème préoccupant lié à l’accès aux fonds européens. Le volet de coopération de ce programme leader +, troisième génération, s’est soldé par la non-utilisation d’une enveloppe de 30 millions d’euros.
Le problème risque de s’aggraver aujourd'hui. Il faut absolument tenir compte de toute cette vie de pays : elle a été traduite dans une loi ; l’État s’est engagé ; le Gouvernement a contresigné les conventions territoriales.
Je sais que ce combat sera difficile, mais selon un proverbe chinois, les seuls combats perdus d’avance sont ceux que l’on n’engage pas.

M. Raymond Vall. J’ajouterai que ce n’est pas parce qu’on est seul, ou presque seul, que l’on a tort.
Applaudissements sur les travées du RDSE et du groupe socialiste, ainsi que sur le banc des commissions

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l’idée des pôles d’excellence rurale a été lancée en 2005 et ce dispositif s’est inspiré des pôles de compétitivité adoptés en faveur des villes. En 2009, monsieur le ministre, l’État continue à suivre de près une politique utile à l’aménagement du territoire.
Ce dispositif a eu pour ambition d’apporter un soutien aux projets émanant des territoires ruraux en leur permettant de découvrir et de développer des richesses qui, reconnaissons-le, étaient parfois en sommeil. Ces pôles d’excellence rurale ont fait l’objet d’une réflexion et d’une mobilisation collective permettant parfois, monsieur le rapporteur, de chasser un pessimisme de circonstance. Ils ont aussi été à l’origine d’un véritable partenariat public-privé, jusqu’ici non fonctionnel. Certains projets ont été l’occasion d’affirmer la transformation, dans les départements ruraux, de handicaps en atouts.
Par ailleurs, soyons satisfaits, car de 300 projets prévus à l’origine, la Commission nationale de présélection des pôles d’excellence rurale a finalement validé 379 projets. Bravo et merci, monsieur le ministre ! Il convient également de remercier votre prédécesseur, car les élus constatent souvent un manque de crédits de la part du Gouvernement. Mais, en la circonstance, il y a eu un plus, que nous avons apprécié.
Reconnaissons très objectivement que l’État a suivi toutes les initiatives locales, dépassant assez largement l’objectif initialement fixé. C’est un encouragement à poursuivre des actions de développement local.
Ces projets à financements divers et multiples se sont étalés sur trois ans. D’ailleurs, aujourd’hui, tous ne sont pas bouclés, mais ils le seront certainement. Notre collègue Rémi Pointereau, sénateur du Cher, a accepté une mission nécessaire objective, prospective, voire visionnaire. Il sera sans aucun doute un artisan actif à vos côtés, monsieur le ministre, au sein des assises des territoires ruraux.
Cher Rémi Pointereau, vous habitez le Cher et vous connaissez bien Vierzon. On y fabriquait du matériel agricole, que j’ai utilisé lorsque j’étais en activité ; on y fabriquait également des locomotives et des tracteurs : je sais que vous serez toujours le tracteur qui tirera la charrue des pôles d’excellence rurale.
Sourires

Je formulerai une autre appréciation positive : reconnaissons, monsieur le ministre, que l’existence d’un ministère de l’espace rural permet la prise en compte tangible de nos territoires ruraux, donc de tous nos territoires.
Nous nous félicitons que notre ministre, ex-sénateur, toujours élu départemental, sache qu’il existe aussi, dans le Rhône ou ailleurs, ce monde rural où, s’il n’y a pas la tour Eiffel, se trouvent des hommes de bonne volonté qui veulent que leur pays puisse associer à la fois économie et écologie, notamment dans le cadre du Grenelle de l’environnement. La France rurale n’a pas de grands équipements, mais elle a des responsables qui aiment leur pays et se battent régulièrement pour compenser les handicaps qui la singularisent dans certains secteurs.
Dans les zones de revitalisation rurale, ou ZRR, les compensations fiscales ont été surtout appréciées lorsqu’elles risquaient d’être perdues : on apprécie un avantage quand on ne l’a plus !

Des richesses en sommeil dans nos territoires ont attiré l’attention sur différents secteurs comme la filière bois, le tourisme, le patrimoine ou la qualité des productions.
Dans quelques semaines, nous serons amenés à tirer les conclusions de cette première initiative en faveur des territoires ruraux. Néanmoins, je me permettrai de vous livrer mon sentiment personnel : un état d’esprit collectif est souvent indispensable ; dans les pôles d’excellence rurale, on ne peut pas « jouer perso » si l’on veut participer à la construction de l’édifice ; il faut apporter les complémentarités indispensables à une réussite collective.
Les pôles d’excellence rurale sont jeunes ; il faut les regarder grandir et, pour cela, surveiller leur développement, mais aussi leurs difficultés. Ils vont accompagner encore longtemps nos territoires ruraux. Une mise au point semestrielle me semble une démarche minimale pour voir si quelqu’un ne reste pas au bord de la route.
Enfin, le système des financements croisés ne peut-il pas être amélioré, afin que les projets ne soient pas bloqués ?
Monsieur le ministre, certains retards sont indépendants de la volonté des porteurs de projets et correspondent plutôt à des comportements personnels négatifs – les parcelles ne sont pas disponibles, le propriétaire se bloque – ou à des délais incompressibles dus à l’administration. C’est la raison pour laquelle il a été demandé de porter une attention bienveillante à certains porteurs de projets dont le retard n’était pas imputable à leur comportement.
L’idée d’une ligne budgétaire spécifique pour les pôles d’excellence rurale est avancée. Elle aurait, monsieur le ministre, le mérite de la clarté par rapport aux fonds ministériels mutualisés, qui sont peu visibles pour les acteurs de ces programmes de développement.
Nous avons pu également constater que le montage de certains dossiers avait été trop rapide. Il faudra demander aux responsables des pôles de ne pas agir dans la précipitation. Nous avons pu dresser ce constat dès la mise en place de la première vague des PER. C’était une aubaine pour les responsables ruraux et ils sont parfois allés un peu vite, sans avoir suffisamment réfléchi.
Reconnaissons malgré tout que cette initiative nationale a été très appréciée.
Dans le contexte actuel où les difficultés sont importantes, voire persistantes, où la morosité est contagieuse, la deuxième génération de PER sera indiscutablement bienvenue. Elle apportera à cette France rurale, à cette France d’en bas, des possibilités nouvelles qui non seulement génèreront des richesses, mais également créeront indiscutablement une envie d’entreprendre et de travailler ensemble.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE et du groupe socialiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce débat sur les pôles d’excellence rurale marque, une fois encore, l’attachement de la Haute Assemblée aux questions de la ruralité.
Je tiens en premier lieu à rendre hommage à mes collègues Jean-Paul Emorine et Rémy Pointereau, qui ont pris l’initiative de créer, en février dernier, au sein de la commission de l’économie, un groupe de travail dédié aux pôles d’excellence rurale, afin d’en établir un bilan et d’analyser leurs effets sur le développement des territoires ruraux.
Le rapport d’information, présenté par notre collègue Rémy Pointereau, souligne le succès des PER créés en 2006 et 2007 et qui arrivent à leur terme à la fin de cette année. La raison de ce succès, c’est que les projets sont définis localement et mis en œuvre par les acteurs des territoires, et qu’ils bénéficient d’un ancrage rural fort.
En conséquence, le rapport d’information préconise de continuer cette politique fédératrice et dynamisante pour les territoires ruraux : sont ainsi formulées vingt propositions en vue du lancement d’une seconde génération de pôles d’excellence rurale, pour en améliorer encore l’efficacité.
À ce sujet, le Premier ministre, François Fillon, qui était en déplacement dans mon département de la Gironde le 8 septembre dernier – vous étiez présent, monsieur le ministre –, notamment pour saluer la cohérence du développement local, a annoncé l’engagement d’un nouveau cycle de pôles d’excellence rurale pour 2010, ce dont nous nous réjouissons tous.
À l’origine, lors de leur création, à la fin de l’année 2005, les pôles d’excellence rurale devaient être au nombre de 300. Finalement, près de 400 PER ont été labellisés. Ce bilan positif nous conduit tout naturellement à appeler de nos vœux une nouvelle vague de PER pour le développement, l’attractivité et la compétitivité de nos territoires ruraux.
Toutefois, comme le souligne très opportunément Rémy Pointereau, les thématiques du nouvel appel à projets devront désormais être orientées en priorité vers le développement durable, les services au public et le soutien aux filières existantes.
J’adhère totalement à ces nouveaux objectifs, qui me paraissent essentiels et incontournables. Néanmoins, chaque situation particulière doit être étudiée avec pragmatisme, en vue d’apporter le meilleur soutien aux territoires.
Par ailleurs, les PER marquent un engagement fort de l’État, que le rapporteur du groupe de travail a souligné, notamment d’un point de vue financier, mais également par l’intervention des préfectures et des services aux côtés des collectivités territoriales.
Les pôles d’excellence rurale constituent aussi un outil concret au service de la relance. Plus d’un milliard d’euros d’investissement auront été réalisés au titre des PER à la fin de l’année 2009, grâce au versement de 160 millions d’euros de crédits de paiement par l’État cette année, après 45 millions d’euros l’an dernier. On constate d’ores et déjà que 6 000 emplois directs ont été créés en 2008 et 2009, et l’on estime à 30 000 le nombre total d’emplois qui auront été créés ou maintenus à l’issue de l’opération, dont 11 600 emplois directs, ce qui est considérable.
Le partenariat public-privé, condition de l’éligibilité d’un projet au dispositif des PER, a également profondément modifié et dynamisé les méthodes de travail sur le plan local. L’évaluation montre que l’association des entreprises est souvent difficile ; mais, lorsque le partenariat est noué, il perdure et apporte au PER une dimension économique incontestable et indispensable.
Les travaux d’évaluation qualitative confirment l’effet positif des PER en termes d’accélération et d’amplification des projets locaux, de revalorisation de l’image des territoires ou d’aide à la reconversion de territoires fragilisés. Il y a là un véritable effet de « label » pour le territoire, qu’il faut faire vivre dans la durée.
Les évaluations font apparaître nombre de résultats remarquables, par exemple pour les PER développés autour de la filière bois, qu’ils concernent l’utilisation du bois dans l’éco-construction ou le développement de filières d’énergies renouvelables ancrées dans les territoires.
En Gironde, cinq pôles d’excellence rurale ont été labellisés en 2006, ce qui représente une véritable chance pour le département.
Il s’agit du projet de territoire visant à développer l’activité touristique, culturelle et économique de la juridiction de Saint-Émilion autour des richesses du patrimoine bâti et du patrimoine naturel ; du projet de « l’Estuaire de la Gironde, l’univers nature », espace naturel remarquable, le plus vaste et le mieux préservé des grands estuaires européens ; du « pôle biomasse : énergie et chimie verte », avec la création d’une filière bois, d’une filière bioénergie et chimie verte ; du pôle de valorisation de la race bazadaise – ce quatrième PER, qui est celui qui me tient le plus à cœur et pour lequel je me suis particulièrement investie, a pour objectif de promouvoir le terroir de la région du grand Bazadais par la valorisation de l’ensemble des richesses naturelles au travers de deux opérations : la création d’une ferme éducative sur la race bazadaise et l’ouverture d’une vitrine de promotion et de valorisation des produits du terroir ; enfin, le cinquième PER, qui a été récemment qualifié de « réussite » par le Premier ministre et par vous-même, monsieur le ministre, lors de votre visite, est celui de l’Entre-Deux-Mers.
Ce dernier PER, encore plus important que les précédents pour le département de la Gironde, a pour stratégie de développement économique l’œnotourisme, qui repose sur la valorisation du vignoble et des produits du terroir. Le renforcement du partenariat, permis par ce PER, entre l’office du tourisme et les viticulteurs est considéré comme une vraie réussite dans le département et bénéficie d’un report du délai de réalisation jusqu’au 31 décembre 2010.
Je crois savoir – et je ne peux que m’en féliciter, mais vous me le confirmerez, monsieur le ministre – que la conviction du Président de la République est non seulement que, dans cette crise qui dure, nous ne devons laisser aucun territoire sur le bord du chemin, mais également que la France peut en sortir plus forte si elle investit utilement, notamment dans ses territoires.
L’aménagement du territoire et la ruralité devraient donc figurer parmi les six domaines prioritaires d’investissement d’avenir identifiés par le Président de la République, et susceptibles de bénéficier des moyens financiers tirés d’un grand emprunt. En tant que représentante d’un territoire rural, je ne peux que me réjouir d’une telle décision.
Les territoires ruraux connaissent aujourd’hui de profondes transformations. Terres d’exode pendant plus d’un siècle, ils bénéficient de nos jours, de manière affirmée et presque généralisée, d’une attractivité indiscutable, comme l’attestent les derniers résultats du recensement de la population. Ruralité rime désormais avec modernité, ce qui n’a pas toujours été le cas.
Nos concitoyens viennent non seulement y chercher un environnement de qualité, mais ils souhaitent également y trouver du travail, des systèmes de transport efficaces, des services publics accessibles, ainsi que le même accès que les urbains à internet et à la société de l’information.
À l’évidence, les zones rurales continueront à se développer dans les dix ou vingt prochaines années grâce à l’arrivée de nouveaux habitants et à une volonté politique affirmée depuis 2002, avec la loi relative au développement des territoires ruraux, les zones de revitalisation rurale – qu’il faut absolument maintenir –, les pôles de compétitivité et les pôles d’excellence rurale, sans oublier les lois de modernisation de l’agriculture.
Les territoires ruraux ont ainsi pu démontrer leur dynamisme et leurs atouts. La forte mobilisation des partenaires a permis d’aller au-delà des objectifs initiaux et de mettre en place des outils spécifiques aux territoires ruraux.
Au final, mes chers collègues, les pôles d’excellence rurale constituent le dispositif emblématique de la ruralité positive, entreprenante, appuyée sur ses valeurs et sur les richesses de nos territoires. Donc, souhaitons-leur longue vie !
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre débat porte sur les pôles d’excellence rurale lancés en décembre 2005 dans le but de renforcer la cohérence de l’action publique et les synergies locales dans les zones rurales. Mais, plus largement, il s’agit pour nous d’évoquer la politique de développement rural et d’aménagement du territoire menée par le Gouvernement et son degré d’efficacité pour, d’une part, compenser les handicaps humains et naturels des zones rurales et les écarts de croissance qui en découlent et, d’autre part, valoriser les ressources et les atouts existants, qui sont souvent sous-exploités.
J’évoquerai d’abord le redressement démographique des espaces ruraux et les mutations qui s’y produisent.
Si l’exode rural a marqué nos campagnes depuis l’après-guerre et a amené l’État à mettre en place des politiques publiques d’aménagement du territoire pour ne pas laisser ces espaces à l’abandon, on assiste aujourd'hui à un renouveau d’attractivité et à l’installation, ou au retour, de nouvelles populations à la recherche d’un cadre de vie et d’un environnement plus agréables.
La population rurale se modifie donc, avec de moins en moins d’actifs agricoles, mais également plus d’ouvriers, d’artisans et de retraités, quelquefois même en proportion plus importante que dans les villes. On assiste à un développement de l’emploi dans le secteur tertiaire, notamment en matière de services à la personne, à un maintien des activités industrielles – agroalimentaire, mécanique, imprimerie, textile –, lesquelles sont souvent en mutation, et, enfin, à un développement du télétravail.
Comment accompagner cette nouvelle dynamique qui semble s’être enclenchée et l’évolution des espaces ruraux qu’elle rend nécessaire ?
Le rapport du Commissariat général du plan sur les politiques de développement rural de juin 2003 avait identifié cinquante-neuf dispositifs opérationnels visant à stimuler le développement rural. Mais il soulignait aussi le manque de lisibilité des politiques menées par l’État et l’absence de cohérence des choix stratégiques et des actions, qui sont souvent conduites de façon trop sectorielle.
Face à l’affirmation des prérogatives des collectivités territoriales et de l’Union européenne, laquelle soutient une politique régionale économique et sociale visant à réduire l’écart de développement entre les différentes régions européennes, l’État doit continuer à jouer un rôle moteur dans l’aménagement du territoire et assumer la responsabilité qui est la sienne pour garantir la cohésion de ce dernier.
Mais une nouvelle conception du développement des territoires est à construire de façon coordonnée et partagée entre les différents acteurs de ces territoires. Cela rend particulièrement nécessaire le maintien de services publics et de services au public de qualité et fait aussi naître des besoins auxquels il faut répondre : habitat résidentiel et locatif, infrastructures d’éducation, de santé, de garde d’enfants, transports adaptés, nouvelles technologies de l’information et de la communication, structures d’accueil pour les touristes, mise en valeur de l’espace, des paysages, du patrimoine, commerce et artisanat, formation professionnelle, ou bien encore qualification.
Ces besoins sont bien sûr différents selon les zones rurales. L’intervention publique doit s’adapter à cette diversité de besoins, mais aussi de moyens.
Les services déconcentrés de l’État ont donc encore un rôle important à jouer, en coordination avec les collectivités locales et avec le soutien des associations de développement rural.
Les pôles d’excellence rurale affichaient cette ambition de renouveau de la politique d’aménagement du territoire dans les zones rurales et de promotion des partenariats locaux public-privé. Il est vrai qu’ils ont donné de la visibilité et des financements à des projets locaux de qualité, puisque l’on estime qu’une bonne centaine de ces projets sont de bons exemples de développement territorial avec des actions innovantes portées par le public et le privé.
Cette créativité institutionnelle a pu provoquer un effet de levier intéressant, malheureusement essentiellement pour des projets déjà existants.
Il reste que, dans les zones rurales, le manque d’ingénierie pour monter des projets et des clusters est un handicap, ce qui explique peut-être le lent démarrage de la première génération des PER.
Les deux caractéristiques principales des zones rurales, notamment des zones les plus reculées, restent leur faible densité de population et le manque d’activités économiques, qui handicapent les acteurs locaux pour se structurer et piloter des projets.
Le département de l’Ardèche, dont je suis l’élu, a souscrit à huit PER avec des thématiques différentes. Je n’en évoquerai qu’un : le développement d’un projet de service productif local fondé sur la mise en place d’une nouvelle fibre textile. Ce projet, qui devrait relancer l’activité textile – très importante pour mon département –, montre qu’il est possible de développer un secteur de recherche et une industrie en milieu rural grâce à un partenariat public-privé entre une communauté de communes portant le projet et l’association d’une quinzaine de chefs d’entreprises.
Quoi qu’il en soit, je suis obligé de constater qu’il existe souvent un écart important dans la réalisation des opérations des PER. Celui-ci peut s’expliquer par un manque de soutien technique, par des délais trop contraignants lors de la présentation des projets de la première phase des PER et, bien sûr, par les difficultés conjoncturelles récentes liées à la crise économique.
C’est pourquoi je souhaite que soient accordés des délais pour les PER de la première génération susceptibles de concrétiser des opérations intéressantes et innovantes qui n’ont pu être menées à bien dans le temps imparti. Je sais que des préfets – c’est d’ailleurs le cas en Ardèche – ont déjà agi en ce sens.
Pour en revenir aux PER de deuxième génération, je souligne que le dispositif d’appel à projets peut favoriser les zones où il y a déjà une concentration de capital humain, technique et financier. En effet, disposer d’un projet, mener les études préalables, construire, le projet puis passer au montage financier requiert des connaissances et un degré d’expertise qui peut faire défaut dans certaines régions rurales.
Les financements proposés, notamment par l’État et ses services, ont d’ailleurs été d’une grande complexité. Je souhaite que la création d’un « fonds PER » permette de simplifier les montages financiers pour la deuxième phase à venir. Toutefois, une partie de ce fonds devrait être consacrée à l’aide au montage des opérations et, le cas échéant, à certaines dépenses connexes de fonctionnement, afin que les zones les plus en retard puissent aussi y participer et développer des initiatives innovantes et pérennes.
L’une des critiques principales que je ferais est que les collectivités territoriales n’ont peut-être pas été assez associées à la définition du dispositif, alors qu’elles en sont les acteurs principaux, soit en portant les projets, soit en étant la source principale de financement.
Le rapport d’information aboutit à une vingtaine de propositions pour donner un nouvel élan à l’excellence rurale et dépasser les obstacles auxquels ont été confrontés les premiers PER. Je soutiens ces propositions. J’espère que le prochain appel à projets en tiendra le plus grand compte. J’en profite d’ailleurs pour souligner la qualité du travail de M. Pointereau et de l’ensemble des membres du groupe de travail.
S’agissant des orientations possibles de la deuxième génération des PER, nous savons seulement, pour l’instant, qu’il sera demandé aux nouveaux pôles de mettre l’accent sur l’innovation, les services au public et l’emploi. Cette ambition peut paraître quelque peu démesurée par rapport aux résultats obtenus par la première génération de PER – il faudra d’ailleurs procéder à une évaluation à la fin de ceux-ci – et aux moyens, certes limités, mais tout de même non négligeables, mis par l’État dans ces « contrats » au travers de redéploiements de crédits, y compris européens.
En tout état de cause, les pôles d’excellence rurale ne régleront évidemment pas l’ensemble des problèmes, en particulier ceux qui sont liés aux enjeux nationaux, lesquels devraient être prioritaires pour l’État. Les PER ne doivent surtout pas cacher les défaillances des autres politiques d’aménagement du territoire, notamment en matière de services publics.
Les services publics doivent être efficaces et accessibles à tous les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence. Il s’agit d’un principe communément admis dans notre République, mais qui est malheureusement de plus en plus éloigné de la réalité, surtout dans les zones rurales. Nous le constatons depuis quelques années : qu’il s’agisse de services essentiels à la population ou de services d’intérêt général comme la santé, l’accès aux soins ou la justice, l’État se désengage ou s’éloigne des zones les moins densément peuplées, au mépris des principes de solidarité et de cohésion économique et sociale des territoires.
Or l’attractivité économique des zones rurales et l’installation de nouvelles populations, comme nous l’avons vu, dépendent du maintien et du développement des services publics et des services au public. Le maillage des territoires par ces derniers est donc une absolue nécessité.
Quant aux collectivités territoriales, vouées à subir une réforme de leurs compétences et de leur organisation, elles risquent d’être asphyxiées par la suppression de la taxe professionnelle. Comment départements et régions pourront-ils poursuivre leurs forts partenariats avec les communes et les EPCI, notamment dans les futurs PER, si leurs compétences et leurs moyens se trouvent fortement érodés ? Nous sommes donc à un tournant pour l’avenir des zones rurales et les PER ne suffiront pas.
Dans tous les cas, ne faisons pas l’impasse sur les difficultés actuelles des territoires ruraux et sur la responsabilité de l’État à assurer l’équité territoriale.
Le nouveau ministre de l’espace rural et de l’aménagement du territoire annonce avoir une autre ambition pour les territoires et compte orienter la politique d’aménagement vers la compétitivité des territoires ruraux, la correction des inégalités et la réduction de la fracture territoriale. Nous sommes prêts à le suivre dans cette voie, mais nous aimerions en savoir plus.
Monsieur le ministre, vous avez lancé l’idée des assises des territoires ruraux. Vous avez déclaré que ces assises permettraient d’aborder sans tabou tous les sujets de la vie des territoires : la santé, le transport, l’emploi, la formation, l’enfance, etc. ; dans la transparence et la concertation, ce serait encore mieux, car, pour l’instant, nous n’avons aucune information sur les tables rondes, les participants et les rencontres départementales qui devraient avoir lieu. C’est sans doute un peu trop tôt… Néanmoins, je vous remercie par avance des éclaircissements que vous pourrez nous apporter à cet égard.
J’aimerais aussi en savoir plus sur l’avenir de la Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires. Je me demande si l’instabilité de son rattachement ministériel, qui n’est pas de votre fait, monsieur le ministre, n’est pas néfaste à terme. En effet, sans faire toute une litanie, depuis 2003-2004, les rattachements ont changé à peu près tous les deux ans.
Jusqu’à une période récente, la DIACT était rattachée au ministre d’État chargé de l’écologie. Désormais, elle est rattachée aux services du Premier ministre et du ministre de l’espace rural et de l’aménagement du territoire et devrait redevenir la DATAR. Qu’est-ce que cela va changer ? Qu’est-ce que cela peut apporter dans le « pilotage » d’une vraie politique d’aménagement du territoire, qui reste encore à construire aujourd’hui ?
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à ma connaissance, c’est la première fois qu’est nommé un ministre de l’espace rural et de l’aménagement du territoire. Je salue avec beaucoup d’émotion le nouvel intitulé de cette fonction ministérielle.
À Rémy Pointereau, dont Jean Boyer disait à l’instant qu’il est le tracteur de la ruralité, je veux dire que plus qu’un semi-diesel de Vierzon, il est un diesel total.
Intervenant le dernier, à plus de vingt-trois heures, après tant d’orateurs qui ont tout disséqué avec le scalpel du chirurgien, je me demande s’il est opportun de lire le discours que j’avais préparé. Je vais m’en garder, car ce serait une redite de ce qui a déjà été exposé si brillamment.
Après avoir entendu mon prédécesseur à cette tribune, Yves Chastan, et tous ceux qui sont intervenus avant lui, je me pose effectivement la question de savoir si nous ne nous trouvons pas à un tournant pour la ruralité en France. En fait, nous sommes à la veille de ce tournant : il commence à s’ébaucher, car beaucoup reste à faire !
La dynamique économique et sociale a longtemps reposé sur la ruralité non seulement dans notre pays, mais également dans le reste du monde, puisque tout ou presque était issu de l’agriculture. L’ère industrielle, avec les services qui s’y rattachent, a créé des agglomérats de populations qui ont fabriqué un déterminant démographique vraiment prééminent en milieu urbain.
Yves Chastan vient de dire à l’instant que les derniers recensements pouvaient peut-être allumer quelques espoirs dont le bien-fondé pourrait reposer sur les prémisses de mutations de la ruralité et sur les comportements de nos concitoyens. Il est vrai, comme La Fontaine le disait déjà en son temps, qu’il y a un comportement des villes et un comportement des champs.
Pour ma part, je suis tellement citadin que certains m’ont demandé ce que je venais faire dans ce débat. Mais il m’a semblé important de mettre en exergue une telle problématique, car nous avons de plus en plus besoin, quand on voit le comportement des villes, de nous référer au comportement des champs et de nous y ressourcer. La ruralité doit enfin renaître des cendres quelque peu refroidies par cette ère industrielle pour retrouver toute sa place dans la dynamique économique et sociale de notre pays. Voilà le fameux tournant que l’on ne peut qu’appeler de nos vœux, car il répondra à bien des questions que se posent nos concitoyens dans notre société actuelle.
Tournons-nous vers cette ruralité ! Sachons en dégager les grandes vertus, qui ont été nourries par l’expérience, la tradition et les cultures qui se sont toujours mues pour faire le cœur des grandes civilisations !
Ce matin, la Haute Assemblée connaissait la première réunion de notre nouvelle délégation à la prospective. Nous sommes d’ailleurs la seule assemblée en Europe, avec les Finlandais, à être dotée d’une telle délégation. Alors que nous réfléchissions à la teneur des premiers débats, savez-vous ce qui est venu tout naturellement à l’esprit du bureau de la délégation ? Eh bien ! s’est posée à nous la fameuse problématique vécue par nos concitoyens dans les villes : comment répondre à cette soif incontestable de retourner vivre en milieu rural afin de retrouver les fondements d’un art de vivre de qualité, que nous avons trop souvent perdu en étant entassés dans des agglomérations qui finissent par avoir une taille démesurée ?
Je pense au Minotaure, qui finit par mourir d’avoir trop mangé les autres. Un jour viendra – il n’est peut-être pas si éloigné – où cette ruralité, qui avait perdu la prééminence de dynamique économique et sociale, pourra enfin retrouver droit de cité. Pendant longtemps, la ruralité était synonyme d’agriculture, et les concentrations urbaines d’industrie. Aujourd’hui, on le sent avec les perspectives qui se dessinent, le monde industriel n’est plus étranger au monde de l’agriculture. Il arrive même à ceux-ci d’entrer en résonnance : on parle parfois d’agro-industrie !
Voilà que la nouvelle industrie, intimement liée à la problématique de l’agriculture, apparaît. Dès lors, un nouveau souffle peu venir habiter un territoire rural, qui s’était désertifié du fait des flux démographiques et des courants provoqués par l’industrialisation.
Au travers de ces formidables pôles d’excellence rurale qui ont été lancés, pour la première fois depuis longtemps, le qualificatif « rurale » est accolé à la notion d’excellence. Quelle avancée ! En comparaison, pour les villes, nous en sommes restés aux pôles de compétitivité…
Aujourd'hui, l’excellence deviendrait-elle enfin le fait des terroirs et des espaces de la ruralité ? Pourquoi pas ? Il semble que la voie soit ouverte. Regardez la nouvelle industrie ! La chimie, par exemple, est une chimie verte. Adieu la chimie du charbon et de l’acier ! Adieu, probablement, les tours de cracking distillant du pétrole : c’est la production agricole qui sera « enfournée » dans ces nouvelles tours.
On voit ainsi bouger la nature de l’industrie, qui revient vers la production agricole. La syncrétie entre les mondes agricole et industriel se trouve ainsi créée, régénérant la ruralité.
Je souhaite revenir sur les pôles d’excellence rurale, auxquels je me suis fortement intéressé. Notre ami parlait de la Gironde ; permettez-moi de dire quelques mots sur la Champagne-Ardenne : cela, c’est de la ruralité, je puis vous l’assurer ! Je dirai au passage aux Girondins que notre petit vin local n’est pas plus mauvais que les autres.
Sourires

Sur les dix-neuf pôles d’excellence de ma région, je me suis intéressé non pas à ceux qui étaient prometteurs et qui fonctionnaient bien, mais aux trois qui étaient en panne ; c’est de ceux-là que je voudrais parler un court instant pour conclure.
Les porteurs de projets ont déploré que la méthodologie pour construire ces pôles d’excellence et les projets pour les décliner concrètement n’assurent pas la faisabilité, que les problématiques de fonctionnement secondaires ne soient pas toujours prises en charge au départ. Ils ont évoqué l’intérêt de la méthode, qui a d'ailleurs cours à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, consistant à asseoir la faisabilité des projets dès leur instruction, en les dotant, comme les programmes Leader +, d’une petite somme apéritive d’argent ouvrant droit, s’ils sont acceptés, à la suite de l’instruction et à leur déclinaison concrète.
Applaudissements
Monsieur le président, monsieur le président de la commission de l’économie, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est avec un plaisir non feint que je viens dialoguer avec vous sur les pôles d’excellence rurale.
Cher monsieur le rapporteur, je voudrais tout d’abord vous remercier du travail nourri et précieux que vous avez conduit sur les pôles d’excellence rurale, avec votre groupe de travail, à la suite d’une décision de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire. Vous venez de nous livrer la substantifique moelle de votre rapport. Je dois dire que nous étions impatients de disposer de ses conclusions, puisque nous nous sommes très largement appuyés sur vos travaux – je vous remercie de nous les avoir transmis par anticipation – pour lancer la deuxième vague de pôles d’excellence rurale annoncée par le Premier ministre le 8 septembre dernier. Vous verrez que nous sommes restés très proches des propositions du Sénat.
Je suis heureux d’être ce soir au Sénat, une institution qui m’est chère et dont je connais l’engagement au service des territoires. Vos interventions ont montré, au-delà de votre engagement, une vraie passion pour les territoires. Cette passion, vous le savez, je la partage : c’est notre culture commune, et j’ai la chance de la vivre pleinement et intensément au sein du ministère dont j’ai la charge.
Les territoires ruraux sont une priorité. L’intitulé du ministère qui m’a été confié indique une volonté politique forte, celle du Président de la République, du Premier ministre et du Gouvernement tout entier. Le Président de la République avait souligné la priorité qu’il accordait au développement des territoires ruraux au mois de juin dernier, devant le Congrès. Il a eu maintes occasions de le rappeler depuis et il devrait le confirmer encore prochainement.
Il y a désormais un ministère de l’espace rural et de l’aménagement du territoire : ce n’est pas un effet d’annonce ; c’est l’expression d’une nouvelle ambition pour la politique d’aménagement du territoire, en accordant une attention particulière aux territoires ruraux, que l’on a trop souvent mis de côté.
M. Chastan a évoqué la DATAR. Dans la conscience collective, la DATAR était le signe d’une volonté affirmée d’aménager le territoire. Nous retrouvons cet engagement fort, ce qui est essentiel.
Depuis leur création en 2005, les pôles d’excellence rurale ont constitué une formidable dynamique pour le développement économique des territoires ruraux. Votre rapport le montre bien, monsieur Pointereau, en soulignant la nouvelle vision de l’aménagement du territoire que les PER ont su inspirer, tout en définissant une nouvelle ambition pour le monde rural et en préservant un tissu économique local au travers du soutien accordé à des savoir-faire spécifiques, emblématiques d’un terroir et d’une tradition historique.
Je partage votre bilan : au-delà des réussites, des améliorations sont certes souhaitables. Nous allons ensemble essayer d’y œuvrer.
Avec le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, M. Bruno Le Maire, nous allons lancer la nouvelle génération de PER en 2010, comme l’a voulu le Premier ministre. C’est un dossier phare pour le ministère de l’espace rural et de l’aménagement du territoire, sur lequel je m’engage avec détermination et conviction.
M. Bourquin a souligné quelques points faibles et déploré l’absence d’un véritable bilan des pôles d’excellence rurale ; MM. Boyer et Etienne en ont également parlé. C’est exact, car ces pôles vivent encore et n’ont pas épuisé leurs attributions. L’évaluation sera faite et elle sera naturellement présentée au Sénat.
Il existe un décalage entre les engagements et les paiements. Les PER en cours ont bénéficié de 175 millions d'euros de crédits d’État de toute nature ; 117 millions d'euros de crédits d’État ont déjà été versés à l’Agence de services et de paiements, qui les reverse à chacun des PER, et 55 millions d'euros ont été effectivement payés ; le reste le sera lorsque toutes les factures auront été transmises.
Pour ce qui est du décalage entre le moment où les PER sont labellisés et leur réalisation effective, il est dû au problème de l’ingénierie, que vous avez tous souligné. Nous allons essayer d’y répondre en organisant mieux le dépôt des candidatures et la période de la décision, afin de laisser le temps suffisant pour préparer les dossiers à l’échelon des territoires. Nous allons également mobiliser l’ingénierie publique pour les porteurs de projets qui souhaiteraient y avoir recours.
La réforme des préfectures va libérer les sous-préfets. Lors de la dernière réunion des préfets, place Beauvau, j’ai demandé que les sous-préfets soient à la disposition des porteurs de projets, qu’ils deviennent de véritables assembleurs, sur le terrain, aux côtés des élus.
Dans une République décentralisée, l’État n’a pas à être toujours au-dessus : il doit être à côté.
Son rôle est d’accompagner et de rendre réalisables les idées exprimées sur le terrain. C’est ce nouveau rôle que nous souhaitons voir jouer aux sous-préfets dans les pôles d’excellence rurale et, plus largement, dans l’ensemble des politiques qui seront mises en œuvre au profit des territoires ruraux.
Plusieurs d’entre vous ont souligné que les collectivités locales avaient beaucoup participé, mais l’État ne se défausse pas pour autant ! Nous avons simplement appliqué la loi de 1982, qui fut une grande étape de la décentralisation, ainsi que la loi intérimaire sur le Plan, votée à l’instigation de M. Rocard et qui prévoit expressément la compétence du département pour tout ce qui concerne l’équipement rural. Nous avons respecté cette compétence dans le cadre des PER.
M. Vall nous a expliqué qu’il était un fervent partisan des PER et qu’il craignait que la réforme de l’organisation territoriale ne casse cette belle dynamique en ne reconnaissant plus les pays. Je tiens à le rassurer : la future loi n’a pas pour objet d’abroger les pays existants ; simplement, il ne s’en créera pas de nouveaux.
Vous avez évoqué, monsieur Vall, la difficulté pour une seule communauté de communes de porter un PER. Le Gouvernement répond pleinement à votre attente en proposant de rationaliser la carte de l’intercommunalité.
Comme vous, nous pensons qu’un certain nombre de communautés de communes sont trop petites et qu’il faut définir des périmètres plus pertinents.
M. Michel Mercier, ministre. Dans cet esprit, la réforme de l’organisation territoriale comportera une rationalisation de l’intercommunalité. Cela va dans le sens que vous souhaitez, monsieur Vall, et votre intervention me semble donc annoncer un soutien au texte que nous soumettrons prochainement au Sénat, soutien dont je vous remercie d’ores et déjà !
Sourires
Le cahier des charges de l’appel à projets pour la nouvelle génération de PER précise d’ailleurs que la structure porteuse pourra être un établissement public de coopération intercommunale, un parc naturel régional, un conseil général, une association ou un groupement d’entreprises privées, sous certaines conditions : vous n’avez donc rien à craindre.
M. Boyer a souligné à juste titre que les PER ont permis de transformer des handicaps en atouts : telle était bien leur vocation. Il nous a par ailleurs fait part de ses inquiétudes concernant la pérennisation du dispositif des zones de revitalisation rurale. Un bilan de ce dispositif est actuellement en cours, mais il est certain que son statut fiscal, notamment au regard de la taxe professionnelle, en est l’un des points forts. Or il n’échappera à aucun d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, que la proposition du Gouvernement de supprimer la taxe professionnelle pour la remplacer par une cotisation économique territoriale répond parfaitement à la préoccupation de M. Boyer. En effet, la cotisation complémentaire ne sera payée que par les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 000 euros : les PME en seront donc toutes exemptées, ce qui revient à dire que l’adoption du projet de loi de finances que vous examinerez bientôt permettra la création de ZRR sur l’ensemble du territoire, et c’est tant mieux pour le développement économique local !
MM. Yvon Collin et Raymond Vall rient.
Je ne doute pas que je parviendrai à vous en convaincre lors du débat budgétaire, si ce n’est déjà fait !
Rires.
En ce qui concerne les financements croisés, vous avez raison de dire, monsieur Boyer, qu’ils sont toujours complexes. En matière de financement, il faut choisir entre soutenir un grand nombre de pôles d’excellence rurale ou opter pour un champ d’intervention réduit. Mon ministère prévoit d’ores et déjà de réserver un peu plus de 100 millions d’euros à la nouvelle génération de PER, mais d’autres ministères peuvent également contribuer au financement du dispositif : je pense, en particulier, au ministère de l’intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Lorsque j’ai été nommé ministre, on m’a notamment confié la mission d’instaurer une plus grande équité des dotations versées par l’État aux communes rurales par rapport à celles qu’il attribue aux communes urbaines. La dotation de développement rural constitue naturellement l’une des sources de financement des PER, mais il convient à mon sens d’utiliser complètement les fonds européens. Or, parfois, la réglementation européenne nous conduit à en rendre une partie. Il serait préférable de prévoir des contreparties budgétaires avec certains ministères afin de pouvoir mobiliser leurs fonds européens et disposer ainsi d’une masse de crédits plus importante pour financer les PER, l’Agence de services et de paiement de l’État pouvant gérer l’ensemble.
Monsieur Boyer, vous considérez enfin que le montage des dossiers a été trop rapide. Nous veillerons à répondre à la préoccupation que vous avez exprimée.
Madame Des Esgaulx, il est vrai que notre premier objectif est de créer des emplois et d’assurer le développement économique des territoires ruraux. Il est exact que ces derniers sont très divers : si l’agriculture constitue leur épine dorsale, d’autres activités économiques y existent également. Les PER, qui comporteront une forte dimension économique, contribueront à dynamiser les territoires ruraux et à stimuler certaines filières, comme la filière bois, que vous avez évoquée.
Les PER pourront également permettre la mise en place d’un certain nombre de services : je pense en particulier au haut débit et au très haut débit, et j’ai à l’esprit la proposition de loi de M. Pintat.
M. Chastan a souligné avec raison que, pendant très longtemps, gérer les territoires ruraux est revenu à gérer un déclin. Aujourd'hui, nous devons accompagner leur redressement démographique, en maintenant les services publics et les services au public. À cet égard, je vous félicite, monsieur le sénateur, d’avoir bien fait la distinction entre ces deux notions, car elle est essentielle : dans la vie de tous les jours, on a davantage besoin d’un médecin que d’une perception, même s’il est très important de pouvoir payer ses impôts !
En ce qui concerne cette question des services publics, nous devons être le plus clairs possible. J’ai suivi, il y a bien longtemps, l’enseignement d’un professeur qui avait lui-même été formé, à Bordeaux, dans la grande école du service public du doyen Duguit. J’ai appris qu’un service public se caractérisait par un certain nombre de principes, dont celui de mutabilité : un service public doit toujours s’adapter pour remplir au mieux son rôle, car on ne peut plus gérer les choses aujourd'hui comme il y a cinquante ans. Cela ne signifie pas que les services publics doivent disparaître, mais ils doivent évoluer.
À cet égard, les PER pourront être utilisés, par exemple pour développer le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Ainsi, j’ai inauguré voilà quelques jours une maison des services publics équipée d’une borne de visioconférence, qui permet aux habitants d’un territoire où il n’y a jamais eu de service de sécurité sociale de s’entretenir de leur dossier avec un agent.
Il est donc possible aujourd'hui de faire vivre autrement les services publics, et c’est à juste titre que vous avez souligné que les territoires ruraux peuvent être des lieux d’innovation sur ce plan. Ainsi, j’ai décidé il y a quelques jours de créer une nouvelle aide, d’un montant de 20 millions d’euros, pour les « grappes d’entreprises », qui assurent les services publics locaux. En milieu rural, ces grappes d’entreprises doivent travailler en lien avec les pôles de compétitivité : il n’y a pas d’opposition entre ces deux structures, qui doivent au contraire être complémentaires.
Vous avez donc raison de dire que la ruralité est à un tournant, monsieur Étienne. Nous devons non plus la cacher, mais à l’inverse la montrer comme un espace de modernité et de progrès, où les gens ont envie de vivre.
Tel est le but des assises de la ruralité qui se tiendront prochainement. Tout ne doit pas être décidé depuis Paris : il faut écouter les acteurs de terrain. Je vais demander aux préfets d’organiser, dans les semaines qui viennent, des débats dont ils feront remonter les conclusions, ce qui nous permettra, dès la fin du mois de janvier prochain, de définir les lignes de force de notre politique en faveur des territoires ruraux.
J’évoquerai maintenant les axes de la nouvelle génération d’appels à projets, lesquels doivent s’inscrire dans les problématiques des territoires ruraux. Ils visent à favoriser de nouvelles dynamiques territoriales, concernant aussi bien la valorisation du potentiel local existant que la gouvernance et les relations entre les acteurs. Je souhaite que les appels à projets permettent de faire émerger des propositions d’actions diversifiées et adaptées en prenant en compte la complémentarité des instances.
Deux enjeux fondamentaux pour les territoires doivent, à mes yeux, structurer les appels à projets : le renforcement de la capacité économique des territoires ruraux et la prise en compte des besoins des populations dans le domaine des services publics et des services au public, en fonction des évolutions des territoires.
Je crois en la diversité économique des territoires, qui est, selon moi, un atout à valoriser. Les nouveaux emplois ne relèvent pas uniquement des productions agricoles ou agroalimentaires ; il faut aussi mieux prendre en compte les potentialités naturelles des territoires, leurs savoir-faire techniques, leurs spécialisations artisanales et industrielles, leur patrimoine, voire leur vocation.
Je pense en particulier au développement des entreprises et des filières, à la création d’activités marchandes fondées sur les productions de nos territoires. Plusieurs exemples pourraient être cités, mais je n’évoquerai que celui de la filière pierre volcanique qui a été relancée dans le Puy-de-Dôme.
Je pense aussi à la création d’ateliers-relais ou de pépinières d’entreprises dans une logique de développement durable, en lien avec les bio-constructions et les bioénergies. Les ressources forestières peuvent ainsi trouver une valorisation et un débouché dans les chaufferies, en milieu rural ou en milieu urbain.
L’emploi et l’économie sont bien sûr les priorités des pôles d’excellence rurale, mais, parallèlement, il est essentiel de répondre aux besoins des habitants en termes de services.
Plusieurs d’entre vous ont observé que, du fait de l’essor démographique des territoires ruraux, de nouveaux habitants côtoient désormais les ruraux « historiques ». Ce mélange de populations, l’accès aux nouvelles technologies, ainsi que l’ouverture sur le monde de ces territoires, font que, aujourd'hui, les standards de vie sont les mêmes que l’on vive en ville ou en milieu rural : les besoins et les envies sont les mêmes, on s’habille de la même façon, on regarde les mêmes chaînes de télévision.
Il faut donc offrir un socle de services adaptés à la demande de la population. Cela passe par l'utilisation de nouvelles technologies et par de nouveaux types de partenariats : je pense aux missions de service public et aux maisons médicales de santé. Cet après-midi, j'ai travaillé avec Mme Bachelot-Narquin pour que nos ministères puissent concevoir ensemble des réponses au problème de la démographie médicale, que les habitants de certaines zones rurales subissent quotidiennement.
On peut bien sûr envisager le déploiement, comme dans la Manche, de bornes visio-relais pour assurer le maintien et l'amélioration des services publics, mais il faudra aller plus loin.
Les pôles d’excellence rurale pourront ainsi contribuer à développer des formes expérimentales de services, comme les espaces publics numériques, les télé-centres avec visioconférence ou la télémédecine : nous lancerons une expérimentation en ce sens avec le ministère de la santé.
Cette deuxième génération se caractérise donc par une ouverture de l'objet des pôles d'excellence rurale, qui pourront parfaitement servir à développer les services publics et les services au public. Pour être sélectionnés au titre de cette nouvelle génération de PER, les projets devront répondre à des objectifs précis, que M. Pointereau a d’ailleurs mentionnés dans son intervention.
En ce qui concerne le calendrier, le premier appel à projets sera lancé dès la fin de ce mois, les réponses pouvant être adressées jusqu’en janvier 2010, en vue d’une prise de décisions vers le mois d’avril de la même année. Une seconde vague sera lancée au début de 2010, après les assises des territoires ruraux, les décisions devant être arrêtées pendant l’été. Ces délais, de quatre mois pour la première vague et de dix mois pour la seconde, sont, me semble-t-il, de nature à répondre à vos attentes. S’agissant de l’ingénierie publique, les sous-préfets, notamment, se tiendront à la disposition des collectivités territoriales pour les aider à élaborer des projets. Pour l’heure, nous avons prévu, pour la seconde vague, un financement au moins égal à celui de la première vague.
Nous comptons articuler ce dispositif avec l’ensemble des autres instruments de la politique en faveur des territoires ruraux, qui ne se résume pas aux seuls pôles d’excellence rurale, même si ces derniers sont particulièrement intéressants dans la mesure où ils associent des acteurs qui n’avaient pas l’habitude de travailler ensemble jusque-là.
Afin d’aller plus loin, d’autres actions seront menées. Ainsi, s’agissant du numérique, M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Mme la secrétaire d'État chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique et moi-même avons lancé aujourd'hui un appel à projets pour utiliser les 30 millions d’euros de crédits européens qui viennent d’être mis à disposition de la France. En outre, j’ai déjà évoqué les grappes d’entreprises et les actions que nous envisageons de mener avec le ministère de la santé pour répondre à un certain nombre de problèmes en matière de permanence des soins et de démographie médicale.
J'ai le sentiment d’avoir été un peu long, ce dont je vous prie de m'excuser, …
M. Michel Mercier, ministre. … mais je voulais répondre à chacune et à chacun d'entre vous, puisque c'est une des premières fois que je m'exprime devant le Sénat en qualité de membre du Gouvernement. De surcroît, la relance de la politique d'aménagement du territoire, notamment dans sa dimension rurale, est un sujet qui mérite qu’on s’y attarde.
Applaudissementssur les travées de l’Union centriste et de l’UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 22 octobre 2009 :
À neuf heures trente :
1. Question orale avec débat n° 47 de Mme Nathalie Goulet à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur le contrôle parlementaire de l’action du Fonds stratégique d’investissement.
Mme Nathalie Goulet attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur la nécessité d’instaurer un meilleur contrôle parlementaire de l’action du Fonds stratégique d’investissement (FSI).
Né de la volonté du président de la République et d’une annonce du 20 novembre 2008, le Fonds stratégique d’investissement (FSI) est composé de deux actionnaires, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et l’État, qui détiennent respectivement 51 % et 49 % du fonds. Le Parlement, s’il a agréé au principe de la création de ce fonds, n’a été associé ni à son organisation ni à sa gouvernance. Le 6 juillet dernier, l’État et la CDC ont annoncé l’apport de 14 milliards d’euros de participation au FSI, portant ainsi sa dotation à 20 milliards d’euros.
Comme toute filiale de la CDC, le FSI exerce ses activités sous le contrôle de la commission de surveillance de la Caisse. C’est dans ce cadre que les parlementaires représentant les deux assemblées au sein de la commission de surveillance exercent, quand ils sont présents, leur contrôle sur la stratégie et les investissements du FSI. De même, un rapport au Parlement est bien remis mais il s’agit seulement d’une information a posteriori. Elle s’interroge sur le bien-fondé d’une telle gouvernance, à l’heure où l’ensemble des organismes financiers réclament plus de contrôle et plus de transparence. De la même façon, elle s’interroge sur le processus décisionnel qui a conduit l’État à apporter des participations dans des entreprises faisant l’objet d’un rapport annuel, jaune budgétaire annexé à la loi de finances. Ces procédés lui semblent peu en adéquation avec les impérieuses nécessités de la LOLF.
Hormis ces questions de gouvernance et de stratégie, les annonces récentes du Président de la République le 3 septembre, à Caligny, dans l’Orne, quant à l’implication du FSI dans plusieurs actions visant à renforcer les fonds propres des entreprises, puis, le 25 septembre, quant à la participation du FSI dans un fonds de consolidation et de développement des entreprises destiné à soutenir les PME en difficulté, ne sauraient laisser le législateur indifférent. Là encore, compte tenu de la crise de l’ensemble du secteur industriel, elle estime nécessaire que les modalités de participation fassent l’objet d’un examen attentif non discriminatoire et soient justifiées économiquement.
Compte tenu de l’importance des montants engagés, du caractère stratégique de son intervention, mais aussi du fait que le FSI a la pleine et entière responsabilité de ses actifs, elle estime souhaitable qu’une réflexion commune soit engagée rapidement afin de mettre en place un pilotage spécifique de ses actions. Il lui apparaît en effet essentiel que le Parlement soit pleinement associé dans la gouvernance et le contrôle des choix du FSI. Les exemples étrangers comme le Fonds structurel norvégien, qui associe en amont et en aval le Parlement norvégien à ses travaux, montre qu’il existe d’autre type de gouvernance.
Elle souhaite par conséquent que la présente question orale avec débat permette de débattre des méthodes et des objectifs du FSI ainsi que du contrôle parlementaire sur son fonctionnement et ses choix.
À quinze heures :
2. Questions d’actualité au Gouvernement.
Délai limite d’inscription des auteurs de questions : jeudi 22 octobre 2009, à onze heures.
3. Débat européen de suivi des positions européennes du Sénat :
- brevets européen et communautaire ;
- droits des consommateurs ;
- transposition insuffisante d’une directive ferroviaire (mise en demeure de la France) ;
- coopération judiciaire et policière : situation en Bulgarie et Roumanie.
4. Débat sur les prélèvements obligatoires.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures cinquante.