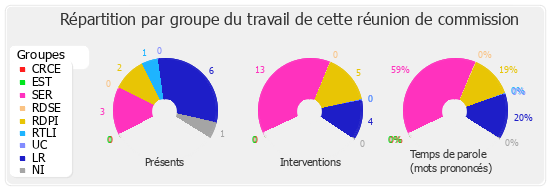Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
Réunion du 11 septembre 2013 : 2ème réunion
Sommaire
La réunion
Au cours d'une seconde séance qui s'est tenue dans l'après-midi, la commission auditionne M. Nonce Paolini, président-directeur général de TF1, sur le projet de loi organique n° 815 et le projet de loi n° 816, adoptés par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatifs à l'indépendance de l'audiovisuel public.

Nous poursuivons les auditions de notre commission sur le projet de loi relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public. Nous accueillons M. Nonce Paolini, président-directeur général de TF1. M. Paolini, je vous cède tout de suite la parole pour recueillir votre analyse et vos réflexions.
Si nous n'avons pas à nous prononcer sur la nomination des présidents des sociétés d'audiovisuel public, il nous semble essentiel que le rôle et les moyens du régulateur se transforment profondément. Notre secteur a subi de multiples transformations (lancement de la télévision numérique terrestre, arrivée des acteurs de l'Internet) et le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) doit être en mesure de développer sur les évolutions technologiques une réflexion débouchant sur une véritable régulation économique. Nous sommes donc favorables au texte adopté par l'Assemblée nationale, qui représente un tournant majeur pour notre univers. Le CSA ne peut plus se cantonner à un rôle d'observateur ou de censeur éditorial, il lui incombe d'aider à la régulation économique du secteur. Il a déjà commencé à le faire à propos de la bande des 700 MHz ou du changement d'actionnariat de certaines chaînes de télévision. Il doit continuer, et garantir à tous les acteurs les conditions d'une concurrence saine et profitable. La modification de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, qui suscite de nombreuses oppositions, évitera au secteur un immobilisme préjudiciable à tous les opérateurs.

L'indépendance du CSA constitue une des conditions de l'indépendance de l'audiovisuel public. Nous y sommes très attachés parce qu'elle renforcera son autorité. Les responsables de l'audiovisuel public ne seront plus nommés par un CSA lui-même composé de manière contestable. Leur indépendance sera assise sur une désignation à la majorité positive des trois cinquièmes dans les deux chambres, méthode nouvelle qui favorisera la nomination de personnalités dont les compétences reconnues auront fait consensus, au-delà des clivages politiques.
L'amendement relatif aux compétences du CSA ayant été déposé tardivement, l'été s'est écoulé, et c'est ici que le débat aura lieu. Votre secteur est peut-être celui qui évolue le plus rapidement, sans qu'on sache quand cette évolution s'arrêtera...
Il y a peu de chance qu'elle s'arrête !

Le rôle du CSA ne doit donc pas être figé. Avec l'amendement en question il pourra décider plus facilement de faire passer une chaîne de la TNT payante à la TNT gratuite. À qui cela profitera-t-il ? Les regards se tournent vers votre groupe : LCI pourrait être candidate, comme Paris Première... On a même parlé - c'est un abus de langage - d'« amendement LCI » ! Certains, comme M. Méheut ou M. de Tavernost, ou encore les responsables du groupe L'Equipe, y voient un changement injuste des règles du jeu, qui déstabiliserait le secteur de la TNT gratuite, et cherchent à démontrer qu'il serait contraire à la Constitution et au droit européen. D'autres défendent le point de vue inverse. Nous cherchons à faire prévaloir l'intérêt général. Si vous étiez à la tête de Canal + ou de BFM, comment réagiriez-vous à cet amendement ?
Je serais un homme heureux, et non un homme soucieux : patron de Canal +, je serais à la tête du groupe audiovisuel français le plus profitable, dégageant chaque année environ 700 millions d'euros de résultat opérationnel, à comparer aux quelques 250 millions d'euros auxquels parvient TF1 dans ses meilleures années. Même s'il est choquant d'entendre des responsables de chaînes d'information désinformer le public en parlant d'erreur stratégique, je serais serein, quoique un peu égaré dans l'information et encore peu présent dans la diffusion en clair, surtout après l'arrivée de beIN Sport. La chaîne iTélé, dans mon compte d'exploitation, ne pèse rien ! Elle n'est ni un enjeu stratégique ni une préoccupation économique. L'arrivée éventuelle de LCI, alors que nous sommes positionnés depuis 2005 sur l'information gratuite, avec des stars et des moyens considérables, ne m'inquiéterait nullement, et me ferait plutôt sourire, en pensant au risque que cela constitue d'arriver en challenger, avec une numérotation qui sera sans doute la dernière des chaînes gratuites, dans un marché tenu par un duopole formidablement rémunérateur. Bien sûr, je viendrais vous expliquer que le groupe Canal + est en péril -j'ai d'ailleurs récemment déclaré aux marchés que nous n'aurons cette année que 650 millions d'euros à proposer à nos actionnaires... Heureusement, je continue à jouir d'une TVA favorable.
Patron de BFM, comme je serais heureux d'être entré dans l'audiovisuel ! Lorsque j'ai repris RMC pour un euro, personne ne m'a dit qu'il y avait trop de radios en France, personne ne m'a expliqué que France Inter, RTL, Europe 1 et d'autres occupaient déjà le créneau de la matinale, que je ne devais pas faire de journaux entre midi et deux heures, ni que le soir, après les conseils de Brigitte Lahaie, je ne pouvais faire librement une session d'information ! Petit à petit, ma radio a acquis des fréquences, a prospéré, et j'ai construit un groupe formidable, dont la force repose sur la mutualisation des moyens. J'ai récemment assuré à la presse que la rentabilité de BFM TV était exceptionnelle : elle est de 25 % supérieure à celle de M6, la chaîne privée la plus rentable. Certes, j'ai coulé La Tribune, le groupe Tests, et j'ai procédé à quelques licenciements dont, fort heureusement, on a oublié le nombre. Aujourd'hui, mon groupe est fortement bénéficiaire, il comprend trois chaînes de télévision. Lorsque j'ai lancé BFM TV, j'ai indiqué au CSA qu'il s'agirait d'une chaîne d'information économique, promesse non tenue. J'explique que ce serait une chance pour la France de disposer d'une troisième chaîne d'information nationale avec BFM business. Je n'imagine pas qu'il puisse s'agir de LCI, tenue à l'écart par des opérateurs qui n'en veulent plus, confinée dans ce ghetto qu'est la télévision payante, et qui craint pour ses deux cents emplois. L'actuel duopole me convient parfaitement : j'écrase Canal +, qui stagne quand mon audience se développe. Mes rentrées publicitaires ont encore une forte marge de progression. Bref, je vous déconseillerais de faire entrer LCI !
Voilà ce que je vous dirais, monsieur le rapporteur, si j'étais le président de Canal + ou de BFM. Je me suis inspiré de faits réels et de phrases réellement prononcées !
Le CSA n'a pas attendu l'amendement dont nous parlons pour modifier sérieusement le paysage audiovisuel. Quand M. Méheut a acheté D8 et D17, a-t-il rendu l'autorisation pour candidater de nouveau ? Pourtant l'actionnariat de ces deux chaînes a été modifié, ce qui a autorisé l'acteur presque unique du payant à venir sur le clair, mouvement qui ne s'est produit nulle part ailleurs en Europe. Nous-mêmes, nous avons obtenu du CSA, en passant par l'Autorité de la concurrence et le Conseil d'État, de pouvoir acquérir TMC et NT1. Il s'agit de modifications très importantes : nous allons d'ailleurs reparler, devant le Conseil d'État, des engagements pris par Canal + auprès de l'Autorité de la concurrence lors du changement d'actionnariat de D8 et D17. Des modifications de format ont été faites : W9, qui était une chaîne musicale, l'est beaucoup moins. M. Méheut demande à ce que D17 puisse diffuser davantage de séries américaines et moins de musique française.
Le CSA dispose d'ores et déjà une marge de manoeuvre. Pourquoi l'étendre ? Parce qu'à l'avenir, celui-ci doit pouvoir analyser et décider pour préserver les grands équilibres. L'arrivée d'une petite chaîne, qui s'ajouterait aux six récentes, ne constituerait pas un danger pour l'audiovisuel français, mais un concurrent ! M. Weill, adepte de la concurrence, et M. Méheut, partisan du monopole, doivent s'y faire : pour ma part, cela fait vingt-cinq ans que je suis confronté à la concurrence... J'aime mon métier d'entrepreneur, et mon but est d'apporter le meilleur service à mes téléspectateurs.
Je suis très choqué de la manière dont on vous traite : on laisse penser que vous pourriez être manipulés par le groupe TF1 en faveur de LCI. Mais le CSA lui-même a demandé dans son dernier rapport annuel la modification du « 42-3 », afin d'étendre son pouvoir de régulation. J'aime autant ne pas avoir pris part à de telles campagnes de désinformation.

Lors des assises de l'audiovisuel, les responsables étaient unanimes pour considérer que le spectre de la TNT était trop éclaté et qu'il fallait procéder à des regroupements. Ajouter une chaîne gratuite, n'est-ce pas faire l'inverse ? S'il est nécessaire de donner plus de souplesse au CSA, il convient aussi d'éviter les contestations.
C'est vrai, tous les patrons des groupes historiques considèrent que la France a fait une erreur en prenant un chemin très différent de celui retenu ailleurs en Europe. Il n'y a pas trop de chaînes, mais trop d'opérateurs. Les autres pays européens ont confié aux opérateurs existants la possibilité de multiplier l'offre audiovisuelle en leur donnant des multiplex. Aucun opérateur nouveau n'est entré. La France a fait l'inverse, au risque que les fréquences soient revendues. Nous avons toujours plaidé pour des groupes de taille nationale, voire internationale, ce qui nécessite des regroupements. Il ne faut pas confondre développement de l'offre et multiplication des opérateurs. L'éclatement actuel du marché, joint aux conditions économiques difficiles, met plusieurs acteurs en difficulté.
Nous avons déjà connu l'étude d'impact : lorsque TMC et NT1 ont été présentées au CSA, il y a eu une étude d'impact extrêmement sérieuse. Nous avons dû défendre notre dossier avec de solides arguments, qui se vérifient aujourd'hui : les autres opérateurs n'ont pas été balayés, les résultats sont bons pour tous. Lorsque Canal + a souhaité acquérir D8 et D17, le CSA s'est aussi penché de près sur la question. Pour autant, il ne faut pas créer une usine à gaz : les demandes de modification de modèle économique présenteront sans doute un caractère d'urgence, l'étude d'impact devra donc être menée à bien dans des délais raisonnables. Le CSA, déjà bien équipé, pourra renforcer sa capacité de régulation économique.
La stratégie de TF1 en matière de TNT remonte à 2001. Pourquoi avons-nous fait de LCI une chaîne de la TNT payante ? LCI est, historiquement, la première chaîne d'information. Elle a été créée dans les années 1990 pour la plateforme Canal Satellite, qui dominait le marché de la télévision à péage. Le groupe TF1 avait alors créé les deux chaînes à risque - LCI et Eurosport - pour alimenter le groupe Canal +, qui se concentrait sur le cinéma et les séries. Quand TPS a été lancée par les groupes TF1 et M6 et, au départ, France Télévisions, le groupe Canal + a réagi en créant iTélévision et Sport +. Il distribuait LCI et Eurosport, qui passaient aussi sur TPS. L'information continue était donc un service payant, partagé entre le groupe Canal + et TF1.
Lors du lancement de la TNT en 2001, chacun des deux groupes a déposé sa chaîne d'information en TNT payante au titre du canal bonus : iTélévision et LCI payantes. En 2004, après qu'un recours contentieux devant le Conseil d'État a révélé que le groupe Canal + avait dissimulé au CSA un pacte de co-contrôle entre Canal + et Lagardère qui avait pour conséquence de leur accorder plus d'autorisations que ne le prévoyait la loi, le Conseil d'État a annulé partiellement les autorisations de Canal + et de Lagardère. Le nombre maximal d'autorisations était fixé à cinq, et Canal + en contrôlait sept ! Le groupe TF1, lui, avait déclaré son pacte de co-contrôle avec M6 de la chaîne TV6. Le groupe Canal + a alors représenté, en connaissant l'état de la concurrence, une série de candidatures, et s'est vu attribuer toutes les chaînes qui avaient été annulées, ainsi que la présence d'iTélévision en clair. C'est alors que BFM TV est entrée sur le marché. Contrairement à ce qu'ils prétendent, nos concurrents ne sont pas venus en prenant un risque, mais bien en connaissant parfaitement l'état du marché et de la concurrence, ce qui n'était pas notre cas en 2001. Or en télévision, trois ans équivalent à trois millénaires. LCI n'avait pas eu son autorisation, elle. Elle ne pouvait donc pas candidater de nouveau, au risque de perdre sa fréquence. Les relations avec le CSA n'étaient pas aussi apaisées qu'elles le sont aujourd'hui...
Excellente question.
Nous aurions eu le choix, au moins. Il était encore possible que la TNT payante se développe bien. En tout état de cause, la question ne se posait pas. Si le CSA avait eu à l'époque les moyens dont nous parlons, le débat aurait été ouvert. Canal +, qui avait triché, a pu revenir à la table des discussions, et demander le changement de modèle économique de sa chaîne d'information, qui avait été agréée en TNT payante en 2001. Après trois ans, la donne avait changé, et d'autres paris étaient possibles. J'ai été membre de l'équipe qui, en mai-juin 1994, a créé la première chaîne d'information : ce n'est pas BFM qui a pris le risque, mais nous, et bien que nous soyons sur ce marché depuis vingt ans, nous sommes à l'heure actuelle dans le ghetto qu'est la télévision payante. Nos concurrents ont déclaré que l'information payante, cela n'avait plus de sens. Je suis d'accord avec eux !
LCI est ensuite restée payante lors de la fusion entre TPS et Canal Sat, elle a été distribuée en exclusivité par Canal + pendant quelques années, qui l'a marginalisée. Les chaînes de la TNT gratuite sont en must carry-must offer : tous les opérateurs doivent les référencer en premier niveau de service gratuitement pour tous leurs abonnés. Elles sont donc reçues par 95 % de la population. Les chaînes de la TNT payante, elles, ne sont accessibles que par abonnement : elles ne peuvent pas être exposées en must carry. Sur l'ensemble du paysage audiovisuel, LCI est marginalisée sur le câble, sur le satellite, sur le filaire, car elle n'est accessible qu'à ceux qui paient un abonnement. Sa marque existe donc de moins en moins. Les plateformes de distribution ne peuvent pas compenser la réduction des rémunérations par une exposition maximale, car elles sont dans des bouquets optionnels, en deuxième niveau de service, accessible uniquement par abonnement. Cette marginalisation est un élément fondamental à prendre en compte dans l'étude d'impact.
Le groupe TF1 n'a pas fait une erreur stratégique en présentant HD1 et non LCI lors du dernier appel à candidature : le contrat qui le lie au groupe Canal + jusqu'au 31 décembre 2014 est global, et le groupe Canal + a demandé à ce que le groupe TF1 s'engage à ne pas sortir LCI de la télévision payante, sauf à dénoncer globalement le contrat et à revoir les rémunérations de toutes les chaînes du groupe TF1, y compris Eurosport : nous avons subi cette contrainte.
Il aurait fallu abandonner l'autorisation et se présenter à nouveau pour l'obtenir. Les nouvelles dispositions évitent cette contrainte.

Que pensez-vous du pouvoir donné au CSA de lancer des appels à candidature aux chaînes régionales pour étendre le réseau national de haute définition ?
Nous n'avons pas d'avis particulier. La diffusion en haute définition est très coûteuse. Pour les six nouvelles chaînes, il dépassera les douze millions d'euros lorsque le réseau couvrira l'ensemble du territoire, contre 4,5 millions d'euros aujourd'hui. Les chaînes locales n'ont aucun intérêt à abandonner la définition standard, qui reste très bonne. Cela fait partie des moyens d'investigation du CSA.

C'est une possibilité d'interprétation ouverte par la loi, pas nécessairement un voeu. Si nous n'encadrons pas les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, les candidats à la haute définition pourraient vouloir devenir des chaînes nationales.
Cela ajouterait à la confusion générale.

A quel équilibre économique pensez-vous qu'aboutira la coexistence, sur la TNT gratuite, de trois formats d'information continue, reposant sur un système comparable d'information rapide - émissions de plateau courtes, peu de reportages ?

On nous dit qu'il n'existe nulle part ailleurs autant de chaînes comparables.
Dans tous les pays d'Europe il y a au moins trois, et parfois jusqu'à cinq ou six chaînes gratuites d'information continue. Nous aurons peut-être ce débat avec le CSA si l'amendement est adopté. Regardez LCI : vous verrez que son format diffère de BFM comme d'iTélé, par la place qui y est faite au débat et au pluralisme. Y a-t-il trop de radios généralistes, trop de radios d'information ? Certainement pas.
RMC en est une autre : « infos, talk, sport... ». Il y a de l'information sur toutes les radios, exactement aux mêmes heures. Le payant est devenu un ghetto, l'information appartient désormais au domaine du gratuit. Financer une chaîne d'information payante devient impossible, et tous les trois ans, les équipes se demandent si les contrats seront reconduits et vivent dans l'angoisse du lendemain. Les équipes de LCI sont dans une incertitude permanente. Le fait que LCI se retrouve sur le marché concurrentiel contribuera au renforcement du pluralisme des courants d'expression. C'est une chaîne d'information qui revendique le sérieux et la crédibilité du travail de ses équipes et qui est estimée depuis vingt ans.

Pensez-vous vraiment que l'arrivée, si légitime soit-elle, d'une chaîne d'information gratuite supplémentaire n'aurait aucun effet sur la santé économique des deux autres ? Cette concurrence fera-t-elle des victimes ?
Lorsque la TNT gratuite est apparue, qui s'est soucié de son incidence sur l'évolution des audiences et du chiffre d'affaires de TF1 ? Entre 2007 et 2012 la chaîne TF1 a perdu plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires à cause du développement de la TNT ! Nous avons trouvé des solutions, sans aucune aide. La chaîne iTélé est adossée à un groupe extrêmement puissant et financièrement sain, dans les résultats économiques duquel elle ne pèse rien. Le risque est donc faible. Alain Weill ne cesse de répéter que le groupe BFM est en pleine santé et que les synergies entre ses radios et ses télévisions lui procurent des résultats économiques exceptionnels. Il y avait vraiment une place pour d'autres opérateurs. Mais c'est au CSA que cette décision incombera.
Le risque industriel sera pris par le groupe TF1, qui arrivera le dernier, se verra attribuer la numérotation la plus défavorable, et n'a aucune base structurée de clientèle. Nous voulons le prendre parce que le pluralisme se portera mieux si LCI peut faire concurrence à ces deux autres chaînes, et - je suis chef d'entreprise - pour sauver l'emploi des deux cents collaborateurs de LCI. Au 31 décembre 2014 à minuit, ils n'en auront plus si nous ne pouvons pas défendre notre dossier auprès du CSA et que celui-ci ne prend pas assez rapidement la décision opportune. Le rôle d'un chef d'entreprise est de prendre des risques. Que le meilleur gagne ! Nous nous battons tous les jours pour gérer l'entreprise le mieux possible ; je me bats aujourd'hui pour l'avenir des deux cents employés de LCI et de leurs familles. Je veux que cette chaîne puisse saisir sa chance, même si ce n'est pas le choix le plus facile. Si nous n'y arrivons pas, nous en tirerons les conséquences.

Merci de votre passion. Nous avons entendu aussi MM. Méheut et de Tavernost. Nous allons faire en sorte que le travail de l'Assemblée nationale soit conforté et qu'un encadrement juridique précis écarte tout soupçon. Vous évoluez dans un monde très dur !
Je ne demande qu'à faire mon métier d'entrepreneur pour sauver deux cents emplois tout en contribuant au pluralisme. Puisque hier vous avez évoqué la loi Hadopi, je veux signaler que nous constatons, dans notre activité de distribution de DVD et de vidéo à la demande, que le vide juridique créé par les interrogations sur les suites d'Hadopi fait croître le piratage de façon exponentielle. Certains opérateurs économiques sont allés voir le CSA. Nous discutons avec les ayants droit. Il y a urgence à ce que les pirates sachent que la zone de non-droit va bientôt disparaître.
La profession, que je ne représente pas, doit en avoir. Les ventes ont brutalement chuté il y a quelques mois, de l'ordre de 15 % à 20 %. Il y a urgence.

Le débat que nous aurons à ce sujet ne manquera pas d'être animé. Nous nous efforcerons de lever les incertitudes qui compromettent l'avenir. Le maintien de l'Hadopi serait-il selon vous de nature à faire diminuer le piratage, ou devrions-nous plutôt, comme le propose le rapport Lescure, transférer au CSA la responsabilité de mettre en oeuvre la réponse graduée?
La loi Hadopi, en créant un régulateur indépendant, a été fondatrice. Mais la dispersion nuit à l'efficacité. Le CSA, acteur majeur du secteur, a de plus un champ de compétence très large qui englobe autant les diffuseurs de contenus que les auteurs ou les producteurs. Lui donner davantage de moyens est une excellente idée.

Merci pour la passion que vous avez manifestée : elle a conféré à cette audition un suspense digne d'une série télévisée.

Monsieur Hees, soyez remercié d'avoir répondu à notre invitation. Quel regard portez-vous sur le projet de loi relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public ?
L'indépendance fait partie de mon travail de journaliste depuis 45 ans. Parfois source de difficultés, elle est tellement consubstantielle à mon métier que je ne me suis jamais vraiment posé de questions à son propos. De toute évidence, l'indépendance n'est pas qu'un slogan, c'est aussi un principe de base. Il n'en faut pas moins des personnes pour le traduire en actes.
N'attendez pas de moi que je juge la qualité des lois votées par la représentation nationale. Je ne l'ai jamais fait et ne le ferai jamais. Les antennes de Radio France sont mon seul juge de paix. Bien qu'il ne soit pas toujours facile de vivre dans un régime dont on n'a pas choisi les règles, il serait hypocrite de ma part de prendre position sur ce point. En toute hypothèse, l'indépendance n'est pas une licence pour faire n'importe quoi : le service public impose des devoirs.

Quel jugement portez-vous sur la procédure qui a conduit à votre nomination, et sur celle envisagée dans la réforme ? Un CSA composé de membres ayant réuni sur leur nom l'avis positif des trois cinquièmes des membres des commissions parlementaires chargées des affaires culturelles vous paraît-il de nature à réaffirmer l'indépendance, partant la crédibilité des directeurs qu'il nommerait ?
Plus globalement, comment voyez-vous la place que prend le CSA et l'extension de ses compétences en matière de régulation du secteur de l'audiovisuel ?
Enfin, pouvez-vous nous dire quelques mots de l'état de santé de Radio France ?
Je ne veux pas être juge et partie, ni faire preuve d'hypocrisie. J'ai des sentiments sur ces questions, mais je me refuse à commenter le travail du Parlement.
Le soupçon est une chose terrible à vivre. J'ai commencé à exercer le métier de journaliste à 17 ans, et je l'ai exercé, je crois, honorablement. Être président d'une chaîne du service public est un honneur, mais l'honneur personnel souffre du soupçon. En tant que président, je suis le garant de l'indépendance et de la liberté de cette belle entreprise qu'est Radio France. S'agissant du CSA...
Je les connais. Nous travaillons de concert. Vous savez, ce qui professionnalise cette institution me convient parce que je suis confronté à des enjeux industriels, portant sur des centaines de millions d'euros ; Radio France regroupe près de 130 métiers, des investissements doivent être engagés afin de dessiner un avenir. J'apprécie de travailler avec l'organe coopératif qu'est le CSA pour conduire les transitions utiles au groupe. Je crois aux vertus des règles, je n'ai pas de problème avec l'autorité, et en l'espèce, elle est sainement exercée car son contrôle est bienveillant.
Cela a d'ailleurs été l'objet du premier entretien que j'ai eu avec son président. En me donnant sa carte, Olivier Schrameck m'a conseillé de l'appeler immédiatement à la moindre difficulté. Il est vrai que les cahiers des charges et les règles à respecter, en matière publicitaire par exemple, sont complexes. Je n'émets aucun doute sur l'indépendance du CSA.

Le projet de loi dont nous parlons aujourd'hui modifie les modalités de sa composition. S'il était adopté, ce serait la première fois qu'une autorité serait composée de membres approuvés par trois cinquièmes des membres des commissions parlementaires. Cette procédure témoigne de l'entrée dans une nouvelle culture démocratique, plus apaisée. Elle est souhaitable, particulièrement par les temps qui courent. En outre, le CSA est doté de nouveaux pouvoirs de régulation économique du secteur, qui ne seront pas sans conséquences sur de gros dossiers comme la radio numérique terrestre, cette arlésienne. Pensez-vous que ces dispositions vont dans le bon sens ?
Tout ce qui favorise l'indépendance et la gestion plus professionnelle des dossiers va dans le bon sens. Nous sommes attentifs aux chantiers d'avenir, et voyons d'un bon oeil qu'une autorité spécifique soit chargée d'enjeux industriels majeurs. Cela nous aide à y voir clair et à programmer nos investissements.
J'étais lundi dernier à Saint-Etienne pour le lancement de la 44e station de France Bleu. C'est une formidable satisfaction. La station stéphanoise de France Bleu est un merveilleux projet, qui a réuni les élus locaux au-delà des clivages politiques.
Malgré des contraintes budgétaires plus fortes que par le passé, notre actionnaire nous respecte et nous a beaucoup épargnés. Radio France prend néanmoins sa part des sacrifices demandés à tous : nous réalisons des économies en veillant à ne pas abandonner nos objectifs initiaux.
France Culture, France Musique et France Bleu se portent bien. Trois autres antennes sont en difficulté. France Inter, d'abord, nous donne beaucoup de travail. Ses audiences ont piqué du nez après le sommet d'intensité de l'élection présidentielle, mais nous sommes confiants quant à leur relèvement. France Info est un cas plus complexe. Avec huit points d'audience, elle attire davantage d'auditeurs que les antennes d'information allemandes ou italiennes. Il n'en faut pas moins, sans renier le passé, changer la grille de programmes et ouvrir les esprits à la compétition comme aux nouveaux modes de consommation de l'information.
Le Mouv' est une affaire plus compliquée encore. C'est peut-être le moment de lancer une révolution. L'aventure dure depuis dix-sept ans, mais n'a toujours pas trouvé son aboutissement. Est-ce à dire que je n'y suis pas parvenu ? Je ne lâcherai jamais ce projet ! La population jeune de ce pays mérite toute l'attention du service public : sous ma houlette, Le Mouv' ne deviendra pas un robinet à musique. Je déplore les bêtises que rapporte la presse spécialisée sur Le Mouv', sur son budget et ses effectifs. J'ai lu qu'une station privée convoitait ses fréquences : il faudra me passer sur le corps : on ne confie pas les clés de la Banque de France à Bonnie and Clyde.
Il y a, c'est vrai, du travail à faire pour redresser la station, et la révolution numérique est l'occasion idéale pour s'y atteler. Marier le numérique et le broadcast servira d'ailleurs à l'ensemble du groupe Radio France. Nous y avons mis les moyens et nos équipes sont en ordre de bataille. Je viens de nommer notre responsable du numérique à la tête de la station - ce qui n'annonce en rien sa transformation en web-radio. Le Mouv' est le plus beau projet politique de Radio France : il lui reste à modifier sa programmation musicale et à trouver son public. Je suis attentif aux critiques et j'assume entièrement ce qui a été fait, mais comparons ce qui est comparable : Le Mouv' est présent sur 32 fréquences, France Culture sur 512. Un mot encore : cette chaîne est remplie de talents formidables qui ne lâchent rien, et je n'ai pas l'intention de les lâcher.

Vous avez dit que l'antenne devait résonner avec son territoire : cela me va droit au coeur. France Bleu, tant dans sa programmation musicale que dans ses reportages, remplit tout à fait son rôle dans ma région, le Finistère.
La semaine prochaine, nous examinons le projet de loi présenté par Mme Vallaud-Belkacem relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes. Certaines de ses dispositions portent sur le CSA et sur la représentation et le rôle des femmes dans la programmation audiovisuelle. Quel est celui-ci à Radio France, et quelle est la proportion de femmes dans les instances dirigeantes de cette société ? La chaîne joue-t-elle un rôle dans la lutte contre les stéréotypes de genre ?

L'offre de Radio France est très structurée, variée, organisée en stations thématiques. L'offre de la télévision publique ne vous semble-t-elle pas moins fortement structurée selon une logique thématique ?
Des critiques ont été émises sur le mode de gouvernance des chaînes publiques, notamment sur la présence des personnalités qualifiées au sein des conseils d'administration. Ces critiques concernent-elles Radio France ? Au-delà du rôle joué par le médiateur, comment concevez-vous la représentation des auditeurs de Radio France ? Est-elle envisageable au sein de votre conseil d'administration ? Passe-t-elle par de grandes associations de consommateurs plutôt que par des associations ad hoc ? Bref, comment concevoir un service public rénové qui ne représente pas seulement l'État actionnaire et les partenaires sociaux, mais aussi les auditeurs qui sont aussi les premiers pourvoyeurs de fonds ?

M. Hees a eu raison de ne pas se prononcer sur la notion d'indépendance : il y aurait perdu la sienne ! Nous sommes tous, au Parlement, attachés à l'objectif d'indépendance de l'audiovisuel public, cela va de soi. Le débat est évidemment politique, et nous rejoignons là les disputes qui ont émaillé l'examen de la loi de 2009. L'indépendance n'est pas de ce monde. Comme les modes de scrutin, la gouvernance change à chaque alternance politique. Heureusement, certains responsables ont un miroir dans leur salle de bain, qui les rappelle à leur devoir d'honnêteté intellectuelle. Votre successeur répondra des mêmes obligations. Si le débat n'est qu'une revanche sur le passé, vous avez raison de ne pas vous en mêler, d'autant que les récentes nominations, au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) et au CSA, n'étaient pas particulièrement guidées par l'exigence d'indépendance. Ce débat est par conséquent un faux débat.
Je me réjouis de l'état de santé de Radio France. Ses équipes sont attachées à redresser la barre là où c'est nécessaire. Vous avez mené votre action avec l'indépendance que nous défendons tous ici.

Le soupçon est difficile à vivre, avez-vous dit. Quelles mesures peut-on prendre pour réduire ce soupçon ?
Je préfère l'absence de soupçon. L'envie de remettre les pendules à l'heure me démange, car le soupçon est difficile à vivre, surtout pour un journaliste, mais ma position m'empêche d'en dire davantage.
Mon conseil d'administration, auquel votre rapporteur a siégé, est composé de gens de qualité, qui s'intéressent à la radio et donnent leur avis sur les antennes, les programmes, les orchestres, les intentions que nous manifestons dans toutes ces matières. Ils sont très attentifs à défendre la maison.
L'idée de leur adjoindre des représentants des auditeurs est intéressante, quoique j'ignore comment la mettre en oeuvre. Comme le monde a changé, nous sommes plus que jamais à l'écoute de nos auditeurs. Le médiateur, qui est la personne la plus décriée de la maison, assure un travail très difficile. Il y a une douzaine d'année, lorsque je dirigeais France Inter, les relations avec les auditeurs se limitaient à des échanges de courriers. Ne perdons toutefois pas de vue que le service public est un système d'offre et non de demande : nous n'avons pas à répondre aux exigences du moment.
J'ai réuni les directeurs de la chaîne sur la question de la parité hier après-midi. Bien sûr, nous y sommes tous très attachés. L'un d'eux m'a dit avec justesse : « comment rendre compte de l'actualité du monde si l'on en exclut une moitié ? ». J'ai une directrice générale, une directrice financière, nos antennes sont très féminisées, mais cela ne suffit pas. Nous avons lancé une enquête, dont les résultats nous sont parvenus hier : la perception qu'ont les femmes de nos équipes n'est pas satisfaisante. À l'avenir, il faudra nous auto-contraindre en prenant les dispositions adéquates.
Je ne juge pas les télévisions.
Je m'occupe des problèmes de Radio France. Diriger France Télévisions est une tâche très rude...

Il ne s'agit pas de se prononcer sur les personnes. L'offre de France Télévisions est spécifique, historiquement héritée, elle a sa logique propre.
Nos structures sont différentes. Nous produisons 100 % des contenus que nous diffusons ; la masse salariale représente 60 % de notre budget, contre 29 % à France Télévisions. Ce sont deux filières, deux industries complètement différentes.

Les directeurs d'institutions que nous auditionnons sont soumis à un devoir de réserve. Ceux dont la parole est la plus libre sont en définitive, et c'est normal, les responsables de grands groupes privés.
J'ai participé avec fougue au débat de 2009, mais en tant que rapporteur de ce texte, c'est l'avenir qui m'intéresse. Le vrai sujet n'est pas le concept abstrait d'indépendance, mais le consensus dans la nomination. Le relativisme n'est pas recevable : la nomination des prochains directeurs nécessitera votre accord, monsieur Leleux. Nous sommes à la recherche d'une procédure rassurante susceptible de nous aider à identifier les profils dont nous avons besoin.
Le soupçon, les politiques le connaissent. Dissipons-le en améliorant la transparence, recherchons l'efficacité ensemble, et avançons comme nous le faisions sous la présidence de M. Legendre.
Comme vous l'avez compris, je ne suis nullement insatisfait des changements prévus. Merci de votre écoute.

Nous nous fondons sur un simple constat : malgré les précautions de langage du président Hees, chacun a compris que la méthode maladroite de nomination suivie jusqu'ici éveillait des soupçons qui fragilisaient les personnes en dépit de leurs qualités. Nous entendons lever ces soupçons.

Merci, madame la présidente, d'avoir répondu à notre invitation. Cette audition s'inscrit dans le cadre des travaux préparatoires à l'examen des projets de loi relatifs à l'indépendance de l'audiovisuel public. Quelle lecture en faites-vous ? Quelles interrogations ou quelles réflexions suscitent-ils chez vous ? Et pouvez-vous faire le point sur l'état du groupe que vous dirigez ?
Il ne m'appartient pas de commenter un projet de loi qui touche directement à mon statut. Je rappellerai cependant que lors de ma nomination il y a un an, le Président de la République a souhaité devancer l'évolution du droit en demandant au CSA de désigner lui-même un candidat, qu'il nommerait. Et je dois dire que le fait d'être choisie par le Conseil a rendu ma position plus confortable. L'évolution prévue me semble donc aller dans le bon sens.
Il m'a également paru très important de présenter mon projet devant les commissions chargées des affaires culturelles des deux assemblées, dont le vote m'a touchée puisqu'il a montré que ma nomination était consensuelle et due à des critères professionnels. À l'avenir, les membres du CSA eux-mêmes ne pourront être nommés qu'avec l'aval de vos commissions. Les présidents de sociétés de l'audiovisuel public leur remettront un document d'orientation dans un délai de deux mois après leur nomination. Cette disposition est d'autant plus opportune qu'il ne s'agit que d'un premier document, et non du plan stratégique. Celui-ci réclame du temps, car il doit être l'émanation de toute l'entreprise. Il faut avoir l'humilité de découvrir la société où l'on arrive. Pour ma part, j'ai voulu élaborer le plan stratégique de France Médias Monde selon une méthode très participative, en organisant des séminaires le samedi sur la base du volontariat. Le plan fut ensuite restitué aux salariés au cours du mois de janvier, et c'est sur cette base que j'ai entamé les discussions avec l'État sur le futur contrat d'objectifs et de moyens.
Qu'est-ce que l'indépendance ? C'est presque un sujet de philo... L'indépendance ne consiste pas seulement en un mode de désignation ; c'est peut-être aussi un équilibre entre la liberté, la responsabilité et la confiance.
La liberté : la société que je dirige y est d'autant plus attachée qu'elle rassemble des médias d'information, organisés autour de rédactions. La liberté d'informer est l'un des piliers de la démocratie française, et elle n'existe pas partout. Il arrive encore, dans certains pays, que des journalistes soient blessés ou emprisonnés : il n'est pas inutile de le rappeler. Les choix éditoriaux de nos rédactions ne peuvent donc pas être l'émanation de la politique du gouvernement français. Cette indépendance figure en toutes lettres dans notre cahier des charges, et elle est le gage de notre crédibilité.
D'ailleurs, parmi les employés de France Médias Monde, on compte plus de 60 nationalités, et nous émettons en 14 langues. Cette diversité de points de vue fait notre richesse, et c'est peut-être une signature française. Elle n'empêche pas l'existence d'un socle de valeurs communes, énoncées dans une charte : honnêteté dans l'exposé des faits, pluralisme, liberté de conscience, laïcité, attachement aux droits de l'homme et à l'égalité entre les femmes et les hommes, promotion de la diversité. À cela s'ajoutent des règles strictes de traitement de l'information.
La responsabilité : un groupe audiovisuel à vocation internationale doit être conscient, notamment en période de crise, qu'il est capable d'infléchir le cours des événements, et qu'il peut même mettre en danger la vie de nos concitoyens. Un traitement responsable de l'information, c'est la condition de notre crédibilité, donc de notre indépendance.
Être responsable, c'est aussi rendre des comptes. Nous sommes financés par des fonds publics, et il est normal que nous répondions de notre activité devant le CSA, notre conseil d'administration, nos tutelles et le Parlement.
Mais il y faut un zeste de confiance, car une surveillance tatillonne serait contre-productive : nous avons besoin d'agir. Ce lien de confiance, nous le tissons avec notre actionnaire, l'État, par le biais d'un contrat d'objectifs et de moyens : par ce contrat, l'État et France Médias Monde s'entendent sur une stratégie, mais aussi sur des assurances financières qui sont la condition de notre indépendance.
Cette sécurité financière est particulièrement importante pour un groupe d'information, qui doit être indépendant non seulement du pouvoir politique, mais aussi des puissances d'argent. En droit français, un journal ne peut être parrainé, et c'est bien normal. Il serait également problématique qu'une émission médicale le fût par un laboratoire pharmaceutique. Un groupe comme le nôtre est soumis à une déontologie particulièrement stricte dans le choix de ses annonceurs publicitaires. Et c'est ce qui explique l'importance d'un financement public stable, donc fléché : la redevance, qui a récemment changé de nom.
L'audiovisuel extérieur n'a pas toujours bénéficié de la redevance. Il est encore largement financé par voie de subvention. La question de notre mode de financement mérite d'être posée, comme celle d'une réforme de la redevance, qui est en France l'une des plus basses d'Europe. Elle est encore plus basse en Grèce, et l'on voit ce qui arrive dans ce cas... Il me paraît important d'y réfléchir, comme vous le faites. L'État est soumis à des contraintes budgétaires qui limitent l'évolution des dotations. Dans ces conditions, et si l'on a des ambitions internationales, il faut une recette appropriée. Je rappelle que la dotation de l'audiovisuel extérieur, même si l'on y inclut TV5 Monde, représente moins de 9 % du budget de l'audiovisuel public français. Si l'on conserve la même proportion, il faudrait l'appliquer à un plus gros gâteau.
L'indépendance repose aussi sur la stabilité : il faut avoir du temps devant soi pour se sentir les coudées franches. D'où la nécessité de réfléchir à la durée des mandats et à la stabilité des stratégies.
Nous entretenons actuellement des relations tout à fait satisfaisantes avec l'État. Le projet de contrat d'objectifs et de moyens est une véritable refondation de l'audiovisuel extérieur. Avec le Parlement, nous avons également des échanges intenses. J'ai invité les membres des commissions de la culture et des affaires étrangères à venir visiter nos locaux, car si le questionnaire parlementaire est utile, un contact direct peut être éclairant.
Nos relations avec le CSA ne sont pas moins excellentes. J'ai voulu associer le Conseil à notre stratégie. Ses membres au grand complet nous ont fait l'honneur de leur visite, et ils ont tenu une réunion de travail à bâtons rompus avec toute l'équipe de la direction.
J'aimerais évoquer la question de notre présence en France. Je conçois que des entreprises privées puissent s'inquiéter de l'arrivée de nouveaux venus dans le paysage audiovisuel national et de la modification du marché publicitaire qui en résulterait. Mais si je plaide en ce sens, c'est parce que France Médias Monde est investie d'une mission de service public, je dirais même d'une mission sociétale. Le service public donne le la : un service public fort, c'est un gage de haut niveau pour le paysage audiovisuel dans son ensemble. En outre, nous ne nous adressons pas seulement à des téléspectateurs ou des auditeurs, mais à des citoyens, et certains sujets ne sont pas traités par les médias nationaux. France 24 est par exemple la seule chaîne d'information continue dotée d'un positionnement mondial. Elle n'envisage d'ailleurs pas de se financer sur le marché français. Et n'est-il pas difficile pour elle de prétendre obtenir des fréquences de TNT dans d'autres pays, sans en avoir en France ? J'aimerais au moins que la chaîne obtienne une fenêtre d'émission sur une fréquence : nous en discutons avec l'État.
Radio France International (RFI), de son côté, est une station remarquable, qui remplit - comme le reconnait Jean-Luc Hees, avec qui j'ai eu des échanges très confraternels - des missions de service public laissées de côté par les médias nationaux. La rédaction a une connaissance très précise de l'Afrique, où vivent des milliers de nos ressortissants. Grâce à RFI, Français et étrangers sont rendus sensibles à de grands enjeux internationaux. Je note d'ailleurs une distorsion entre l'Ile-de-France, où la station émet, et la province où elle n'émet pas. Tout le monde ne peut pas écouter la radio sur son ordinateur ou son téléphone, et le service public est encore absent de la radio numérique nationale.
RFI accorde une grande place à l'actualité européenne, qui n'intéresse guère les médias nationaux. Chaque jour, l'émission Accents d'Europe décrit la vie des sociétés civiles européennes et oeuvre ainsi à leur rapprochement : créer un sentiment européen, c'est apprendre à rire ensemble, à s'inquiéter ensemble. Et l'émission Carrefour de l'Europe accueille des parlementaires européens qui, pour beaucoup d'entre eux, sont francophones - et qui s'étonnent de ne pas pouvoir écouter leurs propres interviews lorsqu'ils siègent à Strasbourg... Dans toute la France, RFI aurait son public : parmi ses auditeurs franciliens, on compte notamment des personnes d'origine étrangère et des « CSP ++ ».
Quant à Monte-Carlo Doualiya, c'est une radio arabophone laïque, universaliste, attachée à l'égalité hommes-femmes, très écoutée dans le monde arabe et notamment dans des pays en crise comme la Syrie, l'Irak ou le Liban. L'arabe est aussi une langue de France. C'est la France qui a inventé l'agrégation d'arabe ! Et pourtant, il reste impossible d'écouter ici Monte-Carlo Doualiya. D'autres radios arabophones émettent sur notre territoire, mais ce sont des stations confessionnelles...
Actuellement, RFI et Monte-Carlo Doualiya se partagent une fréquence à Marseille, mise à disposition par l'aviation civile jusqu'au 31 janvier prochain. Les Marseillais, comme les employés des deux stations, seraient tristes que l'aventure s'arrête là. Se savoir écoutés sur tous les bords de la Méditerranée, c'est pour eux une source de grande fierté. Et il est bon de faire entendre à la radio française d'autres réalités que celles de Paris. Nous sommes en discussion avec nos tutelles et le CSA pour trouver le moyen de poursuivre cette diffusion.

Lors de notre récent entretien, madame la présidente, nous avons parlé de la situation de l'audiovisuel public extérieur. Aujourd'hui il est question du projet de loi relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public. Vous avez proposé une définition de l'indépendance. Et c'est peut-être parce que le Président de la République a anticipé, dans votre cas, le nouveau processus de nomination, que vous éprouvez aujourd'hui cette joie si perceptible à exercer vos fonctions. Lors de votre audition ici même, il y a un an, nos échanges furent consensuels. De la même façon, pour nommer les membres du CSA, il faudra désormais rechercher systématiquement un consensus, en dépassant les clivages politiques.
Comme vous, M. Pflimlin avait insisté sur l'indépendance financière du service public, par rapport à l'État mais aussi aux puissances d'argent. Le présent projet de loi n'en traite pas. Mais notre commission a souvent défendu l'importance de la redevance, qui n'est pas redéfinie chaque année comme les dotations, et je retiens votre plaidoyer vibrant, parfaitement argumenté, en faveur de ce mode de financement. L'an dernier, le Sénat a voulu aller au-delà de l'augmentation de la redevance inscrite dans le projet de loi de finances qui lui était soumis, en relevant la redevance de quelques euros supplémentaires. Et ce mouvement devra se poursuivre, car l'audiovisuel public doit être financé principalement par la redevance. C'est déjà vrai dans votre cas.
Il est important de se souvenir que l'audiovisuel public, ce n'est pas seulement France Télévisions. À l'heure de la mondialisation, l'audiovisuel extérieur ne doit pas être considéré comme un élément marginal de notre paysage audiovisuel. Vous avez plaidé pour que France 24 soit visible depuis la France : je m'en souviendrai. Un de nos collègues plaidait hier pour que les Français de l'étranger aient accès aux chaînes publiques nationales...

Il n'est pas normal que tout le monde ne puisse pas voir France 24 en clair. Certes, une décision brutale pourrait déséquilibrer le marché ; il en va de même si LCI avait accès à la TNT gratuite. Mais France 24, pour sa part, ne compte pas investir le marché publicitaire national... Prudente, vous ne réclamez pour l'instant qu'une « fenêtre ». Mais là où le service public n'est pas, d'autres prennent sa place ! Il n'existe pas de radio publique en arabe en France, d'autres émettent, qui ne véhiculent pas toujours des idées aussi rassembleuses !
Vous avez devancé la plupart de mes questions. Je voulais, par exemple, vous demander ce que le nouveau mode de désignation des présidents des sociétés de l'audiovisuel public changerait à vos yeux. Le devoir de réserve auquel vous êtes soumise vous empêche de répondre, mais votre parcours parle pour vous.
Une question tout de même. L'extension des pouvoirs du CSA et l'assouplissement de ses procédures de travail vont-elles, selon vous, dans le bon sens ? Ou doit-on craindre une autorité tentaculaire, comme certains pourraient éventuellement le supposer ?

L'indépendance est aussi celle de votre conseil d'administration. La proportion d'administrateurs indépendants au sein de France Médias Monde vous semble-t-elle raisonnable ?
Je suis très favorable à la diffusion de France 24 sur le territoire national, pour toutes sortes de raisons et d'abord parce qu'il est utile de donner aux téléspectateurs français une vue plus mondiale de certains problèmes. Vous vous êtes engagée à oeuvrer en ce sens depuis votre nomination. Où en sont les négociations ?
RFI émet à Marseille jusqu'au 31 janvier. Espérez-vous pouvoir continuer ? La même expérience est-elle envisageable à Strasbourg ou dans d'autres grandes villes françaises ?

On s'étonne en effet que des chaînes de télévision et des stations de radio, dont le rôle n'est pas de porter la voix mais des voix de la France, ne figurent pas dans le paysage audiovisuel national. On parle d'une troisième chaîne d'information en continu, mais France 24 est la seule à offrir des reportages, au lieu d'un flux ininterrompu de séquences de plateau avec quelques images... Il importe pour le développement de France 24 et RFI qu'elles puissent émettre en France. On le doit aux Français, qui les financent au travers de la redevance. Je suis pour une vraie concurrence, qui suppose la diversité des formats.
Certes, une diffusion nationale 24 heures sur 24 aurait un coût. France 24 n'en a peut-être pas les moyens.

Toujours est-il que vous pourriez vous inspirer de l'expérience de la Sept, chaîne préfiguratrice d'Arte qui diffusait quatre ou cinq heures de programmes le samedi après-midi : c'était un moyen de faire connaître ses émissions, avant la diffusion sur un canal dédié.
L'indépendance de l'audiovisuel public doit être appréhendée dans sa globalité, en tenant compte de l'audiovisuel extérieur. La diffusion en France est une source de de notoriété : j'ai pu le constater dans ma vie professionnelle, lorsque RFI s'est mise à émettre en région parisienne. Il était beaucoup plus facile alors pour les journalistes d'attirer des invités. Comme vous l'avez dit, les parlementaires européens s'étonnent de ne pas pouvoir écouter leurs interviews à Strasbourg ! Tout le monde n'a pas accès au podcast, et RFI ne doit pas s'adresser seulement aux CSP + et à la classe politique.

Lorsqu'on parle de l'audiovisuel public, on pense immédiatement aux chaînes et stations nationales. C'est dans doute lié à l'histoire et aux aléas de l'imputation budgétaire. On ne reconnaît pas assez l'incidence de l'audiovisuel public français en dehors de nos frontières. Une fois de plus, ce projet de loi néglige cet aspect des choses. Je me réjouis donc que le rapporteur ait rappelé la demande que j'ai faite à Mme la ministre hier.
L'indépendance de l'audiovisuel public passe aussi par une offre élargie et équitable, afin de mieux informer nos concitoyens en France comme ailleurs : je rappelle que 2,5 millions de Français vivent à l'étranger.
Nous connaissons votre engagement ; nous ne sommes pas insensibles à votre proposition d'ouvrir une fenêtre régionale de diffusion pour France 24 ; vous teniez le même discours en tant que directrice générale de TV5 Monde. Notre offre audiovisuelle à l'extérieur, malheureusement, est méconnue, y compris par le gouvernement. Ce projet de loi ne prend pas assez en compte l'influence de la présence française à l'étranger. Comment envisagez-vous l'évolution du dossier de la TNT ? Il s'agit d'un enjeu national mais aussi international pour notre pays. Je partage votre volonté d'élargir vos possibilités de diffusion à l'international.
L'autorité du CSA est-elle tentaculaire ? J'ai toujours, même à TV5 Monde, société multilatérale avec des règles particulières, essayé d'entretenir des rapports étroits avec les différents membres du CSA. Professionnels de l'audiovisuel, ils comprennent nos enjeux et projets et peuvent nous apporter un appui et une aide. Ce dialogue est complémentaire du dialogue avec notre tutelle financière et constitue plutôt une occasion de mieux nous faire entendre.
Même indépendante, France Médias Monde est une société publique financée par des fonds publics. La tutelle décide des allocations budgétaires et influe sur certaines décisions stratégiques. Nous sommes soumis à des règles de droit public. C'est normal. Aussi au conseil d'administration les représentants de notre autorité de tutelle pèsent-ils davantage que les personnalités extérieures, même si celles-ci, venues d'autres horizons, apportent un autre éclairage.

Certains regrettent l'absentéisme de ces personnalités indépendantes, leur manque d'expertise notoire en matière d'audiovisuel extérieur ou encore leur inertie. D'autres personnalités, plus jeunes et plus dynamiques, n'apporteraient-elles pas davantage à votre société ?
Ces personnalités extérieures connaissent l'international et l'audiovisuel. La composition de notre conseil d'administration doit répondre à l'objectif de parité, encore renforcée avec la dernière nomination, et de représentation de la diversité. Il est important de renforcer la diversité de notre conseil pour y associer des Français qui connaissent à la fois les problématiques de l'audiovisuel et les cultures de territoires étrangers.
Concernant les fréquences FM, nous n'avons malheureusement pas lancé d'expérimentations à Strasbourg. À Marseille, grâce au soutien des élus locaux, dans le cadre du projet « Marseille capitale européenne de la culture 2013 », de l'antenne locale du CSA, et de l'aviation civile, nous avons réussi à occuper une fréquence à titre temporaire. On sent en écoutant RFI, qui est à Marseille, que l'émission ne vient pas de Paris. Outre la touche de soleil apportée par les invités, les journalistes eux-mêmes adoptent un autre ton. La France constitue l'un des axes de notre plan stratégique. Nos auditeurs savent que nous émettons depuis la France. Le nom de nos chaînes est révélateur : France 24, Radio France International... Il importe que nous représentions toute la diversité de la France et non seulement Paris. C'est pourquoi cet axe me tient à coeur
Le logo a légèrement évolué. La radio existe depuis 40 ans ; sa notoriété étant forte, il fallait conserver la dénomination « Monte Carlo ».
Nous souhaitons obtenir des fréquences dans plusieurs grandes villes ouvertes vers l'international : Strasbourg, Marseille, Bordeaux ou Toulouse ; une élue toulousaine de notre conseil d'administration souhaite que RFI puisse émettre du Mirail.
Pour MCD, nous avons demandé des fréquences en Ile-de-France et à Marseille, où réside une importante population arabophone. Ces projets ont un coût raisonnable. Nous connaissons les contraintes budgétaires de l'État et bornons nos ambitions sans dresser de plans sur la comète. De nombreux élus sont prêts à trouver des recettes pour financer notre présence. Une discussion est aussi en cours avec Radio France qui ne perçoit pas notre demande comme une forme de concurrence.
Pour la TNT, nous rêvons d'une fréquence permettant de diffuser 24 heures sur 24 en France. Contrairement à la Sept qui ne disposait que d'une fenêtre d'émission, faute de pouvoir produire suffisamment de programmes, nous émettons déjà partout dans le monde en continu. Notre offre est importante et nous la renforçons : nous avons créé une tranche d'informations de 6 heures à 10 heures, avec de l'information tous les quarts d'heure et des ouvertures sur l'Asie ; sur le canal en français, des journaux sont consacrés à l'Afrique ; sur le canal arabe, nous avons lancé une « heure du Maghreb » en arabe, journal que nous aimerions développer en français et que l'Algérie souhaite diffuser. Nos équipes sont mobilisées. Nous sommes une des rares chaînes à disposer d'envoyés spéciaux à Damas et sommes très sollicités par les autres médias. Il est dommage que tous nos concitoyens ne puissent pas profiter de nos initiatives.
Nous n'avons pas demandé une fréquence nationale car le coût, 7 millions d'euros en simple définition, est élevé pour notre actionnaire, l'État, et nous ne voulons pas remplacer un autre émetteur. C'est pourquoi nous souhaiterions obtenir des fenêtres de diffusion nationale sur des chaînes de service public. De plus un créneau semblait libre en Ile-de-France. Les autorités de tutelle nous ont prêté une oreille attentive ; mais les contraintes sont fortes, France Télévisions est aussi en mouvement.
Monsieur Duvernois, une anecdote illustrera la méconnaissance de notre diffusion à l'étranger : récemment à Marseille, dans une école de journalisme, j'ai présenté France Médias Monde, ses médias, son plan stratégique, etc. À la fin de mon exposé, une étudiante a reconnu qu'elle n'en savait rien !
Mais, inversement, l'audiovisuel national doit être vu. Telle est la mission de TV5 Monde de diffuser les programmes libres de droits. Disposer des droits de diffusion à l'international est coûteux. C'est une question complexe mais centrale.