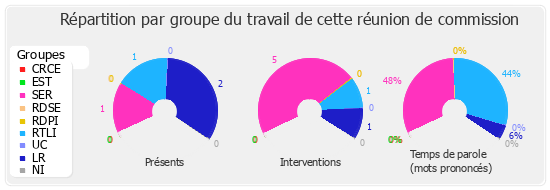Délégation sénatoriale à la prospective
Réunion du 23 octobre 2013 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion

Mes chers collègues, nous sommes heureux d'accueillir Philippe Chalmin, professeur d'économie et d'histoire et fondateur du cercle Cyclope, laboratoire de recherche sur les marchés des matières premières, qui est en train de préparer son 28e rapport annuel. Nous avons souhaité recueillir son avis de spécialiste reconnu sur les perspectives à long terme concernant les marchés des matières premières. Je lui cède donc la parole.
Mesdames, messieurs les sénateurs, pour appuyer mon propos, je vais vous présenter un certain nombre de graphiques que je commenterai en même temps. Je commencerai en nous resituant dans la tendance économique générale.
S'agissant de la croissance du PIB mondial en volume, nous subissons toujours les conséquences de la crise des subprimes survenue en 2008, avec une rechute bien visible en 2012-2013 suivie, récemment, d'un léger rebond. Cette rechute, l'évolution de l'indice boursier mondial le montre, les marchés boursiers ne l'ont pas connue : un tel optimisme est compréhensible dans la mesure où les entreprises mondiales bénéficient du dynamisme des pays émergents.
Pour leur part, les marchés des matières premières sont, encore aujourd'hui, touchés par un choc d'une ampleur comparable à celui que nous avons connu en 1974. Nous construisons tous les jours avec Coe-Rexecode un indicateur global, assis sur un panier constitué de matières premières, de l'énergie, des matières agricoles et des métaux non ferreux. Depuis sa création en 1988, cet indicateur a connu son point le plus bas à la fin de 1998 et au début de 1999 : jamais sans doute, au cours du XXe siècle, les prix des matières premières n'avaient été, en valeur réelle, si peu élevés. Ils ont été, depuis, multipliés par six.
Je mettrai deux bémols à ce constat. D'une part, ces cours sont exprimés dans une monnaie, le dollar, qui est instable. D'autre part, il s'agit de prix courants, même si l'incidence de l'inflation est toute relative. Le graphique montre très clairement un « hoquet » au second semestre 2008, suivi d'un rebond. Depuis pratiquement trois ans, les prix des matières premières restent stables, à des niveaux très élevés.
Quelles sont les incertitudes qui pèsent actuellement sur la situation économique mondiale ?
Tout d'abord, l'économie chinoise ralentit. J'attire votre attention sur le fait que, pour la Chine, ce qui équivaut pour nous à la croissance zéro se situe probablement entre 5 % et 6 %. Autrement dit, à ce niveau, la Chine ne crée pas les emplois nécessaires pour satisfaire non seulement son trend démographique mais surtout les vingt millions de migrants qui, chaque année, quittent les campagnes pour aller vers les villes.
Le graphique illustrant la croissance de la production industrielle chinoise est sans doute le plus intéressant à ce titre, car il est vraiment le plus explicatif de la crise des matières premières que nous vivons aujourd'hui. Je ne cesse de le dire à mes étudiants, c'est le graphique le plus extraordinaire de toute l'histoire économique. Il commence en 1998, mais il aurait pu débuter en 1976, à la mort de Mao. Depuis 1976, la Chine et son 1,3 milliard d'habitants tournent en moyenne à 10 % de croissance annuelle.
Pour donner un ordre de grandeur, entre 1880 et 1914, les États-Unis, le grand pays émergent de l'époque, ont enregistré une croissance annuelle moyenne de 4,5 %, avec une population passant de soixante millions à cent millions de personnes, sur un total mondial de 1,8 milliard d'êtres humains à la veille de la Première Guerre mondiale.
À la fin du XXe siècle, la production industrielle chinoise suit un trend de 10 % de croissance par an et connaît un changement de braquet brutal à partir de 2001-2002. Souvenez-vous qu'en novembre 2001, à Doha, la Chine adhère à l'OMC. Sur les huit années suivantes, la moyenne de la croissance chinoise monte à 16 %, et la Chine apparaît alors sur les marchés mondiaux des matières premières, alors que ce pays avait auparavant un rôle marginal, tantôt importateur, tantôt exportateur.
C'est à partir du début du XXIe siècle que la Chine importe de plus en plus de matières premières, jusqu'à en devenir pratiquement le premier importateur aujourd'hui. À la limite, il est plus facile de recenser ce qu'elle n'importe pas ou pas beaucoup : cela se résume au café, au chocolat et au sucre. Ainsi, en 2002, la Chine importait cinquante millions de tonnes de minerai de fer ; en 2012, elle en a importé six cent cinquante millions de tonnes.
La croissance de la production industrielle marque une pause avec la crise de 2008, en diminuant même légèrement vers janvier 2009. Puis elle repart à la hausse, ce qui explique que l'indice des matières premières atteigne son plus haut à la fin de 2009 et au début de 2010.
Depuis, la production chinoise est assez fluctuante, très dépendante des aléas de la conjoncture politique. Elle a ainsi eu un passage à vide en 2012, en raison des incertitudes pesant sur le changement des équipes au pouvoir, de la tenue du 18e congrès du Parti communiste et des « révolutions de palais » autour de l'affaire Bo Xilai. Au début de 2013, la production industrielle est revenue à un niveau de croissance annuelle autour de 8 %-9 %, et de 10 % aujourd'hui.
La Chine était encore un petit radeau dans les années quatre-vingt-dix ; elle est désormais la deuxième puissance économique mondiale. Le fait de maintenir de tels niveaux de demande sur les marchés mondiaux est véritablement marquant.
Derrière la Chine, les autres pays émergents sont en train de « digérer » leur croissance récente relativement forte. Le taux de croissance annuel atteint 4 %-5 % en Inde, 2 %-3 % au Brésil. La Russie est plus un « émirat pétrolier » qu'un pays émergent : c'est un très bel exemple de ce que j'appelle la malédiction des matières premières ; j'y reviendrai.
La croissance américaine, inférieure à 2 %, n'a rien de très extraordinaire quand on sait tous les « dopants » fournis par les autorités de la FED au travers notamment du quantitative easing. Cela va tout un petit mieux sur le marché immobilier, d'où la crise est partie avec les subprimes. Les États-Unis se sont remis à créer des emplois, entre cinq millions et six millions, mais pas suffisamment pour récupérer les sept millions et demi d'emplois perdus en 2008-2009. D'où la faiblesse persistante du taux de participation à l'emploi calculé selon les critères américains. Néanmoins, les chefs d'entreprises américaines ont retrouvé un tant soit peu le moral, d'après les résultats de la célèbre enquête menée auprès des directeurs d'achat.
Un élément joue pour moitié au moins dans la croissance américaine : c'est le choc énergétique des gaz de schiste.
En France, la messe est dite, leur exploitation n'est pas envisageable avant la prochaine élection présidentielle.
Peut-être. Aux États-Unis, les gaz de schiste ont provoqué une véritable révolution énergétique.
La courbe d'évolution du prix du gaz naturel est exprimée en dollar le million de BTU, pour British Thermal Unit. Pour avoir l'équivalent en dollar par baril de pétrole, il faut multiplier par six. Actuellement, le gaz naturel vaut à peu près 3,75 dollars le million de BTU, c'est-à-dire moins de 24 dollars le baril équivalent pétrole. En 2006, avant le développement des gaz de schiste, l'hiver avait été particulièrement rigoureux, entraînant une hausse de la consommation de gaz naturel à un point tel que les Américains étaient persuadés d'avoir atteint le Peak gas : le prix du gaz avait dépassé 15 dollars le million de BTU, soit plus de 100 dollars le baril équivalent pétrole. Rappelons-nous que le pétrole n'avait atteint son propre pic que dans les premiers jours de 2008.
Depuis, le prix du gaz n'a cessé de diminuer. Nous, Européens, payons le gaz naturel 11-12 dollars le million de BTU, grosso modo trois fois plus cher. Pour le Japon, le prix d'importation du gaz naturel liquéfié est de 17-18 dollars le million de BTU. Les États-Unis bénéficient donc en la matière d'un avantage comparatif considérable.
Ne nous faisons pas d'illusion. Même si la France avait du gaz de schiste exploitable, ce que nous ne savons pas à l'heure actuelle, étant donné le poids des normes environnementales, tout à fait légitimes d'ailleurs, et notre structure géologique, à mon avis moins favorable, la production se ferait à un coût de revient de l'ordre de 8 dollars le million de BTU. Ce serait tout de même inférieur au prix d'importation du gaz naturel, et cela nous donnerait une marge de manoeuvre pour renégocier nos contrats avec Gazprom et la Sonatrach.
Cela étant, à l'instar des OGM, les gaz de schiste sont devenus un sujet politique, sur lequel aucune discussion rationnelle n'est possible. Nous ne pouvons que constater avec un peu plus de déception le niveau de la croissance américaine en sachant que la révolution énergétique, qui touche aussi le développement des pétroles non conventionnels, les pétroles de schiste, y contribue pratiquement pour moitié.
Si la situation des États-Unis n'est pas très glorieuse, celle de l'Europe n'est vraiment pas brillante. Je viens d'apprendre que l'OFCE tablait sur une croissance française à 1,3 % l'année prochaine. J'avoue que ce n'est pas exactement mon sentiment.
À voir l'évolution du nombre des logements mis en chantier en Espagne, passé de plus d'un million en 2006 à 30 000-40 000 à l'heure actuelle, je n'aurai qu'un commentaire : c'est le moment de s'acheter un appartement sur la Costa Brava ! Les Allemands ne se portent finalement pas si mal que cela, même s'ils ont du mal à relancer la consommation et qu'ils ne jouent pas le rôle moteur qui devrait être le leur. Quant aux Français, ils ont, comme vous le savez, le moral dans les chaussettes, et cela n'a pas dû s'arranger ces quinze derniers jours. Le dernier indicateur à ce sujet date de septembre ; je redoute une rechute au mois d'octobre.
Mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi de livrer maintenant à votre sagacité un graphique d'une insigne cruauté, celui qui compare les taux de chômage allemand et français. Il se passe de commentaires... L'OFCE, par la voix d'Éric Heyer, prévoit 11 % de chômage en France à la fin de l'année prochaine malgré 1,3 % de croissance.
D'une manière générale, je ne fais pas partie des plus optimistes sur les prévisions de croissance des pays avancés. Cela n'engage que moi et la croissance n'a de toute façon qu'une incidence secondaire sur le marché des matières premières dans la mesure où la consommation dans ces pays ne varie pas significativement. Incontestablement, c'est la demande émanant des pays émergents qui pèse le plus.
En revanche, les taux de croissance ont une implication sur une matière première essentielle qui s'appelle le dollar. Tous les marchés que j'évoque sont cotés en dollars, avec une corrélation du fait de la capillarité des marchés financiers : en clair, quand le dollar monte, le prix des matières premières baissent, et quand il descend, le prix des matières premières a tendance à monter. Ainsi, en juillet 2008, le pétrole atteint son point maximal, le dollar comparé à l'euro son point minimal. C'est à ce moment que se produit un événement fascinant : l'un et l'autre se retournent presque en même temps sans que l'on sache qui a commencé.
Sur une durée longue, à en croire la théorie de la PPA - la parité de pouvoir d'achat, en d'autres termes l'« indice Big Mac » -, le dollar devrait se situer entre 1,15 et 1,20 euro. Il est aujourd'hui sous-évalué. L'euro est pourtant le seul marché assez important pour juger de la faiblesse ou de la force du dollar, puisque le yuan n'est pas convertible.
Le cadre général fixé, venons-en aux matières premières.
Deux indicateurs sont à comparer. Le premier, global, est très dépendant du pétrole ; le second ne comprend pas l'énergie et s'appuie sur les produits agricoles et les métaux non ferreux. Je précise qu'il s'agit de l'énergie mondiale. Il n'est donc pas possible d'intégrer le gaz naturel puisque cette ressource n'a pas de prix mondial. Le premier indicateur a connu son point le plus haut en janvier 2011, dépassant même le pic survenu en janvier 2008, ce qui est directement dû à l'impact des achats chinois. Il s'est depuis lentement érodé, pour atteindre aujourd'hui un niveau de prix comparable à celui du deuxième trimestre 2008, qui était déjà un record. Le niveau le plus bas correspond à la fin de 2001, après le 11 septembre, c'est-à-dire le creux de la récession américaine. J'oserai dire que Ben Laden était un grand économiste : il a frappé des États-Unis qui étaient en récession alors que personne ne le savait.
Je vais maintenant balayer un certain nombre de marchés, en commençant par le pétrole.
Aujourd'hui, le baril oscille entre 100 et 110 dollars et on a l'impression que le pétrole n'est pas cher. Mais regardez la courbe ! Je cite toujours la couverture de The Economist, sur laquelle on pouvait voir un derrick en train de s'effondrer et lire cette légende : « Oil : 5 dollars the baril ? ». Des gens intelligents se demandaient donc si le pétrole pouvait tomber aussi bas.
Moi-même, en 2001-2002, je situais le prix du pétrole durablement dans une fourchette allant de 20 à 30 dollars le baril, en m'appuyant sur le raisonnement suivant : au-dessous de 20 dollars, les États producteurs se seraient retrouvés en difficulté ; au-dessus de 30 dollars, l'économie mondiale n'aurait pu supporter pareil choc. Or, le 10 juillet 2008, le pétrole a atteint 147 dollars le baril puis est retombé un petit peu.
Il faut distinguer le prix du pétrole à l'international, le Brent, du prix du pétrole américain, le WTI, le West Texas Intermediate. Au cours des dernières années, l'écart entre les deux a pu aller jusqu'à 25 dollars. Il est aujourd'hui de l'ordre de 10 dollars, le Brent valant 110 dollars, le WTI 100 dollars. L'une des raisons de cet écart provient du fait que les États-Unis ont développé leur production nationale. Au mois de septembre dernier, la Chine les a dépassés comme premier importateur mondial.
Au fond, le marché du pétrole a été relativement peu perturbé. Les cours montent très légèrement au moment des frappes franco-américaines sur la Syrie, et cela se calme rapidement. À l'heure actuelle, le marché est bien approvisionné. Je me risque encore à un truisme dangereux : un prix de 100-110 dollars conviendrait à peu près à tout le monde. Outre qu'un tel niveau ne constitue pas un poids majeur, il représente un puissant facteur d'équilibre géopolitique. En effet, la plupart des pays producteurs équilibrent leur budget avec un pétrole à 80-100 dollars le baril. À 100 dollars, ils sont en mesure de rentabiliser des infrastructures nouvelles. Récemment, Total, soutenu par des partenaires chinois, a remporté le contrat relatif au gisement Libra au Brésil : étant donné qu'il y a trois mille mètres d'eau et trois mille mètres de sel au-dessous, le pétrole ne devrait pas sortir à moins de 80 dollars le baril.
Un prix de 100 dollars permet donc de garantir un relatif équilibre. Ainsi, l'Arabie saoudite n'as pas eu à pâtir du problème libyen, les actes de piraterie se stabilisent au Nigéria, l'Iran ne soulève pas de difficultés particulières. Je ne vois donc pas, à titre personnel, de détente sur le marché à très court terme.
Si, dans ce marché de l'énergie, le pétrole est le marché symbole, le gaz naturel, pour lequel, je le répète, il n'y a pas de prix mondial, nous raconte une histoire tout à fait différente. La révolution du gaz naturel a eu un impact sur la troisième grande énergie, à savoir le charbon. Le charbon est aujourd'hui l'énergie la plus sale, mais c'est aussi la plus consommée dans le monde.
Du fait du développement des gaz de schiste, les États-Unis se sont décarbonés, le gaz naturel augmentant sa part de marché dans la production d'électricité aux dépens du charbon. Étant un grand pays charbonnier, ils ont ainsi dégagé des excédents de charbon pour l'exportation, lesquels pèsent sur le marché mondial. Le charbon est un marché pur, qui n'a pas de marché dérivé. Alors qu'il a pu coûter, « coût et fret », 150 dollars la tonne, il doit se négocier à Anvers autour de 85 dollars la tonne aujourd'hui.
Que font nos amis Allemands qui, pour des raisons « vertueuses », ont décidé de sortir du nucléaire ? Comme ils n'ont pas encore suffisamment d'énergies alternatives, ils développent leur production d'électricité thermique, non pas avec du gaz trop cher, mais avec du charbon. Un industriel français du sucre m'a confirmé que le charbon était beaucoup moins cher que le gaz.
Après l'énergie, j'évoquerai l'agriculture.
En la matière, nous sortons à peine de la troisième crise majeure en cinq ans. Une très bonne illustration vous en est donnée par la courbe du prix du blé à Chicago, exprimé en dollar le boisseau, qui est une composante majeure du prix mondial des matières agricoles.
Le cours du blé est déprimé. Après une petite pointe en 1995-1996, liée à un accident climatique, il se situe de 1997 à 2006 entre 2 et 4 dollars le boisseau. À partir de 2007, nous connaissons un épisode climatique très marqué avec le phénomène El Niño prononcé dans la zone pacifique, principalement en Australie. C'est la première grande flambée des prix, à la fin de 2007 et au début de 2008, connue sous le nom d'« émeutes de la faim ». La FAO a organisé un sommet alimentaire mondial en juillet 2008, au cours duquel de grandes décisions ont été prises. Mais, trois mois plus tard, Lehman Brothers fait faillite et tout est oublié. La canicule survenue en Russie en juillet 2008 a provoqué une nouvelle flambée des prix. En 2012, la sécheresse aux États-Unis a entraîné une hausse du blé, mais aussi du maïs et du soja.
Aujourd'hui, nous sommes plutôt dans une phase que je qualifierai d'atterrissage en douceur. Le cours du blé est remonté aux environs de 7 dollars le boisseau, soit le double d'avant la crise. Si les prix sont en train de rebondir, c'est en raison du poids de la Chine. Alors qu'elle n'était que marginalement présente sur le marché du blé, cette année, en raison de mauvaises récoltes, elle va dépasser l'Égypte comme premier importateur mondial, ce qu'elle est d'ores et déjà pour le soja.
Sur le soja, nous retrouvons des périodes de crises similaires au blé, avec un impact de la sécheresse américaine encore plus fort en 2012-2013. Les cours du soja se sont maintenus pendant des années entre 5 et 6 dollars le boisseau. Ils oscillent aujourd'hui entre 10 et 13 dollars, frôlant même un jour, à Chicago, 20 dollars le boisseau. La Chine importe aujourd'hui à peu près un tiers du soja mondial, ce qui est somme toute logique car, à la différence des Indiens, les Chinois ne sont pas végétariens. Du reste, la Chine devient un importateur structurel de maïs, des accords de long terme avec l'Ukraine venant d'ailleurs d'être signés.
Ces marchés des céréales sont littéralement sur la corde raide, avec des stocks de reports pour la campagne 2013-2014 qui vont être extrêmement réduits.
Je continue mon petit catalogue à la Prévert en abordant les marchés des métaux.
Intéressons-nous à l'indicateur qui reprend les six grands métaux non ferreux cotés sur la bourse de Londres, à savoir l'aluminium, le cuivre, le nickel, le plomb, le zinc et l'étain. Les prix ont été multipliés par quatre et restent à un niveau élevé, avec des histoires différentes. Tous les graphiques montrant l'évolution des cours des métaux ont à peu près le même aspect : flambée des prix jusqu'en juillet 2008, effondrement lié à la disparition temporaire de la Chine des marchés, rebond très net. Ce cycle se retrouve non seulement sur tous les métaux, mais également sur toutes les matières premières industrielles. C'est encore la Chine qui est l'élément déterminant sur tous ces marchés.
Je pourrais aussi vous parler de matières secondaires. Le marché des vieux papiers est à cet égard passionnant à étudier car, pour une fois, c'est nous qui sommes les producteurs. Le cycle des vieux papiers est très simple : nous importons des pays émergents des produits manufacturés qui sont emballés, nous les déballons et nous avons donc des monceaux de cartons et de vieux papiers. Ces monceaux de vieux papiers sont largement supérieurs aux besoins de nos papeteries puisque, produisant moins, nous avons moins besoin d'emballer. La logique est donc de réexporter nos vieux papiers, ce qui a ce côté très pratique de donner du lest aux conteneurs vides que nous renvoyons vers l'Asie.
Or, vers la fin de 2008, la Chine est totalement sortie du marché des vieux papiers, à tel point que, comble du paradoxe, les vieux papiers en Europe et aux États-Unis ont connu des prix négatifs. Jusque-là, les supermarchés se faisaient payer pour céder leurs vieux papiers et nombre de collectivités locales avaient elles aussi pris l'habitude de faire recycler leurs vieux papiers et leurs métaux. En 2008, la situation s'est inversée : il a fallu payer pour qu'on vienne chercher nos matières secondaires.
Au niveau du marché des métaux, la même courbe se retrouve un peu partout, exception faite de l'aluminium, qui a une histoire totalement différente. Les prix de l'aluminium sont aujourd'hui tellement déprimés qu'aucun producteur ne gagne sa vie sur ce marché. Cela provient d'investissements extrêmement importants. Pour produire de l'aluminium, il faut de la bauxite, de l'alumine et de l'énergie. Or de nombreux producteurs, notamment ceux du Golfe, ont voulu valoriser leur énergie, qui ne leur coûtait quasiment rien, en développant la production d'aluminium. D'où un constat de surcapacités et une déprime totale du marché. C'est ainsi qu'une ville comme Saint-Jean-de-Morienne serait insolvable si on ne lui faisait pas cadeau de son électricité.
Le contraste est saisissant avec le marché du cuivre, sur lequel même le marchand le moins efficace continue de gagner largement sa vie. Une tonne de cuivre vaut 7 500 dollars quand le plus mauvais producteur au monde doit s'en tirer avec un prix de revient de 5 000 dollars. Pour l'aluminium, le cours se situe à 1 800 dollars la tonne, alors que le prix de revient ne peut être inférieur à 2 000 dollars la tonne.
Tous ces marchés étant instables, des bulles spéculatives sont susceptibles de se former. En effet, qui dit instabilité dit risque, qui dit risque dit anticipation, qui dit anticipation dit spéculation, au sens de speculare, c'est-à-dire regarder vers le lointain, anticiper ce que sera, demain, le rapport entre l'offre et la demande. Si tout cela est rationnel, il est des moments où même les plus tempérés des spéculateurs versent dans une certaine forme d'irrationalité, sous la forme d'une bulle.
Nous en avons un exemple avec le coton, qui, au début de 2011, a connu un niveau de prix jamais atteint en valeur réelle depuis la guerre de Sécession. Depuis, le cours s'est effondré à un dollar la livre. Les producteurs ne sont pas si mécontents sachant que le cours était à 40 cents la livre voilà une dizaine d'années. Là encore, la Chine, premier importateur mondial, joue un rôle stratégique tout à fait fondamental en s'appuyant sur d'importants stocks.
Pour le café, l'Organisation internationale du café a construit un indicateur global, résultat d'une pondération entre l'arabica et le robusta. En réalité, l'arabica a connu en 2011 une énorme tension. Cette même année, le cours était monté à 250 cents la livre, mais avec un écart de 140 cents entre l'arabica et le robusta. Aujourd'hui, la différence est tombée à 30 ou 40 cents. Si le robusta reste stable, l'arabica a connu une énorme variation liée aux aléas de la récolte au Brésil.
Le cacao connaît une relative remontée, après avoir vécu tous les aléas liés à la guerre civile en Côte d'Ivoire. Il reste des zones d'incertitudes.
Pour évoquer le sucre, je me contenterai d'une anecdote. Georges Conchon, ancien secrétaire des débats au Sénat, avait joué sur le marché du sucre les droits d'auteur qu'il avait perçus pour L'État sauvage, prix Goncourt. Il avait tout perdu ! Il en a fait un livre, qui est devenu un film.
Il est à noter que, notamment dans le domaine agricole, un prix de marché peut rester inférieur aux coûts de production, même ceux des producteurs les plus efficaces. Aujourd'hui, le Brésil est considéré comme le plus producteur le plus efficace au monde, avec un prix de revient de 15 cents la livre. Le cours mondial n'en est pas très loin, mais fut pendant longtemps largement inférieur. Cela démontre une certaine résilience quand bien même les prix sont bas. Il convient également de tenir compte de l'impact des politiques agricoles.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le graphique que je m'apprête à vous projeter est peut-être la meilleure introduction à une considération sur l'avenir. Il porte sur une matière première, ou plutôt une commodité : le fret maritime. Les taux de fret font en effet l'objet d'un marché extrêmement fluctuant. Le Baltik Dry Index, ou BDI, est un indicateur calculé tous les jours en fonction des taux d'affrètement sur les principales routes maritimes pour le « vrac sec », c'est-à-dire les minerais et les céréales notamment, transporté par de gros vraquiers. Il s'agit d'un marché totalement libre, sans spéculation financière. Il y a, d'un côté, les armateurs - grecs, scandinaves, chinois -, de l'autre, les chargeurs, c'est-à-dire les affréteurs - grandes compagnie minières, négociants en céréales, etc.
Le BDI était à 1 000 en 1985. Il a connu une période de folie totale en juin 2008, montant à près de 12 000. Autrement dit, à cette époque, un bateau de 120 000 tonnes se louait grosso modo 150 000 dollars par jour. En décembre 2008, le même ne trouvait pas preneur à 7 500 dollars par jour. La situation est restée déprimée en 2011-2012.
Tout cela tient au fait que le marché est dépendant d'un cycle de l'investissement. Quand les prix sont élevés, les commandes de bateaux se multiplient. Or la construction navale fonctionne avec un cycle de deux à trois ans. À partir de 2010-2011, ont donc été livrés les navires commandés en 2007-2008. Les taux se sont alors effondrés, la situation perdurant jusqu'à ces derniers jours. Je prends avec des pincettes la remontée que nous venons de connaître car, à l'heure actuelle, la flotte mondiale reste surcapacitaire. Songez que les taux pratiqués cet été ne suffisaient pas à payer le capitaine russe, l'équipage philippin, l'armateur maltais, le pavillon libérien, et encore moins les frais de soute pour faire fonctionner le bateau.
Finalement, que dire, que penser ?
Nous sommes dans une phase de fortes tensions sur les marchés. En tant qu'historien, je l'analyse comme s'inscrivant dans un cycle des matières premières qui fonctionne à peu près depuis la fin du XIXe siècle sur un rythme de vingt à trente ans, certes un peu perturbé par les guerres, un cycle essentiellement marqué au coin de l'investissement.
Pour résumer, au moment d'une forte tension sur les prix, tout le monde se dit qu'il faut investir, sachant que le temps de l'investissement est un temps long. S'ensuit une longue phase de déclin des prix. Les prix sont alors tellement bas que certains arrêtent de produire. Le marché se trouve rééquilibré, en attendant le prochain choc.
Quelles ont été les étapes successives depuis la fin du XIXe siècle ? Chute des prix dans les années 1900-1910 ; parenthèse de la Première Guerre mondiale ; choc en 1921, lié à la demande ; effondrement dans les années 1920-1930, bien avant, d'ailleurs, la crise de 1929 ; parenthèse de la Seconde Guerre mondiale ; choc de réapprovisionnement dans les années 1948-1953 ; tensions de la guerre de Corée ; effondrement des prix dans les années 1950-1960, avec un niveau de prix extrêmement bas à l'aube de 1970.
À l'époque, on a pu penser que le monde allait à terme manquer. Rappelons-nous le célèbre rapport Halte à la croissance ? Ce dernier concluait que, au vu des prix pratiqués, le monde ne passerait pas la fin du siècle, en raison de la pénurie de pétrole et de famines à répétition. La crise de 1974 fut, en réalité, la crise des années 1972-1980. Après un fort mouvement de réinvestissement, les prix s'effondrent dans les années 1980-1990, phénomène accru par l'implosion de l'URSS. Les cours atteignent des niveaux minimum à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Très logiquement, il y eut un nouveau choc sur les prix à partir de 2005-2006. La dernière étincelle fut la montée en puissance de la demande chinoise. Ce cycle des matières premières constitue somme toute une histoire assez différente de la crise de 2008.
Mesdames, messieurs les sénateurs, puisque votre délégation a pour préoccupation de se projeter dans le long terme, posons-nous la question : où en est-on du cycle aujourd'hui et que va-t-il se produire ? Pour y répondre, revenons-en au basique : c'est une affaire d'offre et de demande.
La demande, elle, est toujours là. Ce n'est pas parce que notre pays connaît une croissance quasi nulle que le monde n'avance pas. Selon les prévisions, que je prends néanmoins avec des pincettes, d'Olivier Blanchard, chef économiste au FMI, la croissance économique mondiale tourne autour de 3 % par an. Ce n'est pas aussi bien que les 4,5 % auxquels nous nous étions habitués au début du siècle mais, en perspective historique longue, un tel résultat est tout de même extraordinaire. Aujourd'hui, nous pouvons vraiment parler d'une « économie-monde », au sens de Braudel, qui couvre la planète entière. Or jamais le monde n'a connu durablement pareille croissance et, objectivement, il n'y a aucune raison d'imaginer que cette situation ne va pas perdurer.
Au sein du marché des matières premières, la Chine a donc une grande influence ; l'Inde aucune. Peut-être en aura-t-elle demain ; pour le moment, elle joue le rôle qui était celui de la Chine dans les années quatre-vingt : tantôt importatrice, tantôt exportatrice, mais toujours dans une proportion marginale. Si le reste de l'Asie n'est pas à négliger et se révèle globalement importateur, c'est bien la Chine qui pèse le plus lourd, en tant que premier consommateur et premier importateur mondial de pratiquement toutes les matières premières.
Le pari sur les matières premières est donc avant tout un pari sur la Chine. Pour ma part, je ne me pose pas la question de savoir si, un jour, il y aura une crise chinoise ; je me demande quand elle aura lieu. À l'évidence, la Chine connaîtra une crise. Je peux même vous dire que ce sera sur le modèle de la crise asiatique qui s'est déclenchée le 3 juillet 1997, à la suite de la dévaluation du baht thaïlandais.
Cela étant, à chaque fois que je me rends en Chine, j'ai tendance à en repousser l'échéance tellement je suis fasciné par l'exercice de fine tuning auquel se livrent les autorités chinoises. Je ne sais pas combien de temps tout cela va durer. Les déséquilibres s'accumulent et certains de mes confrères élaborent déjà des scénarios tablant sur une croissance chinoise à 5 %. À un tel niveau, la demande est toujours là mais ne pèse plus exactement du même poids.
Je vous invite à suivre plus particulièrement certains marchés de matières premières, car ils se révèlent de bons indicateurs du sentiment chinois. Le marché du minerai de fer est, de ce point de vue, emblématique. La Chine absorbe 60 % des importations mondiales. Le prix du minerai de fer était tombé à 110 dollars la tonne en mai-juin 2013, lorsque les doutes s'accumulaient sur l'économie chinoise. Il est, depuis, remonté à 130 dollars la tonne. Effectivement, au troisième trimestre, la croissance chinoise a été de 7,8 %.
Si la Chine donne l'impression de redécoller, elle représente une véritable épée de Damoclès qui menace tous les marchés de matières premières. Il est clair que ces marchés ne manqueront pas de répercuter le moindre aléa chinois, et ce de manière extrêmement violente. Voilà pour ce qui est de la demande.
Du côté de l'offre, il faut tout d'abord tenir compte de ce que j'appelle le « cycle de l'investissement » et intégrer le fait que le temps de la production des matières premières est un temps long.
Ce n'est que cette année, par exemple, que sortira le premier morceau de cuivre de la mine d'Oyu Tolgoi, en Mongolie, qui représente le plus grand projet de ce type au monde. C'est Rio Tinto qui l'a finalement développé. Voilà un projet vieux de vingt ans, puisqu'il remonte à 1994. Oyu Tolgoi ne produira probablement pas à plein régime avant 2018.
Cette année devrait aussi voir la première goutte de pétrole extraite de Kashagan, gisement situé dans la partie nord de la mer Caspienne. Les problèmes ne manquent pas. D'abord, c'est au Kazakhstan. Ensuite, le climat y est rude : froid et gel en hiver, grosse chaleur en été. Ce projet a au moins une quinzaine d'années. Lancé par ENI, à la tête d'un consortium de compagnies, il a été repris par Total, Chevron et quelques autres. Kashagan ne commencera vraiment à produire « plein pot » que dans trois ou quatre ans. Là aussi, cela aura pris quelque vingt années.
En matière agricole, c'est pareil. Nous avons tous entendu parler de multiples projets, notamment d'accaparement de terres, mais, jusqu'à présent, personne n'a vu la moindre production dans ce domaine. Chacun connaît le temps nécessaire à l'élaboration de nouvelles semences, à l'acquisition de nouvelles molécules.
Le cycle de l'investissement, j'y insiste, est un cycle long. Les matières premières en ont plus pâti à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, quand cela faisait plus chic d'aller investir dans l'économie numérique et que Serge Tchuruk ambitionnait de faire d'Alcatel une « entreprise sans usine ». Investir dans les matières premières n'était alors vraiment pas à la mode.
Au-delà du cycle de l'investissement, il y a une véritable malédiction des matières premières. Les pays producteurs de matières premières ne sont jamais des pays heureux, bien au contraire. Pour décrire ce phénomène, les économistes parlent de Dutch disease, ou « mal néerlandais », expression apparue aux Pays-Bas après la découverte de gisements de gaz naturel près de Groningue, dont l'exploitation avait, au début des années soixante, provoqué une récession dans ce pays pourtant calme et tempéré. C'est Jan Tinbergen, l'un des premiers prix Nobel d'économie, qui en avait développé le concept.
Tous les pays producteurs de pétrole, tous les pays miniers sont marqués au coin de la corruption, de l'instabilité, des guerres civiles. Il n'est qu'à voir la situation de la République démocratique du Congo (RDC), de la Libye, du Nigéria ou du Venezuela. Il faut avoir le coeur bien accroché pour y investir ! Même aux prix actuels, personne n'a envie de risquer entre 3 milliards et 4 milliards de dollars - soit, à peu près, le niveau du ticket d'entrée - pour développer un complexe minier en RDC, pourtant riche en cuivre. La Russie en est aussi une cruelle illustration. A contrario, la Norvège, avec le pétrole, le Chili, avec le cuivre, sont quasiment les deux seuls exemples de pays ayant bien géré leurs ressources en matières premières.
Pour l'instant, donc, le cycle de l'investissement a pris un retard considérable. C'est vrai qu'il faut aller plus loin, plus profond et dans des pays plus risqués.
À observer les équilibres de marchés, un constat s'impose à nous : pour la plupart des produits, à quelques exceptions près comme l'aluminium ou le fret maritime, les marchés sont toujours pratiquement sur le fil du rasoir, à la merci d'éléments susceptibles de les perturber à court terme, tels le climat, qui joue un rôle très important et pas seulement pour les produits agricoles, ou, bien entendu, les aléas politiques.
Mon diagnostic est le suivant : la phase haute du cycle, dans laquelle nous nous trouvons, devrait, en toute logique, perdurer encore quelques années.
Il est tout à fait possible qu'il y ait, ensuite, cette phase de baisse tendancielle qui s'est toujours produite. Il faut bien se le dire, des prix élevés constituent une forte incitation à développer non seulement la production, mais aussi l'inventivité. C'est le point suivant que j'évoquerai, à savoir les « révolutions » industrielles.
Nous ignorons ce que seront les technologies de demain. Ainsi, personne n'avait entendu parler avant 2006 des gaz et pétrole de schiste, dont l'exploitation est désormais une réalité aux États-Unis. En matière de prospective, une chose est sûre : c'est dans le domaine alimentaire que les tensions promettent d'être les plus fortes.
Dans l'un de mes ouvrages, Le siècle de Jules : le XXIe siècle raconté à mon petit-fils, j'écrivais ceci : la seule chose dont je sois certain, c'est que, quand il aura mon âge, Jules aura toujours besoin de consommer, dans le cadre d'une alimentation la plus équilibrée possible, entre 2 500 et 3 000 calories par jour, avec une centaine de grammes de protéines, dont la moitié d'origine animale. Mais j'ignore à quelle énergie il aura recours ou les métaux dont il aura besoin pour vivre.
Le lithium, utilisé pour les batteries de nos véhicules électriques, a actuellement le vent en poupe ; mais qu'en sera-t-il dans vingt ans ? Les terres rares faisaient la une des journaux il y a encore deux ou trois ans : après avoir connu une flambée, leurs prix se sont effondrés car on a trouvé d'autres ressources à utiliser.
Certes, nous aurons toujours besoin de matières premières. Nous ne savons pas exactement lesquelles, sachant que nous faisons d'énormes progrès dans la récupération, le recyclage. L'objectif ultime, que nous n'atteindrons jamais, étant de parvenir à boucler le cycle de la matière.
Dernier élément venant conforter le scénario à moyen terme de prix qui restent tendus : le dollar et la spéculation.
Ne l'oublions pas, les marchés sont, par nature, totalement instables et ne l'ont jamais autant été. Ils se trouvent être cotés dans une monnaie, le dollar, elle-même totalement instable, et ce dans un monde de spéculation.
Si les prix devraient, en toute logique, rester tendus dans les années à venir, des bulles pourraient apparaître. De mauvaises récoltes l'année prochaine seraient susceptibles de créer un nouveau choc sur les marchés agricoles. Nous vivons avec une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, dont le fil s'effrite un petit peu chaque année : je veux parler de la Chine. Peut-être une crise chinoise pourrait-elle marquer assez durablement un retournement des marchés.

Je vous remercie, monsieur Chalmin, de nous avoir présenté ce vaste panorama.

La mise en exploitation de réacteurs de type EPR va permettre d'économiser énormément de minerai de base. J'ai lu dans la presse que les Anglais, qui ont du gaz de schiste, sont en train d'acquérir les deux premiers EPR d'Europe. Pensez-vous que cela puisse avoir une incidence sur les matières premières de l'énergie ? Autrement dit, le nucléaire n'est-il pas appelé à connaître une deuxième vie ?
Objectivement, je ne le pense pas. Malgré tout, Fukushima a montré que le nucléaire ne pouvait pas être mis entre toutes les mains. Je ne parle pas simplement d'un point de vue militaire. Le nucléaire exige un environnement sécuritaire et scientifique de très haut niveau. Souvenez-vous de Kadhafi venu rendre visite à Paris à l'ancien Président de la République, lequel, à l'époque, avait l'idée de lui vendre un réacteur nucléaire. Et que dire des réacteurs, dont la fiabilité est médiocre, que la Corée du Sud a « refilés » aux Émirats arabes unis.
Le nucléaire ne disparaîtra pas, mais il n'est pas opportun d'en attendre un développement considérable. À la limite, l'EPR pourrait enrayer son déclin, à condition que les problèmes techniques soient réglés. Là encore, nous sommes dans le fantasme politique.
J'ai eu l'occasion de dire à quel point le débat qui a eu lieu au sujet de la transition énergétique était surréaliste, puisqu'il excluait tant le nucléaire, l'énergie normalement la plus propre qui soit, que les gaz de schiste.
Or, je vous le rappelle, le charbon pollue et émet du carbone à un niveau de 4, le pétrole à un niveau de 2, le gaz naturel à un niveau de 1. À mon sens, le gaz naturel peut être le chaînon manquant, sachant que nous rêvons tous d'un temps où nous aurons mis un terme aux énergies fossiles, d'un monde heureux fonctionnant avec des énergies renouvelables. Aujourd'hui, le renouvelable ne tient pas la route, ni économiquement ni même technologiquement. Il faut être clair à ce sujet. Ce débat français a un côté totalement surréaliste.
Dans la mesure où le nucléaire dépend de l'uranium, je ferai observer que l'uranium ne pose vraiment pas de problèmes. D'autant que, plus le nucléaire se développe, plus on tend vers le rêve de l'alchimiste, c'est-à-dire le renouvellement permanent.
Je ne connais pas suffisamment les centrales de quatrième ou cinquième génération pour en parler. Convenons, au demeurant, que le temps du nucléaire est un temps extraordinairement long.

Monsieur Chalmin, vous avez conclu en disant à peu près ceci : d'une certaine manière, la seule chose que l'on sait, c'est que l'on ne sait jamais, car il y a toujours des doutes. L'histoire récente le montre bien, personne, y compris les meilleurs prévisionnistes, n'avait imaginé la crise que nous traversons, qui est en fait une mutation profonde. Voilà qui est tout de même surprenant.
Monsieur le sénateur, avec un manque de modestie total, permettez-moi de vous recommander un petit ouvrage que j'ai écrit Crises : 1929, 1974, 2008. Histoire et espérances. Je m'y livre à un certain nombre de comparaisons et de citations.
En 1929, quinze jours avant le Jeudi noir, Irving Fischer écrivait ainsi que les marchés boursiers avaient atteint un haut plateau au-dessous duquel ils ne descendraient jamais. En 1974, Samuelson, prix Nobel, affirmait que nous étions capables de prévoir, d'anticiper et de guérir les crises économiques. Pour 2008, j'aurais également quelques perles à vous livrer, mais leurs auteurs étant des économistes français encore vivants, je préfère m'abstenir ! Je me contenterai de rappeler cette très jolie remarque de Standard & Poor's en 2006 : « L'industrie bancaire mondiale est dans un état de prospérité inégalée et qui est destinée à durer. » Croyez-moi, j'ai tout un bêtisier de ce genre !

Pour autant, Amartya Sen, prix Nobel d'économie, indiquait avant la crise de 2008 que l'économie mondiale, notamment son volet financier, ne pouvait pas continuer ainsi, avec des taux d'intérêt à deux chiffres exigés au profit des fonds de pensions alors que la croissance mondiale oscillait entre 4 % et 6 %. Il y a toujours eu des économistes ou des prévisionnistes pour alerter l'opinion et les responsables politiques ou économiques. Convenez avec moi qu'ils ont été peu écoutés.

La crise des subprimes est survenue sans qu'il y ait eu beaucoup d'alertes.
Nous aurions pu avoir la même discussion voilà trente ou quarante ans, mais avec une différence de taille : le monde ne se limite plus à l'Occident. Avant, il n'y avait que nous et nous ne nous préoccupions pas des autres. Dorénavant, vous l'avez dit, il y a la Chine. Il faut également tenir compte de l'évolution très importante du Brésil et, au-delà, de l'ensemble de l'Amérique latine, ainsi que de l'Afrique, même avec ses fortes incertitudes démocratiques.
À mes yeux, le fait majeur des vingt dernières années, c'est aussi l'évolution considérable qui s'est produite au niveau géopolitique. Il est possible d'imaginer que cela puisse encore bouger très rapidement. Personne n'avait prévu le Printemps arabe. Au Qatar, en Arabie saoudite, pour ne citer qu'eux, il y a bien un jour où les hommes et les femmes exerceront leur droit de révolte.
Finalement, il est plus facile et rassurant sur le plan économique et financier, aux yeux de l'Occident et de l'ensemble de l'économie mondiale, que les régimes en place dans de tels pays se maintiennent au pouvoir. Mais il y a bien un moment, même s'il est difficile de prévoir dans quel contexte cela aura lieu, où la situation évoluera.
À l'heure où la spéculation continue malgré tout de se développer, un élément s'impose à notre réflexion : le monde doit probablement s'organiser beaucoup plus qu'il ne le fait aujourd'hui, au niveau tant de l'Organisation mondiale du commerce, du Fonds monétaire international, de l'Organisation des Nations unies, avec les limites qu'on lui connaît, que des démocraties. Sinon, rien ne se régule, tout est possible, et c'est la pire des choses.
Aujourd'hui, la grande ambition des démocraties doit être de promouvoir une meilleure organisation de notre économie mondiale, qui puisse s'asseoir sur des réflexes et une approche démocratiques qui ne sont pas toujours évidents.
À défaut d'agir en ce sens, tous ces hommes et, surtout, toutes ces femmes qui souffrent d'une absence de démocratie pourraient bien donner un coup de pied aux fesses de ceux qui n'auraient pas pensé suffisamment tôt à s'organiser.
Je partage totalement votre point de vue sur les pays que vous avez cités. Le Qatar et l'Arabie saoudite illustrent cette malédiction des matières premières que j'évoquais. Simplement, ces pays sont tellement petits et disposent de tellement d'argent à dépenser qu'ils représentent des modèles, dangereux certes, mais impossibles à reproduire.
J'ai conclu ma présentation en soulignant que jamais le monde n'avait été aussi instable. J'aurais pu ajouter : jamais il n'y a eu aussi peu de pilotes dans l'avion. Et ce n'est pas la faute des marchés.
Qu'il me soit permis de rappeler que la dimension spéculative des marchés traduit simplement une fonction d'anticipation. Au travers de la fixation du prix d'une denrée, il projette ce qu'il en sera, demain ou après-demain, du rapport entre l'offre et la demande.
Nous avons tous en tête les images de 2008, au moment de la flambée des prix alimentaires, de ces « émeutes de la faim » : c'étaient des émeutes de la pauvreté et de la mal-gouvernance, pas des émeutes de la faim. Les produits ne sont jamais venus à manquer. Ont alors été immédiatement incriminés les « horribles spéculateurs ». Mais les marchés étaient dans leur fonction d'alerte. Que disent-ils encore aujourd'hui ? Pour nourrir correctement 10 milliards d'hommes en 2050, il va falloir doubler la production agricole de la planète ; il est donc temps d'investir et d'encourager la production pour augmenter les rendements, plutôt que d'inciter les agriculteurs à faire du bio.
Pour la prise de conscience du problème alimentaire mondial, les marchés, par le biais des trois crises des cinq dernières années, ont fait beaucoup plus que le silence coupable qui a été le nôtre par le passé, notamment dans les années quatre-vingt-dix.
Il y avait autant de gens qui mourraient de faim ; simplement, ce n'étaient pas les mêmes. Quand les prix sont bas, ce sont les agriculteurs qui crèvent de faim, et aucune caméra n'est là pour les filmer. Quand les prix sont élevés, il y a, dans les villes du tiers-monde, des « émeutes de la faim » et beaucoup de caméras.
Au fond, la fonction des marchés, c'est d'alerter.
Quand le prix du pétrole atteint plus de 100 dollars le baril, voici ce qu'il faut comprendre : le pétrole, c'est rare, c'est sale et cela vient de lieux instables, donc il faut en payer le prix. À la limite, c'est le meilleur cadeau que nous puissions faire aux générations à venir.
Je n'ai jamais réussi à convaincre un ministre de l'agriculture, que ce soit Bruno Le Maire ou Stéphane Le Foll, de l'utilité de la spéculation. Je me suis rendu compte qu'ils traduisaient le mot anglais regulation, qui veut dire « réglementation », par « régulation », c'est-à-dire intervention et stabilisation.
À titre personnel, j'ai pris une grande part à la négociation d'accords internationaux, notamment sur les marchés du sucre, du café, du cacao. Cela n'a jamais marché. Je suis d'accord avec vous, le monde a besoin de gouvernance. Mais aucune stabilisation des prix des matières premières ne sera possible sans la mise en place d'un nouveau système monétaire international avec des taux de change stables. Cela devrait être facile à obtenir compte tenu du cartel de banques centrales existant. Nous n'y sommes pas encore parvenus.
La mère de toutes les instabilités, c'est l'instabilité monétaire. Ce n'est pas le rôle de l'OMC, ni celui de la FAO. Il faudrait, au minimum, pouvoir demander une certaine forme de réglementation sur les marchés dérivés. Mais pareil souhait se heurte à la réalité internationale, à tous ces opérateurs installés dans des paradis fiscaux.
Je suis désolé de le dire, nous sommes dans des situations totalement ingérables. Jamais le monde n'a été aussi instable mais, quelque part, il gère cet état de fait. Il y a dans cette instabilité une certaine forme de dynamique. Oui, monsieur le sénateur, vous avez totalement raison : jamais le monde n'a été aussi peu gouverné. Malheureusement, je ne sais pas du tout comment tout cela peut évoluer. Ce qui est clair, c'est que l'instabilité majeure est celle des devises. Tant que les marchés des devises n'auront pas été stabilisés, tant qu'un nouveau Bretton Woods n'aura pas été mis en place, assis sur un trépied dollar-euro-yuan, nous ne pourrons pas avoir quelque stabilité de longue période sur les prix des matières premières que ce soit.

Je ne partage pas votre analyse, excepté votre conclusion sur le fait que c'est effectivement sur le plan monétaire que se trouve le noeud du problème. Tout est parti, me semble-t-il, de la mise en cause des accords de Bretton Woods, quand le dollar n'a plus été indexé sur l'or.
Comment pouvez-vous considérer que les marchés ont raison de spéculer au prétexte que cela permettrait d'arriver à une forme d'équilibre ? Pour moi, c'est le contraire qui se produit.
Je comprends que mes propos puissent vous choquer.

Ce n'est pas la question. Je ne suis tout simplement pas d'accord avec votre analyse.
Contrairement à ce qui est dit, la spéculation financière ne modifie en aucune manière les évolutions des prix à moyen et long termes. De multiples comparaisons ont été faites entre les différents types de marchés, dérivés, donc financiers, d'un côté, purement physiques, de l'autre. Qu'il s'agisse du minerai de fer, du cuivre, du blé ou du riz, la volatilité sur de tels marchés est souvent plus importante que celle sur les marchés financiers, justement parce qu'il n'y a pas cette même capacité d'anticipation que sur les marchés de spéculation financière.
Je sais que cela choque. D'ailleurs, vous avez voté dans la dernière loi bancaire l'interdiction de jouer sur les marchés agricoles. Permettez-moi de vous le dire, c'est, pour moi, de la sensiblerie mal placée. Paradoxalement, plus il y a de spéculation, plus efficient est le marché : le terreau de liquidités étant beaucoup plus large, personne ne peut l'influencer.
Je me souviens de Michel Rocard disant, au printemps 2008, au moment de la flambée des prix : « C'est très simple, il faut fermer les marchés. » Vous pouvez casser le thermomètre ; il fera toujours aussi chaud, ou aussi froid.

Là n'est pas la question. Personne ne vous dit qu'il faut fermer les marchés. Le temps manque aujourd'hui pour un vrai débat, je trouve cela dommage. Je suis obligé de vous quitter. Je m'en vais avec ma « sensiblerie mal placée » assister au débat sur le logement.

Monsieur Chalmin, je partage votre point de vue sur la nécessité d'une stabilisation des marchés. Loin du sens commun que les gens lui donnent, la spéculation a en effet un caractère stabilisateur.
Il y a bien longtemps, à la fois en France, avec l'Onic, l'Office national interprofessionnel des céréales, et un certain nombre d'autres organismes, et surtout dans les pays africains producteurs, ont été mises en place des caisses nationales de stabilisation. Pour le cacao ou le café, par exemple, c'est-à-dire des matières premières qui ne se détériorent pas à très court terme, ces caisses achetaient des stocks, les conservaient et, selon l'évolution du marché, les mettaient en vente ou laissaient aller les productions.
Sur le papier, un tel système « tampon » était prometteur. Mais il a échoué, les dernières caisses de stabilisation ayant dû disparaître il y a une dizaine d'années. La raison en est toute simple : les hommes sont les hommes ; ceux qui étaient aux responsabilités n'ont pas forcément eu une bonne appréhension de l'efficacité du marché et leurs interventions ne se sont pas toujours faites sous le sceau de l'honnêteté.
Pierre Moussa fut l'inventeur des caisses de stabilisation africaines. À la limite, je serais partisan du retour de systèmes de ce type comme je suis partisan, en Afrique, d'un retour à des mécanismes fondés sur le modèle de la politique agricole commune.
La politique agricole commune fut financée dans les années soixante par le biais de prix élevés imposés aux consommateurs. Nous étions alors au coeur des Trente glorieuses. Aujourd'hui, les consommateurs dans les pays africains ne sont pas solvables. Dès lors que le producteur se voit garantir un prix rémunérateur, il faut qu'un tiers assure la compensation afin d'éviter des prix trop élevés dans les villes. Sinon, c'est la révolution qui menace. Cela étant, il faut reconnaître qu'une telle solution n'est pas du tout à la mode.
J'ai dû paraître à votre collègue Yannick Vaugrenard un horrible libéral et un être totalement sans coeur. Mais croyez bien que, quand je cherche à vendre mes idées sur la politique agricole dans les pays africains, je suis considéré comme le plus ringard des Français, à un point tel que vous ne pouvez pas l'imaginer. On est toujours à la droite ou à la gauche de quelqu'un. En ce qui me concerne, je fais le grand écart !
Le développement agricole de l'Afrique est le problème majeur du XXIe siècle. Pour le résoudre, il faudra selon moi passer par le maintien de la petite agriculture familiale, et donc par la garantie des prix et des débouchés. C'est ce qui a été admirablement réussi à l'époque de l'Onic et de la politique agricole commune des années soixante et qui a débouché sur ce que Debatisse a appelé la « révolution silencieuse ».
Cela étant, le credo néolibéral reste très largement dominant à Washington, à la Banque mondiale ou même à la FAO.

Ma deuxième observation portera sur la malédiction des matières premières, phénomène que j'ai moi-même observé un peu partout, notamment en Afrique.
Le Congo est en train de se décomposer dans des conditions absolument dramatiques. Son malheur est d'être une anomalie géologique ; on y trouve de tout : cuivre, cobalt, etc. Résultat : le pays connaît une lutte de pouvoir importante, qui se traduit par des guerres intestines, civiles, et des intrusions extérieures.
La Guinée est un autre exemple. Elle renferme une véritable montagne de fer.

Cela se sait depuis longtemps, et chacun a en tête les coups durs que la Guinée a connus.
La Sierra Leone et le Libéria sont frappés par les guerres du diamant. La pire des matières premières pour l'entente entre les peuples, c'est le diamant : trouver quelques pépites ou quelques pierres précieuses est tout de même plus intéressant à la vente que deux kilos de fer !
Il existe cependant quelques exceptions à cette malédiction des producteurs de matières premières. Ainsi, la Zambie, que je connais bien pour être président du groupe interparlementaire d'amitié France-Afrique australe, reste un pays sérieux tout en étant un gros producteur de cuivre.
Dans les pays « à risque », il n'y a guère plus que les Chinois et les Indiens qui investissent. La Zambie en fait partie. Rappelons que la Copperbelt est le coeur de la pandémie du sida. Les anglo-américains ont pratiquement quitté la Zambie « à la cloche de bois », au point que la Banque mondiale les a obligés à payer une sorte de dédit à l'époque.

Sur le marché du blé, l'offre n'est-elle pas relativement contrainte, au vu de la faible quantité de terres à blé dans le monde ? N'y a-t-il pas là une perspective de tension à la hausse relativement durable sur les prix ? D'autant que la Chine et de nombreux pays du tiers monde achètent du blé désormais. Les émeutes de la faim ont principalement eu lieu au Maghreb, dans des pays dépendants de la consommation de blé tendre ou de blé dur.
Il ne faut pas généraliser le cas de cette année. La Chine va probablement être l'un des premiers, si ce n'est le premier, importateurs mondiaux de blé. Aujourd'hui, les importations de blé chinoises varient dans une fourchette allant de six millions à dix millions de tonnes, sachant que le marché mondial se situe entre cent millions et cent dix millions de tonnes. C'est considérable, d'autant que nous ne disposons d'aucun élément sur une telle variation : cette année, non seulement la récolte de blé chinoise est mauvaise, mais surtout, 15 % à 20 % se trouvent impropres à la consommation. Pareille situation ne devrait pas se renouveler l'année prochaine. La Chine devrait beaucoup plus monter en puissance comme importateur de maïs.
À la limite, c'est le maïs qui apparaît comme la céréale la plus importante. Il est à espérer une légère détente sur ce marché, étant donné que les États-Unis pourraient, à mon sens, ramener le programme de transformation de maïs en éthanol à des niveaux plus raisonnables.
Le blé a une dimension géopolitique majeure. Parmi les grands importateurs mondiaux, on trouve quelques pays tout à fait « normaux », à l'instar du Japon et de la Corée, ainsi que tout l'arc allant du Maroc à l'Iran. L'Iran fait aujourd'hui avec le Pakistan des opérations de troc « pétrole contre blé », à cette réserve près que la qualité du blé pakistanais ne satisfait pas les Iraniens.
Les pays de la mer Noire - Ukraine, Russie, Kazakhstan - ont, en la matière, un énorme potentiel.
Absolument. Un aléa existe : ce sont des territoires très élevés en altitude. Les Russes ont trois semaines de retard dans leurs semis de blé, en raison de pluies abondantes. Or l'hiver arrive. Les premiers grands froids représentent toujours un moment très important dans l'année. Si la vague de grand froid arrive après la neige, le matelas neigeux est suffisant et les graines ne gèlent pas, même à - 10°C. Dans le cas contraire, quand la neige ne joue pas son rôle protecteur, le sol gèle, il n'y a plus rien et il faut ressemer ce que l'on appelle les blés de printemps, avec des rendements beaucoup plus faibles.
Nous parlons là de zones, à l'instar du tchernoziom, ou « terres noires », d'Ukraine, qui ont des potentiels extraordinaires. L'Ukraine devrait être cette année le deuxième exportateur mondial de blé. Voilà une heureuse nouvelle car, à l'autre bout de la Terre, les vagues de chaleur vont avoir raison des récoltes en Australie. À terme, la production y est menacée. Si vous voulez vous faire une idée de la réalité du réchauffement climatique, allez en Australie : avec une sécheresse tous les ans, ce n'est plus un accident, c'est une mutation climatique structurelle. Je ne m'y connais pas assez sur le sujet pour me lancer dans le débat mais je peux affirmer qu'un producteur très fiable comme l'était l'Australie risque véritablement de disparaître peu à peu.
Je suis relativement optimiste sur le blé. Le développement du marché à terme de Paris est une très belle réussite. La cotation du blé « FOB Rouen » est devenue la deuxième cotation mondiale de référence, après Chicago. Point très important à retenir : les blés de la mer Noire se cotent par référence à Rouen aujourd'hui, plus qu'à Chicago ou au Golfe.

Merci, monsieur Chalmin, nous avons eu beaucoup de plaisir à vous écouter.

Mes chers collègues, le président Bel a souhaité que la réflexion engagée avec l'audition du Commissaire général à la stratégie et à la prospective, Jean Pisani-Ferry, sur Quelle France dans dix ans ? se poursuive dans le cadre de deux groupes de travail pour lesquels vos candidatures ont été sollicitées. Je vous indique que ces ateliers se réuniront une première fois le mercredi 30 octobre prochain, l'un après l'autre. Y seront désignés deux co-rapporteurs. Les travaux de ces deux ateliers seront rendus publics le 4 décembre prochain.
Ce rappel étant fait, Alain Fouché va maintenant nous présenter l'étude de faisabilité qu'il a préparée en prévision de l'établissement de son rapport d'information sur l'emploi.

Monsieur le président, mes chers collègues, lors de sa réunion du 8 novembre 2012, la délégation a retenu, au titre de son programme de travail pour l'année 2013, l'établissement d'un rapport consacré aux emplois de demain et aux formations à mettre en oeuvre pour s'y préparer. Elle a bien voulu m'en confier la responsabilité.
Bien sûr, mon ambition n'est pas d'espérer apporter des solutions immédiates aux difficultés liées aux taux d'inactivité, et croyez bien que je le regrette ! Mais dans le contexte économique actuel, marqué par une montée importante du chômage, notamment celui des jeunes, il m'est apparu paru utile de réfléchir aux évolutions prévisibles du marché de l'emploi.
Quels sont les secteurs dont on peut prévoir qu'ils seront plus tard recruteurs ? Quelles sont les formations qu'il faudrait prochainement mettre en place - en commençant par former les futurs formateurs -, tant au stade de l'éducation de base qu'au niveau de la formation tout au long de la vie ?
Pour m'assurer de la pertinence et de l'intérêt de ce projet, j'ai déjà conduit une vingtaine d'auditions entre mars et octobre 2013.
Il ressort de ces premières rencontres un certain nombre de constatations, que je vous livre en vrac car elles m'ont troublé.
Premièrement, les données statistiques ne sont pas toutes concordantes, ni tenues très à jour.
Deuxièmement, la multiplicité extrême et le cloisonnement des organismes chargés de la formation ou du placement des personnes à la recherche d'un emploi brouillent le message et accroissent l'opacité de la situation.
Troisièmement, les secteurs probablement recruteurs à terme sont déjà plus ou moins connus, mais seulement si l'on se place dans une optique de prolongement ou de répétition des tendances actuelles ; on imagine rarement les évolutions qui résulteront, par exemple, des progrès technologiques.
Quatrièmement, les compétences à acquérir tendent à devenir transversales ; on peut penser à l'informatique, bien sûr, mais aussi aux savoirs liés à l'environnement.
Cinquièmement, les méthodes d'enseignement, notamment dans l'enseignement supérieur, sont en profonde mutation.
Sixièmement, les parcours professionnels seront à l'avenir plus discontinus qu'actuellement et mieux individualisés, pour tenir davantage compte des aspirations personnelles.
Septièmement, enfin, les conditions d'exercice des métiers seront profondément modifiées, qu'il s'agisse de la localisation de l'emploi, de l'organisation du temps de travail, ou encore des rapprochements intersectoriels.
Telles sont mes premières observations. Afin de poursuivre et d'approfondir notre réflexion, d'autres auditions restent à mener, soit par moi-même, soit en réunion de délégation.
Enfin, j'envisage d'effectuer quelques déplacements. Je me rendrai à Bruxelles, pour y rencontrer la DG Éducation et culture, le Cedefop (Centre européen pour le développement de la formation professionnelle), les responsables du programme Ecvet (validation des qualifications en Europe). Je compte également aller dans la Vienne, que je connais bien, pour y auditionner le site du Futuroscope, le Cned, l'antenne régionale de Pôle Emploi, ainsi que le CNDP (Centre national de documentation pédagogique). Par ailleurs, je souhaite me rendre sur le terrain en province, pour visiter un OPMQ (Observatoire prospectif des métiers et des qualifications), et en Allemagne, pour rencontrer les responsables d'un centre d'apprentissage.
Je pense pouvoir vous présenter ce rapport d'ici à la fin de l'année 2013, après la tenue rituelle d'un atelier de prospective réunissant divers intervenants du secteur de l'emploi.
Conformément au devis qui sera soumis à l'approbation du conseil de Questure, si vous m'en donnez l'autorisation, les dépenses à engager pour réaliser ce travail devraient s'élever à 17 004 euros.

Je vous remercie, mon cher collègue, de cette présentation synthétique. Personne ne demandant la parole, je soumets l'étude de faisabilité au vote.
La délégation approuve l'étude de faisabilité.