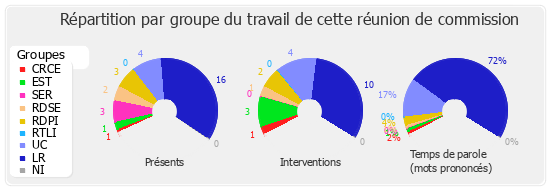Commission des affaires économiques
Réunion du 18 novembre 2015 à 9h30
Sommaire
La réunion
La réunion est ouverte à 9 heures 30.

Mes chers collègues, l'ordre du jour de notre réunion appelle l'examen des crédits de la mission « Économie ». Je cède la parole à nos trois rapporteurs pour avis et, en premier lieu, à notre collègue Élisabeth Lamure.

Monsieur le Président, mes chers collègues, la mission « Économie » est l'une des deux principales missions budgétaires de soutien à l'activité des entreprises. Sa maquette budgétaire est stabilisée, seuls des changements de périmètre d'ampleur très limitée l'affectant : le principal est la création d'une action nouvelle, l'action n° 22 « Économie sociale et solidaire », qui recueille les crédits précédemment inscrits au programme 304 « Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire », dont les crédits s'élèvent à 4,2 millions d'euros, ce qui représente une baisse de 7,5 % par rapport à 2015.
De façon globale, les crédits de la mission connaissent à nouveau une baisse sensible, à périmètre constant, par rapport à 2015 : ils s'élèvent à 1,46 milliard d'euros en crédits de paiement contre 1,55 milliard d'euros en 2015, soit une baisse de 5,6 %. En autorisations d'engagement, la baisse est considérable puisque le projet de loi de finances est en recul de 43,5 % par rapport à 2015, mais elle s'explique par la forte réduction du programme 343, dont le montant s'élève seulement à 188 millions d'euros, destinés uniquement à apporter au guichet « Réseaux d'initiative publique » des ressources complémentaires à celles puisées au sein du fonds national pour la société numérique. Ainsi, au cours des trois dernières années, la baisse cumulée des crédits de la mission, à périmètre constant, atteint environ 13 %.
Le programme 134 « Développement des entreprises et du tourisme » totalise, pour 2016, 851,71 millions d'euros en autorisations d'engagement et 838,35 millions d'euros en crédits de paiement. À structure constante, l'évolution du programme est marquée par une baisse de 5 % en crédits de paiement et de 1,75 % en autorisations d'engagement. Mais il faut souligner que les seules dépenses d'intervention du programme connaissent une baisse de 9,5 % en autorisations d'engagement et 13,9 % en crédits de paiement par rapport à 2015. Plutôt que de faire porter l'effort sur les dépenses de personnel ou de fonctionnement, le choix du Gouvernement est donc de réduire la capacité d'intervention et de financement des entreprises, à un moment où, compte tenu de la crise, elles en ont sans doute le plus besoin.
Les actions comportant les plus fortes dépenses d'intervention connaissent des évolutions diverses. Je me contenterai d'évoquer certaines d'entre elles seulement.
Par rapport à la précédente loi de finances initiale, les dotations de l'action 2 « Développement du commerce et de l'artisanat » diminuent de 21 % en crédits de paiement et de 18 % en autorisations d'engagement, pour s'établir respectivement à 29,8 millions et 34,8 millions d'euros. Cette baisse s'explique en grande partie par la réduction des crédits du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (Fisac). Je reviendrai dans un instant sur ce choix discutable.
Les crédits affectés aux services à la personne ainsi qu'à l'aide au départ baissent également fortement, de l'ordre de 20 %. Dans ce dernier cas, cette baisse s'explique par la mise en extinction de cette aide au 1er janvier 2015, les crédits prévus au présent projet de loi n'ayant vocation qu'à assurer le financement des demandes d'aides reçues avant cette date.
Enfin, les crédits destinés à l'EPARECA connaissent une baisse plus limitée (-6 %), et s'élèvent à 6,27 millions d'euros.
L'action n° 7 « Développement international des entreprises et attractivité du territoire » voit ses crédits se fixer à 103,8 millions d'euros, en autorisations d'engagement comme en crédits de paiement, soit une baisse de 4,5 %. Si cette baisse de crédits reste moindre que la baisse moyenne des crédits du programme, elle est néanmoins regrettable alors que le développement de l'internationalisation de nos entreprises, en particulier les PME, doit être une priorité.
L'action n° 20 « Financement des entreprises », qui vise à fournir un appui au développement des PME et des ETI à travers l'action de Bpifrance, voit son montant stabilisé à 26,4 millions d'euros en crédits de paiement comme en autorisations d'engagement. Cette année, un fléchage particulier vers les entreprises ultramarines est prévu, afin d'affecter une partie des crédits au profit du développement des entreprises ultramarines, dès lors que le fonds de garantie spécifique qui avait été mis en place au profit des départements et régions d'outre-mer est mis en gestion extinctive.
La contribution des autres actions - qui financent pour l'essentiel les organismes de régulation ou d'inspection - à l'effort de réduction des dépenses publiques est en revanche beaucoup plus mesurée. Il faut néanmoins souligner le cas particulier de l'action n° 15 « Mise en oeuvre du droit de la concurrence », qui correspond au budget de l'Autorité de la concurrence, et qui voit ses crédits augmenter de 61 % en autorisations d'engagement et de 10 % en crédits de paiement, afin de lui donner les moyens nécessaires pour développer sa fonction au regard de l'implantation et de la tarification de certaines professions juridiques réglementées.
Le programme 220 « Statistiques et études », qui assure le financement exclusif de l'INSEE, est doté de 437 millions d'euros en autorisations d'engagement et 436 millions d'euros en crédits de paiement, traduisant respectivement une baisse de 2,8 % et 2,5 % par rapport à 2015.
Le programme 305 « Stratégie économique et fiscale » est doté de 426 millions d'euros en autorisations d'engagement comme en crédit de paiement, ce qui représente une baisse de 7,7 % par rapport à l'an dernier. Comme l'an passé, l'essentiel de cette baisse est imputable à la diminution de la subvention versée à la Banque de France au titre de sa mission de secrétariat des commissions de surendettement.
Les crédits de la mission ont un peu évolué au cours de la discussion à l'Assemblée nationale. Au cours de sa séance du 5 novembre 2015 :
- d'une part, elle a décidé, contre l'avis du Gouvernement, d'abonder de 12,5 millions d'euros les crédits du programme 134, afin de permettre au Fisac d'assurer le financement du stock de dossiers de subventions accordées par le comité professionnel pour la distribution de carburant (CPDC). C'est néanmoins une opération qui s'avérait neutre pour le Fisac lui-même car le Gouvernement a pris l'engagement de faire financer le stock des 4 000 dossiers de subvention des stations-services en souffrance par une enveloppe de 12,5 millions d'euros prélevée sur le fonds d'aide à l'investissement local, prévu par l'article 59 du projet de loi de finances ;
- d'autre part, elle a adopté un amendement du Gouvernement tendant à abonder de 3,58 millions d'euros les crédits du programme 134 afin de contribuer au financement de la nouvelle Agence France Entrepreneur. Mais, en réalité, il ne s'agit que d'un regroupement de crédits avec des prélèvements concomitants sur d'autres missions budgétaires.
Même si ces amendements permettaient d'assurer une meilleure lisibilité de l'effort budgétaire en faveur des entreprises, ils ne traduisaient pour autant aucune amélioration réelle des crédits par rapport à ceux envisagés par le Gouvernement. Quoi qu'il en soit, en seconde délibération, le Gouvernement a néanmoins fait adopter un amendement qui a notamment ramené à 3,12 millions d'euros l'abondement supplémentaire du Fisac et, dans le même temps, réduit de 1,76 millions de plus, en autorisations d'engagement comme en crédits de paiement, les crédits de la mission « Économie ».
Un mot, en second lieu, sur les dépenses fiscales associées : en volume, et comme les années précédentes, le principal levier d'aide aux entreprises au sein de la mission reste de nature fiscale, et non budgétaire. Le montant cumulé des dépenses fiscales associées à la mission est en effet évalué à 20,5 milliards d'euros.
À cet égard, il faut souligner la mise en oeuvre du dispositif de suramortissement en faveur des investissements industriels, prévu par la loi Macron. Profitant aux investissements intervenus entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016, ce mécanisme contribuera à un accroissement de la dépense fiscale associée à la mission d'environ 350 millions d'euros pour 2015 et 500 millions d'euros pour 2016. Il conviendra de s'interroger sur son éventuelle prolongation si son effet d'entraînement est avéré.
Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) représente à lui seul 13 milliards d'euros. Il est établi que l'activité de préfinancement du CICE par Bpifrance a, depuis 2013, pu apporter un « bol d'oxygène » à des entreprises qui se trouvaient dans une situation de trésorerie critique. Cependant, à ce jour, il est encore difficile de tirer un bilan réel de l'efficacité du CICE au-delà du mécanisme de préfinancement.
Certes, dans une très récente étude, l'INSEE a pu considérer, dans une comparaison avec le coût du travail en Allemagne, que, depuis 2012, en France, le coût horaire a augmenté de façon plus modérée sous l'effet du CICE ; mais cette appréciation favorable contraste avec celle, beaucoup plus mesurée, portée par le comité de suivi du CICE, évoquée par M. Jean Pisani-Ferry, lors de son audition par notre commission le 4 novembre dernier. Il y a donc lieu d'attendre une analyse plus fine du dispositif afin de pouvoir porter un jugement définitif sur les effets réels de cette mesure sur la compétitivité de nos entreprises et l'emploi.
Il est important que, malgré des contraintes budgétaires que l'on ne saurait ignorer, les crédits de la mission soient à la hauteur des enjeux de développement de nos entreprises. Il est regrettable que les dépenses d'intervention soient, dans le cadre du présent projet de loi, la seule réelle variable d'ajustement utilisée par le Gouvernement. C'est pourquoi je vous proposerai de vous abstenir lors du vote de ces crédits.
Néanmoins, au-delà des crédits de la mission, j'ai souhaité examiner plus spécifiquement trois éléments qui peuvent contribuer au dynamisme des TPE et PME.
Le premier concerne le Fisac. Les dispositions du projet de loi de finances ont pour objet de mettre en oeuvre, pour la première fois, le dispositif rénové de ce fonds qui était indispensable, non seulement en raison d'un manque de ciblage des territoires prioritaires, de délais de double instruction trop longs et d'une pure logique de « guichet », mais aussi du fait de la réduction considérable des crédits du fonds : depuis 2007, le montant des crédits du fonds a diminué de 87 % en crédits de paiement et de 81,5 % en autorisations d'engagement !
Cette situation très dégradée a conduit à engager une réforme - qui vient d'entrer en vigueur - afin de mieux cibler les interventions du Fisac. Elle permet de substituer à une logique de guichet un dispositif d'appel à projets national, en distinguant trois catégories d'opérations éligibles au fonds. Néanmoins, avec un niveau de crédits de paiement initialement fixé à 10 millions d'euros et d'autorisations d'engagement de 15 millions d'euros, les moyens du Fisac pour 2016 apparaissaient particulièrement faibles. Et ce, alors même que le fonds reprend les attributions du CPDC : une enveloppe de 2,5 millions d'euros sera en effet réservée au soutien des stations-services de carburant en milieu rural, qui s'imputera sur l'enveloppe globale dévolue au Fisac, ce qui réduit donc d'autant les fonds mobilisables pour le soutien des autres entreprises.
Certes, la logique « d'appel à projet » justifie une dissymétrie entre les montants des autorisations d'engagement et les crédits de paiement ; mais elle n'implique pas, de manière automatique, une réduction des crédits.
En outre, se pose la question du financement des dossiers encore en stock. Il y en aurait encore 188 dossiers, nécessitant un financement de 5 millions d'euros. Selon les représentants de la direction générale des entreprises, ce financement devrait pouvoir être opéré dans le cadre des crédits ouverts au titre de l'année 2015 ; mais il n'est pas exclu qu'une partie des dossiers encore en souffrance doivent être financés sur les crédits ouverts au titre de l'année 2016, venant encore réduire mécaniquement l'enveloppe disponible au sein du Fisac pour financer de nouveaux projets.
Il est encore trop tôt pour s'assurer des effets réels de la réforme, car l'appel à projet n'est pas totalement clos. Mais la plus grande sélectivité des projets et une réduction des effets d'aubaine collatéraux constatés par le passé seront, en tout état de cause, de nature à renforcer l'efficacité du fonds. Dans ces conditions, la réduction « à peau de chagrin » des moyens du Fisac apparaît tout-à-fait discutable.
Certes, à l'issue de la seconde délibération de l'Assemblée nationale, la dotation globale du fonds devrait atteindre 18,1 millions d'euros en autorisations d'engagement et 13,1 millions en crédits de paiement. C'est une amélioration qui permet notamment de prendre en compte la compétence nouvelle du FISAC pour les stations-services. Elle est néanmoins bien limitée et il faudra également veiller à ce que le stock du CPDC soit bien financé à partir du fonds de dotation des collectivités territoriales, prévu à l'article 59 du projet de loi. Un abondement supplémentaire du fonds doit donc être envisagé.
Depuis plusieurs années, notre pays s'est engagé dans une démarche de simplification des formalités administratives auxquelles sont astreintes nos entreprises. Je souhaite en particulier évoquer trois chantiers spécifiques, dont la réussite est essentielle puisqu'on estime généralement le coût total de la charge administrative pesant sur les entreprises de 3 à 5 % du PIB.
En premier lieu, le Gouvernement a lancé, en 2014, un programme de simplification administrative, principalement à l'égard des entreprises, dénommé : « Dites-le nous une fois ». Il a pour objet de « réduire la redondance » des informations demandées aux entreprises :
- d'une part, en appliquant un principe de confiance, permettant de substituer à la production de pièces justificatives des déclarations sur l'honneur assorties, le cas échéant, d'un mécanisme de contrôle a posteriori ;
- d'autre part, un système d'échanges d'informations interne à l'administration. Ainsi, lorsqu'une administration dispose déjà d'une information ou d'une pièce justificative dans le cadre d'une procédure particulière, cette information ou pièce est directement transmise à une autre administration dans le cadre d'une autre procédure, sans que l'entreprise concernée ait à redonner cette même information ou pièce.
D'ores-et-déjà il faut saluer la mise en place, dans ce cadre, de deux procédures « simplifiées » à destination des entreprises : les marchés publics simplifiés et le dispositif « aide publique simplifiée » : dans les deux cas, les entreprises se bornent à s'identifier par leur numéro SIRET, et automatiquement, des informations déjà détenues par l'administration apparaissent alors dans des formulaires pré-remplis.
En deuxième lieu, un autre axe de la politique de simplification est la mise en place des nouveaux principes « silence vaut acceptation » et « saisine par voie électronique ».
La loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens a renversé le principe selon lequel le silence gardé par l'administration à l'égard d'une demande d'un administré valait décision implicite de rejet contre laquelle celui-ci pouvait intenter un recours en annulation. Elle lui a substitué un principe inverse, aux termes duquel le silence de l'administration vaut désormais, par principe, acceptation de la demande formulée par un administré.
Les entreprises, comme tous les administrés, sont concernées par cette évolution législative. Mais il reste à savoir si cette mesure, présentée comme une simplification, n'est pas susceptible de contribuer, du moins dans un premier temps, à obscurcir le paysage juridique compte tenu du grand nombre d'exceptions prévues à ce principe.
Quant à lui, le droit de saisir l'administration par voie électronique est une mesure de simplification en elle-même considérable : elle permet en effet d'éviter, dans son principe, le déplacement physique à un guichet ou l'envoi par voie postale de documents, et, de ce fait, est une source de gain de temps et d'argent non négligeable pour les entreprises.
Ce droit a vocation à s'exercer principalement dans le cadre de téléservices mis en place par l'administration. Il s'applique aux administrations de l'État et à ses établissements publics administratifs depuis le 7 novembre 2015, mais ne sera applicable aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et aux autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif qu'à compter du 7 novembre 2016.
Le chantier de la simplification des formalités est vaste et de nouvelles mesures doivent encore être envisagées qui devraient faciliter les démarches des entreprises. Mais, plus que d'une simplification des formalités, c'est toutefois bien une simplification des normes qu'il convient avant tout d'opérer pour permettre aux entreprises, notamment les plus petites d'entre elles, de produire sans que des contraintes administratives qui n'apparaissent pas réellement justifiées n'entravent leur action.
Sur ce point, il faut noter que l'article 10 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises comporte une large habilitation permettant au Gouvernement de prendre, par ordonnance, aux fins d'alléger les contraintes pesant sur les entreprises, toute mesure permettant notamment de supprimer ou de simplifier les régimes d'autorisation préalable et de déclaration auxquels sont soumis les entreprises et les professionnels.
Au-delà, il est sans doute nécessaire que tant le pouvoir réglementaire que le législateur changent leur façon d'aborder le droit des entreprises. Il faut lutter contre la tentation de réglementer à l'excès la vie de nos entreprises en limitant au strict nécessaire les obligations de toutes natures qui pèsent sur elles. C'est du reste l'un des axes de travail de la délégation aux entreprises dont plusieurs des membres devraient, dans les prochaines semaines, déposer une proposition de loi en ce sens.
En dernier lieu, un effort tout particulier doit être fait pour favoriser la complémentarité des acteurs de l'accompagnement des entreprises.
À cet égard, un mot s'impose concernant la nouvelle Agence France Entrepreneur, qui devrait se mettre en place en janvier 2016. Les priorités fixées à l'agence sont, selon le Gouvernement :
- de favoriser les créations d'entreprises plus pérennes et créatrices d'emploi ;
- d'aider au développement des TPE et des PME qui créent de l'emploi ;
- de concentrer particulièrement l'effort sur des territoires fragiles, qui bénéficient souvent moins de l'accompagnement des réseaux traditionnels de création d'entreprise.
Cette structure nouvelle est destinée à s'appuyer sur les réseaux d'accompagnement existants et les divers acteurs qui oeuvrent pour le développement économique, en particulier les régions. L'idée est donc de mutualiser et rationaliser les moyens et les pratiques des acteurs existants.
On ne peut évidemment qu'inciter à une rationalisation de l'offre d'appui aux entreprises, mais je reste quelque peu sceptique sur l'innovation réelle liée à cette création, tant les missions confiées à cette nouvelle agence ressemblent à celle de l'agence pour la création d'entreprise (APCE). Dans ces conditions, une simple évolution de l'APCE n'aurait-elle pas suffit ?
Par ailleurs, nos PME rencontrent encore de trop grandes difficultés dans leur démarche d'internationalisation, alors même qu'elles présentent de fortes potentialités de développement à l'étranger.
L'éventail des solutions déjà offertes aux entreprises témoigne d'une réelle volonté de donner aux PME et aux ETI les outils destinés à faciliter la conquête de nouveaux marchés. D'autres doivent encore se développer, mais il importe que ce développement intervienne de manière structurée entre les différents acteurs.
Depuis quelques années, des synergies se sont heureusement mises en place. Ainsi, Business France, Bpifrance et la Coface mettent en oeuvre des solutions complémentaires dans leur coeur d'activité afin de présenter aux entreprises des solutions « clé en mains ». Mais une structuration efficace implique aussi un changement de mentalité entre les différents acteurs et l'adoption d'un positionnement complémentaire et non concurrentiel. Dans ce contexte, il est très satisfaisant que Business France, CCI international et CCI France international aient signé une convention définissant les rôles de chaque organisme dans l'accompagnement des PME à l'international.
Mais il faut aussi mieux mobiliser le réseau des conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF), à l'étranger mais surtout en France, tant l'expérience de ces personnalités peut s'avérer décisive dans l'accompagnement des entreprises en recherche de marchés à l'international.
Un dernier mot sur l'article 52 rattaché à la mission. Dans sa version initiale, cet article tendait seulement à instituer un fonds de péréquation doté de 20 millions d'euros destiné à aider certaines chambres de commerce et d'industrie (CCI) en difficulté. Cette modification, en elle-même bienvenue même si son montant est relativement modeste, s'inscrit dans un contexte de réduction des ressources des CCI issues de la taxe pour frais de chambre.
Cette taxe affectée, qui comporte deux éléments - la taxe additionnelle à la contribution foncière des entreprises et la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, a été soumise à plafonnement par la loi de finances pour 2013, et ce plafond a été abaissé par les lois de finances pour 2014 et 2015. En outre, les lois de finances pour 2014 et 2015 ont procédé à des prélèvements sur le fonds de financement des CCI de région. Au total, les ressources fiscales des CCI se sont réduites de 62 % en 2015 par rapport à leur niveau de 2012.
L'article 14 du projet de loi prévoit un nouvel abaissement du plafond, réduit d'un montant de 130 millions d'euros. Cette nouvelle baisse du plafond a fait réagir le réseau des CCI, qui estime qu'elle va conduire à une baisse des financements des services aux entreprises ou de l'offre d'enseignement ; il semble néanmoins qu'elles s'y soient résignées.
A l'occasion de la discussion à l'Assemblée nationale, les députés ont modifié le dispositif initial sur deux points :
- d'une part, ils ont scindé l'enveloppe de 20 millions euros en deux fractions : l'une, à hauteur de 18 millions, destinée aux actions de péréquation, en précisant que les actions menées doivent être des « projets structurants », l'affectation étant déterminée par décision de l'assemblée des CCI dans des conditions définies par décret ; l'autre, à hauteur de 2 millions, réservée à des projets d'intérêt national destinés à la structuration et la modernisation du réseau ;
- d'autre part, ils ont modifié le mode de financement de CCI France, conduisant ainsi à modifier la gouvernance du réseau des CCI. Aux termes de la disposition, CCI France bénéficierait d'une dotation directe en vertu de la loi et ne serait ainsi plus tributaire des décisions de l'assemblée des CCI, qui fixe actuellement chaque année son budget.
Il semble que cette initiative n'ait pas fait l'objet d'une concertation réelle préalable entre les CCI, ce qui peut expliquer la réaction de certaines d'entre elles. Mais il faut souligner qu'elle tend ainsi à rapprocher la gouvernance des CCI de celle des chambres de métiers et de l'artisanat. En outre, cette évolution correspond à une préconisation faite par le président Lenoir et notre collègue Claude Bérit-Débat dans le cadre de leur rapport de contrôle de l'application de la loi de 2010.
Dans ces conditions, je vous propose de ne pas remettre en cause cette évolution qui devrait logiquement renforcer le poids de la tête de réseau des CCI au détriment de l'influence de certaines CCI de région et de donner un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

J'ai souhaité cette année consacrer mon rapport pour avis aux incidences budgétaires de la politique industrielle. La question industrielle fait en effet partie des compétences centrales de notre commission et c'est aussi l'une des priorités de l'action économique du Gouvernement. J'ai donc voulu savoir comment l'engagement en faveur du redressement industriel se traduisait concrètement dans les dépenses budgétaires et fiscales de l'État : Combien -et par quels canaux budgétaires-l'État investit-il pour appuyer la reconquête industrielle qui est au coeur de son projet économique ?
Pour naturelles que puissent sembler ces questions, j'ai pu constater que leur apporter une réponse ne va pas de soi. Comme je l'ai souligné lorsque nous avons auditionné le ministre de l'économie, aucun document budgétaire actuel ne permet d'avoir une vision transversale de l'effort financier de la nation en faveur de l'industrie. On se trouve face à de multiples dispositifs institutionnels, et de non moins nombreux outils budgétaires et fiscaux, sans que cette information éparpillée soit rassemblée en un lieu unique.
J'ai donc cherché à établir moi-même cette synthèse chiffrée.
Sur un plan méthodologique, l'exercice se heurte à une quadruple difficulté :
Premièrement, cerner les contours de l'industrie ne va pas de soi. On peut agréger ou non à l'industrie un certain nombre de services directement liés à l'industrie. On peut s'interroger aussi, en amont de l'activité industrielle proprement dite, pour savoir si certaines aides à la recherche scientifique appliquée, qui ont des implications industrielles évidentes, doivent ou non être intégrées. J'ai choisi, pour ma part, de me cantonner aux activités qui se situent clairement dans le champ de l'industrie. De ce point de vue, les chiffrages que je propose sont des minorants de l'effort financier de l'État ;
Deuxième question méthodologique à trancher : quelles sont les engagements financiers qui doivent être retenus dans le calcul ? On pourrait envisager de compter dans l'appui étatique à l'industrie ce qui relève de la commande publique, mais cela nous éloignerait de l'exercice budgétaire. De même, je n'ai pas retenu dans mon calcul les investissements en fonds propres dans l'industrie opérés par l'agence des participations de l'État. Nous verrons, avec le rapport d'Alain Châtillon, que les prises de participation dans l'industrie sont massives, dans des entreprises comme Renault ou Peugeot. Mais elles sont financées par la cession de titres, c'est-à-dire par une recomposition du portefeuille, et n'ont donc pas d'incidence budgétaire directe.
Troisième difficulté méthodologique : les enveloppes financières qui alimentent la politique industrielle ne sont souvent connues qu'après un certain délai, qui peut atteindre plusieurs années. C'est le cas notamment des dépenses fiscales telles que le CICE ou le CIR. Pour intégrer ces dépenses fiscales dans mon chiffrage, j'ai donc dû me baser sur des estimations. J'ai évidemment utilisé les plus récentes.
Enfin, certains dispositifs d'appui aux entreprises ont un caractère intersectoriel. C'est le cas là encore des dépenses fiscales. C'est le cas aussi de certains outils de financement opérés par BPI France. Comme plusieurs secteurs d'activité en bénéficient, il faut donc mesurer ou estimer la part qui revient à l'industrie. La BPI et le commissariat général à l'investissement effectuent un reporting assez précis qui permet d'identifier avec une grande fiabilité les sommes qui reviennent à l'industrie. Pour connaître ce qui va vers l'industrie dans le cas des dépenses fiscales, il faut en revanche déterminer des clés d'imputation plus imprécises. Par exemple, pour mesurer les montants de CICE qui vont vers l'industrie, je me suis basé sur le poids de l'industrie dans la valeur ajoutée marchande.
Au total, le chiffrage que je propose n'a pas la prétention de fournir une vision exhaustive et rigoureusement précise des incidences budgétaires de la politique industrielle. Cela était hors de portée compte tenu de la difficulté méthodologique de l'exercice et du temps et des moyens impartis. Toutefois le chiffrage que je vais vous présenter dans un instant fournit des ordres de grandeurs intéressants et il vient combler un véritable vide dans l'information des parlementaires et du public concernant la politique industrielle. J'espère qu'il sera poursuivi à l'avenir par le Gouvernement avec des outils plus perfectionnés d'une part parce que c'est un élément utile à l'évaluation d'une politique publique de premier plan et, d'autre part, parce que le Gouvernement n'a pas à rougir des résultats qui ressortent de ce travail de mesure.
Pour décrire l'effort budgétaire en direction de l'industrie, je commencerai bien sûr par analyser les crédits de la mission « économie ». Cette dernière intervient dans le financement vers le secteur industriel de deux manières :
- En premier lieu, le programme 134 comporte une action intitulée « actions en faveur des entreprises industrielles », qui finance des opérations pilotées en administration centrale ou au niveau des Dirrecte et qui visent à accompagner la restructuration des filières ou à cofinancer, avec les organismes professionnels, des sessions de formation sur des thématiques en lien avec la compétitivité. Figurent aussi sur cette ligne budgétaire les crédits à l'AFNOR, aux centres techniques industriels et ceux destinés au financement des structures de gouvernance des pôles de compétitivité (les projets eux-mêmes sont financés via le FUI sur une autre mission budgétaire). Au total, les crédits de cette action, hors dépenses de personnel, atteignent pour 2016, 59 millions d'euros en crédits de paiement, contre 129 millions d'euros en 2010. La baisse a donc été drastique depuis cinq ans. Une petite partie de ce recul s'explique par des changements de périmètre budgétaire, mais l'essentiel s'explique par un effort d'économies substantiel ;
- Le programme 134 porte également une partie des crédits destinés à la BPI et, auparavant à OSEO, à savoir les crédits en faveur de l'activité garantie. Ces crédits sont stables par rapport aux années précédentes. Ils s'établissent, pour 2016, à 26 millions d'euros. Les garanties de la BPI ne financent pas que l'industrie, mais le reporting de la BPI permet néanmoins d'identifier précisément la part qui profite à ce secteur. Elle est de 25 %. Par ce biais, c'est donc un peu plus de 5 millions d'euros de crédits budgétaires qui profitent à l'industrie.
Au total, la contribution financière de la mission « économie » à la politique industrielle est à la fois marginale et en forte baisse, puisqu'elle s'établit désormais à environ 65 millions d'euros.
Une autre mission contribue bien plus fortement à l'appui à l'industrie, il s'agit de la mission « recherche et enseignement supérieur ». Comme le rapporteur de cette mission en présentera tout à l'heure les crédits, je me garderai d'entrer dans les détails pour simplement recueillir quelques éléments de chiffrage nécessaires à mon propre rapport.
L'action 2 du programme 192, intitulée « soutien et diffusion de l'innovation technologique », a pour objectif de contribuer au développement des entreprises technologiquement innovantes. Elle est dotée de 345 millions d'euros à la fois en engagement et en crédits de paiement. À périmètre constant, cette action se situe à peu près à son niveau de 2010 ou de 2012.
Dans cette action 2, le programme « Aides à l'innovation », qui porte les crédits relatifs aux subventions, avances remboursables ou prêts à taux zéro opérés par la BPI, connaît cependant une baisse sensible depuis 2011 et 2012. Il a perdu 100 millions d'euros en quatre ans. La BPI tire à ce sujet le signal d'alarme et estime menacée cette activité à haut risque et fortement consommatrice de capital qu'est l'aide à l'innovation.
L'action 3 du programme 192, intitulée « soutien de la recherche industrielle stratégique », finance, d'une part, le Fonds de compétitivité des entreprises (FCE), qui porte notamment une partie des crédits du programme nano 2017 ainsi que les projets du programme européen Eurêka et, d'autre part, le Fonds unique interministériel (FUI), qui est le principal soutien aux projets des pôles de compétitivité.
Les actions de cette action sont en fort recul : 125 millions d'euros en engagements sont prévus pour 2016 et 192 millions d'euros en crédits de paiement - contre respectivement 363 et 305 millions cinq ans plus tôt. Cette forte baisse ne doit pas nécessairement s'interpréter comment un abandon des politiques financées par ces crédits. En réalité, aussi bien les actions du FUI que du FCE sont de plus en plus éligibles à d'autres guichets, notamment via les enveloppes du PIA. Plus qu'un recul des crédits, on a vraisemblablement affaire ici à une diversification des canaux de financement.
Au total, les appuis financiers au secteur de l'industrie par le canal du programme 192 s'établissent pour 2016, hors titre 2, à 687 millions en engagements et 742 millions en crédits de paiement.
Le troisième outil budgétaire de financement de l'industrie est le programme des investissements d'avenir.
L'un des axes du PIA, intitulé « Industrie et PME », est doté d'une enveloppe globale de 14,4 milliards d'euros. Pour mon calcul, je retiendrai en réalité seulement 13,4 milliards d'euros, car il faut lui retrancher l'enveloppe de 1 milliard d'euros qui a avait été créée pour refinancer OSEO.
Cette enveloppe de 13,4 milliards d'euros est constituée de dotations intégralement consommables fléchées vers des projets industriels majeurs tels que, par exemple, le véhicule du futur (1,12 milliards d'euros), la maîtrise des technologies nucléaires (1,7 milliards d'euros) et des technologies spatiales (170 millions d'euros), ou encore la recherche aéronautique (2,7 milliards d'euros), les prêts à la robotisation (300 millions d'euros) ou le fonds national d'amorçage (600 millions d'euros).
Ces crédits sont engagés à 80 %. C'est-à-dire qu'en 5 ans, cette composante du PIA a injecté en moyenne 2 milliards d'euros par an de dotations publiques dans la politique industrielle.
Deux autres composantes du PIA ont une dimension plus transversale que la précédente, mais impactent néanmoins fortement le secteur industriel.
Il s'agit en premier lieu du programme « économie numérique ». Il est doté de 4,5 milliards d'euros au total. Si on retranche ce qui ne relève pas de l'industrie stricto sensu, à savoir le financement de l'installation des réseaux à très haut débit et la transition numérique de l'État, on dispose néanmoins d'une enveloppe consommable de 2 milliards d'euros, déjà engagée à 60 %.
L'autre enveloppe transversale qui concerne fortement l'industrie est celle fléchée vers le développement durable. Si on en retire, là encore, les crédits qui ne concernent pas directement l'industrie, comme ceux consacré à l'urbanisme et à la rénovation thermique des bâtiments, il reste encore une enveloppe, intégralement consommable, de 2,7 milliards d'euros, dont 1,6 milliard d'euros ont été déjà engagés.
Au total, les enveloppes des PIA 1 et 2 fléchées vers l'industrie représentent donc 18,2 milliards d'euros, déjà engagées à hauteur de 13,5 milliards d'euros, ce qui représente un effort annuel moyen en direction de l'industrie de 2,7 milliards d'euros.
Le dernier mode de financement public de la politique industrielle consiste à mettre en oeuvre des dépenses fiscales.
Trois dispositifs fiscaux ont un impact financier particulièrement fort sur le secteur industriel et ont même été créés en grande partie pour en améliorer la compétitivité : il s'agit du crédit d'impôt compétitivité-emploi (CICE), du crédit d'impôt recherche (CIR) et du dispositif transitoire de suramortissement.
Le CIR représente un abaissement de la charge fiscale des entreprises de l'ordre de 5,5 milliards d'euros par an. D'après les informations fournies par le ministère des finances, 60 % de cette somme -soit 3,3 milliards d'euros- bénéficie au secteur de l'industrie manufacturière.
Le montant du CICE est plus compliqué à évaluer, car, par construction, les entreprises disposent de plusieurs années pour le déclarer et l'imputer sur leur imposition. D'après le dernier rapport du comité de suivi du CICE, qui date de septembre 2015, le montant de CICE déclaré au titre des salaires de 2014 atteignait 14,2 milliards d'euros au 31 juillet 2015. Le comité de suivi table sur un total de CICE de 18 milliards d'euros pour 2014, qui sera la première année pleine au taux de 6 % de la masse des salaires inférieurs à 2,5 Smic.
On ne saura pas avant 2016 quelles sont exactement les entreprises bénéficiaires et quelle est, en particulier, la part du CICE qui revient au secteur industriel. Toutefois, pour estimer approximativement la part de l'industrie dans le CICE, on peut se référer à la part de l'industrie dans la valeur ajoutée marchande, qui est de 16 %. Sur cette base, la part industrie du CICE serait de l'ordre de 2,9 milliards d'euros.
Pour le dispositif de suramortissement exceptionnel de 40 %, le projet annuel de performance chiffre son montant à 500 millions par an en année pleine. En se basant sur la part de l'industrie dans la formation brute de capital fixe des sociétés non financières, qui est de 21,5 %, on peut estimer que le secteur de l'industrie pourrait en bénéficier à hauteur de 100 millions d'euros par an. Cette estimation est une estimation basse. Si l'on regarde la liste des investissements éligibles au suramortissement exceptionnel, il est évident que l'industrie est la principale concernée par ce dispositif. À dires d'experts, la part de l'industrie dans cette dépense fiscale pourrait atteindre 60 %, auquel cas c'est 300 millions d'euros, au lieu des 100 millions que j'ai retenus, qui profiteraient à la politique industrielle.
Enfin, il existe d'autres dispenses fiscales qui ont un impact financier sur le secteur industriel, et notamment l'ensemble des mesures qui entrent dans le Pacte de responsabilité hors CICE.
Le pacte comporte en effet des mesures de réduction du coût du travail :
- une exonération des cotisations patronales versées aux Urssaf ;
- une révision du barème des allègements existants jusqu'à 1,6 fois le Smic ;
- une baisse des cotisations familiales pour les salaires compris entre 1,6 et 3,5 Smic.
Le Pacte prévoit également la disparition progressive de la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (C3S) et la suppression dès 2016, de la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés.
L'ensemble de ces mesures représente un allègement fiscal pour les entreprises de l'ordre de 6,5 milliards d'euros en 2015 et de 13 milliards d'euros pour 2016, ce qui pour les entreprises du secteur industriel représenterait un baisse d'impôt de 1 milliard en 2015 et de 2 milliards en 2016 -qui s'ajoutent aux effets du CICE, du CIR et du suramortissement exceptionnel. Là encore ce calcul repose sur une répartition de la dépense fiscale proportionnelle au poids de l'industrie dans la valeur ajoutée marchande.
Au total, pour 2015, le cumul des dispositifs fiscaux représente un effort financier vers l'industrie de plus de 7,3 milliards d'euros pour 2015 et de plus de 8 milliards pour 2016.
Et si l'on met bout à bout les financements budgétaires, ceux du PIA et les dépenses fiscales, on obtient un effort financier global pour soutenir les politiques industrielles qui atteint 11,2 milliards d'euros par an.
C'est un chiffre important. Même si certaines enveloppes sont en baisse, même s'il faut se montrer vigilant sur l'évolution du financement de certains dispositifs d'appui, il reste que la nation investit de nouveau fortement dans son redressement industriel.

Je vais évoquer avec vous le volet « communications électroniques et poste » de la mission « économie ». Je le ferai en deux temps. Tout d'abord, une analyse des évolutions budgétaires pour 2016. Puis quelques développements sur les problématiques actuelles du secteur, à savoir le déploiement de la fibre à travers le plan « France très haut débit », qui a pris le relais du « programme national très haut débit », sans que le contenu n'en soit véritablement changé.
À titre général, je tiens à souligner le manque de lisibilité des crédits consacrés au numérique dans ce projet de budget : nous ne parvenons pas à retracer le financement de certaines actions, comme celle concernant la French Tech par exemple.
L'analyse budgétaire porte tout d'abord sur les actions n°s 4 et 13 du programme n° 134. Elles correspondent à des sommes relativement faibles - 184 millions d'euros - au regard du poids du secteur dans la richesse nationale.
Avec 162 millions d'euros de dotations, l'action n° 4 voit ses crédits reculer de 6 %, après une baisse de 11% l'an passé. Cela s'explique par la baisse de 5% de la dotation de l'Agence nationale des fréquences (ANFR), d'un montant de 31,8 millions d'euros. Cette nouvelle diminution est inquiétante car la subvention pour charges de service public représente 90 % des ressources de l'Agence. Or, celle-ci voit ses missions s'élargir, et ses moyens se réduire.
La loi du 9 février 2015 relative aux ondes électromagnétiques lui a tout d'abord confié de nouvelles missions afin de concilier l'information du public et le déploiement rapide des réseaux numériques. En outre et surtout, l'Agence gèrera, en 2016, le plan d'accompagnement des téléspectateurs, suite au changement de normes de réception de la télévision prévu dans le cadre de la libération de la bande 700 MHz, ou « deuxième dividende numérique ».
Cette action 4 du programme 134 mobilise par ailleurs 119 millions d'euros pour la compensation par l'État des surcoûts de la mission de service public de transport postal, soit une baisse d'environ 11 millions d'euros par rapport au précédent exercice. Ceci en application du protocole d'accord État-Presse-La Poste de 2008, dit « accord Schwartz », portant sur les tarifs postaux de la presse.
Cet accord arrive à échéance le 31 décembre 2015. Des hausses de tarifs de transport très importantes ont été réalisées durant son exécution, entre 2008 et 2015 : + 47 %, inflation comprise ! Sachant que 92 % de la diffusion de cette presse est acheminée par voie postale, les 500 entreprises du secteur, représentant 1 200 titres de presse, attendent donc impatiemment la fixation des nouveaux tarifs. Ce d'autant plus que leur diffusion et leur chiffre d'affaires sont en baisse. Le niveau de ces tarifs sera donc déterminant pour leur équilibre économique. Aussi je questionnerai le ministre sur ce point.
L'action n° 13 est consacrée à la régulation des communications électroniques et des postes. Également en recul de 5 %, avec 21,5 millions d'euros, elle finance l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Et là encore, nous retrouvons une situation d'extrême tension, une sorte d'« effet de ciseaux » entre des dotations publiques en recul et des missions qui s'accroissent.
Cette baisse s'inscrit en effet dans une trajectoire triennale 2015-2017 prévoyant une réduction drastique de ses effectifs et de ses moyens matériels. Les crédits de fonctionnement de l'Agence ont ainsi été réduits de 45 % depuis cinq ans !
Les responsables de l'ARCEP que j'ai auditionnés ont indiqué qu'il manquerait 500 000 euros en exécution d'ici la fin de l'année. Une solution devrait être trouvée par le Gouvernement pour boucler le budget 2015, mais que se passerait-il s'il ne se montrait pas aussi arrangeant dans le futur ?
Cela pose en réalité une question de fond, sur laquelle je m'étais déjà penché l'an dernier : y a-t-il lieu de déléguer à une autorité administrative indépendante un nombre croissant de missions dont l'État devrait demeurer seul garant ? L'action de l'Autorité excède en effet largement aujourd'hui le champ de la régulation, sans qu'elle n'en ait les moyens financiers. Et la loi du 6 août dernier sur la croissance, l'activité et l'égalité des chances, dite « loi Macron », a d'ailleurs continué d'accroître le champ d'action de l'ARCEP.
J'ai pris part à la mission d'information sénatoriale qui a récemment publié un rapport intitulé « Un État dans l'État : canaliser la prolifération des autorités administratives indépendantes pour mieux les contrôler ». Il y est évoqué, s'agissant du secteur de l'ARCEP, un « délitement de l'État » et la « perte de l'expertise des administrations centrales, faute de personnels qualifiés en nombre ». Il y a là un sujet d'une grande importance dans le pilotage des politiques numériques, sur lequel il nous faudra revenir.
La mise en oeuvre du plan « France très haut débit », dont les crédits figurent dans le programme 343, illustre parfaitement les limites de cette absence de pilotage étatique.
Ce plan doit nous permettre d'avoir un accès généralisé au très haut débit d'ici 2022, selon l'objectif fixé par le président de la République en février 2013, et un accès pour la moitié de la population dès 2017. Vous le savez, les usages de l'internet explosent, et ne vont cesser d'augmenter ; il faut demain que nos réseaux soient en mesure d'y donner accès sur l'ensemble du territoire.
La priorité a été donnée à la fibre optique, qui doit desservir 80 % des foyers en 2022. Mais la « montée en débit » est également soutenue, dans les territoires où la fibre n'arrivera pas de sitôt.
La réalisation du réseau optique a été confiée à :
- des opérateurs privés comme, Orange et SFR-Numéricable, notamment. Ils se sont engagés, dans les zones à haute densité démographique (dites « zones à manifestation d'intention d'investissement », ou « zones AMII »), soit 3 500 communes et 57 % de la population, pour un coût de 6 ou 7 milliards d'euros.
L'opérateur historique, Orange, dispose encore d'une autorité et d'une influence déterminants. Or, le rythme qu'il impose est particulièrement lent. En effet, il n'a pas d'intérêt à favoriser la transition d'un réseau qu'il possède et maîtrise entièrement, à un nouveau réseau où il se trouvera en concurrence avec les autres opérateurs ;
- les collectivités publiques, en parallèle, s'engagent dans les zones non retenues par le privé - certains quartiers de villes, les zones suburbaines, le rural profond - à construire des réseaux d'initiative publique (RIP).
La couverture de ces zones coûtera 13 ou 14 milliards d'euros. Elle proviendra pour une moitié de subventions publiques, et pour l'autre de cofinancements et du produit d'exploitation des RIP.
La gouvernance publique de cette politique reste centralisée, mais se partage entre plusieurs structures : l'Agence nationale pour le numérique, l'ARCEP, le Commissariat général à l'investissement (CGI), la Caisse des dépôts et consignations (CDC)... À l'échelon régional, les préfets disposent simplement d'un agent consacré à ces problématiques.
La mise en oeuvre du plan France très haut débit se heurte aujourd'hui à plusieurs difficultés, dont la première réside dans le manque de financement des RIP.
L'État a annoncé qu'il mettait à leur disposition 3,3 milliards d'euros, dont 1,5 ont déjà été engagés. Cependant, les 900 millions d'euros du Fonds national pour la société numérique (FSN) mobilisés à cet effet tardent à être débloqués au profit de leurs bénéficiaires. Il faut au moins deux ans à une collectivité, en effet, pour obtenir le « feu vert » du Premier ministre sur un dossier de financement de RIP.
En outre, le système de soutien prévu par la France, notamment à la montée en débit sur les réseaux cuivre, n'a pas été agréé par les instances européennes, car il finance le réseau d'un unique opérateur privé.
L'absence de visibilité sur le calendrier d'exécution et sur la volonté des opérateurs privés de réaliser leurs engagements en zones denses constitue une autre difficulté. La concurrence entre les opérateurs prend des chemins inattendus à la suite des restructurations qu'elles connaissent, et notamment du rachat de SFR par Numéricable.
En définitive, c'est donc une politique « au fil de l'eau » qui s'installe, gérée par un « navire sans pilote », avec le risque de voir les usages d'internet exploser sans trouver de réponse pour tous et sur tout le territoire, et certaines zones accuser un retard croissant avec celles les mieux desservies.
Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, ma contribution à cette mission « économie », et les nombreuses interrogations qu'elle suscite dans son volet numérique. Afin de tirer un signal d'alarme sur les évolutions de la politique des pouvoirs publics en la matière, je vous propose fort logiquement un avis défavorable sur l'adoption des crédits correspondants.

Je remercie nos rapporteurs pour leur présentation. Je laisse notre collègue Jacques Chiron, rapporteur spécial de la commission des Finances pour la mission « Économie », nous faire part de la position adoptée par celle-ci.

La commission des Finances s'est réunie pour examiner les crédits de la mission et des articles rattachés avant le vote de l'Assemblée nationale. À cette occasion, elle a adopté les crédits de la mission ainsi que des amendements aux articles 52 et 53. Ces amendements sont néanmoins différents de ceux retenus par l'Assemblée nationale ; la commission des Finances aura donc à réexaminer sa position. Je peux néanmoins détailler les modifications qui avaient été envisagées par la commission.
À l'article 52, l'amendement adopté par la commission des Finances tend à réserver le bénéfice du fonds de péréquation à la réalisation de projets structurants de portée nationale ou régionale, sans d'ailleurs réserver les aides aux seules CCI de région ou à CCI France. À l'article 53, notre amendement vise à permettre que les taxes affectées aux centres techniques industriels et aux comités professionnels de développement économique financent des actions correspondant à l'ensemble des missions qui leurs sont dévolues par la loi, en raisonnant sur l'ensemble d'une filière, pourvu que celles-ci correspondent à des missions d'intérêt général.

Merci, cher collègue. Je propose de laisser immédiatement la parole à Alain Chatillon, rapporteur pour avis sur le compte d'affectation spécial « Participations financières de l'État », puis nous pourrons ouvrir une discussion sur l'ensemble des rapports.

Le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » est l'outil budgétaire de contrôle de la gestion du portefeuille financier de l'État.
Ses recettes proviennent de la cession des titres détenus par l'État et ses dépenses servent à financer l'entrée ou la montée de l'État au capital de certaines entreprises, ainsi que la réduction du stock de la dette publique au travers de versements à la Caisse de la dette publique.
L'examen de ce compte d'affectation spéciale constitue un exercice un peu particulier, puisque le bleu budgétaire associé à ce compte est presque totalement dépourvu d'éléments prévisionnels. Tant du côté des dépenses que des recettes, les sommes inscrites par le projet de loi de finances initiale revêtent en effet un caractère conventionnel et n'apportent donc aucune information véritable sur le volume et la nature des opérations qui seront menées, ni sur la part des dépenses qui serviront au désendettement.
Pour 2016, comme ce fut le cas les années précédentes, le projet de loi de finances initiale prévoit ainsi 5 milliards d'euros de recettes tirées de la cession des titres de l'État et 5 milliards d'euros de dépenses, qui seront réparties en principe en une enveloppe de 3 milliards pour acquérir de nouveaux titres et une autre de 2 milliards pour financer le désendettement.
La discrétion des informations fournies par le gouvernement sur les acquisitions et cessions à venir est évidemment liée à la nature financière de ces opérations. La stratégie de cession dépend en effet largement de la situation des marchés, très difficile à anticiper, des projets stratégiques des entreprises intéressées, de l'évolution de leurs alliances ainsi que des orientations industrielles retenues par le Gouvernement. Dans ce contexte mouvant, l'agence des participations de l'État ne peut indiquer par avance son programme : elle doit donc agir en opportunité et avec réactivité, dans le respect des grandes lignes de la doctrine de l'État actionnaire.
Au-delà de l'analyse de prévisions budgétaires qui sont purement conventionnelles, mon travail du rapporteur budgétaire consiste en réalité à faire le point annuellement sur les évolutions constatées du compte « participations financières », à analyser les stratégies industrielles et financières sous-jacentes aux décisions prises et à formuler des préconisations relatives à l'évolution future de ces stratégies.
Concernant l'évolution de la composition et du montant du portefeuille des participations de l'État au cours de l'année écoulée, il faut retenir les points suivants :
- Au 30 avril 2015, le portefeuille financier géré par l'agence des participations de l'État était évalué à 110 milliards d'euros, stable en valeur par rapport à l'année précédente ;
- les participations de l'État sont désormais réparties dans 77 entreprises contre seulement 74 entreprises il y a un an. Au cours de l'année écoulée, l'État a en effet investi près de 300 millions d'euros pour entrer au capital de trois nouvelles sociétés : l'Aéroport de Marseille-Provence, la Société aéroportuaire de Guadeloupe Pôle Caraïbes et STX France ;
- les entreprises dans lesquelles l'État détient une participation sont présentes dans quatre grands secteurs. Les transports (Air France-KLM, groupe SNCF, Aéroports de Paris, RATP, multiples ports et aéroports en régions), l'énergie (EDF, ENGIE, AREVA), les services et la finance (Orange, La Poste, groupe BPI, Française des jeux, CNP assurances, Dexia, Semmaris, Radio France, France Télévisions) et l'industrie, avec un volet industrie de défense (Airbus, Safran, Thalès, Giat, DCNS) et un volet industrie automobile (Peugeot, Renault) ;
- le secteur de l'énergie est cependant prépondérant. Les participations dans le secteur de l'énergie (EDF, ENGIE, AREVA) atteignent en effet à elles seules un montant de 51,3 milliards. Elles représentent plus de 60 % en valeur du portefeuille coté de l'État et près de la moitié de son portefeuille total ;
- compte tenu du poids des entreprises du secteur de l'énergie dans le patrimoine financier de l'État, la valeur boursière de ce dernier est extrêmement sensible à la variation du cours des entreprises énergétiques. Les évolutions marquées du cours de l'action d'EDF, en lien avec les évolutions conjoncturelles et structurelles fortes du marché de l'énergie, expliquent l'essentiel des variations de valeur du portefeuille de l'APE : forte baisse entre 2010 et 2012, très forte hausse entre 2012 et 2013, avec un doublement de l'action d'EDF qui a mécaniquement provoqué une hausse de près de 50% du portefeuille de l'État ; depuis deux ans, la tendance s'est de nouveau inversée, la baisse de l'action entraînant avec elle celle du portefeuille de l'État (-2 % entre avril 2014 et avril 2015) ;
- enfin, concernant la composition du portefeuille, on peut noter que 13 entreprises, soit 16 % du total, sont des sociétés cotées au CAC 40 : EDF, ENGIE (ex-GDF-Suez), Areva, Aéroports de Paris, Airbus, Air France-KLM, Safran, Thalès, Renault, PSA, Orange, CNP assurances et Dexia. Minoritaires en nombre, ces sociétés cotées représentent néanmoins 75 % du total en valeur du portefeuille financier de l'État, puisque leur valorisation boursière s'établit à 83,1 milliards d'euros au 30 juin 2015.
Pour ce qui concerne les principales opérations de cession et d'acquisition de l'année écoulée, il faut signaler les faits suivants.
L'État a procédé en 2015 à des cessions de titres pour un montant total de 2,8 milliards d'euros :
- deux opérations de cession ont concerné GDF-Suez. En février, une offre réservée aux salariés a conduit à céder 1,3 millions de titres pour une valeur de 26,6 millions d'euros. En juin 2015, l'État a lancé une cession au « fil de l'eau » qui a abouti à la vente de 11,6 millions de titres (soit 0,48 % du capital de la société) pour un montant de 206 millions d'euros. Au terme de l'opération, l'Etat détient 32,76 % du capital ;
- 6,5 millions de titres Safran ont été vendu en mars 2015 pour la somme de 1,033 milliard d'euros. Cette cession visait à tirer parti de la très bonne appréciation par les marchés financiers de Safran. Elle ne modifie en rien la stratégie de l'État vis-à-vis de l'entreprise. Le jeu des droits de vote double permet d'ailleurs à l'État de retrouver depuis le 24 juillet un niveau de droits de vote (27,4 %) supérieur à celui dont il disposait avant la cession (25,4 %) ;
- enfin, l'État a annoncé le 4 décembre 2014 qu'il retenait le consortium Symbiose comme acquéreur de sa participation de 49,99% au capital de la société Aéroport Toulouse Blagnac. Autorisé par l'arrêté du 20 mars 2015, cette cession a rapporté à l'État 308 millions d'euros.
Pour ce qui est des acquisitions, l'État en a réalisées en 2015 pour un montant total de 1,69 milliard d'euros :
- la principale opération concerne l'acquisition de 14 millions de titres Renault (soit 4,73 % du capital de l'entreprise) pour un montant de 1,258 milliard d'euros. Cette acquisition est directement liée à l'adoption de la loi Florange, puisque l'État est monté au capital pour rejeter une résolution qui visait à empêcher la mise en place des droits de vote doubles. Cette montée de l'État au capital de Renault n'est en principe que temporaire ;
- l'acquisition de titres Air France-KLM pour 42 millions d'euros en mai 2015 constitue une autre opération importante sur le plan de l'affirmation du rôle de l'État actionnaire. L'État a en effet souhaité se donner les moyens de soutenir l'adoption des droits de vote doubles dans un contexte où une résolution s'opposant à leur introduction était soumise au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale du 21 mai. L'État a ainsi acquis entre le 8 et le 13 mai 5,1 millions de titres portant sa participation au capital de l'entreprise de 15,88 % à 17,58 %.
Quelques mots maintenant sur les revenus courants générés par ce patrimoine.
En 2014, les dividendes perçus par l'État ont atteint près de 4,1 milliards d'euros, en légère baisse par rapport à 2013.
La loi de finances initiale avait prévu pour 2015 des dividendes d'un montant de 3,7 milliards d'euros. L'État ayant accepté qu'une partie des dividendes versés par EDF lui soient versés sous forme de titres, seuls 3,2 milliards d'euros devraient finalement être versés en numéraire et inscrits en recettes au budget général.
Pour 2016, le document d'évaluation des recettes du projet de budget en cours d'examen prévoit que la rémunération des participations de l'État devrait atteindre 3,3 milliards d'euros.
La provenance de ces dividendes est très concentrée. En 2014, 28 entreprises sur 74 ont rémunéré l'État pour sa participation à leur capital. Parmi elles, six entreprises lui ont versé des dividendes supérieurs à 100 millions d'euros et, à elles seules, ces six entreprises ont représenté 89 % du total des dividendes reçus par l'État.
Les deux plus importants contributeurs sont EDF (avec 1,965 milliard d'euros de dividendes versés à l'État en 2014), et GDF-Suez (avec 1 milliard d'euros). Ils pèsent pour plus de 70 % dans le total des dividendes de l'État.
Soucieux d'être un partenaire de moyen ou long terme pour les entreprises d'intérêt stratégique national dans lesquelles il investit, l'État mène une politique « mesurée » en matière de dividendes.
Cette « mesure » n'empêche toutefois pas le portefeuille de l'APE d'être rémunérateur. Le rendement des actions cotées de l'État s'établit en effet à 5,3 % en 2014, nettement au-dessus du rendement du CAC 40, qui est de seulement 3,5 %.
Ce rendement élevé est la conséquence directe de la composition sectorielle de son portefeuille de titres. Les taux de rémunération du capital dans les entreprises du secteur de l'énergie sont en effet à la fois plus stables et plus élevés que dans les secteurs cycliques et plus fortement concurrentiels.
Comme vous le savez, ces dividendes alimentent les recettes courantes du budget général, alors qu'on aurait pu imaginer qu'ils puissent être reversés directement sur le compte d'affectation spéciale.
Je regrette ce choix.
Il a en effet pour conséquence que le désendettement est financé par la vente des titres du portefeuille au lieu d'être financé par les dividendes. En 2014, 1,5 milliard d'euros tirés des cessions de titres ont ainsi été affectés à la diminution de la dette nette des administrations publiques. En 2015, il est encore prévu de consacrer à cet objectif 2 milliards d'euros tiré de la vente des actions de l'État. Quant à l'année prochaine, le projet de loi de finances compte consacrer au désendettement public 2 milliards d'euros issus du produit de cession des titres gérés par l'agence des participations de l'État.
Si je souscris sans réserve à l'objectif de réduction de la dette publique, je trouve qu'il n'est pas optimum d'un point de vue économique de se désendetter en cédant les titres du portefeuille de l'État.
En effet, la dette des administrations publiques, de l'ordre de 2100 milliards d'euros actuellement, génère une charge annuelle qui atteint environ 45 milliards d'euros. La charge de la dette représente donc 2,1% de la dette. Dans le même temps, les participations financières de l'État, d'une valeur de 110 milliards d'euros, génèrent un revenu annuel de l'ordre de 3,5 à 4 milliards d'euros (4,1 milliards en 2014 ; 3,7 milliards en 2015 selon les dernières évaluations). Les dividendes offrent donc un rendement qui représente entre 3,2 et 3,6 % du capital détenu.
Compte tenu du différentiel entre le coût annuel de la dette et le niveau de rémunération des participations financières de l'État, il serait plus profitable pour l'État de conserver ses titres plutôt que de les aliéner pour diminuer son stock de dettes.
Ce sont donc les dividendes générés par les participations qui devraient financer le désendettement plutôt que le produit des cessions de titres. Ces dernières devraient plutôt être réinvesties, en particulier dans des entreprises de taille intermédiaire à fort potentiel de croissance créatrices d'emplois territorialisés. C'est une préconisation que j'avais déjà faite l'année dernière.
Je terminerai ce rapport en donnant quelques indications sur les cessions et acquisitions susceptibles d'intervenir en 2016 et, plus généralement, sur les inflexions qui me paraissent souhaitables dans les pratiques de l'État actionnaire.
Tout d'abord, vous le savez tous, on s'oriente vers une recapitalisation d'Areva assez massive.
À la fin de 2014, Areva a annoncé un résultat net négatif de 4,8 milliards d'euros. Face à cette situation, le Président de la République a annoncé en juin un plan de « refondation de la filière nucléaire », qui prévoit la séparation des activités « combustible » d'Areva de ses activités de construction de réacteurs.
Areva Nuclear Power (ou Areva NP), anciennement Framatome, la filiale du groupe Areva spécialisée dans l'ingénierie des réacteurs des centrales nucléaires, passera sous le contrôle d'EDF. EDF devrait racheter en effet 51 % de la société Areva NP d'ici à la fin 2016. Dans le plan prévu, Areva conservera une partie du capital d'Areva NP. Le reste du capital pourrait être cédé à des tiers, comme le groupe japonais Mitsubishi Heavy Industries.
Areva, désormais ramenée au périmètre de l'ancienne Cogema (mines, enrichissement de l'uranium, retraitement, recyclage des déchets), procédera par ailleurs à la cession de certains actifs, comme la filiale Canberra qui conçoit, fabrique et commercialise des équipements et systèmes pour détecter et mesurer la radioactivité.
Au final, l'État devrait être amené à recapitaliser Areva pour un montant de l'ordre de 3 milliards d'euros en puisant dans les ressources du CAS « Participations financières de l'État » et en cédant une partie des titres.
Le CAS « Participations financières de l'État » devrait également enregistrer en 2016 la cession des participations majoritaires de l'État au capital des aéroports de Nice et de Lyon.
Ces cessions ont été autorisées par l'article 191 de la loi Macron.
Je rappelle qu'il s'agit de céder uniquement les participations dans les sociétés de gestion des aéroports. Les infrastructures aéroportuaires et le foncier demeureront la propriété de l'État.
Concernant la procédure de cession, elle reposera sur un appel d'offres sur cahier des charges, sous le contrôle de la Commission des participations et des transferts, autorité indépendante chargée de superviser les opérations de cession menées par l'État.
L'article 191 de la loi dite Macron précise que : « le cahier des charges de l'appel d'offres devra préciser les obligations du cessionnaire relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien, ainsi que ceux du territoire concerné en matière d'attractivité et de développement économique et touristique. Il précise également les obligations du cessionnaire afin de garantir le développement de l'aérodrome en concertation avec les collectivités territoriales sur le territoire desquelles il est installé ainsi qu'avec les collectivités territoriales actionnaires ».
En outre, la loi du 6 août 2015 prévoit que : « les candidats au rachat des parts de l'État disposent d'une expérience en tant que gestionnaire d'aéroport ou actionnaire d'une société gestionnaire d'aéroport ».
Ces dispositions montrent que les critiques et les préconisations que j'avais faites l'année dernière à l'occasion de la cession de l'aéroport de Toulouse-Blagnac ont été entendues et prises en compte. Devant les conditions peu satisfaisantes de la privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, j'avais en effet souligné que l'État actionnaire devait davantage prendre en considération les logiques économiques territoriales lorsqu'il cède un actif stratégique du point de vue de l'activité économique locale.
Je rappelle pour finir sur la question des cessions à venir que la question de l'investissement dans Alstom reste pendante.
Le montage des opérations de cession à General Electrics des activités d'Alstom dans le domaine de l'énergie comporte une option d'accès de l'État à 20 % du capital d'Alstom, via une promesse de vente octroyée par Bouygues. La possibilité de cette cession dépend de l'évolution du cours de l'action d'Alstom et représenterait, si elle avait lieu, un investissement de plus de 2 milliards d'euros.
Je répète donc ce que j'ai indiqué l'année passée, à savoir que des sommes aussi importantes devraient être mobilisées de préférence pour des acquisitions plus offensives, en particulier dans des ETI porteuses d'un fort potentiel de croissance, d'innovation et d'emploi.
Un mot de conclusion concernant les moyens humains mobilisés par l'État pour remplir son rôle d'actionnaire. Je tiens à répéter ce que j'ai déjà souligné précédemment, à savoir qu'il est indispensable de dynamiser la gestion du portefeuille financier de l'État en ouvrant plus largement la fonction d'administrateur à des personnalités issues du monde de l'entreprise.

S'agissant du numérique, je rejoins le constat fait par notre rapporteur pour avis, Philippe Leroy, mais je m'en sépare sur les conclusions qu'il en tire. Des progrès ont réellement été accomplis dans le développement de la fibre à l'horizon 2022. On ne peut que prendre acte du fait que des crédits importants ont été mobilisés à cette fin.
Il faut en outre souligner que le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique a fait plier les opérateurs de téléphonie, en les obligeant à s'engager sur la mobilisation du mobile afin de couvrir dès 2016 les communes qui ne sont aujourd'hui pas couvertes et sur le fait qu'en 2017 serait développé l'internet mobile.
Notre collègue a souligné la fragilité de l'ensemble des opérateurs, mais il faut nuancer les choses : les enchères pour la fréquence 700 Mhz se sont élevées à 2,8 milliards d'euros, au lieu des 2 milliards attendus. C'est le signe de la bonne santé financière des opérateurs. On a aussi parlé des difficultés du rachat de SFR par Numéricable : mais le président de ce nouvel ensemble a indiqué qu'il allait engager un investissement sur les réseaux de 2 milliards d'euros, dont il faudra malgré tout s'assurer de la mise en oeuvre concrète.
Il ne faut donc pas être si pessimiste. Les collectivités locales se sont réellement engagées ; certes sur un temps long, mais construire le réseau du XXIème siècle demande du temps. Et lorsque M. Leroy évoque l'opposition de la Commission européenne, celle-ci ne concerne pas le fibrage mais la montée en débit ; il a néanmoins raison de dire qu'Orange ne manifeste pas une forte appétence au déploiement des réseaux du XXIème siècle, car il assure sa survie financière sur la maîtrise d'un réseau unique dont il est propriétaire. Quoi qu'il en soit, la volonté gouvernementale est bien présente pour favoriser la numérisation de la société qui est la clé de la sortie de la crise.

Je ne voterai pas les crédits relatifs aux participations de l'État car, d'une part, ce dernier se fourvoie en réduisant sa présence capitalistique, d'autre part, les ventes de participations doivent être réinvesties dans le capital public. La politique suivie, qui consiste à rembourser les dettes avec la vente d'actifs est alarmante : culturellement, en France, le capital public est un capital stable, à faible rendement attendu, qui peut permettre d'accompagner les entreprises fragiles ou en démarrage dans la durée. L'on devrait d'ailleurs investir davantage dans le capital numérique. À cet égard, il est regrettable que l'on ait soustrait 2 milliards d'investissement à l'industrie pour assurer le financement du logement intermédiaire : il faut avant tout soutenir l'économie productive industrielle.
S'agissant de la mission « Économie » et, en particulier, du financement de l'industrie, je comprends qu'il y a un accroissement de l'effort, c'est bien, mais je constate que l'on continue encore trop d'investir dans l'immobilier, au détriment de l'investissement productif.
Je suis très attentive au suramortissement, qui devrait permettre de combler notre retard en matière de robotisation. Je rappelle que notre commission souhaitait depuis deux ans un dispositif analogue, et qu'un dispositif de suramortissement n'a finalement été adopté qu'en août dernier. Alors qu'on devrait prolonger ce dispositif au-delà d'un an, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique nous répond qu'il faut garder un dispositif très limité dans le temps pour inciter les entreprises à investir immédiatement. Mais un dispositif de plus longue durée est nécessaire, ne serait-ce que pour permettre aux PME et aux ETI d'être suffisamment informées de ce dispositif pour l'utiliser. Il faut une lisibilité à moyen terme beaucoup plus forte. Il faut au minimum envisager une prolongation de deux ans du dispositif ; et je déposerai des amendements en ce sens.

Je rejoins notre collègue Philippe Leroy au sujet de l'ARCEP. On donne à cette autorité des compétences supplémentaires, alors qu'elle n'est pas en état d'exercer ses compétences de base, notamment celle consistant à s'assurer de la couverture du territoire en téléphonie mobile. L'ARCEP n'a pas un budget suffisant.
Concernant le plan « France très haut débit », on constate que tout le milieu rural est couvert, mais rien n'avance concernant les zones à manifestation d'intérêt d'investissement (AMII).
En ce qui concerne les participations financières de l'État, ce qui s'est passé à Areva est absolument scandaleux, et j'aurai l'occasion d'en reparler la semaine prochaine à l'occasion de mon rapport pour avis.

Je tiens également, comme notre collègue Elisabeth Lamure l'a fait, à attirer l'attention sur les crédits du Fisac. Ces crédits, qui provenaient initialement d'une taxe affectée, s'élevant à près de 100 millions d'euros de crédits en 2007 ; aujourd'hui, il n'y en a plus que 13 millions. C'est très préoccupant pour les territoires, car le fonds sert à la revitalisation de nos territoires ruraux et urbains. Nous proposerons un amendement pour l'abonder davantage.

Je constate sur le terrain de profondes similitudes avec les faits exposés par notre collègue Philippe Leroy. Je ne conteste pas l'existence d'un effort financier, mais les procédures d'instruction sont trop longues : deux ans !
Je regrette l'attitude des deux plus gros opérateurs - SFR-Numéricable et Orange - qui n'ont comme volonté que de préserver leur pré carré plutôt que de favoriser des réflexions départementales et régionales. Il ne faut donc pas tout miser sur la montée en débit et aller plus loin dans les contraintes à appliquer à ces opérateurs. Il y a aussi trop d'enchevêtrement des interventions ; il faut simplifier en ce domaine. Et je ne parle pas des difficultés liées aux contraintes en matière d'exploitation des réseaux, qui n'ont pas été abordées aujourd'hui.

Le groupe UDI-UC s'associe aux remarques faites par nos différents collègues, y compris celles de Marie-Noëlle Lienemann, que je partage entièrement.
Je souhaite néanmoins attirer l'attention sur la politique suivie par Bpifrance. On se rend compte sur le terrain que la pratique ne correspond pas toujours aux annonces qui sont faites. Ainsi, des PME qui, avec des aides à l'investissement pourraient largement se développer, se voient refuser des garanties d'emprunts, alors même que Bpifrance a été mise en place pour pallier le refus des banques de financer les entreprises. Il faut que Bpifrance soutienne les PME et ETI qui sont sur des segments à forte valeur ajoutée même s'il existe un risque à assumer : sinon, à quoi sert-elle ? Pour le reste, nous nous abstiendrons.

S'agissant des CCI, on a abaissé leur financement public par taxe affectée et ponctionné leur fonds de roulement. Mais on crée par ailleurs un fonds de péréquation entre les CCI : or, l'argent risque d'être finalement affecté aux grosses CCI ; il faudra être vigilant sur l'utilisation qui doit être faite de ces sommes.
Sur le développement du très haut débit sur l'ensemble du territoire, on nous annonce une échéance en 2022. Mais en Lozère, où près d'un tiers du territoire n'est pas couvert par un réseau mobile, malgré ce que dit l'ARCEP, on ne voit pas comment l'on pourrait y arriver avant même 25 ans ! Il y a un vrai problème d'équité territoriale.
Le déploiement de la 4G pourrait contribuer à la couverture du territoire en milieu rural pour des usages fixes, notamment pour les hameaux dispersés. Il faut faire quelque chose.

Les centre techniques industriels (CTI), ainsi que les comités professionnels de développement économique (CPDE), sont des structures qui mettent en oeuvre des actions de promotion et permettent la diffusion des techniques auprès des PME et TPE. Une mission a été confiée à Mme Clotilde Valter, alors députée, qui a formulé six recommandations. Peut-on considérer que le ministère a pris les mesures nécessaires pour sécuriser l'avenir et le rôle de ces centres qui sont essentiels pour la diffusion de l'innovation auprès des entreprises ?

Je partage la position de notre collègue Alain Bertrand : il faut vraiment prendre en compte la situation très particulière des territoires ruraux et ultra-ruraux. La question de la simplification des normes et des démarches des entreprises a été abordée ; si l'on va dans cette direction, il est indispensable malgré tout de maintenir des contrôles et d'obliger les entreprises à rendre compte de leur activité, en particulier lorsqu'elles bénéficient de fonds publics.

Je ne voterai pas les crédits de la mission « Économie » eu égard à la situation du Fisac.

Je comprends l'opposition au vote des crédits. Cependant, je vous invite plus simplement à vous abstenir de voter les crédits et à présenter un amendement, au nom de la commission, destiné à augmenter le Fisac de 5 millions en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, en abondant le programme 134 à partir de crédits prélevés sur le programme 220, dont les crédits baissent seulement de 2,5 % par rapport à 2015. La dotation actuelle du Fisac, même si elle a été un peu améliorée par l'Assemblée nationale, n'est en effet pas acceptable. Cet abondement permettrait simplement d'être presque au niveau de l'an dernier, si l'on prend en compte le financement du stock des dossiers du Fisac et le fait qu'une partie de son enveloppe est fléchée vers les stations-services en milieu rural.

Je soutiens la proposition de notre rapporteur pour avis, compte tenu de l'évolution depuis 2007. Je pense que nous pouvons tous nous retrouver sur la nécessité de renforcer les crédits du Fisac.

Monsieur le Président, avant de passer au vote sur les crédits de la mission, je souhaitais répondre aux interrogations formulées par notre collègue Roland Courteau sur les CTI. L'article 53 du projet de loi de finances prévoyait de modifier la gouvernance de ces centres, afin qu'ils soient davantage rattachés à l'État. Mais l'Assemblée nationale a tempéré cette évolution et maintenu les professionnels à la direction des CTI, dans le cadre d'un financement par taxes affectées. L'avenir de ces structures essentielles pour les TPE et PME, et celui de leurs 3 200 collaborateurs, est donc assuré.
Pour répondre à Mme Marie-Noëlle Lienemann, j'indique que les prêts à la robotisation s'élèvent à 350 millions d'euros dans le cadre du PIA, dont 98 millions ont été d'ores-et-déjà engagés et décaissés. S'agissant du dispositif de suramortissement qui représente 500 millions de dépenses fiscales par an, je rappelle qu'il cible la modernisation de l'outil de travail ; 100 millions d'euros reviendront à l'industrie en estimation basse, 300 millions en estimation haute.
Bpifrance fait déjà beaucoup et les résultats sont impressionnants. S'il doit y avoir des correctifs pour résoudre certaines difficultés, il faut bien entendu les apporter.

Je ne nie pas les crédits déjà adoptés concernant le plan « Très haut débit ». Je souligne néanmoins qu'il ne s'agit que d'autorisations d'engagement. À titre personnel, je persiste à ce stade à proposer un avis défavorable à l'adoption des crédits de la mission.

Je rappelle les positions de nos rapporteurs pour avis sur les crédits de la mission « Économie » : Mme Lamure propose de s'abstenir, M. Bourquin propose un avis favorable et M. Leroy un avis défavorable. Nous allons donc procéder au vote.
La commission décide de s'abstenir sur le vote des crédits de la mission, dans l'attente de la présentation de l'amendement relatif aux crédits du Fisac. Elle donne un avis favorable à l'adoption de l'article 52 rattaché, sans modification.

Je rappelle que M. Chatillon, rapporteur pour avis du compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État », propose de donner un avis de sagesse aux crédits concernés.
La commission décide de s'en remettre à la sagesse du Sénat sur le vote des crédits du compte d'affectation spéciale.

Je vous propose que nous nous intéressions aux conditions dans lesquelles les banques garantissent aujourd'hui les crédits bancaires. Il faudrait envisager un mécanisme d'auto-assurance, avec une taxe sur les banques qui permettrait d'abonder un fonds d'assurance afin de garantir les PME, les PMI et les ETI.

Je passe maintenant la parole à notre collègue Valérie Létard, pour nous présenter l'avis budgétaire « Recherche et enseignement supérieur», en remplacement de Henri Tandonnet, rapporteur pour avis, actuellement empêché. Ma chère collègue, je vous passe la parole.

Monsieur le Président, mes chers collègues, je vais donc, cette année encore, vous présenter les crédits de la MIRES, la mission interministérielle « recherche et enseignement supérieur ». Mais ceci dans un contexte un peu particulier, puisque je remplace notre collègue Henri Tandonnet, qui a été opéré la semaine dernière.
Je me propose donc, en me faisant sa simple porte-parole, de vous exposer les grandes orientations du budget pour 2016, puis d'approfondir le sujet que M. Tandonnet a souhaité développer, à savoir le financement de la recherche et de l'innovation par les collectivités, notamment dans le cadre des nouveaux contrats de plan État-région (CPER).
Avec quasiment 26 milliards d'euros, le budget de la MIRES est en stagnation, cette année encore. À l'intérieur de cette enveloppe, les crédits consacrés à la recherche, qui nous intéressent, sont également en stagnation, à un peu moins de 14 milliards d'euros.
Ce gel des crédits se retrouve dans les dotations allouées aux organismes de recherche. À première vue, avec environ 5,8 milliards de crédits alloués en 2016, ils enregistrent une reconduction de ces dernières. Cependant, ce constat est en réalité à nuancer.
D'une part, ce nouvel exercice s'inscrit dans la continuité de précédents déjà marqués, de façon globale, par une stagnation ou une légère régression des dotations, ce qui implique une évolution négative en termes réels.
D'autre part, il n'est ici rendu compte que des dotations en loi de finances initiale, qui bien souvent se trouvent affectées par des mesures de régulation budgétaires en cours d'année. 577 millions d'euros ont ainsi été affectés par ces mesures lors du précédent exercice ; ce n'est pas négligeable ! Il y aurait un accord pour un dégel de 376 millions d'euros, mais nous en attendons la confirmation.
Enfin, ces évolutions généralement négatives s'appliquent à des organismes qui, pour beaucoup d'entre eux, ont déjà « rogné » au maximum leurs dépenses courantes et risquent de voir remise en cause la pérennité de leurs actions d'intérêt général.
L'exemple d'IFP-Énergies nouvelles (IFP-EN) et de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA), développé dans le rapport pour avis, illustre cette évolution inquiétante.
Ainsi, depuis 2010, la dotation nette d'IFP-EN aura été réduite de 37 millions d'euros, soit pas moins de 22 %. Cette baisse fragilise fortement l'équilibre financier de l'institut, et par conséquent ses missions de service public ; elle affecte en priorité les travaux de recherche sur les nouvelles technologies de l'énergie, et s'inscrit en contradiction avec les objectifs et priorités de l'État en matière de transition énergétique.
L'institut a déjà réalisé des efforts conséquents sur ses dépenses et semble aujourd'hui parvenu au bout de l'exercice. Depuis 2010, il s'est séparé de près de 150 personnes et a stoppé des projets de recherche parmi ceux à plus haut risque et aux débouchés de plus long terme.
La situation budgétaire, qui permettait encore jusqu'à récemment de compenser la baisse de la dotation par des ressources propres, est arrivée à une limite. En effet, les prélèvements étaient effectués sur les sociétés filiales. Envisageables dans un contexte de croissance, ils ne le sont plus, du fait de la baisse du chiffre d'affaires de ces dernières.
La problématique, quoique différente à l'IRSTEA, aboutit aux mêmes impasses budgétaires. Ses ressources propres, qui s'appuyaient sur les appels d'offre de financeurs publics - comme l'État, les collectivités territoriales ou encore l'Agence nationale de la recherche (ANR) - vont être réduites. En effet, de fortes restrictions budgétaires affectent ces financeurs publics.
Les conséquences sur le fonctionnement au quotidien de l'organisme, mais aussi sur la planification de ses activités de recherche, sont inquiétantes. Ses moyens sont tendanciellement décroissants - à commencer par les plus importants, à savoir le personnel de recherche, réduit d'une cinquantaine de postes ces cinq dernières années. Ainsi que l'ont clairement exprimé à votre rapporteur pour avis ses responsables, l'institut risque d'abandonner certains champs de recherche ces prochaines années.
Je vous l'annonçais déjà l'an dernier, mes chers collègues : nous sommes parvenus à une situation extrême, qui ne permet plus de préparer l'avenir de la recherche, et dont nous ferons les frais dans le futur. En effet, dans une économie où la connaissance et l'innovation seront, demain plus que jamais, la source de toute valeur ajoutée, comme l'a rappelé le ministre de l'économie, M. Emmanuel Macron, lors de sa dernière audition devant notre commission, on mesure les conséquences désastreuses d'une telle évolution pour notre pays. Encore une fois, on voit ici le décalage entre les ambitions annoncées et les moyens réellement mis en oeuvre.
Quelques mots sur l'ANR : après trois années de baisse consécutives, ses crédits sont maintenus cette fois-ci. Mais à niveau tellement faible que l'on peut s'interroger, comme le reconnaît d'ailleurs le ministère, sur l'utilité de cette structure pour financer la recherche sur projet. Vous connaissez d'ailleurs la complexité des dossiers qui sont ceux présentés à l'ANR et il importe de mobiliser les moyens nécessaires.
Ainsi, avec des montants alloués plus importants que ses capacités de trésorerie, l'ANR risque de ne plus pouvoir honorer les échéances des projets engagés, et donc de devoir réduire ses engagements futurs. Il y a là une véritable interrogation sur la place et les moyens consacrés à la recherche sur projet dans notre pays.
Un mot enfin du crédit d'impôt recherche (CIR). Sa dépense fiscale, évaluée à 5,5 milliards d'euros en 2016, serait en passe de se stabiliser. Le régime du CIR n'a pas été modifié à l'Assemblée nationale ; il devrait rester inchangé, ce qui répondrait aux attentes des entreprises en matière de stabilité du cadre règlementaire et fiscal, notamment pour les PME. Ces dernières nous signalent d'ailleurs qu'elles sont très souvent contrôlées a posteriori. Il conviendrait, me semble-t-il, plutôt d'envisager les modalités de leur contrôle a priori.
J'en viens à présent au thème principal du rapport pour avis : l'effort des collectivités en matière de recherche et développement, notamment dans le cadre des CPER.
Si elle reste modérée comparé aux presque 14 milliards d'euros de la MIRES, la contribution des collectivités à l'effort national de recherche n'est pas à négliger : en 2013, elle s'élevait à 1,34 milliard d'euros. Et ce montant ne cesse de progresser, avec une hausse de 13,4 % depuis 2011.
Les conseils régionaux sont les plus investis, avec 918 millions d'euros, soit plus des deux-tiers de l'effort total. Viennent ensuite les communes et leurs groupements, à hauteur de 18 %, puis les départements avec une hausse de 13,5 %, dont l'effort était pourtant supérieur à celui des communes en 2011.
La répartition des dépenses montre la prééminence des opérations immobilières, qui représentent plus du tiers des investissements en recherche-développement (R&D) de l'ensemble des collectivités. Un taux qui n'a cessé d'augmenter, et qui représente même les trois-quarts des dépenses dans le cadre des CPER. Viennent ensuite le soutien à la recherche publique et les aides à l'innovation en entreprises à hauteur respectivement de 31 % et de 28 %.
D'un point de vue géographique, l'investissement en recherche-développement, cela ne vous surprendra pas, est très polarisé. Ainsi, cinq régions en concentrent plus de la moitié : outre l'Ile-de-France, ces régions sont Rhône-Alpes, Aquitaine, les Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Je voudrais m'attarder davantage sur les CPER, un sujet que nous avions abordé l'an dernier. Je vous rappellerai tout d'abord que la cinquième génération de contrats de plan de 2007 à 2014 s'est achevée, et que la sixième, de 2015 à 2020, est dans sa première année d'exécution.
Le volet « recherche et enseignement supérieur » des nouveaux CPER est l'une des six orientations prioritaires retenues par ces derniers. Il représente 1,2 milliard d'euros sur 5 ans, ce qui est à peu près en phase avec les 1,7 milliard d'euros sur 7 ans de la génération précédente.
Sur ces 1,2 milliard d'euros, l'essentiel, soit un milliard, est dédié aux universités. Seul le reliquat de 200 millions d'euros environ profitera à la recherche, ce qui est vraiment insuffisant. Et encore a-t-il fallu « taper du poing sur la table » pour obtenir des décisions de rallonge de la part du Premier ministre ! Au départ en effet, une enveloppe de 124 millions d'euros seulement était prévue, soit un très net recul par rapport à l'exercice précédent. Cela au motif que les précédentes dotations avaient été sur-calibrées, et qu'il existait d'autres instruments de financement comme le programme des investissements d'avenir (PIA) ou le plan Campus.
Finalement, les discussions engagées avec l'État et les préfets de région ont permis d'obtenir un surplus de 81 millions d'euros de dotations. Ce n'est pas négligeable, mais cela restera sans doute trop limité. Pour ma région par exemple, cela représente 18 millions de plus, pour un total consacré à l'enseignement supérieur et à la recherche de 69 millions d'euros. Pour celle de M. Tandonnet, l'Aquitaine, c'est 11,6 millions de plus, pour un total de 53,6 millions d'euros.
Par ailleurs, et nous avions évoqué ce problème il y a un an, le mélange des sources de financement, entre le CPER et d'autres instruments de soutien, pose problème. Ils sont en effet fondés sur des logiques différentes : alors que le CPER tend à opérer un rééquilibrage entre les régions, ces autres instruments tendent au contraire à les mettre en concurrence, car ils sont basés sur des appels d'offre. Il pourrait en résulter un effet d'éviction des financements des CPER, que le faible suivi budgétaire et financier de ces contrats risque de masquer. Il y a là un point d'importance sur lequel nous pourrons interroger le ministre.
Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, les analyses qu'ont inspirées à mon collègue Henri Tandonnet cet avis sur les crédits de la MIRES. Elles rejoignent, vous le voyez, les préoccupations qui étaient les miennes les années passées.
Pour conclure, il me reste à vous faire part de son avis sur les crédits de la mission pour 2016. Eu égard au contexte très particulier de ce projet de budget, qui devrait précéder un accroissement des dépenses publiques dans les domaines de la sécurité et de la défense, M. Tandonnet entend faire preuve d'indulgence, même s'il y était plutôt défavorable au départ, et propose de s'abstenir sur le vote de ces crédits.
Mais il tient à souligner que sa position aurait sans doute été bien moins compréhensive en-dehors d'un tel contexte. Ceci du fait des évolutions budgétaires, qui ne donnent pas à nos organismes de recherche les moyens d'accroître leurs performances dans un secteur extrêmement concurrentiel à l'échelle mondiale, désormais. Ceci également, et peut-être surtout, du fait de l'absence de dynamique impulsée par l'État en matière de recherche : il n'y a ni ligne claire, ni ambition, au plus haut niveau, sur le modèle vers lequel notre pays souhaite s'orienter, ce qui n'est pas sans soulever de vives inquiétudes dans le monde de la recherche.

Merci à notre collègue Valérie Létard, qui a suppléé notre rapporteur pour avis Henri Tandonnet, auquel nous souhaitons un prompt rétablissement.

Je partage totalement le point de vue exprimé, lors de la précédente présentation, par notre collègue de la Lozère. Il importe de mobiliser nos capacités d'innovation et de recherche, en dégageant les moyens suffisants, pour assurer la compétitivité de notre secteur agricole, à l'instar des Allemands qui y ont consacré des efforts beaucoup plus rapidement que nous. Comme l'on connaît l'impératif d'assurer une agriculture productive et technologique pour éviter le réchauffement de la planète, on ne peut que s'inquiéter de la baisse des crédits ! Aussi me rallierai-je à l'avis de sagesse !

Je partage l'inquiétude exprimée par notre collègue M. Gérard Bailly. En revanche, si nous sommes pour la recherche agricole, nous privilégions une approche fondée sur l'agronomie et les bénéfices de l'agro-écologie. La recherche collaborative avec les agriculteurs de terrain manque en effet de moyens. Ainsi, certaines espèces plus anciennes sont adaptées au terroir et méritent d'être mises en valeur, voire sélectionnées et améliorées. C'est ce type de recherche, qui accorde la priorité au respect des sols et de la nature, qui nous importe !

Ces missions sont marquées du sceau de l'austérité. Ce n'est certainement pas juste, et il y a d'autres choses à faire dans notre pays pour relancer l'activité. Ce dossier du CIR n'est pas sans poser problème, comme en témoignent les difficultés qui ont entravé la sortie du rapport initialement destiné à évaluer cet outil. Or, ce dernier, comme le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), ne répond pas aux objectifs qui lui avaient été fixés. Nous sommes évidemment opposés à ce budget et aux missions telles qu'elles sont exposées ici.

S'agissant de la recherche en agriculture, l'IRSTEA est certainement l'organisme qui a connu les baisses les plus drastiques. L'Institut national de la recherche agronomique (INRA), quant à lui, a connu une baisse de 0,13 %. S'y adjoignent les précédents gels budgétaires, ainsi que l'évolution d'autres facteurs, comme le glissement vieillesse technicité (GVT) induisant une évolution de la masse salariale. Si c'est la même chose en visuel, en réalité, la situation est bien différente en termes de volumes d'activités !

Je vous remercie mes chers collègues et mets au vote l'avis budgétaire sur la mission « Recherche et enseignement supérieur ».
La Commission propose de s'abstenir sur le vote les crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».

Je passe à présent la parole à notre collègue M. Serge Larcher qui va nous présenter son avis budgétaire sur la Mission « Outre-mer ».

Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous présente aujourd'hui les principaux axes de mon rapport sur les crédits de la mission « Outre-mer » pour 2016.
L'idée directrice est que ce budget est globalement sauvegardé, mais il doit être assorti de mesures offensives pour stimuler l'économie des outre-mer. Entendons-nous bien : à mon sens, l'offensive ne consiste pas à multiplier les normes, mais à réduire l'instabilité et la complexité du cadre juridique et fiscal. Je formulerai donc quelques propositions fiscales et non-fiscales pour encourager l'investissement dans ces douze territoires situés dans le Pacifique, dans l'Atlantique, dans l'Océan indien et en Amérique du Sud.
Mon premier thème porte sur le présent et l'avenir budgétaire avec une stabilisation rassurante des crédits de paiement et une diminution plus inquiétante des autorisations d'engagement.
Vous vous en souvenez, lors de son audition en commission la ministre a présenté, à juste titre, la stabilité des crédits de la mission outre-mer comme un point positif. Je précise que nous parlons ici du maintien pour 2016 des crédits de paiements (CP) au-dessus du seuil de deux milliards d'euros, soit un demi pour cent du budget de l'État, mais nous nous situons 44 millions d'euros en-dessous du plafond triennal. On constate aussi une baisse de 3,1 % des autorisations d'engagement (AE) par rapport à 2015 et c'est un signal plus inquiétant pour l'avenir budgétaire ultramarin.
Économiquement, que signifie pour les outre-mer cette stabilité ? Dès 2009, j'avais, avec notre délégation sénatoriale aux outre-mer, annoncé l'achèvement d'un cycle. Depuis 30 ans, c'est l'emploi public qui a servi d'amortisseur - ou de « buvard social » - face aux chocs économiques, tant outre-mer que dans un certain nombre de territoires de l'hexagone. Ce qui caractérise la crise actuelle c'est avant tout l'impossibilité d'appliquer ce remède traditionnel.
Dès lors, pour offrir aux jeunes ultramarins des perspectives autres qu'un taux de chômage de 50 % ou l'exil, il nous faut absolument éviter de brutaliser la sphère publique tout en favorisant la création de richesse par les entreprises locales. Car, comme vous le savez, lorsque le taux de chômage dépasse certains seuils, ce sont les bases de la démocratie qui vacillent. De ce point de vue, si la situation est critique en métropole elle est explosive dans les outre-mer.
En même temps, je tiens à y insister, les ultramarins participent à l'effort de rigueur budgétaire. Tout d'abord, les mesures restrictives prises en 2015 produisent leurs effets : par exemple, l'an dernier, l'aide à la rénovation hôtelière a été abrogée et l'aide à la continuité territoriale a été recalibrée. Je rappelle également qu'entre 2009 et 2013, une vingtaine de mesures restrictives ont été adoptées en matière de défiscalisation. Ensuite, pour 2016 comme en 2015, les moyens du ministère de l'Outre-mer sont revus à la baisse, conformément la norme générale de productivité.
Enfin, je veux souligner tout particulièrement la poursuite de la baisse des dotations aux collectivités territoriales ultramarines avec une diminution de 80 millions d'euros dans la mission « Relations avec les collectivités territoriales ultramarines ». Certes, on constate dans la mission « outre-mer » une légère augmentation de 6 millions d'euros des crédits en faveur de la politique contractuelle entre État et collectivités mais le compte n'y est pas. Or ce sont bien les collectivités ultramarines qui sont en première ligne pour prendre en charge les personnes les plus fragiles. C'est pourquoi j'insiste sur l'idée d'une dotation spécifique d'amorçage pour accompagner, en Guyane et en Martinique, la toute prochaine fusion entre départements et régions.
En définitive, pour 2016, les crédits directement gérés par le ministère des Outre-mer devraient progresser de plus de 0,3% par rapport à la loi de finances pour 2015, pour s'établir à 2,08 milliards d'euros en AE et à 2,06 milliards d'euros en CP. Toutefois, cela ne représente qu'une petite partie de l'effort global de l'État au bénéfice des départements et collectivités d'outre-mer, qui s'élève à 14,5 milliards d'euros. Cet effort n'a rien d'exceptionnel par rapport aux autres territoires puisqu'il s'agit principalement de dépenses relatives aux pouvoirs régaliens de l'État (Intérieur, Éducation, Justice). Globalement, j'observe que ces 14,5 milliards d'euros représentent 3,8 % des dépenses de l'État pour 2,7 millions d'ultramarins, soit 4,05% de la population totale (66,7 millions en 2015).
J'en viens à l'analyse des deux programmes de la mission « outre-mer ».
Le programme 138 « Emploi outre-mer » a pour finalité d'encourager la création d'emplois et la compétitivité des entreprises ultramarines. L'éloignement géographique, l'exiguïté, l'insularité des territoires, l'étroitesse des marchés, l'exposition aux risques naturels et la proximité de pays à très bas salaires sont autant de handicaps qu'il faut compenser. N'oublions pas que nos voisins sont aussi nos concurrents. Dans le domaine touristique, par exemple, pour des produits équivalents, les prix pratiqués sont souvent inférieurs aux nôtres et je rappelle qu'en République Dominicaine, on recrute à 300 euros par mois. En même temps - on ne le souligne pas assez - les entreprises ultramarines sont soumises à des normes et des exigences de certification similaires à celles de l'hexagone.
L'action 1 du programme porte sur la compensation des exonérations de charges sociales spécifiques aux outre-mer. Les crédits s'élèvent à 1,11 milliard d'euros pour 2016, en baisse de 28,3 millions d'euros par rapport à 2015. Cette baisse concerne les allègements de charges spécifiques à l'outre-mer et, sur ce point, la réforme adoptée en loi de finances pour 2014 et celle que prévoit le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 vise à renforcer de plus en plus la concentration de ces allègements sur les bas salaires et sur les secteurs exposés prioritaires.
Selon le Gouvernement, la diminution des exonérations spécifiques aux outre-mer est compensée, d'un autre côté, par l'augmentation des allègements de charges de droit commun et par des taux majorés du CICE outre-mer, soit 9% de la masse salariale en 2016 contre 6 % en métropole.
Sans entrer dans une très complexe querelle de chiffres sur la mesure exacte de cette compensation, je formule trois observations. Tout d'abord, il faut reconnaitre que le dispositif antérieur est préservé dans les secteurs prioritaires définis par la loi du 27 mai 2009, à savoir : le tourisme, les énergies renouvelables, l'agro-nutrition, la recherche-développement et les technologies de l'information. Cependant, en pratique, le droit applicable à ces allègements et au CICE n'est pas simple, et cette complexité risque d'ailleurs de dissuader certaines entreprises d'y recourir.
J'insisterai surtout sur l'impact du principe même de la concentration des allègements sur les bas salaires. Certes, selon les modèles économétriques, ce ciblage est le plus efficace à court terme pour favoriser les embauches. Cependant, à plus long terme, il faut tenir compte des effets de structure de ces allégements de charge. J'ai retenu de l'audition de Louis Gallois par notre commission que l'encouragement des embauches au salaire minimum n'est pas sans lien avec la désindustrialisation de notre pays et une spécialisation insuffisante de notre production dans le haut de gamme. J'ajoute que cette trappe à bas salaires a tendance à conduire les diplômés ultramarins à s'orienter vers la fonction publique ou vers l'exil vers l'Hexagone ou l'étranger, alors qu'il est impératif, d'une part, de rééquilibrer le secteur public et le secteur marchand, d'autre part, de monter en gamme et enfin, d'éviter les effets de seuil pour les entreprises.
Dans ce programme 138, je mentionne également l'action n° 2 qui finance principalement le service militaire adapté (SMA), c'est-à-dire un stage d'un an qui s'adresse aux jeunes ultramarins, garçons ou filles, âgés de dix-huit à vingt-six ans, et comprend un mois de formation militaire, ainsi que 800 heures de formation professionnelle. Le succès de cette formule - 80 % de taux d'insertion - a conduit, depuis 2009, à viser le doublement des effectifs pour les porter à 6 000 en 2017. Je suis très attentif au maintien de la qualité des stages et je me demande s'il ne faudrait pas s'inspirer de ce dispositif pour l'Hexagone.
J'en viens à présent au programme 123 « Conditions de vie outre-mer » qui se décline en 8 actions. Ses crédits augmentent de 2,7 % en 2016, avec une dotation de 702 millions euros.
Un mot sur une mesure nouvelle incluse dans l'action n° 3 relative à la « Continuité territoriale » : il s'agit de la création d'un nouveau dispositif d'aide à la continuité funéraire visant à faciliter le rapatriement du corps des défunts ultramarins et à permettre aux familles d'assister aux obsèques. Il y a là un symbole très fort, car les Ultramarins restent marqués par le souvenir du déracinement de nombre de leurs jeunes, notamment à la Réunion, durant les années 60.
Par ailleurs, au sein du programme 123, je me félicite de la montée en puissance de la nouvelle génération des contrats de plan État-Région. Les crédits qui y sont dévolus s'élèvent à 137 millions d'euros en autorisations d'engagement - c'est une stabilisation mais augmentent de 4 % en crédits de paiement, avec 161 millions d'euros pour 2016.
Bien que la plupart des actions soient préservées ou augmentent légèrement, je regrette tout particulièrement que l'objectif fixé par le Président de la République de doter le fonds exceptionnel d'investissement (FEI) de 500 millions d'euros entre 2013 et 2017 ne soit désormais pas en mesure d'être atteint. Pour 2016, les autorisations d'engagement se limitent à 40 millions d'euros, soit une hausse de 1,8 % par rapport à 2015, et les crédits de paiement à 27,9 millions d'euros, soit une hausse de 8,6 %. Ces crédits ont un effet de levier considérable pour l'investissement, et leur augmentation favoriserait l'offensive économique.
Je me concentrerai ici sur le logement qui est une des principales difficultés de la vie quotidienne des Ultramarins. Je rappelle que les besoins en logements sociaux sont très importants pour des raisons démographiques et parce que la proportion des ménages à bas salaires est élevée. Concrètement, en Martinique, on recense aujourd'hui près de 11 500 demandes de logement social et, selon l'INSEE, il faudrait construire pour la période 2010-2040, 2 500 à 3 000 logements neufs par an. Or en moyenne depuis 2006, 489 logements sociaux ont été financés tandis que 403 ont été livrés par an. Nous sommes donc très loin du compte !
De plus, le nombre de logements classés comme insalubres par l'État est d'environ 68 000 et concerne plus de 150 000 personnes. Les cinq DOM, à travers des situations différentes, ont en cependant en commun une urbanisation rapide et mal maîtrisée.
Or, bien que cette politique demeure une priorité gouvernementale, on constate, dans ce programme 123, une baisse de 9 millions d'euros, en crédits de paiements, sur l'action Logement. Je précise que sur les 234,6 millions d'euros prévus en 2016, 50,3 millions d'euros sont destinés aux ménages, dont 20,1 millions en faveur de l'accession à la propriété et 29,7 millions d'euros destinés à l'amélioration de l'habitat privé, et 140,5 millions d'euros sont destinés aux opérateurs, dont 125,8 millions d'euros au logement locatif social et 6 millions d'euros à l'amélioration du parc locatif social.
Le but fixé pour 2016 est de financer 6 953 logements locatifs, en retrait de 12,5 % par rapport à l'année précédente, puisqu'il était de 7 950 logements en 2015. Pour l'instant, nous sommes donc encore éloignés des objectifs fixés par le plan logement outre-mer, qui doit s'étaler sur cinq ans, et vise un minimum de 10 000 logements sociaux par an.
Je rappelle ici que le soutien budgétaire est fondamental pour compléter l'aide fiscale à l'investissement et le crédit d'impôt en faveur du logement social, dont le terme a été porté à 2020, dans le texte du projet de loi de finances pour 2016 qui vient d'être adopté par les députés et à 2025 pour les autres collectivités ultramarines relevant de l'article 74 de la Constitution.
En définitive, nos possibilités d'actions sur ces crédits sont limitées : nous avons d'un côté une diminution des crédits du programme 138 qui porte sur l'emploi et une augmentation de même montant du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » : compte tenu des besoins dans ces deux domaines, il me parait difficile de modifier les équilibres prévus, à enveloppe globale inchangée.
C'est donc surtout en travaillant à rendre plus stable et plus lisible le cadre juridique et fiscal que nous pourrons faciliter l'offensive économique dans nos outre-mer. Je proposerai ou soutiendrai donc plusieurs amendements à l'article 43 du projet de loi de finances qui porte sur le soutien à l'investissement dit « défiscalisation ». Ces modifications sont inspirées par le pragmatisme et, en particulier, le souci de calibrer les opérations de réhabilitation de logements de façon aussi réaliste que possible.
Je résumerai le message qu'expriment les remontées de terrain en rappelant que « le temps c'est de l'argent », et on en perd encore trop en Outre-mer. En matière de logement social, par exemple, qui est un domaine particulièrement encadré, il est urgent de permettre aux opérateurs de se mieux se concentrer sur leur coeur de métier qui est de construire, car le temps consacré à remplir des dossiers atteint aujourd'hui des seuils excessifs. Ce dont souffrent aujourd'hui nos outre-mer, c'est surtout d'un manque de stabilité et de visibilité. Tous les ans, lors de la discussion de la Loi de Finances, nous redoutons que surgissent de nouvelles incertitudes juridiques et la modification du paradigme économique et fiscal de nos territoires. Afin de rétablir et d'instaurer un climat de confiance propice à l'investissement, il faut que les gouvernements garantissent le maintien de dispositifs pluriannuels et pérennes.
Dans le contexte difficile que nous connaissons, les crédits de la mission outre-mer sont malgré tout sauvegardés et par conséquent, chers collègues, je vous invite à les voter.

Merci Monsieur le Rapporteur pour le travail que vous avez accompli. Je passe la parole, dans un premier temps, à notre collègue Michel Magras.

Je tiens à féliciter notre rapporteur pour son rapport qui est d'une grande précision et d'une réelle exhaustivité. Force est de constater qu'au fil des années le budget de la « mission Outre-mer » a effectivement été sanctuarisé. Certes, des difficultés réelles, que le rapporteur a mises en évidence, subsistent, mais nous connaissons tous la situation dans laquelle se trouvent les finances de la France. Notre rapporteur a également insisté sur une chose importante : le budget de la mission n'est pas le seul que la France consacre à ses Outremers qui sont également parties intégrantes de la République. Un certain nombre des lignes budgétaires dont ils bénéficient se retrouvent également dans d'autres missions.
Je souhaitais faire deux observations. Ma première porte sur l'abaissement des charges. Je ne peux que souscrire à la volonté du Gouvernement de recentrer ses actions en faveur des bas salaires. Néanmoins, en diminuant les avantages prévus par la Loi pour le développement économique des Outre-mer (LODEOM), ce recentrage se solde par un basculement de l'aide vers les crédits d'impôts compétitivité emplois (CICE), à savoir le crédit d'impôt recherche (CIR) et le crédit d'impôt innovation (CII). Sauf que dans ce basculement, une réalité demeure : les collectivités d'Outre-mer ne disposent pas du CICE. Ce qui signifie que ces collectivités-là subissent la baisse des avantages dont elles étaient précédemment bénéficiaires et ne les récupèrent pas par ailleurs. Il faut avoir conscience de cette situation. C'est un choix puisque ces collectivités ont opté pour l'article 74 de la Constitution et pour avoir l'autonomie fiscale. Ce qui signifie que ce n'est pas à l'État de compenser par les crédits d'impôts, mais plutôt à la collectivité elle-même de l'assumer. Je ne critique pas cette situation ; je la constate simplement.
Mon deuxième constat concerne la défiscalisation. Bien qu'en tant que représentant de la Collectivité de Saint-Barthélemy, je ne sois pas un gros défenseur de la défiscalisation, je ne peux qu'en constater les bienfaits pour l'Outre-mer. Sur ce point-là, Madame la Ministre nous a indiqué, la semaine passée, que la défiscalisation devrait être garantie jusqu'à 2020 pour les Départements d'Outre-mer (DOM) et la Collectivité de Saint-Martin qui est une région ultrapériphérique. Mais pour les autres collectivités, qui ne sont pas en lien avec l'Europe, la défiscalisation devrait être assurée jusqu'à 2025. Je reste pour ma part persuadé que nous pouvons aller au-delà de 2020 pour les DOM ! D'ailleurs, le Gouvernement n'est pas hostile à cette réflexion et je pense que certains amendements sénatoriaux pourraient préconiser la prolongation de ce dispositif d'une, voire de plusieurs années. Ce n'est certes pas un engagement, mais cette démarche existe ! Elle souligne l'importance de donner davantage de lisibilité à ceux qui investissent en Outre-mer. Car il est certain qu'un projet de défiscalisation s'inscrit dans la durée et celui qui s'engage doit recevoir des garanties pluriannuelles avant de se décider. À titre personnel, je pense que la mission Outre-mer a toujours fait l'objet d'un consensus. Aussi, je propose que mon groupe en adopte les crédits.

Un mot pour féliciter notre rapporteur et pour vous confirmer que notre Groupe votera les crédits dont il faut souligner la stabilité globale. Ce qui prouve que les Outremers restent une priorité dans l'action gouvernementale. Je veux, à cet égard, souligner les crédits destinés à l'investissement public aux collectivités et au logement, de même que ceux alloués au service militaire actif et à la formation professionnelle qui permettront de favoriser l'insertion des jeunes. Je souhaite également souligner le rôle important de l'Outre-mer, comme nous l'avions fait il y a quelques jours avec Madame la Ministre, à l'approche de la COP 21. La question majeure demeure celle de la sauvegarde et de la préservation de la biodiversité. En dépit de la grande vulnérabilité des communautés ultramarines aux risques naturels et aux conséquences du changement climatique, ils restent une chance pour la France dans de nombreux domaines, tels que l'énergie, l'agriculture, la recherche, avec un développement notoire de projets innovants, et la coopération décentralisée.

Je voterai en faveur de ce budget. Toutefois, je souhaiterai que soit bel et bien assuré un suivi efficace des aides fiscales, puisqu'il s'agit d'argent public.

Nous voulons danser la biguine, où l'on tourne pour mieux avancer, tandis que les gouvernements successifs nous ont fait danser le cha-cha-cha, avec deux pas en avant et trois pas en arrière ! Nous voulons avancer ! Au-delà de la boutade, lorsqu'on met en place des dispositifs de soutien à l'investissement, il faut laisser du temps ! Or, si chaque année apporte son lot de modifications qui vient saper la confiance des investisseurs, ceux-ci sont dissuadés d'investir. Stabilisons et pérennisons plutôt les dispositifs d'aide à l'investissement. Si je n'avais qu'une seule idée à vous faire passer, ce serait bien celle-là ! Je vous remercie.

Très bien, Monsieur le rapporteur. Je vais mettre aux voix les crédits de la mission « Outre-mer ».
La Commission émet un avis favorable aux crédits de la mission « Outre-mer ».
Mes chers collègues, je vous remercie de votre nombreuse participation à notre réunion.
La réunion est levée à 12h25.