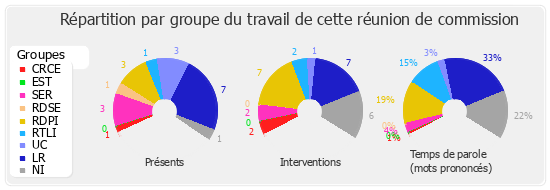Commission des affaires européennes
Réunion du 31 mars 2016 à 8h35
Sommaire
La réunion

Notre ordre du jour appelle une communication de Fabienne Keller sur l'arrangement pour le Royaume-Uni.
Je rappelle que le Conseil européen, réuni les 18 et 19 février, est parvenu à cet arrangement, qui comporte plusieurs volets. Mieux vaut regarder cet accord sous un angle positif. Avant la réunion du Conseil européen, nous avions nous-mêmes, sur le rapport de Fabienne Keller, formulé une résolution européenne, devenue résolution du Sénat le 16 février. Ce texte affirmait notre souhait de voir le Royaume-Uni rester dans l'Union européenne, se montrait ouvert au dialogue avec ce grand pays mais restait ferme sur la préservation des acquis de la construction européenne.
Un référendum sera organisé le 23 juin prochain au Royaume-Uni sur le maintien ou non dans l'Union. L'arrangement trouvé au Conseil européen est un élément important du débat. Mais on peut aussi penser que la réponse à la question de l'appartenance à l'Union dépendra plus profondément de l'état et de la sensibilité de l'opinion britannique à l'égard du projet européen. Sur ce point, il semble difficile de faire des pronostics très assurés.
Toujours est-il qu'il est intéressant à ce stade de faire un point sur ce qui a été décidé lors du Conseil européen.

L'« arrangement » obtenu en février dernier par le Royaume-Uni constitue la réponse unanime de l'Union européenne, par la voix de ses 28 États membres, aux demandes britanniques de réforme de l'Union telles qu'elles ont été présentées par le Premier ministre britannique dans sa lettre au Président du Conseil européen datée du 10 novembre 2015.
Nous parlons d'« arrangement » parce qu'il s'agit de la traduction officielle du mot anglais « arrangement » qui n'a pas la même charge négative qu'en français. Il est évident qu'il aurait fallu préférer le mot « accord ».
Sur cet accord, quelques remarques liminaires. Le Royaume-Uni a obtenu moins que ce qu'il demandait, mais plus que ce que l'Union voulait d'abord lui concéder. C'est peut être le signe d'un bon compromis. Cet accord - somme toute modeste - n'est pas de taille à peser beaucoup dans le débat interne en Grande-Bretagne sur le maintien dans l'Europe. Sa force est avant tout symbolique dans la mesure où l'Union répond aux demandes britanniques, reconnaissant ainsi le poids de cet État membre dans l'Union ; en outre, si cet accord prend en compte des intérêts nationaux, il y a dans les mesures qu'il contient des germes de réforme qui peuvent mériter examen même pour les Européens convaincus que nous sommes. L'ensemble des dispositions de l'accord ne prendront effet que le jour où le Royaume-Uni informera le Conseil de sa décision de rester membre de l'Union européenne. Cela signifie que leur mise en oeuvre est reportée au lendemain du référendum du 23 juin prochain, à la condition expresse que le référendum débouche sur une confirmation du maintien du Royaume-Uni dans l'Union ; dans le cas contraire, l'accord sera nul et non avenu. Enfin, dans le cas où le Royaume-Uni se maintient dans l'Union, l'accord entrera en vigueur, car l'ensemble de ses dispositions ont été déclarées pleinement compatibles avec les traités, mais encore faut-il mettre en oeuvre les engagements qui y sont contenus de modifier le droit dérivé, en tant que de besoin, pour rendre ses mesures applicables, ce qui entraînera un nouveau délai.
J'en viens au fond de l'accord, qui reprend l'ordre des quatre demandes britanniques et je suggère d'en faire de même pour l'analyse.
Sur la gouvernance économique et la zone euro, en premier lieu, l'accord répond en grande partie aux inquiétudes britanniques. Il réaffirme la nécessité d'approfondir l'union économique et monétaire et demande aux pays non membres de la zone euro de ne pas entraver ce processus, lequel devra, en contrepartie, rester respectueux des droits et compétences des États membres non participants. L'Union se propose de faciliter la coexistence entre les deux groupes et réaffirme que tout discrimination entre personnes physiques ou morales fondée sur la monnaie officielle de l'État membre où elles sont établies ou sur la monnaie ayant cours légal dans cet État membre est interdite.
Il est précisé que le droit de l'Union relatif à l'union bancaire s'applique uniquement aux établissements de crédit situés dans la zone.
Toute dépense liée à la politique monétaire ne pourra être imputée qu'à la zone euro.
Enfin, si un membre du Conseil ne participant pas à l'union bancaire indique son opposition motivée à l'adoption d'un acte législatif relatif à celle-ci, le Conseil est tenu d'en discuter et l'État membre concerné de justifier son opposition en indiquant en quoi le projet ne respecte pas les principes de non-discrimination. Le Conseil doit alors faire tout ce qui est en son pouvoir pour aboutir dans un délai raisonnable à une solution satisfaisante. Il s'agit d'une procédure d'alerte et non d'un veto, mais sur ce chapitre, les demandes du Royaume-Uni ont été entendues.
S'agissant de la recherche d'une plus grande compétitivité, l'Union, en réponse aux demandes britanniques, rappelle que le marché intérieur est son objectif premier et que pour créer de la croissance et des emplois, elle doit renforcer sa compétitivité. En quoi faisant ? En réduisant les charges administratives et les coûts de mise en conformité pesant sur les opérateurs économiques. L'accord reprend ce qui est déjà contenu dans « Mieux légiférer » et dans le programme de la Commission dit « REFIT ». Il s'agit ni plus ni moins de simplifier, d'alléger, voire d'abroger, les textes législatifs quand ils gênent le développement des PME et des micro-entreprises.
En outre, l'Union s'engage à pousser les feux en matière de négociations commerciales avec les États-Unis, le Japon, l'Amérique latine et l'Asie Pacifique...
Sur ces points, l'accord se contente de réitérer un ensemble de promesses dont le seul mérite est de convaincre que le Conseil et l'Union sont « business minded » ou au moins « business friendly » - comme on dit en bon alsacien.
J'en viens au volet relatif à la souveraineté et à la défense des parlements nationaux.
Le Royaume-Uni ne sera plus tenu désormais de prendre part à une intégration politique plus poussée dans l'Union. De plus, l'accord reconnaît, à ce propos, que la référence à une « union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe » ne constitue pas une base légale pour étendre la portée des dispositions des traités et du droit dérivé de l'Union et ne peut en aucun cas être utilisé à l'appui d'une interprétation extensive des compétences de l'Union ou des pouvoirs de ses institutions. Cette référence à une « union sans cesse plus étroite » ne peut empêcher les différents États membres « d'emprunter différentes voies d'intégration » ni contraindre l'ensemble des États membres à aspirer à un destin commun.
Tout est dit et c'est pour ainsi dire la reconnaissance d'une Europe à deux vitesses.
Quant au principe de subsidiarité, en réponse à la position britannique, l'accord en offre une exégèse classique avant d'introduire une nouvelle règle capitale : dans le cas où les avis motivés sur le non-respect du principe de subsidiarité par un projet d'acte législatif de l'Union représentent plus de 55 % des voix attribuées aux parlements nationaux, la présidence du Conseil inscrira - c'est un impératif - la question à l'ordre du jour du Conseil afin que ces avis motivés et les conséquences à en tirer fassent l'objet d'une délibération approfondie.
À la suite de cette délibération, les représentants des États membres mettront fin à l'examen du projet d'acte en question ou ils le modifieront pour prendre en compte les préoccupations exprimées dans les avis motivés.
Sans aller jusqu'au droit de veto que souhaiteraient les Britanniques, il s'agit là d'une avancée majeure au profit des parlements nationaux et de l'amorce du rééquilibrage dans la répartition du pouvoir législatif entre les différents acteurs européens.
J'en arrive au plus délicat, soit aux aménagements à apporter au principe de la libre circulation des travailleurs. L'accord reconnaît qu'il est légitime de tenir compte d'une situation exceptionnelle et de prévoir au niveau de l'Union comme au niveau national des mesures qui permettront de limiter le flux des travailleurs quand il est d'une telle importance qu'il a des incidences négatives autant pour les États membres d'origine que pour les États membres de destination. C'est pourquoi l'accord reconnaît que le droit à la libre circulation peut souffrir des limites pour des raisons sociales et économiques ainsi que pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ainsi, si des raisons impérieuses d'intérêt général le justifient, la libre circulation des personnes peut être restreinte par des mesures proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi. Quelles sont ces mesures ?
Le « frein d'urgence », tout d'abord. C'est un mécanisme d'alerte et de sauvegarde destiné à faire face à l'afflux - d'une ampleur exceptionnelle et pendant une période prolongée - de travailleurs en provenance d'autres États membres. Ce mécanisme permet à un État membre, après examen et sur proposition de la Commission, de restreindre l'accès aux prestations liées à l'emploi de caractère non contributif. L'État membre concerné peut limiter, pendant une durée totale pouvant aller jusqu'à quatre ans, l'accès des travailleurs communautaires à ces prestations non contributives. Cependant, cette limitation doit être graduelle et un accès progressif doit être aménagé afin que le travailleur touche l'intégralité de ces prestations au bout de ces quatre ans. Ce type d'autorisation aura une durée limitée de sept ans. L'accord précise, aspect intéressant, que la Commission européenne estime qu'il ressort de la situation britannique que le Royaume-Uni peut déjà prétendre activer ce mécanisme.
Deuxième mesure, l'indexation des allocations familiales : les États membres reçoivent la possibilité d'indexer ces allocations sur les conditions qui prévalent dans l'État membre où l'enfant réside, mais cela ne sera valable que pour les travailleurs qui arriveront après l'entrée en vigueur de l'accord. Après 2020, la mesure pourra être généralisée.
La troisième série de mesures a trait aux mariages de complaisance et aux menaces à l'ordre public : l'arrangement prend des dispositions pour lutter contre les mariages de complaisance de ressortissants d'un État membre avec des personnes extra-communautaires dans le seul but de leur assurer l'entrée sur le territoire de l'Union et pour empêcher l'entrée de certaines personnes en provenance d'autres États membres et présentant une menace pour l'ordre public ou la sécurité.
Quatrième mesure, enfin, la limitation de la libre circulation des personnes lors de futurs élargissements : l'accord prévoit que lors des futurs élargissements de l'Union des mesures transitoires seront prises pour limiter la libre circulation des personnes en provenance des nouveaux entrants.
En conclusion, au-delà des détails techniques, quelle est l'essence du message envoyé ? En premier lieu, le principe de la libre circulation des personnes peut recevoir des aménagements en réponse à des situations spécifiques.
En deuxième lieu, l'Union respecte pleinement la libre organisation des systèmes sociaux nationaux.
En troisième lieu, l'Union doit réguler, mais sans la brider, l'activité des acteurs économiques.
En quatrième lieu, le principe d'une « union sans cesse plus étroite » ne peut s'opposer à ce que chaque État membre emprunte une voie différente d'intégration ni contraindre l'ensemble des États membres à aspirer à un destin commun.
En cinquième lieu, les traités doivent reconnaître qu'il y a deux groupes au sein de l'Union : la zone euro et les autres États membres n'ayant pas adopté la monnaie unique.
Enfin, le renforcement du rôle des parlements nationaux est en marche : ils sont associés plus étroitement au processus législatif.

Ce dernier point est peut-être le point le plus important. Nous verrons ce que sera la décision du peuple britannique. Nous espérons tous, pour l'équilibre de l'Union, que la Grande-Bretagne fera le choix d'y rester, mais cela engage une nouvelle approche de l'Union, une Europe à plusieurs vitesses, une certaine émulation en matière de compétitivité venant corriger je ne dirai pas les excès mais certaines orientations britanniques un peu abruptes. Le débat est ouvert, il ne s'agit là que d'un rapport d'étape et peut-être sommes-nous à l'aube d'un nouveau départ - en Européen convaincu, je veux le croire. La démarche britannique doit être appréhendée sous un angle positif. L'Europe en a bien besoin. Il est clair, cependant - les simulations le montrent assez - qu'un Brexit serait très pénalisant pour la City, pour l'activité économique, pour le traité transatlantique, et avant tout pour les Britanniques.

Les parlements nationaux pourront-ils opposer un véto au cours du processus d'élaboration des textes ?

Non, il faut 55 % des voix, soit un nombre significatif d'États membres, pour s'opposer à un texte.

C'est une procédure nouvelle, qui prendra effet si les Britanniques décident de rester. Dans le processus de « carton jaune », où chaque parlement avait deux voix et qui exigeait de réunir un tiers des voix, il n'y avait pas obligation de réexamen par le Conseil. La force de ce dispositif, c'est que lorsque 55 % des voix sont réunies, il y a obligation d'inscription à l'ordre du jour du Conseil, ce qui crée, pour les chefs de gouvernement, une obligation politique. Le fait est que si plus de la moitié des parlements demande un changement, c'est qu'il y a un vrai problème de fond. Il y aura là un vrai exercice de contre-pouvoir.

Le Conseil aura élaboré et adopté telle ou telle proposition et les parlements pourront ensuite s'y opposer ? Ce qui veut dire qu'un chef de gouvernement, qui aura souscrit à ce texte dans le cadre du Conseil, pourra voir son parlement dire qu'il n'est pas d'accord. Curieuse situation.

Le processus d'élaboration des textes est très long. C'est dans la phase d'examen d'une proposition soumise par la Commission que nous donnerons un avis, ou menacerons de le donner, ce qui aura un effet sur les discussions préparatoires au Conseil. C'est l'exercice traditionnel de notre pouvoir d'influence, mais assorti de cette menace d'un vote négatif, ce qui n'est pas rien.

Je l'ai dit d'emblée, ce processus ne va pas, pour moi, dans le bon sens. Ce n'est pas la construction européenne que nous voulons. Les Anglais ont le droit de ne pas partager ces vues, mais nous devons nous tenir prêts à aller plus loin, en nous inspirant de la théorie des cercles concentriques. Car ce que nous voulons, c'est construire une union économique, monétaire et financière plus étroite avec l'Allemagne et l'Italie.

Ce que je veux dire, c'est que nous souhaitons avancer au lieu de regarder vers Singapour et les moutons de Nouvelle-Zélande.

Le gouvernement britannique appelle à la vigilance sur ce qui pourrait entraver le développement des PME ? Il vient aussi, dans le dernier budget, de baisser l'impôt sur les sociétés, passé de 28 % à 20 % et annonce 17 % pour 2020. Et cela sans concertation, bien sûr, puisque l'on est dans un espace économique de concurrence effrénée. Autant dire que le Royaume-Uni pousse les feux très loin. N'est-ce pas de nature à peser sur nos propres choix fiscaux, à l'heure où certains qualifient notre fiscalité de confiscatoire ?... Le Royaume-Uni agit en pleine souveraineté, c'est son droit, mais dans le concert européen, cela pose une vraie question.

Je ne vous suis pas totalement lorsque vous dites que l'on entre dans une Europe à deux vitesses, avec la zone euro d'un côté et le reste de l'autre. On est, en réalité, en train de créer une troisième dislocation. Pour l'heure, la Grande-Bretagne, le Danemark sont dans l'opt-out, notamment sur l'euro, mais tous les autres membres sont dans un processus d'adhésion à l'euro. Là, j'ai le sentiment que l'on est en train de créer un statut particulier pour la Grande-Bretagne, notamment sur la question des droits sociaux des travailleurs intra-européens. Toutes les enquêtes britanniques montrent que les citoyens de l'Union qui travaillent en Grande-Bretagne ont un taux de qualification, d'activité, de rémunération et donc de cotisations sociales supérieurs à l'Anglais moyen. Or, la Grande-Bretagne nous dit que tous ces gens que son attractivité économique amène chez elle lui coûtent très cher, en oubliant qu'ils lui rapportent aussi. Et avec cet arrangement, ils vont lui rapporter plus encore puisqu'elle ne versera pas un certain nombre de prestations sociales. M. Cameron vante le dynamisme de son économie en oubliant que son attractivité repose non seulement sur un coût du travail faible mais surtout sur des charges sociales et patronales extrêmement faibles. Ce dumping social lui attire du monde, mais il ne veut pas en payer le prix. Il y a là un paradoxe, et la Grande-Bretagne se comporte, en cela, un peu comme elle le fait pour l'immigration : avec les accords du Touquet, c'est sur les épaules de la France que repose le soin d'assurer son contrôle aux frontières.
L'Union européenne essaye d'habiller la dérogation qu'elle va consentir aux Britanniques d'un cadre plus générique, mais en réalité, elle crée un statut particulier. C'est une situation très ambiguë. D'autant que les derniers sondages ne sont pas favorables au maintien dans l'Union, les deux camps sont au coude à coude. Que deviendront toutes ces concessions à l'issue du référendum ? S'il tranche pour le Brexit, j'ai tendance à penser que l'on renégociera pour en conserver tout de même quelque chose.

Je ne suis pas un chaud partisan de la doxa anti-Brexit, au contraire. J'ai voté non au référendum organisé par le président Pompidou sur l'adhésion de la Grande-Bretagne, et je ne l'ai pas regretté une minute. J'étais convaincu à l'époque - et les faits ont montré que je n'avais pas tort - que la Grande-Bretagne n'entrait dans le marché commun que pour veiller à ce qu'il reste un simple marché commun. Il s'agissait de tuer dans l'oeuf toute ambition d'une Europe politique, d'une Europe fédérale - que j'appelais de mes voeux. L'Europe est de fait devenue un vaste ensemble économique libéral où sévit la concurrence entre les salariés, entre les économies, entre les États. Avec cette conséquence que la dérégulation, par le haut, produit, à l'autre bout, des milliers de normes. En revanche, pas l'ombre d'un chantier social, pas l'ombre d'un chantier fiscal. Au contraire, la Grande-Bretagne est en train de devenir, au nez et à la barbe de tout le monde, un paradis fiscal, avec son taux de 17% d'impôt sur les sociétés - que je vous invite à comparer au taux français.
Comment en est-on arrivé là ? Par l'élargissement permanent. Si bien qu'avec 28 États, la dynamique franco-allemande, qui était le moteur du processus européen, est noyée. Cela entraîne à l'évidence une paralysie des institutions. La règle de l'unanimité ne fonctionne pas, elle ne peut pas fonctionner. Et les deux avancées que constituaient, par rapport au marché commun, l'euro et Schengen, sont en voie de dislocation. Sous le coup des événements, certes, mais aussi parce qu'à un si grand nombre, on n'arrive jamais à se mettre d'accord.
Sans compter que cette course à l'élargissement a jeté l'Europe dans une politique extérieure parfaitement aventureuse. Sous l'égide de L'OTAN, c'est à dire des États-Unis. Il y a une dizaine d'années, de bons esprits nous expliquaient que la Turquie faisait partie de l'Europe et qu'il fallait qu'elle y entre. Personne n'a voulu voir que le Président Erdogan se servait de ce miroir aux alouettes pour régler son compte à l'armée qui veillait à ce que la Turquie reste un État laïc. Et il a réussi à liquider son influence politique, donc celle de la laïcité, sous les applaudissements de l'Europe. Il faut le faire ! A suivi cette aventureuse politique de voisinage, qui oubliait que nos voisins avaient d'autres voisins. Et quels voisins ! La Russie ! Sans doute dans les années 1990 était-elle encore très déstabilisée mais dès que l'ours russe s'est remis sur ses pattes, ce n'était plus jouable. Cela nous a amenés tout droit à la confrontation. Avec, accessoirement, les conséquences que l'on sait sur le monde agricole français.
Ceci pour dire que j'espère que les Anglais voteront non. Puissent-ils nous quitter, enfin ! Et que l'Europe saisisse sa chance de revenir à ses fondamentaux. Si cela doit passer par une Europe à plusieurs vitesses, peu importe, ce qui compte, c'est le noyau dur. Si je dis dur, c'est en n'oubliant pas que l'Allemagne a la tête dure, mais enfin... La conséquence - je parle sous le contrôle de notre ami Yves Pozzo di Borgo - c'est que l'on retrouvera des relations apaisées avec la Russie. Comme l'a fort bien dit le général de Gaulle, l'Europe va de l'Atlantique à l'Oural. Mais pas jusqu'à Washington !

Comme je l'ai dit lors de nos précédentes réunions, David Cameron joue avec le feu. Bien qu'il ait obtenu un certain nombre d'aménagements en faveur de la Grande-Bretagne, la population ne votera pas là-dessus. Les sondages, comme le rappelait André Gattolin, ne sont guère rassurants. M. Cameron porte ainsi un très mauvais coup à la construction européenne. Soit c'est le Brexit, avec les conséquences économiques que l'on sait, soit c'est le maintien dans l'Union, mais avec un arrangement dont les dispositions pourront à l'avenir être revendiquées par tout autre pays qui ferait valoir ses particularismes. Entre deux maux, il faut choisir le moindre : mieux vaut que la Grande-Bretagne reste dans l'Union. Mais cela appellera de la part du couple franco-allemand, une initiative politique rapide, pour amener un rebond de la construction européenne. Cela passe par la construction d'un noyau dur mais suppose d'aller, au-delà, vers un parlement de la zone euro, de prendre des initiatives en matière de convergence sociale et fiscale, de réaffirmer notre politique extérieure commune, qui a besoin, comme l'a montré la crise des réfugiés, de plus d'intégration et de volonté.
Si ces initiatives n'étaient pas rapidement prises, le risque de délitement de la construction européenne est réel. Nous avons donc tout intérêt, quelle que soit notre sensibilité politique, à plaider pour un tel rebond.

M. Cameron choisit le moment où l'Europe est fragilisée dans ses frontières pour négocier son « chèque ». C'est lancer un très mauvais signal, alors que l'Union a besoin de cohésion. Si chaque pays en vient à négocier pour y rester, on ne s'en sortira pas.
Que le Brexit ait lieu ou non, on fera avec. Je m'interroge, en revanche, sur la portée des avis des parlements nationaux. Que nous puissions rendre de tels avis est une bonne chose, mais cela n'est pas sans danger si les voix sont discordantes. On l'a vu avec l'agriculture. Aujourd'hui, nous n'avons plus une mais des politiques agricoles communes, ce qui nous met dans une situation de concurrence déloyale. Comme l'ont rappelé Richard Yung et Didier Marie, notre objectif doit être de construire une Europe solide et c'est pourquoi la demande britannique me déplaît beaucoup.

À mettre en regard cet arrangement et le projet de directive sur les travailleurs détachés, je me pose la question de la cohérence. Je me félicitais de ce projet de directive, qui vise à faire en sorte que les conditions de travail dans le pays d'accueil s'appliquent à tout le monde. Or, l'arrangement va au rebours. C'est toute la politique stratégique de l'Union qui, à ce compte, peut être remise en cause, car où est la cohérence ? Cet accord, camouflé sous des préoccupations d'ordre général, m'inquiète, car chacun pourra s'en saisir, alors qu'il contredit d'autres aspects des politiques européennes, qui vont vers plus d'intégration.

J'ai été ravi d'entendre mon ami Danesi. J'étais, à l'époque à laquelle il fait référence, dans le même état d'esprit et je retrouve dans son propos l'essence de la construction européenne.
Nous sommes à la croisée des chemins. Nous nous rendons compte que nous sommes trop petits pour faire face à la mondialisation, et qu'il faut aller vers plus de fédéralisme. Un exemple. Il y a quelques jours, on a appris que les Russes, mis en difficulté par la baisse des prix du pétrole, voulaient emprunter sur les marchés financiers. Coup de fil du Trésor aux banques américaines : pas question de prêter un centime aux Russes, sous peine de rétorsion. Même chose avec les banques européennes, qui ont, furieuses, dû obéir. Cela donne la mesure de la puissance américaine. Or, si la France, l'Allemagne et l'Italie étaient unies, nous serions capables de résister.
Autre exemple, on nous annonce ce matin la sortie de la nouvelle BMW Tesla, avec un chargement électrique qui donne une autonomie de 400 à 450 kilomètres. Or, la valorisation du groupe est à elle seule supérieure à celle de Peugeot et Renault réunis. Si Tesla réussit, cela va tuer notre industrie automobile. L'Europe ne devrait-elle pas faire, dans ce secteur, comme elle a fait pour Airbus, et aider les entreprises à investir ? Nous avons tout intérêt à retrouver l'état d'esprit des origines, si nous ne voulons pas nous retrouver à la traîne de la Silicon Valley, où s'opèrent des choix industriels essentiels. Voyez le numérique : les Américains ont leur système, les Chinois ont leur système et nous, nous n'existons pas.
Autre exemple, encore, on a appris que les Américains envoient des chars à l'Est. Imaginez l'humiliation que cela représente ! C'est à peu près comme si nous en envoyions au Mexique parce qu'il craindrait un voisin ! Il ne s'agit pas ici de faire de l'anti-américanisme, mais alors que l'Europe est une vraie force économique, nous restons amorphes ! Je rejoins mon ami Danesi, avec lequel je partage une histoire militante, il faut aller vers plus de fédéralisme.
Quant aux Anglais, s'ils nous quittent, je ne suis pas sûr qu'ils en profitent beaucoup. Les marchés financiers en seront ébranlés et l'on peut s'attendre à des transferts d'entreprises, qui viendront sur la zone euro. Alors que l'Angleterre n'est pas autre chose qu'un paradis fiscal « légal », je ne suis pas persuadé que sa sortie ne soit pas favorable à la construction européenne.

Je vous remercie de ces nombreuses interventions, qui regardent vers l'avenir. Richard Yung s'inquiète de voir disparaître la notion d'une union « sans cesse plus étroite ». Bien qu'elle soit plus déclarative que juridique, il est vrai qu'elle n'en marque pas moins avec force l'esprit de la construction européenne.

En cas de modification du traité... On touche là à une symbolique très puissante.
Éric Bocquet et Yves Pozzo di Borgo ont posé la question de la cohérence de la politique fiscale et économique de l'union monétaire. Vaste sujet, qui engage non seulement la question des taux mais celle des bases fiscales. Les groupes multinationaux ne sont pas au taux nominal, auquel seules les PME, attachées à un territoire, sont soumises. Il faut à tout prix harmoniser tant les bases que les taux. D'autant que la France est, à cet égard, en mauvaise posture face à certains États membres qui essayent, on peut le comprendre, de sauver une partie de leur activité. Seul un débat au sein de la zone euro nous permettrait d'avancer. Ce qui ne règle pas, cela dit, le cas du Royaume-Uni.
André Gattolin craint que le statut particulier qui serait reconnu au Royaume-Uni ne crée un risque supplémentaire de dislocation. Mais ce pays jouit déjà d'un statut particulier, qui ne date pas d'hier. Je reste prudente sur ce qu'il a dit des sondages, car il semblerait que la plupart sont des sondages par internet, qui comportent des biais énormes. J'ajoute que de tels pronostics peuvent aussi susciter un réflexe pro-européen.
René Danesi, dans son exposé très complet, s'est inquiété des risques de dislocation de l'euro et de Schengen. Je rappelle cependant que le Royaume Uni n'y est pour rien, puisqu'il ne fait partie ni de l'un ni de l'autre. Si Schengen est déstabilisé, c'est plutôt par la poussée de l'immigration, des difficultés posées aux pays du sud et du terrorisme. Et si l'euro l'est, c'est du fait de notre propre fragilité économique. Quant à son analyse sur nos relations avec la Russie et la Turquie, je dirais qu'elle va bien au-delà de celle que j'ai livrée.
Jean-Paul Emorine a souligné à juste titre qu'il n'y avait plus de politique agricole commune, une politique qui a pourtant longtemps été au coeur de la volonté européenne.

Et fut un grand succès de l'Union européenne, soucieuse d'assurer sa sécurité alimentaire.
Il nous a dit combien la démarche britannique lui déplaisait. N'oublions pas que c'est la démarche d'un État en prise à des difficultés internes, où le pouvoir est éclaté entre eurosceptiques et europhiles et dont le chef du Gouvernement, victime d'un populisme que tous les États membres connaissent aussi, a trouvé la solution du référendum pour franchir le cap des législatives. Il ne faut pas perdre de vue l'origine de cette démarche, même s'il est vrai qu'elle est susceptible de déstabiliser les principes fondamentaux de l'Union européenne.
André Reichardt s'inquiète de la cohérence avec la directive travailleurs détachés. Je rappelle cependant qu'à la différence des autres États membres, la Grande-Bretagne n'est guère concernée par cette directive. Elle est plutôt confrontée à des migrants intra-européens qui s'installent sur son territoire. Il est vrai cependant que pour les autres pays européens, se pose un problème de cohérence.
Yves Pozzo di Borgo a souligné que nous sommes trop petits pour faire face à la mondialisation, alors que les États-Unis sont partout. Ne perdons pas de vue, cependant, que les Américains sont aussi souvent nos alliés sur beaucoup de sujets.
J'en viens à la question principale. Le Brexit serait-il ou non une catastrophe ? On pourrait certes considérer, comme certains, que ce serait loin d'être un drame, et qu'il n'y a pas de quoi sonner l'alarme au seul motif que l'insularité des Britanniques les porte à une démarche britanno-centrée. Mais souvenez-vous des propos de Mme Bermann, ambassadrice de France au Royaume Uni, lors de son audition. Elle rappelait qu'un pays comme la Chine, qu'elle connaît bien pour y avoir été en poste, constaterait purement et simplement, en cas de Brexit, que la zone Europe connaît une inversion brutale de dynamique du fait de la sortie d'un Etat membre, et non des moindres. Si donc on peut considérer qu'un Brexit ne changera, techniquement, pas grand chose, et que l'on montera vite des accords à l'image de ceux que l'on a passés avec la Norvège ou la Suisse, il reste qu'au plan politique, le regard du monde sur l'Union européenne peut changer brutalement, avec des conséquences considérables sur la place de l'Europe dans le monde. C'est pourquoi je suis résolument favorable au maintien du Royaume Uni dans l'Union.
Le débat n'est pas terminé. Nous nous rendrons sur place, avec Jean Bizet, pour suivre les élections et vous livrer une analyse des forces en présence. Vous avez vu que récemment, le ministre des affaires sociales, Ian Duncan Smith, a quitté le Gouvernement, que le maire de Londres, Boris Johnson, a pris position pour le Brexit. Les forces en présence sont mouvantes et nous vous proposerons, fin mai ou début juin, une analyse plus poussée.

Je me réjouis de la qualité des échanges sur un sujet extrêmement important. Il est vrai que pour des raisons de politique intérieure, M. Cameron s'est engagé dans une démarche dangereuse. J'insiste sur le fait que si Brexit il y avait, l'arrangement deviendrait caduc et ne pourrait s'appliquer à d'autres États membres. Je n'irai pas jusqu'à dire que cela pourrait donner des idées à certains, mais enfin...
Le référendum est un outil qu'il faut manier avec beaucoup de précaution. Comme disait Woody Allen à propos des référendums : « La réponse est non. Rappelez-moi la question ? » Quelle que soit la décision du peuple britannique, nous serons amenés à réfléchir à un rebond du fonctionnement de l'Union européenne. Notre commission s'honorerait à le faire. Comme l'a rappelé Fabienne Keller, l'Europe est sous le regard de ses grands voisins.
Pour faire écho au propos d'Yves Pozzo di Borgo au sujet de la puissance américaine, je relève que dans le cadre de la négociation sur le traité transatlantique, M. Obama devrait, pour lui donner un dernier coup d'envoi, se rendre en Europe avant la fin de son mandat, et ce sera vraisemblablement plutôt en Allemagne et à Londres...
Il est indispensable que nous donnions, avant la mi-décembre, notre analyse sur le statut d'économie de marché de la Chine, et notamment sur la question du « droit moindre ».
J'ajoute que l'on ne peut négocier sereinement sur le traité transatlantique avec cette épée de Damoclès que représente l'extraterritorialité de la loi américaine. Nous ne pourrons peser que si les États membres sont unis.

Nous allons entendre à présent la communication d'André Gattolin et Colette Mélot sur la mise en oeuvre de la stratégie numérique de l'Union européenne.
Nous pouvons suivre la Commission européenne dans sa proposition de construire un marché unique du numérique. Il y a là un enjeu économique majeur pour permettre à l'Europe de retrouver le chemin de la croissance et de la création d'emplois. Mais on ne saurait sous-estimer les obstacles encore nombreux qui entravent la réalisation de cet objectif.
Nous avons souligné au Sénat que l'Union européenne ne pouvait pas être une simple consommatrice. Elle doit aussi être productrice sur le marché unique numérique. Nous devons nous préoccuper de la perte de souveraineté de l'Union européenne sur ses données. Nous sommes depuis longtemps très vigilants sur la protection des données personnelles. Nous nous sommes préoccupés du maintien du niveau de protection de nos consommateurs dans le cadre des achats en ligne, en adoptant un avis motivé.
La gouvernance de l'Internet a aussi fait l'objet de travaux et de résolutions du Sénat, sur le rapport de notre collègue Catherine Morin-Desailly. L'Europe devrait jouer tout son rôle pour promouvoir un Internet conforme aux valeurs démocratiques et aux droits et libertés fondamentaux.
Nous souhaitons une régulation effective des grandes plates-formes qui occupent une position dominante qui peuvent leur permettre d'imposer leurs vues à des PME sous-traitantes.
Le Sénat est saisi du projet de loi pour une République numérique qui a été adopté par l'Assemblée nationale en janvier. Il l'examinera en mai. Il est donc nécessaire de nous interroger sur la cohérence entre l'agenda européen et l'agenda national.
Il ne vous a pas échappé en lisant les journaux économiques nationaux que le débat sur le statut et les fonctions de l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) fait rage. Il s'agit d'une société de droit privé à laquelle les Américains ne sont pas prêts à renoncer. Là encore, ne pas jouer collectif nous met en position de faiblesse.

Il y a pratiquement un an, la Commission européenne présentait une ambitieuse stratégie numérique pour l'Union européenne. Après les annonces, viennent les actions et nous voulions, avec Colette Mélot, faire un point avec vous.
Seize initiatives étaient annoncées. Où en est-on ?
On peut dire que la Commission européenne a été assez méthodique et volontaire. Après l'annonce de sa stratégie, et avant que celle-ci ne soit définitivement validée par le Conseil et le Parlement européen, elle a lancé une série de consultations publiques sur différents aspects de la politique numérique. Il est bon de suivre ces consultations, car notre parole de parlementaires est écoutée dans ces travaux préalables. L'une, en cours, porte sur le statut de la Chine à l'OMC. Concernant le numérique, la dernière consultation a été lancée il y a moins d'une semaine, le 23 mars dernier. Elle concerne la place des éditeurs dans la chaine de valeur des droits d'auteurs et l'exception de panorama.
Cette question des droits d'auteur est très importante à l'ère numérique et particulièrement pour notre pays. La Commission européenne avait initialement prévu de présenter une proposition législative sur le sujet en juin. D'après nos informations, ce sera pour l'automne, au mieux. Je ne pense pas que cette réforme sera enterrée, mais je crois que les Commissaires se sont rendu compte qu'il convient d'avancer prudemment sur ce sujet sensible.
Pour le reste, la Commission européenne a poursuivi ses travaux. Elle a déjà soumis au Conseil quatre propositions de texte. Deux concernaient les transactions en ligne et ont fait l'objet d'un avis motivé du Sénat au titre de la subsidiarité. Vous vous souvenez certainement que nous nous étions émus d'une harmonisation totale du droit des consommateurs qui aboutirait à un affaiblissement de la protection des consommateurs français, sachant que notre droit est plus protecteur. Hélas, nous avons été peu suivis par les autres parlements. La raison est double : d'une part, peu d'États membres disposent d'un droit de la consommation qui couvre déjà les transactions en ligne et la plupart sont donc en attente d'un texte européen ; d'autre part, beaucoup de petits pays ont intérêt à développer le commerce transfrontière pour les exportations de leurs entreprises.
De son côté, le Gouvernement français partageait notre préoccupation. Par conséquent, lors des négociations qui ont déjà débuté, il demande que les aspects qui nous posent problème soient exclus de l'harmonisation maximale pour ne faire l'objet que d'une harmonisation minimale. Je rappelle que les directives d'harmonisation maximale ne permettent pas de mieux-disant ; ce sont des règlements qui ne disent pas leur nom. Mais du moins, les négociations semblent avancer assez vite, ce qui était aussi un engagement de la Commission pour mettre en oeuvre sa stratégie numérique, et nous pouvons espérer obtenir satisfaction.
Le troisième texte concerne la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur. Notre compatriote Jean-Marie Cavada, Président du Mouvement européen-France, a été nommé rapporteur de ce texte pour le Parlement européen. Je propose que Colette Mélot et moi-même le rencontrions pour recueillir son avis avant de vous présenter notre position.
Le quatrième texte est une proposition de décision sur l'utilisation de fréquences 470-790 MégaHertz dans l'Union. Jean Bizet nous l'avait soumis par procédure écrite car il ne semblait pas poser de difficulté. La proposition reprend en effet dans les grandes lignes la position des autorités nationales et s'inscrit dans la continuité du rapport de Pascal Lamy sur le sujet. Toutefois, elle semble poser des difficultés aux radiodiffuseurs. Peut-être pourrions-nous entendre un représentant de TDF pour y voir plus clair.
J'en viens maintenant aux projets à venir. Devant le Parlement européen le 19 janvier, le vice-président Ansip, en charge de la stratégie numérique, a fait des annonces concernant le calendrier d'un certain nombre de réformes. Un document vous a été distribué sur lequel je pourrai revenir si vous le souhaitez.
Je voudrais insister sur le « paquet Industrie » annoncé pour le début du mois d'avril. Il s'appuierait sur trois communications visant l'informatique en nuage avec la création d'un cloud européen, la normalisation des technologies de l'information et de la communication et enfin l'amélioration des compétences des Européens dans le numérique.
Il s'agit du volet de la stratégie européenne pour lequel, je pense, la France et le Sénat doivent être force de proposition. En effet, la Commission européenne est toujours plus prompte à réglementer qu'à laisser les États membres agir. Pourtant, on le sait bien, l'accès au financement pour le développement des start-ups reste difficile en Europe, alors qu'il est aisé sur le continent américain, voire en Asie. De la même façon, l'Union européenne ne permet pas assez aux États membres de soutenir certains secteurs ou certaines industries, là où Canadiens, Américains et Asiatiques ne se gênent pas !
L'Union européenne pourrait s'inspirer du régime qu'elle a mis en place pour les technologies clés génériques, les « kets » selon l'acronyme anglais (key enabling technologies). Il s'agit de technologies à vocation pluridisciplinaire qui peuvent produire des résultats prometteurs pour la recherche et pour l'économie en proposant de nouvelles technologies industrielles, de nouveaux services et des applications encore inédites. Elles nécessitent qu'on investisse très en amont et sur du moyen à long terme. L'Union a prévu un financement par le programme cadre de recherche et d'innovation Horizon 2020 de 6 milliards d'euros, couplé à un régime dérogatoire aux règles encadrant les aides d'État. L'Union européenne stimule la concurrence mais empêche du coup, sur des secteurs industriels stratégiques, tout interventionnisme des États nationaux. Il devient pourtant urgent d'avoir une vision stratégique et les États nationaux qui le souhaitent doivent pouvoir agir dans ce domaine qui réclame des investissements massifs. L'essentiel, dans ce régime d'aides, est de ne pas prévoir de conditions trop complexes et trop rigoureuses afin qu'il reste attractif et donc efficace.
Dans la résolution du Sénat du 30 juin 2015 pour une stratégie européenne du numérique globale, offensive et ambitieuse, nous plaidions pour une véritable politique industrielle en faveur du numérique dans l'Union européenne. Sur la base des propositions que la Commission européenne va émettre, je crois qu'il faudra travailler à préciser notre vision pour permettre à l'Union européenne de développer sa propre industrie numérique européenne. Les enjeux sont importants - or, si l'Union européenne facilite l'harmonisation du marché, elle reste, en matière de politique industrielle, en retrait. Je terminerai en en ajoutant deux : le Big Data, le traitement des données de masse, un secteur d'avenir mais qui implique qu'on s'y intéresse aujourd'hui, et la régulation des plateformes dont on voit qu'elle est nécessaire et dont Colette Mélot va vous parler.

C'est en effet un sujet que je voudrais aborder avec vous car il est au coeur d'une interrogation que peut susciter le projet de loi pour une République numérique qui a été transmis au Sénat : faut-il légiférer sur le numérique au niveau national ou au niveau européen ? Faut-il réguler les plates-formes au niveau national ou au niveau européen ?
Comme vous le savez peut-être j'ai été nommée rapporteur de la commission de la culture sur ce projet de loi et m'y suis donc intéressée de près. En premier lieu, le texte consacre la neutralité d'Internet déjà approuvée au niveau européen. Il charge l'ARCEP, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de veiller au respect de cette règle.
Autre apport majeur, la définition des plates-formes et l'instauration d'une obligation de loyauté. Qu'est-ce que cette obligation ? C'est celle de « délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente ». Il s'agit donc simplement d'une obligation d'information, somme toute peu contraignante. Mais elle marque le début d'une régulation des plates-formes dans notre pays.
Pour certains comme le président de l'ARCEP, Sébastien Soriano, il s'agit d'une erreur et la régulation de ces plates-formes devrait se faire uniquement au niveau européen. On peut pointer deux risques inhérents à une réglementation uniquement nationale. Le premier tiendrait à un manque d'efficacité - comment imposer une obligation à une entreprise qui n'est pas sur le sol français ? Deuxième risque, l'obligation ne s'appliquerait finalement qu'aux entreprises françaises, voire européennes et briderait leur développement face aux géants de l'Internet américains.
Lorsque nous avons entendu Alexandre Tisserant, directeur-adjoint du cabinet d'Axelle Lemaire, secrétaire d'État chargée du numérique, celui-ci a fait valoir plusieurs arguments qui, je crois, ne sont pas tous en contradiction avec l'idée d'une régulation européenne.
Tout d'abord, il y a l'argument juridique : le règlement « Rome I » fixe des règles à l'échelle de l'Union européenne pour déterminer la loi nationale applicable aux obligations contractuelles en matière civile et commerciale impliquant plusieurs pays. Pour le Gouvernement, en application de ce règlement, l'obligation de loyauté s'appliquerait aux plates-formes dont les services sont employés par les consommateurs français, quel que soit le pays où elles ont leur siège.
Ensuite, le cabinet de la ministre estime cette obligation de loyauté assez faible. Qu'une entreprise ait obligation d'informer le consommateur ne devrait pas l'empêcher de se développer.
Enfin, et c'est je crois l'argument le plus important, l'adoption d'une loi française ne va pas nécessairement à l'encontre de l'adoption d'une réglementation européenne sur les plates-formes. Des échanges entre la Commission européenne et le ministère, il ressort que cette dernière envisage de définir les plates-formes et de leur imposer des obligations. Nous pouvons nous en réjouir. Mais elle regrette que la France n'ait pas attendu qu'elle le fasse. Face à quoi le Gouvernement fait valoir deux arguments. Le premier tient au délai d'adoption d'un texte européen. La phase de consultation publique ne s'est terminée que le 6 janvier 2016. Il faut désormais que la Commission rédige une proposition qui sera soumise au Conseil et au Parlement européen. En pratique, le futur texte n'entrera en vigueur que dans quatre ou cinq ans. Pour le ministère, il sera toujours temps, alors, d'adapter la loi française s'il le faut. Deuxième argument, l'influence de la France dans l'élaboration de la future réglementation européenne. Le ministère estime qu'il sera plus facile de peser dans la discussion si la France dispose d'une loi déjà en vigueur.
Ces arguments me paraissent fondés. Nous déplorons tous le temps que peut prendre l'adoption d'une directive ou d'un règlement européen. J'évoquerai dans un instant celui sur la protection des données. Et nous constatons régulièrement les difficultés qui existent déjà avec les plates-formes en ligne.
Tout le monde a en tête la protection des données pour laquelle la loi sur la CNIL de 1978 avait fortement inspiré le règlement européen de 1995. La France peut montrer l'exemple. J'émettrai simplement une réserve sur l'influence réelle de notre pays. À la commission des affaires européennes, nous sommes bien placés pour constater que l'influence française est en baisse dans une Europe à vingt-huit.
Au plan économique, le problème ne tient pas uniquement à la réglementation. Comme l'a rappelé André Gattolin et comme nous l'a dit ici même le Président de l'ARCEP, nous ne nous donnons pas les moyens, au niveau européen, de faire émerger des acteurs susceptibles de concurrencer les grands groupes américains. Là est le problème. Il nous manque une politique industrielle européenne en faveur du numérique.
Je reviens à la protection des données personnelles. Là aussi, le projet de loi présente des avancées. Toutefois, la rédaction de certaines dispositions diverge du projet de règlement européen. Ce dernier a fait l'objet d'un compromis en janvier dernier entre les institutions européennes. Il devrait - le conditionnel est important ! - être adopté par le conseil Justice et Affaires intérieures le 21 avril prochain et par le Parlement européen réuni en séance plénière à la même période.
Le cabinet d'Axelle Lemaire nous a assurés que des amendements au projet de loi sont d'ores et déjà prévus au cas où le règlement serait adopté. Ils pourraient être introduits lors de la discussion en séance publique au Sénat, qui débutera à la fin du mois d'avril. C'est le cas des dispositions concernant le droit à l'oubli pour les mineurs. Le projet de loi suit la logique du projet de règlement, mais il faudra adapter le premier en fonction de la rédaction finale du second.
Bien que l'on puisse se demander pourquoi le projet de loi ne suit pas déjà le texte du règlement, on voit que le Gouvernement n'avance pas indépendamment de l'Union européenne. Un autre exemple relatif à la protection des données personnelles en témoigne. Le projet de loi encadre la « mort numérique », c'est-à-dire le devenir des données personnelles après la mort. Cela se fait conformément à l'accord trouvé sur le règlement européen, qui avait prévu de laisser cette question aux législations nationales.
Viennent encore des dispositions concernant les pouvoirs de la CNIL, la portabilité des données ou encore le secret des correspondances sur lesquelles je pourrai revenir, si vous le souhaitez.
J'en termine par deux sujets qui occupent beaucoup le rapporteur pour la commission de la culture que je suis : le libre accès aux données de la recherche et la fouille de données, qu'on appelle, en bon français, data mining. Je précise que la commission de la culture est saisie au fond sur ce sujet.
Sur le premier point, le Gouvernement suit un mouvement déjà engagé en Europe. Le projet de loi prévoit que les publications nées d'une activité de recherche financée principalement sur fonds publics peuvent être rendues publiquement et gratuitement accessibles en ligne par leurs auteurs après un certain délai. L'embargo est à l'heure actuelle de douze mois pour la recherche scientifique, et de vingt-quatre mois pour les sciences humaines ; il passerait à six et douze mois respectivement. Ce n'est pas sans poser problème aux éditeurs. Mais ce principe figure dans les lignes directrices du programme-cadre Horizon 2020 établies en 2014 et il est déjà en vigueur en Allemagne et en Italie. Notre pays va s'inscrire dans le même mouvement.
Second point : la fouille de données et de textes. Grâce à une extraction automatisée des informations contenues dans un nombre gigantesque de données et de textes scientifiques, cette technique permet de créer une information qui ne pourrait pas être produite autrement. On est au coeur des évolutions permises par le numérique et le Big Data.
Alors qu'elle est mise en oeuvre au Canada, au Japon et aux États-Unis, cette technique n'est pas encore permise en Europe - mais le Royaume-Uni l'autorise déjà puisqu'il a modifié sa législation en ce sens dès 2014. Son régime juridique relèverait d'une exception au droit d'auteur, dont on sait qu'il devrait être réformé à l'automne au niveau européen, comme André Gattolin vous l'a dit. Cependant, un amendement a été introduit à l'Assemblée nationale pour que la loi l'autorise dès maintenant.
Mon sentiment est qu'il n'y a pas de raison d'anticiper plus que de raison car cette méthode pose de gros problèmes aux éditeurs et aux organismes de recherche. Toutefois, l'enjeu est important pour les chercheurs, qui y sont très favorables. Nous ne pouvons donc pas tourner complètement le dos à cette évolution. Si nous ne souhaitons pas créer une nouvelle exception au droit d'auteur, il faut trouver un autre moyen. Je vais donc proposer à la commission de la culture une position de compromis, fondée sur les relations contractuelles entre chercheurs et éditeurs. Je ne sais pas si cette solution sera retenue, mais je pense que notre commission des affaires européennes sera amenée à se pencher sur la question quand la réforme du droit d'auteur lui sera soumise.

Sur ce sujet, qui est au coeur de l'économie du XXIème siècle, deux mondes, là encore, s'affrontent. Un monde de l'innovation sans règles et le nôtre.

J'admire nos deux rapporteurs, aussi à l'aise sur ce sujet ardu que des poissons dans l'eau. Je m'interroge sur notre stratégie. La France, dans une Europe à vingt-huit, devient sans doute de moins en moins influente, mais pour autant, elle considère qu'en adoptant un texte, elle pourra peser sur le contenu de la directive. Cette stratégie est-elle aussi celle d'autres pays et si tel est le cas, une alliance ne renforcerait-elle pas la démarche ?

Je remercie à mon tour nos rapporteurs. Sur la question des plates-formes, le Gouvernement s'est appuyé sur notre droit de la consommation, dont il a fait son point d'entrée pour nous assurer protection. Je pense notamment à l'obligation faite aux plates-formes d'avoir un représentant physique en France, contraire au principe de liberté de service en Europe et qui risque de nous fermer aux innovations venues d'ailleurs. Ceci pour dire qu'il faut être très vigilant aux décalages qui peuvent exister entre la rédaction actuelle du projet de loi pour une République numérique et le projet de règlement européen. On ne peut pas se le permettre, ni dans les principes, ni dans les sanctions.
Il est important, en revanche, d'être actifs sur le TDM (Text and Data Mining). Nos chercheurs, qui sont au fondement de l'innovation, restent très conservateurs dans leur façon de communiquer leurs travaux. Ils se tiennent à l'écart du numérique et demeurent prisonniers de la publication en revue. Peut-être n'ont-ils pas le choix, car ce sont les éditeurs qui « labellisent » leurs travaux, mais force est de constater que les pays qui autorisent le TDM, comme les États-Unis et le Japon, sont les plus grands pays de recherche. Ceux qui le refusent se privent de l'accès à une mine de connaissances et de la possibilité de diffuser les travaux par cette voie ; c'est à côté de la plaque. Ne serait-il pas judicieux de faire évoluer notre droit d'auteur pour tenir compte du TDM, devenu indispensable à l'avenir de la recherche française ? Veillons à ne pas nous priver d'une possibilité qu'ouvre la directive. On évitera que des chercheurs talentueux n'aillent s'installer ailleurs.

À la différence de nos rapporteurs, je ne me sens pas, sur ce sujet, comme un poisson dans l'eau. Face à ces évolutions rapides, nos concitoyens ont besoin d'être rassurés. Avec le commerce électronique, par exemple, ce ne sont plus les grandes surfaces mais bien les plates-formes de vente en ligne qui sont devenues les premiers concurrents des commerces de centre-ville.
Vous n'avez pas parlé de la cybersécurité, un vrai sujet d'inquiétude, y compris pour les entreprises, attaquées de toutes parts. Voyez ce qu'il s'est passé avec la mise en place des virements Sepa par les banques. On a vu se multiplier les mails envoyés par des petits malins qui sollicitaient, sous ce prétexte, des informations confidentielles, des RIB. Les hackers sont pleins de ressources. On ne souvient de l'affaire Michelin, mais les PME sont concernées elles aussi. Il faut agir sans tarder, au niveau européen, car on a toujours un train de retard sur le piratage.

Vous évoquez le droit d'auteur, il n'est pas seul concerné. Nous sommes à la veille de voir évoluer les titres de propriété intellectuelle. Je pense aux certificats d'obtention végétale. C'est le 18 mai prochain que la présidence néerlandaise organisera une conférence sur la propriété intellectuelle. C'est un pays très en pointe sur ces questions. Jusqu'à présent, la durée des certificats était de 20 à 25 ans mais à présent que le temps économique va infiniment plus vite que le temps politique et administratif, on songe à raccourcir ce délai de cinq ans.

Merci de vos questions qui témoignent de l'intérêt que vous portez à ce sujet complexe. Comme l'a souligné Pascale Gruny, l'attente de nos concitoyens, qui se sentent souvent menacés par ces évolutions, est forte. Il y a donc urgence.
Alain Vasselle s'interroge sur la meilleure façon pour la France de peser sur la décision européenne. Des alliances sont-elles possibles ? Bien que peu de pays aient encore entrepris de légiférer sur le numérique, certains s'y sont engagés. Nous pourrions ainsi travailler de concert avec l'Allemagne, qui prévoit un texte d'ici à la fin de l'année. Ce serait une bonne chose, comme sur bien d'autres sujets, que la France et l'Allemagne prennent une position commune. Une conférence franco-allemande devrait se tenir l'été prochain à Berlin et le ministre de l'économie allemand a indiqué que le projet de loi en préparation en Allemagne comporterait trois volets : territoire ; sécurité des données - probablement sous un angle souverain, en réaction aux derniers rebondissements sur le Safe Harbor - ; établissement de la responsabilité des données pour les entreprises. Quant à l'Italie, elle a prévu un texte sur l'économie collaborative, qui va à l'encontre du droit européen.
Jean-Yves Leconte a rappelé que la France a choisi de s'appuyer sur le droit de la consommation. Nous avions voté, il y a quelque temps, une résolution à ce propos. Il faut réguler les plates-formes, nous en sommes convaincus. Il est vrai que leur faire obligation d'avoir un représentant légal sur le territoire peut poser des difficultés et risque de brider le développement des entreprises françaises. Il faut avancer en prenant en compte tous les paramètres.
Sur le TDM, un outil technique essentiel pour les chercheurs, je ne vous cache pas que ce sont les éditeurs qui résistent ; ils ne sont pas prêts à modifier leur modèle économique. Je crois qu'ils y viendront, mais il ne faut pas trop tarder. C'est pourquoi, sachant que le Gouvernement entend supprimer l'article nouveau voté à l'Assemblée nationale sur l'exception au droit d'auteur, pour ne pas anticiper sur la directive, je pense proposer, par amendement, une solution alternative, dans son attente. Une clause contractuelle entre les éditeurs et les organismes de recherche pourrait ainsi autoriser le TDM. C'est un compromis qui permettrait d'agir en attendant la directive.

Les chercheurs ne sont pas du tout hostiles au TDM, ce sont en effet les éditeurs qui s'y opposent. Or, pour le chercheur, la publication dans des revues bien accréditées est essentielle, car elle détermine son « ranking ». Il se mêle à ce processus, comme l'ont montré de nombreuses études menées aux États-Unis, beaucoup d'intérêts matériels. On publie des recherches que l'on juge porteuses, susceptibles de faire l'objet d'un vrai financement, ce qui pose un réel problème d'indépendance. Les éditeurs, qui jouent un rôle de filtre, sont vent debout contre toute exception au droit d'auteur ; on l'a vu, à la commission de la culture, lorsque l'on a travaillé sur des exceptions au droit d'auteur dans le cadre du texte sur l'enseignement supérieur et la recherche. C'est une manne qu'ils entendent conserver.

C'est proprement scandaleux, et plus encore dès lors que le financement de la recherche est public.

Absolument. Du temps que j'étais chercheur, je refusais les droits d'auteur lorsque l'on m'en proposait, considérant que j'étais payé pour publier. C'était aussi une façon d'inciter les éditeurs à faire de même et à ouvrir les données au numérique.
Je rebondis sur les interrogations d'Alain Vasselle. Est-il opportun d'aller plus vite que l'Union européenne ? Je crois que oui, dans certains cas, comme celui des plates-formes. Quand on travaille, en matière législative, dans un cadre multilatéral, on dresse toujours un état de l'art. Autrement dit, on fait le point sur les législations nationales existantes. À l'époque où le pouvoir d'influence de la France était fort, on pouvait se contenter de n'intervenir sur la décision qu'en aval, une fois le texte présenté. Mais tel n'est plus le cas, il faut travailler en amont, intervenir dans les consultations publiques et à toutes les étapes du processus d'élaboration des textes.
Ce qui importe, s'agissant des plates-formes, c'est d'obtenir plus de transparence sur les algorithmes qui, étant régulièrement modifiés par l'interaction des internautes, transforment les résultats de requête, dont l'ordre se retrouve bouleversé. Certains restaurateurs ont ainsi constaté qu'ils se trouvaient rejetés en bas de liste non du fait des consommateurs mais de concurrents malveillants qui s'évertuaient à envoyer des avis négatifs sur leurs services. Y voir un peu plus clair sur la manière dont les algorithmes fonctionnent serait une bonne chose. Attendre la directive ? Bien souvent, à force d'attendre, on se retrouve les mains liées, face au fait accompli. Lors de l'audition d'Axelle Lemaire devant la commission des finances, nous avons appris que son cabinet surveillait de près l'évolution des textes européens sur le sujet, pour essayer de s'adapter au plus juste. Mais il semble que sur les plates-formes, l'Europe reste réticente à aller vers plus de transparence : il n'est pas mauvais, dans ce cas, de chercher à influer.
La cybersécurité est en effet un enjeu important. La directive NIS, adoptée fin décembre, répond aux souhaits de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - une agence qui fonctionne fort bien et dont la mission de se limite pas à l'administration puisqu'elle joue de plus en plus un rôle de conseil auprès des entreprises. Il est vrai, cependant, que les PME-PMI sont encore peu aidées. Dans le cadre du deuxième pilier de la stratégie numérique, un texte devrait voir le jour en juin ou juillet prochain, visant à mettre en place un partenariat public-privé pour la recherche en matière de cybersécurité. Je ne suis pas un partisan inconditionnel des partenariats public-privé, mais en ce domaine, je les ai toujours préconisés car les capacités de l'État sont limitées tandis que beaucoup d'entreprises privées très qualifiées en ce domaine travaillent pour des grandes entreprises, elles-mêmes stratégiques pour notre économie.
En matière de cybercriminalité, la France dissocie clairement entre attaque et défense : c'est la DGSI (direction générale de la sécurité intérieure) qui est en charge des attaques, et l'ANSSI qui est chargée de la protection. Bien des pays considèrent ce modèle avec intérêt.
L'enjeu est loin d'être négligeable, ainsi que cela a été rappelé lors du dernier sommet de Davos ; si l'on ne fait rien, on va au-devant de grandes difficultés. En effet, si les gouvernements et les entreprises ne prennent pas de mesures adéquates, les cyber-attaques pourraient entraîner une perte pouvant aller jusqu'à 3 000 milliards de dollars d'ici à 2020. Et les grandes entreprises ne sont pas seules concernées. Une PME de vingt personnes peut être amenée à traiter des dizaines de millions de données personnelles. Si ces données sont détournées, l'impact peut en être énorme et sur nos libertés et sur le dynamisme de notre économie. Nous avons beaucoup insisté là-dessus ces dernières années, et cela a porté ses fruits puisqu'un texte devrait voir le jour d'ici à l'été.

Merci pour ces échanges sur un sujet qui n'a pas fini de nous occuper. Nous verrons quelle sera l'évolution du projet de loi pour une République numérique.

Nous allons maintenant entendre un point d'actualité sur les questions agricoles. Je suis d'autant plus reconnaissant à nos deux collègues d'avoir accepté une interversion dans notre ordre du jour que Patricia Schillinger était contrainte de nous quitter et de laisser le soin à Pascale Gruny de faire seule cette communication.
Il n'est pas besoin de souligner la très grande actualité de ces questions tant les légitimes préoccupations de nos agriculteurs et éleveurs se sont exprimées dans nos territoires au cours des derniers mois. Les filières porcines et laitières ont été particulièrement concernées.
La communication de ce jour est naturellement centrée sur la dimension européenne de ces questions qui ont aussi des aspects qui relèvent directement des États membres, dont la France. Pour ma part, il me semble que les instruments européens, en particulier les lignes budgétaires, devraient être utilisés pour oeuvrer à la modernisation des structures agricoles. Le deuxième pilier de la PAC offre des possibilités qu'il faut exploiter. Les régions ont, dans ce domaine, une responsabilité clé. C'est un message à envoyer aux présidents de régions alors qu'elles prennent toute leur dimension économique.

Nous renouvelons, à travers ce point d'actualité, une expérience de l'année dernière. Il n'y a ni texte à examiner, ni projet en préparation, mais seulement une difficulté sur un secteur et un débat public autour d'une situation de crise.
Nous avons choisi de nous concentrer sur deux filières, même si nous n'ignorons pas que d'autres sont dans l'inquiétude : la filière porcine et la filière laitière, en respectant évidemment les compétences de notre commission, c'est-à-dire en privilégiant les aspects européens.
La filière porcine engage deux sujets, le marché et le contentieux lancé contre l'Allemagne.
Le marché du porc est en pleine restructuration. La mise aux normes s'est accompagnée d'investissements de capacité dans la plupart des pays. Les deux dernières années sont marquées par une hausse de production qui vient surtout des deux grands leaders européens, l'Allemagne et l'Espagne. La France est encore le troisième producteur mais est talonnée par la Pologne. Beaucoup de pays sont dans une stratégie offensive.
Du côté de la demande, la consommation interne est atone. La baisse de la consommation de porc, plus faible que celle de la viande bovine, mais de 1 % par an tout de même, est à peine compensée par une augmentation de la population. La demande externe a été bouleversée par l'embargo russe, même si globalement le marché asiatique a pris le relais.
La France est dans une situation décalée : la production augmente, sauf en France ; les exportations se tiennent, sauf en France.
Trois points méritent une attention particulière. Quid, tout d'abord, de l'engagement sur un prix d'achat de 1,40 euro le kilo ? On se souvient que, pendant l'été, les GMS (grandes et moyennes surfaces) avaient pris l'engagement d'acheter à ce prix minimum. Cet engagement n'a pas été tenu. À notre grande surprise, nous avons appris, lors de nos auditions, que cet accord avait été dénoncé autant par les acheteurs, les GMS, que par les producteurs. Ils nous ont expliqué pourquoi. La filière porcine est complètement ouverte. Il y a des flux dans les deux sens. On importe autant qu'on exporte. Car on est déficitaire sur certains produits - le jambon, par exemple -, et on exporte ce que l'on ne consomme pas : les abats et la graisse en Russie, les oreilles et les pieds en Chine. Le marché est très concurrentiel. En fixant un prix de 1,40 euro, au-dessus des cours européens, les producteurs se déconnectaient du marché mondial. Ils ne pouvaient plus vendre à l'extérieur. Ni en Europe, ni hors l'Europe.
Cet aspect du marché était loin des préoccupations de Leclerc et Intermarché, principaux signataires de l'engagement de 1,40 euro, car ils sont très peu présents à l'export. Les grands abatteurs, en revanche, tels que Bigard par exemple, se sont vite rendus compte qu'ils ne pouvaient pas tenir ce prix. Bigard s'est ainsi retiré du marché au cadran, et a préféré se tourner vers le gré à gré.
Avec cet engagement, les producteurs prenaient le risque de perdre non seulement les marchés extérieurs, mais aussi le marché au cadran qui est un point de référence déterminant pour la profession. C'est pourquoi, d'un commun accord, entre acheteurs et producteurs, l'engagement de 1,40 euro a été levé. Une sérieuse leçon pour l'avenir. On croit à une bonne idée et, pour finir on se rend compte, à l'expérience, que les effets pervers l'emportent. Il faut d'ailleurs préciser que l'engagement sur un prix de vente est un peu illusoire, car tout dépend du prix de revient - en l'espèce du prix des intrants, de l'alimentation animale.
Se pose, ensuite, le problème de l'embargo sanitaire décidé par la Russie après la découverte d'un cas de peste porcine africaine sur un sanglier en Lituanie. Tout le monde convient que le fondement sanitaire est très léger et que les règles commerciales internationales n'empêchent pas d'avoir des échanges régionaux, qui devraient permettre la reprise des exportations françaises.
Notre président a eu plusieurs échanges avec la Commission européenne mais cela n'avance guère. Nous avons eu deux explications différentes. La première est que les Russes seraient prêts à reprendre les importations régionales, à l'exception des pays Baltes, de la Pologne, et des pays limitrophes. Mais il y aurait un blocage de la Pologne et de l'Allemagne car aucun ne veut que la Russie reprenne ses échanges sans eux. La Commission ne peut qu'enregistrer. Une autre explication veut que les Russes s'amusent à organiser des rivalités et n'ont aucune intention de lever l'embargo. Il y a un contentieux en cours à l'OMC mais les Français savent que, si les Russes perdent, ils feront de toute façon appel. On est au point mort.
Vient, enfin, la question du stockage privé. Pour alléger le marché, la Commission a ouvert les possibilités de stockage privé. Je rappelle qu'il n'y a pas de stockage public sur le porc. Dans le cas de stockage privé, l'opérateur s'engage simplement à ne pas vendre les carcasses pendant une durée allant de 90 à 120 jours.
Les Français sont très peu présents sur le stockage privé. Il y a une raison technique à cela. Nous sommes peu équipés en enceintes de congélation. En France, on consomme du porc frais. Il n'y a pratiquement pas de délai entre l'abattage et la consommation. Les pays orientés sur le grand export sont beaucoup plus équipés. Mais il y a aussi une raison stratégique. Le stockage privé est très lié à l'exportation. Il y a des pays qui ont une stratégie d'export, dans une logique de partenariat de long terme avec des opérateurs internationaux. C'est beaucoup moins le cas des producteurs français, qui font du coup par coup et considèrent l'export comme un marché de dégagement. Quand un client extérieur disparaît, comme c'est le cas des Russes, les Français sont un peu désemparés. Les Allemands ont doublé leurs exportations porcines en Chine. Les Espagnols les ont augmentées de 70 %. Les exportations françaises sont restées marginales.
J'en arrive au deuxième sujet d'actualité, le contentieux TVA avec l'Allemagne. C'est le deuxième contentieux, initié par les professionnels de la filière porcine, contre ce qu'ils considèrent comme une concurrence déloyale de la filière allemande.
Le premier remonte à 2012 et concernait le recours abusif aux travailleurs détachés dans les abattoirs. En 2013, l'Allemagne a adopté le principe d'un salaire minimum - conformément à un engagement politique du gouvernement de coalition CDU/SPD, mais qui répondait aussi à la demande de la filière, et a éteint le litige.
Cette fois, le contentieux porte sur l'application de la TVA. Le dossier nous paraît beaucoup mieux préparé que le précédent. Les opérateurs appliquent une directive du Conseil de 2006 relative au système commun de TVA, dite directive TVA. Cette directive prévoit que les États peuvent adopter un régime particulier - en fait un régime forfaitaire, pour les producteurs agricoles « pour lesquels l'assujettissement au régime normal se heurterait à des difficultés particulières ». Ces conditions sont définies par les États. La France a choisi un seuil objectif, lié au chiffre d'affaires. Le forfait s'applique aux très petites entreprises qui réalisent moins de 46 000 euros de chiffre d'affaires. C'est clair. L'Allemagne, en revanche, a choisi un critère lié au chargement, c'est-à-dire au nombre d'animaux par exploitation, avec des différences selon les tailles d'exploitation. L'idée est de privilégier les élevages extensifs sans pénaliser les très petites exploitations qui ont des taux de chargement supérieurs.
Trois problèmes peuvent être identifiés. Il faut reconnaître, en premier lieu, que la directive est ambigüe. Un régime de forfait peut être justifié « en cas de difficultés particulières ». De quelles difficultés s'agit-il ? Spontanément on pense aux difficultés administratives. Les procédures sont lourdes pour de très petites structures ; c'est l'interprétation française. Mais chaque État peut avoir son interprétation. Ce point nécessiterait d'être éclairci lors de la révision de la directive TVA.
Deuxième problème, ce mécanisme de forfait ouvre la voie à des systèmes d'optimisation fiscale. Un éleveur peut diviser son exploitation en autant d'unités qui lui permettent d'être au forfait. Ensuite, les Français ont mis en évidence des montages juridiques qui permettent de jouer sur les différenciations de taux. C'est ce qu'on appelle « le carrousel du porc ». Un éleveur fait du naissage/engraissage, mais entre les deux, il crée une structure intermédiaire de commercialisation. Il vend en facturant au client - lui-même - 10,7 %. Sa structure de commercialisation revend à un engraisseur - toujours lui - qui paye 7 % sur ses achats et qui va revendre à 10,7 %. L'État rembourse le différentiel. L'avantage fiscal peut aller jusqu'à 2 euros par porc. Cela peut paraître peu mais représente 15 000 euros pour une exploitation moyenne de 7 000 porcs. Je tiens les détails de ce dossier à votre disposition.
Troisième problème, sans doute le plus important car c'est celui qui est le plus surveillé par la Commission : ce système est encouragé par les pouvoirs publics. La Commission ne peut pas être insensible aux détournements de TVA, qui constituent incontestablement un avantage concurrentiel. La fédération des producteurs indique que sur le site des chambres de commerce allemandes, on trouve même de la publicité pour l'optimisation fiscale. C'est hallucinant ! Ce dossier sera à suivre avec beaucoup d'attention.
J'en viens à l'actualité de la filière laitière, que je vous présenterai au nom de Patricia Schillinger. Il y a un peu moins d'un an, nos collègues Michel Raison et Claude Haut faisaient le point sur la situation du secteur, au moment du grand tournant de l'abandon des quotas laitiers. Où en est-on un an après ?
Il y a un point commun avec la filière porcine. Le marché laitier est dans une situation de surproduction, liée à la libéralisation du marché et aux stratégies de développement de certains États membres. Globalement, tous les grands pays laitiers ont augmenté leur production, de façon mesurée - 5 % en Allemagne -, ou plus nettement - le Danemark et l'Irlande affichent ainsi une croissance de plus de 10 %. La France fait figure d'exception, puisque nous sommes le seul pays, avec l'Italie, à avoir une production pratiquement égale à celle de l'année dernière. Mais les réserves d'un seul pays ont peu d'effet quand tous les autres sont dans une stratégie différente. Je reviendrai sur ce point.
Il y a donc eu une augmentation de la production. Avec, en face, quelques désillusions sur le marché mondial. La fameuse demande chinoise qui devait tirer le marché n'est pas au rendez-vous.
Il s'agit d'une configuration du marché très classique qui entraîne un niveau de prix très déprimé. Le prix du lait est à 29 centimes le litre, début 2016, soit 10 centimes de moins qu'il y a deux ans. La baisse est de 8 % en 2015, en France comme dans la moyenne de l'Union. Cette situation est même assez nouvelle, car en général, notre système de contrats amortit les baisses de prix. Mais cette année, ce n'est pas le cas.
Cette situation est très compliquée pour nos éleveurs car cette baisse se produit dans un contexte de grande incertitude. Nos collègues l'avaient bien décrit dans leur rapport : les quotas laitiers avaient surtout pour mérite d'équilibrer la production laitière, de permettre une production dans presque toutes les régions. Sans les quotas, cette répartition est compromise. Personne ne veut le dire aussi clairement, mais c'est bien l'un des ressorts de la crise actuelle. Le contexte est donc éminemment anxiogène.
Autre élément d'incertitude, l'impression d'être dépassé, de subir le marché, sans aucune marge pour agir. Le marché chinois est tout de même un peu abstrait pour les éleveurs normands. De même, à quoi sert de restreindre nos productions si nos partenaires augmentent les leurs ?
C'est dans ce contexte qu'il faut analyser les résultats du Conseil Agri du 14 mars. Voilà plusieurs mois que la France mettait la pression sur les autres États membres et sur la Commission pour obtenir une évolution au niveau européen. Je passe rapidement sur l'illusion encore portée par quelques éleveurs quant au retour des quotas et à la hausse du prix d'intervention. Le commissaire européen a toujours été clair là-dessus.
La Commission a d'abord décidé de relever les volumes d'intervention, c'est-à-dire le stockage public, mais les Français sont assez peu présents dans ce domaine. Les Belges, par exemple, ont trois fois plus recours à l'intervention que les Français.
Il fallait autre chose et cette autre chose a été trouvée dans le règlement OCM (organisation commune des marchés) unique, plus précisément son article 222, qui prévoit qu'en cas de déséquilibre grave du marché, l'application des dispositions du traité relatives au droit de la concurrence peut être suspendue. Les organisations de producteurs et les organisations professionnelles peuvent conclure des accords pour stabiliser le secteur concerné. En d'autres termes, il s'agit ni plus ni moins de reconnaître les ententes temporaires entre producteurs. Les détails doivent être précisés dans un acte d'exécution de la Commission, attendu pour avril.
Pour un observateur extérieur, cette mesure passe un peu inaperçue. Pour les connaisseurs des institutions et du droit européen, elle est au contraire extrêmement importante. D'abord parce que la Commission reconnaît qu'il y a bien un « déséquilibre grave sur les marchés ». Cette notion, pas plus que celles de « perturbation du marché » et de « problème spécifique » auxquelles il est fait référence dans le règlement OCM unique, n'est définie et relève donc de la seule appréciation de la Commission qui, en l'espèce, reconnaît la gravité de la situation.
Cette mesure est importante, ensuite, parce que la Commission envisage une exception à ce qui fait le socle du droit européen, à savoir le droit de la concurrence. Notre président a travaillé sur cette question, il y a trois ans, dans un rapport intitulé La PAC et le droit de la concurrence, qui faisait le point sur ce qu'il est convenu d'appeler « l'exception agricole ». Le principe est que les règles de la concurrence - qu'il s'agisse des accords d'entreprises, de l'abus de position dominante ou du contrôle des concentrations - s'appliquent à tous les marchés et tous les produits. Il y a une exception en matière agricole. Plus particulièrement, les accords et les ententes sont autorisés dans certains cas.
C'est ce que les juristes ont défini comme « l'exception agricole », qui a en effet été appliquée au début de la PAC. Mais le rapport montre bien que progressivement, les règles de concurrence se sont imposées et que les exceptions se sont réduites comme peau de chagrin. La Cour de justice a estimé que les dérogations au droit de la concurrence n'étaient justifiées que si tous les objectifs de la PAC étaient favorisés. Or, comme ces objectifs sont un peu contradictoires, les dérogations n'étaient jamais acceptées.
Jusqu'à très récemment, les entorses au droit de la concurrence étaient de plus en plus rares. Puis est venue la crise laitière. Les règles relatives aux organisations de producteurs introduites en 2012 avaient constitué un premier pas, avec une dérogation implicite au droit des ententes, puisque les OP peuvent négocier les contrats pour le compte de leurs adhérents. Le recours à l'article 222 va encore plus loin puisqu'il prévoit, cette fois, une dérogation explicite au droit commun de la concurrence. On peut imaginer qu'en interne, les discussions doivent être vives entre DG agri et DG concurrence pour préparer l'acte d'exécution.
Il faut reconnaître que les éleveurs français auraient préféré une mesure administrative générale - de type quota laitier peut être ! - mais le choix s'est porté sur une entente volontaire. Comme je l'ai dit, c'est un pas symbolique et politique très important de la part de la Commission. Pour la petite histoire, je peux aussi rappeler que cet article a été introduit par le Parlement européen. Cette disposition ne figurait évidemment pas dans la proposition initiale de règlement OCM unique présenté par la Commission.
C'est maintenant aux professionnels de s'organiser. La mesure n'aura d'efficacité que si elle regroupe les producteurs et organisations de producteurs de plusieurs pays. On conviendra que s'entendre tout seul n'a pas beaucoup d'effet !
Les premiers échos ne sont pas très optimistes. Peu d'États ont des OP et les OP peuvent-elles s'entendre entre elles ? On retombe sur les stratégies différenciées des pays. Un observateur nous confiait d'ailleurs que l'Allemagne avait soutenu la France, en pensant que les producteurs allemands ne participeraient pas à ces ententes. C'est néanmoins un geste fort de la Commission et c'est aux professionnels de se regrouper.
Pour l'instant, l'action européenne a porté sur le plan juridique. Il me faut évoquer également le volet budgétaire. Je rappelle que trois outils sont susceptibles de soutenir la restructuration du secteur. D'abord, les régions ont la maîtrise du deuxième pilier, parfaitement adapté aux mesures de structure. Ensuite, le plan Juncker peut être mobilisé. C'est désormais acquis. Le commissaire européen a donné des garanties - même si ce n'est pas la Commission qui décide des opérations - et deux pays, la Finlande et la Pologne, ont déjà déposé des dossiers agricoles. Enfin, il y a toujours une réserve de crise. La Commission a reconnu un « déséquilibre grave de marché », mais pas « une crise ». Et puis cette réserve touche cette fois au budget et je ne suis pas sûre que nos alliances avec l'Allemagne tiendraient longtemps.
Je me suis concentrée sur la partie juridique car c'est elle qui a le plus avancé. Mais les deux leviers doivent être surveillés.

Merci pour cette communication sur deux filières qui ne sont pas seules à connaître des difficultés. La filière élevage dans son ensemble et la filière céréalière qui l'alimente ne se portent pas bien non plus. On peut avoir des appréciations divergentes sur l'ampleur de la crise mais au-delà, c'est bien à une mutation que ces filières sont confrontées.
Sur la filière porcine, je n'ai pas le sentiment que l'Allemagne tienne à voir menée une expertise. Les deux syndicats respectivement majoritaires, en France et outre-Rhin, ne se parlent pas. Preuve que lorsque le couple franco-allemand ne marche pas, on n'avance pas.
Quant aux quotas laitiers, nos éleveurs ne se sont toujours pas faits à leur disparition. Ils ne souhaitent qu'une chose, les voir rétablis. Or, la limitation des productions décidée lors du Conseil agriculture du 14 mars suppose que tous les pays soient vertueux. Si seuls la France et l'Italie le sont, les autres s'engouffreront dans la brèche. Lorsqu'en 2009, la production française est restée en deçà, de 4 % ou 5 %, ces parts de marchés ont immédiatement été prises par d'autres, dont l'Allemagne, et on ne les a jamais récupérées depuis.
Nous restons, en France, dans une opposition binaire entre deux modèles agricoles, si bien que l'on ne parvient pas à engager la mutation de certaines filières. D'autre pays, considérant qu'il existe des modèles plus productivistes, qui doivent cohabiter avec les autres, ont pourtant su s'engager dans une évolution. On le voit dans la production de lait bio. Dans la Manche, les producteurs, qui y gagnaient très bien leur vie, faisaient du prosélytisme pour que d'autres s'y engagent. Ils ont cessé quand ils ont compris que leurs prix étaient liés à une niche qui, à trop s'agrandir, finirait par s'écrouler. Ils commencent à accepter l'idée que les modèles doivent coexister.

Quelle imagination pour frauder ! Cela nous ramène au débat de tout à l'heure sur la concurrence fiscale. « Concurrence libre et non faussée », a-t-on inscrit dans les traités, mais tout est fait pour que les choses se passent à l'inverse ! Sur ces filières, où l'Allemagne est le premier producteur, il se crée des montages qui ne visent à rien d'autre qu'à l'optimisation fiscale, comme dans la finance. On crée des entités séparées, naissage d'un côté, engraissage de l'autre, et le tour est joué. Un tel écart entre les valeurs affichées et ce que les gens vivent ne peut que créer un malaise. C'est aussi affligeant que le scandale des lasagnes à la viande de cheval, en 2013. On transite d'ailleurs par les mêmes territoires, par Chypre, par Malte. La Commission envisage-t-elle de prendre des mesures pour contrer l'optimisation ?

Une plainte a été déposée. La Commission européenne a vraiment pris les choses à bras le corps. Le souci vient de l'ambiguïté de la directive TVA. En France, le forfait est chiffré, c'est objectif, tandis qu'en Allemagne, les choses sont beaucoup plus floues. Dès lors que les règles fiscales sont imprécises, elles ouvrent la voie à l'optimisation. Il faudrait que les pouvoirs publics allemands s'en soucient, car il y a véritablement concurrence déloyale. Cela dit, grâce aux éléments factuels qui ont été réunis, une plainte a pu être déposée auprès de la Commission, qui est enfin à l'écoute. Vous avez raison de rappeler aux valeurs car quand il s'agit d'argent, elles ont tendance à disparaître.

Nous ne pourrons pas faire l'économie d'une restructuration dans un certain nombre de filières. Entre les fonds du deuxième pilier, le plan Juncker, les crédits de la Banque européenne d'investissement et la réserve de crise, nous disposons d'une palette d'instruments financiers, mais il faut aussi que la profession agricole fasse son évolution. Il s'agit d'en finir avec cette opposition binaire qui prévaut encore en France. Je vous remercie de suivre ces questions, qui sont au coeur de nos territoires.
La réunion est levée à 10 h 55.