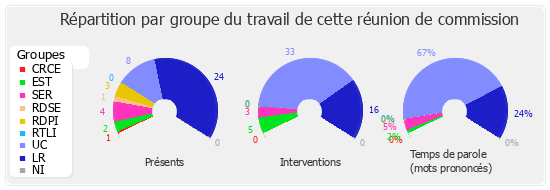Commission des affaires économiques
Réunion du 9 décembre 2014 : 1ère réunion
Sommaire
- Transition énergétique pour la croissance verte
- Audition de mme marylise léon secrétaire nationale de la confédération française démocratique du travail cfdt responsable de la politique du développement durable des politiques industrielles de la recherche de l'enseignement supérieur et de la coordination en matière de rse (voir le dossier)
- Audition de m. jacky chorin représentant de la confédération force ouvrière - membre du conseil économique social et environnemental (voir le dossier)
- Audition de m. alexandre grillat secrétaire national au secteur « développement durable logement rse et énergie » de la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres cfe-cgc (voir le dossier)
- Audition de mme marie-claire cailletaud responsable de la politique énergétique et industrielle à la fédération nationale des mines et de l'énergie - confédération générale du travail fnme-cgt (voir le dossier)
- Nouvelle organisation territoriale de la république
La réunion
Transition énergétique pour la croissance verte
Audition de Mme Marylise Léon secrétaire nationale de la confédération française démocratique du travail cfdt responsable de la politique du développement durable des politiques industrielles de la recherche de l'enseignement supérieur et de la coordination en matière de rse
La réunion est ouverte à 14h30.

Notre président, Jean-Claude Lenoir, est à Lima, pour la Conférence sur le climat. Mme Marylise Léon va nous présenter la position et les propositions du syndicat CFDT sur le projet de loi relatif à la transition énergétique pour une croissance verte.
Vous êtes, à la CFDT, en charge de la négociation sur la réforme du dialogue social, mais vous suivez également la transition énergétique. En quoi ce projet de loi favorise-t-il la compétitivité des entreprises, la création d'emplois, nos futures industries d'excellence et la croissance de nos territoires ? Ce texte apporte-t-il une vraie réponse à ceux de nos concitoyens qui, de plus en plus nombreux, ont des difficultés pour régler leur facture d'énergie ?
Dominique Olivier, secrétaire confédéral chargé du développement durable, sera heureux de répondre également à vos questions. Cela fait plusieurs années que la CFDT s'est investie dans une réflexion sur la transition énergétique, à l'occasion des conférences environnementales ou dans les débats publics et citoyens organisés sur la question. Nous ne nous contentons pas de réfléchir aux conséquences qui résulteront des choix économiques et environnementaux liés à la transition énergétique. Pour nous, la question est d'abord sociale et nous la posons en termes d'emplois et de transition professionnelle. Nous évaluons l'impact des options proposées sur la vie quotidienne des salariés - la qualité des logements, les transports, les ressources énergétiques. Lors de notre dernier congrès, nous avons clairement affiché notre ambition de travailler sur cet enjeu : comment agir collectivement pour aborder cette mutation tout à la fois économique, financière, sociale et environnementale ? Nous ne ferons pas rimer croissance et réduction de la consommation d'énergie sans mener une réflexion nouvelle. Nous proposons de centrer cette réflexion sur la qualité - celle de notre travail, de notre cadre de vie, de l'écosystème, du fonctionnement démocratique et du dialogue social.
La diversification des modes de production pour renforcer notre efficacité énergétique nous paraît un bon choix. Nous le soutenons, car il est en phase avec les engagements défendus par la Confédération européenne des syndicats et par la Confédération syndicale internationale. Diviser par deux notre consommation d'énergie à l'horizon 2050 est une obligation qui n'implique pas forcément la décroissance. Ce n'est pas une punition ! Produire et consommer autrement est possible, en s'appuyant sur l'intelligence et l'innovation. L'économie circulaire consiste à trouver les meilleures approches pour produire à moindre coût et sans gaspillage des ressources rares. Il manque un objectif intermédiaire dans les prévisions de réduction de la consommation d'énergie à l'horizon 2030. Une diminution de 20 % à 2030 ne suffira pas : elle implique un effort énorme entre 2030 et 2050. La sobriété précède l'efficacité énergétique dans l'ordre des priorités. Nous souhaitons que cette ligne soit clairement établie dans le projet de loi, ce qui est loin d'être le cas.
On a l'habitude de brandir un chiffre totem dans les discussions sur la part du nucléaire dans la production d'électricité. Fixer l'objectif à 60 % en 2030, voilà ce qui nous paraît plus réaliste. Il faudra nous préparer à la fermeture d'un certain nombre de centrales. En l'état actuel, le dialogue social ne permet pas d'envisager de tels changements. La transition professionnelle reste à aménager pour les personnes dont l'emploi risque d'être menacé - non statutaires, sous-traitants ou prestataires. La mobilité est une piste.
Nous ne pouvons que nous interroger sur la disposition qui prévoit de définir un prix compétitif pour les énergies renouvelables (EnR). La philosophie de l'économie circulaire consiste à faire reculer la consommation d'énergie, jusqu'à pouvoir idéalement s'en passer. À quoi servirait-il donc de fixer un prix compétitif ? La modulation du tarif d'achat des EnR en fonction d'un prix de marché et d'un complément de rémunération nous convient. Mieux vaut encourager l'investissement plutôt que la rente. Nous sommes particulièrement favorables à la participation des collectivités territoriales et des citoyens au capital des sociétés produisant ces énergies. Quant aux dispositifs relatifs aux concessions hydroélectriques, ils sont insatisfaisants, voire dangereux.
Il nous paraît important de faciliter les opérations de rénovation thermique des logements, tant pour le diagnostic que pour la qualité des prestations ou pour le financement. Le projet de loi y contribue, en installant des plateformes territoriales et en prévoyant un certain nombre de subventions ou d'incitations fiscales. Nous soutenons l'obligation de travaux. Nos concitoyens gagneront en confort et en hygiène, les factures d'énergie baisseront et l'on préviendra mieux les risques domestiques. Des interrogations demeurent sur le cadrage des guichets uniques. Un renforcement des structures décentralisées - et des moyens - de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) est souhaitable. Nous sommes également favorables à un fléchage d'une partie des certificats d'énergie sur la résorption de la précarité énergétique.
Une réflexion sur les besoins de mobilité, donc sur l'organisation du travail - notamment, le développement du télétravail - s'impose pour faire baisser la consommation d'énergie liée aux transports. La mise en place de transports collectifs adaptés est une autre piste. Elle pourra être négociée dans le cadre des plans de déplacement intra- ou interentreprises. Enfin, la transition professionnelle est déjà en cours dans certaines régions, comme l'Ile-de-France ou le Nord-Pas-de-Calais. Des expériences y ont été menées pour créer quelques milliers d'emplois autour d'un objectif d'efficacité énergétique. Lors du Grenelle de l'environnement, nous proposions déjà d'établir, au sein des branches professionnelles, un diagnostic partagé, sur les emplois touchés et sur l'évolution des métiers, afin d'anticiper les évolutions de compétences nécessaires. Des négociations collectives dans les filières professionnelles sont à articuler avec les réflexions concernant les territoires. On pourrait adjoindre aux schémas régionaux climat-air-énergie, un volet emplois-compétences-formation pour anticiper les évolutions de métiers. On optimiserait ainsi l'efficacité énergétique, tout en créant des emplois nombreux et de qualité.

Le seuil des 60 % qui devrait, selon vous, définir la part du nucléaire dans la production d'électricité en 2030 est-il le résultat d'une analyse scientifique ? Vous nous avez fait part de votre inquiétude sur le devenir des emplois dans la filière du nucléaire. Je crois que vous aviez été plus explicite, lors de votre audition par la commission homologue de l'Assemblée nationale. Pourriez-vous nous en dire plus sur les difficultés de reclassement auxquelles les salariés du nucléaire risquent d'être confrontés ? Comment encourager le recours aux EnR thermiques - réseau de chaleur renouvelable, méthanisation, biogaz ? Ces énergies ont l'avantage d'être permanentes, et elles peuvent se développer partout sur le territoire.

L'objectif affiché d'une baisse de la consommation d'énergie ne doit pas obérer l'évolution nécessaire de la croissance : c'est là une position intéressante, à laquelle on devrait davantage faire écho. La Confédération européenne des syndicats, à laquelle vous participez, a certainement mené une réflexion sur la transition professionnelle - sujet douloureux en Allemagne, où s'est opéré un passage brutal du nucléaire au charbon. Comment éviter de faire les mêmes erreurs ? Enfin, quel regard portez-vous sur le stockage énergétique, question essentielle dans le développement des EnR ?

Disposez-vous de statistiques sur le nombre d'emplois créés grâce au développement des EnR et de la croissance verte ?

Il est de plus en plus compliqué d'implanter des parcs éoliens, d'utiliser la biomasse, la méthanisation, etc. Comment faciliter ces évolutions, en les rendant plus acceptables pour les populations ?
Je suis membre du Conseil national de la transition écologique (CNTE), et j'ai suivi le Grenelle de l'environnement depuis son début. J'ai également participé aux travaux de la Conférence européenne des syndicats sur l'ensemble de ces sujets.
Nous avons défini le seuil de 60 % pour la part du nucléaire dans la production d'électricité, il y a une dizaine d'années, bien avant qu'on ne parle de transition énergétique. Ce repère correspond à la production de base, au « lourd » de la consommation d'électricité. Par son inertie, le nucléaire répond bien à la fourniture du volume de masse. Les énergies complémentaires alimentent les pics ou les demandes supplémentaires. Nos analyses sont datées - elles remontent à l'avant Fukushima - mais elles méritent d'être prises en compte. L'horizon 2030 laisse du temps pour conduire la transition professionnelle dans l'industrie du nucléaire. Nous savons comment fonctionnent les centrales. Nous avons conscience qu'il faudra plus de temps que ce que prévoit le texte.
J'ai dit devant vos collègues députés que les salariés titulaires de leur emploi chez EDF n'avaient pas d'inquiétude. Qu'ils soient affectés à la construction des grands barrages, à l'exploitation des mines de charbon, ou à la filière nucléaire, ils ont l'habitude de la mobilité. Un accompagnement est prévu pour prendre en compte la diversité de leurs situations familiales. Ils sont également protégés par le statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG). La pyramide des âges indique qu'une hémorragie touchera toutes les catégories de personnel de l'entreprise d'ici cinq à dix ans : 100 % des exécutants, les deux tiers de la maîtrise, 50 % de l'encadrement et des ingénieurs devront être renouvelés. C'est considérable. On aura besoin de recruter massivement, à un moment où l'arrêt d'un certain nombre de centrales et de réacteurs sera prévu à moyen terme. Quel paradoxe ! Quant aux sous-traitants, ils sont clairement menacés, et pas protégés. Certains d'entre eux trouveront une suite à leur carrière professionnelle hors de la filière du nucléaire, lâchés dans la nature sans sécurisation de leur parcours - sauf à mettre en place un repérage.
On se polarise sur le caractère intermittent des premières énergies renouvelables - éolien ou photovoltaïque - alors que les énergies marines, la biomasse ou la méthanisation apportent des solutions dans la durée. GRDF propose un scénario alternatif, qui respecte l'objectif de réduction au quart des émissions de gaz à effet de serre. J'ai visité leurs installations, près de Lille. En injectant du gaz de biomasse dans leur réseau et grâce à un enrichissement à l'hydrogène, ils créent la possibilité d'une équivalence entre l'électricité et le gaz.
La baisse de la consommation d'énergie n'implique pas forcément la décroissance. Consommer moins d'énergie, c'est solliciter davantage l'intelligence et le travail humains. La rénovation thermique, l'efficacité énergétique, sont autant d'occasions de créer de l'activité, pour des entreprises qui sont les meilleures du monde en la matière - Saint-Gobain, Schneider ou Legrand. Nous avons du potentiel. L'avenir n'est pas sombre. Ces choix n'ont rien de nouveau. Ils figuraient déjà dans un livre de 400 pages que nous avions publié au Seuil, en 1983, Le Dossier énergie de la CFDT.
Quant à la transition professionnelle, nous devons l'anticiper, l'accompagner et la sécuriser, sans attendre d'être au pied du mur pour envisager les mesures à prendre. En Allemagne, le développement de nouveaux modes de production et d'une meilleure efficacité énergétique a créé 400 000 emplois qualifiés. J'ai participé à un voyage d'études en Pologne, en Allemagne et en France. Le point faible chez nos voisins est le recours au charbon : ils ne respecteront pas les engagements de réduction des émissions de CO2. En revanche, leurs efforts en termes d'innovation et de recherche ont trouvé leur aboutissement dans la création d'entreprises performantes. J'ai visité un parc photovoltaïque de 25 000 panneaux. Ils étaient fabriqués en Chine, certes... mais avec des machines allemandes ! Dans le Nord-Pas-de-Calais, l'Observatoire régional des emplois et de la formation (réseau Carif-Oref) a évalué à quelques milliers le nombre d'emplois créés par la rénovation thermique des logements. Pour l'Ile-de-France, la direction régionale des entreprises (Dirrecte) a présenté un rapport sur les perspectives d'emplois dans ce secteur.
En favorisant le développement de l'économie circulaire et l'installation de boucles locales d'électricité - sans changement de lieu entre la production et la consommation - on éviterait le problème du stockage de l'énergie. D'autres solutions émergent, y compris pour les éoliennes en mer, capables de stocker leur propre énergie. Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a lancé des travaux d'investigation sur le sujet. Nous y participons.
Ouvrir aux collectivités territoriales et aux groupements de citoyens le capital des entreprises productrices d'énergies renouvelables est le meilleur moyen pour que chacun ait le sentiment d'un choix collectif fait dans l'intérêt général, avec un droit de regard, un contrôle et un retour sur investissement. C'est dans l'ouest de notre pays, où la citoyenneté se nourrit d'une culture particulière, que les innovations et les coopératives de production sont les plus nombreuses. Les éoliennes en mer et les hydroliennes irritaient les pêcheurs. Des mois de concertation ont abouti à un compromis pour que l'activité de pêche côtière ne soit pas trop perturbée par ces initiatives.
Quant au projet de stockage de déchets radioactifs Cigéo, il est le résultat d'un choix responsable. Il est dommage qu'il ait disparu, reparu, pour être finalement exclu du projet de loi de simplification. Les déchets sont actuellement stockés sous des hangars, non sécurisés. Il vaudrait mieux qu'ils soient enfouis à 500 mètres sous terre, dans l'argilite de la Meuse. Les obligations européennes sont claires : chaque pays doit gérer ses propres déchets sur son territoire.
La Conférence environnementale a été une occasion de débattre sur l'acceptabilité sociale des projets de développement des EnR. Une réflexion est en cours, notamment dans le cadre du Conseil national de la transition énergétique (CNTE). S'il n'y a pas de consensus, laissons le temps aux citoyens de s'approprier les projets pour qu'à défaut, il y ait au moins un consentement.

Nous entendons M. Jacky Chorin, représentant de Force Ouvrière, membre du Conseil économique, social et environnemental, et également membre suppléant du Conseil national de la transition écologique (CNTE). Votre carrière se déroule à EDF et vous êtes très impliqué dans les sujets relevant de la transition énergétique. En quoi ce projet de loi favorise-t-il la compétitivité des entreprises, la création d'emplois et la croissance de nos territoires ? Ce texte apporte-t-il une vraie réponse à ceux de nos concitoyens qui peinent à régler leur facture d'énergie ?
Le projet de loi sur la transition énergétique, même rebaptisé « pour la croissance verte », traite de points qui n'ont pas fait consensus dans le débat sur la transition énergétique. Il prévoit de réduire de 50 % la consommation d'énergie en 2050 et de réduire la part du nucléaire dans le mix électrique à l'horizon 2025. FO réaffirme son opposition à ces deux objectifs qui vont à l'encontre des besoins des citoyens et favorisent une logique de décroissance - et qui sont irréalistes selon de nombreux experts. FO soutient la transition énergétique dès lors qu'elle est fondée sur des incitations. Les obligations de travaux sont contre-productives, coûtent cher en financements publics dans une conjoncture budgétaire difficile, sans aucune garantie de performance des travaux. Le mix énergétique optimal doit articuler des impératifs de coût, de sécurité d'approvisionnement pour notre pays, de sûreté des installations, de réduction suffisante des émissions de CO2, d'emploi et de garanties collectives.
Le projet de loi cible particulièrement l'électricité d'origine nucléaire, en laissant de côté le pétrole et le gaz, alors que le nucléaire est une industrie d'avenir pour la France, qui emploie 220 000 salariés. Le choix fait outre-Rhin, motivé par des positions idéologiques, a conduit à un échec patent Les dispositions qui plafonnent la part du nucléaire dans le mix énergétique imposent à l'opérateur public EDF - et à lui seul - l'élaboration d'un plan stratégique ; les entreprises privées en sont dispensées. Nous en demandons le retrait. Nous nous étonnons également que la représentation nationale soit appelée à se prononcer alors que les aspects financiers ne font l'objet d'aucune analyse. Rien sur l'impact de l'augmentation de la part des énergies renouvelables (EnR) sur la CSPE payée par les usagers, ni sur le coût des énergies intermittentes, en particulier les coûts de réseau. Pas d'indications non plus sur l'indemnité versée à EDF, en cas de plafonnement du nucléaire. Le texte occulte l'échec des politiques de déréglementation et de concurrence mises en oeuvre au niveau européen sur l'électricité et le gaz, avec l'appui des gouvernements français successifs. En organisant la mise en concurrence des concessions hydro-électriques, le texte ne tient pas compte des possibilités ménagées par la récente directive européenne qui autorise le maintien de droits exclusifs au profit des services d'intérêt économique général (SIEG). Nous demandons le retrait de ces articles, ou un plus grand volontarisme politique.
L'aspect social est inexistant dans le projet de loi. La communication interministérielle met l'accent sur les créations d'emplois, or elles sont indépendantes du mix énergétique choisi. Notre confédération n'oppose pas les énergies les unes aux autres ; nous défendons avec la même détermination les salariés de Photowatt, de Total, GDF-Suez, Areva, EDF, etc. Les salariés du nucléaire se sentent injustement mis en cause, alors que le Comité stratégique de la filière nucléaire prévoit le remplacement de 100 000 postes d'ici 2020. Les garanties collectives des salariés, notamment ceux qui sont soumis au statut du personnel des industries électriques et gazières (IEg) ne sont pas non plus traitées. Les entreprises d'énergies renouvelables, en créant des sociétés de projet, contournent le statut, fraudant la loi et provoquant un dumping social intolérable. Nous demandons que la loi garantisse l'application du statut IEG. GDF-Suez lui-même cherche à vider la maison-mère du personnel sous statut. Des parlementaires ont saisi le ministère de cette question, nous attendons sa réponse. Une modification de la loi sur la nouvelle organisation du marché de l'électricité (Nome), qui a réécrit en 2010 le périmètre du statut, est indispensable.
Enfin, nous soutenons la création d'un chèque énergie pour les usagers modestes, visant tous les modes de chauffage. Pour autant, nous ne comprenons pas le mode de financement de cet outil.

Votre position est claire et elle me plaît ! Je ne suis pas d'accord avec les deux objectifs que vous contestez et je les formulerai différemment dans la loi ; je suis certain d'être suivi, du moins ici au Sénat... Quant à la concurrence hydraulique, la possibilité laissée à des acteurs publics ou privés d'entrer au capital des entreprises est une manière de respecter la directive européenne sans renoncer à tout - c'est-à-dire en maintenant un contrôle de l'État français. Je soutiendrai cette partie du texte. Enfin, pouvez-vous en dire plus sur les 100 000 emplois dont vous dites qu'ils disparaîtront d'ici 2020 ?
Ce n'est pas ce que j'ai dit.

Je partage votre point de vue sur le chèque énergie, c'est un bon produit. Une partie sera financée par la contribution au service public de l'électricité (CSPE) ; une autre par l'État, et c'est cette partie qui vous cause souci. Comment voyez-vous l'avenir de la CSPE ?

Pour vous avoir connu dans d'autres fonctions, je reconnais votre clairvoyance sur le dossier du nucléaire et du mix énergétique. Avec volontarisme, vous avez mis l'accent sur la reconquête industrielle, donc sur les besoins énergétiques. Vous avez évoqué 100 000 postes à renouveler dans la filière nucléaire. Craignez-vous que la jeunesse se détourne de cette voie, qui pourrait être perçue comme condamnée ? Pensez-vous que la France, avec ses possibilités de production électrique à partir de l'eau, de la mer et des surfaces agricoles, ait une capacité exportatrice ?
Notre position, si elle a pu vous paraître un peu tranchée, est en réalité pragmatique. Elle se résume en une question : doit-on, pour des raisons uniquement politiques, arrêter des centrales nucléaires qui fonctionnent et que l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) juge sûres ?
Cela signifierait que les efforts consentis depuis la loi de 2006 sur la transparence et la sûreté nucléaire n'ont servi à rien, cela signifierait aussi qu'il faudrait verser à EDF une indemnité puisque la société, et ce n'était certes pas le choix de FO, est cotée en bourse. Notre pays est déjà en difficulté, faut-il en ajouter ?
Monsieur le rapporteur, le Comité stratégique de la filière nucléaire évalue non pas la perte mais le turn over dans les prochaines années à 100 000 postes à cause des départs en retraite. Que se passera-t-il si des centrales ferment ? Soit dit en passant, les négociations autour de la réduction de la part du nucléaire de 75 % à 50 % dans la future programmation pluriannuelle de l'énergie seront aussi importantes que les dispositions de la loi.
Très peu d'experts, mis à part ceux qui sont parfaitement militants, pensent que la France pourra diviser par deux sa consommation d'énergie par deux en 2050. Cela suppose une modification de notre mode de vie que les Français n'accepteront pas forcément. Si la réduction de notre consommation est une tendance historique et même une nécessité, inscrire dans la loi des objectifs inatteignables est contreproductif.
Notre approche est tout aussi pragmatique sur les barrages. La France est pratiquement le seul pays d'Europe à avoir adopté le support des concessions. Ce choix ne date pas d'hier, il remonte à 1919. La dernière directive, FO l'a fait vérifier, nous autorise à ne pas ouvrir leur renouvellement à la concurrence si la production d'énergie hydraulique est considérée comme un service économique d'intérêt général. Nous pensons que c'est le cas, parce qu'elle représente 75 % des ressources en eau, qu'elle est indispensable au fonctionnement des centrales et à la transition énergétique. Si l'on éclate l'opérateur historique en six ou sept morceaux, cela sera-t-il plus efficace ? L'exemple du gaz prouve le contraire : la Commission européenne a cassé les monopoles en Europe, elle demande maintenant la constitution de centrales d'achat pour baisser les prix... Environ 2 000 agents d'EDF travaillent à la gestion des ouvrages ; ils sont responsables des alertes météo ou encore des alertes de crue. Devront-ils vendre leurs services aux nouveaux concessionnaires ? Et dans quelles conditions ? Cette désoptimisation nous coûtera cher. FO, qui soutenait la proposition de loi de M. Roland Courteau, a cru comprendre qu'un compromis avait été trouvé à l'Assemblée nationale : investissement contre prolongation de la concession. À suivre. En tout cas, le contrôle public n'est pas assuré dans les sociétés d'économie mixte. L'État a beau détenir 34 % de participation au sein de GDF-Suez, on a vu comment Emmanuel Macron a dû valider la retraite chapeau de Gérard Mestrallet... On préfère parler d'ouverture du capital plutôt que de privatisation, mais quelle est la réalité quand un groupe chinois détiendra bientôt 49,9 % des parts de l'aéroport Toulouse-Blagnac ? Bref, portons ce beau débat sur le service public. Le Parlement européen, grâce au rapport de Philippe Juvin, a fait inclure dans la directive une réserve au titre des SIEG, il faut l'exploiter.
Le chèque énergie est une bonne idée, que nous avons toujours défendue. Cependant, beaucoup de petits propriétaires en zones rurales ou semi-rurales se chauffent au fioul, il n'y a aucune raison qu'ils subissent de ce fait une discrimination. Quant au financement, on peut imaginer une extension de la CSPE à plusieurs opérateurs, un système passant par l'impôt ou un abondement de la collectivité nationale sous toute autre forme. Le tout est de ne pas, au passage, détruire la CSPE et les tarifs sociaux du gaz, qui ont fait leur preuve.
Un seul constat sur l'avenir de la CSPE : aucune étude d'impact n'a chiffré les conséquences d'une augmentation de la part des EnR. Cette contribution doit-elle tout financer ? Y compris les primes sur l'effacement diffus dont il était question ce matin au Conseil supérieur de l'énergie ? La CSPE doit financer la solidarité et les tarifs sociaux ; les projets de développement d'EnR également, mais jusqu'où ? Une aide se justifie pour les hydroliennes au large de l'île de Bréhat parce que c'est un projet d'avenir ; on peut se poser la question dans d'autres cas.
L'absence de chiffres, j'y reviens, car elle me frappe. Développer l'éolien offshore, très bien, mais il faudra demain, pour les exploiter, installer des lignes à haute tension, les raccorder au réseau. Cela ne se fera pas sans l'accord des populations. Combien de kilomètres de lignes ? Pour quel coût ? Quel sera l'équilibre entre la production et la consommation ? Comment stocker ces énergies intermittentes ? Quel statut pour les employés de l'éolien offshore ? La loi de 1946 n'est pas appliquée à cause du détour par la sous-traitance : les salariés ne bénéficient pas du statut IEg. Tous ces sujets méritent d'être mis sur la table.
Puis-je vous remettre une proposition d'amendement ?

Bienvenue à Alexandre Grillat, secrétaire national de la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) chargé de l'énergie. Votre carrière professionnelle se déroule au sein d'EDF, et vous avez également été en pointe lors des débats sur la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (Alur). Quel est votre avis sur le projet de loi sur la transition énergétique ?
Ce texte fait suite au débat national de 2013 auquel la CFE-CGC a largement contribué. L'enjeu prioritaire est la mise en place d'une stratégie bas carbone. La transition énergétique, au vu des derniers rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) et de celui de M. Jean Jouzel, constitue une urgence absolue : le dérèglement climatique aura des effets sur le monde, y compris sur notre territoire national, dès 2050. C'est pourquoi nous accueillons favorablement les objectifs fixés et en particulier la priorité à la stratégie de bas carbone.
Cela suppose d'abord un mode de consommation plus sobre et plus intelligent dans les deux secteurs les plus énergivores. En premier lieu, le logement. L'objectif de rénovation thermique dans le bâtiment est bon, mais quel sera son coût et comment le Gouvernement compte-t-il le financer ? En second lieu, le transport.

Le transport relève de la compétence de la commission du développement durable.
Soit, cependant, je veux vous en dire un mot car ce secteur, le plus grand consommateur d'énergie et émetteur de gaz à effet de serre, est fondamental pour une transition énergétique responsable, pragmatique et rationnelle. La sobriété et la décarbonation de notre consommation passent par le développement de véhicules propres, qu'ils soient électriques ou au biogaz, pour les particuliers comme pour les transports collectifs et le transport routier ; et par l'articulation des politiques de mobilité, d'habitat, d'aménagement et d'urbanisme au niveau des territoires.
La stratégie bas carbone doit également s'appliquer à nos modes de production. Pour une transition énergétique systémique, il aurait fallu engager une réflexion sur les usages du pétrole et nos modes d'approvisionnement, une dimension qui est totalement absente de ce texte. Plus polémique, le plafonnement de la part du nucléaire et la mise en concurrence des concessions hydrauliques regroupées au niveau des vallées paraissent incohérents avec l'objectif d'une production peu ou pas carbonée. Prenons exemple sur la Suède qui a mis l'accent sur les énergies renouvelables (EnR) thermiques - les chaufferies biomasse et les réseaux de chaleur - plutôt que sur les EnR électriques. Un bon deal, à la fois pour les salariés et pour une transition énergétique responsable, a été trouvé à l'Assemblée nationale s'agissant des concessions hydrauliques : investissement contre prolongation de la concession.
On a reproché à ce projet de loi d'être électrocentré. Le développement des énergies renouvelables électriques se fera à deux conditions. D'abord, contrebalancer le coût pour la collectivité par la perspective de constituer des filières industrielles, a minima européennes, créant des emplois durables, qualifiants et valorisables dans la compétition internationale. La France peut miser sur l'éolien offshore et les hydroliennes, alors qu'elle a pris beaucoup de retard sur l'éolien et le solaire. Ensuite, le coût de la transition énergétique doit être financièrement soutenable pour la collectivité car, in fine, ce sont les consommateurs et les contribuables qui en supporteront le prix. La soutenabilité n'est pas garantie en l'état actuel du texte, en raison d'un pilotage insuffisant du développement des énergies renouvelables et de l'évolution de la CSPE. À propos de la CSPE, et après les longs débats à l'Assemblée nationale, la CFE-CGC pense qu'il faut limiter son évolution à un niveau raisonnable à cause de sa place croissante dans la facture d'électricité, qui augmente à vive allure.
Je poursuis sur la structure des tarifs, un aspect de la loi qui pose particulièrement question. Il faut indéniablement une vérité économique dans le signal prix. Marcel Boiteux, le président d'honneur d'EDF, aime à dire : « les horloges sont faites pour donner l'heure, le prix pour donner le coût ». Les Français doivent pouvoir effectuer leur choix en connaissance de cause - les particuliers, mais aussi les investisseurs, dont les décisions déterminent la qualité du service public et les emplois chez les prestataires et fournisseurs de matériels. Vous le savez tous ici, la dynamique d'EDF et de GDF, avec leurs sous-traitants, irrigue nos territoires. Quels que soient les choix effectués, l'entretien du parc nucléaire ou l'augmentation de la part des EnR, les investissements s'évaluent à des dizaines de milliards d'euros. Il faut de bons signaux économiques, afin que les opérateurs économiques soient en mesure de prendre des décisions rationnelles. Inclure une composante de prix du marché dans la structure tarifaire constitue une entorse au principe de la couverture des coûts. J'ajoute que le marché électrique est aujourd'hui complètement déstructuré à cause de la distorsion au profit des EnR subventionnées. Ce qui, en outre, fragilise la rentabilité de certains actifs de plus en plus déclassés, alors que les sites correspondants peuvent être appelés à la pointe. En revanche, l'introduction de la régulation normative concernant l'utilisation des réseaux et la sécurité des investissements va clairement dans le bon sens.

Merci pour ces propos très clairs. La réussite de ce texte dépend, vous avez raison, du pouvoir d'achat des Français. Faute d'argent, ils peineront à effectuer des travaux de rénovation thermique dans leurs logements. Plutôt que l'isolation, coûteuse, ne faut-il pas privilégier l'installation de systèmes de chauffage à partir de biomasse ou de bois ? Le retour sur investissement est plus court : quatre à cinq ans, contre quinze ans. Autre sujet délicat, le « baudet » de la CSPE est chargé, surchargé, son dos ploie sous la charge... Comment alléger le fardeau ?

La biomasse et la méthanisation offrent des solutions pour du collectif de proximité et territorialisé, mais rien ne remplacera les réseaux classiques de gaz et d'électricité : je ne connais pas un dispositif d'énergie renouvelable qui fonctionne sans soutien public. De nouvelles économies d'énergie seront donc également indispensables. Sur les concessions, le renouvellement peut être vertueux : il est grand temps de revoir le contenu de contrats conclus il y a vingt, trente, voire cinquante ans.

La question de l'après pétrole n'est pas abordée, à dessein, dans ce projet de loi. Faut-il encourager la chimie verte, susciter l'émergence de nouvelles filières ? Je regrette que ce sujet ne soit abordé qu'à la marge.

Avez-vous une idée du montant des investissements nécessaires dans le nucléaire et dans les EnR ? Selon quel échéancier ? Quelles en seront les incidences sur le prix de l'électricité ?

Comme dans notre proposition de loi déposée il y a plus d'un an, vous proposez d'échanger investissements contre prolongation des concessions. Je me réjouis de l'entendre. Évitons de brader notre patrimoine national hydroélectrique, qui risque de passer sous capitaux étrangers !
Que pensez-vous du complément de rémunération pour les énergies renouvelables ? Le passage du soutien public à une logique de marché ne compromettra-t-il pas le développement de cette énergie verte ?
Le chèque énergie est indispensable également pour ceux qui se chauffent non pas au gaz ou à l'électricité, mais au fioul ou au bois. Avec la création de ce nouvel outil, faut-il maintenir les tarifs sociaux en l'état ?

Merci pour la cohérence de votre présentation. Quelle est votre position sur la réduction du nucléaire de 75 à 50 % d'ici 2025 ? L'indépendance énergétique est une question géopolitique majeure pour la France mais aussi pour l'Union européenne. Il serait intéressant de l'évoquer dans le cadre de ce projet de loi.
L'énergie de proximité ne risque-t-elle pas de rester au niveau du symbole à court et moyen termes, compte tenu des volumes d'énergie dont notre pays a besoin ? Alstom et General Electric développent une nouvelle filière industrielle avec l'énergie marine renouvelable, mais son coût reste très élevé, notamment le coût lié à l'usure, pour les éoliennes off shore. Que pensez-vous de ces nouvelles énergies ?
Pour réussir la transition énergétique, les investissements devront être rationnels. L'isolation des immeubles coûte extrêmement cher : l'opération doit être rentable. Seul un prix élevé de l'énergie justifie l'investissement. Plutôt que de dépenser des milliards d'euros pour isoler, il serait préférable d'investir dans la gestion active de la demande, afin que chacun pilote au mieux sa consommation, par l'utilisation d'appareils moins énergivores par exemple. L'électricité et le gaz se prêtent parfaitement à une telle gestion.
Le chèque énergie tel qu'il est conçu pour l'instant sera financé par les consommateurs d'électricité et de gaz, qui sont les énergies les moins carbonées ; et il bénéficiera surtout aux ménages qui se chauffent au fioul ou au propane, fortement carbonés. Il faut repenser cela. Le traitement de la précarité énergétique doit passer par des leviers fiscaux ou des subventions, non par les tarifs. Nous sommes opposés à une cohabitation entre tarifs sociaux et chèque énergie, qui pèsent sur les consommateurs d'électricité et de gaz. Concernant les dispositions relatives à la souveraineté énergétique dans les territoires d'outre-mer, des questions restent posées : quel en est le coût ? Par qui doit-il être supporté ?
Une approche globale de tous les postes de la CSPE est nécessaire, puisqu'elle traite à la fois de la précarité énergétique, des tarifs de première nécessité, des zones non-interconnectées et du financement des EnR.
Les énergies renouvelables thermiques sont par nature territoriales, ce qui n'est pas le cas de celles électriques qui font partie d'un système national. Une transition énergétique décentralisée implique la valorisation des ressources locales.
Pour que la transition énergétique soit la moins coûteuse possible, il convient de veiller à la rationalité économique et technique. Le coût de l'électricité française est le plus bas d'Europe parce que c'est l'ensemble du système national qui a été rationalisé - je ne veux pas évoquer le totem de la nationalisation de 1946, et nous ne sommes pas dans un combat entre Jacobins et Girondins... mais le service public du gaz et de l'électricité a favorisé l'efficacité. Nous prônons non une révolution, mais une évolution, et celle-ci sera d'autant plus facile qu'elle utilisera les atouts énergétiques de la France.
Ainsi, sur la part du nucléaire, gardons-nous de fixer des chiffres de façon dogmatique. N'oublions pas que le retour de la croissance impliquera une hausse de la demande d'énergie. Les usages électriques vont également se développer avec, par exemple, le véhicule électrique et les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC). Aux États-Unis, Internet et les smartphones consomment la puissance de vingt centrales nucléaires. Les scénarios de la demande détermineront les besoins en 2025, auxquels il faudra répondre 24 heures sur 24, même en l'absence de vent ou de soleil. L'objectif des 50 % du nucléaire dans la production d'électricité d'ici 2025 ne correspond ni à l'objectif bas carbone ni à celui d'une transition énergétique rationnelle. L'évolution de la demande déterminera l'évolution du mix électrique du pays.
Nous sommes défavorables à la mise en concurrence sur l'hydraulique, qui désorganiserait et fragiliserait notre système national et ferait entrer des capitaux étrangers dans nos installations sans aucune réciprocité. En revanche, nous souhaitons un dialogue avec les concessionnaires lors du renouvellement.

Vous êtes, madame Cailletaud, ingénieur à EDF, membre du Conseil économique, social et environnemental pour la CGT et membre suppléant du Conseil national de la transition écologique.
La CGT s'est beaucoup investie dans ce débat. Les enjeux énergétiques concernent tous les citoyens, au premier chef les salariés que nous représentons. Dès le départ, nous avons été assez critiques car le sujet mérite d'être abordé grand angle et non par le petit bout de la lorgnette. Lors de la Conférence environnementale de 2012, le Président de la République s'était engagé sur divers points qui reprenaient les thèmes développés lors de la présidentielle. Le débat s'en est trouvé centré sur le nucléaire, alors qu'il aurait fallu débattre de toutes les énergies. Il est également indispensable que ce texte traite des transports. Or, pour l'instant, il ne fait référence qu'aux véhicules électriques, ce qui est bien réducteur puisque les transports sont le premier émetteur de gaz à effet de serre.
Nous contestons la procédure accélérée : une loi annoncée comme majeure, comme la loi du quinquennat mériterait un débat digne de ce nom au Parlement. Et voilà qu'il n'y a pas de navette et que la procédure du temps programmé à l'Assemblée nationale a empêché des échanges sur des questions aussi importantes que la privatisation du secteur hydraulique.
Nous contestons l'objectif de diminution par deux de la consommation énergétique d'ici 2050, car il faut avant tout répondre aux besoins tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre. Comment d'ailleurs y parvenir avec une démographie dynamique, quand la réindustrialisation de notre pays apparaît indispensable ? De surcroît, et les NTIC sont grandes consommatrices d'électricité.
Le volet efficacité énergétique faisait consensus. Nombreux sont ceux qui estiment que les logements doivent être isolés, mais avec quels financements ? Les annonces du Président de la République impliquent 10 à 15 milliards d'investissements par an. Or, la loi énergétique ne prévoit qu'un milliard en tout. Si l'isolation devient obligatoire, les propriétaires augmenteront les loyers.
Nous contestons aussi la diminution dogmatique de la part du nucléaire dans le bouquet énergétique. Certes, une évolution est souhaitable, mais en fonction de la maturité technologique. La loi ne dit pas comment la diminution du nucléaire sera compensée dans le bouquet électrique. Les énergies renouvelables ne sont pas prêtes à prendre la relève : le tarif de rachat devient insoutenable et les tranches thermiques classiques ferment dans notre pays.
Tous les syndicats s'inquiètent de la privatisation du secteur hydraulique qui produit une électricité à faible coût et sans émettre de gaz à effet de serre. De plus, nous sommes le seul pays d'Europe à livrer ces véritables mines d'or à la concurrence. On l'a vu avec GDF-Suez, il s'agit d'une privatisation, ni plus ni moins.
Enfin, la territorialisation et la régionalisation marquent le retour au morcellement d'avant 1946. C'est faire bon marché de la péréquation et de la solidarité. Les grandes métropoles vont prendre en 2015 la compétence énergie. Le gouvernement nomme en ce moment de nouveaux dirigeants dans les entreprises de l'énergie, qu'il s'agisse d'EDF, de GDF-Suez, d'Areva, du CEA ou, prochainement, de Réseau de transport d'électricité (RTE). Dans le même temps, il annonce la vente de 5 à 10 milliards d'actifs pour renflouer les caisses de l'État et il évoque l'ouverture du capital de RTE ce qui est fort inquiétant d'un point de vue stratégique.

J'ai bien l'intention de revenir sur la réduction dogmatique du nucléaire et sur la diminution de moitié de la consommation d'énergie. Je serai probablement suivi par mes collègues, mais le combat n'en sera pas pour autant terminé puisque nous devrons trouver un terrain d'entente avec l'Assemblée nationale, ce qui ne sera pas chose aisée. Poursuivrez-vous votre lobbying auprès des députés ?
De même, vous avez raison de souligner le problème de financement, car si certaines mesures sont positives, il y a très peu de solutions précises. Vous avez parlé d'un milliard dans le projet de loi : où le trouvez-vous ? En outre, vous avez dit que le Président de la République avait annoncé, en 2012, 15 milliards de dépenses : pouvez-vous être plus précise ?

Seule l'isolation des logements fera baisser le prix du chauffage et la charge du logement dans le budget des familles. Le prêt à taux zéro ne pourrait-il bénéficier aux offices HLM comme aux particuliers ? Réussir est possible et nécessaire pour faire rapidement repartir le bâtiment.
La ministre a annoncé le chiffre d'un milliard, mais il n'y en a nulle trace dans le projet de loi. Quant aux 10 à 15 milliards, nous nous sommes bornés à reprendre l'annonce du Président de la République qui disait vouloir que 500 000 logements soient isolés. Or, chaque logement faisant en moyenne 90 mètres carrés et le coût de l'isolation s'élevant à 250 euros le mètre carré, le calcul était simple. L'isolation des logements pourrait être une grande cause nationale ...à condition d'y mettre les moyens. Or, les personnes en précarité énergétique sont souvent des ruraux âgés qui se chauffent au fioul et dont la maison n'est pas isolable : le prêt à taux zéro n'est pas adapté à leur cas.
La filière du bâtiment a perdu 70 000 emplois en deux ans et elle emploie 200 000 travailleurs détachés qui sont payés 600 euros par mois. Si les emplois ne sont pas délocalisables, les salariés, eux, le sont ! Créons une filière, donnons-nous les moyens. Isoler les logements allégerait la facture énergétique de la France qui accuse un déficit de 70 milliards.

Nous avons évoqué avec l'administrateur général du CEA la question de la sûreté nucléaire, et nous savons les difficultés dans la sous-traitance. Quelle est la position de la CGT sur la diminution de la part du nucléaire dans le mix énergétique, ainsi que sur celle du stockage des déchets nucléaires ?
Comment donner un accès généralisé à l'énergie - 11 millions de Français sont en situation de précarité énergétique - tout en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre ? Il est étrange de commencer par affirmer qu'il faut réduire une énergie - le nucléaire - qui n'en émet pas ! Le bouquet énergétique doit donc évoluer grâce à de nouvelles technologies matures non émettrices de gaz à effet de serre. Si nous avions une technologie pour stocker l'électricité, nous changerions de paradigme : nous pourrions alors avoir recours à des énergies intermittentes et le bouquet énergétique évoluerait. Mais tel n'est pas le cas pour l'instant et la recherche est mal traitée.
Compte tenu de la situation actuelle, la filière nucléaire est nécessaire à condition que l'Autorité de sûreté nucléaire soit indépendante et de bon niveau, ce qui est le cas en France, et que tous les travailleurs bénéficient d'un haut niveau de garantie collective. Or la fragilité de la filière nucléaire vient des facteurs sociaux organisationnels et humains, notamment de la sous-traitance. Enfin, nous exigeons une maîtrise publique de l'industrie nucléaire.
Il est grand temps que le projet de stockage de déchets nucléaires Cigéo voit le jour. Les déchets sont là, il faut les traiter et nous avons la chance d'avoir pensé une filière complète. Or, les deux articles qui traitaient de l'enfouissement des déchets nucléaires ont été retirés de manière un peu cavalière à la demande de certaines personnes - les organisations syndicales n'ont pas eu le même succès lorsqu'elles ont demandé le retrait des dispositions sur les concessions hydrauliques. Dans le projet de loi pour la croissance et l'activité présentée par Emmanuel Macron, des articles sur Cigéo ont également été supprimés. Or, si l'on veut régler le problème du stockage des déchets nucléaires, le centre Cigéo doit voir le jour.
EXAMEN DE L'AVIS

Le 5 novembre, notre commission s'est saisie pour avis du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République déposé en première lecture au Sénat, conformément à la tradition. Ce texte vise à renforcer l'efficacité de l'action des collectivités en substituant à la clause de compétence générale une répartition des responsabilités plus précise par niveaux de collectivités.
Notre commission a décidé d'examiner plus précisément les volets économie et tourisme, traités dans 7 des 37 articles de ce projet : les articles 2 et 3 donnent à la région le premier rôle dans le soutien au développement économique ; l'article 4 est consacré au tourisme ; l'article 6 traite du schéma régional d'aménagement et développement durable du territoire, pour son impact économique ; les articles 18, 19 et 20 renforcent le bloc des compétences obligatoires des intercommunalités en matière de tourisme et l'article 28 prévoit la création de guichets uniques en matière de tourisme.
J'ai procédé à plusieurs auditions et consultations tout en participant aux travaux de la commission des lois où des points de vue très divers se sont exprimés. Sept rapporteurs relevant de six commissions interviendront sur ce texte : Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck, pour la commission des lois, Charles Guené pour la commission des finances, Catherine Morin-Desailly pour la commission de la culture, Rémy Pointereau pour la commission du développement durable et René-Paul Savary pour la commission des affaires sociales.
Dans ce contexte, mes propositions s'ordonnent autour d'un message simple : l'analyse des transformations économiques et sociales de terrain - et non pas l'esprit de système - doit guider l'adaptation du cadre juridique des interventions économiques des collectivités locales. Seul le réalisme assurera l'efficacité économique, la cohésion sociale et la préservation de la motivation des élus pour répondre aux attentes des entreprises et des citoyens. De plus, la situation actuelle ne nous donne guère le droit à l'erreur.
Au cours des auditions, certains intervenants ont rappelé qu'il n'était pas simple de distinguer parmi les interventions des collectivités celles qui sont de nature purement économique. Les collectivités territoriales, comme l'État, sont, par l'exercice direct de leurs compétences, des agents économiques de premier plan en tant qu'acheteurs et en tant qu'employeurs. Cependant, dans la logique juridique, ce rôle doit être distingué de celui d'intervenant au profit des entreprises du secteur marchand. Par leurs actions diverses en matière d'aménagement, d'infrastructures et de services aux entreprises, les collectivités contribuent à créer un environnement favorable à l'implantation et au développement des entreprises. Ces actions ne relèvent pas de la compétence « développement économique » au sens du projet de loi mais elles contribuent au dynamisme des territoires.
Les interventions économiques des collectivités territoriales avoisinent 6,5 milliards d'euros soit le septième de celles de l'État. Les régions y consacrent 2,1 milliards d'euros (soit 8,3 % de leur budget 2011), les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 1,7 milliard d'euros, les départements 1,6 milliard d'euros (1,6 % de leur budget) et les communes 983 millions d'euros (1,5 %).
Si les dépenses d'intervention économique des collectivités ont progressé de près de 1% en moyenne annuelle sur la période 2007-2011, celles des départements ont décru de 14 %, en particulier à partir de 2010, et surtout au détriment de l'investissement (- 23 %) ; celles des régions ont progressé de 18 %, et celles des communes et groupements à fiscalité propre de près de 7 %. Ces dépenses se répartissent à part égale entre fonctionnement et investissement.
Le cadre juridique de ces interventions a été redessiné par deux lois de décentralisation récentes : celle du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, a institué le rôle de chef de file de la région, qui implique l'obligation de conventionnement pour certaines aides, ainsi que la nécessité, pour une collectivité infrarégionale souhaitant créer un dispositif propre, d'obtenir l'accord de la région ; la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, a supprimé la distinction entre aides directes et indirectes pour adapter le droit français à celui de l'Union européenne. Le régime actuel ne traduit pas de choix tranché en faveur d'une région chef de file incontestable en matière d'interventions économiques. Si les aides indirectes libres ont disparu, le nombre d'aides à l'immobilier que les collectivités peuvent octroyer sans accord de la région s'est accru.
Nous connaissons tous, sur nos territoires, le résultat de ce maquis institutionnel. À l'heure où les contraintes budgétaires se font toujours plus pressantes, il est grand temps de revoir notre copie, afin de rendre l'intervention des collectivités la plus efficace possible.
Dans une logique de cohérence et de simplification, nous devons consacrer le rôle de chef de file des régions en matière de développement économique. Leur fonction de coordination doit être spécifiée, car le développement économique est une vaste politique publique. Les régions sont, par exemple, le bon échelon pour organiser les plateformes de projection des PME et ETI à l'exportation, ou encore pour coordonner les stratégies d'attractivité. La coordination de ces actions s'impose, dans un contexte mondialisé, afin d'optimiser la visibilité de nos territoires.
Les spécificités des territoires doivent être mieux prises en compte, notamment par leur association forte aux schémas régionaux. Encourageons le dynamisme des collectivités, au moment où notre pays en a le plus besoin. Le soutien du développement économique passe par de nombreux vecteurs sur lesquels les régions n'ont ni monopole, ni véritable capacité de maîtrise d'ouvrage : animation de proximité de l'économie locale (réseaux d'affaires, interfaces avec l'université), aménagement économique du territoire (immobilier, foncier, dépollution des sols, réseaux...), services supports nécessaires pour attirer des entreprises (logement, offre culturelle et sportive, crèches etc..). Réfléchi au niveau régional, le schéma de développement économique doit être co-construit et co-produit avec les autres acteurs du territoire, intercommunalités et des métropoles en particulier.
Nous devons introduire dans la loi la souplesse nécessaire à l'élaboration de schémas qui soient vraiment du cousu-main. En matière de tourisme par exemple, on ne peut traiter de la même manière un territoire où rayonnent des stations touristiques classées, connues mondialement, et ceux dont le pouvoir d'attraction s'exercera dans le registre du tourisme vert ou industriel.
Comme l'a fait remarquer à juste titre Jean-Paul Delevoye lors de son audition devant la commission des lois, la carte territoriale ou la nouvelle répartition des compétences ne doivent pas être un objectif en soi ou une occasion d'appliquer des schémas de pensée verticaux hérités du passé, mais un moyen d'améliorer la performance économique de nos territoires et d'assurer la cohésion sociale. Dans ce que Laurent Davezies a appelé la « France périphérique », où le sentiment d'abandon domine, les collectivités sont en première ligne pour la sauvegarde de l'emploi. Favorisons des métropoles dynamiques, qui soient les locomotives d'un développement régional équilibré. Il nous faut pour cela clarifier les registres d'intervention entre le bloc local et le niveau régional, tout en respectant le principe de libre administration des collectivités locales et l'absence de tutelle de l'une sur l'autre.
Quant aux grands principes constitutionnels applicables aux interventions économiques décentralisées, le président de la section de l'intérieur du Conseil d'État, entendu par la commission des lois, a souligné que « la prescriptibilité des schémas régionaux frise la tutelle d'une collectivité sur une autre ». Le Conseil d'État a donc, par précaution, demandé que soit substitué le terme de compatibilité à celui de conformité.
Afin de surmonter tout risque d'incertitude juridique, tout en nous conformant à la logique économique et sociale, je vous proposerai d'introduire, à l'article 2, l'élaboration conjointe des schémas de développement économique. Nous ne pourrons bâtir une réforme durable en matière de développement économique sans une vision stratégique partagée et une co-construction du schéma de développement. C'est en travaillant ensemble que les régions et leurs territoires construiront des politiques alliant l'aide au tissu économique et la préparation des activités du futur. C'est pourquoi les orientations du schéma doivent être mises en débat au sein des conférences territoriales de l'action publique (CTAP) pour un avis global.
Je vous proposerai d'assortir ce principe du mécanisme de contractualisation issu de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014. Des conventions territoriales d'exercice concerté clarifieront la mise en oeuvre des orientations du schéma et définiront l'implication des collectivités dans une territorialisation fine. Il importe, pour consolider les orientations régionales et leur donner une réelle cohérence, de les rendre consensuelles et de prévoir leur déclinaison territoriale. Loin d'opposer un niveau à un autre, mon objectif est de mobiliser toutes les énergies, afin de construire un projet commun, cohérent et efficace, qui favorise l'optimisation des ressources au service du développement des territoires
Enfin, je vous proposerai le maintien du mécanisme de sauvegarde prévu par l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, permettant à une collectivité, en cas de carence de l'initiative régionale, d'intervenir en contractualisant avec l'État.
En matière de tourisme, le maintien de la compétence partagée me semble opportun, et appelle la même logique de schéma co-élaboré. Les stations classées doivent pouvoir transférer leur compétence tourisme aux intercommunalités - une souplesse fortement demandée par les associations des organismes de tourisme et les collectivités -, non y être contraintes, au risque de démotiver les communes concernées, dont le savoir-faire est précieux pour notre pays.

Je félicite notre rapporteure pour cette présentation très synthétique. Que devient la notion de guichet unique ?

Je ne propose aucun amendement à ce sujet qui est traité, en particulier à l'article 29 du projet de loi. Notre examen s'est concentré sur la définition de l'architecture guidant l'élaboration des schémas économique et touristique. Il appartiendra aux assemblées délibérantes des régions de se les approprier. Compétentes en matière économique, les régions doivent se concerter avec les territoires porteurs de l'action. La région co-élaborera, avec les collectivités, les établissements publics et les organismes consulaires, une stratégie globale, cohérente et partagée. Afin de garantir le caractère opérationnel de cette collaboration, le projet de schéma sera soumis à la conférence territoriale de l'action publique (CTAP), c'est-à-dire aux élus, avant de se décliner en conventions territoriales, c'est-à-dire en une contractualisation par les deux acteurs. La création de guichets uniques doit s'inscrire dans ces déclinaisons et faire l'objet de conventions ? Il ne faut pas fixer de modèle uniforme dans la loi, car ce qui est adapté aux territoires ruraux ne l'est pas pour autant pour les collectivités urbaines. Faisons confiance aux régions, pour mettre en oeuvre, sur la base d'une règle du jeu très claire, des dispositifs adaptés, et faisons confiance aux territoires pour leur application fine.

J'arrive d'un colloque du Conseil économique, social et environnemental qui traitait de l'agriculture familiale au niveau planétaire mais je suis pleinement convaincu par la clarté de votre présentation.

Ma lecture du texte est celle d'une élue de terrain ; nous verrons demain si la commission des lois la partage.
EXAMEN DES AMENDEMENTS
Article 2

L'amendement n° 1 traduit le principe d'une co-élaboration avec la région.

Il n'est plus question ici des pays, qui étaient pourtant jusqu'à présent les interlocuteurs des régions.

On pourrait les mentionner, mais je rappelle que l'article 51 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a supprimé la possibilité de créer de nouveaux pays

J'apprécie votre distinction entre concertation et co-élaboration. C'est surtout cette seconde notion qui devrait figurer dans le texte.

Nous y viendrons en examinant ma proposition de rédaction de l'alinéa 5 de l'article 2 du projet de loi.

Aujourd'hui, les intercommunalités travaillent déjà sur les schémas régionaux de développement économique. La nouveauté réside dans l'émergence du couple région-communauté de communes ou communauté urbaine.

Le projet de loi vise à passer un cran au-dessus : la région serait désormais responsable sur son territoire de la définition de toutes les orientations stratégiques. Logiquement, si les territoires ne s'y conforment pas, ils n'obtiendront pas les moyens afférents.

Voilà qui a le mérite d'être plus précis : la région doit désormais travailler avec l'ensemble des collectivités.

C'est souhaitable, si on ne veut pas que les décisions de la région leur soient imposées, mais cela ne signifie pas que le schéma régional soit l'addition de schémas territoriaux. Voilà tout l'intérêt de la compétence obligatoire de la région, qui pourra désormais trancher.

L'Association des Maires de France (AMF) souhaite que les collectivités locales et les intercommunalités soient systématiquement associées à l'élaboration de ces schémas.

Ce n'est pas moi qui dirai le contraire ; je suis simplement soucieuse de l'avis que la commission des lois exprimera demain.
L'amendement n° 1 est adopté.
L'amendement n° 2 supprime une mention peu claire sur la prévention des délocalisations au sein de la région ou d'une région limitrophe. Il y a un vrai sujet d'égalité de traitement entre la métropole et le reste de la région. Attention à ne pas créer de distorsions !

Si je m'accorde avec la rapporteure pour déplorer l'absence de toute précision sur les moyens pour atteindre l'objectif, j'estime qu'une simple suppression de cette phrase de l'article 2 ne règle rien.

Je veux bien retirer cet amendement, mais, loin d'assurer un équilibre, cette mention nous expose à de très graves disparités territoriales.

Les délocalisations sont évidemment le résultat du dumping fiscal entre territoires.

Certes, mais la liberté accordée aux métropoles dans la suite de cet article 2 n'arrangera rien dans ce domaine. D'un côté, le projet redoute les délocalisations d'activité mais quelques alinéas plus loin, il instaure un régime dérogatoire en faveur des métropoles.

Je suis prête à retirer cet amendement, à condition de favoriser l'égalité des territoires, comme le proposent mes amendements suivants, qui précisent qu'un unique schéma doit associer tous les territoires d'une région.

À mon sens, le schéma régional ne doit pas être prescriptif.
L'amendement n° 21 est retiré.

Afin de favoriser la montée en gamme des schémas régionaux, l'amendement n° 26 distingue trois phases de concertation, d'élaboration et de contractualisation des schémas. La convention territoriale d'exercice concerté des compétences de développement économique déterminera les orientations et les règles que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires s'engageront à respecter. Afin de tenir compte des observations du Conseil d'État, ces établissements mettront en oeuvre des stratégies compatibles avec les orientations des schémas, et non conformes.

Il faut se garder d'instituer la tutelle d'une collectivité sur d'autres.

Certes, mais ne vaudrait-il pas mieux parler d'un schéma d'objectifs partagés ?

La compétence étant régionale, le concept de co-construction du schéma de développement économique me convient.

Ce mécanisme imposera aussi aux territoires de s'intégrer au jeu collectif et de faire preuve de vision prospective. Cet amendement les remet dans la boucle, tout en respectant l'équilibre du texte.
L'amendement n° 26 est adopté.
Sans s'immiscer dans les compétences des métropoles, l'amendement n° 25 tend à appliquer à tous les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) le même mécanisme, sinon on risquerait d'aboutir à un schéma métropolitain différent du schéma régional. L'élaboration d'une stratégie partagée ne peut pas passer par des démarches parallèles.

Je tiens à souligner que Lyon est la première métropole à mettre en oeuvre la loi « Métropoles » avec toutes les difficultés que cela implique. Il n'est pas question que notre travail soit remis en cause par un nouveau changement des règles du jeu. Gérard Collomb l'a dit au Gouvernement avec beaucoup de force : il faut nous laisser mener à bien notre tâche en fonction de la loi votée il y a six mois. Je ne nie pas, pour autant, la réalité du problème que vous soulevez.

Pensons co-construction et prenons garde à ce que la métropole ne devienne pas un État dans l'État régional. La métropole doit réfléchir au-delà de son territoire.

Je suis pleinement consciente de la complexité de la machine qu'est une métropole. Ma région en comportera une. L'important est que la métropole tienne compte, dans l'élaboration de son schéma de développement économique, de celui de la région. C'est à cette condition qu'elle jouera son rôle de locomotive, en entraînant les wagons, et qu'elle pourra discuter avec la région, notamment de l'utilisation des fonds européens.

Je rappelle que les dispositions de la loi d'affirmation des métropoles ont été votées très rapidement et sans étude d'impact, ce qui explique les difficultés qu'elle rencontre à présent.

Notre avis reste défavorable car la loi « Métropoles » votée en janvier 2014 a tranché le débat.
L'amendement n° 25 est adopté.

L'amendement n° 4 intègre dans le schéma régional de développement économique les entreprises de l'économie sociale et solidaire, en cohérence avec l'article 7 de la loi du 31 juillet 2014.
L'amendement n° 4 est adopté.
Article additionnel après l'article 2

Les organismes consulaires, associés de plein droit à la concertation sur le schéma régional de développement économique, doivent pouvoir l'être également aux conventions territoriales d'exercice concerté. L'amendement n° 27 prévoit, à cette fin, que des dispositions relatives aux relations entre collectivités et organismes consulaires soient annexées à ces conventions.

Il s'agit donc d'une clarification des compétences.
L'amendement n° 27 est adopté.
Article 3

L'amendement n° 29 garantit l'égalité de traitement des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de mécénat et d'aide aux organismes participant à la création d'entreprises. Les EPCI sont soumis à des règles du jeu, les métropoles non.

Je m'efforce de remettre les amendements en perspective : nous sortons d'une réunion avec le président Larcher et les présidents des trois grandes associations d'élus. Cette proposition ne sera pas du goût des régions, qui voient déjà d'un mauvais oeil les pouvoirs des métropoles.

Revenir sur la loi MAPTAM créerait une insécurité intenable pour la métropole de Lyon.

Je partage votre inquiétude, mais peut-on accepter la différence de traitement entre deux types d'EPCI ?

Le Parlement en a déjà débattu et a donné aux métropoles une liberté spécifique d'action.

La métropole de Lyon est un prototype qui marche. Les équilibres ont été négociés à la base, entre des collectivités de tendances parfois différentes. Les remettriez-vous en cause ?

La même discussion sur la compétence économique a eu lieu lors des débats sur la loi MAPTAM, et n'a jamais été vraiment tranchée. Cette clarification serait bienvenue.

La situation étant, pour moi, trop confuse, je ne participerai pas au vote.
L'amendement n° 29 est adopté.

L'amendement n° 28 maintient le mécanisme de sauvegarde prévu à l'article L.1511-5 du code général des collectivités territoriales.

Je participais tout à l'heure à une réunion autour du président Larcher, qui souhaite une solution d'ensemble. Cet amendement risque de mettre le feu aux poudres dans les régions.

Pourquoi supprimer cette soupape de sécurité dans la période d'incertitude politique que nous connaissons ?

La loi donne aux régions une compétence, et on envisage qu'elles ne l'exercent pas...

Les régions, qui auront la compétence économique, n'en feraient pas usage ?

Le mécanisme ne jouerait qu'en cas de carence. Je suis prête, cela dit, à retirer cet amendement : il aura eu le mérite de soulever clairement le problème.
L'amendement n° 28 est retiré.
Article 4

En cohérence avec les dispositions de ce texte faisant du tourisme une compétence partagée, cet amendement prévoit une élaboration conjointe du schéma dédié au tourisme, ainsi que l'articulation de cette compétence partagée dans le cadre d'une convention territoriale.

Les élus locaux réclament des compétences, ne leur imposons pas trop de contraintes ! La région Rhône-Alpes Auvergne ne fera sans doute pas les mêmes choses que l'Île-de-France.

Encore faut-il qu'il y ait un chef de file. On parle d'élaboration conjointe ; comment aura-t-elle lieu entre une vingtaine d'intercommunalités et huit ou neuf départements ?

Pourquoi descendre autant dans le détail des choses ? Énoncer le principe général de co-construction me parait suffisant.

Nous venons d'avoir le même débat pour le schéma économique, et nous avons approuvé un mécanisme similaire : soyons cohérents.
La réunion, suspendue à 18 h 30, est reprise à 19 h 35.
L'amendement n° 6 est adopté.
Article 6

L'amendement n° 7 confie aux régions la mise en place d'une politique d'information géographique qui mette à disposition des collectivités et des autres acteurs un système d'information géographique (SIG).

Cela créerait un outil unique pour tout le territoire, avec le concours des services de l'État.

L'amendement n° 23 intègre pleinement les EPCI à fiscalité propre et les conseils généraux concernés à l'élaboration du projet de schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, en écrivant « participent » et non « sont associés ».

La participation active est en effet préférable.
L'amendement n° 23 est adopté.
Article 18

L'amendement n° 14 évite de limiter les actions de promotion du tourisme à la création d'offices du tourisme.

Les communautés de communes seront compétentes en matière de tourisme. L'amendement n°15 propose que les stations classées puissent le rester.

Certes, mais le texte confie cette compétences aux communautés de communes. Bien des voix se sont élevées pour demander le retour de toute la compétence tourisme aux communes. Ma proposition est de compromis : une dérogation pour les stations classées.

Maintenons la compétence communale : les intercommunalités sont l'émanation des communes.

Le tourisme relève du développement économique ; cela fait sens qu'il soit confié à l'intercommunalité, sans nier le caractère touristique de telle ou telle commune.

Il est très important que cette vision soit portée par l'intercommunalité, même si c'est principalement sur le territoire de la commune concernée.

Comment mutualiser la taxe de séjour ? Comment développer des projets communs, comme des sentiers ? Les stations thermales, les stations vertes sont-elles concernées ? Si la commune veut être moteur eu sein de l'intercommunalité, soit !

Vice-président d'une région à l'aménagement du territoire, j'ai eu un mal fou à coordonner les stations de ski du massif vosgien ; et je ne parle pas de celles du versant alsacien ! La communauté de communes est presque trop petite pour le tourisme.

Si ces communes veulent rester indépendantes, c'est souvent au détriment des autres membres de l'intercommunalité.

La commission des lois proposerait que le tourisme soit confié aux départements et aux régions, sans chef de file.

La communauté d'agglomération de près de 200 000 habitants que je préside a un office du tourisme intercommunal. Je n'ai déposé cet amendement que parce que les représentants des communes concernées m'avaient convaincu du bien-fondé de leur requête.

Je retire l'amendement après vous avoir rendu compte des remontées des auditions.
L'amendement n° 14 est retiré.
Article 19
L'amendement de coordination n° 16 est adopté.
Article 20
L'amendement de coordination n° 17 est adopté.

L'amendement n° 22 associe de plein droit les communautés d'agglomération ayant une population de plus de 150 000 habitants au pilotage des pôles de compétitivité dont le siège est situé dans leur territoire.

Aujourd'hui, elles les financent sans être vraiment consultées.
L'amendement n° 22 est adopté.
L'amendement n° 18 est retiré.
Article 21
L'amendement n° 20 est retiré.
Article 23

L'amendement n° 5 autorise les agents des organismes départementaux assumant les compétences susceptibles d'être transférées ou mises à disposition des métropoles à bénéficier d'une mise à disposition de la métropole à qui la compétence tourisme aurait été transférée. Il faut rassurer les quelque 2 000 agents potentiellement concernés.
L'amendement n° 5 est adopté.
Article 28

Les amendements n°s 10, 12 et 13 sont en cohérence avec les amendements des commissions de la culture. Ils créent des commissions thématiques tourisme, sport, culture.
L'amendement n° 10 est adopté.
Articles additionnels après l'article 28
L'amendement n° 12 est adopté, ainsi que l'amendement n° 13.
La réunion est levée à 19 h 55.