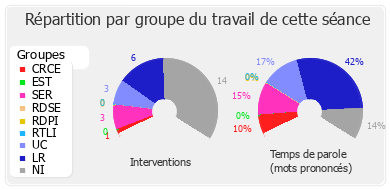Séance en hémicycle du 1er mars 2016 à 21h00
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à dix-huit heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle le débat sur le dispositif exceptionnel d’accueil des réfugiés, organisé à la demande du groupe Les Républicains.
La parole est à M. François-Noël Buffet, orateur du groupe auteur de la demande.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe Les Républicains a souhaité que puisse se tenir, ce soir, un débat sur la situation liée à la crise migratoire que nous connaissons depuis maintenant plusieurs mois.
Je voudrais tout d’abord rappeler quelques chiffres. En 2015, un million de migrants, venus de Syrie, d’Irak, d’Érythrée, parfois même d’ailleurs – par exemple, d’Afghanistan –, sont entrés sur le territoire européen. Les premiers chiffres pour 2016 font déjà état de plus de 110 000 arrivées sur les deux premiers mois de l’année, ce qui laisse augurer, à nouveau, que la barre du million de personnes sera atteinte cette année.
En ce début d’année, quelque 58 000 personnes sont déjà passées par la Grèce, un pays qui, sur le million de migrants enregistrés en 2015, a vu transiter sur son territoire 855 000 personnes, dont 500 000 entrées par l’île de Lesbos. Bien évidemment, des arrivées sont également constatées en Italie.
Tous ces migrants, en mettant le pied sur le sol européen, espèrent trouver un eldorado, celui que les membres des réseaux mafieux – ceux-là mêmes qui abusent de la plupart d’entre eux – leur ont sans doute promis. Malheureusement, ils se rendent vite compte que la situation n’est pas aussi simple.
D’abord désireux de rejoindre le nord de l’Europe, si possible la Grande-Bretagne, la majorité de ces migrants aspire ensuite à s’installer en Allemagne, répondant d'ailleurs, il faut le rappeler, à un appel que ce pays lui-même a lancé l’année dernière. Depuis lors, la situation paraît s’emballer.
En septembre 2015, la France décide d’accueillir, dans le cadre d’un programme de relocalisation, plus de 30 000 migrants pendant deux ans. L’Europe, quant à elle, décide d’instaurer un certain nombre de procédures. D’une part, elle renforce les moyens attribués au contrôle de ses frontières via l’agence FRONTEX ; d’autre part, elle crée des dispositifs de relocalisation, au travers de ce que l’on a appelé les hotspots, installés sur le territoire européen, singulièrement en Italie et en Grèce.
J’ai eu l’occasion, avec la commission des lois de notre assemblée, d’aller à Cergy-Pontoise et à Champagne-sur-Seine pour constater les premières mises en œuvre de ce programme de relocalisation. Plus récemment, nous nous sommes également rendus en Grèce, à Athènes, mais aussi à Lesbos, afin d’en savoir plus sur ce premier hotspot de Moria, destiné à accueillir les migrants.
Je vous livrerai un autre chiffre, si vous me le permettez, mes chers collègues : le passage entre la Turquie et l’île de Lesbos a concerné 10 000 personnes par jour dans le courant du mois d’août 2015, ce contingent oscillant entre 2 000 et 3 000 personnes pendant l’hiver.
En soi, la procédure de relocalisation est intéressante. Elle consiste à accueillir les populations migrantes dans des hotspots, en présence du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés – le HCR –, des différentes organisations, comme l’Organisation internationale pour les migrations – l’OMI - ou encore le Bureau européen d’appui en matière d’asile, parfois même de renforts nationaux, notamment français, pour « faire le tri », si l’on me permet cette expression un peu triviale.
On va donc identifier les migrants susceptibles de relever du droit d’asile et ceux qui sont plutôt des migrants économiques. Puis, par dérogation au dispositif instauré par le « règlement Dublin », on soulagera la Grèce en orientant les demandeurs d’asile vers des pays ayant formulé des offres de places. C’est le cas de la France, qui, je crois pouvoir le dire, a accueilli 201 personnes entre janvier et février, dans le cadre de ce programme de relocalisation.
Néanmoins, que constate-t-on ? Que les migrants ne relevant pas du droit d’asile bénéficient malgré tout d’un laissez-passer, car ils disposent d’un délai d’un mois – six mois pour les Syriens – pour retourner dans leur pays d’origine. Dès lors, et c’est un constat objectif, tout le monde reste !
Ceux qui peuvent bénéficier de la procédure d’asile – pour l’instant, ils sont très minoritaires – y ont recours, tandis que les autres se précipitent vers le nord de l’Europe. Ils prennent la route des Balkans ; en deux jours, ils sont en Allemagne et, quelques jours plus tard, en France, notamment à Calais. D’où la situation que nous connaissons aujourd'hui : 2 000 personnes accueillies à Calais au mois de juillet dernier, environ 4 000 au mois de septembre et probablement de l’ordre de 6 000, voilà quelques semaines.
Telle est la situation, malgré le travail que le Gouvernement a réalisé et que je reconnais, avec la prise en charge d’un important contingent de personnes – environ 2 000. Pour autant, même si nous reconnaissons la complexité de la situation, ce travail nous laisse parfois une impression de très grande difficulté.
Aujourd'hui, la situation se tend. Certains pays européens ont décidé de fermer leurs frontières, comme, récemment, la Belgique. Le ministre de l’intérieur allemand vient de déclarer que le nombre de réfugiés à la frontière turco-grecque devrait avoir baissé au 7 mars, sans quoi l’on verrait ce qu’il se passerait. On constate également un durcissement de la situation en Macédoine.
À Calais, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures : 125 containers permettent de loger 1 500 personnes ; le centre Jules Ferry accueille 500 personnes – c’est incontestable ; le démantèlement de la partie sud de la « jungle » est naturellement une bonne chose. À côté, la commune de Grande-Synthe vit d’autres événements tout aussi dramatiques, en l’absence, d’ailleurs, d’un certain nombre de dispositifs.
Voilà pourquoi ce débat ne doit pas simplement viser à dresser des constats ; nous devons essayer de tirer des conclusions et, peut-être, d’avancer quelques propositions.
Le plus difficile et le plus critiquable, me semble-t-il, c’est le rôle que détiennent les réseaux mafieux dans cette affaire, ainsi que le commerce parallèle et l’exploitation des personnes, notamment à Calais, mais pas seulement. Par ailleurs, on a récemment constaté une présence importante de mineurs isolés qui, naturellement, inquiète nos organisations internationales et nationales. Il se dit que 10 000 enfants auraient disparu durant cette crise migratoire. On sait enfin que les réseaux, comme No Border, par exemple, font un véritable contre-travail par rapport à l’action de nos services : ils incitent les migrants à ne pas avoir recours au dispositif d’accueil qui leur est proposé, voire à refuser de bénéficier des mesures d’asile.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne suis pas là pour dire que tout est bien ou que tout est mal. Je suis là parce que, me semble-t-il, nous avons besoin de trouver collectivement une solution, à tout le moins de dégager quelques pistes nous permettant de traiter une situation qui, au vu du contexte international, risque de durer !
Je le dis très franchement, nous avons toujours opéré un peu à contretemps. En tout cas, nous avons toujours eu un peu de retard par rapport aux événements. Je crois que, dans quelques jours ou quelques semaines, une rencontre aura lieu entre le Président de la République et la Chancelière allemande. Dans ce cadre, trois points mériteraient d’être soulignés.
Premier point, alors que l’on installe des hotspots sur le territoire européen, n’eût-il pas fallu réfléchir pour les créer dans les pays voisins des pays sources de cette migration ?
Il s’agirait, non pas de refuser sans humanité l’accès à notre territoire, mais d’éviter que des passeurs voyous profitent de ces personnes et les embarquent – la situation se renouvellera cet été – dans des aventures parfois mortelles. Il faudrait alors que l’on puisse, au travers d’une importante aide européenne, financer ces dispositifs et atteindre un standard d’accueil de haut niveau, ce que, je pense, nous appelons tous de nos vœux.
Deuxième point, se pose la question du rôle que notre pays doit jouer au plan européen pour redonner à l’Europe une véritable ambition en matière de politique migratoire, lui permettant de gérer cette crise et de ne pas agir au coup par coup.
Nous avons le sentiment, je le dis comme je le pense, que chacun joue sa partition personnelle, se souciant peu de ce qui se passe chez ses voisins et considérant que, hors de ses frontières, aucun problème ne se pose. Il faut absolument, monsieur le ministre, que par votre voix ou celle du Gouvernement, la France puisse reprendre une forme de leadership sur le sujet et imposer à l’Europe la mise en œuvre d’une politique migratoire claire.
Troisième point – le temps m’étant compté, j’en terminerai là –, qu’en est-il de notre propre situation nationale ?
S’agissant de Calais et de Grande-Synthe, la mise en place d’un hotspot n’est sans doute pas une bonne idée. En revanche, un dispositif plus structuré – il commence à l’être, je l’admets bien volontiers –, avec une présence permanente de tous nos services et un contrôle systématique des migrants présents, de manière à éviter la présence insupportable des réseaux mafieux et autres agitateurs, vous permettrait de traiter la situation de la meilleure manière possible.
Sans doute faut-il aussi, au regard des événements, repenser les accords du Touquet, en tout cas discuter avec vos collègues britanniques pour faire en sorte qu’ils prennent leur part de responsabilité et de charge dans le dispositif.
Voilà ce que je suis venu dire, ce soir, à cette tribune. Je ne suis pas venu polémiquer ; je cherche simplement à contribuer à un travail, qui est difficile. Dans ce cadre, constatons tout de même que nous avons besoin d’avoir une vision politique plus forte et, sans doute, d’y consacrer des moyens plus importants, afin de régler la question de la meilleure manière qui soit, de façon ferme et déterminée lorsque c’est nécessaire, mais aussi de façon accueillante à l’égard de ceux qui le méritent.
En tout cas, nous devons agir sans faiblesse et avec anticipation, afin que la situation actuelle – nous espérons qu’elle se règle très rapidement – puisse être traitée dans les meilleures conditions possible.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC. – MM. Alain Néri et Jean-Pierre Sueur applaudissent également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans le même esprit que François-Noël Buffet, je m’exprime à cette tribune en tant que « local de l’étape » Manche-mer du Nord. Loin de toute volonté polémique, moi aussi, je souhaite, en tant qu’élu national aujourd’hui et élu local hier, trouver des solutions pour ce territoire à partir des constats que j’y ai dressés.
En effet, j’ai eu l’occasion, à plusieurs reprises, de me rendre dans différentes villes du littoral directement confrontées à l’installation de camps de migrants sur leur territoire. Dernièrement, François-Noel Buffet l’a rappelé, nous nous sommes rendus à Calais, puis à Grande-Synthe.
Ces visites nous ont permis de mieux appréhender la problématique migratoire sur le territoire : une situation humanitaire indéniable ; la présence des associations, qu’il est important de voir fonctionner dans chaque camp ; l’action des activistes ; l’organisation des passeurs ; le manque de moyens des collectivités territoriales, ce qui soulève des interrogations ; l’épuisement des forces de l’ordre ; enfin, un avenir incertain pour des centaines, voire des milliers de personnes fuyant leur pays.
L’État est effectivement présent à Calais, mais cela semble si naturel dans de telles conditions que nous nous attendrions à plus de soutien de sa part.
Le dispositif des containers sur ce que l’on appelle vulgairement le « centre d’accueil provisoire », ou CAP, semble prendre toute sa dimension. En tout cas, cette solution est sûrement préférable à ce qui prévaut actuellement dans la « jungle ». Les centres d’accueil et d’orientation se sont organisés et les déplacements se font dans de bonnes conditions, semble-t-il.
Nous avons constaté aussi, monsieur le ministre, et cela relève probablement du jeu politique, la présence d’associations contestant très souvent l’action de l’État et des élus locaux.
Toutefois, il faut accentuer le travail sur certains points. Les contrôles au sein même des structures sont importants : l’État se doit d’y faire respecter la loi. Il essaie, monsieur le ministre, mais il faut bien avouer, si l’on regarde la situation de près comme je l’ai fait, que certaines parties de la « jungle » étaient des zones de non-droit ; la situation va sans doute s’améliorer à la suite du démantèlement de cette dernière.
Un autre point crucial est l’identification des migrants. Il est important qu’ils puissent être identifiés dès lors qu’ils entrent sur notre territoire.
Une solution intéressante semble avoir été trouvée par le centre d’accueil provisoire de Calais. Un procédé biométrique et chiffré permet d’identifier les gens qui entrent et qui sortent de ce camp. C’est une première étape avant d’aller plus loin. J’ai d’ailleurs tendance à rejoindre ceux qui proposent une identification au moyen d’une photographie ou par la prise des empreintes digitales – peut-être ces suggestions feront-elles l’objet d’une future proposition de loi. C’est important, surtout quand une procédure judiciaire doit être engagée.
On le sait, tout un système de désinformation a été mis en place. Nous comptons vraiment sur la présence des services de l’OFPRA, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui doivent être l’ennemi juré de ces passeurs qui désinforment les migrants en leur expliquant que, s’ils s’en remettent à l’office, jamais ils ne pourront rejoindre le Royaume-Uni.
Je serai plus bref au sujet de la commune de Grande-Synthe, qui mène un projet de requalification de son camp. À cet égard, monsieur le ministre, son maire se sent bien seul. Certes, il a le soutien des associations, mais il se demande où est l’État. Si ce projet est mené à bien, le nouveau camp qui verra le jour accueillera de nouveaux migrants. La présence de l’État sera alors essentielle pour que cela fonctionne bien.
Monsieur le ministre, j’avoue – pardonnez-moi cette tournure quelque peu vulgaire – que, étant donné son état actuel, je ne mettrais même pas mon chien dans le camp de Grande-Synthe.
Les flux migratoires ont également une incidence sur les enjeux économiques liés à notre littoral. Je souhaitais en parler ce soir à cette tribune.
Calais souffre, notamment d’un fort taux de chômage. Calais souffre, d’autant plus qu’elle voit le trafic transmanche perturbé quotidiennement, que ses hôtels, ses restaurants et ses commerces fonctionnent moins bien. À cet égard, nous nous inquiétons pour un très beau projet, celui du développement du port de Calais.
Xavier Bertrand a écrit voilà quelques jours au Président de la République et au Premier ministre britannique, insistant sur les enjeux économiques de la frange littorale. Nous ne devons pas négliger cette question, et mon plus grand souhait est que notre façade Manche-mer du Nord ne devienne pas un jour le mur de la Manche.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC. – M. Jean-Yves Leconte applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’afflux de réfugiés en Europe et en France s’inscrit dans le contexte international du conflit syrien, ainsi que de la menace que fait peser Daech en Irak, en Syrie et, désormais, aussi en Libye.
L’instabilité politique et les luttes de pouvoir embrasent le Moyen-Orient ; les millions de Syriens et d’Irakiens fuyant les zones de conflit menacent l’équilibre du Liban, de la Jordanie et de la Turquie. L’Afrique n’est pas épargnée non plus par l’islamisme radical.
Face à cette poudrière, nous constatons avec regret que la voix de l’Europe résonne toujours aussi faiblement. Pis encore, il nous faut déplorer amèrement la lenteur du déploiement des initiatives européennes coordonnées et collectives.
La liste commune des pays d’origine sûrs est toujours en discussion. Le renforcement de FRONTEX et sa transformation en une agence véritablement efficace de gardes-frontières aux limites extérieures de l’Union européenne attendent encore, à tel point que nous assistons aujourd’hui à la fermeture temporaire des frontières de nombreux États membres, comme la semaine dernière dans ma région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, les Belges ayant décidé de contrôler la frontière. C’est aux antipodes d’une politique migratoire coordonnée et commune.
Nous aurons retenu du dernier Conseil européen des 18 et 19 février dernier que la question de l’accueil des réfugiés risque de conduire l’Union européenne à son éclatement, tout aussi fortement que le Brexit. D’ailleurs, on perçoit bien l’imbrication des deux sujets.
Sur les onze hotspots prévus par la Commission européenne, trois étaient opérationnels au 1er janvier 2016. François-Noël Buffet l’a rappelé, nos collègues de la commission des lois, lors de leur déplacement à Lesbos, ont été informés de l’ouverture imminente de quatre hotspots grecs supplémentaires. Peut-être pourrez-vous, monsieur le ministre, nous en dire plus sur le nombre de réfugiés enregistrés grâce à ces nouveaux centres de passage ?
S’agissant du processus de relocalisation entre pays membres de l’Union, l’accord de septembre dernier portait sur 160 000 réfugiés, dont plus de 30 000 en France. C’est là un effort assez modeste si nous le mettons en regard du million de personnes arrivées en Europe en 2015, plus de 850 000 étant passés par la seule Grèce.
À Lesbos, la délégation de la commission des lois a pu voir que le mécanisme de relocalisation montait en puissance lentement : 94 relocalisés pour le mois de janvier 2016, c’est loin du chiffre mensuel de 1 450, qui avait été annoncé initialement par M. Arhoul, préfet coordinateur national chargé de l’accueil des migrants.
Après les attentats de novembre dernier, la France a souhaité, et c’est compréhensible, relever le niveau des contrôles sur l’identification des réfugiés. Estimez-vous, monsieur le ministre, que ces contrôles ont atteint un niveau de sécurité satisfaisant ? Le rythme d’arrivée des réfugiés en provenance des hotspots sera-t-il ainsi amené à s’accélérer en 2016 ?
En 2015, l’OFPRA et l’OFII, l’Office français de l'immigration et de l'intégration, ont été dotés de moyens humains supplémentaires, qui ont permis de traiter 79 130 demandes d’asile – un chiffre en hausse de 22 % – et d’améliorer sensiblement le nombre de décisions favorables accordées par l’OFPRA. Toutefois, aujourd’hui, vu l’évolution de la situation, il serait justifié, me semble-t-il, que ses moyens augmentent encore et que le nombre de places d’hébergement soit revu à la hausse.
Ces chiffres montrent le décalage persistant entre les pays d’origine d’une majorité des demandeurs d’asile en France, qui vient, outre de la Syrie, principalement du Soudan, du Kosovo et de la République démocratique du Congo, et ceux des réfugiés enregistrés en Grèce – 95 % des réfugiés y sont syriens, irakiens ou afghans.
En septembre dernier, monsieur le ministre, vous aviez fait appel aux collectivités territoriales volontaires pour créer des places d’hébergement pour les 30 000 réfugiés relocalisés. Cet appel a été entendu, et à la date du 10 février 2016, quelque 1 680 logements avaient été enregistrés sur la plateforme nationale pour le logement des réfugiés, équivalant à 5 200 places d’hébergement.
Or peu de ces logements ont été mobilisés. Depuis plusieurs semaines, les collectivités qui s’étaient portées volontaires pour accueillir des réfugiés de manière diffuse se voient sollicitées par les préfets pour accueillir temporairement dans des centres collectifs des migrants de Calais.
Cela suscite des interrogations et un malentendu ; non qu’il ne faille pas accueillir les migrants, mais sur la forme. Les collectivités volontaires pensaient qu’elles auraient vocation à insérer des familles sur leur territoire et elles avaient mobilisé leur population en ce sens. Elles se trouvent, au terme d’une concertation souvent très limitée, confrontées à une tout autre forme d’accueil. Prévenus souvent au dernier moment, les élus ont bien du mal à expliquer à leurs concitoyens ce changement sur lequel ils ne disposent eux-mêmes que de très peu d’informations, ne sachant en général ni le nombre de migrants accueillis ni la durée de leur séjour.
Comme le rappellent justement les associations présentes à Calais, ces migrants ont en général un projet de vie qu’ils voient outre-Manche. Les persuader de demander l’asile en France est donc une mission difficile, pour laquelle l’État dépense aujourd’hui beaucoup de temps, d’énergie et de moyens. Ne serait-il pas plus raisonnable que le Royaume-Uni prenne aussi sa part de l’effort ?

Considérez-vous comme satisfaisant, monsieur le ministre, que le Royaume-Uni préfère aller recruter un quota de réfugiés dans les camps jordaniens ? En ma qualité d’élue de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, je ne peux qu’inviter le Gouvernement à rouvrir une discussion avec nos voisins britanniques sur cette question : il faudrait peut-être que le Royaume-Uni prenne sa part dans l’accueil des migrants actuellement stationnés à Calais.

Bien sûr, cher collègue.
Pouvez-vous également, monsieur le ministre, nous confirmer les derniers chiffres disponibles sur l’opération d’évacuation de la zone sud du camp qui a eu lieu précédemment, et nous informer des résultats du travail que vous menez depuis ces derniers jours pour procéder au démantèlement de la « jungle » de Calais ?
Un article du Figaro paru le 23 février dernier relatait que 15 % des 2 691 migrants de Calais délocalisés n’effectuaient aucune démarche en vue d’une demande d’asile et qu’environ 20 % d’entre eux repartaient des centres sans laisser de trace. Est-ce exact ou non ? Si je vous interroge sur ce point, c’est que je crains que, faute d’une maîtrise suffisante, les migrants ne soient encouragés à retourner vers la « jungle ».
De ce point de vue, nous sommes satisfaits du travail que vous menez actuellement à Calais. La question que je pose est la suivante : comment les collectivités et l’État peuvent-ils œuvrer au mieux ensemble, en amont ? En effet, nous sommes loin d’être au bout du processus et nous ne pourrons pas poursuivre durablement de cette façon avec l’assentiment des territoires.
Les informations remontant de ces communes volontaires nous interpellent également quant aux moyens que l’État est décidé à leur octroyer.
À l’heure actuelle, l’État assure une aide de 1 000 euros par logement et propose un fonds de 50 millions d’euros permettant de financer des travaux de réhabilitation. Mais les autres coûts, en particulier les frais relatifs à la scolarisation des enfants ou à l’apprentissage du français comme langue étrangère, restent à la charge des communes. Pour faire face aux besoins constatés, les préfets inciteraient les élus à s’appuyer sur les associations, sur les bénévoles, sur les bibliothèques municipales ou encore sur les structures culturelles existantes…
Ces initiatives sont bien maigres, en comparaison de l’aide de 5 000 euros par réfugié versée en Allemagne.
Pourtant, de son côté, l’Union européenne accorde, par réfugié accueilli, un montant de 6 000 euros aux pays membres. Le Conseil des communes et régions d’Europe, le CCRE, ainsi que plusieurs associations d’élus demandent que ce soutien financier européen puisse être ouvert directement aux communes, notamment via le fonds « Asile, migration et intégration ». Monsieur le ministre, avez-vous l’intention de prendre en compte cette requête ?
Enfin, comme je l’ai souligné en septembre 2015 lors de l’annonce du plan de relocalisation, l’accueil de populations traumatisées par la guerre et l’exil ne saurait relever d’un seul mouvement compassionnel, dont on a observé les limites depuis les attentats du 13 novembre. Ce travail impose une solide réflexion, une planification étroite en lien avec les collectivités, pour ne pas ajouter de la pauvreté à la pauvreté. Il exige un accompagnement dans la durée et un effort financier adéquat.
À cet égard, je me joins une nouvelle fois à Jean-François Rapin : vous le savez, dans ce domaine, Calais constitue un exemple significatif. L’économie de ce territoire, qui n’avait franchement pas besoin de cela, a été très violemment frappée par la réalité dans laquelle elle se trouve. Le travail étroit que je viens d’évoquer n’en sera que plus nécessaire pour assurer un véritable maillage territorial, une anticipation des situations, une structuration de notre capacité à répondre, collectivement, à ces enjeux.
En concentrant la douleur et la misère sur quelques points, on ne pourra que susciter le rejet de la part des populations locales. À l’inverse, il nous faut opérer un mouvement d’ensemble auquel nous prenons toute notre part, mais une part maîtrisée et responsable. Ainsi, l’État et les territoires prouveront qu’ils maîtrisent la situation, qu’ils sont à même d’honorer les engagements de la convention de Genève. Parallèlement, on évitera d’opposer la souffrance de Français en difficulté à celle de réfugiés qui arrivent en France.
En procédant de cette manière, ces diverses populations pourront vivre convenablement et, à l’avenir, les collectivités territoriales comme le Gouvernement, que vous représentez, pourront mener une politique claire d’accueil maîtrisé. Je le répète : en la matière, l’État doit prendre toute sa responsabilité, aux côtés de collectivités qui ne seront pas mises devant le fait accompli !
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et sur plusieurs travées du groupe Les Républicains. – MM. Jean-Pierre Sueur et Pierre-Yves Collombat applaudissent également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, « Réfugiés : l’Europe se désintègre », titrait Le Monde de ce week-end.
L’Autriche et les pays des Balkans ont décidé unilatéralement de filtrer les entrées sur leur territoire. La Grèce a rappelé son ambassadeur à Vienne. La justice a autorisé l’évacuation de la « jungle » de Calais. La Belgique a rétabli des contrôles à la frontière française.
Incapable de surmonter la crise des migrants, comme en témoigne la réunion houleuse des ministres de l’intérieur qui a eu lieu jeudi dernier, l’Union européenne laisse se jouer une tragédie humaine redoutable. C’est dans ce contexte que nos collègues du groupe Les Républicains nous invitent à débattre de l’accueil des réfugiés.
Le mot « réfugié » recouvre une définition juridique précise.
L’article 1er de la convention de Genève de 1951, ratifiée par 145 pays, définit un réfugié comme une personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence habituelle, et qui, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, craint avec raison d’être persécutée et ne peut se réclamer de la protection de ce pays ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
Pour les États, seuls habilités à accorder le droit d’asile, est considérée comme réfugiée une personne qui a déposé une demande d’asile et a obtenu le droit d’asile après avoir apporté la preuve que sa vie est sérieusement menacée dans son pays.
Tout réfugié serait donc un migrant, mais tout migrant ne serait pas réfugié…

Pourtant, la pratique de l’asile montre qu’il est erroné de distinguer radicalement les demandeurs d’asile et les migrants économiques. Tout comme les demandeurs d’asile ont des raisons économiques de fuir leur pays, il existe des exploitations économiques qui relèvent de la persécution. Par exemple, l’esclavage existe toujours en Mauritanie.
Les discours politiques et médiatiques qui s’acharnent à distinguer différentes catégories de migrants relèvent souvent d’une vision discriminante.
Aujourd’hui, le tri entre « bons » réfugiés et « mauvais » migrants s’effectue en Grèce dans les quatre hotspots, ou « centres d’accueil », désormais opérationnels. Ce constat a été rappelé : en 2015, ce pays a accueilli plus de 856 000 migrants, soit 82 % de l’ensemble des personnes arrivées en Europe. En outre, entre 1 200 et 3 000 réfugiés continuent d’accoster chaque jour dans les îles de la mer Égée. Environ 40 % d’entre eux sont aujourd’hui refoulés et voués à rester bloqués en Grèce.
Mercredi dernier, le Premier ministre grec Alexis Tsipras a menacé de refuser tout accord européen si le fardeau de la crise migratoire « n’est pas partagé d’une manière proportionnelle » par les pays membres de l’Union européenne.

M. Tsipras a ajouté : « Il faut le plus large consensus politique sur cette question. Nous n’allons pas accepter que notre pays se transforme en un entrepôt d’êtres humains. »
Au même moment, l’Autriche réunissait les pays des Balkans pour y coordonner la fermeture des frontières.
Le gouvernement français a le devoir d’apporter son soutien à la Grèce et à son Premier ministre.
Mise en œuvre via deux décisions du Conseil de l’Union européenne des 14 et 22 septembre 2015, la procédure de « relocalisation », qui consiste dans le transfert de demandeurs d’asile à partir de la Grèce et de l’Italie vers d’autres États membres de l’Union européenne, doit être revue et rendue véritablement effective.
Dans un premier temps, l’Europe s’est engagée à « relocaliser » 120 000 personnes en deux ans. Puis, on a évoqué le chiffre de 160 000 personnes. Mais, à l’heure actuelle, cette politique des quotas se solde par à peine quelques centaines de relocalisations effectives en France. Parallèlement, en 2015, 80 000 demandeurs d’asile se sont manifestés dans notre pays.
Je rappelle, puisque cela semble nécessaire, que personne ne quitte son pays par plaisir. Toutes les migrations de populations dépendent de l’ordre économique mondial établi et des rapports de force politiques entre les États.
Les guerres civiles, l’effondrement d’États, la barbarie née de vingt ou trente années de conflits ont provoqué une crise humanitaire sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale.
En conséquence, chacun doit prendre ses responsabilités.
Pour l’heure, la priorité est d’assurer la sécurité de ces réfugiés, en les libérant de l’exploitation des passeurs et des réseaux mafieux.
Si cet accueil relève de la compétence régalienne de l’État en matière de droit d’asile, sa mise en œuvre concrète repose pour beaucoup sur les collectivités territoriales.
La délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation l’a souligné en octobre dernier : l’accueil des réfugiés en France doit faire l’objet d’une coproduction territoriale, ce qui nécessite notamment d’établir un diagnostic des collectivités et des moyens qu’elles peuvent déployer pour contribuer à l’effort national. Dans le même temps, les collectivités territoriales attendent un soutien accru de l’État.
Par le passé, le département dont je suis l’élu, le Val-de-Marne, était déjà fortement sollicité pour l’accueil des mineurs étrangers isolés. L’expulsion engagée de la « jungle » de Calais, où 326 mineurs isolés ont été identifiés, va rendre cette question encore plus urgente. Elle exigera des négociations beaucoup plus serrées avec le Royaume-Uni, pour permettre aux mineurs concernés de bénéficier du regroupement familial.
En septembre dernier, l’État a sollicité les collectivités de notre département, dans la perspective d’un fort afflux de réfugiés syriens. Très rapidement, dès le 23 octobre, nous avons mis à sa disposition, bien entendu à titre gratuit, un bâtiment de la commune de Fontenay-sous-Bois regroupant plusieurs logements, pour l’hébergement provisoire de réfugiés. Malheureusement, le bilan des réalisations est loin d’être concluant.
La convention signée avec l’État, pour six mois, arrive à échéance très prochainement. Or seule une famille syrienne de cinq personnes a été accueillie, …

… sur les quarante-sept personnes relogées, lesquelles sont principalement évacuées des squats de Paris. Bien entendu, tel n’était pas le projet initial.
L’exemple du Val-de-Marne est révélateur d’un fait désormais avéré : si l’État peine à relocaliser les réfugiés, c’est parce que ces derniers, dans leur grande majorité, ne veulent pas rester en France.
Les campagnes de stigmatisation et de peur de l’étranger, largement alimentées par la propagande de l’extrême droite, ont fortement terni l’image de la patrie des droits de l’homme.
Pourtant les chiffres le montrent, l’idée d’une « invasion », sur laquelle le Front national continue d’appuyer sa propagande, relève bel et bien du fantasme. Elle trahit un mépris insupportable à l’égard d’hommes, de femmes et d’enfants qui vivent un drame épouvantable.
Monsieur le ministre, la France est encore loin de prendre toute sa place dans l’accueil de réfugiés qui sont poussés à l’exil au péril de leur vie. Or, à l’instar de l’Union européenne et des États-Unis, notre pays porte sa part de responsabilité dans le chaos que nous connaissons en Syrie, en Irak ou en Libye.
Ces réfugiés ne disparaîtront pas par la répression et la fermeture des frontières. Seuls le rétablissement d’une paix durable et l’anéantissement de Daech permettront d’envisager leur retour. Mais, dans l’immédiat – c’est bien entendu sur ce point que se mobilisent les élus du groupe CRC –, il est de notre devoir de les accueillir avec dignité et humanité.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC. – Mme Esther Benbassa ainsi que MM. Jean-Pierre Sueur et Alain Néri applaudissent également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le débat de ce soir n’a pas pour objet les politiques migratoires. Il porte sur l’accueil de familles qui fuient la mort. En prenant la route, ces hommes et ces femmes savent très bien qu’ils mettent en danger leurs enfants, qu’ils devront payer des passeurs, lesquels ne sont pas nécessairement fiables. Mais, ils en sont également persuadés, s’ils ne quittent pas leur pays, ils n’échapperont pas à la mort. C’est en ces termes que nous devons aborder cette discussion.
Il ne saurait être question, au sujet des migrants, de seuils de tolérance ou d’acceptation par nos sociétés. Les personnes dont il s’agit ont besoin de protection. En tout cas, c’est à celles qui implorent notre secours que nous devons dédier ce débat.
Dès lors, évoquer de tels quotas reviendrait à admettre un seuil de tolérance de camps de la mort, d’horreur, de refus de protéger.
L’accueil est notre premier devoir.
Selon Europol, parmi les migrants, 10 000 enfants auraient disparu au cours de l’année dernière.

Ce chiffre ne peut que nous effarer. Il nous impose d’aborder le problème autrement.
Au regard de la situation actuelle, force est de l’admettre : aujourd’hui, l’Europe est menacée par ses fantasmes, elle semble totalement terrassée par ses peurs.
Sur le territoire européen, un demi-milliard d’habitants a reçu moins de 1 million de personnes. Dans le même temps, la Jordanie, qui compte 8 millions d’habitants, en a reçu plus de 2 millions. Le Liban, avec ses 6 millions d’habitants, en a lui aussi reçu plus de 2 millions. Quant à la Turquie, qui compte plus de 80 millions d’habitants, elle a recueilli plus de 2 millions de réfugiés.

L’Europe ne peut se contenter d’imaginer qu’il faut payer ces trois États pour continuer à « sous-traiter » le problème.
En outre, on ne peut pas dire un jour à la Turquie : « Ouvrez vos frontières, car des bombardements russes menacent la vie de dizaines de milliers de personnes », puis, quelques heures plus tard, lui déclarer : « Faites absolument tout pour garder tous ces réfugiés sur votre territoire ».
Mes chers collègues, en préambule, je tiens parallèlement à formuler quelques rappels.
Tout d’abord, le droit d’asile est un droit individuel. Il doit être appliqué de manière individuelle, et non par nationalité. Lorsque, à la frontière gréco-turque, on accepte certaines entrées en en refusant d’autres, selon le critère de la nationalité, on se livre à une violation du droit d’asile.
La situation actuelle dans les Balkans le prouve clairement : sans coopération européenne, on ne pourra rien faire. §Pourtant, tous les États européens semblent, aujourd’hui, dans la situation de conducteurs freinant sur une plaque de verglas, au lieu d’essayer de reprendre une trajectoire.
On le sait tous, c’est dans la solidarité et dans la coopération qu’il sera possible d’agir. Cependant, chacun, saisi par un réflexe de peur, se referme sur lui-même et empêche de ce fait toute solidarité.
Ce n’est que par un renforcement de la coopération européenne que l’on pourra lutter contre les crises humanitaires que l’on constate, mais aussi contre les crises sécuritaires qui peuvent être engendrées par cette situation et contre l’économie du crime qui se développe autour des passeurs chaque fois qu’il y a des frontières.
C’est important, mais il est aussi important de savoir dire clairement à l’Europe centrale ce que l’on attend d’elle. Elle doit en effet avoir en mémoire ce qu’elle a pu vivre : il ne s’agit pas de la stigmatiser mais de la mettre devant ses responsabilités. On voit aujourd’hui se reconstituer volontairement sur ce sujet, de manière quelque peu étonnante, le pacte de Varsovie. L’attitude de la Roumanie, de la Hongrie et de la Slovaquie est particulièrement inquiétante pour la solidarité européenne. Cela est du ressort de ces pays, mais il faut leur en parler.
Je suis aussi inquiet de la situation en Grèce. Près de 8 000 personnes sont aujourd’hui bloquées à la frontière avec la Macédoine, frontière dont la militarisation est de plus en plus sensible. Une pression européenne s’exerce toujours plus fortement sur la Grèce autour de l’accueil des réfugiés, alors même que, depuis deux ans, la Grèce avait fait beaucoup d’efforts, en particulier pour leur premier accueil et la politique d’asile.
La situation en Macédoine est aussi inquiétante : aucune identification claire n’y est effectuée, alors qu’on y constate des flux encore plus importants qu’en 2015.
Alors, dans cette situation, la France a pris l’engagement d’accepter la relocalisation de 30 000 personnes. Le fait est qu’aujourd’hui, comme cela a déjà été relevé par Christian Favier, assez peu d’exilés demandent en fin de compte une relocalisation en France. Cela doit nous interroger sur notre attractivité.
Je dois cependant rendre malgré tout hommage à l’OFPRA, dont nous avons vu le travail en Grèce, en particulier pour les mesures entreprises pour accomplir la promesse française, dont j’espère qu’elles prendront de l’ampleur. Il faut aussi garder à l’esprit que tous les pays n’ont peut-être pas les mêmes capacités et compétences que nous dans ces domaines et accompagner en conséquence ces pays pour y faciliter la relocalisation de réfugiés.
J’espère aussi que le sommet Union européenne-Turquie permettra de constater que des préoccupations communes existent en termes de lutte contre les passeurs. Certes, compte tenu de sa situation intérieure, la Turquie n’est pas aujourd’hui un pays sûr : si l’on ignorait ce fait, nous serions d’ici peu frappés par d’autres crises. Il faut néanmoins savoir trouver, ensemble avec la Turquie, des moyens de protéger ceux qui sont encore sous les bombardements russes. Si nous ne gardons pas tout cela en tête, alors l’Europe perdra son âme et n’aura plus de sens, d’image ni de force.
Permettez-moi en conclusion de faire trois propositions.
En premier lieu, il me semble important d’être capable de développer, dès la Turquie, une identification unique des personnes qui veulent rejoindre l’Europe, afin de ne pas répéter des opérations d’identification moyennes d’une partie du flux de réfugiés en Grèce, après qu’ils ont pris le risque de traverser la Méditerranée, puis encore en Macédoine, en Serbie et de nouveau à l’entrée en Croatie. Une identification unique, c’est plus de sécurité et plus de capacités à suivre les choses.
En deuxième lieu, je proposerai de revoir le fonctionnement et les fins d’Eurodac. Il faut développer les capacités de ce système et développer le nombre de bornes d’enregistrement. Il faudrait également réfléchir à l’avenir du système de Dublin. On voit aujourd’hui la Grèce enregistrer toutes les arrivées, ce qui, selon le système de Dublin actuellement en vigueur, la rend entièrement responsable. Cette situation ne peut plus durer très longtemps.
En troisième lieu, je suggérerai d’ouvrir la possibilité de se porter candidat à la relocalisation en Europe aux réfugiés dès la Turquie, le Liban et la Jordanie. Il n’est pas logique d’être obligé, somme toute, de demander à ces gens de prendre le risque de traverser, avec leurs familles la mer Égée pour qu’ils puissent ensuite bénéficier éventuellement de notre protection.
Je n’entends pas par cette proposition la création de hotspots : cela impliquerait en effet la création de camps européens dans des pays tiers, qui ne sont pas nécessairement prêts à l’accepter. Il s’agit plutôt, dans mon esprit, de pouvoir enregistrer dans ces pays des demandes de relocalisation : cela me paraît indispensable.
L’annonce faite aujourd’hui d’une rencontre entre le Président de la République et la Chancelière allemande avant le sommet Union européenne-Turquie est à mes yeux importante. Ainsi, enfin, une initiative franco-allemande sur ce dossier pourrait permettre à l’Europe de retrouver son âme, de parler fortement avec la Turquie pour exprimer les préoccupations que nous avons en commun et, plutôt que de subir la situation, de vouloir la maîtriser ensemble avec la Turquie. À ce propos, on ne dira jamais assez combien nous payons aujourd’hui le prix de l’abandon de la perspective européenne de la Turquie en 2007.
Voilà les préoccupations et les propositions que je souhaitais exprimer. Aujourd’hui, en vérité, l’Union européenne se trouve sur ce sujet à la croisée des chemins. L’Europe, c’est la paix et la solidarité : elle a été construite pour cela. Or nous sommes en train de tout perdre.
Aussi, le couple franco-allemand a besoin de prendre une initiative sur cette question. Nous avons certes des préoccupations différentes mais elles convergent quant aux migrations, à l’accueil des réfugiés et à la sécurité : cela doit pouvoir de nouveau constituer une force pour l’Europe !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – Mme Valérie Létard et M. Pierre-Yves Collombat applaudissent également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la guerre civile syrienne, l’aggravation du conflit en Libye et la situation dramatique de l’Érythrée ont jeté sur les mers et sur les routes des millions de femmes, d’hommes et d’enfants dont la priorité est de survivre. Ils tentent de gagner l’Europe dans les conditions dramatiques que l’on sait, espérant y trouver protection et sécurité.
En décembre 2015, l’Organisation internationale pour les migrations et le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés faisaient état de 1 005 504 entrées de migrants en Europe par voies maritime et terrestre.
Face à cette situation sans précédent, le Conseil de l’Union européenne a notamment pris la décision, en septembre dernier, de mettre en œuvre une procédure dite de « relocalisation », consistant à transférer les demandeurs d’asile arrivant en Grèce et en Italie vers d’autres États membres, chargés de l’étude de leur demande d’asile.
Cette procédure, qui devait concerner 160 000 personnes en deux ans, semblait constituer un pas en avant vers davantage de solidarité intra-européenne. La France prenait également ses responsabilités, s’engageant à accueillir environ 30 000 réfugiés dits « relocalisés » en deux ans.
Aujourd’hui, près de six mois après la mise en place de cette procédure et alors que notre commission des lois revient d’un voyage en Grèce dans le cadre de la mission de suivi et de contrôle du dispositif d’accueil des réfugiés, qu’en est-il ?
Eh bien, le moins que l’on puisse dire, mes chers collègues, c’est que la mise en place du programme de relocalisation est laborieuse !
Au 10 février, 218 personnes avaient été transférées de Grèce et 279 d’Italie vers les autres États membres ; la France pour sa part en avait accueilli 135. Au vu de tels chiffres, il pourra sembler dérisoire que notre Premier ministre affirme, comme il l’a fait lors de la conférence de Munich sur la sécurité des 12 et 13 février, que la France ne pourra accueillir plus que les 30 000 réfugiés prévus.
Cent trente-cinq personnes ! On est loin de la marée humaine annoncée par certains, parfois à des fins électoralistes. Comment expliquer ce phénomène alors que le cadre réglementaire existe et que la situation demeure si préoccupante ?
Rappelons aussi que la relocalisation ne concerne que les Syriens, les Érythréens et les Irakiens ; par ailleurs, elle ne permet pas le choix du pays de transfert. En fin de compte, environ 40 % des personnes arrivant en Italie et en Grèce ne relèvent pas de cette procédure. Nombre de ceux qui pourraient en bénéficier préfèrent ne pas faire de demande plutôt que de se voir imposer un pays de destination et de risquer de ne pas retrouver leurs proches.
Comme l’ont relevé nos collègues de la commission des lois lors de leur déplacement en Grèce, « le programme de relocalisation est encore trop timide et d’une échelle sans commune mesure avec les besoins réels ». Au rythme où vont les choses, il faudrait plusieurs dizaines d’années pour relocaliser dans les pays de l’Union européenne les 160 000 personnes prévues, et cela sans même compter, bien sûr, les milliers d’autres qui continuent d’arriver.
Il est heureux qu’Angela Merkel, ne cédant ni à la pression de son propre parti ni aux critiques venant de toutes parts, y compris des pays de l’Union européenne, continue de nous donner une leçon d’humanité. Quel contraste avec les déclarations de notre Premier ministre le 13 février ! « Nous ne pouvons pas accueillir plus de réfugiés. » Voilà une phrase qui laissera des traces dans l’histoire de notre pays.
Rien de très nouveau, en vérité. Rappelons-nous seulement l’accueil réservé en 1938 aux juifs fuyant l’Allemagne nazie et l’Autriche après l’Anschluss ou, en 1939, lors de la Retirada, aux milliers de Républicains espagnols entassés dans des camps d’internement.
Notre gouvernement a le devoir d’agir. Il est intolérable de durcir le ton dans les sommets internationaux et de recourir à ce fameux langage de fermeté, cédant ainsi au populisme, souvent teinté de xénophobie, qui ronge notre pays.
Au nom de la simple dignité humaine, nous sommes liés par les devoirs incombant à cette « patrie des droits humains » dont nous claironnons les principes sans prendre toujours concrètement soin de nous y tenir.
Essayons, de grâce, de ne pas l’oublier. Les autres pays européens sont également tenus de s’associer au mouvement de solidarité pour accueillir les réfugiés. Les égoïsmes nationaux en la matière risquent à la longue de faire craquer l’Union européenne.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC. – M. Pierre-Yves Collombat applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il me semble tout d’abord nécessaire de souligner que, sous le vocable « réfugié », très vite devenu unique et obligatoire, se cache une très forte disparité d’individus.
S’il existe à n’en pas douter quelques véritables réfugiés qui fuient la guerre, un grand nombre d’entre eux, pour ne pas dire la majorité, constituent en réalité une immigration économique.
Mme Éliane Assassi s’exclame.

En outre, les images de ces cohortes humaines – 10 000 entrées par jour, a-t-on entendu ici tout à l’heure –, dont les médias nous inondent chaque jour, démontrent qu’il s’agit là d’une population essentiellement masculine et relativement jeune.

Quant à l’accueil à proprement parler, force est de constater qu’il est imposé à ceux qui vont devoir, que cela leur plaise ou non, vivre aux côtés de ces populations : j’ai nommé les Français !
Nos compatriotes, celles et ceux qui nous ont élus, sont les grands oubliés, une fois de plus, de ce faux débat…

… qui, chacun le sait, se conclura dans un bel élan d’humanisme et, selon la formule consacrée par M. le ministre de l’intérieur, par l’application de la tradition d’accueil séculaire de la France, héritée de 1793…

… et qui fait l’honneur et les valeurs de la République. Rangez vos mouchoirs !
Nous savons pertinemment que ce gouvernement, comme les précédents, ne s’intéresse plus à ce que souhaitent nos compatriotes, alors qu’il devrait imiter et non fustiger la Hongrie, qui a sagement et démocratiquement appelé son peuple à se prononcer par la voie du référendum, consciente que le phénomène qui la touche engage son avenir comme il engage le nôtre.

Tant de raisons justifient que nous nous opposions à cette déferlante migratoire !
La première : nous n’avons pas les moyens d’appliquer votre idéologie, avec une dette abyssale, 6 millions de chômeurs, 8 à 9 millions de pauvres, une crise du logement et, à Marseille, des écoles qui s’effondrent. La Déclaration des droits de l’homme et autres discours coupés des réalités ne suffiront pas à absorber cette misère.
Mmes Esther Benbassa et Éliane Assassi s’exclament.

Nul doute cependant que cette manne bon marché qui acceptera de travailler pour des salaires au rabais fera le bonheur du MEDEF, qui imitera ainsi son modèle allemand.

Cette concurrence déloyale de l’intérieur, nos compatriotes devront la subir, …

… puisque les syndicats, qui sont pourtant censés les défendre, sont favorables à l’accueil et donc à l’exploitation de ces populations.

Il n’y a pas que les passeurs qui s’enrichissent sur le dos de la misère.

Quant à la cohésion et à l’identité nationales, elles n’en seront que davantage fragilisées. Il n’est qu’à observer la guerre qui se déroule à Calais et qui a plongé les habitants ainsi que les forces de police et de gendarmerie dans l’enfer de ce que vous osez encore appeler le « bien vivre ensemble ».
Quant au risque terroriste, il s’est déjà manifesté dans l’horreur que l’on sait au mois de novembre dernier à Paris
Plusieurs sénateurs du groupe socialiste et républicain frappent sur leur pupitre en signe d’impatience.

Je conclus, monsieur le président. Merci de me laisser un petit peu plus de temps, comme vous l’avez fait pour les collègues qui se sont exprimés avant moi !

M. Stéphane Ravier. Enfin, et ce point est souvent oublié de vos analyses, ces immigrés représentent les forces vives des pays d’origine.
M. Daniel Raoul frappe sur son pupitre en signe d’impatience.

… dans l’intérêt de tous, celui de nos compatriotes comme celui de ces populations, et forts du constat de l’échec de l’Europe à maîtriser la situation, retrouvons ici aussi notre souveraineté.

En effet, le seul débat que nous devons ouvrir urgemment porte non pas sur l’accueil, mais bien sur le retour de ces populations dans leur pays d’origine.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, déjà peu lisible pour l’observateur moyen – c’est un euphémisme –, la politique migratoire européenne, ou plutôt l’absence de politique migratoire européenne, en train de virer au « sauve-qui-peut » prend un air « surréel » vu de la Grèce qui a accueilli l’année dernière 911 000 réfugiés – jusqu’à 7 000, parfois 10 000 réfugiés certains jours –, en provenance de Syrie, d’Irak, d’Afghanistan, d’Érythrée et de bien plus loin.
Telle est en tout cas mon impression en tant que membre de la mission sénatoriale chargée du suivi du dispositif exceptionnel d’accueil des réfugiés, qui vient de se rendre à Athènes et à Lesbos, cette île de 70 000 habitants qui, à quelques kilomètres des côtes turques, accueillit 500 000 réfugiés en 2015 et enterra leurs morts.
« Surréel », parce que ce phénomène hors norme a été traité et continue de l’être par les responsables européens avec les procédures de routine, c'est-à-dire les procédures légales. Comme on le sait, celles-ci reposent sur la distinction entre les demandeurs d’asile et tous les autres immigrants : les premiers sont accueillis de droit, parce qu’ils sont persécutés ou victimes d’une guerre, les seconds sont immédiatement expulsables s’ils se trouvent en situation irrégulière, ce qui est massivement le cas. D’où l’importance centrale accordée à l’identification des arrivants et de leur pays d’origine, qui permet de distinguer les légitimes demandeurs de « protection internationale » des migrants économiques. D’où la fixation de Bruxelles et des pays d’éventuelle destination sur la mise en place de points de passage – les fameux hotspots –, où les arrivants seront identifiés, triés et enregistrés dans le fichier Eurodac.
Cette question réglée, l’intendance est censée suivre, sauf qu’il faut deux conditions : que les flux de réfugiés restent modérés et pas trop erratiques, d’une part, que les déboutés du droit d’asile puissent être effectivement renvoyés d’où ils viennent, d’autre part. Or ces conditions ne sont plus remplies.
Même la France, dont la situation n’est pas celle de la Grèce, ne parvient pas, malgré tous ses efforts et des moyens bien supérieurs, à renvoyer tous les déboutés du droit d’asile. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2015, sur les 79 914 demandes d’asile qui ont été enregistrées, 26 700 ont été accordées et 53 214 ont été refusées, 17 000 reconduites à la frontière ont eu lieu, ce dernier chiffre étant en augmentation.
Imaginons la Grèce, où étaient déjà installés un million de migrants en 2014, faisant face, quasi seule au départ, à la vague migratoire dont j’ai parlé. François-Noël Buffet l’a souligné, après leur passage dans un hotspot où ils sont identifiés, enregistrés, reconnus ou non comme demandeurs d’asile légitimes, tous les réfugiés se retrouvent sur les ferrys qui les emmènent à Athènes et, un peu plus tard, pour la plupart, en route vers l’Allemagne, la Suède ou le Royaume-Uni, via la Macédoine et les Balkans. Seule les distingue la durée de validité de leur sauf-conduit : six mois pour les demandeurs d’asile reconnus, deux mois pour les autres.
Pour l’heure, la foule indifférenciée des nouveaux réfugiés ne fait que passer en Grèce et dans les pays qui les séparent de leur point de chute final, tant que les frontières ne se fermeront pas, ce qui est en train de se passer. Actuellement, quelque 70 000 réfugiés seraient pris au piège de la frontière macédonienne ouverte au compte-gouttes.
« Surréel » aussi est le plan de relocalisation des réfugiés péniblement adopté au mois de septembre 2015. Il est non seulement obsolète avant même de naître, puisque sont concernés seulement 120 000 réfugiés – je maintiens ce chiffre, même si celui de 160 000 a été évoqué –, dont 66 000 en provenance d’Italie et de Grèce, alors que c’est là que sont les flux principaux, mais aussi poussif au démarrage, faute de places offertes et d’appétence des réfugiés eux-mêmes au regard des délais d’instruction et de l’ignorance de leur destination finale. À la date du 17 janvier 2016, seules 597 places étaient offertes et 621 demandes étaient enregistrées !
« Surréelle » enfin est la facilité de la bureaucratie et des dirigeants politiques européens à se dédouaner de toute responsabilité. Pour eux, l’origine d’une situation aussi catastrophique ne saurait résulter de leur immobilisme, de leur manque d’anticipation, encore moins de l’insuffisance des règlements et des traités, mais serait la conséquence de l’incapacité, voire de la mauvaise volonté, des exécutants, en l’espèce la Grèce.
Ainsi, dès l’été 2015, un procès en sorcellerie pour insuffisance fut-il préventivement instruit à l’encontre de la Grèce, alors que celle-ci, écrasée par les « restructurations » imposées par la Troïka, faisait face quasi seule avec ses dix millions d’habitants et à ses frais – au moins 600 millions d'euros – à une catastrophe humanitaire majeure. Le maire de Mytilene – commune de 28 000 habitants – nous l’a dit : « On s’est sentis très seuls, humiliés par les visites étrangères d’inspection et les critiques de la commission permanente de contrôle de la mise en œuvre des règles de Schengen en novembre 2015 ».
Pour l’heure, je le dis tout net, on est accablé de devoir constater que le seul chef d’État à avoir le courage d’appeler, comme elle vient de le faire il y a quelques jours encore, à ne pas abandonner la Grèce, à ne pas la laisser plonger dans le chaos, c’est Mme Merkel !
Mmes Françoise Férat et Catherine Di Folco ainsi que M. Jean-Pierre Sueur applaudissent.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour beaucoup de Français, la crise des migrants, c’est d’abord la vision insoutenable de la « jungle » de Calais. Avec les membres de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, je m’y suis rendue voilà quelques semaines.
Jamais, monsieur le ministre, jamais, mes chers collègues, alors que j’ai visité de nombreux camps de réfugiés en Syrie, en Jordanie, en Turquie, en Irak, jamais je n’ai vu de conditions de vie aussi inhumaines, une telle saleté, une telle misère. Cette situation honteuse n’a que trop duré et je salue le démantèlement du bidonville. Attention toutefois à ce que les migrants ne se retrouvent rapidement de nouveau à la rue, à la merci des réseaux de traite des êtres humains, susceptibles de les acculer au travail forcé ou à l’exploitation sexuelle. Il est indispensable d’assurer le suivi de ces personnes, en particulier celui des mineurs isolés. Monsieur le ministre, je serais heureuse que vous nous indiquiez les dispositifs prévus à cette fin.
Pour nos sociétés, la grande question est celle de l’insertion des migrants. Au mois de mai dernier, à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif à la réforme du droit d’asile, j’ai déposé des amendements visant à faciliter l’accès au travail des demandeurs d’asile durant la période d’examen de leur dossier. Dans ce domaine, la France est très en retard par rapport à la Suède, à l’Allemagne ou aux États-Unis.
L’exclusion du marché du travail pendant de longs mois empêche les migrants de vivre dignement. Elle a aussi un coût élevé pour notre société en favorisant l’économie clandestine. Il faut lever ce tabou. C’est d’autant plus urgent que le nombre de migrants s’accroît à une vitesse sidérante. En France, les migrants se comptent par milliers, en Grèce, par centaines de milliers, en Turquie, en Jordanie ou au Liban, en millions…
Dans certains pays, les réfugiés pèsent désormais pour un quart de la population, ce qui, pour les petits pays, entraîne une fragilisation potentiellement explosive de leurs structures économiques et sociales. Il est indispensable d’aider ces pays pour leur permettre d’accueillir plus de réfugiés, qui, en restant près de chez eux, pourront y retourner plus facilement pour reconstruire leur vie et leur pays. Il faut de nouveaux accords de Bretton Woods.
Je sais que l’aide publique au développement ne relève pas de votre compétence, monsieur le ministre, mais il est véritablement indispensable de mieux épauler le Liban et la Jordanie, qui demeurent exclus des financements concessionnels, réservés aux pays les plus pauvres.

Quant au mécanisme de relocalisation, il commence à peine à fonctionner avec la Grèce. Ce mécanisme ne devrait-il pas être élargi à la Turquie, à la Jordanie ou au Liban, afin de court-circuiter les réseaux de passeurs ?
Par ailleurs, où en est-on du mécanisme d’examen des visas pour l’asile dans nos consulats en Irak et en Syrie ? Les délais, me dit-on, se sont beaucoup allongés.
Il est évidemment urgent de démanteler les réseaux de passeurs, d’autant que ceux-ci contribuent au financement du terrorisme. Cela nécessite une politique pénale rigoureuse et une véritable coopération européenne. La coopération entre FRONTEX et l’OTAN en mer Égée est un progrès. L’ayant réclamée depuis le mois d’avril dernier, je m’en réjouis, mais il faut aller plus loin dans la coopération avec les pays les plus concernés.
Au mois d’octobre dernier, l’Union européenne et la Turquie ont signé un plan d’action de lutte contre les passeurs : où en sommes-nous ? Il semblerait aussi que les contrôles d’identité réalisés dans les hotspots en Grèce soient peu fiables, faute notamment de recoupement entre les informations de la police grecque, celles de FRONTEX, d’Europol et celles du système d’information Schengen, ce qui laisse le trafic de faux documents prospérer. Qu’est-il prévu pour améliorer le dispositif ?
La cohésion européenne est aujourd’hui à rude épreuve, alors qu’une véritable coopération s’impose plus que jamais. La libre circulation des biens et des personnes est menacée. C’est pourtant un pilier de la construction européenne, son incarnation la plus tangible pour les citoyens et un enjeu économique énorme.
Sachons discerner les priorités. Ne laissons pas les égoïsmes triompher, alors même que la violence obscurantiste est à nos portes. Notre pays, patrie historique des droits de l’homme, se doit d’être leader en Europe sur cette question. C’est un devoir pour nous tous.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Françoise Férat applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me réjouis que, à une exception près – heureusement, ce fut bref –, nous ayons un débat de qualité, montrant ainsi que la représentation nationale est consciente de l’importance et de la difficulté du sujet. Tous, nous affirmons cette obligation de solidarité à l’égard des réfugiés, même si elle est difficile à mettre en œuvre, notamment parce que nos populations – comme de nombreuses autres en Europe – n’y sont pas aussi favorables que l’on pense. Même en Allemagne, la Chancelière est critiquée, alors que, de là où je vis, je vois comment des communes allemandes accueillent facilement 400 réfugiés. Reste que les populations commencent à s’inquiéter.
On oublie vite, trop vite, l’image de cet enfant mort sur une plage de Méditerranée, qui a suscité un émoi extraordinaire ; tout le monde en parlait. Tout cela semble avoir disparu aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que les populations, sauf celles qui sont directement concernées, soient aussi sensibles aux difficultés de vie des réfugiés à Calais et des populations voisines.
La solidarité de nos populations n’est pas au rendez-vous. Il est vrai que celles-ci souffrent aussi : difficultés économiques, chômage… Ce n’est certainement pas le meilleur moment pour avoir le sens de l’accueil.
La solidarité, cela a été dit, c’est d’abord la solidarité européenne. L’Europe est-elle capable de construire effectivement une politique commune qui lie chacun des États alors que, pour être clair, certains refusent de s’engager et d’autres acceptent que certains pays, notamment la Grèce, mais très souvent également l’Italie, soient confrontés plus que d’autres à des difficultés ? Disant cela, je pense à la situation que vivent souvent les maires en matière d’accueil des gens du voyage, chacun espérant que ces gens s’arrêtent sur le terrain des autres et pas sur le sien !
La solidarité en Europe est indispensable. La proposition de Jean-Yves Leconte et d’autres de travailler sur une identification unique est la seule solution, bien que sans doute difficile à mettre en œuvre.
Vous l’avez compris, monsieur le ministre, une initiative franco-allemande est fortement attendue. Alors que la Chancelière a clairement affirmé sa volonté d’accueillir des réfugiés, elle connaît quelques difficultés dans son pays. L’État français est lui aussi prêt à en accueillir, mais notre pays n’est pas la terre préférée des réfugiés, qui déclarent régulièrement qu’ils ne veulent pas rester en France.
Une solidarité des territoires, localement, est également nécessaire. Vous avez, les uns et les autres, mes chers collègues, évoqué un partenariat avec les collectivités locales. Je pense, monsieur le ministre, qu’il y a lieu de mieux construire ce partenariat. Il n’est pas forcément simple, pour les élus locaux, de demander à leurs administrés de bien vouloir accueillir des réfugiés, surtout lorsque les logements sociaux sont déjà pleins. C’est un peu plus facile de le faire en Alsace, car on peut rappeler aux Alsaciens qu’ils étaient contents, en 1939, d’être réfugiés notamment en Dordogne ou dans le Limousin, mais les générations qui ont vécu cette période tendent à disparaître.
Permettez-moi d’évoquer la manière dont les services de l’État en région se comportent à l’égard des communes, car il faut en parler. Un vrai partenariat est nécessaire. Lorsque vous mettez des logements à disposition pour l’accueil des réfugiés, on vous dit : Signez une convention avec une association. Or, en tant que maire, je veux un écrit avec l’État !
Ce partenariat suppose également que l’accueil des enfants à l’école soit garanti. Or, alors que le nombre d’enfants que la commune s’apprête à accueillir devrait permettre le maintien d’une classe, on m’annonce sa fermeture ! C’est un détail, mais il est important. En effet, les maires qui font l’effort de convaincre leur population d’accueillir des réfugiés doivent être soutenus par l’État. Ceux qui ont répondu à votre invitation, monsieur le ministre, qui ont ensuite fait des efforts et qui constatent aujourd'hui qu’ils n’ont pas de réponse ne manquent pas de s’interroger.
Les maires de Grande-Synthe et Calais sont interpellés par leur population et ont besoin d’une présence de l’État afin de ne pas avoir le sentiment d’être seuls face à leurs administrés. À défaut, certains maires pourraient très vite être enclins à partager, parfois de manière démagogique, les discours xénophobes et sectaires que l’on entend parfois.
Enfin, et cela fait longtemps que l’on en parle, les territoires doivent être solidaires en matière d’accueil des mineurs isolés étrangers. Des départements se plaignent depuis longtemps d’avoir beaucoup trop de charges quand d’autres n’en ont pas. Pour respecter nos engagements internationaux, nous devons accueillir ces mineurs étrangers, même si nous savons que certains sont victimes de trafic et de réseaux et dont les parents ont payé en pensant les envoyer vers un eldorado. Ces enfants ont vécu tellement de choses qu’ils sont admirables. Une solidarité de l’ensemble des territoires, je le répète, est nécessaire.
Ce débat a permis de montrer, monsieur le ministre, que la représentation nationale, dans sa très grande majorité, à une exception près, avait conscience de ce besoin de solidarité.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et sur plusieurs travées du groupe CRC. – M. Pierre-Yves Collombat applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l’évidence, le problème auquel l’Europe est confrontée est sans précédent, tout du moins dans son histoire récente. Il ne se réglera pas par des incantations, encore moins par des imprécations. Il faut avoir l’honnêteté et l’humilité de dire qu’il trouve son origine dans les conflits qui dévastent le Proche-Orient et que nous n’avons pas à nous seuls la clef de la solution à ces conflits. Ce problème trouve également son origine dans l’émigration de la misère, car il serait faux de dire que le flux d’un million de personnes ayant rejoint l’Europe l’année dernière serait constitué à plus de 50 % de demandeurs d’asile ayant de bonnes chances d’obtenir l’asile. Nous sommes confrontés au cumul d’une migration de la misère et d’une immigration de réfugiés authentiques.
La source vive de ces migrations est plus active que jamais. Nous assistons à une véritable déstabilisation de certains pays européens. Les efforts de nos États, de l’Union européenne, sont restés sans grands résultats, hélas !
Les capacités d’accueil d’un certain nombre de nos voisins parmi les plus allants, revendiquant pour eux-mêmes leur générosité, sont déjà dépassées. Les retours vers les pays d’origine sont pratiquement inexistants. La Grèce, les États des Balkans sont débordés par la traversée en masse de leur territoire et guettés par le chaos.
La commission des lois du Sénat a mis en place dès le mois de septembre un suivi du dispositif européen de relocalisation. Il a été confié à François-Noël Buffet, notre rapporteur spécial, qui a ouvert ce débat au nom du groupe Les Républicains. Je tiens d’ailleurs à rendre hommage à la qualité de son travail.

Des membres de tous les groupes politiques représentés à la commission des lois se sont rendus en Grèce, après les déplacements effectués par notre rapporteur à la fois à Calais et en Sicile. Nous avons pu apprécier la qualité du travail des services français, nos agences, l’OFPRA, l’OFII. De même, nous avons pu apprécier la qualité du travail des fonctionnaires de police mis à la disposition de FRONTEX et des agents de la DGSI, la direction générale de la sécurité intérieure, en charge de l’évaluation de la sensibilité éventuelle des demandeurs d’asile aux mots d’ordre islamistes. Nous avons également pu apprécier la qualité de l’engagement des organisations non gouvernementales françaises, notamment dans le domaine médical.
Nous avons constaté qu’aucun de nos partenaires européens n’en fait autant. Il nous semble que le dispositif mis en place, s’il apporte des garanties en termes de sélection des demandeurs d’asile admis en France, connaît des limites inhérentes à la situation que chacun peut constater. Certes, il donne de bonnes chances que seuls de véritables demandeurs d’asile soient admis en France et que ceux-ci aient en main le maximum d’atouts pour s’intégrer, en raison de leurs qualifications ou des liens qu’ils auraient déjà avec la France. Il permet en outre d’écarter toute personne sur laquelle pourrait peser le plus petit soupçon d’une sensibilité à des messages djihadistes. Il remplit donc correctement sa fonction.
La faiblesse de ce dispositif – la qualité et l’efficacité des agents qui le mettent en œuvre ne sont pas en cause – est d’un autre ordre : c’est qu’il traite la partie la plus visible du phénomène et que cette partie est aussi la plus petite. Ce dispositif n’est pas de nature à permettre la maîtrise de la partie souterraine de ces flux, dont l’importance n’est pas correctement mesurée. Le mois dernier, nos dispositifs ont permis l’accueil d’un peu moins de cent personnes. Si l’on rapporte ce nombre à l’année 2015, cela signifie que le sol européen a accueilli plus d’un million de personnes.
Aujourd'hui, que constatons-nous ? La Turquie ne respecte pas les engagements qu’elle a pris à l’égard de l’Europe, qui a pourtant mis à sa disposition des crédits importants. La Grèce est débordée, et la crise grecque ne permet pas à ce pays de faire face à ses engagements ; l’aide qu’elle reçoit ne suffit pas encore à permettre l’enregistrement de tous les migrants. §L’appel d’air créé par l’Allemagne a joué un rôle très négatif en amplifiant le phénomène et en le dénaturant. Il a conduit à un afflux de migrants de la misère dont les motivations sont essentiellement économiques et qui n’ont pas de raison d’être acceptés par nos pays. Selon les témoignages que nous avons recueillis sur place, au moins 50 % des migrants sont des migrants économiques.
L’Union européenne se montre impuissante. C’est le sauve-qui-peut général. L’espace Schengen est en train de voler en éclats, la Turquie, je l’ai dit, se dérobe. De nouvelles frontières s’érigent entre nous, y compris en Belgique – et je sais que M. le ministre de l’intérieur a fait les observations qui s’imposaient à cet égard. L’Union européenne se révèle incapable d’agir à la racine du problème, au Proche-Orient. Notre politique à l’égard de la Russie reste à la remorque de la diplomatie américaine.
L’Européen que je suis ne se résigne pas à ce déclin politique de l’Europe, qui la met en grand péril, et s’inquiète de l’incapacité de la France et de l’Allemagne à dépasser leurs divisions pour mettre en œuvre une politique efficace susceptible d’entraîner l’ensemble de nos partenaires européens.
L’Europe ne piétine pas, elle recule. Elle est aujourd'hui gravement menacée. Un sursaut politique et rapide est devenu indispensable.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mmes Françoise Férat, Valérie Létard et Catherine Di Folco applaudissent également.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, pour commencer, je tiens à remercier le groupe Les Républicains d’avoir pris l’initiative de ce débat, qui intervient dans un contexte migratoire particulièrement difficile pour l’Union européenne. Je remercie également l’ensemble des sénateurs qui sont montés à cette tribune pour faire part de leurs préoccupations, de celles de leur groupe politique, et pour interroger le Gouvernement sur un certain nombre des orientations de la politique européenne à l’élaboration de laquelle il contribue et sur les dispositions qu’il prend sur le territoire national pour faire face à cette crise migratoire.
Bien des chiffres qui ont été cités, bien des propos qui ont été tenus dans le cadre de ce débat m’ont ramené à l’humilité de l’exercice de ministre : j’ai en effet pu constater que, en dépit de la réitération des informations que je détiens, celles-ci ont un mal considérable à passer. §J’impute cela à la faiblesse de mon argumentation…
Sourires.
… et à la difficulté dans laquelle je me trouve de faire passer ce à quoi je crois. Je l’impute également, très accessoirement – très accessoirement ! –, à la mauvaise foi d’un certain nombre de mes interlocuteurs.
Aussi, je voudrais revenir sur des interrogations qui ont été exprimées, lesquelles sont d’ailleurs toutes légitimes, qui renvoient, d’abord, au contexte international et à la politique européenne, et, ensuite, aux dispositions que nous avons prises en France pour faire face à l’arrivée des migrants et les accueillir dans de bonnes conditions.
Je souhaite d’abord dire quelques mots du contexte européen.
Vous avez toutes et tous, à juste titre, signalé la dimension inédite de la crise migratoire à laquelle nous sommes confrontés et donné des chiffres qui sont justes. Je veux rappeler les chiffres, sans les citer tous, puisque vous en avez donné beaucoup. Je m’en tiendrai à ceux qui montrent l’évolution depuis trois ans des flux migratoires à l’arrivée en Grèce ou en Italie et qui témoignent de la dimension inédite de cette crise.
En 2014, 174 000 migrants relevant du statut de réfugié en Europe ou étant migrants économiques irréguliers ont franchi les frontières extérieures de l’Union européenne en Grèce ou en Italie. En 2015, ils ont été plus d’un million à le faire.
Sur les deux premiers mois de l’année 2016, les tentatives de franchissement de la frontière franco-italienne à Vintimille ont connu une augmentation de 63 %. Pour ce qui concerne les arrivées en Grèce, sur cette même période, 60 000 migrants ont tenté de franchir la frontière extérieure de l’Union européenne sur les îles grecques afin de pouvoir entrer dans l’Union et rejoindre leur pays de destination.
Alors que nous sommes en période hivernale et que, généralement, lorsque les conditions météorologiques en mer se dégradent, les flux migratoires diminuent, ceux-ci restent, cette année, à un niveau extrêmement élevé. Aussi, nous serons vraisemblablement, dans le courant de l’année 2016, confrontés à des flux plus importants encore que ceux de 2015, qui ont déjà créé le désordre que l’on sait et que vous avez pointé dans vos interventions respectives.
Cela résulte, comme vous l’avez dit les uns et les autres à juste titre, des désordres du monde. Aussi longtemps qu’aucune solution politique en Syrie, en Irak, n’aura été trouvée de nature à permettre à ceux qui sont persécutés dans leur pays de ne plus l’être et de pouvoir rester là où ils ont toujours vécu et aspirent à vivre encore pour y développer leurs talents, leurs compétences, après avoir fait leur apprentissage dans les universités pour les plus jeunes d’entre eux, nous serons confrontés à cette situation.
Il en sera ainsi tant que nous n’aurons pas réussi à dégager une solution politique d’union nationale en Libye, tant que la déréliction de l’État libyen se poursuivra avec l’espace considérable laissé à toutes les organisations criminelles qui appauvrissent ce pays et font peser, à partir de la Libye sur l’Europe, les plus grands dangers. Je pense à la traite des êtres humains, au trafic de drogue, au trafic d’armes et, bien entendu aussi, à Daech qui s’implante chaque jour davantage en Libye. Aussi longtemps que tous ces problèmes n’auront pas trouvé de débouché politique, nous serons confrontés à cette situation.
M. Alain Néri applaudit.
Pour ce qui concerne l’Union européenne, j’ai notamment entendu le sénateur Buffet dire que la France n’a pas pris les initiatives qu’elle devait prendre, qu’elle n’est pas suffisamment à la pointe. Le président Bas vient, quant à lui, de dire que l’Allemagne et la France ne font pas ce qu’elles devraient faire.
M. Philippe Bas le confirme.
Je veux rappeler ce qui a été fait, car nous avons une propension en France à considérer que ce que le gouvernement – quel qu’il soit, d’ailleurs – fait pour le pays est toujours plus mauvais ou en tous les cas moins satisfaisant que ce que d’autres gouvernements de l’Union européenne font sur les mêmes sujets.
Je veux rappeler la chronologie des événements et des initiatives en espérant qu’ainsi je parviendrai à convaincre les plus sceptiques d’entre vous. J’espère surtout qu’à l’occasion des prochains débats sur ces questions, la mise en cause de notre pays, qui n’a cessé de prendre des initiatives sur tous ces sujets, sera moins sévère et le jugement plus juste.
Le 31 août 2014 précisément – j’ai rendu compte de mon activité devant la commission des lois de votre assemblée à plusieurs reprises –, alors que la crise migratoire n’a pas encore éclaté et que nous sommes loin du niveau de pression que nous constatons aujourd’hui, sur la base de propositions que j’ai adressées au Président de la République et au Premier ministre et qui ont recueilli leur accord, j’entame une tournée des capitales européennes pour proposer à l’Union européenne, sentant cette pression inéluctable, en raison de la situation en Irak et en Libye, un agenda extrêmement précis.
Qu’y a-t-il dans cet agenda ?
Il y a d’abord la nécessité de renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l’Union européenne. En effet, sans ces contrôles, il n’y a pas d’autre choix que celui du rétablissement progressif, dans la plus grande confusion, dans le plus grand désordre, des frontières intérieures au sein de l’Union européenne. Et c’est ce qui se produit.
Si, aujourd’hui, certains pays de l’Union européenne rétablissent unilatéralement les frontières, c’est tout simplement parce que l’Union a été dans l’incapacité, depuis des années, et même ces derniers mois alors que la pression à ses frontières s’accroît, de mettre en place un contrôle aux frontières extérieures qui soit à la hauteur de la pression subie par le continent.
Nous avons proposé la mise en place de ce contrôle. Nous avons été les premiers à proposer que FRONTEX se déploie en un corps de gardes-côtes et un corps de gardes-frontières. C’est dans le scepticisme général que, lors d’un conseil Justice et affaires intérieures, nous avons été les premiers à proposer qu’on augmente les moyens de FRONTEX pour en faire une agence dotée de moyens lui permettant de faire face à cette réalité nouvelle. C’est devenu l’agenda de l’Union.
Nous avons, à ce moment-là, dit à nos partenaires européens non seulement qu’ils exercent ce contrôle aux frontières extérieures de l’Union européenne, mais également que si, dès lors que ces frontières sont franchies, n’est pas opérée une distinction entre ceux qui relèvent du statut de réfugié en Europe, c’est-à-dire qui justifient de la protection du continent en raison des persécutions qu’ils ont subies, et ceux qui sont migrants économiques irréguliers, en organisant immédiatement le retour de ces derniers dans leur pays de provenance, il n’y aura aucune soutenabilité de l’accueil de ceux qui relèvent du statut de réfugié.
J’ai bien entendu, monsieur Favier, votre propos dans lequel vous regrettiez que l’on procède à cette distinction. Mais si on ne le fait pas au moment du franchissement des frontières extérieures de l’Union européenne, en procédant à la reconduite de ceux qui ne relèvent pas du statut de réfugié en Europe, il n’y aura plus de soutenabilité de l’accueil des réfugiés en Europe. Et si nous voulons rester fidèles à nos valeurs et mettre l’Europe en situation d’assumer sa responsabilité dans un contexte de crise considérable, …
… il faut que nous puissions procéder à cette distinction.
Nous avons aussi proposé que mandat soit donné à la Commission européenne de négocier avec les pays de la bande sahélo-saharienne, notamment le Niger, des centres de maintien et de retour organisés en liaison avec le HCR et l’OIM de manière que ces retours puissent se produire.
C’est sur la base de cette proposition française que la Commission européenne a confié à la Haute Représentante, Mme Mogherini, le soin de négocier ces conventions de retour. Il lui appartenait de le faire, elle n’a pas fait grand-chose du mandat qui lui a été confié. Je regrette d’avoir à faire ce constat devant le Sénat, mais c’est la réalité.
C’est nous aussi qui avons proposé le dispositif de relocalisation auquel Mme la sénatrice Benbassa a fait référence dans son propos, en évoquant à juste titre la dimension de solidarité de ce processus.
Quand Jean-Claude Juncker a présenté ses propositions à la Commission européenne, il l’a fait sur la base de propositions françaises.
Systématiquement, messieurs Bas et Buffet, lorsque la France a fait ces propositions, elle s’est empressée de demander à l’Allemagne de faire en sorte que cela soit porté conjointement. Or, malgré la totale convergence de vues entre la France et l’Allemagne dans l’élaboration de ces propositions et leur formulation, il a fallu dix-huit mois à l’Union européenne…
Je crains qu’il ne lui faille plus de temps encore pour appliquer ce qu’elle a mis trop longtemps à décider.
On ne peut donc pas imputer ces difficultés, dont nous sommes comptables, à la France seule ou à l’Allemagne et à la France seules. C’est le système européen tel qu’il fonctionne qui est en cause. Je souhaite que nous puissions continuer à agir pour que, dans la solidarité, des décisions soient prises.
Pierre-Yves Collombat a dit que la situation était difficile pour les Grecs. Il a dit aussi que Mme Merkel avait été la seule à aider les Grecs. Ce n’est pas vrai du tout.
Non, ce n’est pas vrai, monsieur le sénateur.
La semaine dernière, lors du conseil Justice et affaires intérieures, le ministre grec de l’immigration a remercié la France et l’Allemagne parce qu’elles avaient agi ensemble. Voilà quinze jours, mandaté par le Président de la République, j’étais en effet en Grèce, avec mon homologue Thomas de Maizière, lui-même mandaté par la Chancelière allemande, afin de proposer l’aide conjointe de la France et de l’Allemagne à la Grèce.
Une mission du ministère de l’intérieur a été, la semaine dernière, envoyée sur place. Les sénateurs français qui se sont rendus en Grèce ont pu constater que cette mission était à l’œuvre. Elle vise à aider la Grèce à prendre toutes ses responsabilités, à assumer tous ses engagements en ne la laissant pas seule face aux engagements qu’elle avait pris, précisément parce que nous avons parfaitement conscience que la Grèce seule ne pourra pas assumer ses responsabilités.
Et nous agissons avec l’Allemagne.
Vous avez été nombreux aussi à dire que la Grèce avait accueilli 900 000 réfugiés dans le courant de l’année dernière. Ce n’est pas exact
M. Pierre-Yves Collombat est dubitatif.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Non, la Grèce n’a pas un million de réfugiés sur son territoire !
M. Pierre-Yves Collombat s’exclame.
L’Allemagne doit faire face à l’arrivée de ces réfugiés. Elle ne demande d’ailleurs à personne, vous avez raison de le souligner, car c’est son honneur et sa grandeur d’engager un processus de relocalisation à partir de l’Allemagne sous prétexte que le million de réfugiés qui seraient passés en Grèce seraient arrivés en Allemagne. L’Allemagne assume sa responsabilité parce qu’elle a aussi contribué par ses initiatives à créer les conditions de cette arrivée. Nous, nous sommes aux côtés de l’Allemagne pour faire en sorte que le processus de relocalisation fonctionne.
Le président Bas, parce que le sujet de la Grèce et des dispositifs européens est lié à la question de la relation de l’Europe à la Turquie, a indiqué que la Turquie ne faisait pas assez, qu’elle ne remplissait pas ses obligations. Là aussi, soyons très exigeants dans la convocation des faits.
Je me suis rendu, après avoir séjourné en Grèce avec mon collègue Thomas de Maizière, en Turquie. Qu’y ai-je vu ? Le HCR, le Programme alimentaire mondial, l’UNICEF, c’est-à-dire l’ensemble des organisations gravitant autour des Nations unies, qui m’ont dit que la Turquie avait accueilli près de trois millions de réfugiés syriens. Mesdames, messieurs les sénateurs, trois millions de réfugiés syriens sont actuellement sur le territoire turc, dont 300 000 à 500 000 dans les camps de réfugiés.
Le HCR nous dit que le niveau d’accueil des réfugiés en Turquie est bien supérieur à celui des camps du HCR. Les Turcs ont agrandi leurs écoles pour y scolariser près de 300 000 enfants syriens, qui apprennent leur propre langue grâce à des enseignants issus des camps et venus de Syrie.
Nous demandons aujourd'hui aux Turcs d’accueillir encore plus de réfugiés, grâce aux 3 milliards d’euros alloués, et de revoir leur politique de visa. Nous sommes légitimes à formuler ces demandes, mais nous ne pouvons pas reprocher dans le même temps à la Turquie de ne pas remplir ses obligations, sachant que, ce qu’elle fait, nous serions incapables de le faire à vingt-huit !
Car telle est bien, malgré tout, la réalité.
Un autre sujet a été évoqué, qui renvoie toujours au contexte européen, celui du lien entre l’arrivée des migrants, le contexte international et le risque terroriste.
Rien ne serait pire que de confondre l’ensemble de ceux qui ont été persécutés par les barbares de Daech et les quelques bourreaux qui pourraient se mêler au flux des victimes, par cynisme, barbarie et volonté de commettre d’autres crimes que ceux qu’ils ont déjà commis en Syrie, en Irak ou ailleurs. Si nous voulons éviter une telle confusion, il faut impérativement que nous prenions, au moment du franchissement des frontières extérieures de l’Union européenne, des dispositions qui, pour l’instant, ne sont pas prises, mais qui correspondent aussi à l’agenda français au sein de l’Union européenne.
Lorsque les réfugiés franchissent les frontières extérieures de l’Union, en Grèce ou en Italie, non seulement le dispositif des hotspots doit être mis en place – nous y contribuons, même si c’est très difficile –, mais le système d’information Schengen doit aussi être systématiquement interrogé. S’il ne l’est pas, nous sommes confrontés à des risques sécuritaires.
Pour que le système d’information Schengen soit interrogé avec efficacité, encore faut-il que tous les pays de l’Union européenne l’alimentent de façon homogène et identique, ce qui n’est pas le cas. Un certain nombre de ceux qui nous ont frappés lors des attentats du 13 novembre, qui n’étaient pas connus de nos services, n’avaient pas été signalés au système d’information Schengen comme terroristes, mais simplement comme délinquants, notamment par la Belgique.
Ensuite, le système d’information Schengen ainsi informé doit être connecté aux autres fichiers, notamment au SLTD – Stolen and Lost Travel Documents. Je pense aussi que le fichier Eurodac doit pouvoir être interrogé pour des raisons sécuritaires, ce qui suppose une modification du règlement Eurodac au sein de l’Union européenne. Une véritable task force européenne de lutte contre les faux documents doit se constituer. En effet, Daech a récupéré des centaines de passeports vierges en Irak et en Syrie et s’est dotée d’une véritable usine de fabrication de faux documents. Deux des kamikazes qui nous ont frappés le 13 novembre ont fait prendre leurs empreintes à Leros en ayant en main de faux passeports.
Si ces mesures ne sont pas prises d’urgence au sein de l’Union européenne – c’est une demande française constamment réitérée –, nous n’avons aucune chance de pouvoir créer les conditions de l’efficacité de notre démarche et de notre discours à l’égard de ceux qui, dans l’outrance, s’emploient à susciter les sentiments les plus xénophobes en convoquant les peurs les plus instinctives. De ce point de vue, nous venons d’assister, ici même, dans cette assemblée, à six minutes d’un discours emblématique des représentants de cette mouvance. Nous devons y répondre en consolidant cet agenda et en le mettant en œuvre rapidement.
Mme Létard et M. Rapin ont évoqué la question de Calais et des dispositions prises en France pour faire face à l’arrivée des réfugiés. Tout d’abord, vos chiffres ne sont pas exacts, monsieur Buffet, et je veux rappeler ici les chiffres précis pour Grande-Synthe et Calais.
Il y avait effectivement 6 000 migrants à Calais, dans la « jungle », à la fin de l’année 2015. Voyant que ce nombre augmentait, le ministère de l’intérieur a pris la décision d’ouvrir des centres d’accueil et d’orientation. On en compte désormais 102 en France, et ils permettent aux migrants de Calais qui relèvent du statut de réfugié d’être accueillis dans des lieux en dur, où ils sont pris en charge par des associations, ont accès à la langue française et à l’asile.
Depuis le mois d’octobre, nous avons accueilli près de 3 000 personnes venant de Calais et de Grande-Synthe dans ces centres d’accueil et d’orientation. Voilà ce qu’un grand journal du soir appelle un « échec » ! Sur ces 3 000 personnes accueillies dans les centres d’accueil et d’orientation, 85 % ont fait une demande d’asile en France, et 15 % seulement se sont « évaporées » – il s’agit là d’une moyenne, le pourcentage pouvant varier selon la nature des CAO.
Alors qu’il y avait 6 000 migrants dans la boue, le froid et la précarité à Calais à la fin de l’année dernière, on en dénombre aujourd’hui 3 800, soit une diminution de près de moitié. À Grande-Synthe, le dernier comptage est de 1 100, contre 3 000 l’an passé, soit une division par trois.
Ces migrants-là ne se sont pas évaporés ; ils n’ont pas non plus été dispersés après que le ministre de l’intérieur a survolé la « jungle » en hélicoptère en demandant aux forces de l’ordre d’évacuer le camp ! Des travailleurs sociaux de la direction de la cohésion sociale, de l’OFII, de l’OFPRA et des associations comme SOS se sont mobilisés pour aller proposer à chaque migrant un hébergement en dur dans un centre d’accueil et d’orientation.
Ce que vous appelez « expulsion » ou « démantèlement » de la « jungle » n’est rien d’autre que la poursuite d’une politique méthodique et difficile de mise à l’abri des migrants de Calais. Cette politique, engagée voilà quatre mois, a déjà permis de dégager un certain nombre d’espaces. Nous la poursuivons avec détermination, pour une raison très simple, madame Létard, monsieur Rapin : nous ne considérons pas que maintenir des enfants, des femmes et des familles en situation précaire dans la boue de Calais corresponde à un idéal humanitaire !
Notre idéal humanitaire, c’est de proposer à ces personnes qui ont déjà beaucoup souffert un dispositif leur permettant d’être mises à l’abri, de bénéficier d’un accompagnement social et d’un accès à la langue française. Voilà ce que la France doit faire si elle veut être à la hauteur de sa réputation !
pour dire que la boue, le froid et la précarité sont indignes et, de l’autre, lorsque nous voulons extraire les migrants de cette précarité et de cette indignité, à venir expliquer qu’il faut les laisser là où ils sont !
Pour bien matérialiser qu’il faut les laisser là où ils sont, lorsque nous mobilisons nos travailleurs sociaux pour aller dans les maraudes au contact des migrants et les convaincre, nos troupes se font insulter et « caillasser », et lorsque je mobilise des forces de l’ordre pour les protéger dans l’exercice de leurs missions, on crie aux violences policières… La ficelle est un peu grosse, et la manipulation, compte tenu du destin de ces femmes et de ces hommes en détresse, assez peu convenable.
C’est la raison pour laquelle je veux aussi, devant le Sénat, rappeler cette réalité avec force. Le ministère de l’intérieur, les collaborateurs de l’OFII et de l’OFPRA, les travailleurs sociaux de la cohésion sociale et les volontaires des associations qui se mobilisent avec nous pour atteindre cet objectif ne sont pas des individus brutaux qui sont indifférents au sort des migrants. Ils sont au contraire soucieux de leur assurer une protection, et c’est pourquoi ils n’entendent pas les laisser dans la boue et le cloaque de ce qu’est la « jungle » de Calais.
Dans un pays qui décide d’accorder généreusement l’asile à ceux qui relèvent du statut de réfugié, il n’y a pas de raisons non plus que l’on concentre toute la précarité et la difficulté dans une seule ville, sans se préoccuper des difficultés auxquelles ce territoire peut se trouver confronté seul dès lors que l’effort n’est pas partagé entre toutes les parties du territoire national.
Quand on prétend, monsieur Rapin, madame Létard, que les villes sont seules, je m’inscris en faux. Non, la ville de Calais n’est pas seule !
Lorsque nous mettons en place un centre d’accueil de jour à Calais en très étroite liaison avec la municipalité, lorsque nous mettons en place le centre d’accueil provisoire, c’est-à-dire les bungalows où nous accueillons 1 500 personnes, c’est l’État qui passe les marchés, c’est l’État qui finance, c’est l’État qui mobilise ses travailleurs sociaux pour les maraudes !
C’est aussi l’État qui est présent lorsqu’il s’agit, au terme d’un audit réalisé par les inspections générales, de mettre en place un dispositif de soins minimal permettant aux migrants d’éviter les épidémies et les difficultés sanitaires les plus importantes !
Et, lorsque nous négocions avec le Royaume-Uni des dispositifs qui conduisent les Britanniques à investir près de 60 millions d’euros à Calais, y compris sur les aspects humanitaires à nos côtés, c’est encore nous qui sommes à la manœuvre, et personne d’autre !
Je veux bien entendre que l’État pourrait en faire plus, mais je ne peux pas entendre que l’État laisserait les collectivités seules, alors que l’État agit comme je viens de l’indiquer. Dans les années 2000, lorsqu’on a vidé Sangatte et qu’on a réparti, sans les loger, les migrants sur la côte septentrionale, j’étais à l’époque maire de Cherbourg. Je n’ai pas eu une visite ministérielle ni le début d’un euro pour aider ma ville à faire face à cette situation !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Je veux bien que chacun développe son argumentation et soutienne sa posture, mais je ne veux pas que cela se fasse au détriment de la vérité et de la réalité de l’engagement de l’État. Je le dis d’autant plus volontiers, monsieur le sénateur, que vous êtes bien placé pour savoir qu’il existe entre les collectivités locales, notamment la ville de Calais, la région et le Gouvernement une relation de grande confiance sur ce sujet, qui s'explique aussi par le sens élevé de leur responsabilité qu’ont les élus et la tradition d’accueil dans laquelle ils se sont engagés. Je veux saluer ici en votre présence l’action de la maire de Calais, Natacha Bouchart, et du nouveau président du conseil régional, avec lequel nous agissons du mieux que nous pouvons.
Je voudrais conclure sur un point : ce qui fait la capacité de la France à accueillir, dans la durée, c’est la volonté d’un gouvernement de donner aux services qui sont en charge de l’asile les moyens d’un accueil digne. Là aussi, je tiens à apporter quelques précisions. Nous avons fait voter une loi sur l’asile qui vise à réduire de vingt-quatre mois à neuf mois la durée de traitement des dossiers des demandeurs d’asile. Une telle évolution ne se fait pas d’un coup de baguette magique. M. Buffet, qui a beaucoup travaillé sur cette question, le sait bien.
Pour passer de vingt-quatre mois à neuf mois, il faut augmenter considérablement les effectifs de l’OFII et de l’OFPRA. En quelques mois, nous aurons créé 300 emplois à l’OFII et l’OFPRA. Il faut aussi créer des places en centres d’accueil de demandeurs d’asile, ou CADA. Nous en aurons créé près de 20 000 en cinq ans. Combien de places ont-elles été créées au cours des dix dernières années ? Nous avons également mis en place des dispositifs d’urgence, au mois de juin dernier, avec ma collègue ministre du logement. Nous avons aussi décidé de doter certaines associations des moyens dont elles avaient besoin pour nous accompagner dans cet effort, notamment à Calais.
Mais, si nous voulons être efficaces dans l’accueil des réfugiés, il faut un parcours complet d’intégration, en particulier d’un point de vue résidentiel.
Quand, à Paris, on ne peut pas faire autrement que de vider des squats pour mettre à l’abri des migrants, nous le faisons en mobilisant l’hébergement d’urgence. Ceux qui relèvent du statut de demandeur d’asile sont intégrés en CADA.
Il est important que ceux qui sont dans un hébergement d’urgence et relèvent de l’asile en sortent pour entrer en CADA et il importe que ceux qui sont en CADA et ont obtenu le statut de réfugié en sortent pour entrer dans les logements de droit commun.
Là, je réponds donc très précisément à Valérie Létard : c’est ce parcours-là que nous voulons construire.
Lorsque nous mobilisons les maires et que je nomme le préfet Kléber Arhoul, qui est ici avec nous ce soir, pour recenser les logements qui, dans les bourgs ou dans les villes, permettront à ceux qui ont obtenu le statut de réfugié de se loger, nous sommes dans un dispositif d’accueil de ceux qui ont terminé leur parcours d’accès à l’asile.
Mais lorsque nous demandons à des communes de mettre en place des centres d’accueil et d’orientation pour faire entrer dans le processus d’asile ceux qui sont à Calais, nous ne mobilisons pas des logements de droit commun, mais des bâtiments qui sont à la disposition des communes et dont nous aurons utilité mais ferons une utilisation temporaire, jusqu’à ce que nous ayons pu ouvrir des CADA. Ces nouvelles structures permettront d’accueillir des personnes venant de Calais, qui sont temporairement dans des centres d’accueil et d’orientation. Ensuite, elles pourront entrer dans les 1 500 logements que nous avons mobilisés avec le concours du préfet Arhoul.
Si nous ne disposons pas de ce parcours complet de résidence, pour lequel nous avons mobilisé énormément de moyens, nous n’aurons absolument aucune chance d’être à la hauteur de l’accueil que nous voulons mettre en place pour ceux qui relèvent du statut de réfugié.
Cette pression migratoire va se poursuivre, du fait du désordre du monde, et nous aurons, nous, pays européens, à être à la hauteur de cette situation.
Il ne s’agit pas de dire qu’il faut accueillir tout le monde pour y parvenir et pour que les peuples d’Europe l’acceptent. Pour accueillir ceux qui doivent l’être parce qu’ils sont persécutés dans leur pays, il faut qu’il y ait une organisation et une maîtrise.
Dire qu’il n’y a pas d’accueil possible si cette maîtrise et cette organisation n’existent pas et si les dispositifs de contrôle à l’entrée des frontières extérieures de l’Union européenne ne sont pas présents, ce n’est pas manquer de générosité, c’est avoir la lucidité qui rend la générosité possible.
En effet, la générosité autoproclamée ne règle aucun des problèmes auxquels le monde est confronté lorsqu’il veut – comme c’est notre cas – être à la hauteur de sa réputation et de ses valeurs.
Il faut pour cela de la maîtrise, de l’organisation, du travail.
Je voudrais ajouter qu’il ne suffit pas d’avoir des postures pour garantir la générosité… Ce que je disais sur Calais tout à l’heure m’a beaucoup enseigné de ce point de vue. Lorsque l’on est au Gouvernement, il ne suffit pas d’être sincère dans ses intentions et déterminé à atteindre le but pour être compris et parvenir au résultat escompté : il y a toujours des activistes, des groupes, qui n’ont pas intérêt à ce que les problèmes se règlent, …
… car les problèmes sont le terreau de leur prospérité !
Nous, nous ne souhaitons pas que les problèmes perdurent ; nous souhaitons les régler et il est difficile de le faire lorsque nous rencontrons autant d’obstacles. Ce serait pourtant facile si tous décidaient d’unir leurs forces pour créer les conditions d’un accueil qui soit le plus humanitaire possible.
De ce point de vue, je veux dire, là aussi, ce que je pense : les postures font du mal ! Elles empêchent les solutions d’aboutir rapidement et sont parfois à l’origine de bien des manipulations, qui suscitent dans le pays un mauvais sentiment, celui que rien ne peut être réglé et que rien n’est possible. Pourtant, face au Front National, il y aurait une urgence à démontrer que nous sommes capables, ensemble, en unissant nos forces, d’apporter des solutions humaines à ceux qui sont en situation de détresse.
Ce débat ayant permis d’aborder toutes ces questions en sincérité et de façon approfondie entre nous, je voudrais remercier ceux qui ont demandé son organisation, car j’ai pu, par là même, revenir sur un certain nombre de sujets qui tiennent particulièrement à cœur au Gouvernement parce qu’ils sont au centre de ses préoccupations et de sa politique.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – M. Pierre-Yves Collombat applaudit également.

Nous en avons terminé avec le débat sur le dispositif exceptionnel d’accueil des réfugiés.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 2 mars 2016, à quatorze heures trente et, éventuellement, le soir :
Débat sur la situation financière des départements.
Débat sur « le trentième anniversaire du baccalauréat professionnel ».
Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs ;
Rapport de M. François Bonhomme, fait au nom de la commission mixte paritaire (n° 381, 2015-2016) ;
Texte de la commission (n° 382, 2015-2016).
Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif aux réseaux des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat ;
Rapport de M. Michel Houel, fait au nom de la commission mixte paritaire (n° 383, 2015-2016) ;
Texte de la commission (n° 384, 2015-2016).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures cinq.