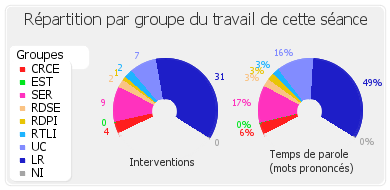Séance en hémicycle du 20 novembre 2018 à 9h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Questions orales (voir le dossier)
- Modification du contrôle technique pour les véhicules associatifs assurant les services d'urgence aux personnes (voir le dossier)
- Mise en place du service national universel pour les jeunes français établis hors de france (voir le dossier)
- Candidature à une commission
- Questions orales
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

La parole est à Mme Sylvie Robert, auteur de la question n° 479, adressée à M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, voici un dossier qui s’enlise depuis plusieurs décennies.
La Rance, qui serpente dans les Côtes-d’Armor et en Ille-et-Vilaine, doit faire face à une situation écologique de plus en plus critique. En quatre ans, pas moins de deux cent mille mètres cubes de sédiments ont été charriés, et ce malgré plusieurs opérations visant à désenvaser l’estuaire. En certains endroits, les masses de boues grises ont rendu la navigation impossible, portant ainsi préjudice aux riverains et aux communes situées le long du cours d’eau.
Quant à l’impact sur la biodiversité, il est terrible : plusieurs espèces de poissons, à l’instar des poissons plats, ont disparu, tandis que les oiseaux nicheurs se font de plus en plus rares. En d’autres termes, les milieux naturels se trouvent extrêmement fragilisés.
Pourtant, un rapport issu d’une mission interministérielle et publié en 2016 concluait que « l’extension du phénomène d’envasement de l’estuaire de la Rance a atteint aujourd’hui un niveau tel qu’il convient de réduire au maximum les dépôts, voire de mettre un terme à la progression des volumes de sédiments qui continuent à se déposer ». Il était ainsi proposé d’adopter un programme expérimental sur cinq ans en vue d’extraire deux cent cinquante mille mètres cubes de sédiments, tout en recherchant une solution pérenne, à plus long terme.
Néanmoins, ce plan quinquennal achoppe toujours sur la question budgétaire. Jusqu’à présent, Électricité de France, EDF, en tant que concessionnaire de l’usine marémotrice, avait payé la quasi-intégralité des opérations de désenvasement. Toutefois, aujourd’hui, plus d’un tiers du plan d’un montant initial de 9, 5 millions d’euros reste non financé, EDF refusant d’augmenter sa participation, et certains acteurs ne souhaitant pas compenser ce qui leur semble relever de la responsabilité de l’opérateur.
Par conséquent, la situation est dans une impasse, alors que la solution a été trouvée et qu’il n’y a qu’à mettre le plan quinquennal en œuvre.
Ainsi, madame la ministre, je souhaite connaître l’état du dialogue du Gouvernement avec les collectivités territoriales concernées, qui veulent avancer au plus vite afin que le fleuve redevienne entièrement praticable. En outre, comment entendez-vous finaliser le budget du programme quinquennal, tout en faisant respecter par EDF l’obligation qui lui est faite de garantir le maintien de la navigation sur la Rance ?
Les associations, les riverains, les plaisanciers, les élus locaux, qui se battent pour enrayer cette dérive écologique, attendent un soutien affirmé de l’État, comme ils attendent que le Gouvernement agisse en responsabilité, afin de débloquer la situation.
Madame la sénatrice Sylvie Robert, vous avez interrogé M. François de Rugy, ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire. Ne pouvant être présent, il m’a chargé de vous répondre.
Vous faites part de votre inquiétude quant au financement de l’opération et quant aux délais pour désenvaser la Rance. Un point d’étape sur le plan de gestion des sédiments de la Rance, réalisé par le préfet de la région Bretagne en juillet dernier, a permis de confirmer les avancées de la mise en œuvre des recommandations de la mission sur le sujet.
Tout d’abord, l’opération de désenvasement du chenal a été réalisée par EDF, au début de l’année 2018.
Pour ce qui concerne la mise en œuvre des actions du plan Lyvet 3, confiée à l’association Cœur Émeraude, les travaux d’aménagement du centre de transit ont débuté à la fin du mois d’août et le curage du piège à sédiments, à la mi-septembre. La maîtrise d’ouvrage du programme sera assurée par l’établissement public territorial de bassin Rance-Frémur, qui reprend à sa charge la gestion sédimentaire de la Rance, à l’exception des actions de curage du Lyvet 3. Cet établissement est également chargé de la suite des opérations d’expérimentation à cinq ans.
Par ailleurs, l’organisation de la gouvernance a été validée par l’ensemble des acteurs et comprend quatre instances : le comité de pilotage, le comité des financeurs, le conseil scientifique et la commission locale de l’eau Rance-Frémur-Baie de Beaussais.
Le comité de pilotage a été mis en place. Il est coprésidé par le président du conseil régional et le préfet de région, et il intègre les acteurs locaux, notamment les élus de l’association Cœur Émeraude, qui pourront avoir un rôle d’impulsion compte tenu de leur implication historique sur le dossier.
La composition du conseil scientifique vient d’être validée. Ce conseil, installé en septembre, devra notamment traiter la question de l’utilisation des bassins de stockage après l’opération Lyvet 3, afin de déterminer les différents types de mesures de gestion sédimentaire qui peuvent être conjugués et la durée de dépôt sur le site de stockage.
Sur le plan financier, EDF a confirmé son accord pour un financement à 50 % du montant global de l’opération Lyvet 3, soit 550 000 euros. Il a augmenté sa participation, la faisant passer de 40 % à 50 % pour la gestion sédimentaire de 2017-2023. L’objectif est d’atteindre la parité entre EDF et les autres acteurs publics.
La mise en œuvre du plan de gestion des sédiments de la Rance est donc en bonne voie. Une réunion du comité de pilotage et du comité des financeurs a eu lieu en septembre 2018.
François de Rugy accorde toute sa confiance au préfet de région pour la poursuite des actions définies dans le plan de gestion du Conseil général de l’environnement et du développement durable et du Conseil général de l’économie.

Je remercie Mme la ministre de ses réponses. Avec les acteurs publics - vous les avez cités -, j’espère qu’il y aura une décision sur le financement de ce qui reste à charge s’agissant d’un projet extrêmement important pour ce territoire.

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, auteur de la question n° 516, adressée à M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.

Madame la ministre, en Dordogne comme dans beaucoup de départements, le traitement des déchets est assuré par un syndicat départemental, le syndicat mixte départemental des déchets de Dordogne, le SMD3.
Jusqu’à présent, les déchets plastiques lourds étaient confiés à une usine qui en faisait des paillettes. Le cours du pétrole, qui favorise l’achat par les plasturgistes de plastique vierge plutôt que le plastique recyclé, a conduit cette entreprise, Recymap, à fermer.
Les centres potentiels de recyclage étant situés trop loin pour poursuivre dans cette filière, le SMD3 est aujourd’hui obligé d’enfouir ses déchets comme du plastique non recyclable ordinaire, en parfaite contradiction avec les objectifs de la feuille de route pour l’économie circulaire.
Je rappelle que l’économie circulaire vise à recycler 100 % du plastique d’ici à 2025, au moyen d’une augmentation de la fiscalité pour rendre la valorisation moins chère que l’élimination. Cela passera par la hausse de la composante « déchets » de la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, qui passerait de 48 à 165 euros par tonne pour le stockage et de 15 à 25 euros par tonne pour le traitement thermique, et aussi, bien entendu, par des mesures compensatoires – baisse du taux de TVA sur le tri et sur le compostage, de 10 % à 5, 5 % ; réduction des frais de gestion de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la TEOM, de 8 % à 3 % ; allongement de la durée du taux réduit des frais de dégrèvement, de trois à cinq ans.
Ces mesures de compensation sont toutefois insuffisantes, car les collectivités n’ont pas de marge de manœuvre pour réduire les volumes. Toutes les simulations montrent que, si les collectivités arrivent à respecter les objectifs de la loi sur la transition énergétique, cela se traduira par un coût supplémentaire d’au moins un euro par habitant.
Aussi, plutôt que d’instaurer la double peine pour les collectivités et pour les contribuables, ne pourrait-on pas mettre en place, pour les déchets plastiques lourds, une taxe sur les produits non recyclables, sorte de TGAP en amont, pour taxer les émetteurs, et non les collectivités, ou même une REP balai – responsabilité élargie du producteur –, qui prendrait en charge tous les projets recyclables ?
Que pensez-vous de ces propositions ?
Monsieur le sénateur Claude Bérit-Débat, vous soulevez la question du recyclage du plastique lourd en citant la fermeture de l’usine Recymap de Saint-Pierre-de-Côle, qui recyclait certains plastiques, et l’impact pour les collectivités de la future hausse de la TGAP.
Votre question met en lumière les coûts de gestion de nos déchets - les signaux économiques ne sont pas au bon niveau. Aujourd’hui, si le recyclage peine à se développer, c’est en partie dû au fait que la mise en décharge ou l’incinération de ces déchets reviennent beaucoup moins cher. Il faut donc renchérir le coût de l’élimination des déchets tout en diminuant celui de leur recyclage, afin qu’une véritable industrie française du recyclage puisse se développer, une industrie génératrice d’emplois et de valeur ajoutée.
Le Gouvernement, au travers de la feuille de route pour l’économie circulaire, fruit de plus de six mois de concertation, a décidé d’utiliser plusieurs leviers pour y parvenir.
Cela passe tout d’abord par une réforme globale de la fiscalité, afin de rendre le recyclage des déchets économiquement plus attractif que leur mise en décharge ou leur incinération. Cela repose sur une trajectoire de TGAP revue à partir de 2021, de telle sorte que le coût moyen de l’élimination des déchets devienne supérieur au coût moyen de leur recyclage.
En parallèle, il s’agit de donner de nouvelles capacités financières aux collectivités pour investir et pour s’adapter, en allégeant la pression fiscale sur les activités de tri et de recyclage. Cela se traduira notamment par une baisse du taux de la TVA pour les opérations de prévention, de collecte, de tri et de recyclage des déchets, mais également par une baisse des frais de gestion de la TEOM pour les collectivités qui font le choix d’opter pour une tarification incitative.
Les mesures de la feuille de route pour l’économie circulaire ne se limitent toutefois pas aux aspects fiscaux, puisque la réforme des filières REP sera également menée l’année prochaine. Elle permettra de développer le recyclage, en fixant de nouveaux objectifs aux éco-organismes, de développer les bonus-malus, pour favoriser l’incorporation de matière plastique recyclée, et de créer de nouvelles filières REP.
L’objectif est donc de s’appuyer sur l’écoconception des produits, pour stimuler tant l’offre que la demande en matières recyclées, afin qu’une véritable économie du recyclage se développe sur notre territoire.
La feuille de route pour l’économie circulaire a d’ores et déjà permis de réunir les industriels pour qu’ils s’engagent dans le recyclage. Soixante entreprises et fédérations professionnelles se sont déjà engagées à incorporer dans leurs produits près de trois cent mille tonnes de matières plastiques recyclées en plus.
C’est un premier pas, il faudra encore aller au-delà. D’autres idées pour développer le recyclage des plastiques pourront également être débattues dans le cadre du futur projet de loi sur l’économie circulaire.

Mes chers collègues, à moins de sept secondes de temps de parole restant, je ne peux pas vous laisser répondre au Gouvernement.
Monsieur Bérit-Débat, il ne vous restait que six secondes…

La parole est à M. Christophe Priou, auteur de la question n° 389, adressée à Mme la ministre auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports.

Madame la ministre, en avril dernier, ma collègue Élisabeth Doineau, sénatrice de la Mayenne, et le maire de Blain, Jean-Michel Buf, ont saisi le Premier ministre du dossier de la liaison routière entre Saint-Nazaire et Laval. Il a même été créé, voilà plusieurs années, une association regroupant les élus et les acteurs de la vie économique des départements de Loire-Atlantique, de Mayenne et de Maine-et-Loire pour faire aboutir ce dossier.
Certaines études ont été menées pour le contournement de Cossé-le Vivien, dans la Mayenne, de Pouancé, en Maine-et-Loire, et de Châteaubriant et Treffieux, dans la Loire-Atlantique.
Sur la partie de la RN 171 reliant Nozay à Saint-Nazaire, l’État a concentré ses investissements sur la section entre Savenay et le futur contournement de Bouvron, laissant le tronçon de Nozay à Blain sans nouvelles perspectives. Pourtant, la sortie, vers La Grigonnais, de la route à deux fois deux voies reliant Rennes à Nantes est particulièrement dangereuse.
La traversée de Blain n’est plus supportable pour les habitants, et un contournement est devenu absolument nécessaire. Cette commune est aujourd’hui traversée par treize mille véhicules par jour. Avec l’axe Redon-Nort-sur-Erdre, le nombre s’élève à vingt-trois mille véhicules par jour, et les projections font état de trente et un mille véhicules quotidiens dans les dix ans.
Plusieurs hypothèses de travaux entre la RN 137 et la RN 171 vers Bouvron ont été étudiées, ainsi qu’entre la RN 173 à la RN 171, au sud de Blain. Pour autant, l’option envisagée ne permettra pas un aménagement complet du contournement de Blain. Il faut donc impérativement un aménagement de la RN 171 intégrant pleinement le contournement de la ville.
Cinq possibilités d’aménagement et de contournement ont été récemment dévoilées concernant cette route nationale.
Madame la ministre, pouvez-vous nous informer des dernières positions du comité consultatif piloté par la préfecture de Loire-Atlantique, à la lumière de l’abandon, notamment, du projet de nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes et donc de la desserte routière dédiée qui était prévue ?
Monsieur le sénateur Christophe Priou, vous souhaitez connaître ma position sur l’aménagement de la RN 171, en particulier au niveau de la commune de Blain.
L’État a engagé une étude de faisabilité sur la liaison entre la RN 171, à Bouvron, et la RN 137 en comaîtrise d’ouvrage avec le conseil départemental de Loire-Atlantique, afin notamment d’assurer une bonne coordination entre les travaux en cours sur le réseau routier national et les aménagements étudiés par le conseil départemental sur le secteur.
Cette démarche a permis d’établir un état des lieux de la RN 171 et des axes assurant la liaison entre Nort-sur-Erdre et Bouvron. Toutefois, vous le savez, la décision d’abandon du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes a modifié le cadre général de cette réflexion et a nécessité de réinterroger l’ensemble des hypothèses et des résultats d’études de circulation menées jusqu’alors. Un temps d’étude supplémentaire a donc été nécessaire pour prendre en compte ces nouvelles hypothèses.
Les études complémentaires ont fait l’objet d’une restitution au cours du comité de suivi du 5 juillet dernier, auquel vous étiez convié. Ce comité a permis de présenter le résultat des diagnostics réalisés ainsi que les cinq scénarios d’aménagement étudiés.
Deux de ces scénarios consistent à aménager la RN 171, en prévoyant notamment un contournement complet de Blain, tandis que les autres prévoient d’aménager une liaison est-ouest en parallèle des RD 16 et RD 164 existantes. Une phase de concertation avec le public est prévue au cours de l’année 2019 pour déterminer le parti d’aménagement préférentiel en s’appuyant sur les études menées. Votre point de vue sera donc examiné et pris en compte à cette occasion.
Je ne manquerai pas de revenir vers vous à l’issue de cette concertation pour vous informer des suites que nous donnerons s’agissant de l’aménagement de cet axe essentiel au bon développement de la Loire-Atlantique.

Je vous remercie, madame la ministre.
Il est évident que ce contournement est attendu et doit s’inscrire dans le projet stratégique pour les mobilités du Grand Ouest. En commission, nous avons souvent l’occasion de rappeler les conséquences de l’abandon par le Gouvernement du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes : il nous faudra, sur ce dossier comme sur d’autres, des mesures compensatoires extrêmement fortes et qui s’inscrivent dans le contrat d’avenir promis par l’État, à l’occasion de cet abandon.

La parole est à M. François Grosdidier, auteur de la question n° 471, adressée à Mme la ministre auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports.

Madame la ministre, l’axe Rhône-Saône-Moselle était déjà le premier axe nord-sud de l’Europe à l’époque romaine. Aujourd’hui, tout y dysfonctionne, en raison d’une série de non-décisions ou de mauvaises décisions ; et le pire est pour demain.
La route de la soie arrive au port de Rotterdam, se prolonge par le chemin de fer jusqu’à Bettembourg, puis se diffuse vers le sud par notre réseau routier et autoroutier, nous engorgeant, nous polluant. Le gouvernement français en répercute le coût sur les usagers français, après avoir renoncé à faire payer le transit international au travers de l’écotaxe poids lourds, alors que celle-ci existe chez nos voisins européens.
La première mauvaise décision a donc été l’abandon de cette taxe, qui aurait pourtant permis de faire payer au transit international ces infrastructures qu’il use, mettant ainsi en pratique le principe du pollueur-payeur.
Ce fiasco s’est soldé par le versement d’un milliard d’euros d’indemnité à Ecomouv’, par un manque à gagner, chaque année, d’un milliard d’euros pour financer nos infrastructures de transport et par la perte de centaines d’emplois promis à Metz en compensation des restructurations militaires.
Faute d’écotaxe, ce sont les Lorrains, dont les cent mille travailleurs frontaliers, qui devraient payer un péage sur l’autoroute A31 bis, pour rejoindre le Luxembourg, comme vous l’avez décidé le 24 septembre dernier. Cela représenterait jusqu’à 6, 36 euros par automobiliste. Faute d’écotaxe, ce sont tous les automobilistes français qui sont taxés et, acculés, sans autre solution, ils se révoltent en mettant leur gilet jaune.
Première question : pourquoi ne mettez-vous pas en place cette écotaxe ?
Vous avez annoncé ici même, le 5 juin dernier, l’abandon par le Gouvernement du projet de liaison fluviale Saône-Moselle, en m’expliquant que son coût était insoutenable pour la France. Mais il s’agit d’un projet européen. D’où ma deuxième question : allez-vous porter et défendre ce projet au niveau pertinent, l’Europe ?
Cerise sur le gâteau, nous avons appris le 26 septembre dernier la suppression de la liaison ferroviaire Metz-Nice. Pour rallier le sud de la France, les Lorrains doivent passer par Strasbourg ou par Paris…
Cette décision, qui pénalisera les nombreux voyageurs - hausse du prix des billets, multiplication des contraintes pratiques – est en outre une absurdité sur plan écologique. D’où ma troisième question : allez-vous rétablir la liaison ferroviaire directe entre Metz et Nice, et, troisième question bis, allez-vous enfin réduire l’embouteillage ferroviaire à Lyon, qui empêche le développement de l’autoroute ferroviaire Bettembourg-Perpignan ?
Monsieur le sénateur Grosdidier, avant toute chose, je souhaite réaffirmer ici que le Gouvernement n’a pas l’intention de restaurer le système de l’écotaxe.
Toutefois, vous le savez, nous sommes confrontés à plusieurs défis ; l’état de nos réseaux de transport s’est fortement dégradé depuis de trop nombreuses années. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé d’inscrire dans le projet de loi sur les mobilités une programmation sincère des infrastructures, qui prévoie une augmentation de 40 % de l’investissement dans les systèmes de transport au cours des cinq prochaines années. En 2019, cette augmentation des investissements est assurée par redéploiement au sein du budget de l’État, mais il faudra, à partir de 2020, une ressource nouvelle et durable à hauteur de 500 millions d’euros.
Pour ce qui concerne le secteur septentrional de l’A31 bis, la réalisation d’un contournement de Thionville en tracé neuf est nécessaire. Un débat public sur les différentes options de tracé vient d’être lancé, puis une décision ministérielle fixera les conditions de réalisation, notamment au sujet de la mise en place d’un péage qui permettra de financer et de réaliser les travaux dans un délai raisonnable. Je sais la contrainte financière que représente ce péage pour les usagers de l’A31, mais il est indispensable pour répondre rapidement aux difficultés qu’ils connaissent.
J’en arrive au projet « Saône-Rhin Saône-Moselle » que vous appelez de vos vœux. Ce projet de 350 kilomètres de voies navigables a un coût de l’ordre de 15 milliards d’euros. Malgré l’impact économique de ce projet sur la région, le coût de l’infrastructure paraît hors de portée des financements envisageables, même en intégrant le soutien de l’Union européenne. Il ne peut donc malheureusement pas constituer une réponse avant un horizon de long terme.
Enfin, en ce qui concerne la liaison en train à grande vitesse, ou TGV, entre Metz et Nice, la gare de Lyon Part-Dieu connaît précisément des travaux importants jusqu’en 2023 – un débat aura lieu en 2019 sur le nœud ferroviaire lyonnais –, ce qui limitera la capacité d’accueil et entraînera des modifications de dessertes.
Pour compenser cette situation, SNCF Mobilités a proposé un départ depuis Nancy reliant Strasbourg à Marseille et à Nice, et le prolongement de la liaison TGV entre Montpellier et Strasbourg jusqu’à Metz, pour renforcer le lien avec l’arc méditerranéen. La SNCF a rencontré les élus pour leur présenter ces propositions, en lien avec la région Grand Est.
Par ailleurs, un groupe de travail se réunira autour des sujets de desserte ferroviaire pour aborder en amont les évolutions de dessertes de TGV et de trains express régionaux, les TER.
Enfin, je précise que la loi pour un nouveau pacte ferroviaire impose la création de comités de desserte au sein desquels les élus seront représentés.

La parole est à Mme Viviane Artigalas, auteur de la question n° 488, adressée à Mme la ministre auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports.

Madame la ministre, à l’heure actuelle, de nombreuses villes demeurent à cinq heures de train de Paris, et les temps de trajet sur les transversales, vers Lyon, Strasbourg, Nantes, Lille ou Nice, sont souvent de plus de sept ou huit heures. Dans ces conditions, il peut sembler opportun de mettre en avant une mobilité pratique pour de tels temps de trajets et, en la matière, les trains Intercités de nuit présentent de nombreux avantages.
Ils permettent par exemple d’arriver tôt le matin ou de partir après une journée de travail, et d’arriver en centre-ville. Ils constituent également un complément efficient aux lignes à grande vitesse et, dans l’hypothèse d’une rénovation de qualité du confort des voitures, ils pourraient représenter une offre de mobilité touristique attractive.
À l’étranger, un opérateur autrichien a démontré que les Intercités de nuit, avec un bon niveau de service, peuvent réaliser des bénéfices. Pourtant, en France, cette qualité de service est très basse, et ces trains de nuit subissent de nombreuses annulations et déprogrammations.
L’unique train Intercités de nuit actuel pour le Sud-Ouest dessert déjà quatre destinations : Rodez, Toulouse, Latour-de-Carol et Portbou. Il n’y a pas assez de voitures pour chacune d’entre elles – seulement trois pour Rodez et pour Latour-de-Carol, et ce train affiche souvent complet. Les horaires ne peuvent être optimisés pour autant de destinations disparates et, surtout, la desserte des Hautes-Pyrénées, département dont je suis élue, a été oubliée.
Je regrette bien évidemment cet oubli, comme je regrette fortement la suppression récente de la liaison de nuit Paris-Tarbes-Hendaye, la célèbre Palombe bleue. Nous nous trouvons aujourd’hui dans une situation déséquilibrée en termes d’aménagement et face à un enjeu d’équité territoriale.
À l’aube du projet de loi sur les mobilités, et au moment où vous venez d’annoncer le maintien et la rénovation des lignes reliant Paris aux Pyrénées-Orientales, d’un côté, et aux Hautes-Alpes de l’autre, l’État serait-il prêt à améliorer, dans les mêmes conditions, la desserte du Sud-Ouest avec un deuxième train Intercités de nuit reliant les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ?
Madame la sénatrice Artigalas, vous m’interrogez sur la desserte par train de nuit des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, ainsi que sur l’éventualité d’ouvrir une seconde ligne desservant ces régions.
J’ai récemment eu l’occasion d’emprunter le train de nuit pour un déplacement dans les Hautes-Alpes et je suis, comme vous, convaincue que c’est une bonne solution pour l’accessibilité de certains territoires et un atout pour leur développement économique et touristique.
C’est la raison pour laquelle je réaffirme ici mon engagement à maintenir les deux lignes existantes de train de nuit, Paris-Briançon et Paris-Rodez-Latour-de-Carol- Perpignan-Cerbère. La convention d’exploitation actuelle, qui échoit en 2020, sera donc reconduite au-delà.
C’est un effort significatif, car le subventionnement de ces lignes représente plus de 20 millions d’euros par an.
En outre, l’État a également décidé de financer à hauteur de 30 millions d’euros la rénovation du matériel roulant, afin de le mettre aux standards actuels de confort, avec notamment le remplacement des couchettes, l’installation de prises électriques et l’équipement en Wi-Fi. Les travaux commenceront dès l’an prochain.
Néanmoins, ouvrir une seconde ligne de nuit desservant les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ne paraît pas envisageable aujourd’hui dans le cadre de la convention financière des trains d’équilibre du territoire. En outre, la ligne à grande vitesse qui relie Paris à Bordeaux en deux heures et à Bayonne en quatre heures a sensiblement amélioré l’offre dans le Sud-Ouest. Pour autant, je reste ouverte à toute proposition émanant de collectivités territoriales qui permettrait d’envisager l’exploitation de telles dessertes.
Enfin, je vous le rappelle, à compter de 2020, un opérateur pourra librement mettre en place de tels services s’il le souhaite.

La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour une réplique, en dix-sept secondes.

Je vous remercie, madame la ministre, de vos réponses, et je me félicite de la rénovation des trains de nuit ; je crois que c’est important. J’insiste toutefois sur le fait que les Hautes-Pyrénées sont un petit peu éloignées de toutes ces dessertes et qu’il est important pour nous d’être moins isolés que nous ne le sommes actuellement.

La parole est à M. Laurent Lafon, auteur de la question n° 495, adressée à Mme la ministre auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ma question porte sur l’aménagement de la route nationale 19, et plus particulièrement sur son raccordement à la Francilienne.
La déviation de la RN 19 à Boissy-Saint-Léger, actuellement en travaux, est une étape importante dont chacun se réjouit. Néanmoins, elle s’inscrit dans un projet d’ensemble : le réaménagement de la totalité du barreau de liaison entre la RN 406 et la Francilienne.
En ce sens, le contournement de Boissy est certes une étape importante, mais l’État et les collectivités ne doivent pas perdre de vue l’objectif majeur du projet : l’aménagement de la RN 19 jusqu’à la Francilienne.
L’année prochaine, nous fêterons le vingt-cinquième anniversaire de l’inscription de la déviation au schéma directeur de la région d’Île-de-France. Voilà plus de trente ans que l’Association pour l’aménagement de la RN 19 a été créée par les maires pour alerter l’État et les collectivités. À l’époque, ils dénonçaient le risque lié à l’absence d’opération routière structurante au regard de la forte croissance démographique du territoire.
La suite leur a donné raison : aujourd’hui, la déviation jusqu’à la Francilienne est plus que nécessaire. Elle est même indispensable pour décharger les voiries locales et pour éviter les goulets d’étranglement qui reportent la circulation automobile dans les communes du plateau briard, dont la voirie n’est pas adaptée à un tel afflux. Ce sont la préservation de l’environnement et la qualité de vie de l’ensemble de ces communes qui sont en jeu avec cet aménagement.
En mars 2018, la commission permanente de la région d’Île-de-France a débloqué 1, 5 million d’euros de crédits. Ces derniers permettront de financer les études préalables à la saisine de la Commission nationale du débat public, conformément au contrat de plan État-région 2015-2020.
Ma question porte donc, madame la ministre, sur la position de l’État par rapport à la finalisation globale du projet d’aménagement jusqu’à la Francilienne. L’État est-il prêt à s’engager dans la poursuite de l’aménagement et, si oui, selon quel calendrier ?
Monsieur le sénateur Laurent Lafon, vous appelez mon attention sur l’aménagement de la RN19 depuis Bonneuil-sur-Marne jusqu’à la Francilienne.
Je suis, comme vous, consciente des attentes des usagers et des riverains de cet axe.
Comme vous l’avez indiqué, pour répondre à ces enjeux, les travaux de la première phase d’aménagement, consistant en la déviation de Boissy-Saint-Léger, sont en cours. La réalisation de la tranchée couverte a été achevée à l’été 2017. Les travaux du diffuseur sud ont quant à eux démarré au printemps 2017 et l’achèvement de l’opération est prévu à la fin de l’année 2019. La mobilisation financière de l’État et de la région Île-de-France aura ainsi permis la bonne avancée du projet.
Le projet d’aménagement de la RN19 entre Villecresnes et la Francilienne constituera la seconde phase de l’aménagement de la RN19 en route express jusqu’à la RN104. Pour cette seconde phase de l’opération, 3 millions d’euros, à parité entre l’État et la région, ont été inscrits au contrat de plan État-région 2015–2020. Ces crédits permettront d’étudier les solutions d’aménagements en vue de la tenue d’une première phase de consultation du public. Une convention de financement à cet effet a été signée avec la région Île-de-France.
Je tiens donc à vous rassurer sur les intentions de l’État concernant cette opération. Ainsi que le Gouvernement s’y est engagé, mes services réalisent actuellement les études pour définir les besoins exacts de mobilité du territoire desservi et identifier par la suite les différentes options d’aménagement envisageables. Le calendrier des prochaines échéances reste donc inchangé par rapport à celui qui a été initialement fixé. Dans ce cadre, la saisine de la Commission nationale du débat public pourrait intervenir à l’horizon 2020.

La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet, auteur de la question n° 502, adressée à Mme la ministre auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports.

Madame la ministre, les conditions d’utilisation de la voie en site propre créée sur l’autoroute A10, en Essonne, entre Villebon-sur-Yvette et la gare de Massy sont actuellement définies par un arrêté préfectoral du 16 novembre 2017. Cette voie dédiée aux bus vise à réduire et à fiabiliser le temps de parcours des usagers, en leur permettant de franchir la congestion la plus dure dans ce secteur. L’expérience quotidienne montre que cet objectif a été atteint.
En revanche, les conditions d’usage de cette voie sont actuellement autorisées uniquement pour les véhicules assurant les services de transport public régulier de personnes organisés par Île-de-France Mobilités ou par les services du réseau de transport des personnes à mobilité réduite.
Aussi, les navettes privées mises en place par certaines sociétés, notamment Thales Air Defence, fleuron de la technologie française situé à Limours, commune dont j’ai été le maire pendant dix-sept ans, n’étant pas considérées comme assurant du transport public, ne sont malheureusement pas autorisées à utiliser cette voie, pourtant disponible.
Autoriser la circulation de ces navettes sur cette voie dédiée de l’autoroute A10 entre Villebon-sur-Yvette et la gare de Massy serait une mesure d’efficacité et de bon sens qui ne coûterait pas un centime de plus à qui que ce soit et permettrait un gain de temps et d’organisation pour leurs utilisateurs.
Aussi, madame la ministre, envisagez-vous d’ouvrir la circulation aux navettes privées sur ce tronçon de l’autoroute A10 ? Plus largement, quelles mesures comptez-vous prendre pour encadrer et favoriser le développement de services de mobilités propres sur l’ensemble du territoire francilien ?
Monsieur le sénateur Hugonet, la voie réservée mise en service en novembre 2017 sur l’A10 fait partie du programme prioritaire, pour la période 2014–2020, de réalisation de voies dédiées aux bus et, le cas échéant, aux taxis sur le réseau routier national francilien. D’un montant de 65 millions d’euros, ce programme vise à encourager l’utilisation des transports en commun, en les rendant plus fiables et performants, donc plus attractifs. Il s’inscrit pleinement dans l’objectif du Gouvernement de donner la priorité aux mobilités du quotidien.
Après la mise en service de voies réservées sur l’A1, l’A6a, l’A10 et, très récemment – en septembre dernier –, sur l’A12, ce programme se poursuivra avec la mise en service prochaine d’une voie réservée sur l’autoroute A3 et avec l’étude de la faisabilité de voies réservées sur la RN104 et la RN118.
Le projet de loi d’orientation des mobilités, que je présenterai au conseil des ministres à la fin du mois, permettra de développer plus avant ces solutions de mobilité.
Concernant la voie réservée de l’A10, vous avez rappelé les conditions actuelles d’utilisation, fixées par l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2017.
S’agissant de la possibilité d’utiliser cette voie pour les navettes privées organisées par des entreprises, je vous informe que votre demande est en cours d’instruction. En effet, sans attendre l’adoption de la loi, des études et des consultations sont en cours pour examiner la faisabilité et l’impact sur les conditions de circulation qu’aurait une ouverture de la voie réservée de l’A10 à l’ensemble des transports en commun.
J’examinerai très prochainement, avec le ministre de l’intérieur, les résultats de ces études pour décider du lancement de cette expérimentation. Je ne manquerai pas de vous en tenir informé.

La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet, pour répondre à Mme la ministre, en cinquante et une secondes.

Madame la ministre, je vous remercie de l’intérêt que vous portez à ce sujet.
Dans nos territoires périurbains, le développement économique et le transport, qui en est le vecteur indispensable, sont bien évidemment liés.

La parole est à Mme Nelly Tocqueville, auteur de la question n° 489, transmise à M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.

Madame la ministre, je me permets d’attirer votre attention sur un sujet particulièrement sensible dans mon département, la Seine-Maritime.
Le plateau de Caux, plateau calcaire, est particulièrement concerné par le problème des cavités souterraines, plus communément appelées, chez nous, « marnières ».
Celles-ci sont le résultat de l’exploitation de la craie, par le passé, à des fins agricoles. Elles sont généralement constituées d’un puits, qui se sépare le plus souvent en une ou plusieurs galeries souterraines.
L’exploitation de la craie n’existe plus depuis des décennies, mais, régulièrement, à la faveur des périodes pluvieuses de l’hiver ou sèches de l’été, les marnières réapparaissent et provoquent des affaissements de terrain.
Le plus souvent, les marnières n’ont pas été déclarées et il est particulièrement difficile de les déceler a priori. L’élaboration des plans locaux d’urbanisme et, bientôt, des plans locaux d’urbanisme intercommunaux prend pleinement en compte ce sujet complexe, mais de nombreux cas, dont la presse locale se fait régulièrement l’écho, se déclarent encore chaque année.
Au-delà de la seule problématique technique, ce phénomène touche des familles dont les habitations doivent parfois être abandonnées. Les solutions de confortement, quand elles sont envisageables, sont coûteuses pour les propriétaires, qui se retrouvent dans une situation de grand désarroi.
Certes, plusieurs dispositifs d’accompagnement sont possibles. Ainsi, le dispositif du fonds Barnier, destiné à accompagner les conséquences des catastrophes naturelles, peut être mobilisé selon des taux définis. Le département abonde également sur les travaux réalisés, y compris lorsqu’ils interviennent chez des particuliers. Cependant, les subventions sont calculées sur le montant hors taxes, alors que le taux de TVA en la matière demeure à 20 % et à la charge du propriétaire.
Madame la ministre, je tenais à vous sensibiliser sur cette difficulté particulière, car les travaux à engager sont coûteux. J’ai récemment été interpellée par un particulier qui doit s’acquitter d’une facture qui s’élève à 100 000 euros, dont 20 % de TVA. Vous imaginez bien qu’une telle somme est considérable pour un ménage qui s’est déjà endetté pour réaliser son projet de vie ! Il ne sera pas forcément en mesure de supporter cette charge. Les subventions avoisinent 50 % du montant hors taxes. Mais ce sont encore près de 20 000 euros de TVA qui doivent être absorbés par le particulier, quand une collectivité peut, elle, les récupérer via le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, le FCTVA.
Madame la ministre, pensez-vous qu’il soit possible, notamment dans le cadre du débat sur le projet de loi de finances pour 2019, d’envisager un taux de TVA nul ou du moins réduit sur ces dossiers, qui sont peu nombreux, mais qui impactent fortement les particuliers concernés ?
Madame la sénatrice Tocqueville, M. François de Rugy, ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, que vous avez interrogé, ne pouvait être présent dans cet hémicycle ce matin. Il m’a chargée de vous répondre.
Le sous-sol crayeux de la Seine-Maritime, notamment celui du pays de Caux, présente effectivement de nombreuses cavités souterraines. Parmi ces cavités, les « marnières », creusées pour l’exploitation de matériaux, sont aujourd’hui abandonnées et peuvent, par dégradation naturelle, engendrer des effondrements en surface, voire des fontis de plusieurs dizaines de mètres de diamètre.
M. de Rugy partage totalement votre préoccupation sur le désarroi des propriétaires confrontés à ce risque. C’est pourquoi le ministère s’est engagé depuis plusieurs années dans des actions ayant pour objectifs d’améliorer la connaissance et de réduire le risque inhérent à l’existence de ces carrières souterraines.
À ce titre, des guides et documents méthodologiques sur l’étude, la prévention et la gestion du risque associé aux cavités souterraines ont été élaborés, en lien avec les collectivités locales. En complément, à la demande du ministère, le Bureau de recherches géologiques et minières, le BRGM, réalise actuellement un inventaire des cavités souterraines abandonnées de la Normandie orientale, à savoir les départements de la Seine-Maritime et de l’Eure, afin d’améliorer la connaissance du phénomène.
Le ministère accompagne également financièrement les actions menées par les collectivités ou les particuliers eux-mêmes, via le fonds Barnier. Les communes peuvent être accompagnées pour la réalisation d’études ou de travaux de prévention, sur la base d’un taux de 40 % ou de 50 % selon les cas.
Les particuliers peuvent bénéficier d’un soutien financier de 30 % sur les opérations de reconnaissance des cavités ainsi que sur le traitement et le comblement de ces dernières, si les dangers pour les constructions et les vies humaines sont avérés et dès lors que les travaux de comblement sont moins coûteux que l’expropriation.
En complément des actions faites par l’État, beaucoup de collectivités concernées se mobilisent sur cet enjeu important pour la région. M. François de Rugy tient à saluer leur action.
Certaines d’entre elles lui font part du fait que, malgré leur mobilisation et les outils mis en place par l’État, il demeure difficile de traiter efficacement cette difficulté.
François de Rugy souhaite donc missionner très prochainement le Conseil général de l’environnement et du développement durable, afin qu’il propose des pistes d’amélioration des dispositifs en place. Cette réflexion portera également sur les volets financiers d’accompagnement de cette politique.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, auteur de la question n° 452, transmise à M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.

Madame la ministre, j’attire l’attention du Gouvernement sur les nouvelles dispositions qui s’appliquent au contrôle technique des véhicules associatifs assurant les services d’urgence aux personnes.
L’arrêté du 4 septembre 2017, entré en vigueur le 20 mai 2018 et modifiant celui du 18 juin 1991 pour les véhicules dont le poids n’excède pas 3, 5 tonnes, a introduit de nouveaux points de contrôle pour les véhicules de secours associatifs équipés d’avertisseurs sonores et lumineux, tels ceux qui sont utilisés par la Croix-Rouge, dans le cadre de leur mission de premiers secours aux personnes.
Les modifications introduites et leur application stricte par les opérateurs agréés pour le contrôle technique des véhicules légers amènent les organismes de secours à recevoir des avis défavorables, pour motif de « défaillance majeure ».
En d’autres termes, sans une intervention du Gouvernement, les équipements sonores et lumineux actuellement installés sur les véhicules de secours de la Croix-Rouge ou de la protection civile devront être retirés, ce qui aura pour conséquences de restreindre l’usage et l’efficacité de ces secours indispensables et de mettre en danger la vie de nos concitoyens : sans avertisseurs, ces véhicules arriveront plus tard et il leur sera impossible d’obtenir la priorité sur la voie publique lors des interventions urgentes.
Quelles mesures le Gouvernement entend-il mettre en œuvre pour permettre à ces associations de continuer à assurer leurs missions en cas de situation exceptionnelle ?
Madame la sénatrice Procaccia, je veux vous rassurer : les règles du contrôle technique applicables depuis le 20 mai 2018 sont entièrement compatibles avec les caractéristiques spécifiques des véhicules associatifs assurant les services d’urgence aux personnes. Considérés en tant que véhicules d’intérêt général, ces véhicules peuvent être équipés des feux, dispositifs de signalisation complémentaire et avertisseurs spécifiques au transport sanitaire terrestre qui leur permettent d’assurer plus efficacement leurs missions.
Ces caractéristiques techniques particulières doivent être indiquées sur le certificat d’immatriculation du véhicule par la mention d’une affectation aux transports sanitaires.
Lorsque cette mention figure sur le certificat, la présence des équipements spécifiques que je viens d’évoquer n’est pas sanctionnée lors du contrôle technique.
Dans le cas contraire, la mention peut y être ajoutée en présentant le véhicule en réception à titre isolé auprès d’une direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, puis en effectuant la demande de modification du certificat d’immatriculation via le téléservice de l’Agence nationale des titres sécurisés.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour répondre à Mme la ministre, en cinquante et une secondes.

Madame la ministre, je vous remercie de ces précisions, que je vais transmettre à la Croix-Rouge et à la protection civile.
Ces dernières nous ont saisis parce qu’on leur refuse pour l’instant le contrôle technique, sans doute à cause du certificat d’immatriculation.
Je vais les inciter à faire les démarches nécessaires. J’espère qu’elles pourront ainsi continuer à intervenir, parce que nous savons tous que leur action est indispensable et qu’elles n’ont pas les moyens d’acheter de nouveaux équipements ou de nouveaux véhicules.

La parole est à Mme Éliane Assassi, auteur de la question n° 461, adressée à Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées.

Madame la secrétaire d’État, ma question porte sur la pénurie de places en instituts médico-pédagogiques dans le département de la Seine-Saint-Denis et, plus précisément, sur la prise en charge des enfants, adolescents et adultes en situation de handicap.
La maison départementale des personnes handicapée constatait, en 2016, qu’il n’existait que 1 800 places en instituts médico-éducatifs, en instituts médico-professionnels et en instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques pour les 3 400 enfants et adolescents orientés vers ces établissements.
Cela conduit à de nombreuses déscolarisations et à de mauvaises orientations pour des enfants et adolescents fragiles. Des parents sont contraints de quitter leur emploi ou de recourir à des écoles privées hors contrat, dont le coût n’est pris en charge que partiellement.
Concernant les adultes, 450 sont placés en Belgique, quand 165 jeunes adultes de plus de vingt ans sont maintenus dans des établissements pour enfants et adolescents au titre de « l’amendement Creton ».
Selon le plan départemental « Défi Handicap », 900 places manquent dans les structures pour adultes. En Seine-Saint-Denis, année après année, les institutions sont confrontées à des situations pour lesquelles il est impossible de trouver une solution, qu’il s’agisse d’enfants ou d’adultes.
La situation est grave. L’Agence régionale de santé, l’ARS, devrait s’en indigner, quand l’éducation nationale n’offre aucun débouché concret aux familles, à part la déscolarisation.
Le vice-président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes en situation de handicap de la Seine-Saint-Denis, qui est présent ce matin dans les tribunes de notre hémicycle, appelle le Gouvernement, au nom des familles, à prendre des mesures d’urgence. Que lui répondez-vous, madame la secrétaire d’État ?
Madame la sénatrice, je partage votre constat sur l’insuffisance de l’offre d’accompagnement des personnes, enfants ou adultes, en situation de handicap dans la région Île-de-France, particulièrement en Seine-Saint-Denis. Cette situation n’est pas acceptable.
Ce constat n’est malheureusement pas nouveau, puisqu’il rejoint celui, critique, qu’avait dressé la Cour des comptes dès 2012, dans un rapport sur les missions de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA, regrettant l’insuffisance du rééquilibrage de l’offre médico-sociale entre les territoires.
Les actions entreprises pour accélérer le rattrapage ont toutefois été lentes. Ainsi, la CNSA n’a revu qu’en 2017 sa méthode de répartition des crédits pour renforcer l’équité territoriale.
Aussi, Sophie Cluzel a pris, dès sa nomination, la décision de renoncer à l’emploi de la « réserve ministérielle », pratiquée par tous les gouvernements précédents, dont la Cour des comptes avait critiqué la pratique opaque et noté qu’elle était un frein au rééquilibrage.
L’intégralité des crédits nouveaux de 2018 a ainsi pu être répartie selon des critères prenant mieux en compte les dynamiques des besoins, qui sont très favorables à la région Île-de-France. D’ores et déjà bénéficiaire prioritaire de l’enveloppe de transformation de l’offre, dotée de 180 millions d’euros, la région Île-de-France a disposé, pour cette seule année, d’une enveloppe de plus de 18 millions d’euros pour développer et transformer son offre, améliorer l’accompagnement des personnes autistes et prévenir les départs non souhaités vers la Belgique.
Il y a urgence. Les tensions sur l’offre francilienne sont fortes, en particulier dans le département de la Seine-Saint-Denis.
C’est pourquoi l’Agence régionale de santé considère que ce département est prioritaire dans sa politique d’équipement. Elle a lancé un plan de développement de réponses inclusives, mobilisant, outre ses crédits, les moyens juridiques plus souples qui lui ont été accordés de manière dérogatoire par un décret du 29 décembre 2017.
Le premier appel à manifestation d’intérêt, lancé en juillet dernier, a rencontré un vif succès : 305 dossiers de candidature ont été déposés. Ces derniers incluent des projets répondant à la variété des besoins : appui à la scolarisation en milieu ordinaire, propositions d’habitat inclusif ou encore d’emploi accompagné.
Les premières autorisations seront délivrées avant la fin de l’année.
Les projets qui n’auraient pas pu être retenus dans le cadre de cette première vague pourront l’être dans celui d’un second appel à manifestation d’intérêt, mais aussi des contrats pluriannuels d’objectifs que l’ARS doit engager tout au long de l’année 2019.
Cette politique ne pourra porter pleinement ses fruits qu’en étroite coopération avec les départements, qui partagent la responsabilité de cette politique avec l’État, et grâce à un travail de concertation, lequel est déjà engagé.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour répondre à Mme la secrétaire d’État, en quarante-neuf secondes.

Madame la secrétaire d’État, vous admettrez que le fait que de nombreux enfants et adultes de notre département soient privés de leurs droits fondamentaux, tels le droit à l’éducation, le droit à vivre dignement et le droit à bénéficier d’un accès aux soins, est choquant dans un pays comme le nôtre. Ces personnes et leur famille ne sauraient attendre davantage aujourd’hui. Elles ont déjà trop attendu, et peu de réponses leur ont été données.
Il conviendrait que le Gouvernement ne se contente pas d’annonces générales et prenne des mesures d’urgence pour notre pays, bien évidemment, mais aussi pour la Seine-Saint-Denis en particulier.
Je le répète, il y a urgence, car c’est tout simplement une question d’humanité.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, en remplacement de M. Édouard Courtial, auteur de la question n° 487, transmise à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Madame la secrétaire d’État, mon collègue Édouard Courtial étant souffrant, je vais vous donner lecture de sa question, qui porte sur le plan Pauvreté.
Faire mieux avec moins : plus qu’une ligne de conduite, ce principe est devenu, année après année, au fil des baisses inédites des dotations de l’État depuis la précédente législature, un credo et même une condition de survie pour de nombreuses collectivités, malgré leurs efforts, tout aussi inédits, pour certaines d’entre elles, de réduction des dépenses de fonctionnement, par respect de la parole donnée aux électeurs autant que des deniers publics, fruits du travail de nos compatriotes.
Mais, depuis peu, il s’agit de faire mieux avec plus, non pas plus de moyens, mais plus de compétences et plus de dépenses supplémentaires non compensées par l’État.
Le plan Pauvreté du Gouvernement en est un parfait exemple pour les conseils départementaux.
En effet, si le Président de la République a annoncé une compensation de 8, 5 milliards d’euros, cette somme est toujours en deçà de ce que l’État doit chaque année aux départements pour compenser les dépenses qu’ils effectuent pour lui et qui ne leur sont pas remboursées.
J’en prendrai deux exemples concrets.
Premièrement, le plan Pauvreté renforce l’accompagnement vers l’emploi, en clair le revenu de solidarité active, ou RSA. Or, avant même l’annonce du Président de la République, l’État ne remboursait que 47 % du coût du RSA aux départements. Et vous leur demandez de dépenser toujours plus sur leurs budgets propres ? Ce n’est pas raisonnable.
Deuxièmement, le plan Pauvreté étend l’aide sociale à l’enfance jusqu’à vingt et un ans. Si cela est le cœur de métier du département, la politique migratoire qui est menée depuis 2012 ne l’est pas, et les choix gouvernementaux en la matière font littéralement exploser la demande d’accueil des mineurs étrangers isolés, ou mineurs non accompagnés en politiquement correct. Avant même l’annonce du Président de la République, les centres d’accueil étaient déjà saturés. Et vous demandez aux départements d’aller encore au-delà ? Là encore, ce n’est pas raisonnable.
Madame la secrétaire d’État, selon un principe général du droit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C’est pourtant bien ce que fait l’État en se défaussant sur les conseils départementaux et, plus généralement, sur les collectivités territoriales, en leur demandant toujours plus d’efforts budgétaires, exigence qu’il ne s’applique pas à lui-même.
Madame la sénatrice, vous m’interrogez sur la mise en œuvre du plan de lutte contre la pauvreté au niveau des collectivités territoriales.
Vous avez raison : la stratégie doit être mise en œuvre au plus près des territoires. L’État a pour mission d’organiser un pilotage par tous les acteurs, qu’il s’agisse des associations ou des collectivités, à l’échelon régional. Des animateurs seront désignés parmi eux pour faire avancer le travail collectif sur les différentes thématiques de la stratégie.
En ce qui concerne les mesures relevant de la compétence des départements, chefs de file en matière d’aide sociale, la stratégie prévoit une contractualisation ambitieuse avec les conseils départementaux. Les travaux de contractualisation ont déjà été engagés avec les territoires démonstrateurs de la stratégie, qui sera déployée ensuite dans l’ensemble des départements avant la fin du premier semestre 2019.
La contractualisation s’appuie sur 135 millions d’euros de crédits, dont 50 millions d’euros de fonds d’appui aux politiques d’insertion en 2019, et atteindra au moins 210 millions d’euros d’ici à 2022.
Elle porte sur un socle de thématiques et d’actions dans les domaines de l’aide sociale à l’enfance, de l’insertion, des droits fondamentaux des enfants et du travail social. Sur un socle laissé à l’initiative des départements, ces derniers pourront proposer des actions en lien avec les ambitions de la stratégie, par exemple en matière de prévention spécialisée ou de PMI, auxquelles l’État apportera son soutien financier.
Notre stratégie émane d’une large concertation de terrain. Sa mise en œuvre requiert une gouvernance nouvelle, pilotée et portée par l’ensemble des acteurs, à partir des territoires. En effet, c’est bien sur le terrain que le combat doit être mené.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour répondre à Mme la secrétaire d’État, en douze secondes.

Madame la secrétaire d’État, vous devez entendre, en cette semaine du Congrès des maires, le cri d’alarme des départements et des collectivités.
Nous devons prendre en charge de plus en plus de personnes. La concertation, la contractualisation ne permet pas de faire face à cet afflux de personnes.
Mme Frédérique Puissat applaudit.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, en remplacement de M. Bernard Bonne, auteur de la question n° 459, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Lors de la présentation du plan stratégique de transformation de notre système de santé, en septembre dernier, le Président de la République a annoncé la fin, à partir de 2020, du numerus clausus ainsi que du concours de fin de première année commune aux études de santé, ou PACES.
En effet, plus personne ne défend, en l’état, ce dispositif, qui visait, lors de son instauration, à limiter le nombre de médecins formés et à contenir les dépenses d’assurance maladie, d’autant que cette première année est unanimement pointée comme un gâchis, dans la mesure où les trois quarts des 60 000 inscrits en PACES échouent à l’issue de ce concours, qui repose largement sur les seules capacités de mémorisation des candidats.
Le numerus clausus et les concours seront donc remplacés par un premier cycle commun d’une durée de trois ans. Les étudiants passeront des partiels pour accéder en deuxième année.
Or, en annonçant la fin de ce système à partir de 2020, ce sont les actuels étudiants en PACES qui s’interrogent sur les conséquences de la suppression du numerus clausus, alors qu’ils seront les derniers à y être soumis.
Ces jeunes gens et ces jeunes filles qui passeront le concours en 2019, qu’ils soient inscrits en première année pour la première fois ou qu’ils redoublent cette première année, s’estiment terriblement pénalisés par rapport à ceux qui entreront en première année en 2020.
Aussi, madame la secrétaire d’État, M. Bonne souhaite savoir ce que le Gouvernement entend faire précisément pour ces étudiants, compte tenu de leur situation spécifique.
Madame la sénatrice, je vous remercie de votre question, qui me permet de répondre aux inquiétudes sur les modalités de suppression du numerus clausus.
Le Président de la République a présenté, le 18 septembre dernier, notre stratégie pour transformer en profondeur le système de santé. Dans ce plan, intitulé « Ma santé 2022 », l’adaptation des formations aux enjeux de santé de demain a été identifiée comme un axe prioritaire de travail, avec l’annonce de la suppression du numerus clausus et la refonte des premiers cycles des études en santé.
En effet, comme vous le rappelez justement, le constat est établi que le numerus clausus est un outil inadapté s’il est utilisé seul pour assurer la couverture suffisante du besoin en professionnels de santé sur l’ensemble du territoire.
Le numerus clausus conduit, de plus, à un véritable gâchis humain, du fait d’une sélection de profils d’étudiants réalisée sur des critères pouvant sembler en décalage par rapport aux compétences que l’on attend aujourd’hui dans la pratique quotidienne de la médecine.
Il représente aujourd’hui un obstacle à un déroulé fluide des études d’enseignement supérieur, en ne prévoyant qu’insuffisamment des débouchés vers l’offre de formation globale des universités.
Partant de ces constats, les principaux objectifs de la réforme, que nous conduisons avec Mme la ministre en charge de l’enseignement supérieur et qui sera concertée avec l’ensemble des acteurs, permettront d’apporter des réponses plus adaptées aux défis de notre système de santé.
Il s’agira notamment de diversifier les profils des étudiants et de décloisonner les études, en favorisant les passerelles et les enseignements communs entre plusieurs filières, de garantir le niveau de qualité de nos formations en santé et d’améliorer la qualité de vie des étudiants.
La mise en œuvre de la suppression du numerus clausus tiendra compte du bilan des expérimentations alternatives à la PACES lancées en application de la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. Ce bilan permettra de prendre les décisions les plus adaptées à la gestion de la période transitoire que vous avez évoquée. Pour l’heure, il est prématuré de prendre position de manière définitive.
En tout état de cause, nous veillerons à ce que les étudiants qui passeront le concours en 2019 ne soient pas désavantagés par rapport à ceux qui entreront en première année d’études universitaires en 2020.
Le Gouvernement sera très attentif à la conservation de la qualité de nos études, laquelle ne pourra se traduire que par le maintien d’un système sélectionnant les candidats les plus aptes à exercer le métier exigeant, mais passionnant, de médecin.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour répondre à Mme la secrétaire d’État, en cinquante-deux secondes.

Je prends bonne note de votre réponse, madame la secrétaire d’État.
Nous partageons les objectifs de cette réforme : chacun reconnaît en effet que ce système de sélection constitue un gâchis.
Comme vous le soulignez, cette période de transition suppose une attention particulière. Or le Gouvernement n’a encore rien annoncé.
Ne serait-il pas souhaitable d’augmenter sensiblement le numerus clausus – de l’ordre de 15 ou 20 % – pour éviter que des candidats ne décident d’attendre l’année prochaine pour passer le concours ?
Dix ans étant nécessaires pour former un médecin, il ne faudrait pas que nous nous retrouvions dans dix ans face à un gap, parce qu’un certain nombre de jeunes étudiants auraient décidé de s’abstenir de passer les concours dans cette période transitoire.

La parole est à M. Philippe Madrelle, auteur de la question n° 493, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Comme vous le savez, madame la secrétaire d’État, le hasard du calendrier fait que cette journée du 20 novembre est une journée de grève pour toute une profession : les infirmières et les infirmiers n’en peuvent plus du manque de considération et d’écoute du Gouvernement.
Deux ans après la promulgation de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et dans le contexte des annonces réformant ce système, les trois syndicats représentatifs de 120 000 infirmiers libéraux ont quitté la table des négociations conventionnelles. C’est dire la situation d’incompréhension et de profonde détresse dans laquelle se trouve l’ensemble de toute une profession appelée à jouer un rôle irremplaçable et essentiel auprès des patients.
Les infirmières constituent un maillon de toute première importance au sein de notre système de santé. En effet, à elle seule, cette profession assure la continuité et la permanence des soins au domicile des patients, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et sept jours sur sept.
Pourriez-vous me préciser, madame la secrétaire d’État, dans quels délais sera mise à jour la nomenclature générale des actes professionnels afin que les infirmières et les infirmiers puissent répondre aux attentes et demandes légitimes des patients comme la prise de tension artérielle, la pose de bas de contention ou l’administration de médicaments particulièrement délicate avec des risques de confusion en matière de génériques ? Ces professionnels doivent pouvoir travailler en toute sécurité.
En outre, la prise en charge des suivis de pathologies lourdes reste largement sous-cotée. À titre d’exemple, pour un soin de stomie qui dure vingt à trente minutes, le professionnel va percevoir 6, 30 euros, la moitié de cette somme étant versée en charges sociales.
Par ailleurs, à partir de trois actes consécutifs, le premier est rémunéré à taux plein, le deuxième à moitié prix et les suivants sont effectués gratuitement. Il serait souhaitable que l’infirmière puisse être rémunérée lorsque le patient appelle pour un incident.
Le rôle de prévention et d’organisation des soins n’est jamais pris en compte, alors que l’augmentation de la chirurgie ambulatoire accroît la responsabilité de surveillance dans le suivi des patients.
À toutes ces inégalités, s’ajoute la non-revalorisation des indemnités forfaitaires de déplacement, qui ne s’est appréciée que de cinquante centimes en quinze ans !
Et puisque nous sommes en pleine période de vaccination contre la grippe, pourriez-vous m’indiquer, madame la secrétaire d’État, si la compétence de vaccination accordée aux pharmaciens a accru la part de la population vaccinée ?

Je termine. Surtaxés à outrance, ces professionnels de santé exercent leur mission avec beaucoup de compétence.
Monsieur le sénateur, je partage avec vous le rôle central joué par la profession d’infirmier dans notre système de santé.
Le Gouvernement entend bien s’appuyer sur l’engagement et les compétences des infirmières et des infirmiers pour relever les défis qui nous attendent en ce qui concerne notamment l’accès aux soins et la prise en charge des maladies chroniques.
La reconnaissance de la pratique avancée pour la profession par le décret du 18 juillet 2018 marque une avancée importante.
Les infirmières en pratique avancée auront des compétences élargies et la responsabilité du suivi régulier des patients pour leurs pathologies et pourront prescrire des examens complémentaires, demander des actes de suivi et de prévention, ou encore renouveler ou adapter, si nécessaire, certaines prescriptions médicales.
Cette nouvelle pratique et ces nouvelles compétences fondées sur une formation universitaire bénéficieront d’une reconnaissance en termes de statut et de rémunération, aussi bien dans le cadre de la fonction publique hospitalière qu’au sein des équipes de soins primaires.
Nous souhaitons que cette nouvelle pratique se développe rapidement sur l’ensemble des territoires, au bénéfice des patients.
Nous sommes également sensibles à la juste reconnaissance de l’activité des infirmières libérales et à l’évolution de leur rémunération.
Comme vous le savez, ce sont les partenaires conventionnels, c’est-à-dire les syndicats représentatifs de la profession et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, l’UNCAM, qui déterminent l’inscription des actes à la nomenclature et leur tarif.
À ce titre, l’avenant 5 à la convention des infirmières libérales, signé le 21 novembre 2017, a d’ores et déjà pris en compte les contraintes liées à l’activité des infirmières libérales en revalorisant notamment la majoration du dimanche et des jours fériés à compter du 1er août 2018.
Les négociations doivent reprendre en décembre prochain avec l’assurance maladie.
Nous souhaitons que cette négociation permette de valoriser le rôle des infirmières dans le système de santé et accompagne les pratiques pour une réponse aux besoins de soins de nos concitoyens – prise en charge des maladies chroniques, maintien à domicile des personnes âgées, prévention et éducation à la santé, par exemple.
Je fais pleinement confiance aux partenaires conventionnels pour arriver à un second accord en ce sens.
Enfin, monsieur le sénateur, concernant votre question sur la prise en charge vaccinale des pharmaciens, nous n’en sommes qu’au début de la campagne vaccinale ; nous mènerons une étude et nous ne manquerons pas de vous communiquer les chiffres obtenus.

La parole est à Mme Annie Guillemot, auteur de la question n° 494, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Le 5 juillet dernier, plus de 2 200 masseurs-kinésithérapeutes se sont rassemblés au ministère de la santé pour exprimer leurs vives inquiétudes et réclamer une meilleure reconnaissance de leur métier.
Ces professionnels de santé, qui revendiquent aussi la reconnaissance de leur formation au grade international de master à hauteur de leurs 300 crédits européens, compte tenu de leur niveau bac+5, dénoncent aussi l’inégalité des différentes professions de santé au regard des droits liés au congé maternité.
En effet, depuis octobre 2017, les femmes médecins libérales conventionnées et éligibles au congé maternité peuvent percevoir de 2 066 à 3 100 euros mensuels, pendant trois mois, auxquels s’ajoute une aide forfaitaire d’environ 3 300 euros. Les masseurs-kinésithérapeutes, comme les autres professionnels paramédicaux, ne bénéficient pas de ce traitement. Une pétition réclamant l’« égalité de l’aide financière pour toutes les femmes qui exercent dans le secteur libéral en congé maternité » a rassemblé plus de 55 000 signataires.
Lors de l’examen du PLFSS pour 2019, j’ai déposé un amendement à l’article 47 visant à ce que cet avantage supplémentaire maternité soit étendu à l’ensemble de ces professionnelles de santé. Malheureusement, il a été, comme de très nombreux autres amendements, frappé par l’article 40, car « dépourvu d’impact sur les comptes sociaux ».
Aussi, face à ces inquiétudes et à ce légitime besoin de reconnaissance, d’équité et de justice, pourriez-vous nous dire, madame la secrétaire d’État, quelles réponses vous comptez donner à ces revendications et selon quel échéancier ?
Madame la sénatrice, vous m’interrogez sur les demandes formulées au mois de juillet dernier par la profession des masseurs-kinésithérapeutes.
Je souhaite porter à votre connaissance, et à celle de vos collègues présents, plusieurs éléments d’analyse pour répondre à vos interrogations.
Tout d’abord, et j’aimerais insister sur ce point, la profession de chiropracteur, reconnue par la loi depuis mars 2002, ne constitue pas une profession concurrente de la masso-kinésithérapie.
Ses missions et conditions d’exercice diffèrent sur de nombreux points : il ne s’agit pas d’une profession de santé telle que prévue par le code de la santé publique et les actes délivrés ne sont, en conséquence, pas pris en charge par l’assurance maladie, ce qui constitue deux points de différenciation majeurs.
L’arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie vise à encadrer un usage professionnel déjà existant, mais qui ne disposait pas de référentiel d’activité et de compétences permettant de définir le contenu de la formation nécessaire à l’exercice professionnel.
Cet arrêté consolide sur le plan réglementaire l’exercice et la formation des chiropracteurs et renforce la sécurité des personnes prises en charge par ces professionnels.
Ensuite, s’agissant du désavantage présumé dont pâtiraient les masseurs-kinésithérapeutes au regard de la tarification d’actes réalisés par d’autres professionnels, je tiens à rappeler que les actes des masseurs-kinésithérapeutes, en tant que profession conventionnée, sont pris en charge par la sécurité sociale. Ce n’est pas le cas des actes de chiropraxie, dont je viens de parler et qui peuvent être parfois remboursés par les organismes complémentaires, mais qui ne sont pas inclus dans le panier des soins pris en charge par la sécurité sociale.
En ce qui concerne l’avantage supplémentaire maternité, cette aide, prévue pour les médecins dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, a été mise en place pour renforcer l’attractivité de l’activité libérale des jeunes médecins. L’enjeu de sa création est bien propre à la démographie médicale et aux difficultés d’accès aux soins médicaux qui ne se posent pas dans les mêmes termes pour les autres professions libérales conventionnées.
Par ailleurs, les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés bénéficient déjà d’un régime d’indemnités comprenant une allocation forfaitaire de 3 311 euros et d’indemnités journalières forfaitaires à hauteur de 54, 43 euros.
Enfin, permettez-moi de vous rappeler que l’assurance maladie a signé, en novembre 2017, l’avenant 5 à la convention médicale qui prévoit des revalorisations substantielles sur la période 2018 à 2022. Vous conviendrez que ce geste témoigne, s’il fallait, des attentes fortes des pouvoirs publics à l’égard d’une profession qui joue un rôle majeur dans notre système de santé et dans sa transformation.

La parole est à Mme Annie Guillemot pour répondre à Mme la secrétaire d’État, en une minute et neuf secondes.

Je prends note de votre réponse, madame la secrétaire d’État. Toutefois, ma question ne portait pas sur la chiropraxie, mais bien sur les congés maternité !
Comment ne pas observer que l’article 47 du PLFSS pour 2019, dont le vote interviendra cet après-midi, aligne les droits au congé maternité des travailleuses indépendantes et octroie aux exploitantes agricoles l’allocation de remplacement, visant à rémunérer l’emploi d’une personne les remplaçant dans leurs travaux pendant la durée du congé maternité renforcé ou, à défaut, une indemnité journalière forfaitaire, ce dont je me félicite.
Mais alors, pourquoi ne pas accorder aux professionnelles de santé conventionnées l’avantage supplémentaire maternité qui a pour objet de garantir la viabilité des cabinets ? Une absence d’environ trois mois représente une perte de 10 000 à 12 000 euros par cabinet.
Il ne s’agit certainement pas d’une raison budgétaire, puisque l’étude dont il est fait état pour l’article 47 du PLFSS pour 2019 précise que l’impact pour les travailleuses indépendantes et agricultrices sur le budget et l’emploi des caisses de sécurité sociale sera géré « dans le cadre des moyens existants »…
Bref, tout cela n’est ni sérieux ni surtout équitable pour les femmes exerçant en libéral – infirmières, chirurgiennes-dentistes, orthophonistes, orthoptistes, sages-femmes et, bien évidemment, kinésithérapeutes – à qui vous refusez d’être gérées « dans le cadre des moyens existants »

La parole est à Mme Nathalie Delattre, auteur de la question n° 521, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Aujourd’hui, à quatorze heures, tous les syndicats de la profession d’infirmier se mobilisent pour faire entendre leur mécontentement à la suite des annonces du Président de la République.
Et pour cause ! Le plan « Santé 2022 » repose sur une vision médico-centrée de l’offre de soins. Les 660 000 infirmiers répartis sur l’ensemble de notre territoire n’ont obtenu ni la revalorisation espérée de leur métier, ni celle de leurs compétences et encore moins celle de leur tarification.
Comment expliquer, madame, que 4 000 nouveaux postes d’« assistants médicaux » seront créés aux frais des collectivités, alors que le plan « Santé 2022 » ne prévoit aucune réactualisation du décret d’actes et d’exercice de la profession d’infirmier datant de 2002 ?
Si l’ensemble de la profession se mobilise, c’est parce qu’aucune spécialisation n’a obtenu gain de cause : ni les infirmiers de bloc opératoire, ni les puériculteurs diplômés d’État, ni les infirmiers anesthésistes dans la réingénierie de leurs diplômes.
Que dire des infirmiers libéraux ? Les indemnités forfaitaires de déplacement n’ont été revalorisées que de cinquante centimes d’euros en quinze ans. Une hausse dérisoire face à l’augmentation du prix de l’essence.
On le voit et on le vit, il existe bel et bien un décalage entre l’exercice, sur le terrain, au quotidien, du métier d’infirmier et la nomenclature générale des actes professionnels, qui ne recense toujours pas un grand nombre d’entre eux.
A contrario, quand ils sont pris en compte, le troisième acte médical dispensé est gratuit. Aussi, le travail de vaccination antigrippale, plan dont vous vous enorgueillissez, reste le plus souvent non rémunéré pour nos infirmiers.
Pourtant, face à l’augmentation du nombre de maladies chroniques et au vieillissement croissant de la population, les infirmiers répondent présent. Ils sont les premiers acteurs de terrain, de jour comme de nuit. En se déplaçant à domicile, les infirmiers libéraux participent notamment au désengorgement des services d’urgence. Ils sont d’ailleurs souvent les derniers au cœur du désert médical.
Dès lors, madame la secrétaire d’État, allez-vous répondre favorablement aux attentes de nos infirmiers et, au-delà, à celles des Français, qui sont très attachés à ces femmes et à ces hommes ? Allez-vous adapter votre plan « Santé 2022 » aux réalités du terrain ?
Madame la sénatrice, je vous remercie de votre question qui me permet de répondre à la déception exprimée par les infirmières et par les infirmiers après la présentation du plan « Ma Santé 2022 » par le Président de la République, le 18 septembre dernier.
Vous évoquez plusieurs de leurs revendications concernant la revalorisation de l’ensemble de la profession infirmière en termes de métier et de tarification conventionnelle et l’absence d’actualisation du décret d’actes et de compétences depuis 2002.
Nous regrettons ces prises de position, alors que la profession infirmière a récemment bénéficié d’avantages notables.
D’abord, grâce au développement de protocoles de coopération, notamment dans le secteur ambulatoire, avec le dispositif Asalée, ou action de santé libérale en équipe.
Et récemment, de façon globale, par la reconnaissance de l’infirmier en pratique avancée, dont le cadre juridique a été fixé par le décret du 18 juillet 2018 que j’ai mentionné dans ma réponse à M. le sénateur Madrelle.
Les premières infirmières en pratique avancée diplômées par les universités accréditées en octobre dernier mettront leurs compétences élargies au service des usagers du système de santé dès septembre 2019.
Au-delà des premiers domaines d’intervention ouverts à la pratique avancée, d’autres champs, tel celui de la psychiatrie, vont faire l’objet de prochains travaux.
Encore plus récemment, le décret et l’arrêté du 25 septembre 2018 ont permis aux infirmières d’élargir leurs compétences en matière de vaccination antigrippale.
Enfin, le processus d’universitarisation se poursuit en lien étroit avec le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Par ailleurs, et c’est la seconde partie de votre question, vous estimez que la réforme du système de santé engagée pérennise une vision médico-centrée de l’offre de soins. Ce n’est pas notre appréciation.
Différentes mesures annoncées par la ministre des solidarités et de la santé concernent l’exercice pluriprofessionnel et encouragent une organisation en structure regroupée ou au sein d’une communauté professionnelle territoriale de santé. Notre objectif est clair : l’exercice isolé doit devenir une exception.
Ces orientations donnent aux infirmières toute leur place, notamment quand elles exercent dans le secteur libéral. Cette profession est un des acteurs majeurs de la prise en charge préventive et éducative. Nous avons bien conscience qu’elle est un rouage essentiel du système de santé.

La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour répondre à Mme la secrétaire d’État, en dix-huit secondes.

Mme Nathalie Delattre. Madame la secrétaire d’État, si les avancées que vous mentionnez satisfaisaient les infirmières et les infirmiers, ils ne seraient pas dans la rue, dans dix-sept régions de France. Je ne peux que vous encourager à sortir de votre ministère cet après-midi, à sortir de votre bulle, et à aller à leur rencontre : ils ont vraiment besoin de votre écoute et d’une véritable action.
Mme Brigitte Lherbier applaudit.

Mes chers collègues, en attendant l’arrivée de Mme Morin-Desailly, qui doit nous rejoindre incessamment, et du ministre qui doit répondre aux questions suivantes, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix heures quarante-huit, est reprise à dix heures quarante-neuf.

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, auteur de la question n° 504, adressée à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, certains symboles forgent durablement la réputation d’un territoire et contribuent à son rayonnement, en France comme à l’étranger.
Le camembert est sûrement, avec le Neufchâtel, le Livarot et le Pont-l’évêque, l’élément le plus emblématique de la gastronomie normande, de nos traditions et des savoir-faire de nos artisans fromagers et de ceux de nos producteurs. Inimitable, et à ce titre soumis à une appellation d’origine protégée, ou AOP, depuis 1983, le véritable camembert de Normandie est composé de lait cru et moulé à la louche.
En tant que sénatrice de la Seine-Maritime et élue normande, j’ai été très surprise d’apprendre qu’il était question de modifier les critères de cette AOP en introduisant un nouveau procédé de fabrication : la pasteurisation.
L’introduction d’une telle méthode reviendrait à revoir à la baisse le cahier des charges de notre AOP, avec toutes les conséquences que cela implique en termes de qualité du produit fini.
Avoir recours à la pasteurisation entraînerait également un bouleversement dans la répartition de la valeur entre les différents acteurs de la chaîne de production.
En effet, en substituant la pasteurisation au moulage à la louche, le risque est grand de créer une distorsion de concurrence au sein de la filière même. Et pour cause : favoriser un procédé de fabrication moins cher et standardisé revient à tirer à la baisse la rémunération des petits producteurs, les futurs camemberts AOP pasteurisés étant vendus à moindre prix dans la grande distribution.
Déjà, le niveau moyen de valorisation du lait AOP ne s’élève qu’à 50 % en Normandie. À terme, seuls les consommateurs les plus aisés pourront se permettre d’acheter un véritable camembert AOP produit par un réseau spécialisé haut de gamme.
Il faut prendre garde à ne pas reproduire les erreurs de filières voisines qui, en introduisant la pasteurisation dans leur processus de production, ont contribué à la disparition d’un grand nombre de producteurs. Il serait regrettable de corrompre une recette qui perdure de génération en génération depuis la Révolution française, au profit de seuls intérêts financiers.
Les multinationales qui appellent à l’industrialisation et à la standardisation le font pour exercer une domination plus grande encore sur nos producteurs et réduire les coûts par des suppressions d’emplois. Or la démarche de l’AOP est tout autre et doit, d’une part, favoriser une concurrence saine et, d’autre part, garantir un certain niveau d’exigence.
Les critères de l’appellation nous permettent de préserver notre produit dans sa noblesse sans pour autant nuire à la croissance de la filière.
Je vous demande donc, madame la secrétaire d’État, de tout faire pour maintenir l’AOP camembert de Normandie dans sa formule actuelle, et je vous en remercie.
Madame la sénatrice, je sais ce sujet important pour votre territoire. Aussi, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de mon collègue Didier Guillaume, retenu à Bruxelles pour le Conseil Agriculture de l’Union européenne.
Votre question porte sur la modification des critères de l’appellation d’origine protégée – AOP – camembert de Normandie.
Le 21 février dernier, l’ensemble des acteurs de la filière du camembert de Normandie AOP et du camembert « fabriqué en Normandie » a conclu un accord, après des années de discussions et de travaux.
Cet accord vise, à terme, à la disparition de la mention « fabriqué en Normandie » qui créait de la confusion chez les consommateurs. Il ne s’agit pas d’abaisser les exigences du cahier des charges actuel.
Bien au contraire, cet accord vise à accompagner la montée en gamme et l’évolution des pratiques de tous les opérateurs, actuels et futurs, de l’AOP.
Il s’agira notamment d’augmenter la part des vaches normandes dans les troupeaux, de renforcer la place du pâturage et de l’herbe dans l’alimentation des animaux ou encore d’introduire des dispositions relatives au bien-être animal.
Ces pratiques pourront être différenciées grâce à deux gammes distinctes de camembert de Normandie. Cette segmentation permettra, d’une part, aux opérateurs de faire le choix de produire l’une ou l’autre et, d’autre part, aux consommateurs d’éviter la confusion entre elles.
Le Gouvernement va s’attacher à suivre très précisément et régulièrement les travaux relatifs à l’évolution du futur cahier des charges de l’AOP. Il sera particulièrement vigilant à ce que les termes de l’accord soient respectés et à ce que les travaux aboutissent bien à une montée en gamme pour l’ensemble de la filière.

La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian, auteur de la question n° 505, adressée à M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.

Ma question s’adresse au ministre de l’éducation nationale, et plus particulièrement au ministre de la jeunesse.
Les jeunes Français qui vivent en dehors de nos frontières sont une ressource formidable de talent et de connaissance. Ils sont cultivés, ouverts d’esprit, entrepreneurs. Ils façonnent au jour le jour l’image de la France et sont, quand ils reviennent dans notre pays, parmi nos plus brillants éléments.
Plus de 620 000 jeunes Français de moins de 25 ans vivent à l’étranger : c’est plus que le nombre d’habitants d’une région comme la Vendée ou le Gard. Ces jeunes sont souvent des binationaux. Dans certaines zones – Moyen-Orient, Afrique du Nord… –, plus de 70 % des Français inscrits sur les registres consulaires possèdent une double nationalité. C’est une véritable richesse : deux langues, deux pays, deux cultures. Mais il est parfois difficile pour la France de garder avec eux un lien fort, ce lien qui nous permet de dire : Je suis Français.
Renforcer ce lien est normalement le rôle de l’école, celui de notre réseau de lycées français à l’étranger. Mais ce n’est pas aujourd’hui le sujet de ma question, qui porte sur un autre moyen de renforcer le lien d’appartenance avec la France.
Le service national universel, ou SNU, en préparation a pour ambition de renforcer, chez les jeunes, le sentiment d’appartenance à la France. Or les jeunes Français de l’étranger n’ont pas été, à ma connaissance, monsieur le ministre, particulièrement consultés le mois dernier, lors de la concertation en ligne.
Les intégrer au service national universel, ou dans un dispositif similaire, est d’autant plus important depuis l’annonce, voilà quelques semaines, de la suppression des journées défense et citoyenneté à l’étranger.
J’aimerais savoir, monsieur le ministre, dans quelle mesure vous avez tenu compte de la situation de ces jeunes Français ? Qu’avez-vous prévu pour renforcer leurs liens avec la France ?
Madame la sénatrice, je vous remercie de votre question, extrêmement importante.
Elle entre en résonance avec les travaux que nous menons actuellement à l’échelle interministérielle autour de la mise en œuvre du service national universel, qui recouvre, comme vous l’avez souligné, plusieurs enjeux essentiels : participation et engagement de chaque jeune dans la vie de la Nation, valorisation de la citoyenneté et du sentiment d’appartenance à la communauté nationale en se rassemblant autour de valeurs, renforcement de la cohésion sociale tout en dynamisant le creuset républicain.
L’universalité de ce dispositif, que vous interrogez en soulevant la question de la participation des jeunes Français de l’étranger, sera en effet un important défi auquel nous consacrerons toute notre énergie.
Nos réflexions s’appuient actuellement sur les pratiques qui avaient cours au temps du service national.
Avant sa suspension, l’appel au service national actif était différé pour les jeunes Français résidant à l’étranger jusqu’à l’âge de 29 ans, sauf dans certains territoires européens. Si ces jeunes revenaient habiter sur le territoire national avant cet âge, ils étaient appelés au service national actif dans les quatre mois suivant la date de leur changement de résidence. Dans le cas contraire, ils étaient dispensés.
Depuis la mise en place de la journée défense et citoyenneté, dite JDC, chaque poste diplomatique ou consulaire adresse aux administrés âgés de 16 à 25 ans qui ont été recensés une convocation écrite leur indiquant la date de la session à laquelle ils doivent participer. L’attaché de défense participe aux JDC sous l’autorité du chef de poste diplomatique ou consulaire.
Les Français établis hors de France qui n’ont pu participer à une session de la JDC sont tenus, dès lors qu’ils viennent résider habituellement sur le territoire national avant l’âge de 25 ans, de participer à une JDC.
Différentes options sont possibles à partir de ces considérations. L’identification préalable de ces jeunes et les conditions d’accueil – hébergement, sécurité et accessibilité des sites – dans lesquelles ils pourraient effectuer ce service hors de France posent en effet de nombreuses questions pratiques que nous analysons phase par phase.
Rien n’est encore arrêté définitivement. Toutefois, comme au temps du service militaire et comme cela se fait aujourd’hui pour la JDC, les jeunes expatriés pourraient ainsi être dispensés d’effectuer le SNU tant qu’ils résident à l’étranger.
Nous devons ainsi prendre en considération le contexte particulier de chacun des territoires concernés, l’absence d’infrastructures, le caractère très dispersé des communautés françaises, les problèmes de sécurité dans certains pays, l’absence de personnel d’encadrement remplissant les conditions nécessaires, le caractère non francophone de certains jeunes et, bien sûr, le cas particulier des jeunes binationaux.
Cela ne signifie pas qu’ils en seraient nécessairement exclus. Nous pouvons aussi imaginer des hypothèses intermédiaires. Les travaux ne sont pas encore totalement aboutis. Le Président de la République fera, en temps voulu, les annonces.
Nous commencerons par une première expérimentation en 2019. En tout cas, nous étudions dès maintenant, en lien étroit avec le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, l’ensemble des options envisageables avant d’arrêter une option définitive.

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, auteur de la question n° 509, adressée à M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.

Monsieur le ministre, ma question porte sur la fusion des rectorats de Nice et d’Aix-Marseille et, par conséquent, sur l’éventuelle suppression de l’académie de Nice.
En juillet 2018, vous avez annoncé vouloir une seule académie par région. Pourtant, lors de votre venue à Nice en début d’année, vous aviez d’abord penché en faveur d’un simple rapprochement des services.
Si la décision de fusion devait être confirmée, les professeurs, les proviseurs et les personnels des établissements actuellement placés sous la responsabilité du rectorat de Nice perdraient inévitablement en proximité pour la mise en œuvre des politiques éducatives.
En matière d’examens, un rectorat unique redéfinirait, sous l’autorité du recteur, le service du département des examens et des concours, notamment pour le passage du baccalauréat et du brevet.
De plus, si certains postes devaient être transférés à plusieurs centaines de kilomètres de distance, ce seraient autant de foyers qui seraient impactés par cet éloignement, alors que leur vie quotidienne s’organise à Nice ou dans les communes voisines.
Si le rapport de François Weil préconise un rectorat unique par nouvelle région, la région Sud est un territoire densément peuplé, les effectifs des deux rectorats d’Aix-Marseille et de Nice additionnés donnent un ensemble proche d’une académie francilienne, mais dans le cadre d’un territoire à la fois plus vaste et mixte, mélangeant des zones urbaines denses et des zones rurales et de montagne.
Cette préconisation découle de l’application du nouveau cadre régional fixé par la loi de 2015 relative au redécoupage des 17 régions. Or, vous le savez, monsieur le ministre, la région Sud n’a pas été redécoupée géographiquement.
Monsieur le ministre, comptez-vous fusionner les rectorats de Nice et d’Aix-Marseille ? Si oui, selon quel calendrier ? Quelle est votre vision de la gouvernance éducative pour la région Sud, notamment en matière de réorganisation administrative pour ces deux académies dans les prochaines années ?
Il s’agit bien évidemment, madame la sénatrice, d’une question très importante, sur laquelle je suis heureux de pouvoir m’exprimer.
Je souhaite commencer mon propos par une analyse de la situation existante. Tout le monde reconnaît que la réforme régionale de 2015 nous a placés dans une situation intermédiaire et, parfois, dans une ambiguïté dont il faut savoir sortir. C’est exact, il existait, avant la mise en œuvre de la réforme, deux académies dans cette région.
Aujourd’hui, les cartes des académies et des régions métropolitaines ne correspondent pas. Une telle situation n’est pas satisfaisante, à l’heure où l’éducation nationale doit conduire avec les régions des réformes d’envergure, notamment celle de l’orientation ou celle de la voie professionnelle.
C’est pourquoi nous avons décidé de nous appuyer sur les recommandations de la mission sur la réorganisation territoriale des services déconcentrés des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, conduite par François Weil, conseiller d’État, Olivier Dugrip, recteur de l’académie de Bordeaux, et deux inspecteurs généraux de l’éducation nationale, Marie-Pierre Luigi et Alain Perritaz.
De cette mission, je retiens les grands principes suivants, qui conduisent aujourd’hui la réforme.
Au 1er janvier 2020, il y aura 13 académies dirigées par 13 recteurs d’académie, dans les 13 régions métropolitaines. En fonction des caractéristiques de chaque territoire, le recteur pourra être assisté d’un adjoint.
Il n’y a pas de schéma préétabli, pas d’organisation unique à plaquer sur un territoire. Nous souhaitons au contraire que les territoires sortent gagnants de cette réforme, qui pourra d’ailleurs rééquilibrer certains aspects de la réforme de 2015. Par exemple, certaines fonctions des rectorats pourraient être positionnées dans des villes qui ne sont pas les capitales régionales. Il est également envisageable de distinguer rectorat d’académie dans une ville et chancellerie des universités dans une autre.
Les objectifs et le cadrage de la réforme territoriale ont été fixés par lettre adressée aux recteurs par la ministre de l’enseignement supérieur Frédérique Vidal et moi-même le 19 juillet dernier. Depuis lors, les recteurs conduisent une large concertation avec les élus locaux et les services académiques, afin de permettre d’avoir une feuille de route dès la fin de l’année 2018. Nous annoncerons les arbitrages au début de l’année 2019.
Parallèlement à cette réforme, je souhaite renforcer l’action départementale et infradépartementale de l’éducation nationale, afin d’encourager des formules de gestion du système scolaire au plus près du terrain. Il s’agit là, me semble-t-il, du cœur de la réponse à votre question.
Car la première conséquence de la régionalisation qui a eu lieu avec la loi de 2015 doit être une vision stratégique à l’échelle de chaque grande région et des compétences renforcées à l’échelle de chaque département, pour prendre des décisions pragmatiques au quotidien, dans la lignée des propos tenus par le Président de la République au Congrès de Versailles de juillet dernier.
C’est le cas par exemple de l’expérimentation en cours sur la gestion des ressources humaines de proximité. Sous pilotage des recteurs et des DASEN, les directeurs académiques des services de l’éducation nationale, elle doit permettre d’humaniser la gestion des ressources humaines.
Madame la sénatrice, s’agissant de vos craintes d’un éloignement des examens ou de la gestion des ressources humaines, nous souhaitons avoir, comme vous le souhaitez, une vision départementale de proximité.

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, pour réponse à M. le ministre, en quatorze secondes.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre réponse. Une perte de proximité ne doit pas se traduire par une rupture du service public, j’attire votre attention sur ce point. Il faut également rassurer s’agissant des inquiétudes relatives à des suppressions de postes, que vous avez vous-même annoncées pour 2019. Il convient aussi d’éviter les mobilités contraintes.

La parole est à Mme Françoise Gatel, auteur de la question n° 514, adressée à M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.

Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur le financement des accompagnants d’enfants handicapés scolarisés.
L’accueil à l’école des enfants handicapés progresse de manière très significative, et chacun de nous s’en réjouit. Les communes se sont pleinement engagées pour favoriser l’intégration en milieu ordinaire.
Le Conseil d’État a estimé que les auxiliaires de vie scolaire et les accompagnants d’élèves en situation de handicap relèvent de l’éducation nationale lorsqu’ils interviennent en temps scolaire, mais également périscolaire.
Toutefois, une note du ministère en date du 5 janvier 2018 a annoncé que leur financement devait être supporté par les communes. Sans doute y a-t-il un lien avec la décision du tribunal administratif de Pau d’octobre 2017, qui a considéré que la prise en charge financière de l’accompagnement incombait à la commune lorsque l’activité périscolaire ne pouvait être regardée « comme tendant à l’inclusion scolaire ».
Le plus souvent, les équipes de suivi de la scolarisation, qui répartissent les heures de travail des accompagnants, les consacrent au temps scolaire. Les collectivités locales sont alors contraintes de financer les accompagnants en temps périscolaires.
L’accueil des enfants handicapés à l’école est un enjeu de société, qui ne peut dépendre de la capacité financière éventuelle des communes.
Selon moi, il appartient à l’État, responsable de l’équité territoriale et de l’égalité des chances, porteur d’un projet ambitieux d’intégration, d’assurer la prise en charge financière d’un service indispensable à l’intégration des enfants handicapés, à qui on ne saurait dire : Tu peux être accueilli à l’école, mais pas à la cantine.
Aussi, monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser si cet aspect sera intégré dans la réflexion que vous avez lancée en octobre dernier pour « rénover » la scolarisation des élèves handicapés ?
Comme vous le rappelez dans votre question, madame la sénatrice, l’accueil des enfants en situation de handicap constitue effectivement un immense enjeu de société, qui est au cœur de nos priorités. Vous connaissez mon attachement au principe de l’école inclusive, et ma volonté que ce principe ne constitue pas un simple objectif, mais une réalité.
Je rappelle à titre liminaire que le ministère de l’éducation nationale consacrera 2, 7 milliards d’euros à cette question en 2019, après y avoir affecté 2, 3 milliards d’euros en 2018. Ce sont donc des efforts considérables.
Ainsi, 340 000 élèves en situation de handicap ont été accueillis à la rentrée 2018 dans les écoles et établissements publics et privés sous contrat. En matière d’accompagnement humain de ces élèves, le nombre d’AESH, les accompagnants des élèves en situation de handicap, qui est de 43 041, a dépassé pour la première fois le nombre des contrats aidés, lequel est de 29 000.
La question du financement de l’accompagnement des élèves handicapés pendant le temps périscolaire que vous évoquez est une question juridique complexe. §Elle porte sur la répartition des compétences entre les collectivités, qui sont chargées de l’organisation des activités périscolaires, et l’État, qui a la charge du service public de l’éducation et du temps scolaire.
En pratique, lorsque l’accompagnant d’un élève en situation de handicap assiste également l’enfant pendant les activités périscolaires, il est mis à la disposition de la commune par le biais d’une convention signée entre l’État et la commune, qui assure sa rémunération au titre des activités périscolaires.
Certaines communes considèrent toutefois qu’elles n’ont pas à assurer la prise en charge financière de ces accompagnants durant le temps périscolaire.
Cette situation est à l’origine de plusieurs contentieux, qui ont donné lieu à des solutions divergentes de la part des juridictions administratives du fond, à savoir les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel.
Quant à la décision du Conseil d’État à laquelle vous faites référence, elle a été rendue dans le cadre d’un référé et ne saurait donc, en droit administratif, faire jurisprudence.
Aussi, afin de trancher définitivement cette question, mes services ont formé deux pourvois en cassation, qui permettront au Conseil d’État de se prononcer sur la question que vous posez et de clarifier les responsabilités de chacun – État et collectivités territoriales – quant au financement de l’accompagnement des élèves en situation de handicap.
Au-delà de cette question strictement juridique, nous travaillons de façon très constructive dans le cadre de la concertation que nous avons lancée, avec Sophie Cluzel, le 22 octobre dernier, au sein du Conseil national consultatif des personnes handicapées, le CNCPH, afin de garantir une meilleure continuité des temps scolaires et périscolaires pour les élèves en situation de handicap, parce que là est l’enjeu.
Cette concertation a également pour but d’explorer les pistes permettant de rendre le métier d’accompagnant plus attractif et de permettre à chaque AESH de voir sa situation financière s’améliorer par un temps de travail augmenté dans le cadre du décloisonnement entre temps scolaire et temps périscolaire.
Tel est l’objectif que nous devons poursuivre. Je suis sûr que nous parviendrons à des solutions positives et concrètes grâce à cette concertation, laquelle aboutira au premier trimestre 2019. Elle aura donc un impact à la rentrée 2019. Il s’agit, je le répète, de mettre en place une continuité des temps scolaires et périscolaires, que ce soit l’État ou la collectivité qui assume le financement du temps périscolaire.

La parole est à Mme Françoise Gatel, pour répondre à M. le ministre, en trente-neuf secondes.

Merci, monsieur le ministre. Je vous sais attentif à ce sujet. Le temps périscolaire particulièrement important pour les communes est celui de la cantine. En effet, les enfants handicapés scolarisés restent le plus souvent à la cantine, alors qu’ils participent beaucoup moins aux activités périscolaires du soir.
Je sais la complexité juridique du lien de subordination et la nécessité d’un temps de pause pour les accompagnants. J’insiste toutefois sur la nécessité, pour un enfant handicapé, de bénéficier du même personnel accompagnant à l’école et à la cantine.
Monsieur le ministre, l’effort budgétaire nécessaire pour rembourser aux communes le temps d’intervention des accompagnants durant la pause du déjeuner me semble peu eu égard à l’intérêt et à l’enjeu de la question.

La parole est à M. Michel Savin, auteur de la question n° 476, adressée à M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.

Monsieur le ministre, ma question porte sur la place du sport dans le cadre du nouveau baccalauréat prévu pour 2021.
D’après les informations disponibles, l’éducation physique et sportive pourra toujours faire l’objet d’une option choisie, en plus des deux heures hebdomadaires prévues dans les programmes.
Dans un entretien paru le 30 septembre dernier dans le JDD, vous avez indiqué que « le latin et le grec seront les deux seules options qui rapporteront des points bonus dans le nouveau baccalauréat ». Cette annonce est conforme à la maquette disponible en ligne, aux termes de laquelle « l’option langues et cultures de l’Antiquité est évaluée en contrôle continu et donne lieu, le cas échéant, à un bonus ».
Cette mesure n’est donc pas prévue pour les options LV3, arts et EPS. Je ne souhaite pas ici opposer les disciplines entre elles. Cependant, jusqu’à aujourd’hui, les langues vivantes et étrangères, les arts et le sport étaient des matières optionnelles permettant elles aussi d’obtenir des points bonus pour le baccalauréat, au même titre que le latin et le grec.
Alors que la France accueillera dans six ans les jeux Olympiques et Paralympiques, alors que le Gouvernement a l’ambition de renforcer la pratique sportive, alors que ce même gouvernement souhaite avoir 3 millions de pratiquants sportifs supplémentaires, alors que l’éducation nationale a mis en place un programme d’appui aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 avec une labellisation « génération 2024 », alors que, dans le même temps, l’olympiade culturelle permettra de renforcer l’accès à la culture pour l’ensemble des Français, il est surprenant que ni le sport ni les arts ne puissent rapporter des points dans le nouveau baccalauréat, quand le latin et le grec bénéficieront d’un coefficient 3.
Monsieur le ministre, quelles sont donc les raisons de la suppression de l’option sports, mais également des arts, au baccalauréat à compter de 2021 ?
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Michel Savin, il s’agit d’une question très importante. Il ne faudrait surtout pas opposer les langues et cultures anciennes à l’éducation physique et sportive. Vous avez d’ailleurs fait référence aux jeux Olympiques, dont l’origine remonte à l’Antiquité.
Le ministère de l’éducation accorde une attention particulière au développement de l’éducation physique et sportive, essentielle à l’acquisition par les jeunes de bons réflexes en matière d’activité physique, de bien-être et de respect d’autrui.
La réforme du lycée et du baccalauréat général et technologique garantit pour chaque élève un enseignement commun obligatoire de deux heures en éducation physique et sportive, de la seconde à la terminale, et prévoit en outre un enseignement optionnel de trois heures. C’est évidemment beaucoup plus que ce qui est proposé pour les langues anciennes.
L’EPS est ainsi la seule discipline à être ouverte, selon les mêmes modalités, à la fois en enseignement commun et optionnel, à tous les élèves des voies générale et technologique au lycée.
L’enseignement optionnel d’EPS permet à tous les lycéens, quels que soient leurs projets d’orientation, d’approfondir leur pratique sportive dans un objectif de formation ou de santé.
Par ailleurs, le dispositif des sections sportives scolaires, maintenu dans le cadre de la réforme, permet la valorisation dans la scolarité d’un haut niveau de pratique sportive.
La réforme du lycée et du baccalauréat implique également une évolution des programmes. Le Conseil supérieur des programmes, le CSP, a rendu ses préconisations pour le programme de l’enseignement commun et de l’enseignement optionnel d’EPS au mois d’octobre 2018. Après une consultation, les textes réglementaires concernant les nouveaux programmes seront présentés aux instances à la fin du mois de décembre, pour une publication au premier trimestre de l’année 2019.
Enfin, avec la ministre des sports, nous menons une action volontariste à l’école, au collège et au lycée, pour promouvoir les pratiques sportives dans le cadre non seulement de l’EPS, mais aussi des associations sportives qui interviennent le mercredi.
Vous pouvez le constater, monsieur le sénateur, de nombreuses actions sont menées en faveur de l’éducation physique et sportive, que l’on ne retrouve pas pour d’autres disciplines.
S’agissant des langues et cultures anciennes, il nous a semblé indispensable de les faire bénéficier d’un poids particulier dans le nouveau baccalauréat. Nous envoyons ainsi un signal, qui est unique et que nous assumons, pour le renouveau du latin et du grec en France. Cela n’entraîne aucunement une situation en défaveur des autres enseignements optionnels, comme le sport, les arts ou les langues, qui sont encouragés de bien d’autres façons.
L’évaluation de l’EPS se fera dans le cadre du contrôle continu. Il y aura également une prise en compte des bulletins, pour 10 % de la note finale. Il existe de multiples éléments d’encouragement des pratiques physiques et sportives, que nous n’opposons pas à d’autres encouragements en faveur d’autres disciplines.

La parole est à M. Michel Savin, pour répondre à M. le ministre, en quarante et une secondes.

Si j’ai bien compris, un effort sera fait en faveur de l’encadrement et de l’initiation au sport dans les programmes, ce qui constitue un signe très positif.
Pour autant, vous n’avez pas répondu à la question des options, monsieur le ministre. Selon moi, il est regrettable que le sport, qui est déjà très maltraité au niveau budgétaire – chaque année, le budget qui lui est consacré diminue –, soit également maltraité au niveau éducatif.
Un certain nombre de jeunes, notamment dans les quartiers difficiles, s’engagent par passion dans le sport ou les arts.

Or cet engagement ne sera pas reconnu à sa juste valeur au moment du baccalauréat, ce qui est regrettable.

La parole est à Mme Dominique Vérien, auteur de la question n° 512, adressée à M. le ministre de la culture.

Ma question s’adresse à M. le ministre de la culture, mais je suis sûre que M. Blanquer est intéressé par son sujet.
La réforme de l’audiovisuel public prévoit l’arrêt de la chaîne France 4 sur la TNT, pour la basculer exclusivement en format numérique, en privant ainsi 50 % du territoire national, qui n’a pas accès à un débit internet suffisant pour une telle diffusion. De ce fait, la chaîne qui diffuse le plus grand nombre de compétitions sportives féminines sur le service public va disparaître de nos postes de télévision.
Or la représentation du sport féminin dans les médias est un enjeu majeur, qui touche à des sujets plus généraux tels que la place des femmes dans notre société, la pratique d’une activité sportive par la population, ou encore l’économie du monde sportif.
C’est une satisfaction de voir que la part d’antenne des compétitions sportives féminines est passée de 7 % des diffusions sportives en 2012 à près de 20 % en 2017. Cette hausse a été rendue possible grâce non seulement à l’audiovisuel public, mais aussi à l’implication des chaînes privées comme W9, D8 ou encore TMC, qui ont perçu le potentiel financier et l’importante rentabilité de ces programmes.
De plus, des événements sportifs comme la finale de la Coupe du monde féminine de football ont été de grands succès, à tel point que 4 des 10 plus grosses audiences de la TNT sont des retransmissions de compétitions sportives féminines.
En corrélation avec ces succès, le nombre de femmes licenciées dans une fédération sportive est en nette augmentation, marquant à la fois la réussite, mais aussi la nécessité de poursuivre ce développement.
L’arrêt de la chaîne France 4, qui était le principal canal de diffusion du sport féminin de l’audiovisuel public, ne doit pas mettre en danger ou freiner ce phénomène. Bien au contraire, une telle situation devrait permettre de donner un nouvel élan au sport féminin, en permettant sa retransmission sur des chaînes principales, comme France 2 ou France 3.
Dans le cas contraire, l’arrêt de France 4 sur la TNT impacterait négativement les parts de diffusion et laisserait intégralement aux chaînes privées ce filon économique et la promotion du sport féminin. En revanche, une bonne médiatisation des compétitions féminines permettrait de sortir de la spirale infernale des faibles investissements par manque de diffusions et des faibles diffusions par manque d’investissements.
L’approche de la prochaine Coupe du monde féminine de football, qui se tiendra en juin 2019 et sera organisée en France, pourrait d’ailleurs être l’occasion de diffuser sur une chaîne principale du service public une compétition 100 % féminine.
J’aimerais donc, monsieur le ministre, connaître votre engagement en faveur d’une retransmission sur les deux chaînes principales de France Télévisions des compétitions sportives féminines.
Vous avez raison, madame la sénatrice, cette question m’intéresse. J’y réponds toutefois en remplacement de M. Franck Riester, ministre de la culture, aujourd’hui en déplacement officiel à Bruxelles.
L’exposition du sport dans toute sa diversité est au cœur de la mission de service public de France Télévisions. Attentif au respect de cette mission, le Gouvernement se félicite du fait que le CSA ait dernièrement souligné, dans son avis sur l’exécution 2017 du contrat d’objectifs et de moyens de France Télévisions, la pluralité des disciplines sportives retransmises sur ses antennes.
Nous partageons également votre satisfaction s’agissant de la représentation croissante du sport féminin sur les chaînes de service public, qui ont contribué à le populariser ces dernières années, au point que certains acteurs privés de la télévision se positionnent désormais sur les droits des compétitions majeures. Les droits de la Coupe du monde de football féminine 2019, qui se déroulera en France, ont ainsi été acquis l’année dernière par TF1 et Canal+.
Au sein de l’offre de France Télévisions, le sport féminin n’est pas exposé uniquement sur France 4 : il trouve sa place sur l’ensemble des antennes de la société, en jouant sur leur complémentarité.
À titre d’exemple, 10 des 14 premières parties de soirée consacrées au championnat d’Europe de football de 2017 par France Télévisions l’ont été sur France 2 et France 3.
Nous encourageons bien évidemment France Télévisions à poursuivre l’exposition du sport féminin sur ses antennes, notamment les plus populaires, tout en étant respectueux de la liberté éditoriale de la société en la matière.
Cela étant dit, comme vous le savez, la transformation de l’audiovisuel public que porte le Gouvernement vise à redéployer des moyens consacrés jusqu’à présent aux seules antennes linéaires, pour construire une offre numérique de service public enrichie et adaptée aux nouveaux usages et attentes des Français.
À horizon 2020, cette modification de l’offre de service public supposera nécessairement le basculement de certains programmes d’une diffusion hertzienne à une diffusion exclusivement numérique, linéaire ou non. Cela vaudra aussi pour les programmes sportifs dans leur ensemble.
Compte tenu de l’enjeu que revêt la diversité des programmes sportifs et du sport féminin en particulier, et en tenant compte aussi de leur exposition croissante sur les chaînes privées, nous serons bien sûr attentifs à ce que les évolutions nécessaires des modes de diffusion ne se traduisent pas par un appauvrissement de l’offre de programmes ou par une dégradation de leur exposition, bien au contraire.

J’informe le Sénat qu’une candidature pour siéger au sein de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication a été publiée.
Cette candidature sera ratifiée si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, auteur de la question n° 296, adressée à M. le ministre de l’action et des comptes publics.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je souhaite évoquer l’assujettissement actuel des hippodromes à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties.
Les surfaces des pistes des hippodromes sont aujourd’hui considérées comme des propriétés bâties, ce qui est absolument incohérent.
Par ailleurs, la taxe foncière que les sociétés de courses doivent acquitter à partir de cette année, au titre de leurs infrastructures, dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, connaît une très forte augmentation.
La situation financière des sociétés de courses, qui financent toute une filière et des milliers d’emplois, est fragilisée après plusieurs années de baisse des enjeux, liée notamment à la concurrence des paris sportifs de la FDJ, la Française des jeux. Pour plusieurs d’entre elles, la hausse de la taxe foncière annoncée à moyen terme dans leur dernier avis d’imposition n’est pas supportable et poserait très clairement la question de leur avenir.
Les services fiscaux de certains départements semblent avoir récemment révisé la façon dont sont considérées les pistes des hippodromes, sans pour autant que cette interprétation compréhensive en surfaces non bâties soit généralisée. Par ailleurs, les problèmes de catégorisation des différents espaces composant un hippodrome persistent. Tous les espaces seraient ainsi considérés comme des surfaces principales, même lorsqu’ils ne sont pas accessibles au public.
Il serait donc plus cohérent, monsieur le ministre, d’apprécier toutes les surfaces non couvertes, à savoir les pistes, les parkings, les circulations et les prairies, en foncier non bâti et tous les espaces dédiés au public – halls, salons, tribunes, restaurants – en tant que surfaces bâties principales. Enfin, il conviendrait de classer en « autres surfaces » tout ce qui concerne les vestiaires, les hangars et les ateliers.
Serait-il donc possible, monsieur le ministre, de clarifier cette réglementation en ce sens, afin de rendre plus cohérente l’application de la taxe foncière aux hippodromes, en s’appuyant, vous l’avez compris, sur les usages concrets de ces espaces ?
Madame la sénatrice Loisier, vous attirez mon attention sur la situation fiscale, au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB, des terrains affectés à l’usage des courses hippiques, notamment à la suite de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels en 2017, et sur la possibilité de les assujettir à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la TFPNB.
En application de l’article 1381 du code général des impôts, les terrains qui ne sont pas cultivés et qui sont affectés à un usage industriel ou commercial sont passibles de la TFPB.
Pour les hippodromes, les terrains affectés aux pistes d’entraînement ou de compétition sont donc imposables à la TFPB lorsqu’ils présentent un usage commercial. Dans ce cas, ils sont classés soit dans la catégorie des locaux des établissements ou terrains réservés à la pratique d’un sport ou à usage de spectacles sportifs, soit, le cas échéant, dans celle des locaux présentant des caractéristiques exceptionnelles. Dans le cas contraire, ils sont imposables à la TFPNB. Votre demande est donc déjà partiellement satisfaite.
Vous proposez néanmoins d’élargir l’exception introduite pour les terrains de golf aux terrains affectés à des courses hippiques.
En effet, en application du troisième alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, la TFPNB est également due pour les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf, lorsque l’aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions.
Votre proposition introduirait une exception de plus à l’assiette de la TFPB, qui ne paraît pas justifiée. En outre, cette mesure ne manquerait pas de susciter des demandes similaires de la part d’autres secteurs d’activité, tout aussi dignes d’intérêt.
Enfin, le transfert systématique des terrains hippiques exploités commercialement de la TFPB à la TFPNB aurait des conséquences non négligeables pour les recettes des collectivités territoriales, les recettes de TFPNB étant évidemment moins importantes que les recettes de TFPB.
Par ailleurs, les communes et EPCI ne percevraient plus la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, puisque celle-ci est une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
S’il est vrai que la réforme de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, applicable depuis le 1er janvier 2017, a pu entraîner des variations à la hausse comme à la baisse des montants de TFPB, des mécanismes atténuateurs ont été prévus : ils limitent fortement ces variations, afin de rendre soutenable la réforme.
Cela étant, pour tenir compte des augmentations liées à l’importance des surfaces déclarées par certains grands hippodromes, mes services ont entamé cet été un travail d’analyse avec les représentants de la Fédération nationale des courses hippiques afin de s’assurer de la correcte évaluation des établissements concernés.
Cette démarche en cours de finalisation avec les professionnels du secteur…
… me paraît de nature à répondre, à terme, aux préoccupations dont vous avez bien voulu me faire part.

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour répondre brièvement à M. le secrétaire d’État. Vous disposez en effet de vingt secondes, ma chère collègue.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre attention sur ce sujet. Selon moi, la situation de la filière cheval, qui représente 55 000 entreprises sur l’ensemble du territoire, n’est pas comparable à celle du golf.
Une subtilité consisterait à faire passer ces structures, au titre d’une taxation sur le foncier bâti ou sur le foncier non bâti, de la catégorie 1 à la catégorie 2, afin de faciliter le quotidien et l’avenir de ces structures.

La parole est à Mme Sabine Van Heghe, auteur de la question n° 456, transmise à M. le ministre de l’économie et des finances.

Je souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur l’abattement de 50 % de la taxe foncière pour les propriétaires situés à l’intérieur du périmètre du projet d’intérêt général, ou PIG, Metaleurop Nord.
En effet, jusqu’à sa fermeture en 2003, cette usine bâtie en 1893 a rejeté dans l’air quantité de polluants, laissant derrière elle une pollution irréversible des sols, au plomb et au cadmium.
En 1999, un périmètre dit « PIG » a été défini, afin de délimiter les terres polluées autour de l’usine à Courcelles-lès-Lens, Evin-Malmaison et Noyelles-Godault dans le Pas-de-Calais. Les habitants concernés par ce périmètre ne peuvent pas construire comme ils le veulent ou cultiver leurs terres, d’où un réel préjudice, comme une moins-value de leur habitation.
Du fait de ces préjudices incontestables, l’Assemblée nationale a adopté au mois de décembre 2016, dans le projet de loi de finances rectificative, une disposition permettant aux communes concernées de consentir un abattement de 50 % de la taxe foncière pour tous les propriétaires touchés, dans le périmètre concerné, avec l’engagement que l’État le compenserait à l’euro près sur la dotation globale de fonctionnement, ou DGF.
Les élus des trois villes touchées et de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin ont donc voté cet abattement, pour qu’il puisse être applicable en 2018. Mais le reversement de l’État n’est pas venu… Ce flou quant aux modalités de compensation par l’État suscite de vives inquiétudes s’agissant de l’équilibre du budget des collectivités concernées.
Il est donc primordial que l’engagement pris par l’État soit enfin respecté, afin d’éviter aux villes concernées des difficultés financières qui s’ajoutent à celles qu’elles rencontrent chaque jour davantage. Il faut que les tergiversations de l’État cessent et que les promesses soient tenues.
Madame la sénatrice Van Heghe, vous m’interrogez sur les modalités de mise en œuvre de l’abattement de 50 % de la taxe foncière pour les propriétaires situés à l’intérieur du périmètre du projet d’intérêt général Metaleurop Nord prévu par la loi de finances rectificative pour 2016.
J’attire votre attention sur un point : la disposition prévue au III de l’article additionnel qui avait été adopté constitue en réalité un « gage » ayant pour objectif de compenser la perte de recettes résultant pour une ou plusieurs collectivités d’une mesure proposée par un amendement parlementaire. En effet, l’article 40 de la Constitution, que nous connaissons tous bien, n’autorise la diminution d’une ressource publique que dans la mesure où elle est compensée par l’augmentation d’une autre ressource. Or son champ ne se limite pas aux moyens financiers de l’État ; l’article s’applique également aux organismes de sécurité sociale et aux collectivités territoriales. C’est pourquoi une disposition entraînant une diminution des ressources d’une ou de plusieurs collectivités territoriales, par exemple l’introduction d’un abattement ou d’une exonération sur une imposition, n’est recevable qu’à la condition d’être compensée, ou « gagée », par l’augmentation « à due concurrence » d’une autre recette.
C’est bien l’objet de la mesure de compensation prévue au III, qui visait en réalité à assurer la recevabilité de l’amendement n° 517 déposé par M. Philippe Kemel, alors député de la circonscription. En l’occurrence, le III de l’article assure la recevabilité financière de l’amendement au regard des ressources des collectivités locales tandis que le IV garantit cette recevabilité au regard des ressources de l’État, qui se trouveraient diminuées par la mise en œuvre d’une majoration de la DGF.
Actuellement, il n’est pas possible, d’un point de vue juridique, de mettre en place une telle compensation individuelle pour la communauté d’agglomération Hénin-Carvin ou les communes de Courcelles-lès-Lens, de Dourges, d’Evin-Malmaison, de Leforest et de Noyelles-Godault.
En effet, la détermination du montant des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales relève du domaine de la loi de finances, conformément aux articles 6 et 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et non du pouvoir réglementaire. Or il se trouve que le législateur, et non l’État, n’a jamais majoré la DGF afin de tenir compte de l’abattement créé en loi de finances rectificative pour 2016. Cela rend impossible l’application de la compensation.
En outre, les attributions individuelles au titre de la dotation globale de fonctionnement sont calculées selon des critères fixés intégralement par le législateur et qui ne laissent pas de place à l’interprétation du pouvoir réglementaire. La mise en œuvre de la compensation sollicitée par les collectivités nécessiterait alors que, au-delà de majorer le montant global de la DGF, le législateur institue en son sein une part destinée à compenser les pertes de ressources occasionnées par la mise en œuvre de l’article 1388 quinquies B du code général des impôts.
Telles sont les informations que je suis en mesure de porter à votre connaissance, madame la sénatrice.

La parole est à Mme Sabine Van Heghe, pour répondre à M. le secrétaire d’État, en trente-neuf secondes.

Monsieur le secrétaire d’État, voilà une subtilité que les collectivités concernées apprécieront…
La compensation, qui était d’ailleurs promise dans la loi, serait, me semble-t-il, un bon signal adressé à toutes les communes de France, surtout en ce jour de Congrès des maires. Les élus locaux sont très inquiets à propos de la compensation de la taxe d’habitation, qui sera supprimée prochainement.

La parole est à M. Daniel Gremillet, auteur de la question n° 454, adressée à M. le ministre de l’économie et des finances.

Le 15 novembre dernier, Orange a mis fin à la commercialisation des téléphones fixes. Le réseau téléphonique commuté, ou RTC, va progressivement disparaître à compter de 2023, au profit de la technologie IP. Dans l’immédiat, seuls les nouveaux clients d’Orange et les abonnés qui déménagent sont concernés.
Plusieurs questions m’interpellent. Cela concerne à la fois les usagers et les entreprises. Je souhaiterais pouvoir rassurer ces publics, mais également avoir la certitude que toutes les dispositions seront bien prises pour satisfaire au maintien d’un service téléphonique de qualité à un prix raisonnable.
Les entreprises disposeront de cinq ans pour faire évoluer leurs services de téléphonie et faire jouer la concurrence, afin de choisir l’offre de téléphonie la plus adaptée à leurs besoins. Ce temps peut aussi se révéler bien trop court s’agissant des usages spéciaux du réseau RTC. Je pense au fax, aux télédéclarations de type PAC, à la télésurveillance, aux alarmes d’ascenseurs ou à la téléalarme pour les personnes isolées. Ces équipements, souvent indispensables au fonctionnement des entreprises, s’appuient encore largement sur la technologie RTC, dont on sait par ailleurs qu’elle sera inutilisable en cas de coupures d’électricité.
Je crains que cette décision ne renforce malheureusement les effets de la fracture numérique. Effectivement, le nouveau fixe installé en protocole internet sera plus exposé aux pannes, car il nécessite l’électricité, alors que le réseau RTC fonctionnait même sans électricité.
Pour fonctionner en permanence, ce nouveau téléphone fixe nécessite d’avoir internet. Or, nous le savons, 7, 5 millions de Français disposent d’un internet de mauvaise qualité. De plus, ce sont les zones rurales qui sont majoritairement touchées.
La question des tarifs inquiète légitimement la population. Nous avons besoin d’avoir des assurances.
L’État est le garant d’un service téléphonique de qualité à un prix raisonnable. Le groupe Orange a été désigné opérateur du service universel.
Pouvez-vous garantir aux abonnés, particuliers ou entreprises, que la mutation s’effectuera dans les conditions les plus simples et les moins onéreuses possible ?
Monsieur le sénateur Gremillet, l’arrêt du RTC, annoncé le 15 novembre dernier, constitue une étape essentielle pour la modernisation de nos infrastructures de télécommunications.
Concrètement, à partir du mois de novembre 2018, c’est tout d’abord la commercialisation de nouveaux accès sur le RTC qui va cesser. Les accès existants seront maintenus. Ensuite, progressivement, à partir de 2022, et jusqu’en 2024, le service RTC sera arrêté par plaques annoncées cinq ans à l’avance. Les opérateurs et l’État accompagneront donc les usagers dans cette transition, en termes d’information et d’accompagnement technologique.
La modernisation a pour objectif d’améliorer la qualité de service de l’utilisateur. Elle ne signe pas pour autant la fin du réseau de cuivre. Il est essentiel que le réseau de cuivre, qui constitue pour de nombreux concitoyens le seul moyen de communication, soit pleinement maintenu en attendant le déploiement des nouveaux réseaux de fibre optique.
C’est tout le sens du mécanisme de service universel, dont le Gouvernement entend veiller à la pleine effectivité, et pour lequel l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, a exercé sa mission de contrôle tout récemment, dans le cadre d’une procédure de mise en demeure à l’encontre du groupe Orange, qui est chargé du service universel.
Pour les usagers, la fin du RTC ne signifie pas une modification des tarifs, ceux du service universel étant fixés indépendamment de la technologie utilisée par l’opérateur.

La parole est à M. Daniel Gremillet, pour répondre à M. le secrétaire d’État, en quinze secondes.

Il était important d’avoir des assurances. Trop de questions se posent, notamment pour la population et les entreprises les plus fragiles. Il ne s’agit pas de refuser le progrès. Nous voulons simplement que les usagers les plus exposés puissent continuer de se sentir bien dans notre société.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, auteur de la question n° 467, adressée à M. le ministre de l’économie et des finances.

Au début de l’année 2018, le groupe Carrefour a engagé un plan de restructuration et d’économies, axé notamment sur la fermeture du réseau de proximité formé par les ex-magasins Dia et la suppression de 2 100 emplois.
Les promesses n’ont pas manqué : promesses quant à la recherche de repreneurs, afin de limiter le nombre de fermetures de magasins ; promesses de reclassements internes, d’aides à la formation, censés limiter au maximum le nombre de licenciements, le PDG du groupe s’engageant même à reclasser la moitié des salariés concernés.
Onze mois plus tard, le verdict est tombé, dans sa cruelle réalité : 243 magasins ont été fermés ; près de 1 500 salariés ont reçu leur lettre de licenciement. Un peu plus de 200 seulement ont trouvé un nouveau poste en interne. Ces chiffres justifient à eux seuls nos interrogations sur la sincérité et la réalité des efforts fournis par le groupe. Seuls 30 magasins ont été cédés à des repreneurs. Cela laisse à penser que des offres de reprise auraient été refusées au seul motif de ne pas favoriser la concurrence. Ainsi, 152 magasins auraient fait l’objet d’une offre sérieuse pourtant rejetée. Et que dire des offres de reclassement faites aux salariés ? Certaines à plusieurs centaines de kilomètres ; d’autres avec baisse de salaires ; d’autres encore sur des postes sans aucun lien avec la fonction exercée et sans proposition de formation, quand les postes en question n’étaient pas tout simplement déjà pourvus !
Le Gouvernement, à plusieurs reprises, a fait état de sa « vigilance sur la qualité du dialogue social ». Par conséquent, nous ne pouvons que nous étonner du silence assourdissant qui accompagne aujourd’hui ce qui constitue un des plus grands plans de licenciements en 2018. Car nous parlons d’un groupe qui a défrayé la chronique par l’ampleur des rémunérations attribuées à ses dirigeants, des dividendes versés aux actionnaires et des exonérations sociales dont il a bénéficié, soit 2 milliards d’euros en cinq ans.
Pouvez-vous nous préciser, monsieur le secrétaire d’État, les mesures qui ont été prises pour contraindre Carrefour à respecter ses engagements, c’est-à-dire pour garantir la qualité du dialogue social ?
Madame la sénatrice Gréaume, face aux bouleversements du secteur de la distribution, le groupe Carrefour a décidé d’investir 2, 8 milliards d’euros en cinq ans. Cela sera dédié à la transformation numérique et à la mise en place d’une nouvelle stratégie, liée au concept d’« omnicanal ».
Ce choix stratégique conduit à la mise en place de projets de réorganisation. Il faut le souligner, deux accords majoritaires ont été conclus avec les organisations syndicales de salariés le 25 avril 2018. Le premier concerne la restructuration des sièges et la suppression de 2 400 emplois, à travers la mise en place d’un plan de départs volontaires autonome ; la mobilité externe sera encouragée, de même que les départs liés à la création d’entreprise, ainsi que les départs en retraite anticipée pour les salariés susceptibles de faire valoir leurs droits à la retraite d’ici à la fin 2020. Le second accord entraîne la fermeture de 273 magasins de l’enseigne Dia – vous l’avez rappelé – et la mise en location-gérance de 79 autres magasins, avec un total de 2 100 suppressions d’emplois en CDI dans les magasins et de 200 suppressions dans les sièges.
Outre l’alignement des mesures sociales des ex-magasins Dia avec les mesures du plan de départs volontaires des sièges, la direction de l’entreprise a pris des engagements en matière de reclassement interne, au travers de la mise en place d’actions de formation, d’une cellule d’accompagnement, ainsi que de diverses aides destinées à faciliter le reclassement des salariés, avec notamment des garanties sociales et des périodes d’adaptation.
Concernant le personnel des magasins fermés avec départ contraint, 156 dossiers ont été validés pour un reclassement interne au sein du groupe et 1 753 courriers ont été envoyés proposant deux offres de reclassement interne à chacun des salariés concernés par un départ contraint.
Dans le cadre de cette restructuration d’ampleur, l’État a effectivement affirmé à plusieurs reprises son attachement à un dialogue social de qualité, dialogue qui se tient avec les représentants du personnel. Il y veille très concrètement dans le cadre de la commission de suivi du plan de sauvegarde de l’emploi de Carrefour Proximité, à laquelle participent activement les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, la DIRECCTE.
Plus globalement, le Gouvernement a exigé du groupe Carrefour que cette restructuration s’opère de la manière la plus responsable possible. Il continuera d’être très vigilant quant aux conséquences sociales de ces mesures et à la bonne exécution du plan de sauvegarde de l’emploi, qui a été validé par un jugement du tribunal administratif de Caen le 8 novembre dernier.
À cette fin, les services du ministère du travail et les services du ministère de l’économie et des finances sont particulièrement attentifs à ce que la direction de l’entreprise respecte l’intégralité de ses engagements en matière de reclassement vis-à-vis des salariés et qu’elle mobilise tous les moyens que l’on peut attendre d’un groupe de cette envergure pour garantir le maintien ou l’accès à l’emploi des salariés concernés.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour répondre à M. le secrétaire d’État, en vingt secondes.

Vous ne m’enlèverez pas de l’idée que le Gouvernement fait preuve d’une grande passivité sur ce dossier. Ce n’est pas acceptable. J’ai évoqué le montant des exonérations dont a bénéficié Carrefour. Le Gouvernement, qui est si soucieux d’économie et de rigueur budgétaire, serait bien inspiré de demander des comptes sur l’utilisation de cet argent public versé à fonds perdu et d’exiger son remboursement. C’est la moindre des choses. Car, à l’évidence, cela a servi à tout sauf à préserver l’emploi.

La parole est à M. Yves Bouloux, auteur de la question n° 501, transmise à M. le ministre de l’économie et des finances.

Qu’ils soient professionnels ou volontaires, les sapeurs-pompiers français sont un exemple de dévouement, toujours prêts à affronter tous les périls pour secourir nos concitoyens. Pour autant, rien ne peut justifier de les exposer à des menaces mortelles qui devraient être assez facilement évitées.
En 1999, un sapeur-pompier s’est vu arracher une jambe par l’explosion d’une voiture au gaz de pétrole liquéfié, le GPL. Les enseignements de ce drame en ont été tirés : les véhicules ont été sécurisés grâce à une soupape permettant une lente évacuation du gaz. Cependant, aucune réglementation n’est imposée sur les bouteilles de gaz classiques, GPL ou propane, que l’on trouve partout en France.
Pourtant, quand ces bouteilles sont impliquées dans un incendie, ce qui est fréquent, elles sont un facteur terriblement aggravant. En effet, elles explosent dans un délai inférieur à cinq minutes lorsqu’elles sont immergées dans les flammes. Il s’ensuit une élévation de la température et un violent accroissement de la pression, entraînant des projections de fragments de tôle en effets missiles à des distances supérieures à 80 mètres.
Les conséquences sur la période 2010–2017 sont effroyables : décès d’un sapeur-pompier professionnel, neuf personnes grièvement blessées, essentiellement sapeurs-pompiers ; sinistres avec impossibilité d’attaque pour les soldats du feu et dégâts considérables.
Il paraît donc impératif d’agir au plus vite, à l’instar de la réglementation des véhicules GPL – cela n’a pris que deux mois –, afin d’éviter de nouveaux drames humains et d’énormes préjudices matériels.
Heureusement, les bouteilles de nouvelle génération ne posent pas de problème. Mais il s’agit pour le très important stock de bouteilles d’acier de remplacer l’ancien dispositif par un couple soupape-fusible, ce qui pourrait se faire raisonnablement dans un délai de cinq à huit ans.
De nombreux pays européens ont décidé de sécuriser leur parc de bouteilles de gaz, sur le type de dispositif que je viens d’exposer : le Royaume-Uni, l’Espagne, le Portugal, l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, la Suède, la Finlande, le Danemark… Ces États ont pris la mesure de l’enjeu. C’est une évidence : la France doit s’engager au plus vite sur ce chemin, pour la sécurité de la population, en particulier celle des sapeurs-pompiers.
Quelles mesures précises le Gouvernement envisage-t-il sur ce sujet ? Et dans quel délai ?
Monsieur le sénateur Bouloux, le Gouvernement partage votre souci d’améliorer les conditions d’intervention des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et de sécuriser au maximum les conditions d’intervention de ceux-ci.
Dans ce cadre, vous avez bien voulu solliciter notre attention sur la sécurisation du parc français de bouteilles de gaz, en soulignant plus particulièrement le danger que constitue l’exposition aux flammes de ces mêmes bouteilles. Certains représentants des sapeurs-pompiers, vous l’avez rappelé, estiment en effet qu’elles devraient être obligatoirement munies de soupapes. Le sujet est extrêmement contraint en droit. Je souhaite vous apporter quelques éléments.
Les bouteilles conformes à la directive que vous mentionnez sont en libre circulation dans l’Union européenne, qui n’impose ni n’interdit pas les soupapes. Il ne peut donc pas y avoir de surtransposition pour ces bouteilles.
Néanmoins, l’utilisation du parc historique, qui représente aujourd’hui encore la majorité des bouteilles en France, reste possible. Ce parc n’est pas équipé de soupapes susceptibles d’avoir un effet favorable pour l’exposition des sapeurs-pompiers en cas d’incendie. Mais les bouteilles sont équipées d’un limiteur de débit incompatible, dans l’état actuel des techniques, avec la soupape, qui permet de maîtriser le risque lié à des chutes de la bouteille sur le robinet.
À la suite de contacts avec les sapeurs-pompiers, le Gouvernement a décidé de confier à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques, l’INERIS, une étude relative aux comportements des bouteilles en acier de GPL soumises au feu.
Cette étude, qui s’appuiera sur les essais déjà réalisés, y compris par les sapeurs-pompiers eux-mêmes, permettra de développer un modèle théorique de prédiction du comportement d’une bouteille de GPL en acier prise dans un feu et de déterminer les avantages et inconvénients des différents dispositifs de sécurité envisagés. Dans ce cadre, il conviendra de mener une analyse de risques portant sur l’ensemble du cycle de vie de la bouteille, pour ne pas se limiter à la seule prise en compte du risque d’exposition au feu. Je pense par exemple au stockage en extérieur à des températures plus ou moins élevées ou encore aux conditions de transport.
Les résultats de cette étude permettront d’argumenter une proposition qui visera à rechercher l’appui d’une majorité des États membres de l’Union pour modifier si nécessaire – vous semblez penser que cela l’est – la réglementation européenne couvrant la conception de ces bouteilles de gaz du parc historique.

La parole est à M. Yves Bouloux, pour répondre à M. le secrétaire d’État, en vingt secondes.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous entends. Mais de grâce : faisons vite et épargnons d’autres vies ! Certains sapeurs-pompiers ont malheureusement pâti de cette problématique, qu’il faut prendre en compte très rapidement.

La parole est à Mme Chantal Deseyne, auteur de la question n° 439, adressée à Mme la ministre des armées.

Ma question porte sur la fermeture de la base aérienne de Châteaudun, en Eure-et-Loir.
Le ministère des armées a pris la décision de fermer la base militaire de Châteaudun dès le second semestre 2021. Cette base compte encore 330 personnels civils et militaires. À compter de 2021, l’activité de démantèlement d’avions militaires sera totalement externalisée, pour des raisons de coût.
Ainsi, 330 militaires et civils vont partir, ce qui représente en tout près de 500 consommateurs, contribuables et scolaires en moins pour ce territoire. Les conséquences sociales et économiques de cette décision sont considérables pour les salariés, pour l’économie locale et pour l’avenir de tout le bassin de vie de Châteaudun, qui est déjà particulièrement sinistré.
Je souhaiterais donc savoir si le maintien de cette base aérienne ne pourrait pas être envisagé. À défaut, quelles sont les solutions proposées par le Gouvernement pour l’avenir de ce site, où les gros-porteurs de plus de 40 tonnes peuvent décoller et atterrir ?
Madame la sénatrice, Mme la ministre des armées m’a chargé de vous répondre.
La base aérienne de Châteaudun a été dissoute en 2014, le site ayant été depuis recentré sur le stockage d’aéronefs. La fin de la politique de stockage actif des aéronefs, qui était la mission résiduelle principale de cette emprise, a amené le ministère des armées à envisager sa reconversion en site de déconstruction des aéronefs. Aucun projet industriel viable de ce type n’a cependant pu être identifié.
Ce constat d’une emprise sans devenir opérationnel ni industriel a été confirmé par les équipes du ministère des armées, qui ont examiné ce dossier sur place au début de l’année 2018. Plutôt que de remettre à plus tard cette décision difficile, Mme la ministre des armées a souhaité trancher rapidement, afin de faire bénéficier les Dunois d’un dispositif arrivant à expiration à la fin de l’année 2018, celui du contrat de redynamisation du site de défense, le CRSD. Vous savez combien il a été précieux pour la reconversion réussie de la caserne Kellermann.
C’est pourquoi Mme la ministre des armées a décidé au mois de juillet dernier un désengagement progressif du site d’ici à 2021, comme vous l’avez rappelé, et en a informé les élus locaux. M. le Premier ministre a mandaté la préfète de l’Eure-et-Loir pour aboutir à un nouveau CRSD d’ici à l’été prochain, avec l’appui du Commissariat général à l’égalité des territoires et la délégation à l’accompagnement régional.
Vous pouvez compter sur l’engagement du Gouvernement pour accompagner la région, le département et la municipalité, afin de valoriser le foncier du site de Châteaudun et lui dessiner un avenir soutenable.
À ce titre, je citerais trois dossiers qui nous semblent prometteurs – je pense que vous les connaissez puisqu’ils font l’objet d’un suivi attentif – : l’implantation d’un circuit automobile, l’installation d’une centrale photovoltaïque ou encore la construction d’un démonstrateur de dirigeables.
Parce que votre mobilisation et celle de tous les acteurs locaux sont nécessaires pour accompagner le développement économique de ce bassin de vie, le ministère des armées fera très prochainement un nouveau point de situation, en présence de Mme la préfète et des élus locaux. Vous serez informée des évolutions et de la préparation du CRSD.

La parole est à Mme Chantal Deseyne, pour répondre à M. le secrétaire d’État, en un peu plus d’une minute.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse, même si elle ne comporte pas forcément beaucoup d’éléments nouveaux, puisque je disposais déjà de ces informations.
Je vous signale simplement une annonce parue ce matin dans la presse locale : M. le Premier ministre pourrait indiquer dès jeudi la centaine de « territoires d’industrie » qui seront accompagnés par l’État. Or la ville de Châteaudun, 13 000 habitants, qui remplit un certain nombre de critères, avait postulé. Elle pourrait être éligible à ce dispositif, qui bénéficiera d’un accompagnement, dont un accompagnement financier de l’ordre de 500 millions d’euros.
Le bassin de Châteaudun est un bassin particulièrement sinistré. Une instance de réflexion et de proposition est déjà en place autour de la préfète. Nous souhaitons vraiment trouver des solutions pour revitaliser ce bassin. C’est une spirale infernale : le démantèlement du site de la base de Châteaudun entraîne l’économie du secteur dans le déclin.

La parole est à M. François Bonhomme, auteur de la question n° 481, adressée à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Ma question porte sur les problèmes de sécurité soulevés par la diffusion de prises de vues aériennes des prisons françaises sur Google Maps et Google Earth.
Pour rappel, l’arrêté du 27 octobre 2017 fixe la liste des zones interdites à la prise de vues aérienne par appareil photographique, cinématographique ou tout autre capteur. Parmi les 247 zones interdites de prises de vues aériennes en France figurent 68 prisons. La prise de vues aériennes de l’un de ces sites est ainsi passible d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Toutefois, près d’un an après la publication de cet arrêté, une cinquantaine de prisons, dont certaines accueillent des individus dangereux, resteraient visibles.
C’était il y a un mois encore le cas de la maison centrale de Réau, que tout le monde connaît malheureusement aujourd’hui. Voilà un mois, Google expliquait cette absence de floutage par le caractère non rétroactif de l’arrêté du 27 octobre 2017 : ce dernier ne s’appliquerait qu’aux photos prises depuis 2017.
Or chacun sait que l’accès à ces prises de vues aériennes dites « sensibles » pose de véritables problèmes de sécurité. Cela peut par exemple être utilisé pour préparer et organiser des évasions.
Constatant que ses demandes de floutage de sites sensibles sur Google Maps demeuraient lettre morte, le ministère de la défense belge a annoncé, au mois d’octobre dernier, sa volonté d’attaquer Google en justice.
Madame la garde des sceaux, le 16 octobre dernier, Google vous a annoncé par voie postale le démarrage du floutage des vues aériennes de prisons françaises visibles sur Google Maps et Google Earth, sans pour autant spécifier les prisons concernées. Dans le même temps, Google s’engageait à vous tenir informée de l’évolution du processus toutes les trois semaines.
Pourriez-vous nous préciser le programme de déploiement du floutage ? Où en sommes-nous ? Le cas échéant, quelles mesures envisagez-vous pour vous assurer que Google respecte effectivement le retrait ou le floutage des vues aériennes de nos prisons, afin de garantir leur sécurité ?
Monsieur le sénateur Bonhomme, le 31 juillet dernier, j’ai effectivement transmis un courrier à la direction de Google France en lui demandant de prendre les dispositions techniques nécessaires pour garantir le retrait ou le floutage des vues aériennes sur Google Earth et Google Maps des établissements pénitentiaires listés en annexe des arrêtés pris les 27 janvier et 27 octobre 2017.
La direction de Google France m’a répondu par deux courriers, le premier du 14 août et le second du 8 octobre ; vous y avez fait allusion. Google France m’a signalé que tout était mis en œuvre pour finaliser le floutage de l’ensemble des lieux visés par les arrêtés pris en 2017 d’ici au début du mois de décembre 2018. Nous pourrons donc très prochainement mesurer la portée de l’engagement qui a été pris par Google France. Mais je sais que cela commence d’ores et déjà à être effectif.
En parallèle, le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale conduit actuellement des travaux qui rassemblent les experts juridiques des ministères, directions générales et agences concernés pour adapter les dispositions juridiques encadrant la prise de vue aérienne et par satellite des sites sensibles. Ce groupe de travail, auquel participe le ministère de la justice, a pour objectif de refondre le cadre juridique de la captation d’images et de leur diffusion, afin de préserver les zones sensibles, considérées comme des points d’importance vitale et stratégique. Il vise l’ensemble des fournisseurs, bien au-delà donc des seuls services qui sont proposés par Google. Ses travaux sont menés sur la base des propositions émises par la Direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense, du ministère des armées, dans son rapport du 4 juin 2018, consacré à ce sujet.
Sans attendre, le ministère de la justice, par arrêté du 12 octobre 2018, a enrichi la liste des zones interdites à la prise de vue aérienne pour couvrir tous les établissements les plus sensibles, portant le total de trente-huit à quatre-vingt-neuf sites. Les travaux de recensement des coordonnées GPS des autres sites se poursuivent, afin que l’ensemble des établissements pénitentiaires soient pris en compte en 2019.
Comme vous le voyez, c’est une action globale qui est menée pour assurer l’efficacité des mesures de sécurité que nous prenons pour l’ensemble de nos établissements pénitentiaires.

La parole est à M. François Bonhomme, pour répondre à Mme la garde des sceaux, en vingt-cinq secondes.

Je vous remercie, madame la ministre, de votre réponse, dont je prends acte, comme de vos intentions. Je regrette néanmoins la faible réactivité de Google par rapport à vos injonctions. Malheureusement, le mal est fait : les captures d’écran ont eu lieu et des actions sont peut-être en préparation sur la base de ces données photographiques. Pour l’avenir, j’ai bien noté que vous souhaitiez faire évoluer le cadre juridique relatif aux prises de vues aériennes.

C’est nécessaire, car les choses ne peuvent pas rester en l’état, la situation étant insécure pour les maisons d’arrêt.

La parole est à Mme Brigitte Lherbier, auteur de la question n° 497, adressée à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Pas un mois ne passe sans que la sécurité de nos établissements pénitentiaires soit évoquée dans les médias, au Parlement ou par vous-même, madame le garde des sceaux.
La mission de sécurité de l’administration pénitentiaire consiste à assurer une sécurité optimale dans les prisons en prévenant les évasions, les mutineries, les violences, les dégradations ou les suicides. Sa mission est aussi de prévoir la réinsertion des condamnés à leur sortie pour éviter la récidive.
Depuis 2015, le contexte terroriste a naturellement accentué cette exigence de sécurité et nous oblige à une vigilance accrue.
L’agression de trois surveillants à Vendin-le-Vieil en janvier dernier, par un détenu condamné pour terrorisme, fut à l’origine d’un grand mouvement de mobilisation du personnel pénitentiaire. Il nous faut à toutes fins qu’il ne se redéclenche pas.
Les surveillants, à qui je voudrais rendre hommage, nous ont alertés très souvent sur leurs conditions de travail particulièrement difficiles, sur le manque de personnel qui les expose dangereusement pendant l’exercice de leur mission et sur les difficultés à recruter de nouveaux collègues.
La surpopulation continue de dégrader la vie carcérale et pèse sur les conditions de sécurité de nos établissements pénitentiaires. L’été a été difficile dans de nombreux endroits de France. Il faisait très chaud dans les maisons d’arrêt, au sens propre comme au sens figuré.
La semaine dernière, je suis allée visiter la prison de la Santé avec quelques collègues sénateurs : les syndicats de surveillants nous ont exprimé de nouveau leur mécontentement et leurs craintes. Ils dénoncent surtout le manque de reconnaissance face aux difficultés des missions qu’ils exercent.
Une nouvelle promotion de surveillants devrait assurer l’ouverture de la prison de la Santé : beaucoup de ces personnes venues de l’outre-mer n’ont toujours pas trouvé de logements décents à prix raisonnable afin de pouvoir s’installer à Paris.
Certains surveillants stagiaires ont trouvé des solutions d’hébergement précaire, notamment dans les foyers de jeunes travailleurs. D’autres sont toujours en cours de recherche. Tous réclament des lieux de détente, de sport, pour évacuer la pression quotidienne et pour s’entraîner physiquement. C’est bien le moins que l’on puisse leur offrir quand on sait le nombre de menaces de représailles qu’ils subissent chaque jour. Le sénateur François Grosdidier, lors des travaux de la commission d’enquête sur l’état des forces de sécurité intérieure, l’avait souligné dans son rapport. À chaque visite de maison d’arrêt – Lille-Sequedin, Fresnes, etc. –, nous sentons la tension et les craintes professionnelles, qui pèsent dans la vie de chacun. Je tenais à vous en faire part, madame le garde des sceaux. Je sais que vous n’ignorez rien de cette situation, mais le Sénat prête une attention toute particulière à ces problèmes.
Contexte terroriste, surpopulation carcérale et mécontentement des surveillants : ces trois ingrédients forment un cocktail explosif qui ne peut que nuire à la mission de sécurité de l’administration pénitentiaire.
Madame le garde des sceaux, les orientations voulues par votre ministère ne nous semblent pas suffisamment prendre en compte ces trois facteurs d’insécurité. Votre ministère va-t-il aller plus loin ? Avez-vous les moyens budgétaires pour garantir la sécurité de nos établissements ?
Madame la sénatrice, il me faudrait plus d’une heure pour répondre à votre question tant l’ensemble des mesures que nous avons adoptées afin d’assurer la sécurité de nos établissements pénitentiaires est large et tant la « reconnaissance » – je reprends à mon compte ce terme que vous avez utilisé – que nous devons aux personnels de l’administration pénitentiaire est grande.
Je citerai quelques chiffres. Le budget de l’administration pénitentiaire s’élève à 3, 8 milliards d’euros dans le projet de loi de finances pour 2019, soit 2, 5 milliards d’euros pour les dépenses de personnel, en hausse de 95 millions d’euros, et 1, 2 milliard d’euros pour les autres dépenses.
Globalement, ce budget est en progression de 5, 7 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2018. C’est une augmentation qui correspond à la fois à une hausse des dépenses de personnel de 3, 9 % et à une hausse de près de 10 % pour les dépenses de fonctionnement et d’investissement.
Sans aller plus avant dans l’énoncé des chiffres, car vous pourriez vous lasser, je veux vous assurer que la sécurisation des établissements pénitentiaires est un point majeur : nous y consacrons un effort important de plus de 50 millions d’euros en 2019. Au-delà, nous accordons également une grande importance aux personnels pénitentiaires pour lesquels – je le redis – j’éprouve une véritable reconnaissance en raison de leurs conditions de travail très difficiles.
Nous avons fait un effort du point de vue indemnitaire : nous avons augmenté la prime de sujétion spéciale, la PSS, de plus de 2 % ; nous avons également augmenté le taux de base de l’indemnité pour charge pénitentiaire, qui est passée de 1 000 à 1 400 euros par an ; nous avons accru la prime des dimanches et jours fériés, qui est passée de 26 euros à 36 euros ; nous avons mis en place une prime de fidélisation pour les établissements les plus difficiles ou dans les zones de particulière cherté du coût de la vie – c’est le cas en banlieue parisienne où nous donnerons 8 000 euros pour six ans de fidélité à un établissement, 4 000 euros seront versés dès la première année.
Nous avons consenti un effort important en termes d’équipement, avec de nouveaux matériels de protection, des passe-menottes, etc.
Nous avons fait un effort en termes de renseignement pénitentiaire et en termes de régimes de détention, avec la mise en place d’un système d’étanchéité pour les détenus les plus dangereux, les détenus terroristes.
Toutes ces mesures s’inscrivent dans un plan pénitentiaire global, qui prévoit, à hauteur de plus de 1, 7 milliard d’euros, la construction de 15 000 nouvelles places de prison, dont 7 000 seront livrées en 2022 et 8 000 seront commencées avant 2022. Cet ensemble de mesures nous permet de répondre à l’inquiétude dont vous faisiez état, madame la sénatrice, et dont je mesure la réalité.

La parole est à M. Alain Fouché, auteur de la question n° 445, adressée à M. le ministre de l’intérieur.

Monsieur le secrétaire d’État, le Congrès annuel des maires de France s’ouvre sur fond de malaise des élus locaux. Depuis 2014, le nombre de maires ayant quitté leur poste est en hausse de 55 % par rapport à la précédente mandature ; un dernier sondage prévoit 50 % d’abandons en 2020.
Alors que 68 % des Français leur font confiance, les maires sont usés. Ils sont usés par la recentralisation, la métropolisation, les fractures territoriales qui augmentent. Ils sont usés par des moyens financiers qui diminuent alors que les charges augmentent. La baisse des dotations entraîne des difficultés sans précédent et leur indépendance financière est remise en cause. Ils sont usés par l’accroissement des contraintes administratives. Certaines de ces tracasseries ne datent pas d’aujourd’hui. Ils sont usés par les faibles revenus qu’ils perçoivent : un maire sur deux bénéficie d’une indemnité mensuelle inférieure à 360 euros. La décision du Gouvernement de modifier leur fiscalité va entraîner une augmentation de l’impôt sur le revenu.
Les maires assument une tâche difficile et indispensable à la vie de nos territoires. Elle est peu conciliable avec une activité professionnelle. Un vrai statut de l’élu est attendu depuis longtemps, et c’est votre engagement ! Le Sénat a soumis des propositions en octobre dernier, je crois savoir que certaines d’entre elles seraient reprises.
Je lance aujourd’hui un cri d’alarme, monsieur le secrétaire d’État. Quelles mesures entendez-vous prendre pour résoudre cette crise et pouvez-vous nous indiquer les grandes lignes de ce futur statut de l’élu ? Je vous remercie de nous rassurer.
Monsieur le sénateur, le Gouvernement n’ignore pas les difficultés que peuvent rencontrer les élus locaux, qui consacrent leur temps et mettent toute leur énergie, toutes leurs compétences, au service de leurs concitoyens.
Toutefois, permettez-moi de relativiser les chiffres évoqués dans votre question. Le nombre de démissions de maires a très peu augmenté par rapport à la mandature précédente. Il est d’ailleurs davantage lié à des raisons de santé, professionnelles ou familiales, à des raisons mécaniques, comme la constitution de communes nouvelles, ou à la fin du cumul des mandats qu’à des raisons de départs volontaires pour motifs politiques ou par lassitude.
Néanmoins, nous sommes bien entendu très attentifs à ce point. D’ailleurs, lors de son discours prononcé à l’occasion du 100e Congrès des maires de France du 23 novembre 2017, le Président de la République a fait part de son attachement à la place des élus locaux et a exprimé toute sa considération pour leur engagement et leurs convictions. Conformément à ce qu’il avait annoncé alors, plusieurs mesures sont mises en œuvre pour traduire concrètement cette reconnaissance de l’État.
Tout d’abord, il s’agit de réduire le poids des normes pesant sur les collectivités locales. La circulaire du Premier ministre en date du 20 octobre 2017 prescrit que toute norme réglementaire nouvelle doit s’accompagner de deux mesures d’abrogation ou, à défaut, de simplification. La circulaire du 8 novembre 2017 relative à l’accord de méthode entre l’État et les collectivités territoriales élaboré dans le cadre de la Conférence nationale des territoires, demande au ministre, dans la sphère des compétences décentralisées, de laisser le champ le plus large possible au pouvoir réglementaire local.
D’une manière plus générale et dans le cadre du même accord de méthode, le Gouvernement s’est engagé à ce qu’aucune décision concernant les collectivités territoriales ne soit prise sans que ces dernières aient été préalablement consultées.
Enfin, conformément à la circulaire du Premier ministre du 12 janvier 2018, chaque projet de loi sectoriel devra intégrer un volet de mesures de simplification des normes législatives en vigueur. Les dispositions relatives aux collectivités territoriales sont évidemment comprises dans ce champ.
Les propositions de la mission d’évaluation et d’allégement des normes applicables aux collectivités territoriales, dirigée par Alain Lambert, ancien ministre et président du Conseil national d’évaluation des normes, et par Jean-Claude Boulard, ancien maire du Mans, décédé en juin dernier, font également l’objet d’un examen très attentif par le Gouvernement.
Par ailleurs, un chantier est dédié aux conditions d’exercice des mandats locaux dans le cadre de la Conférence nationale des territoires. Il pourra se nourrir des travaux engagés sur ces questions par la délégation du Sénat aux collectivités territoriales puisque celle-ci a constitué un groupe de travail chargé de mener une réflexion sur le statut des élus locaux.
Dans ces conditions, c’est un véritable pacte de confiance que le Gouvernement propose aux élus de la République, de nature à leur permettre un exercice serein et accompli de leur mandat.

La parole est à M. Alain Fouché, pour répondre à M. le secrétaire d’État, en quarante-trois secondes.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de vos précisions sur les normes. Je connais bien le texte sur les simplifications puisque j’en ai été le rapporteur au Sénat. Néanmoins, et c’est un problème, l’administration ne suit pas toujours ce que décide le politique.
Quoi qu’il en soit, vous ne m’avez pas répondu sur le statut de l’élu. Il est pourtant très important et très attendu. Vous n’avez pas non plus évoqué les dotations. Certes, leur niveau global reste le même, mais de nombreuses communes ont vu leurs dotations baisser. Dans mon seul département, la Vienne, 155 communes sur 280 communes ont enregistré une diminution de leurs dotations. De plus, les régions aident de moins en moins les petites communes. Telles sont nos difficultés. J’ai noté certaines de vos annonces, mais les maires sont las et le Gouvernement doit s’engager à faire plus.

La parole est à M. Antoine Karam, auteur de la question n° 453, adressée à M. le ministre de l’intérieur.

Depuis plusieurs années, la Guyane et Cayenne, en particulier, sont touchés par une prolifération de l’habitat informel et des occupations illicites.
En septembre 2018, c’est une nouvelle affaire de squat qui a agité l’actualité. Des locaux qui avaient été signalés depuis plusieurs années aux forces de l’ordre par les riverains exaspérés par les nuisances demeuraient occupés illégalement, ce qui entraînait un climat d’insécurité dans le quartier.
En dépit des plaintes déposées et des procédures engagées, la situation s’est enlisée avant de dégénérer avec la menace de mort dont a été l’objet une personne du voisinage.
C’est dans ce contexte que les collectifs de citoyens ont décidé de procéder à l’évacuation du squat par leurs propres moyens. Oui, nous convenons tous ici que les citoyens ne peuvent se faire justice eux-mêmes et que l’État de droit doit être respecté. Je vous demande néanmoins, monsieur le secrétaire d’État, d’entendre l’exaspération, la peur même, de ces femmes et de ces hommes qui n’admettent pas que, dans l’un des départements les plus criminogènes de France, on puisse laisser perdurer des années durant de telles situations d’insécurité sous leurs fenêtres. Ces faits d’une rare violence nous rappellent la nécessité d’éradiquer les occupations illicites en Guyane tant elles engendrent de graves troubles à l’ordre public.
Pour rappel, la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, en voie de promulgation, comporte des dispositions relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne en Guyane et à Mayotte. Aux termes de ces dispositions, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel et présentent des « risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique », le préfet de Guyane pourra ordonner aux occupants d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir préalablement une ordonnance du juge et un avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.
À cet égard, monsieur le secrétaire d’État, ce dispositif permettra-t-il également d’agir plus rapidement et plus efficacement s’agissant des squats que je viens d’évoquer, et qui causent de graves troubles à l’ordre public ?
Enfin, plus largement, quelles actions complémentaires le Gouvernement compte-t-il mettre en œuvre pour mieux protéger les propriétaires et les riverains exposés, car ils sont les premières victimes des nuisances liées aux occupations illicites ?
Monsieur le sénateur, le département de Guyane, comme celui de Mayotte, voit se développer un habitat spontané important qui correspond à des zones d’habitations construites sommairement, de façon illégale, regroupant, dans des conditions d’hygiène déplorable, une population souvent en situation irrégulière.
En 2018, les gendarmes de Guyane ont prêté leur concours à l’expulsion des occupants de cinquante-neuf constructions illégales, dans le cadre de deux procédures prévues par le code des procédures civiles d’exécution : « l’assistance aux opérations d’exécution » et le « concours de la force publique ».
Il est précisé que la gendarmerie reste toujours un auxiliaire de « mise à exécution » d’une décision d’expulsion, qu’elle émane d’une autorité de justice ou d’une autorité administrative. Les gendarmes assistent toujours un huissier de justice.
Ces opérations d’expulsion proprement dites ne sont que l’aboutissement de procédures judiciaires et administratives, souvent très longues. Ces délais sont, comme vous l’avez souligné, incompatibles avec la préservation de l’ordre public lorsqu’il est gravement compromis.
La loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique vise à résoudre cette difficulté. La nouvelle procédure d’expulsion qu’elle prévoit permettra une accélération des procédures d’expulsion en cas de risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique.
Elle ne supprime bien évidemment pas pour autant l’obligation de s’assurer que les locaux ou installations visés ont été édifiés sans droit ni titre, et qu’ils répondent bien aux critères d’un habitat informel.
Enfin, la procédure prévue n’est pas automatique. Les préfets apprécieront l’opportunité d’y recourir en veillant à ce que son usage soit proportionné au trouble constaté, tienne compte des possibilités de relogement des personnes expulsées et évite de créer une situation de trouble à l’ordre public plus dégradée que celle qui est constatée.
Mais je puis vous assurer que cette procédure sera bien mise en œuvre, dans les conditions que je viens de rappeler, et vous pouvez compter sur notre détermination pour la faire effectivement appliquer.

La parole est à M. Patrick Chaize, auteur de la question n° 390, adressée à M. le ministre de l’intérieur.

Ma question porte sur la procédure liée à la construction de nouvelles casernes de gendarmerie.
Selon les textes en vigueur, le processus de construction connaît différentes étapes dont la délivrance d’un agrément de la part du ministère de l’intérieur suivie de la validation du terrain, préalable indispensable pour le lancement de la conception réelle du projet avec l’établissement des plans et la réalisation des appels d’offres.
Cette validation s’inscrit dans le cadre d’une commission tripartite composée de représentants du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur, de la gendarmerie et du service de santé des armées, le SSA. Ce dernier assure sa mission au sein des armées et de la gendarmerie en vertu de l’article R. 3232–11 du code de la défense et, depuis le rattachement de la gendarmerie au ministère de l’intérieur en 2009, dans le cadre de la convention de délégation de gestion entre le ministère des armées et le ministère de l’intérieur.
Au regard de la charge de travail qui est aujourd’hui celle du SSA, force est de constater que des projets de construction de gendarmerie sont bloqués comme cela a été le cas dans l’Ain où trois dossiers sont restés plusieurs mois en instance, du fait des difficultés à réunir la commission tripartite. Cette situation a des incidences fortes en termes de budget et de visibilité, notamment pour les collectivités concernées.
Aussi, afin de ne pas stopper la réalisation de projets immobiliers dont l’importance est connue de tous pour la gendarmerie et la sécurité de nos territoires, n’y aurait-il pas lieu d’engager une réforme du processus entre les deux ministères et, dans l’attente de son aboutissement, d’adapter les moyens du SSA afin que les réunions de la commission tripartite puissent se tenir selon des délais qui soient convenables ?
Monsieur le sénateur, votre question témoigne de votre attachement à la gendarmerie et aux conditions d’exercice de ses missions ; je vous en remercie.
Sur le plan immobilier, les collectivités locales sont nombreuses à se montrer désireuses de participer à des projets immobiliers destinés aux forces de sécurité. Il faut donc améliorer le cadre permettant de conduire ces projets.
Pour répondre précisément à votre question, la procédure que vous évoquez a été abrogée en juillet dernier par la gendarmerie en raison même des difficultés que vous soulevez. Ainsi, la situation que vous évoquez pour les casernes de l’Ain est bien prise en compte et ne pose plus de difficulté.
Votre question me permet donc de souligner, à travers cet exemple, l’effort de simplification administrative mené par le ministère de l’intérieur et sur lequel il me semble utile de revenir rapidement.
Pour mémoire, dans le cadre des projets de constructions de casernes locatives, une commission mixte associant différents intervenants devait se réunir pour recueillir l’avis du service de santé des armées afin de protéger les gendarmes de tout risque sanitaire.
Toutefois, les difficultés à réunir ces commissions étaient réelles pour les raisons que vous avez invoquées et l’avancée de certains dossiers de construction de casernes s’en trouvait ralentie.
Cette procédure est désormais simplifiée puisque la nouvelle commission associera la gendarmerie et les services déconcentrés du ministère de l’intérieur. Les experts de la sûreté de la sécurité et de la santé au travail pourront veiller à ce que soient prises toutes les mesures nécessaires à la protection des militaires de la gendarmerie, mais aussi de leurs familles, des agents de l’État qui travaillent à leur côté et des citoyens qui se rendent auprès d’eux.

La parole est à M. Patrick Chaize, pour répondre à M. le secrétaire d’État, en quarante-six secondes.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie d’avoir pris en considération cette problématique qui était tout à fait réelle. J’espère que pour les prochains dossiers tout ira mieux.

La parole est à Mme Chantal Deseyne, en remplacement de Mme Brigitte Micouleau, auteur de la question n° 423, transmise à Mme la ministre des armées.

Je remplace effectivement ma collègue Brigitte Micouleau, retenue dans son département.
Madame la ministre, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, dont nous venons de commémorer le centenaire, 5 000 tonnes de nitrocellulose, un explosif produit en grande quantité sur le site de la poudrerie nationale de Toulouse, sont immergées dans quatre ballastières.
Ces lacs artificiels sont situés aux portes de Toulouse, à seulement 800 mètres de l’Oncopole, l’institut universitaire du cancer qui accueille chaque jour plusieurs milliers de patients et de personnels.
Depuis 2001 et la catastrophe de l’usine AZF, site voisin des ballastières, élus locaux et associations n’ont cessé d’alerter l’État sur cette véritable « poudrière » à ciel ouvert, tout en réclamant très clairement une dépollution des lieux.
En visite officielle à Toulouse le 13 janvier 2017, Bernard Cazeneuve, alors Premier ministre, avait fini par annoncer officiellement le déblocage de ce dossier. Il affirmait alors avoir demandé au ministère de la défense, propriétaire du site, d’engager les travaux de dépollution.
Hélas, depuis ce jour et malgré les interventions du maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, auprès du gouvernement auquel vous appartenez, c’est le statu quo complet.
Mes interrogations sont simples. Cette dépollution est-elle, oui ou non, toujours d’actualité ? Si oui, quand débutera-t-elle ? Combien de temps durera-t-elle ? Quel sera le procédé technique employé ? Combien cette opération coûtera-t-elle ?
Madame la sénatrice, vous appelez l’attention du ministère des armées sur le devenir du site des ballastières, aménagé après la Première Guerre mondiale.
Après le rachat de l’emprise par l’État à la société Grande-Paroisse, en 2004, le site des ballastières a fait l’objet d’une régularisation de son statut d’installation classée pour la protection de l’environnement, ou ICPE, afin notamment d’assurer dans les meilleures conditions la sécurité des biens et des personnes.
Les différentes mesures prescrites dans ce cadre ont été mises en œuvre et sont aujourd’hui strictement suivies par l’inspection des installations classées du contrôle général des armées.
Ce site bénéficie par ailleurs d’une situation environnementale exceptionnelle s’agissant de la biodiversité.
D’une part, il abrite plusieurs espèces de la faune et de la flore protégées par la France et l’Union européenne. Un arrêté préfectoral de protection du biotope a été pris. Le site a fait l’objet d’une désignation en zone spéciale de conservation au titre de la directive Habitats de Natura 2000 et en zone humide au sens de l’article L. 211–1 du code de l’environnement.
D’autre part, la partie sud du site est une zone de protection spéciale au titre de la directive Oiseaux de Natura 2000. Elle jouxte, de surcroît, une zone concernée par un arrêté préfectoral protégeant les poissons migrateurs.
Pour ces différentes raisons, ce site est strictement et durablement fermé au public, comme le souhaite la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie Midi-Pyrénées. Il s’agit d’un site Natura 2000 exceptionnel, notamment en termes de biodiversité, qui se situe par ailleurs en zone inondable.
L’ensemble de ces éléments rend plus complexe toute opération de dépollution et de réhabilitation, dont la mise en œuvre elle-même pourrait porter atteinte à la flore et la faune qui s’y sont développées.
Le ministère des armées reste naturellement particulièrement attentif à l’adoption et au suivi des mesures les plus appropriées pour la gestion du site des ballastières dans les meilleures conditions de sécurité. Soyez-en assurée.

La parole est à Mme Chantal Deseyne, pour répondre à Mme la ministre, en quarante-huit secondes.

Madame la ministre, ma collègue Brigitte Micouleau lira avec attention votre réponse. Certes, le site est classé Natura 2000 – comme vous, j’accorde une importance particulière à la protection de l’environnement. Néanmoins, l’enjeu sanitaire est également bien réel. Il s’agit d’une priorité pour la ville de Toulouse.

La parole est à Mme Laurence Rossignol, auteur de la question n° 460, adressée à Mme la ministre du travail.

Ma question, madame la ministre, porte sur un segment un peu court et concerne les conséquences des mesures prises par votre collègue ministre des solidarités et de la santé, sur l’obligation vaccinale. Je précise bien sûr en préalable que j’apporte tout mon soutien aux mesures décidées par Mme Buzyn pour renforcer le caractère obligatoire des vaccins, en particulier sur les enfants.
Les enfants qui ne satisfont pas aux obligations vaccinales ne pourront plus être accueillis chez les assistantes maternelles au-delà de trois mois. Les parents ont donc trois mois pour mettre leur enfant en conformité avec ces obligations. Au-delà, si ces obligations ne sont pas satisfaites, l’assistante maternelle ne pourra plus accueillir l’enfant. Il s’agira alors d’une démission puisque les assistantes maternelles sont les employées des parents. En l’état des textes, cette démission n’ouvrira aucun droit au chômage pour l’assistante maternelle démissionnaire, alors que cette démission est imposée par la loi.
Voilà pourquoi je vous propose de considérer cette démission comme une démission légitime, ce qui ouvre droit à l’allocation de retour à l’emploi. Pour ce faire, il suffirait de créer une nouvelle catégorie de démission légitime ouverte aux assistantes maternelles pour non-respect de la part des parents de l’obligation vaccinale.
La question que vous soulevez est légitime même si je tiens à rappeler que les situations que vous évoquez restent très minoritaires et qu’elles pourront être en grande partie évitées à l’avenir grâce au contrôle préalable du respect des nouvelles obligations vaccinales.
Les règles de l’assurance chômage permettent déjà, pour partie, de répondre aux situations d’indemnisation de chômage des assistantes maternelles qui seraient confrontées à la situation que vous décrivez.
Ainsi, l’assistante maternelle a la faculté de prendre acte de la rupture du contrat en raison des faits qu’elle reproche à l’employeur, en l’occurrence de ne pas se conformer au calendrier vaccinal exigé par la loi.
Si le juge des prud’hommes confère ensuite à la rupture les effets d’un licenciement, l’assistante maternelle pourra s’ouvrir des droits au chômage. Dans le cas contraire, cette rupture aura les effets d’une démission n’ouvrant pas de droits. C’est la difficulté que vous soulevez. Pour autant, l’assistante maternelle pourra alors solliciter un réexamen de sa situation au terme d’un délai de cent vingt et un jours.
Le cadre juridique, même s’il n’est pas idéal, existe donc bel et bien. La création d’un nouveau cas de démission légitime, comme vous le proposez, relève de la compétence des partenaires sociaux, qui pourront, s’ils le souhaitent, se saisir de votre proposition dans le cadre des négociations en cours. Le Gouvernement leur transmettra bien sûr cette demande, sur laquelle ils auront à statuer.
Par ailleurs, le Gouvernement est mobilisé pour accompagner les assistantes maternelles qui sont confrontées à ces difficultés, notamment en assurant leur orientation vers les acteurs pertinents pour garantir une meilleure sensibilisation des parents, en particulier les relais assistantes maternelles et les services de protection maternelle et infantile.
Vous l’admettrez avec moi, le mieux est d’éviter de se trouver dans cette situation. Il s’agit donc de prévenir, afin que les parents remplissent leurs obligations avant ou au moment de confier leur enfant à l’assistante maternelle.

La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour répondre à Mme la ministre, en un peu plus d’une minute.

En effet, les assistantes maternelles peuvent contribuer à sensibiliser les parents sur le respect de l’obligation vaccinale, et c’est une bonne chose. Mais nous savons aussi que, s’agissant des vaccins, certains parents sont des militants. Les assistantes maternelles qui m’ont saisie de ce cas, de cette petite niche, avaient donc déjà rencontré cette difficulté.
Nous pouvons tomber d’accord sur le fait qu’il faut éviter d’engorger les prud’hommes. Moins souvent les gens sont contraints de saisir ces tribunaux, mieux c’est, car il s’agit de procédures lourdes, qui prennent du temps et sont relativement compliquées.
Vous dites qu’une telle mesure relève des partenaires sociaux. Certes, mais le Gouvernement peut également leur signaler des questions nouvelles. En outre, il ne me semble pas que cette mesure aurait une très grande incidence financière.
Vous l’avez relevé, ces cas seront probablement assez marginaux. Mais, vous le savez, ce sont les dossiers marginaux qui rendent les gens amers, car ils ont l’impression d’être abandonnés et victimes de décisions auxquelles, pourtant, ils adhèrent. Les assistantes maternelles qui m’ont saisie m’ont ainsi fait savoir qu’elles soutenaient absolument le respect de l’obligation vaccinale par les parents. Pour autant, il serait bon de faciliter leurs démarches dans toute la mesure du possible dans l’hypothèse où cette situation se présenterait.
Je leur transmettrai la réponse que vous m’avez faite ce matin, madame la ministre.

La parole est à M. Patrice Joly, auteur de la question n° 513, adressée à Mme la ministre du travail.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, l’AFPA, a annoncé la suppression de plus de 1 500 postes et la menace de fermeture de 38 sites, dont le centre de Nevers, dans le cadre de son plan de restructuration 2019–2020.
Depuis plusieurs années, l’AFPA fait face à des difficultés structurelles résultant d’une profonde évolution de son modèle économique à laquelle elle avait été insuffisamment préparée et accompagnée. Certes, la perte d’exploitation est encore de l’ordre de 70 millions d’euros cette année, mais en réduction significative par rapport aux années précédentes.
Cette situation est d’abord due à la décentralisation, et surtout à une concurrence sauvage via des appels d’offres menée depuis six ans. L’AFPA a ainsi perdu 20 % de ses heures de formation.
Face à une situation critique, en 2012, un premier plan de redressement de l’AFPA avait été élaboré, comprenant un engagement de l’État, à la fois, pour la poursuite de ses activités et pour sa restructuration.
Sur le territoire nivernais, l’AFPA occupe une fonction essentielle en proposant des formations en rapport avec les caractéristiques économiques du territoire. Il s’agit de formations liées, d’une part, à la transformation d’une ressource importante du département, le bois – charpente, menuiserie, etc. –, et, d’autre part, à la mécanique ainsi qu’à la métallurgie avec des formations de soudeurs, de réparation-moteur, de machinisme agricole…
Ces formations nécessitent un plateau technique lourd, ce qui explique que le coût de ces formations soit difficilement couvert par les prix demandés.
Les témoignages sont nombreux pour souligner que l’AFPA est une chance, notamment pour les personnes éloignées du marché du travail qui reprennent ainsi pied et construisent un parcours de réinsertion.
Cette suppression impacterait une large zone de recrutement s’étendant non seulement à la Nièvre mais également à l’Allier et au Cher. Vous comprendrez aisément qu’elle provoque de nombreuses incompréhensions et craintes. Ainsi, pour le seul centre de Nevers, ce sont 17 contrats à durée indéterminée qui sont menacés de suppression.
La fermeture de l’AFPA Nevers est donc sans conteste un nouveau coup dur pour notre territoire rural, qui voit chaque jour la fermeture des services publics et assiste impuissant à un démantèlement par l’État de son maillage territorial.
C’est pourquoi tous les élus du territoire, le conseil départemental en tête, vous demandent la mise en place d’une concertation avec tous les acteurs – élus, chambres de commerce, des métiers et de l’artisanat… – pour envisager de pérenniser cette structure essentielle à la formation professionnelle et aux demandeurs d’emploi de la zone concernée. Une structure dans laquelle l’État, je vous le rappelle, doit assumer toute sa responsabilité puisqu’il représente la moitié de son conseil d’administration.
Monsieur le sénateur Patrice Joly, la situation de l’AFPA est celle d’un opérateur historique du service public de l’emploi dont le modèle économique et les missions n’ont pas été fortement repensés depuis la décentralisation de la formation professionnelle en 2004 et l’ouverture à la concurrence en 2008, laquelle a profondément modifié la situation de l’AFPA.
Vous l’avez rappelé, la décentralisation et l’ouverture à la concurrence par appels d’offres de la part des régions a entraîné pour l’AFPA, sur le plan national, une perte d’environ 20 % de recettes et d’heures de formation chaque année. Or c’est le droit des régions de procéder de cette façon.
Nous sommes donc obligés de tirer les conséquences d’une absence d’anticipation et de résolution des précédents gouvernements qui, depuis dix ans, se sont refusé à prendre les mesures nécessaires pour sauver l’AFPA, mais avec des missions apportant une véritable plus-value dans le paysage de la formation. Le résultat est sans appel : plus de 723 millions d’euros de pertes cumulées entre 2012 et 2016, et plus de 70 millions de pertes d’exploitation cette année.
Chaque année, les pertes d’exploitation, que l’État est obligé de combler, représentent entre 60 et 100 millions d’euros. Ainsi faut-il, pour certains sites qui n’accueillent que très peu de stagiaires, maintenir une structure qui s’avère être décourageante pour tous, y compris pour les salariés.
Ne rien faire et laisser en l’état le premier organisme public de formation professionnelle serait irresponsable. C’est pour cela que nous avons décidé de confier à l’AFPA des missions d’intérêt général, qui correspondent véritablement à une logique de service public de la formation. Je pense à la formation des réfugiés, dans le cadre du programme Hébergement Orientation Parcours vers l’emploi, dit programme HOPE, et aux préparations « compétences » dans le cadre du Plan d’investissement dans les compétences. Pour cela, un projet de plan de réorganisation, que l’État soutient, a été proposé le 18 octobre dernier par la nouvelle gouvernance de l’AFPA. Ce projet est en cours de consultation auprès des représentants des salariés au niveau tant national que local. Il y a en effet deux sujets, l’un social, l’autre territorial.
Cette consultation doit pouvoir se poursuivre jusqu’à son terme normal, en 2019, afin qu’une solution puisse être trouvée pour chacun des salariés dont le poste sera concerné par le plan de réorganisation.
Vous l’avez rappelé, environ 1 500 postes sont concernés, mais cela comprend 600 départs à la retraite. Il y aura, par ailleurs, 600 créations de postes, qui représenteront autant d’opportunités de reconversions internes.
Pour ce qui concerne le plan territorial, le modèle doit être refondé pour répondre aux besoins des bassins d’emploi, comme vous l’avez souligné.
L’AFPA n’a pas vocation à disparaître dans le Nivernais, en Bourgogne-Franche-Comté ou ailleurs. Mais là où des centres ferment, pour que l’AFPA ait un avenir, une nouvelle offre innovante et mobile doit être déployée au plus près des attentes des salariés et des demandeurs d’emploi.
Il ne s’agit pas de choisir entre le « tout AFPA » ou le « zéro AFPA ». L’Agence peut travailler en réseau et de façon mobile : voilà aussi ce qui se prépare, et c’est important si l’on veut que l’ensemble des territoires soient couverts par une offre de proximité.

Nous en avons terminé avec les réponses à des questions orales.
L’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures quarante, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Gérard Larcher.